|
V. Le XVIIIe siècle
Réceptions des princes et du roi Louis
XV.— Fête originale en 1’honneur
du duc de Bourgogne.— Les imprimeurs d’Étampes.—
La vie intellectuelle et l’Académie d’Étampes.—
Le naturaliste Guettard.— Le Bourgneuf et la vie mondaine.— Mesures d’hygiène.— La variole.— Le dernier
bourreau.— Étampes, berceau de l’aviation.
 Les dernières années du XVIIe
siècle et tout le XVIIIe siècle, jusqu’à la Révolution,
s’écouleront dans le calme pour notre ville. Elle ne traversera
plus d’épreuves tragiques, elle ne sera plus mêlée
aux grands événements du royaume. Elle ne retrouvera pas
non plus la prospérité et l’animation qu’elle a connues durant
des siècles: le siège de 1652, s’ajoutant avec toutes ses
conséquences à tant de ravages passés, fut pour elle
une atteinte dont elle ne se relèvera pas. Sa grande histoire est
terminée. Elle se débattra, avec tous ses habitants, au milieu
de difficultés financières grandissantes. Cependant, elle
vivra, dans son obscurité; elle consolidera au moins quelques-unes
de ses acquisitions et s’efforcera de réaliser quelques nouveaux
progrès, dans la mesure où le lui permettront ses faibles
ressources. Malgré les abus dont elle souffre, elle conserve un profond
attache ment pour le roi, n’attendant que de lui les réformes nécessaires.
Elle saisira toutes les occasions, petites ou grandes, de le lui marquer
et s’associera à tous les événements qui intéressent
le royaume et la couronne.
Les dernières années du XVIIe
siècle et tout le XVIIIe siècle, jusqu’à la Révolution,
s’écouleront dans le calme pour notre ville. Elle ne traversera
plus d’épreuves tragiques, elle ne sera plus mêlée
aux grands événements du royaume. Elle ne retrouvera pas
non plus la prospérité et l’animation qu’elle a connues durant
des siècles: le siège de 1652, s’ajoutant avec toutes ses
conséquences à tant de ravages passés, fut pour elle
une atteinte dont elle ne se relèvera pas. Sa grande histoire est
terminée. Elle se débattra, avec tous ses habitants, au milieu
de difficultés financières grandissantes. Cependant, elle
vivra, dans son obscurité; elle consolidera au moins quelques-unes
de ses acquisitions et s’efforcera de réaliser quelques nouveaux
progrès, dans la mesure où le lui permettront ses faibles
ressources. Malgré les abus dont elle souffre, elle conserve un profond
attache ment pour le roi, n’attendant que de lui les réformes nécessaires.
Elle saisira toutes les occasions, petites ou grandes, de le lui marquer
et s’associera à tous les événements qui intéressent
le royaume et la couronne.
Au nombre
de ces occasions, il faut compter les réceptions des membres de la
famille royale. En 1700, passe à Étampes le petit- fils de
Louis XIV, second fils du Grand Dauphin, ancien duc d’Anjour, [p.72] roi d’Espagne depuis trois
semaines sous le nom de Philippe V, par suite du testament du précédent
roi, Charles II, et de l’imprudente acceptation de Louis XIV. Le nouveau
roi, qui n’a que dix sept ans, va prendre possession de son royaume, accompagné
de son frère, le duc de Bourgogne, père de Louis XV, et d’une
escorte innombrable. Il y a quatre carrosses pour le roi et sa suite immédiate,
quatre pour le duc de Beauvilliers, son gouverneur, quatre encore pour le
maréchal de Noailles, plusieurs autres pour diverses gens de qualité
qui les avaient à eux ou les avaient loués et de nombreuses
chaises de poste. Ils arrivent à Étampes le 5 décembre
vers midi, par un beau temps très froid; le maire et les échevins
accueillent le roi à la porte de la ville, le lieutenant du bailliage
Liénart prononce une harangue flatteuse à l’excès et
trois compagnies de milice sous les armes l’accompagnent jusqu’à
l’hôtel des Trois Rois. Les officiers de ville y apportent leurs présents,
qui sont, pour une part, symboliques, mais savoureux, pour une autre: du
pain, du vin et des écrevisses, que l’on jugea «les meilleures
du monde», et les pauvres finances de la ville n’en furent pas plus
obérées. Dans la soirée, le roi et sa suite s’amusèrent
à tirer toutes sortes d’oiseaux et à mettre au net des dessins
de maisons et de châteaux qu’ils avaient ébauchés sur
la route, comme la tour de Montlhéry tandis qu’ils étaient
arrêtés par un embarras de voitures à la porte de Linas.
Les suisses de la garde, se référant à un vieil usage,
prétendirent qu’il leur était dû un minot de sel, comme
dans toute ville en possession d’un grenier à sel qui recevait le
roi. Le receveur d’Étampes ne voulut point se laisser faire et porta
la contestation devant Philippe V, qui lui donna raison, du fait qu’il était
un roi étranger et non le roi: cette décision fort juste fut
très bien accueillie par ceux de notre ville. Le lendemain matin,
après la messe, le nombreux cortège reprit sa route vers l’Espagne.
En 1705,
une fête fut organisée par les chevaliers de l’arquebuse d’Étampes
pour célébrer la conquête du Piémont et les victoires
que Louis-Joseph de Vendôme, duc d’Étampes, venait de remporter
sur le prince Eugène. Ils tirèrent le canon, puis, un feu
d’artifice, rue des Cordeliers, devant l’hôtel de Vendôme, où
l’on avait préparé un «souper magnifique», qui
fut suivi d’un grand bal. Ce duc d’Etampes était connu pour sa bonté
et sa familiarité avec ses soldats, dont il était fort aimé.
Le chevalier de Quincy, qui servait sous lui dans sa campagne du Piémont
précisément, cite dans ses Mémoires cette jolie anecdote:
«Un jour que j’étais avec lui (pour visiter les tranchées),
un grenadier lui dit: “Monseigneur, donnez-moi une prise de votre tabac,
on dit que vous en avez toujours d’excellent”. — “Tiens, prends, mon camarade,
lui répondit le prince. — “Non, mon général, lui répliqua
le grenadier, j’aime mieux que vous m’en donniez vous-même; la raison
en est simple: vous m’en donnerez [p.73] davantage”.
Alors, M. de Vendôme lui versa toute sa tabatière».
Il mourut en 1712, en Catalogne, «d’une indigestion de poisson»,
bien qu’il y fût pour combattre les ennemis de Philippe V, qui lui
dut entièrement le maintien de sa couronne. Un service funèbre
fut alors célébré solennellement à Étampes,
en son honneur, à Notre-Dame.
En 1721,
la misère s’est encore étendue. Le système de Law a
ruiné d’innombrables gens, s’il en a enrichi d’autres. Le Régent
sou lève l’indignation. Au milieu de ces troubles et de ces inquiétudes,
toutes les espérances se portent vers le jeune roi, Louis XV. Or.
à la fin de juillet, il tombe gravement malade, d’un mal qui reste
indéterminé. En quelques jours, il est hors de danger et c’est
alors dans tout Paris et dans tout le royaume une explosion de joie, qui
donne la me sure des sentiments qu’il inspirait à son peuple. Pendant
des semaines, se poursuivent des actions de grâce et des Te Deum, des
feux d’artifice, des illuminations, des chants, des cavalcades, des fêtes
bourgeoises et populaires. A Étampes, c’est le 24 et 25 août
qu’ont lieu ces réjouissances, à Notre-Dame, à Saint-Basile
et dans la rue de la Juiverie. Si nous n’en avons pas le détail, nous
avons du moins ce lui de la réception qui fut faite, l’année
suivante, à la petite infante Marie-Anne-Victoire, que doit épouser
Louis XV. Elle n’a que cinq ans et elle vient de traverser toute la France
en carrosse, quand elle arrive à Étampes, le 27 février.
Le maire et les échevins se sont multipliés. Depuis huit
jours, ils ont arrêté un programme minutieux. Le matin du
27, dès sept heures, les officiers de la bourgeoisie et les habitants
«des mieux faits, habillés et équipés le plus
uniformément possible, au nombre de 600, se rassemblent devant l’Hôtel
de ville, puis, se rendent au son des fifres, tambours et trompettes à
l’hôtel des Trois Rois, où l’intendant de Paris, arrivé
la veille, les passe en revue et leur assigne leurs postes. Vers midi,
ils se rangent sur deux rangs depuis l’hôtel jusqu’à l’Ecce
homo, tandis que le maire et les échevins, avec tous les anciens
échevins et officiers, en robe, manteau et rabat, vont attendre à
la première porte de la ville du côté de Saint Martin.
Les rues sont sablées et la porte décorée de lierre
et de couronnes. L’infante arrive à trois heures. Le maire, Gabriel
Pichonnat, fait une petite harangue à «l’infante-reine pour
ainsi dire encore au berceau». Puis, le corps de ville suit le carrosse
jusqu’aux Trois Rois, où, présenté à l’infante,
dans son appartement, par le maître des cérémonies, il
lui offre le présent de la ville: contenue dans une manne (l’osier,
portée par quatre gardes, c’est toute une pâtisserie en pyramide,
surmontée d’une couronne aux armes de France et d’Espagne en peinture
dorée, autour de laquelle on a réuni des gâteaux, des
confitures sèches et liquides, du cotignac, des massepains, des dragées,
des oranges, des citrons, des fruits de toute espèce et des liqueurs
de toutes façons, «le tout bien arrangé et venant de
Paris», et séparément, des truites, des brochets et des
écrevisses. La petite infante [p.74]
parut satisfaite, mais elle voulut passer à son
bras la couronne et la laissa tomber, si bien qu’elle se brisa en plusieurs
morceaux. Fâcheux présage La petite Marie-Anne-Victoire, après
cinq années mélancoliques passées au Louvre dans le pavillon
du jardin de l’Infante, retourna en Espagne et ne fut, en effet, jamais
reine de France.
La municipalité
revint alors à l’Hôtel de ville «où elle fit une
collation médiocre». Elle eût mérité mieux,
en vérité, mais il fallait tout prévoir, afin que l’ordre
ne cessât pas de régner pendant toute la nuit, où de
grandes réjouissances devaient avoir lieu. Le lendemain matin, la
petite infante partait pour Paris, saluée à la porte Saint-Jacques
par tout le corps de ville.
En 1745,
c’est le roi lui-même qui vient à Étampes, avec le
dauphin, âgé de seize ans, pour y recevoir une autre infante,
Marie Thérèse-Antoinette, la fille de Philippe V, qui sera
dauphine pendant un an seulement, emportée dès ses première
couches. Cette réception fut pour notre ville une lourde tâche,
dont elle s’acquitta digne ment et avec une ardeur émouvante. On disposa
pour le roi la maison de M. Rousse de Saint-André, rue Saint-Antoine,
en face du collège des Barnabites, pour le dauphin, celle de M. Lepetit,
près du Moulin Sablon, et pour l’infante, la maison Hémard
de Danjouan, rue de la Juiverie. Louis XV avait été précédé
de nombreux gardes de la maré chaussée, de 400 gardes françaises
et de 400 suisses et il amenait avec lui, outre les princes du sang, une
partie de la cour, tous ses ministres, les grands officiers de la couronne
et un gros détachement militaire de sa maison. Malgré cette
extraordinaire affluence de personnes, non seulement aucun accident, ni
aucun désordre ne se produisit, mais encore rien ne manqua, ni en
provisions de bouche, ni en logement, ni en moyens de transport; tout avait
été prévu, même au delà du nécessaire
«Étampes pendant ces beaux jours-là était devenue
Paris».
Louis
XV arriva le 20 février. La milice bourgeoise, toujours composée
de 600 hommes, était venue au-devant de lui jusqu’aux Capucins et
formait la haie sur la route. Il entra par la porte Évezard, qui était
décorée d’un arc de triomphe, et fut conduit par un immense
cortège jusqu’à son logis; il y dîna, avec quelques privilégiés
seulement, puisque la table n’était que de dix-huit couverts. Après
le dîner, le roi joua au passe-dix, jeu de dés avec une banque,
et gros jeu, puisque le duc de Richelieu y aurait gagné 1.800 louis,
ce qui représente plusieurs centaines de mille francs de notre monnaie.
Les principaux habitants d’Étampes avaient été admis
au jeu du roi, c’est-à-dire à le voir, et non à y participer,
ce dont ils purent se divertir sans péril pour leur bourse. Pendant
ce temps, la ville s’illuminait. On avait installé, entre le logis
du roi et celui du dauphin, trente caisses, ornées de girandoles
et des chiffres royaux, qui portaient chacune 250 lampions. Le lendemain
soir, la dauphine étant arrivée, les illuminations furent
encore plus nombreuses: soixante-dix caisses semblables [p.75] étaient disposées
rue Saint-Antoine et rue de la Juiverie, jus qu’à la maison Hémard
de Danjouan. L’Hôtel de ville et les jardins des trois logis royaux
étaient aussi brillamment éclairés. Il y eut ainsi
22.000 lampions allumés pendant toute la nuit. Le lendemain 21février,
Louis XV et le dauphin allèrent jusqu’à Mondésir, qui
était la première poste au delà d’Étampes, pour
recevoir l’infante. A son arrivée, elle descendit de carrosse et
vint s’agenouiller devant le roi, sur le tapis qui couvrait la route. Louis
XV la releva, l’embrassa et lui présenta le dauphin, qui l’embrassa
à son tour. Un mémorialiste de la cour nous apprend qu’elle
n’était ni grande, ni petite, mais bien faite et d’allure noble,
pâle et extrêmement blonde, jusqu’aux sourcils mêmes;
ses yeux étaient vifs, mais ce qui la déparait «le
plus», c’était son nez, grand, peu agréable, et paraissant
«tenir à son front sans qu’il ait ce qui s’appelle la racine
du nez». Cependant, le dauphin parut content, en dépit du
nez de sa fiancée, qui était d’ailleurs un héritage
des Bourbon. Revenus à Étampes par le faubourg Saint-Martin,
au milieu des soldats et de tout un peuple enthousiaste, les princes restèrent
jusqu’au lendemain. Le roi joua tout l’après-midi au lansquenet,
jeu de cartes avec banque, qui avait été interdit par Louis
XIV, mais qui, par réaction, était fort en faveur à
la cour de Louis XV. L’infante n’y prit point de plaisir, elle n’aimait
pas le lansquenet et pas davantage le cavagnole, sorte de loto, qu’on lui
avait fait jouer auparavant, pour lequel les vers de Voltaire lui donnent
raison:
On croirait que
le jeu console,
Mais l’ennui vient à pas comptés
A la table d’un cavagnole
S’asseoir entre deux majestés.
Ainsi
la dauphine commençait à connaître l’ennui, dès
son passage dans notre ville, alors que tant de choses y eussent été
susceptibles de la divertir si elle n’avait été une pauvre
petite princesse, prisonnière de l’étiquette et des préjugés.
Le lendemain,
les princes entendirent la messe à Saint-Basile, pour laquelle le
curé reçut un demi-écu d’or, et quittèrent Étampes
par la porte Saint-Jacques.
Les
frais de cette luxueuse réception furent évidemment considérables
pour les ressources toujours précaires de notre ville. Les illuminations
coûtèrent à elles seules 4. 500 livres. Mais la municipalité,
se montrant digne et soucieuse de marquer son attachement au roi, estima
«qu’on ne pouvait moins faire en cette occasion».
Quelques
années plus tard, elle manifesta ces mêmes sentiments sous
une forme nouvelle qui révèle beaucoup de sagesse et de discernement.
Ce fut pour fêter la naissance du duc de Bourgogne, le premier fils
du dauphin qui avait été reçu à Étampes
avec Louis XV en 1745 et qui, devenu veuf, s’était remarié
avec Marie-Josèphe de [p.76] Saxe.
Au lieu d’organiser à cette occasion des réjouissances d’un
jour, coûteuses et dont il ne reste rien, le corps de ville eut l’idée
de témoigner sa joie de l’événement en consacrant une
somme de 1.550 livres, sur les deniers d’octrois, à doter et à
marier une fille de chacune des cinq paroisses. Les cinq mariages eurent
lieu le 8 février 1752 à l’église Saint-Basile, «parée
et lavée», en présence du maire, des échevins
et des officiers de ville. Chacun des mariés reçut un cierge,
une pièce de douze sols pour l’offrande, une paire de gants et un
anneau d’argent. Après le mariage, ils furent conduits à
l’Hôtel de ville, précédés des violons et des
tambours, où la dot de 250 livres fut remise à chaque ménage.
En outre, un festin y fut offert à tous les mariés et à
leurs parents, au nombre de trente personnes, et servi par les deux bedeaux
de ville et les quatre hallebardiers, «revêtus de leurs robes
et habits». On voit que la municipalité avait fait largement
les choses.
A côté
de ces fêtes pittoresques, le XVIIIe siècle apporte à
notre ville des formes d’activité nouvelles. L’une des plus intéressantes
concerne l’imprimerie. Malgré son importance réduite et sa
proximité de Paris, Étampes vit s’établir un imprimeur
dans ses murs, non pas seulement à la Révolution, comme il
a été dit et répété à tort, mais
dès 1709. C’était un nommé Jean Borde, issu d’une famille
d’imprimeurs d’Orléans, né dans cette ville en 1682, qui avait
appris son art, d’abord, dans l’atelier de son père, puis, à
Paris dans d’excellentes maisons, entre autres chez le célèbre
Coignard, où il avait gagné l’estime de ses maîtres
et «avait acquis les connaissances nécessaires pour s’acquitter
de sa profession avec honneur». Depuis le milieu du XVIIe siècle,
l’exercice de cette profession était réglementé en
1704, un arrêt avait fixé le nombre d’imprimeurs dans chaque
ville et l’on ne pouvait installer d’imprimeries nouvelles sans une décision
du Conseil d’État; en outre, le candidat devait passer un examen
qui exigeait une culture approfondie. Jean Borde avait satisfait à
ces épreuves, «expliqué des vers latins et lu des vers
grecs». 11 ouvrit donc en 1709 une imprimerie à Étampes,
où il réédita (la première édition est
jusqu’ici inconnue, mais peut-être fut-elle faite déjà
à Étampes la même année) un petit ouvrage connu
aujourd’hui par un seul exemplaire, qui n’existe même pas à
la Bibliothèque nationale. Il contient l’Office du Saint Sacrement
comme il se dit dans les paroisses et environs d’Étampes et la Vie
et les miracles des saints Can, Cancien et Cancienne, les patrons d’Étampes.
On ne connaît pas d’autres publications de l’imprimerie étampoise,
mais il y en eut certainement, malgré son existence éphémère,
puisque dès 1712, Jean Borde quittait notre ville pour s’installer
à Orléans, où il mourut presque aussitôt. En
1719, le maire, les échevins et les officiers de ville adressent
une requête au Conseil d’État afin d’obtenir le rétablissement
de l’imprimerie locale, «pour le bien et l’utilité de [p.77] la ville, attendu qu’il s’y
présente journellement assez d’ouvrages utiles au public pour qu’un
imprimeur puisse s’y établir et y exercer avec succès».
Il y avait deux candidats Michel Carlu, compagnon imprimeur à Paris,
qui avait fourni les preuves de sa capacité, fut agréé
et demeura sans doute l’imprimeur d’Étampes de 1720 à 1734,
puisqu’on sait que la seconde imprimerie subsista pendant ces quatorze années.
Mais on ne connaît pas de pièce éditée qui porte
son nom. Peut-être est-ce lui qui publia, vers 1722, le poème
bien connu des Étampois, Le chien pêcheur, en vers
latins et français, de Claude Charles Hémard de Danjouan, petit-fils
du maire René Hémard, dont on ignore l’éditeur original.
Le chien des Cordeliers d’Étampes, qui en est le héros, a-t-il
vraiment existé et recueilli des écrevisses parce qu’elles
s’attachaient à ses longs poils? C’est peu probable, d’autant moins
qu’un auteur normand du XVIe siècle, Philippe Le Picard, a conté
une histoire tout à fait analogue. Mais la légende était
sans doute répandue dans Étampes. Si elle a inspiré
à Charles Hémard d’assez bons vers latins, ses vers français
sont malheureusement bien dénués de poésie et tantôt
plats, tantôt d’une pesante emphase, qui répond mal au pittoresque
du sujet. Charles Hémard n’était pas cependant un esprit ordinaire.
Il faisait partie du petit groupe de lettrés et de savants étampois
dont nous parlerons plus loin.
Depuis 1734, il n’y avait plus d’imprimeurs à Étampes, à
cause du décès ou du départ de Michel Carlu à
cette date, et parce qu’ensuite, il ne s’était présenté
personne pour lui succéder. Mais en 1757, François Izenard,
originaire de Poitiers, qui avait fait son apprentissage d’imprimeur chez
son oncle dans cette ville, ouvre une librairie à Étampes et
bientôt se rend compte «que non seulement il y pourrait subsister
avec une imprimerie, mais encore qu’elle y était nécessaire».
Il sollicite donc et obtient le 8 février 1759 de Louis-Philippe,
duc d’Orléans et d’Étampes, l’autorisation d’établir
une imprimerie et de s’intituler «son imprimeur en la ville d’Étampes».
Mais à peine né, son atelier était interdit par un arrêt
du Conseil, qui supprimait les imprimeries dans un certain nombre d’autres
petites villes où l’autorité n’admettait pas leur utilité.
Cependant, Izenard demeura libraire à Étampes, en exerçant
aussi l’art du relieur: l’église de Congervil le possédait
encore, il y a quelques années, un missel et un graduel reliés
par lui, comme en faisait foi la signature. Il fit deux tentatives, en 1765
et en 1778, pour obtenir du Conseil le rétablissement de son atelier
typographique, mais elles restèrent inutiles. En 1780, le maire
et les échevins adressèrent la même requête en
sa faveur à l’intendant, toujours en vain. C’est seulement en 1790
que s’ouvrira, sous la direction de Claude Dupré, une nouvelle imprimerie,
à laquelle les événements révolutionnaires donnèrent
beaucoup d’activité et dont nous parlerons en son temps. [p.78]
L’existence
d’une imprimerie à Étampes dès 1709 et les raisons
qui furent invoquées avec insistance pour son rétablissement
chaque fois qu’elle fut supprimée montrent déjà que
notre ville était alors animée d’un certain mouvement intellectuel.
On sait par ailleurs qu’elle comptait, en effet, tout un groupe de gens fort
instruits dans les matières les plus diverses, qui se réunissaient
chez M. Geoffroy (peut-être le grand’père de Geoffroy-Saint-Hilaire):
Pichonnat, médecin, dissertait sur l’anatomie, Claude-Charles Hémard,
l’abbé Lemaître, curé de Notre-Dame, Michel Godeau, recteur
de l’université de Paris, né à Étampes et toujours
en relations avec ses compatriotes, représentaient les belles-lettres
et Descurain, maître apothicaire et botaniste, s’intéressait
à toute l’histoire naturelle. Il y eut là, pendant de nombreuses
années, une manière de petite Académie, dont tous les
membres étaient entourés de respect et d’admiration et ce n’est
pas à cette époque qu’un Labiche eût pu ridiculiser l’Académie
d’Étampes. Le grand naturaliste Guettard, petit-fils de Descurain,
qui fut élevé dans ce milieu et nous l’a fait connaître,
atteste que les travaux de ces excellents observateurs « les avaient
rendus dignes de la plus célèbre Académie». Descurain
était l’âme de ce petit groupe.
La botanique
surtout le passionnait. Il avait constitué un jardin d’expériences,
où il réunissait les plantes singulières de la région
et des plantes étrangères que lui procuraient ses correspondants,
en particulier les Jussieu, professeurs au Jardin du roi, devenu aujourd’hui
le Muséum d’histoire naturelle. En outre, il avait rédigé
un ensemble d’obersations sur les plantes locales, que publia, en 1747,
son petit-fils Guettard, en y ajoutant un travail personnel, sous le titre
Observations sur les plantes. Nous voyons ainsi
que la répartition des cultures a peu varié depuis cette époque,
sauf en ce qui concerne la vigne, très abondante alors, et que la
flore indigène ne s’est guère modifiée non plus. Nous
avons eu la bonne fortune de retrouver deux plantes rares dans les stations
mêmes signalées par Descurain, l’Aristoloche «dans le
cimetière Saint-Germain», aujourd’hui le cimetière de
Morigny, et l’Asarum europaeum, plante extrêmement rare aux
environs de Paris, qui continuait de fleurir depuis le début du XVIIIe
siècle dans le bois du Chesnay, au-dessus de Brières, tandis
que tant de choses ont disparu à jamais. L’autorité de Descurain
auprès de ses compatriotes était grande. Il avait fait des
études de médecine à Paris, sans avoir eu le temps de
les achever, ce qui lui permit, cependant, de soigner beaucoup de malades
à Étampes et même aux environs c’est ainsi qu’il herborisait
dans toute la campagne. Et lorsque survint une aurore boréale, le 19
octobre 1726, l’effroi fut si vif qu’on fit aussitôt demander à
Descurain ce qu’il pensait de cette troublante apparition. II assura qu’il
n’y avait rien à craindre et «l’on se crut en sûreté,
puisque Monsieur Descurain pensait y être».
Le plus
grand mérite de Descurain fut peut-être de déterminer [p.79] l’orientation de son
petit-fils vers les sciences naturelles. En effet, si Guettard est assez
peu connu du grand public, il est pourtant une des gloires de notre ville.
Dirigé d’abord vers la médecine par Bernard de Jussieu, l’ami
de son grand’père, il étendit ses travaux à toutes
les branches de l’histoire naturelle, botanique, zoologie, minéralogie,
paléontologie et dès l’âge de vingt-huit ans, il entrait
à l’Académie des Sciences. On lui doit de nombreuses découvertes;
la plus importante est celle des volcans éteints d’Auvergne, dont
il reconnut le premier la nature. Mais nous ne saurions omettre qu’il fut
aussi le premier à signaler la présence d’ossements fossiles
d’une faune froide (Renne et Mammouth) aux portes mêmes d’Étampes,
au-dessus de la maladrerie Saint-Lazare.
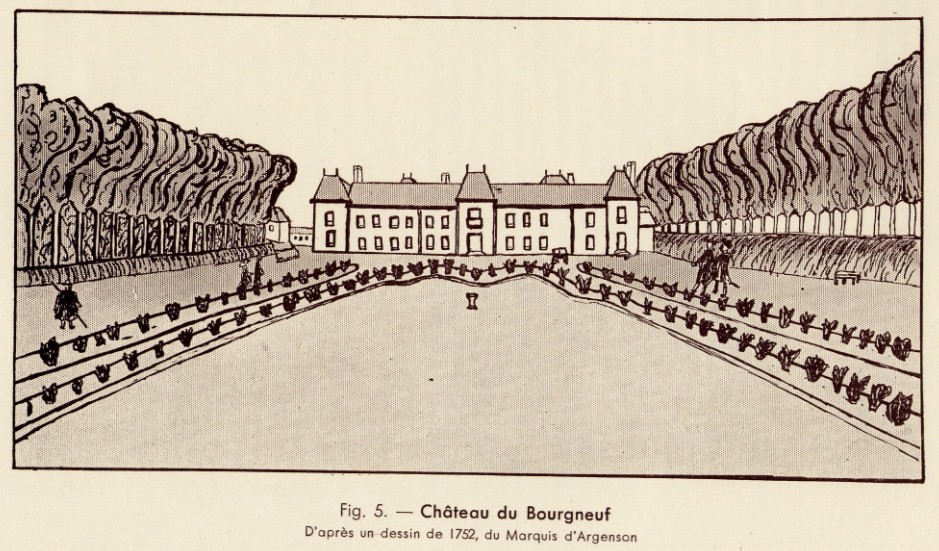
Pendant une partie du XVIIIe siècle, un faubourg de notre ville connut
une animation d’un autre ordre. C’est Saint-Pierre, qui depuis longtemps
déjà constituait une sorte de petite ville un peu à
l’écart de l’autre, avec son église, son prieuré, sa
chapelle Saint-Symphorien, son hôpital de Buval, ses écoles
et enfin, son château du Bourgneuf. Le fief du Bourgneuf et son château
existaient dès le XVIe siècle et ils avaient appartenu par
acquisitions successives à Claude de l’Isle, seigneur du Grand-Boinville,
à François Roiger, seigneur de Mauchesne, à Bénigne
Le Ragois, seigneur de Guignonville, à Nicolas de Cœurs, et enfin à
Alphonse-Germain de Guérin, seigneur de Moulineuf, qui l’acheta en
1710. Ce dernier eût été, contrairement à ses prédécesseurs,
en état de conserver ce lourd domaine par le riche mariage qu’il avait
fait en épousant Henriette-Françoise Le Camus, fille du trésorier
général des états de Courtrai, mais il fut tué
dès 1713 au siège de Fribourg-en-Brisgau. Sa veuve épousa
en 1721 Louis-Guy-Henri de Valori, qui devint ainsi seigneur du Bourgneuf
et le resta jusqu’à sa mort, en 1774, après avoir apporté
dans sa de meure et le petit bourg environnant une vie toute nouvelle. En
effet, le marquis de Valori, allié aux plus vieilles maisons de France,
possesseur d’une immense fortune, qui avait fait la guerre avec Villars et
rempli des missions auprès de Frédéric II, avait des
relations innombrables. Aussi, quand il venait au Bourgneuf, il y recevait
tant de monde que la cour devenait déserte, disait-on. On y jouait
la comédie et les réceptions étaient fastueuses. Voltaire
y séjourna souvent et il y subit une mésaventure dont on fit
grand bruit, non seulement à Paris, mais jusqu’à Berlin: poursuivant
de ses assiduités une servante farouche du marquis de Valori, il reçut
d’elle un bon soufflet. Le château avait été agrandi
et aménagé par Valori. Il s’étendait, avec ses dépendances
et son parc, entre la rue Sadi-Carnot actuelle et la rue de l’Alun. Il comprenait
aussi «l’auditoire» du bailli, avant même que le marquis
de Valori fût nommé gouverneur et bailli d’Étampes, en
1767. 11 mourut en 1774, à quatre-vingt-deux ans, et fut inhumé
dans l’église Saint-Pierre. Un fragment de sa pierre tombale [p.80] a été retrouvé
en 1927 lors de la démolition d’une maison de la rue Évezard,
où elle constituait une partie de cheminée: image des bouleversements
aveugles qu’accomplissent les hommes. Le petit-fils du vieux marquis de
Valori, Charles-Jean-Marie de Valori, lui succéda dans sa propriété
et dans sa charge de gouverneur et grand bailli d’Étampes, qu’il
exerça jusqu’à la Révolution. Il émigra en 1791
avec sa femme, qui était la fille de Dupleix. Ses biens furent vendus
au profit du domaine et sa belle demeure (fig. 5) fut entièrement
démolie. Quelques dépendances, comme le colombier, en subsistèrent
longtemps et c’est à notre époque même qu’on en acheva
sans scrupules la destruction. La bibliothèque, qui était
considérable, fut cependant sauvée à la Révolution
et fait partie maintenant de la bibliothèque de l’Arsenal.
Au temps
où nous parvenons, notre ville commence à perdre sa physionomie
ancienne. Les portes de son enceinte menaçaient ruine on décida
la démolition de plusieurs d’entre elles en 1771. La porte Saint-Jacques
fut abattue la première et remplacée par deux piliers à
chapiteaux. Le fossé de la fortification, en avant des murs, qui
mesurait près de vingt mètres de largeur, fut comblé
sur la moitié de sa longueur dans la direction de la rue Évezard,
avec des déblais qu’on enleva de la rue du Rempart, pour niveler
son sol, auparavant très inégal. Deux allées de tilleuls
furent plantées sur la partie du fossé comblée, tandis
que le reste fut conservé pour abriter le jeu de paume, qui était
très en faveur et se jouait jusque-là dans tout le fossé.
La porte Saint-Martin ou de la Barre, qui évoquait tant de souvenirs,
fut entièrement démolie, «jusqu’à un pied au-dessous
du sol», la même année 1772, et l’on mit à sa place
une simple barrière pour les droits d’entrée. Déjà
quelques années avant, le fossé avait été comblé
et la muraille rasée sur une douzaine de mètres en descendant
vers les Portereaux. La porte du Château ou des Lions fut remplacée
par des piliers surmontés de deux lions. Enfin, la porte Évezard
fut abattue vers 1775 et des piliers, qui furent d’abord élevés
à sa place, s’écroulèrent presque aussitôt.
C’est
aussi à cette époque, en 1774, que la foire Saint-Michel,
qui se tenait depuis le XIIe siècle près de la maladrerie
de Saint-Lazare, au lieu dit Saint-Michel, fut transférée sur
les promenades du Port, agrandies par le comblement du fossé. On sait
que le port ne fonctionnait plus depuis un siècle; les bassins avaient
été comblés et l’on y avait planté des ormes
et des tilleuls. La foire était alors très brillante, parce
que le haut commerce de la ville et des alentours y participait en même
temps que les bateleurs et les fripiers.
Des
mesures d’un autre ordre, prises soit par le lieutenant de police, soit
par le corps de ville, montrent que des conceptions nouvelles commencent
à s’imposer. Ainsi, les règlements relatifs à la propreté
des rues et même à l’hygiène sont renouvelés
en 1779. Les habitants [p.81] sont
tenus de balayer deux fois par semaine devant leurs portes «même
jusqu’à la moitié de la chaussée», d’arroser
avant, en temps de sécheresse, et de ne faire aucun amas de paille,
fumier, pierres, tuileaux ou débris de légumes dans les rues;
un entrepreneur est chargé d’enlever les tas de boue après
le balayage des habitants et de nettoyer les places publiques. Les bêtes
mortes doivent être «traînées dans les terres hors
la ville et les faubourgs, à un quart de lieue des maisons, routes
et chemins et enterrées dans des fosses profondes au moins de sept
pieds». Ces ordonnances étaient d’autant
plus justifiées que des épidémies fréquentes
désolaient la ville. En 1754, ce sont des «fièvres
putrides» difficiles à déterminer, mais en 1781, c’est
la variole, qui fauche près de deux cents enfants en trois mois.
La population, très diminuée par les suites du siège
de 1652, durant près d’un siècle, était remontée
en 1740 à 1628 feux; elle retombe, après les épidémies
de 1754, à 982 feux, mais à l’aube de la Révolution,
elle dépasse 2.000 feux, à peu près comme au milieu
du XVIIe siècle.
La sécurité
et la paix des habitants font également l’objet des soins de la police
urbaine. On interdit dans les rues les jeux dangereux, le jet des boules
de neige, les pétards et fusées, le tir de toutes armes à
feu, les charivaris, les essais de chevaux, les chiens errants. Mais l’éclairage
des rues fait totalement défaut en 1788, M. de Poilloüe de Bierville
réclame en vain l’installation de réverbères.
Cependant,
la municipalité marque son zèle à défendre les
droits de ses administrés, en particulier par un long et dispendieux
procès qu’elle entame, en 1764, contre le dernier exécuteur
des sentences criminelles du bailliage. On sait que ce titre pompeux s’appliquait
tout simplement au bourreau, mais cette dernière appellation était
considérée comme si infâmante que plusieurs arrêts
de Parlements l’avaient interdite et punissaient d’amendes ceux qui l’employaient.
Dès une haute époque et partout, des conflits s’étaient
élevés entre les habitants des villes et le bourreau, en raison
de la singulière manière dont étaient réglés
ses émoluments. En effet, d’une part, il était payé,
à des tarifs divers, pour chacune de ses interventions, qui étaient
nombreuses et variées: attacher au carcan, marquer et flétrir,
fouetter aux carrefours, percer ou couper la langue, appliquer la question,
pendre, rouer, décapiter, brûler, rompre vif et ensuite jeter
au feu, ce qui était le plus chèrement indemnisé: 50
livres au présidial de Bourges, en 1666. D’autre part, il touchait
une redevance en nature, appelée le droit de havage, qui consistait
à prendre lui-même autant que sa main pouvait contenir de céréales,
de légumes, de fruits, d’œufs, etc., mis en vente dans les marchés.
Il était accompagné d’un valet, qui marquait à la
craie le dos des marchands qui s’étaient acquittés. Cette
curieuse rétribution fut abolie à Paris en 1721; mais [p.82] elle subsistait à
Étampes, en dépit des nombreuses contestations auxquelles
elle avait déjà donné lieu au XVIe et au XVIIe siècles.
Le droit pour le bourreau de prendre à la main les denrées
du marché avait été remplacé par celui de les
mesurer au moyen d’une cuiller en fer, mais la dimension de la cuiller,
d’abord fixée, avait constamment grandi et le bourreau ainsi que
«les gens de la lie du peuple qu’il employait» ne manquaient
pas de la prendre comble, au lieu de la prendre rase, et de lui donner des
secousses pour y faire tenir plus de choses. En 1760, les abus commis par
le bourreau Desmorets causaient un si grand tort aux marchands qu’ils commençaient
à déserter le marché d’Étampes. C’est ainsi
que le maire et les échevins, s’appuyant sur le précieux mémoire
rédigé par Plisson au XVIIe siècle au sujet précisément
des droits du bourreau, portèrent l’affaire devant le Parlement, qui
donna raison à la ville, par un arrêt de 1767. Le droit de havage
était réduit à une perception fixe, en argent, qui devait
être levée aux barrières de la ville, sur les grains
et les légumes secs exclusivement. Ainsi ce vieil usage perdait enfin,
à la grande satisfaction des habitants, son caractère abusif
et si curieusement moyenâgeux. Desmorets fut le dernier bourreau d’Étampes.
Il ne devait plus d’ailleurs exercer souvent son office, puisqu’au cours
du procès, la suppression en est envisagée. Les exécutions
avaient lieu place Saint-Gilles, à l’angle de la rue Traversière,
que l’on surnommait, à cause de cela, la rue de la Femme-sans-Tête
ou Monte-à-Regret. C’est là qu’étaient placés
une potence pour les con damnations capitales et un pilori qui servait, avec
le carcan, à infliger la peine du fouet ou de l’exposition, aggravée
par l’écriteau infâmant. Ces divers supplices reprirent activement
à Étampes pendant la seconde partie de la Révolution
et dans les années suivantes, durant lesquelles les vols et les brigandages
se multiplièrent.
Notre
ville nous offre à cette époque un exemple des idées
nouvelles et originales, qui surgissaient alors dans les esprits de toutes
les classes sociales, et de la hardiesse des conceptions et des tentatives.
Un chanoine de l’église Sainte-Croix, l’abbé Desforges, annonça
dans le Mercure de France, en juillet 1772, qu’il avait trouvé
le moyen de faire voler les hommes en l’air dans un cabriolet. Il demandait
à ceux que cette invention, évidemment merveilleuse, pouvait
intéresser une somme de 100.000 livres, si son expérience réussissait,
mais qui devait être préalablement déposée chez
un notaire. La curiosité de ces choses était telle qu’il trouva
la somme auprès de plusieurs habitants de Lyon, qui la remirent effectivement
à un notaire. L’abbé Desforges avait déjà construit
sa machine: elle avait la forme d’une gondole, couverte pour mettre à
l’abri de la pluie, mesurait environ 2m. 25 sur 1m. 15, et ne pesait que
quarante-huit livres. Mais le pilote pouvait emporter, en sus de son propre
poids, une valise de quinze livres. Toute la gondole était enduite
de plumes [p.83] et surmontée,
en outre, d’un parasol de plumes. Deux rames, également à longues
plumes, maniées par le pilote, devaient assurer le maintien et la
progression dans les airs. Il paraît que la machine était, en
principe, à l’épreuve des grands vents, de la pluie, des orages
et pouvait même servir de bateau, en cas de besoin. Elle devait voler
à la vitesse de trente lieues à l’heure et pouvait faire trois
cents lieues par jour pendant quatre mois. L’abbé Desforges avait
bien prévu qu’il faudrait protéger l’homme contre la violence
de l’air et pour cela, il devait porter une grande feuille de carton sur
sa poitrine et un bonnet sur sa tête, avec des verres pour les yeux.
On ne peut nier que cette invention reposait sur une vue prophétique
de ce qui devait être réalisé dans l’avenir, mais là
se borna le mérite du pauvre chanoine puisqu’en dépit de tous
ses efforts, il ne réussit pas à s’en voler. Il avait hissé
sa machine au sommet de la tour de Guinette, au milieu d’un grand nombre de
curieux. Installé dans son cabriolet, il donna le signal du départ,
«les ailes se déployèrent et se mirent en mouvement
avec une grande vitesse», mais dès qu’on le lâcha, il
retomba à terre. Il en fut quitte pour une contusion au coude. Il
paraît que sa foi dans son invention n’en fut pas ébranlée,
mais on ne connaît pas de lui d’autres tentatives. S’il avait rencontré
en France beaucoup de railleurs ou d’indifférents, il n’en fut pas
de même à l’étranger, «où l’on s’attendait,
en plusieurs endroits, le voir arriver dans sa gondole aérienne».
Sachons-lui gré, au moins, d’avoir porté loin le nom de notre
ville, associé à l’idée d’un rêve merveilleux
et non absurde, puisqu’il devait être un jour une réalité.
Malgré son échec, Desforges n’est pas tombé dans l’oubli
et son effort permet de considérer Étampes comme un des berceaux
de l’aviation. [p.84]
|

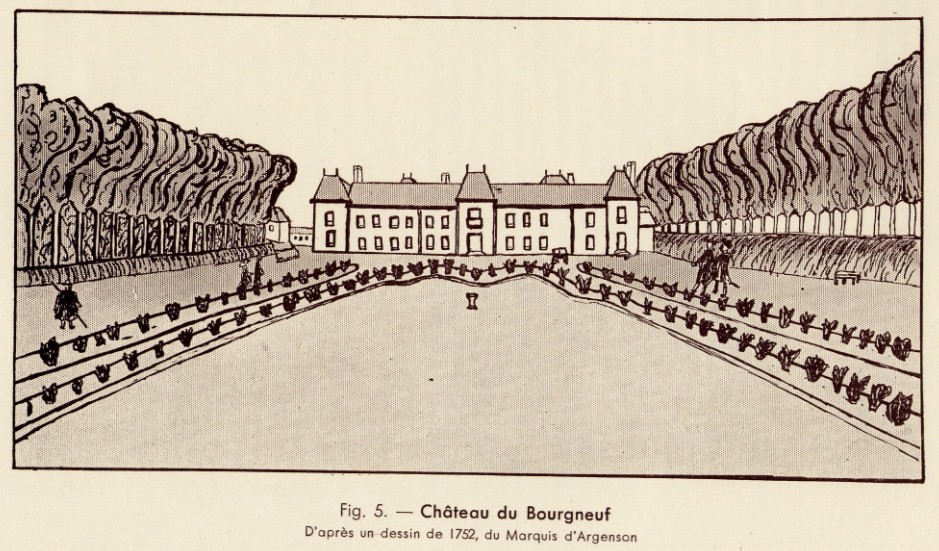

 Édition
princeps: René de
SAINT-PÉRIER, La grande histoire d’une petite
ville: Étampes [in-4° (16 cm sur 25); 143 p.; 8
gravures sur bois originales
in-texto de Jules Lepoint-Duclos;
16 planches hors-texte dont deux croquis et 14 photographies originales
de Jules Lepoint-Duclos; ouvrage
couronne par l’Institut], Étampes,
Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne (1838-1938),
1938 [AME, ADE]. Dont une réédition remaniée
posthume à partir de 1964 dans le Bulletin Municipal d’Étampes.
Édition
princeps: René de
SAINT-PÉRIER, La grande histoire d’une petite
ville: Étampes [in-4° (16 cm sur 25); 143 p.; 8
gravures sur bois originales
in-texto de Jules Lepoint-Duclos;
16 planches hors-texte dont deux croquis et 14 photographies originales
de Jules Lepoint-Duclos; ouvrage
couronne par l’Institut], Étampes,
Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne (1838-1938),
1938 [AME, ADE]. Dont une réédition remaniée
posthume à partir de 1964 dans le Bulletin Municipal d’Étampes.