Les Antiquitez
de la Ville et du Duché
d’Estampes
Paris,
Coignard, 1683
Deuxième
Partie, Chapitre XXIV,
pp. 466-470.
|
Du Hameau, & de la Chapelle
du petit saint Mard.
|
DEUXIÈME
PARTIE, CHAPITRE XXIV.
Du Hameau,
& de la Chapelle du petit saint Mard.
LE Hameau
du petit saint Mard dependant de la Paroisse de saint Martin est situé
hors de l’enceinte des vieilles Estampes, à l’entrée de la
vallée d’Ormoy. Il prend son nom de la Chapelle qui y est dediée,
sous l’invocation de saint Medard: & est dit le petit saint Mard, pour
le distinguer du grand saint Mard, village & Paroisse, que l’on nomme
communement Challou saint Mard. Il se voit une transaction de l’an MCCXIX.
passée entre Odeline une Abbesse, & les Religieuses de l’Abbaye
de saint Cyr, d’une part (c’est une Abbaye de l’Ordre de saint Benoist
auprés de la ville de Pontoise, comme je croy, n’en ayant pû
trouver d’autre;) & le Prieur, & le Curé Chevecier de saint
Martin des vieilles Estampes, d’autre; pour les oblations, qui se faisoient
aux quatre fêtes annuelles, dans la Chapelle de ce lieu du petit
saint Mard, lesquelles doivent toutes appartenir au Chapelain qui dessert
cette Chapelle, par le commandement de l’Abbesse, en payant seulement au
Prieur & au Curé vingt sols parisis tous les ans, à ces
quatre fêtes, à sçavoir six à Noël, six
à Paques, quatre à la Pentecôte, & quatre à
la Toussaints. Lesquelles sommes le Chapelain est obligé de payer
precisément aux jours nommez ou le lendemain; à peine de payer
chaque jour de delay douze deniers, par forme d’amende. Cette transaction
contient deux conditions, l’une en faveur du Prieur & du Curé,
porte qu’outre cette pension, ils auront aussi toutes les oblations qui
se feront à ces fêtes annuelles pour les mariages, par les
Pelerins, par les femmes qui releveront de couches, & pour les defunts;
& l’autre condition, qui est favorable au Chapelain, le decharge du
payement de ce qu’il doit à chaque fête que le Chevecier obligera
les habitans du petit saint Mard, d’aller à sa Paroisse, & d’y
payer les droits Curiaux & aussi en cas d’interdit general, ou special
de cette Chapelle, qui y soit mis pour quelque faute du Prieur, ou du Curé.
Quarante ans
aprés il y eut une contestation entre le Curé & le Chapelain
de cette Chapelle, qui fut reglée l’an MCCLIX. par une transaction,
confirmée par l’Archevêque de Sens, & homologuée
par son commandement dans fon Officialité, laquelle porte que les
habitans du petit saint Mard seront obligez à l’avenir, [p.467]
d’aller à la fête de Pâque à
l’Eglise de saint Martin, recevoir les Sacremens du Curé, ou de
son Vicaire, & y payer les droits Curiaux: & qu’en cette consideration
le Chapelain demeurera dechargé de trois sol parisis sur les six
qu’il est obligé de payer ce jour-là. Voicy ces deux transactions
inserées l’une dans l’autre.
|
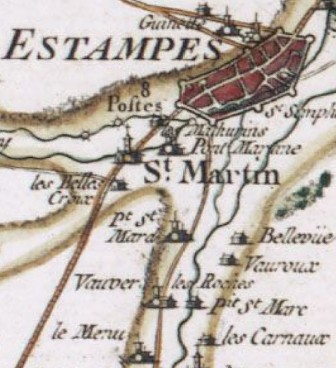
Carte de Cassini (édition de 1756), erronée
|
Omnibus præsentes Litteras inspecturis Petrus officialis
Curia Senonensis in Domino salutem: Noverint universi quòd cùm
inter Capicerium Ecclesiæ sancti Martini de Stampis veteribus, ex
una parte, & capellanum capellæ sancti Medardi, ex altera, coram
Domino Senonensi quæstio verteretur supcr hoc, quòd idem Capicerium
à Capellano prædicto sibi reddi petebat quandam annuam pensionem,
in qua dictum capellanum sibi teneri dicebat, ratione cujusdam compositionis
initæ inter prædecessores eorum, nomine dictarum Ecclesiæ
& Capellæ, secundùm quod continetur in quibus litteris
sigillis Abbatissæ sancti Cirici, & Conventus ejusdem loci sigillatis,
quorum tenor in modum qui sequitur præsentibus est insertus. Ego Odelina
sancti Cirici humilis Abbatissa, & totus ejusdem loci humilis conventus,
omnibus inposterum salutem: Noverit universitas nostra quod cum inter nos
ex una parte, & Priorem & capicerium de veteribus Stampis ex altera,
esset controversia super oblationibus quæ fiunt in Capella nostra de sancto Medardo in festis annualibus.
Tandem de bonorum & prudentum virorum consilio, composuimus in hunc
modum, Capellanus noster, qui de mandato nostro in dicta Capella ministrabit,
amodò oblationes festorum annualium in dicta Capella faciendas pacificè
percipiet, ita quòd singulis annis inposterum, reddet dictis Priori
& Capicerio viginti solidos parisiensis monetæ, scilicet in natali
Domini, sex solidos, in Pascha sex solidos, in Pentecoste quatuor solidos,
in festo omnium Sanctorum quatuor solidos: salvis tamen Priori
& Capicerio oblationibus de nuptiis, de Peregrinis, de purificationibus,
de Defunctis in prædictis festis. Quod si dictæ pensiones
singulæ in festo suo prædicto, vel in crastino festi solutæ
non fuerint, pro singulis diebus, quibus ultra terminum; pensio detinebitur,
duodecim denarios pro pœna eis restituere faciemus. Si verò Capicerius
Vet. Stamparum aliqua casu fortuito, aliquos parrochianos suos apud sanctum
Medardum commorantes, in festis annualibus ad Ecclesiam sancti Martini ire,
& Jura ibi Parrochialia reddere compellat, pensio quæ aßignata
est in festo, quo dictam Ecclesiam coacti adierint, non reddetur. Idem
erit si interdictum fuerit generale: vel si culpa Prioris vel Capicerii [p.468] dicta Capella fuerit interdicta.
Quòd ut ratum permaneat præsentem paginam in testimonium
fecimus annotari, & sigillorum nostrorum munimine roborari. Actum
anno gratiæ MCCXIX. mense Junio. Tandem mediantibus bonis viris,
dicti Capicerius & Capellanus in præsentia dicti Domini, voluerunt
& consenserunt, quod dicta compositio, accedentibus consensu &
confirmatione Domimi Senonensis rata maneret, & ab ipsis, & eorum
successoribus de cætero firmiter & inviolabiliter servaretur,
hoc excepto quod in festo Paschali, Parrochiani dicti Capicerii apud sanctum
Medardum morantes, ad dictam Ecclesiam sancti Martini venire & confiteri
peccata sua prædicto Capicerio, vel Capellano suo, & alia Sacramenta
Ecclesiastica recipere, a jura Parrochialia eidem Capicerio solvere tenebuntur:
& tres solidos quidem de pensione dicto Capicerio debita in festo Paschæ,
& secundum prædictorum continentiam litterarum. Hujusmodi verò
compositionem innovatam prout superius est expressum, Dominus Senonensis
ratam habens, auctoritate Diocesana confirmavit, & nobis viva voce
præcepit, quod super præmißis omnibus eisdem Capicerio
& Capellano, in hujus rei testimonium & munimentum concederemus
litteras sigillo Senonensis Curiæ sigillatas; quod fecimus ad mandatum
dicti Domini & partium prædictarum. Datum anno Domini MCCLIX.
die veneris post festum omnium Sanctorum.
|
Dont traduction en Annexe 1.

Saint Médard de Soissons
|
On peut inferer de la premiere de ces
transactions ce que la tradition publie, qu’il y a eu autrefois au petit
saint Mard des Religieuses, non pas qu’il y ait eu un Monastere formé;
puis qu’il n’en reste nulles vestiges: mais une de ces habitations que
l’on appelloit Granchiæ Monialium, granges ou
metairies de Religieuses, plusieurs desquelles ont cité depuis
converties en ces petits Prieurez de la Campagne que l’on voit encore aujourd’huy,
dependans des Abbayes dont les biens qui font le revenu des Prieurez,
ont esté distraits, & que la demeure de ces Religieuses étoit
dans la Tour qui y reste.
La même transaction fait connoître
que la Chapelle du petit saint Mard appartenoit à l’Abbaye de saint
Cyr, & que le Chapelain qui y residoit, pour le service des Religieuses,
dependoit entierement de l’Abbesse, qui le pouvoit changer à sa
volonté; puis qu’elle transige des droits qui luy devoient appartenir.
Ce Chapelain logeoit dans une maison située du costé de la
plaine opposée à la Chapelle, la ruë entre deux, qui
n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Il y avoit pour marque sur
la porte une Croix gravée dans une pierre. [p.469]
Et de la seconde transaction de l’an 1259.
on infere avec beaucoup de probabilité que dés-lors l’état
des choses étoit changé: que les Religieuses en avoient
esté retirées: que le Chapelain avoit esté rendu
titulaire, puis qu’il transige de soy-même sans aucune dependance
de l’Abbesse: Et qu’avant cette transaction les habitans du petit saint
Mard pouvoient satisfaire au devoir Pascal dans cette Chapelle.
Enfin il y a grande apparence que ces Religieuses
en quittant cette demeure, donnerent à cens & rente les biens
qu’elles y avoient: & qu’en même temps ou peu aprés,
elles infeoderent quelqu’une de leur censivc: & qu’ayant negligé
de se faire reconnoître, ceux qui en ont jouy, dans la suite du temps,
ont porté la foy de ce fief au Seigneur de saint Cyr, ou pour ne
sçavoir pas où est située l’Abbaye de saint Cyr: ou
pour leur plus grande commodité. Peut-être aussi, que ces Religieuses
ont dans quelque necessité de leur maison, vendu ce fief, comme leur
étant un bien peu utile, & trop éloigné.
*
* *
|
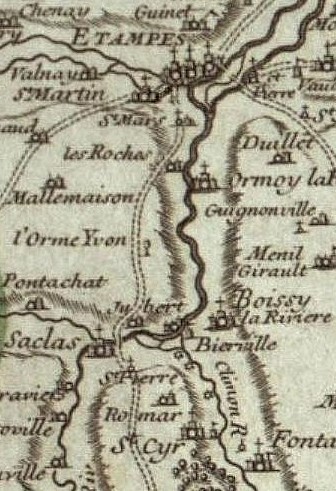
Le Petit-Saint-Mard et Saint-Cyr-la-Rivière
sur la carte de Réginald Outhier (1741)
|
Pour conclusion de cette seconde partie, je remarqueray qu’il y a eu dans
la ville d’Estampes, comme en beaucoup d’autres du Royaume, un lieu d’assemblée
de ces femmes devotes que l’on appelloit anciennement Beguines, dont
la place est encore aujourd’huy appellée le Carrefour des Beguines.
Il est situé au bout de la ruë de la Foulerie, vers saint Gilles,
& il en est fait mention dans les vieils papiers terriers de l’Abbaye
de Morigny. Ces femmes, sans renoncer au mariage, ny s’obliger par aucun
vœu, vivoient ensemble en chasteté religieuse, aussi long-temps qu’elles
vouloient: & se pouvoient retirer de la compagnie des autres sans encourir
aucun reproche. Elles étoient en si grande estime de vertu du temps
du Roy saint Loüis, que ce Monarque leur pourveut, en plusieurs villes
de son Royaume, d’habitations & de revenus pour leur entretien donna
par son testament à celles de Paris cent livres pour ayder à
achever leur bâtiment, & vingt livres pour être employées
â la subsistance des plus pauvres: & il ordonna à son successeur
de faire payer exactement les pensions viageres qu’il avoit données
à ces femmes qui vivoient religieusement ensemble.
Monsieur de Sponde Evêque de Pamiers
a remarqué dans ses Annales qu’il y a eu deux sortes de Beguines:
les unes qui furent infectées des erreurs des Beguards Heretiques
de la basse Allemagne: [p.470] &
d’autres qui vivoient vertueusement. Le Pape Clement V. a condamné
les premieres & leur Maîtres au Concile qu’il celebra l’an
1311. à Vienne en Dauphiné comme il est porté par
la decretale Ad nostrum; qui est tirée de ce
Concile: & les autres se sont éteintes avec le temps, dans
nôtre France.

|
Béguines assistant
à une messe pour les morts
(Pays Bas, vers 1300)
In pluribus civitatibus & castris regni, domos
Beguinis mulieribus ad habitandum providit, & eis, in vita suis sumptibus
ministravit. Vita sancti Lud. p. 36.
Legamus ad ædificandum
& ampliandum locum Beguinarum Parisiis centum libras, & ad sustentationem
pauperiorum ex ipsis viginti libras;
Et plus bas: [p.470]
Volumus insuper & præcipimus
ut provisionem quam fecimus quibusdam honestis mulieribus, quæ Beguinæ
vocantur, in diversis civitatibus et villis religiosè degentibus,
servet et teneat hæres noster, qui nobis succedet in regno, & eam
servari faciat et teneri quamdiù vixerit earum quælibet, quæ
videlicet assignatæ fuerint alias competenter. Clem. lib. 5, tit.
11.
Dont traduction en Annexe
2.
|
Ossements trouvés lors du creusement d’une
fosse devant l’ancienne Chapelle (cliché B.G., 2004)
|
NOTES
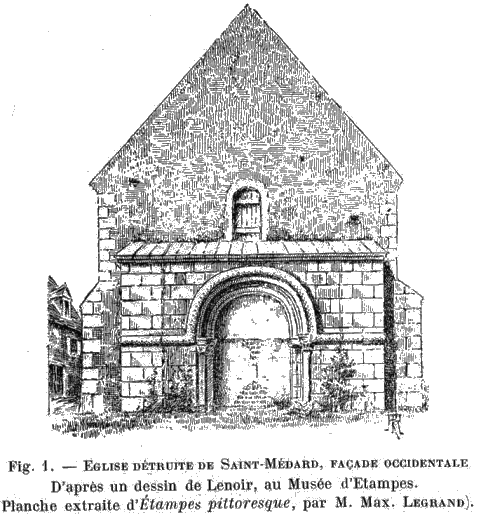 Le Hameau du petit saint
Mard. Fleureau a déjà
parlé de ce hameau, p. 32, dans son Denombrement des Paroisses, au chapitre 18 de la première
partie, pour le ranger au nombre des hameaux dépendant de Saint-Martin
qui “répondent immediatement à la Prévôté
d’Estampes” (p.33).
Dependant de la Paroisse
de saint Martin. Fleureau n’a jusqu’ici
parlé que très brièvement de cette paroisse, page
6, au très
bref chapitre IV de la première partie intitulé la Fondation
d’Estampes les Vieilles. L’histoire ancienne en est de fait très
mal documentée. Il y reviendra surtout dans la troisième partie,
essentiellement consacrée à l’histoire des moines de Morigny,
pour raconter comment cette paroisse leur avait été donnée
par Philippe Ier en 1106, et ce qui s’ensuivit (pages 482 et suivantes).
Le Hameau du petit saint
Mard. Fleureau a déjà
parlé de ce hameau, p. 32, dans son Denombrement des Paroisses, au chapitre 18 de la première
partie, pour le ranger au nombre des hameaux dépendant de Saint-Martin
qui “répondent immediatement à la Prévôté
d’Estampes” (p.33).
Dependant de la Paroisse
de saint Martin. Fleureau n’a jusqu’ici
parlé que très brièvement de cette paroisse, page
6, au très
bref chapitre IV de la première partie intitulé la Fondation
d’Estampes les Vieilles. L’histoire ancienne en est de fait très
mal documentée. Il y reviendra surtout dans la troisième partie,
essentiellement consacrée à l’histoire des moines de Morigny,
pour raconter comment cette paroisse leur avait été donnée
par Philippe Ier en 1106, et ce qui s’ensuivit (pages 482 et suivantes).
Fleureau sait, par la Chronique de Morigny,
que les moines de Fleury (c’est-à-dire de Saint-Benoît-sur-Loire)
ont contesté cette donation par Philippe de Saint-Martin à
ceux de Morigny, prétendant en avoir reçu une donation antérieure
du même roi. A la suite de la Chronique, il l’impute à la
seule jalousie (Antiquitez, pp.481-482).
En réalité il semble que la contestation
n’ait porté que sur le Petit-Saint-Mard. En effet les moines de
Saint-Benoît-sur-Loire conservaient deux chartes de Philippe Ier leur
accordant le Petit-Saint-Mard: la première, de 1071, opérant
la dite donation (elle n’a été éditée qu’en
1895 par Maurice Prou), et la deuxième confirmant en 1080 cette même
donation parmi d’autres (elle n’a été éditée
qu’en 1900 par Alexandre Vidier et Maurice Prou). Elles seront bientôt
en ligne sur le présent Corpus.
Il se voit une
transaction de l’an MCCXIX. On remarquera que
Fleureau ne précise pas où était conservée
la charte qu’il cite ensuite et qui paraît aujourd’hui perdue: c’était
probablement dans le chartrier de la paroisse de Saint-Martin.
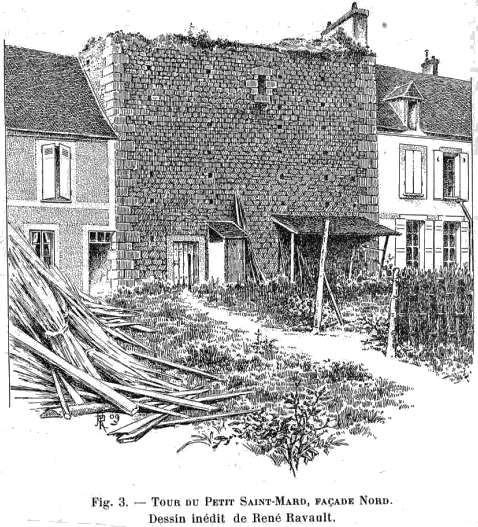 L’Abbaye de saint Cyr... auprés de la ville de Pontoise, comme je croy. Fleureau semble songer au couvent bénédictin
de Saint-Cyr-Saint-l'École, qui se trouve non pas près de Pontoise,
comme il le dit par erreur, mais de Versailles. Ce couvent fondé semble-t-il
vers 1155, sous l'évêque de Chartres de Chartres Robert III,
fut favorisé par le roi Louis VII, qui publia deux chartes en faveur
en sa faveur, l'une en 1156 et l'autre en 1157. Il faudrait en voir le texte.
L’Abbaye de saint Cyr... auprés de la ville de Pontoise, comme je croy. Fleureau semble songer au couvent bénédictin
de Saint-Cyr-Saint-l'École, qui se trouve non pas près de Pontoise,
comme il le dit par erreur, mais de Versailles. Ce couvent fondé semble-t-il
vers 1155, sous l'évêque de Chartres de Chartres Robert III,
fut favorisé par le roi Louis VII, qui publia deux chartes en faveur
en sa faveur, l'une en 1156 et l'autre en 1157. Il faudrait en voir le texte.
Le Curé
Chevecier. Le chevecier
(en latin usuel capicerius, qui se devrait plutôt écrire
capitiarius), était au départ un dignitaire
ecclésiastique préposé à la partie de l’église
où se trouvait le chevet (latin capitium). Son importance dans
les chapitres s’accrût progressivement à un tel point qu’il
finit par devenir le personnage principal de l’église paroissiale
sous la dénomination de curé.
On voit bien ici qu’en 1219 la première charte est signée par
le prieur et le chevecier, mais que la deuxième, en 1259, ne
l’est plus que par le chevecier.
Petrus officialis Curia Senonensis. “Pierre official de la curie (archiépiscopale) de Sens”.
Le Cartulaire de Notre d’Étampes présente aussi une
chartes de l’officialité de Sens datée des alentours de 1395
(n°CXIV p.138). Ce tribunal ecclésiastique
était une juridiction en plein essor, et qui était en cette
affaire parfaitement compétent puisqu’il s’agissait d’une affaire
ecclésiastique dont les deux parties relevaient du diocèse
de Sens.
Ce n’était pas toujours le cas: “Rien ne
nous apprend mieux l’abus qui s’était glissé dans les juridictions
ecclésiastiques que ce que raconte Loiseau dans son traité
des Seigneuries, qu’avant l’ordonnance de 1539 [celle de Villers-Cotterêts],
il y avait trente-cinq ou trente-six procureurs dans l’officialité
de Sens, et qu’il n’y en avait que cinq ou six au bailliage; et que depuis
cette ordonnance il n’y avait plus que cinq ou six procureurs à
l’officialité, et plus de trente au bailliage” (Histoire de France
de Sismondi).
On notera que Viollet-le-Duc
a étudié l’architecture des cachots de l’officialité
de Sens dans son Dictionnaire de l’Architecture, à l’article
“Prisons”, et que cet article a été
mis en ligne sur Wikipédia
(“Ces prisons, écrit-il notamment, ont été
bâties en même temps que l’officialité de Sens, et datent
par conséquent du milieu du XIIIe siècle.”).
 Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre
XCIV de la première partie, Fleureau a porté un Recit
veritable de ce qui s’est paßé au siege de la Ville
d’Estampes en l’année 1652. Il y mentionne au début de mai un mouvement militaire
dans la plaine du Petit-Saint-Mard: Les regimens de Condé,
& de Bourgogne, avec sept autres Allemans d’infanterie se retirerent
dans le fauxbourg de S. Martin, qui étoit leur quartier; &
les regimens de Vitemberg, & de Brouk de cavalerie passerent
au de-là, dans la plaine du petit saint Mard, où ils se
mirent en bon ordre, pour soûtenir autant qu’ils pourroient leur
infanterie (p.271).
Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre
XCIV de la première partie, Fleureau a porté un Recit
veritable de ce qui s’est paßé au siege de la Ville
d’Estampes en l’année 1652. Il y mentionne au début de mai un mouvement militaire
dans la plaine du Petit-Saint-Mard: Les regimens de Condé,
& de Bourgogne, avec sept autres Allemans d’infanterie se retirerent
dans le fauxbourg de S. Martin, qui étoit leur quartier; &
les regimens de Vitemberg, & de Brouk de cavalerie passerent
au de-là, dans la plaine du petit saint Mard, où ils se
mirent en bon ordre, pour soûtenir autant qu’ils pourroient leur
infanterie (p.271).
Ceux qui en ont jouy, dans la suite du temps,
ont porté la foy de ce fief au Seigneur de saint Cyr. Il faut bien avouer que Fleureau n’est pas ici très clair.
Fait-il ici une simple conjecture, ou s’appuie-t-il sur quelque document
ou usage de son temps? Et de quel Saint-Cyr parle-t-il?
Du temps du Roy saint Loüis. Fleureau
s’appuie ici sur une compilation relative à saint Louis publiée
en 1617 par Claude Ménard (1574-1652), sous la forme d’un recueil
in-quarto en deux parties, chez l’éditeur parisien Sébastien
Cramoisy. Il réunissait l’Histoire de saint Louis en vieux
français par Joinville (mort en 1317); quelques pièces inédites
relatives à ce roi avec des observations critiques de Ménard;
la Vita de saint Louis par Geoffroy de Beaulieu, son confesseur,
et celle de Guillaume de Chartres, son chapelain; deux sermons du pape Boniface
VIII (mort en 1303) à l’occasion de la canonisation de saint Louis,
etc.
Monsieur de Sponde Evêque de Pamiers... dans ses Annales.
Fleureau fait ici (comme déjà p.93) allusion aux Annales
Ecclésiastiques de Henri de Sponde, évêque de Pamiers
(1568-1643), qui avait résumé celles de Baronius (1538-1607)
et les avait continuées de 1198 à 1640.
Bernard
Gineste, mai 2007
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
|
ANNEXE
1
Chartes de 1219 et 1259
Texte latin donné par Fleureau (1682)
|
Traduction proposée par B. G. (2007)
|
Omnibus præsentes Litteras inspecturis Petrus officialis
Curia Senonensis in Domino salutem:
|
A tous ceux qui consulteront le présent acte, Pierre, official
de la curie de Sens, salut dans le Seigneur.
|
Noverint universi quòd cùm inter Capicerium Ecclesiæ
sancti Martini de Stampis veteribus, ex una parte, & capellanum capellæ
sancti Medardi, ex altera, coram Domino Senonensi quæstio verteretur
supcr hoc, quòd idem Capicerium à Capellano prædicto
sibi reddi petebat quandam annuam pensionem, in qua dictum capellanum
sibi teneri dicebat, ratione cujusdam compositionis initæ inter
prædecessores eorum, nomine dictarum Ecclesiæ & Capellæ,
secundùm quod continetur in quibus litteris sigillis Abbatissæ
sancti Cirici, & Conventus ejusdem loci sigillatis, quorum tenor in
modum qui sequitur præsentibus est insertus.
|
Que tous sachent ceci. Il y avait controverse devant Monseigneur
de Sens entre le chevecier de l’église de Saint-Martin des Vieilles
Étampes d’une part, et le chapelain de la chapelle Saint-Mard
de l’autre sur le point suivant. Le dit chevecier réclamait
que lui soit versée par le susdit chapelain une certaine rente
annuelle, à laquelle il disait que le dit chapelain était
tenu à son égard, au titre d’une certaine transaction effectuée
entre leurs prédécesseurs, au nom des dites église
et chapelle, selon ce qui et porté dans le dit acte scellé
des sceaux de l’abbesse de Saint-Cyr et du chapitre du dit établissement,
dont on a inséré dans le présent acte le contenu dont
voici la teneur: |
|
Ego Odelina sancti Cirici humilis Abbatissa, & totus ejusdem
loci humilis conventus, omnibus inposterum salutem: |
Moi Eudeline, humble abbesse de Saint-Cyr, et tout l’humble
chapitre du dit établissement, salut à tous dans l’avenir.
|
Noverit universitas nostra quod cum inter nos ex una parte,
& Priorem & capicerium de veteribus Stampis ex altera, esset controversia
super oblationibus quæ fiunt in Capella nostra de sancto Medardo
in festis annualibus. Tandem de bonorum & prudentum virorum consilio,
composuimus in hunc modum,
|
Que sache toute votre collectivité qu’il y avait
controverse entre nous d’une part, et les prieur et chevecier des Vieilles
Étampes d’autre part, au sujet des oblations qui se font dans notre
chapelle de Saint-Mard lors des fêtes annuelles. Finalement, par
l’avis de bonnes et prudentes personnes, nous avons transigé de
la manière qui suit.
|
Capellanus noster, qui de mandato nostro in dicta Capella
ministrabit, amodò oblationes festorum annualium in dicta Capella
faciendas pacificè percipiet, ita quòd singulis annis inposterum,
reddet dictis Priori & Capicerio viginti solidos parisiensis monetæ,
scilicet in natali Domini, sex solidos, in Pascha sex solidos, in Pentecoste
quatuor solidos, in festo omnium Sanctorum quatuor solidos: salvis tamen
Priori & Capicerio oblationibus de nuptiis, de Peregrinis, de purificationibus,
de Defunctis in prædictis festis.
|
Notre chapelain, qui desservira cette chapelle de par notre
mandat, percevra désormais sans qu’elles lui soient contestées
les oblations des fêtes annuelles, sous réserve que chaque
année à l’avenir il rende aux dits prieur et chevecier
vingt sous parisis, à savoir six sous à
Noël, six sous à Pâques, quatre sous à la Pentecôte
et quatre sous à la Toussaint. Cependant resteront réservées
au prieur et au chevecier les oblations des noces, des pélerins,
des relevailles et des défunts lors des dites fêtes.
|
Quod si dictæ pensiones singulæ in festo suo
prædicto, vel in crastino festi solutæ non fuerint, pro singulis
diebus, quibus ultra terminum; pensio detinebitur, duodecim denarios pro
pœna eis restituere faciemus.
|
Si les chacune des dites rentes n’est pas versée
lors de sa fête susprécisée, ni le lendemain, pour
chaque jour pendant lequel cette rente aura été retenue au-delà
du terme, nous leur ferons verser douze deniers à titre d’amende.
|
Si
verò Capicerius Vet. Stamparum aliqua casu fortuito, aliquos parrochianos
suos apud sanctum Medardum commorantes, in festis annualibus ad Ecclesiam
sancti Martini ire, & Jura ibi Parrochialia reddere compellat, pensio
quæ aßignata est in festo, quo dictam Ecclesiam coacti adierint,
non reddetur. Idem erit si interdictum fuerit generale: vel si culpa
Prioris vel Capicerii [p.468] dicta Capella
fuerit interdicta.
|
Mais
si le chevecier des Vieilles Étampes, pour quelque raison fortuite,
forçait certains de ses paroissiens demeurant à Saint-Mard
à se rendre à l’église de Saint-Matin lors des fêtes
annuelles et a y verser les droits paroissiaux, la rente dont le versement
est fixée lors de la fête où ils se seront rendus
à la dite église sous la contrainte ne sera pas versée.
Il en sera de même s’il y a un interdit général, ou
si par la faute du prieur ou du chevecier la dite chapelle était
frappé d’interdit. |
Quòd
ut ratum permaneat præsentem paginam in testimonium fecimus annotari,
& sigillorum nostrorum munimine roborari. Actum anno gratiæ
MCCXIX. mense Junio.
|
Et
pour que cela reste bien établi, nous avons fait mettre par écrit
le présent document et l’avons certifié au renfort de nos
sceaux. Fait l’an de grâce 1219 au mois de juin.
|
Tandem mediantibus bonis viris, dicti Capicerius & Capellanus
in præsentia dicti Domini, voluerunt & consenserunt, quod dicta
compositio, accedentibus consensu & confirmatione Domimi Senonensis
rata maneret, & ab ipsis, & eorum successoribus de cætero
firmiter & inviolabiliter servaretur, hoc excepto quod in festo Paschali,
Parrochiani dicti Capicerii apud sanctum Medardum morantes, ad dictam Ecclesiam
sancti Martini venire & confiteri peccata sua prædicto Capicerio,
vel Capellano suo, & alia Sacramenta Ecclesiastica recipere, & jura
Parrochialia eidem Capicerio solvere tenebuntur: & tres solidos quidem
de pensione dicto Capicerio debita in festo Paschæ, & secundum
prædictorum continentiam litterarum.
|
Pour finir, grâce à la médiation de gens de
bien, les dits chevecier et chapelain, en présence du dit Monseigneur,
ont accepté et consenti que la dite transaction, complétée
par l’accord et la confirmation de Monseigneur de Sens, demeure en vigueur et qu’elle soit maintenue
par eux et par leurs successeurs à venir fermement et inviolablement,
avec cette exception: lors de la fête de Pâques, les paroissiens
du dit chevecier demeurant à Saint-Mard seront tenus de venir
à la dite église de Saint-Martin et confesser leurs péchés
au susdit chevecier, ou à leur chapelain, er recevoir les autres
sacrements de l’Église, et ils seront tenus de régler les
droits paroissiaux au dit chevecier, et trois sous évidemment de
la pension dus au dit chevecier lors de la fête de Pâques et
selon la teneur de la susdite charte,
|
Hujusmodi verò compositionem innovatam prout superius est
expressum, Dominus Senonensis ratam habens, auctoritate Diocesana confirmavit,
& nobis viva voce præcepit, quod super præmißis
omnibus eisdem Capicerio & Capellano, in hujus rei testimonium &
munimentum concederemus litteras sigillo Senonensis Curiæ sigillatas;
quod fecimus ad mandatum dicti Domini & partium prædictarum.
|
Et Monseigneur de Sens, agréant cette transaction modifiée
comme on vient de le dire, l’a confirmée de par son autorité
diocésaine, et il nous a prescrit de vive voix de donner aux dits
chevecier et chapelain un acte portant tout ce qui vient d’être
dit en témoignage et certification de cette affaire, portant le
sceau de la curie de Sens. Et c’est ce que nous avons fait, à la
demande du dit Monseigneur et des susdites parties.
|
Datum anno Domini MCCLIX. die veneris post festum omnium Sanctorum.
|
Donné l’an du Seigneur 1259, le vendredi après la
Toussaint.
|
|
ANNEXE
2
Extraits de la Vie de saint Louis sur
les Béguines
Texte donné par Fleureau (1682)
|
Traduction proposée par B.G. (2007)
|
In pluribus civitatibus & castris regni, domos Beguinis mulieribus
ad habitandum providit, & eis, in vita suis sumptibus ministravit.
Vita sancti Lud. p.
36.
|
Dans plusieurs villes et places fortes du royaume, il pourvut de
demeures les femmes béguines pour qu’elles y résident, et
il les assista de ses deniers de son vivant.
Vie de saint Louis,
p.36
|
Legamus ad ædificandum & ampliandum locum Beguinarum Parisiis
centum libras, & ad sustentationem pauperiorum ex ipsis viginti libras;
|
Nous léguons cent livres pour la construction et l’agrandissement
de l’établissement des Béguines de Paris, et vingt livres
pour donner à manger aux plus pauvres d’entre elles;
|
Et plus bas: [p.470] Volumus
insuper & præcipimus ut provisionem quam fecimus quibusdam
honestis mulieribus, quæ Beguinæ vocantur, in diversis civitatibus
et villis religiosè degentibus, servet et teneat hæres noster,
qui nobis succedet in regno, & eam servari faciat et teneri quamdiù
vixerit earum quælibet, quæ videlicet assignatæ fuerint
alias competenter.
Clem. lib. 5, tit.
11.
|
Et plus bas: Nous voulons en outre et nous ordonnons que notre
héritier, qui nous succèdera sur le trône, conserve
et maintienne la rente que nous avons instituée en faveur de certaines
femmes honnêtes appelées Béguines, qui vivent pieusement
dans diverses villes et villages, et qu’il fasse conserver et maintenir,
aussi longtemps qu’il vivra, toutes celles qui auraient été
instituées autrement de manière justifiée.
Clem. [?] livre 5, article 11.
|
|
ANNEXE
3
Léon Marquis
sur le Petit-Saint-Mars (1881)
Petit-Saint-Mars (Le). — Hameau très-ancien,
situé à 2,200 mètres sud-ouest, sur la route de Saclas.
La chapelle Saint Médard du Petit-Saint-Mars, dont on voyait encore
des débris importants il y a quelques années, existait déjà
l’an 1219 (3). Son revenu était
de 50 livres en 1648 (4). Elle appartenait
aux religieuses de Saint-Cyr au XVIIIe siècle et fut vendue comme
bien national, avec 8 perches de terre, le 2 juillet 1791, à Gilles
Villemaire, aubergiste à La Fontaine, moyennant 1,050 fr. (5).
(3) Fleureau,
p. 466.— (4) Documents particuliers. — (5) Archives départementales.
Les Rues d’Étampes
et ses monuments, 1881, p. 209.
|
|
ANNEXE
4
René de Saint-Périer
sur la Tour du Petit-Saint-Mars (1938)
|
La Tour du Petit Saint-Mard
Infiniment plus
modeste que la belle tour de Guinette, en partie masquée par des
maisons et par cela même fort peu connue, cette tour mutilée
offre cependant un réel intérêt parce qu’elle nous prouve
l’existence, au XIIe siècle et peut-être même auparavant,
d’un autre ouvrage militaire destiné à la défense
d’Étampes. C’était une tour carrée de douze mètres
de côté, dont il ne subsiste que le rez-de-chaussée
et une faible partie d’un premier étage, indiqué par un retrait
de la maçonnerie sur lequel reposaient les poutres du plancher et
qu’éclairaient quatre fenêtres. Le rez-de-chaussée
ne présente aucune ouverture ancienne, ce qui montre bien qu’il
s’agit d’une construction de défense; on pénétrait
dans la tour par le premier étage au moyen d’escaliers mobiles.
Les murs ont plus de deux mètres d’épaisseur et sont bien
construits, les angles et les ouvertures soigneusement appareillés.
Une seule face en est visible pour le passant, des maisons venant s’appuyer
sur les trois autres. Aucun texte ne mentionne l’existence de cette tour,
tandis que par un diplôme de Philippe Ier, de 1071, on sait que
l’église de Saint-Mard fut donnée par lui à l’abbaye
de Saint-Benoît-sur-Loire. Ce document sur une très ancienne
église, qui donna son nom au petit hameau d’Étampes-les-vieilles
et qui ne fut détruite qu’en 1848, entraîna sans doute l’attribution
souvent faite de la tour du Petit-Saint-Mard, à un dernier reste
de cette église. Elles ne peuvent cependant pas être confondues,
leur emplacement n’étant pas le même et la tour étant
bien un ouvrage militaire, remontant peut-être à l’époque
où seule existait Étampes-les-Vieilles, destiné à
la défense de la vieille ville et à la surveillance de l’ancienne
route d’Orléans par Saclas, qui s’étend à ses pieds.
Étampes, la grande
histoire d’une petite ville, 1938, p. 103.
|
|
ANNEXE
5
Léon Guibourgé
sur la chapelle du Petit-Saint-Mars (1957)
Elle fut démolie,
rapporte M. Maxime Legrand, en 1826 par un entrepreneur qui devait la
transporter à Oisonville, mais qui mourut au cours des travaux.
Ses débris furent alors dispersés. Le musée d’Etampes
possède deux curieux chapiteaux qui en proviennent. Il y a aussi,
au Musée, la photographie d’un dessin de M. Lenoir, ancien conservateur,
représentant le portail de cet édifice, près de l’emplacement
duquel sont encore les restes de la tour, dont parle dom Fleureau, comme
demeure des religieuses. Cette tour était massive et carrée
et donnait à l’endroit le nom de «fief de la Tour-Carrée».
C’est le seul vestige ancien qui existe actuellement au Petit-Saint-Mars.
Étampes Ville Royale,
1957, p. 211.
|
|
ANNEXE
6
Frédéric
Gatineau sur les Béguines et Petit-Saint-Mars (2003)
BÉGUINES (les)
Une maison
dite «les Béguines», rue de la Foulerie,
est citée dans un acte de 1567 (AN MC).
Les Béguines étaient des religieuses
qui vivaient en couvent sans avoir prononcé de
vœux. Cette communauté est citée par Basile
Fleureau mais elle n’est déjà plus qu’un souvenir
à son époque.
|
BÉGUINES (carrefour des)
Cet ancien nom de l’actuelle rue
de la Manivelle est cité en 1731 (ADE E sup).
803). La maison précédente devait être
située non loin.
|
PETIT SAINT-MARS
Ce hameau
est cité en 1591 (ADE H dépôt 1B). Il est
orthographié «Petit Saint-Marc» sur le plan
Trudaine.
Sur le plan de 1741 (AD E3845)
figure un puits à la pointe de l’actuelle voie Romaine
et de la route de Saclas.
Saint Mars est une contraction
locale de Saint Médard, titulature de l’ancienne chapelle
du hameau.
Le terme «Petit»
Saint-Mars le distingue du «Grand» Saint-Mars, château
et domaine de la paroisse de Chalo-Saint-Mars.
La fête du quartier avait lieu
le 1er dimanche de Pâques. En 1902, c’est dans ce hameau
que fut finalement tué le bandit Britannicus au terme de
sa cavale après le meurtre du brigadier Dormoy à Angerville.
Le lotissement date de 1954.
Le Petit-Saint-Mars est aussi le nom d’un lieu-dit du cadastre.
[LD 96]
|
PETIT SAINT-MARS (château)
La façade
sud daterait du 17e. La façade nord du 18e. On remarque
un fronton avec œil-de-bœuf. Claude Hémard est seigneur
du Petit-Saint-Mars en 1652 et encore en 1684 (BMS SM) Poilloüe
de Saint-Mars , ancien officier major aux Gardes Françaises,
est seigneur du Petit-Saint-Mars en 1789. Ce château était
la propriété de Madame de la Bigne au 19e siècle,
femme très dévouée et charitable. Une chapelle
du château est encore citée en 1931. Ce domaine est maintenant
la propriété de l’Hôpital général.
L’hospice, annexe de l’hôpital tenue par les Augustines hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Paris, s’y est installé en 1954, d’abord
au château. La section des invalides s’est ouverte en 1958, pour
l’occasion on a surélevé les communs. De nouveaux locaux
ont été bâtis en 1963. Sur un plan de 1960, la
chapelle est le deuxième petit bâtiment sur la gauche côté
cour (ADE 85211). Les anciens communs du château du Petit-Saint-Mars
ont été aménagés en salles de formation
pour l’hôpital. Ce pavillon a été dénommé
pavillon du docteur Calley.
|
PETIT SAINT-MARS (chemin du)
Ancien nom
de l’actuelle rue de la Plaine au cadastre de 1827.
|
PETIT SAINT-MARS (rue du)
Cette voie traverse le
faubourg du même nom. [PV E7]
Au n° 4, ferme de l’Ardoise.
Au n° 30, tour du Petit
Saint Mars
Au n° 36, maison de l’ancien
octroi.
Au n° 47, maison avec vieille
porte en pierre côté cour.
Sur un vieux mur, on voit une
plaque indicatrice ancienne.
|
PETIT SAINT-MARS (sente du)
Ce chemin
longe les murs de l’ancien domaine du Petit-Saint-Mars. [PV E8]
Étampes en lieux
et places, 2003, pp. 95-96.
|
|
|
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 466-470. Saisie:
Bernard Gineste, 2007.
|
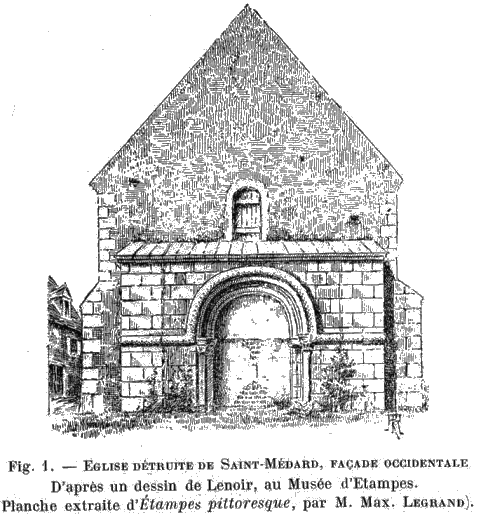
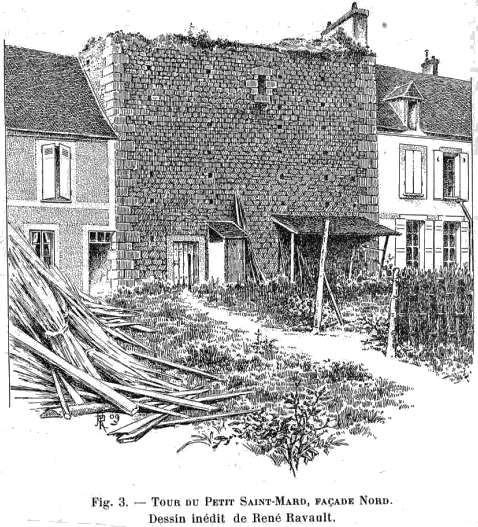
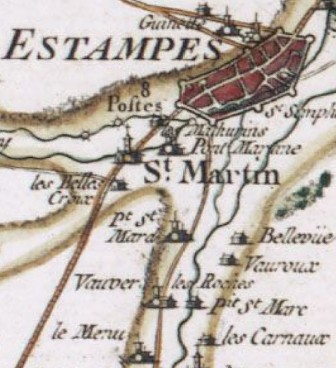

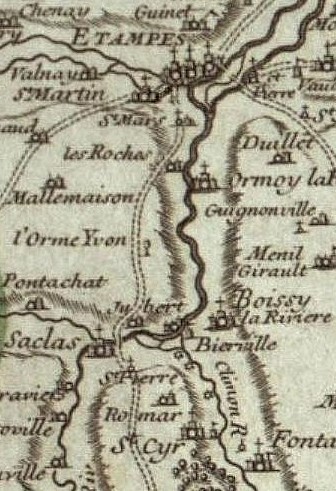

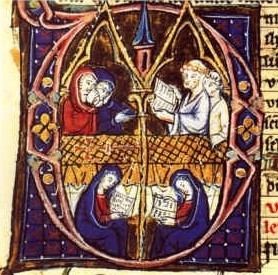

 Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre
XCIV de la première partie, Fleureau a porté un
Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre
XCIV de la première partie, Fleureau a porté un  Léon MARQUIS, «Petit-Saint-Mars (Le)», in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Histoire
- Archéologie - Chronique - Géographie - Biographie et Bibliographie,
avec des documents inédits, plans, cartes et figures pouvant servir
de suppléments et d’éclaircissement aux Antiquités
de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile Fleureau [in-8°;
438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun], Étampes,
Brière, 1881 [dont deux rééditions en fac-similé:
Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de la Tour Gile, 1996]. p.209
[bref paragraphe dont nous donnons le texte ici en
Léon MARQUIS, «Petit-Saint-Mars (Le)», in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Histoire
- Archéologie - Chronique - Géographie - Biographie et Bibliographie,
avec des documents inédits, plans, cartes et figures pouvant servir
de suppléments et d’éclaircissement aux Antiquités
de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile Fleureau [in-8°;
438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun], Étampes,
Brière, 1881 [dont deux rééditions en fac-similé:
Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de la Tour Gile, 1996]. p.209
[bref paragraphe dont nous donnons le texte ici en