Les Antiquitez
de la Ville et du Duché
d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Deuxième Partie, Chapitre
XXIII, pp. 464-465.
|
De I’Hôpital de saint Jean au haut
pavé
|
DEUXIÈME
PARTIE, CHAPITRE XXIII.
De I’Hôpital
de saint Iean au haut pavé.
IL y
a encore dans le même Faux-bourg de saint Martin, en la partie la
plus proche de la ville, dite le haut-pavé, à cause de sa
situation à l’égard du reste, un Hôpital dont la Chapelle
est dediée sous l’invocation de saint Jean l’Evangeliste, &
de saint Altin, l’un des compagnons des saints Savinien & Potentien,
Apôtres de ce pays. Cet Hôpital étoit anciennement appellé
le Refuge des pauvres. Je n’ay pû jusques à maintenant connoître
son vray Fondateur, mais j’ay appris par la Charte suivante de l’an 1085.
que Roy Philippe Premier en a esté le Bienfacteur, & qu’il y
a donné, à perpetuité, un arpent de terre, assis au
long de la riviere, & le droit de la riviere en toute l’étendue
de cette terre, quitte & déchargé de toutes coûtumes,
& autres droits deus à Sa Majesté, avec pareil affranchissement
pour tous ceux qui l’habitoient [p.465] alors,
& pour ceux qui s’établiroient à l’avenir au dedans des
limites de cet arpent de terre, & deffences à ses Officiers
de lever sur eux aucune chose que les droits accoûtumez du marché,
lors qu’ils viendroient à celuy du Roy: auquel ils ne pourroient
les contraindre de vendre leur marchandise à credit. Le Roy donne
pouvoir par la même Charte au Procureur de cet Hôpital, de disposer
de cet arpent de terre comme il le jugera à propos pour le bien
& l’utilité de cet Hôpital. Voicy la Charte.
In
nomine Domini, Philippus Francorum Rex Notum fieri volumus fidelibus
nostris quòd de terra nostra, videlicet de dominio nostro Domui
Dei, quæ dicitur receptaculum siquidem Pauperum, apud veteres Stampas
juxta pontem, arpennum unum donavimus, ea ratione, ut ipsa Domus terram
illam in perpetuum teneat & poßideat solutam & quietam:
nec ullam deinceps redhibitionem, seu consuetudinem indè habeamus,
nec nos, nec ministeriales nostri. Præcipimus autem & auctoritate
Regiæ Majestatis
inhibemus, quòd nullus Præpositus noster, nec cæteri
ministeriales nostri, nec alia quælibet persona de præfata
terra quamlibet consuetudinem requirere seu capere, nec in ipsa violentiam,
seu toltam facere præsumat; excepto Domus ipsius Procuratore, qui
de ea rationabiliter & justè disponat. Hospites autem qui in
ipso arpenno conversantur & conversaturos ab omni consuetudine nostra,
quæ de ipsa terra ab ipsis requiratur, tàm à nobis quàm
à ministerialibus nostris, seu aliqua alia persona, nisi à
præfato Procuratore, solutos, pro Deo, clamamus & quietos. Quod
si ad forum nostrum vendere vel emere venerint, nihil ab eis, præter
justam fori consuetudinem, requiratur aut exigatur. Credantias facere non
cogantur. ln locis nostris nulla eis violentia fiat. Similiter autem eidem
Hospitio aquam juxta terram ipsam profluentem eodem jure donavimus solutam
& quietam. Et ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri, &
nominis nostri Charactere & sigillo signari & corroborari præcepimus
Gervasi Dapiferi, Theobaldi Constabularii, Lancelini Buticularii, Galerauni [sic] Camerarii. Actum Stampis, anno Incarn.
verbi MLXXXV. Regni verò nostri XXIV. Guillermo præposito
Stampis Gildebertus in vicem Goiffridi paris. Episcopi cancell. relegendo
subscripsit.
|
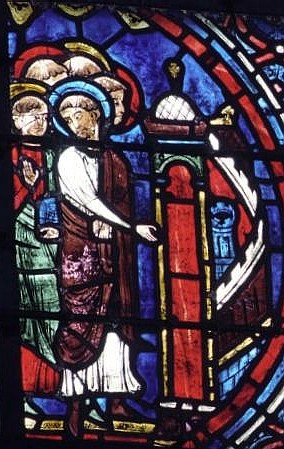
Saints Savinien, Altin, Potentien et Coald
(vitrail de Chartres)
|
|
NOTES
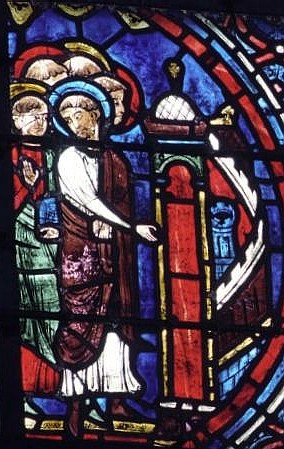 Saint Altin, l’un
des compagnons des saints Savinien & Potentien, Apôtres de ce
pays. Fleureau a déjà parlé au chapitre V de la première
partie, de l’évangélisation de la région d’Étampes,
qu’il suppose avoir été le fait des apôtres légendaires
du diocèse de Sens. Altin (qui aurait
évangélisé Orléans et Chartres) serait passé
par Étampes, lors de l’épisode où saint Savinien
(fondateur de l’église de Sens) l’aurait envoyé à
Chartres. Dans la version acceptée par Fleureau, ces personnages
auraient été des disciples directs de saint Pierre et tout
cela se serait passé au premier siècle. Il est l’un des derniers
auteurs à croire une chose pareille. On essaye ensuite de sauver
l’historicité de ces personnages en les faisant vivre au troisième
siècle.
Saint Altin, l’un
des compagnons des saints Savinien & Potentien, Apôtres de ce
pays. Fleureau a déjà parlé au chapitre V de la première
partie, de l’évangélisation de la région d’Étampes,
qu’il suppose avoir été le fait des apôtres légendaires
du diocèse de Sens. Altin (qui aurait
évangélisé Orléans et Chartres) serait passé
par Étampes, lors de l’épisode où saint Savinien
(fondateur de l’église de Sens) l’aurait envoyé à
Chartres. Dans la version acceptée par Fleureau, ces personnages
auraient été des disciples directs de saint Pierre et tout
cela se serait passé au premier siècle. Il est l’un des derniers
auteurs à croire une chose pareille. On essaye ensuite de sauver
l’historicité de ces personnages en les faisant vivre au troisième
siècle.
La Charte suivante
de l’an 1085. On notera que Léon Marquis
en 1881 écrit par distraction 1055, et que Léon Guibourgé
en 1957 en conclut avec une certaine légèreté que
l’établissement qui bénéficie de la charte de 1085
existait donc déjà en 1055. Ainsi se forgent souvent les
légendes de l’histoire locale.
 Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La
première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,
celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),
la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes
de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où
il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition
de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste
il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement
pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison
de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon Annexe 1) tend à démontrer que Fleureau
avait sous les yeux soit le Cartulaire de Morigny (qui est du XIIIe siècle),
soit une copie qui en était extrêmement proche. La seule variation
intéressante de ces éditions concerne la dénomination
donnée par le roi à l’établissement en question. Voyez
la note suivante.
Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La
première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,
celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),
la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes
de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où
il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition
de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste
il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement
pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison
de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon Annexe 1) tend à démontrer que Fleureau
avait sous les yeux soit le Cartulaire de Morigny (qui est du XIIIe siècle),
soit une copie qui en était extrêmement proche. La seule variation
intéressante de ces éditions concerne la dénomination
donnée par le roi à l’établissement en question. Voyez
la note suivante.
Domui Dei, quæ
dicitur receptaculum siquidem Pauperum. “à
la Maison Dieu qui est appelée Refuge, c’est-à-dire des Pauvres”. Le texte de Fleureau est ici fautif, et il lui
faut préférer celui du Cartulaire de Morigny, suivi
par Menault et Prou: domui
Domini Dei, que dicitur Receptaculo siquidem pauperum, “à la Maison du Seigneur
Dieu qui est appelée Au Refuge, c’est-à-dire des Pauvres”. Ce texte présente deux particularités intéressantes
qui disparaissent dans l’édition princeps de Fleureau.
Tout d’abord l’auteur de la charte n’a pas à
l’esprit les expressions postérieures Maison Dieu ou Hôtel
Dieu, dont on a sans doute eu tort de voir dans notre charte la toute
première occurrence (opinion répercutée notamment
par Patrick Lanotte dans sa thèse soutenue en 1998 à Reims,
Médecine, médecins et hospitalité dans le
haut Moyen Age. L’exemple de Reims. L’origine de l’Hôtel-Dieu de
Reims au VIe siècle: mythe ou réalité? p.44).
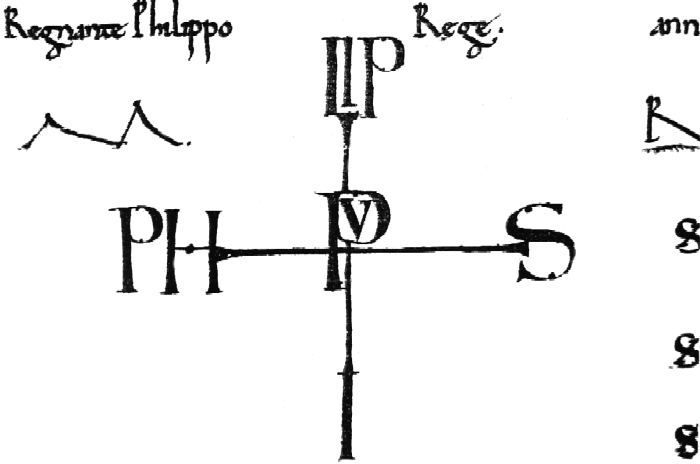 Fleureau a simplifié
le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage
de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte
utilise délibérément une expression typiquement biblique,
Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur
Dieu”, qui désigne régulièrement
dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,
26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;
V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques
XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique
déjà l’expression Domus Dei désignait un
temple.
Fleureau a simplifié
le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage
de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte
utilise délibérément une expression typiquement biblique,
Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur
Dieu”, qui désigne régulièrement
dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,
26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;
V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques
XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique
déjà l’expression Domus Dei désignait un
temple.
L’idée est donc éminemment théologique.
Cet établissement étampois est assimilé au Temple
même de Dieu parce qu’on y accueille les pauvres, à qui le
Christ s’est lui-même assimilé, comme le rappelle encore
l’inscription latine qui est sur la façade de l’ancien Hôtel-Dieu
d’Étampes, à côté de Notre-Dame, rue de la
République.
C’est sans doute là l’origine des expressions
Maison Dieu ou Hôtel Dieu, appliquée
ultérieurement aux hospices, mais il n’est pas probable qu’il s’agisse
déjà ici d’une appellation vernaculaire. Il semble
qu’il s’agisse plutôt à cette date encore d’une périphrase
scripturaire destinée à souligner le mérite de cette
donation. Ce mérite n’est pas moindre que celui d’une donation à
un établissement cultuel.
Par ailleurs on
notera que le nom de l’établissement n’est pas donné au
nominatif, Receptaculum, “le Refuge”, que Fleureau a cru devoir rétablir, comme semble l’imposer
le contexte grammatical, mais à l’ablatif, Receptaculo, “Au Refuge”. Or il ne s’agit certainement pas d’une
faute, car plusieurs chartes étampoises présentent cette
caractéristique, qui doit refléter un usage local, celui
d’user de noms de lieu précédés de la préposition
à. Ainsi dans la charte de 1046: in uilla que
dicitur Montelosberti, “dans le domaine appelé
Au Mont-Losbert”.... alodum unum qui dicitur Magniruallo et Frotmundiuillario,
“un alleu appelé
A Magneruel et à Fromonvilliers”, etc. Et de même
encore en 1274 dans une charte étampoise de la reine Marguerite: boucheriam
stampensem quæ dicitur ad novos stallos, “la boucherie étampoise appelée Aux Nouveaux
Étaux”.
violentiam, seu toltam facere. “ni
violence ni toulte”. Voici les graphies attestées par le Lexicon de Niermeyer pour la toulte: tolta, tulta, touta, tutta, tota. C’est au départ
le participe passé du verbe tollere, “lever”. Le fait que la toulte, autrement
dit la taille, soit mise sur le même plan que la violence
indique assez qu’il s’agit d’une imposition dont la perception se distingue
mal du racket ou du bakchich. Niermeyer traduit ce mot en français
par “taille”,
et en anglais par “arbitrary exaction”... Voilà qui devrait faire réfléchir
les tenants d’une privatisation à marche forcée de pans entiers
de la puissance publique, et d’une diminution de la masse salariale des
fonctionnaires; mais ni l’histoire, ni la géographie
du Tiers-Monde, ne sont généralement le fort des tenants de
cette nouvelle religion. Estimons-nous heureux déjà de cette
tolérance présidentielle: “Vous avez le droit de faire de la littérature ancienne” (19 avril 2007).
Bernard
Gineste, 9 mai 2007
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
|
ANNEXE
1
La charte de 1085
Texte de Fleureau (1682)
|
Texte de Prou (1908)
|
Traduction de B. G. (2007)
|
|
In nomine Domini, Philippus [Ø] Francorum Rex |
In nomine Domini, Philippus, Dei gratia Francorum Rex.
|
Au nom du Seigneur, Philippe par la grâce de Dieu roi
des Francs.
|
Notum fieri volumus fidelibus nostris quòd de terra
nostra, videlicet de dominio nostro Domui [Ø] Dei, quæ dicitur receptaculum siquidem Pauperum, apud veteres Stampas juxta pontem,
arpennum unum donavimus, ea ratione, ut ipsa Domus terram illam in perpetuum teneat & poßideat solutam &
quietam: nec ullam deinceps redhibitionem, seu consuetudinem indè habeamus,
nec nos, nec ministeriales nostri.
|
Notum
fieri volumus fidelibus nostris quod de terra nostra, videlicet de dominio
nostro, domui Domini Dei, que dicitur Receptaculo siquidem pauperum, apud Veteres Stampas juxta pontem,
arpennum unum donavimus, ea ratione ut ipsa domus terram illam imperpetuum
teneat et possideat solutam et quietam: nec ullam deinceps redhibitionem,
seu consuetudinem inde habeamus, nec nos, nec ministeriales nostri.
|
Nous voulons qu’il soit connu de nos féaux
que nous avons donné, sur notre terre, à savoir sur notre
domaine, à la Maison du Seigneur Dieu appelée A l’Asile,
c’est-à-dire à
celui des pauvres, un arpent situé aux Vieilles Étampes
près du pont, étant précisé que cette maison
tiendra et possèdera cette terre à perpétuité
sans aucune charge ni contestation possible, et que ni nous-même
ni nos officiers ne pourrons nous la faire restituer ni en tirer de redevance.
|
|
Præcipimus autem & auctoritate Regiæ Majestatis inhibemus, quòd
nullus Præpositus noster, nec cæteri ministeriales nostri,
nec alia quælibet persona de præfata terra quamlibet consuetudinem
requirere seu capere, nec in ipsa violentiam, seu toltam facere præsumat;
excepto Domus ipsius Procuratore, qui de ea rationabiliter & justè
disponat. |
Precipimus
autem et auctoritate regie majestatis inhibemus, quod nullus prepositus
noster, nec ceteri ministeriales nostri nec alia quelibet persona de prefata
terra quamlibet consuetudinem requirere seu capere nec in ipsa violentiam
seu toltam facere presumat; excepto domus ipsius Procuratore, qui de ea
rationabiliter et juste disponat.
|
Nous prescrivons, et nous interdisons de par l’autorité
de notre majesté royale qu’aucun de nos prévôts, ni
aucun autre de nos officiers ni aucune autre personne que ce soit réclame
ou perçoive quelque redevance que ce soit sur la susdite terre, ni
qu’ils y exercent violence ou exaction, hormis le directeur de la dite maison,
qui en disposera d’une manière raisonnable et juste.
|
|
Hospites autem qui in ipso arpenno conversantur & conversaturos
ab omni consuetudine nostra, quæ de ipsa terra ab ipsis requiratur, tàm à nobis quàm
à ministerialibus nostris, seu aliqua alia persona, nisi à
præfato Procuratore, solutos, pro Deo, clamamus & quietos. |
Hospites
autem qui in ipso arpenno conversantur, et conversaturos, ab omni consuetudine
nostra, que de ipsa terra ab eis requiratur
tam a nobis quam a ministerialibus nostris seu aliqua alia persona, nisi
a prefato procuratore, solutos, pro Deo clamamus et quietos.
|
Quant aux tenanciers qui habitent et habiteront sur cet arpent,
nous les proclamons pour l’amour de Dieu francs et quittes de tout droit
coutumier qui leur serait réclamé, tant par nous-même
que par nos officiers ou par toute autre personne, hormis le susdit directeur.
|
Quod si ad forum nostrum vendere vel emere venerint, nihil
ab eis, præter justam fori consuetudinem, requiratur aut exigatur.
Credantias facere non cogantur.
ln locis nostris nulla eis violentia fiat [Ø].
|
Quod
si ad forum nostrum vendere vel emere venerint, nichil ab eis preter
justam fori consuetudinem requiratur aut exigatur; creditantias facere non cogantur. ln locis nostris
nulla eis violencia fiat nec tolta fiat.
|
Et s’ils se
rendent à notre marché pour y vendre ou y acheter, qu’on
ne réclame ni n’exige d’eux rien de plus que le juste droit de marché. Qu’on ne les force
pas à vendre à crédit. Sur nos terres, qu’il ne se
fasse ni violence ni exaction à leur encontre. |
Similiter autem eidem Hospitio aquam juxta terram ipsam profluentem
eodem jure donavimus solutam & quietam.
|
Similiter
autem eidem hospicio aquam juxta terram ipsam profluentem eodem jure
donavimus solutam et quietam.
|
Nous avons pareillement donné au dit hospice l’eau
qui s’écoule le long de la dite terre, sous le même
régime, sans aucune charge ni contestation
possible
|
Et ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri, &
nominis nostri Charactere &
sigillo signari & corroborari præcepimus
|
Et
ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri & nostri nominis karactere et sigillo signari et corroborari
precepimus
|
Et pour que cela demeure fermement, nous avons ordonné
qu’on en fasse le présent document et qu’il soit marqué
et certifié du monogramme de notre nom et de notre sceau.
|
[Ø] Gervasi Dapiferi, [Ø] Theobaldi Constabularii,
[Ø] Lancelini Buticularii, [Ø] Galerauni [sic] Camerarii.
|
$ Gervasi dapiferi. $ Theobaldi constabularii.
$ Lancelini buticularii. $ Galeranni camerarii.
|
Marque du sénéchal Gervais. Marque du connétable
Thibaud. Marque du bouteiller Lancelin. Marque du chambrier Galerran.
|
Actum Stampis, anno Incarn. verbi MLXXXV. Regni verò
nostri XXIV. Guillermo præposito Stampis
|
Actum
Stampis, anno incarnati Verbi .M°.LXXX°.V°., anno regni nostri .XX°.IIII°. Guillermo preposito
Stampis.
|
Fait à Étampes, l’an de l’incarnation du Verbe
1085, et 24 de notre règne, alors que Guillaume était prévôt
d’Étampes.
|
Gildebertus in vicem Goiffridi paris. Episcopi cancell. [Ø] relegendo subscripsit.
|
Gildebertus
[Corrigez: Gislebertus
(note de Prou)] ad vicem Goisfridi, Parisiorum episcopi, cancellarii nostri relegendo subscripsit.
|
Gilbert, après relecture, a souscrit, à la
place de notre chancelier, l’évêque de Paris Geoffroy.
|

|

|

|
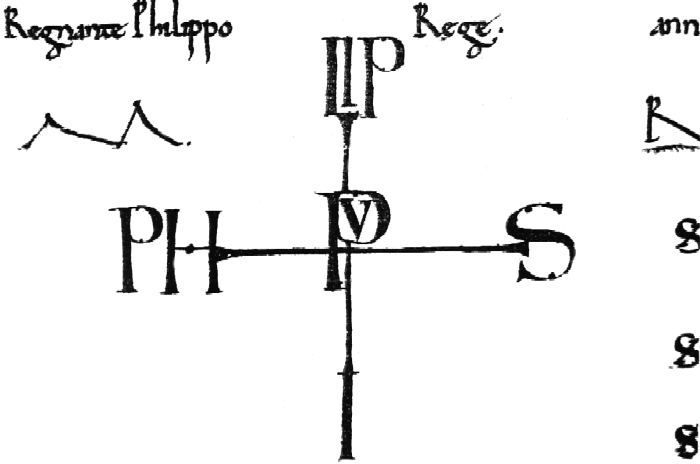
Exemple de monogramme de Philippe Ier
|
ANNEXE
2
Léon Marquis
sur l’Hôpital Saint-Jean (1881)
Rue Saint-Jean. — A gauche de la rue Saint-Martin et faisant
suite à la rue de Saclas. Son nom lui vient de l’hôpital
Saint-Jean ou refuge des pauvres qui était au
coin de cette rue et de celle du Haut-Pavé. Il existait dès
l’an 1055 [Lisez: 1085] et possédait
un arpent de terre le long de la rivière (2). En 1648, d’après
un pouillé de Sens, son revenu était de 8,000 livres. [...]
Rue du Haut-Pavé. —
Fait suite à la rue Saint-Martin. Elle est située dans un
lieu élevé, a le pavé haut. D’après Fleureau,
le faubourg du Haut-Pavé était autrefois l’un des quatre
de la ville.
A gauche de cette rue, on voit d’abord une ancienne
porte surmontée d’une petite niche: c’est un reste de l’hôpital
Saint-Jean. [...]
(2) Fleureau,
p. 464.
Les Rues d’Étampes
et ses monuments, 1881, p. 111.
|
|
ANNEXE
3
Léon
Guibourgé sur le Refuge des Pauvres (1957)
|
REFUGE DES PAUVRES, DES VOYAGEURS, L’HÔPITAL SAINT-JEAN,
LA CHAPELLE.
Dans le quartier Saint-Martin, tout le
monde connaît la rue Saint-Jean. Elle commence au début
de la rue Saint-Martin, en face de la route de Saclas, à un carrefour
qu’on appelait autrefois le carrefour de l’Ecce Homo. Elle monte vers
le cimetière Saint-Gilles, passe devant la piscine et aboutit
au pont Saint-Jean qui passe sur la ligne de chemin de fer. Au carrefour,
à l’angle de cette rue Saint-Jean et de la rue du Haut-Pavé
se trouvait l’hôpital Saint-Jean.
 A l’heure
actuelle tout ce qui reste de cet ancien hôpital est [p.216] une petite maison basse,
ayant sur son toit une sorte de guérite carrée à
fenêtre bouchée, en dessous une niche vide de sa statue et
surmontée d’une croix, et une porte en pierre de taille à
cintre surbaissé, masquée par une porte en bois d’une remise.
A l’heure
actuelle tout ce qui reste de cet ancien hôpital est [p.216] une petite maison basse,
ayant sur son toit une sorte de guérite carrée à
fenêtre bouchée, en dessous une niche vide de sa statue et
surmontée d’une croix, et une porte en pierre de taille à
cintre surbaissé, masquée par une porte en bois d’une remise.
L’hôpital Saint-Jean remontait à
une époque très ancienne. On dit qu’il existait dès
l’an 1055 [N.B. Cette date fantaisiste ne repose
que sur une coquille de Léon Marquis, où il faut lire: 1085
(B.G.)] sous le nom de «Refuge des Pauvres» et que le
roi Philippe Ier, en 1085, l’avait doté de revenus importants. Dans
cet hôpital il y avait une chapelle dédiée, dit dom Fleureau,
sous l’invocation de saint Jean-Baptiste et de saint Altin, l’un des compagnons
des saints Savinien et Potentien, apôtres de ce pays.
Cet hôpital était administré
par un personnel laïque. En 1556, dans le procès-verbal de
la rédaction des Coutumes du Bailliage, il y avait comme administrateur
un nommé Simon Charbonnier. Un aumônier naturellement y résidait
pour le service de la chapelle et pour les secours religieux à
donner aux malades et au personnel.
On y recevait les pauvres malades de la
ville. On y hébergeait aussi les étrangers, les voyageurs
ou pèlerins de passage qui avaient besoin de soins. Ainsi, le 3
février 1599, eut lieu, d’après les registres de la chapelle,
«le baptême de Périne, fille d’Eloy Michon et de Claudine
Migret, laquelle estant en voyage, passant par cette paroisse, estant logée
à l’hôpital Saint-Jean, y est accouchée».
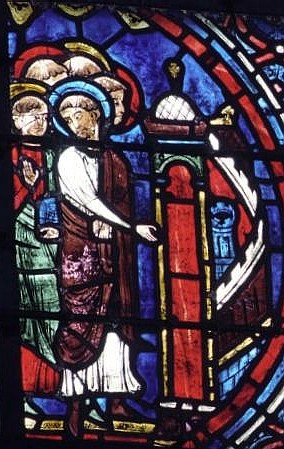 Dans ces
mêmes registres, en 1657, sont inscrits les décès de
plusieurs passants, tristes victimes de la misère générale;
de même en 1662, année de grande mortalité. On y
voit également les naissances et baptêmes des enfants du
personnel de l’hôpital: le 20 août 1655, le baptême
de Jeanne, ou encore la naissance d’un enfant de Mathurin le Tailleur,
gardien de l’hôpital.
Dans ces
mêmes registres, en 1657, sont inscrits les décès de
plusieurs passants, tristes victimes de la misère générale;
de même en 1662, année de grande mortalité. On y
voit également les naissances et baptêmes des enfants du
personnel de l’hôpital: le 20 août 1655, le baptême
de Jeanne, ou encore la naissance d’un enfant de Mathurin le Tailleur,
gardien de l’hôpital.
L’hôpital eut à souffrir des
guerres, en particulier de la Fronde. Dom Basile Fleureau rapporte qu’en
1652, lors du siège de la ville, le régiment «des
Enfants perdus», conduit par un officier de Picardie, ayant coupé
le régiment de Condé et les Allemands, et forcé les
régiments de Bourgogne, entra à l’hôpital Saint-Jean.
On pense aux dégâts et désordres qui en résultèrent.
Ce petit hôpital jouissait en 1648
d’un revenu de 8.000 livres, suivant un registre du diocèse de
Sens. Il avait du mal à vivre. Il fut réuni à l’Hôtel-Dieu
d’Etampes en 1695, mais la chapelle subsista et continua de servir au
culte. C’est ainsi qu’il y fut célébré le 7 novembre
1702 le mariage entre Abraham Dolbet, écuyer ordinaire de la bouche
de Mme la Duchesse de Bourgogne, et Marie-Marguerite, fille d’Octave Dissou,
receveur des Fermiers [p.217] du
Roi, et de Marie-Françoise Robert; en présence de messire
Claude de Massac, docteur de Sorbonne, ministre de la Sainte Trinité.
Arriva la Révolution. En messidor
an II, la chapelle fut louée au profit de 1’hospice et convertie
en grange. Un peu plus tard, en floréal an IV, elle servit de
salle de réunion pour la réorganisation de la Garde Nationale.
Les citoyens furent convoqués en groupes de 95 hommes et on attribua
à ces groupes les édifices religieux pour élire les
nouveaux gradés. L’un de ces groupes se réunit sous la présidence
de Marc Boivin dans la chapelle Saint-Jean.
En prairial de la même année,
un particulier offrit d’acheter la chapelle mais le Conseil Général
de la Commune refusa d’autoriser la vente, «considérant que
la loi du 2 germinal an II veut que les biens des hôpitaux soient
provisoirement exceptés de ceux compris dans la loi du 27 ventôse
sur la vente des biens nationaux, ce qui est le cas de cette chapelle».
Ce qui n’empêcha pas, peu de temps
après, la chapelle d’être vendue, puis démolie, ainsi
que les bâtiments de l’hôpital, sauf une petite partie de
ces bâtiments que l’on voit encore de nos jours au 50 bis de la
rue du Haut-Pavé.
Étampes Ville Royale,
1957, p. 215-217.
|
|
ANNEXE
4
Frédéric
Gatineau sur
les toponymes Haut-Pavé et Saint-Jean (2003)
HAUT
PAVÉ (rue du)
Cette rue est citée
dès 1605 (Adioc1). Le Haut-Pavé est cité
comme faubourg en 1593 (A dioc 5). Cette voie est une portion
de l’ancienne grande route (pavée) de Paris à Orléans.
Il y a, de fait, une petite montée à cet endroit.
Cette rue, située dans le prolongement de la rue Saint-Jacques,
a connu le passage des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle
à partir du 12e siècle. A partir des années
1930 et jusqu’à l’ouverture de la déviation de la nationale
20 en 1961, elle voit passer un flot croissant de véhicules.
La traversée d’Étampes est devenue un cauchemar pour
les automobilistes comme pour les riverains. [PV FG/6]
Une des 22 premières
bornes-fontaines y est installée en 1881.
Au n° 29, ancienne
auberge du Lièvre.
A l’emplacement du n°
33, ancienne maison de l’Etoile.
Au n° 41 ter, ancienne
auberge Saint-Nicolas.
Au n° 2, ancienne
auberge du Mouton.
Au n° 30, maison
avec son ancienne devanture.
Au n° 36-38, ancienne
auberge la Chasse.
Au n° 50-50 bis/50
ter, ancien Hôpital Saint-Jean.
|
HAUT
PAVÉ (puits du)
Ce puits attenant à l’ancien cimetière
Saint-Gilles est cité en 1820.
|
HÔPITAL
SAINT-JEAN DU HAUT PAVÉ
Cette maison d’accueil pour pèlerins était
située à l’emplacement de l’actuel 50 rue du Haut-Pavé.
L’hôpital est cité vers 1085 dans une charte de
Philippe Ier qui en fut le premier bienfaiteur. L’établissement
comprenait deux chapelles, l’une dédiée à
Saint Jean, l’autre à Saint Altin. La maison actuelle a visiblement
été remaniée à la Renaissance et surtout
au cours du 20e siècle. Il subsiste une petite tourelle carrée
avec une niche qui abritait jadis une statuette de la Vierge.
|
SAINT-JEAN
(chemin de)
Ce
vieux chemin a repris le tracé des actuelles allée
du Docteur-Bourgeois et avenue des Meuniers.
Sur un plan de 1812, le chemin
Saint-Jean désigne aussi l’actuelle rue du Pont-Saint-Jean.
Ce chemin de Saint-Jean débutait à l’Est de la ruelle
du Mouton. Il a été très bouleversé
par l’établissement de la ligne de chemin de fer. Le départ
de ce chemin est cité comme ruelle Saint-Jean dès
1512 (ADE E3913).
|
SAINT-JEAN
(impasse)
Cette
impasse qui débouche dans la rue Saint-Jean, derrière
l’ancienne auberge du Grand Saint-Martin figure toujours au cadastre
actuel. Il s’agit d’un ancien chemin fermé en impasse en
1880. [PV F6]
|
SAINT-JEAN
(pont)
Ce
pont sur la voie ferrée fut construit en 1843. Elargie en
1903, la passerelle a néanmoins formé pendant longtemps
un goulet d’étranglement entre la ville haute et basse. Le pont
Saint-Jean sera finalement remplacé par le grand pont actuel
en 1970.
|
SAINT-JEAN
(porte)
Cette
porte fictive, citée dès 1683, était située
près de l’Hôpital Saint-Jean (B F). Elle ne pouvait
faire partie des anciennes fortifications de la ville puisqu’elles
ne passaient pas dans cette zone. La porte devait matérialiser
une simple barrière douanière.
|
SAINT-JEAN
(rue)
Cette
voie était aussi dénommée ruelle aux Loups
au 17e siècle mais aussi ruelle Saint-Jean en 1657 (ADE E3913).
Elle deviendra rue de la Surveillance pendant la période révolutionnaire.
Le nom de cette rue vient de la proximité de l’ancien hôpital
Saint-Jean du Haut-Pavé, cité dès 1085, où
se trouvait une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste.
[PV G6]
Mise à part la façade
nord de l’auberge du Grand Saint-Martin, aucune maison ne figure
dans cette voie sur le plan de 1827.
|
PONT
SAINT-JEAN (résidence du)
Nom donné à l’ensemble des 79 pavillons desservis
par les rues d’Assas, Bayard, etc.
Ces logements en semi-collectif ont été
construits dans les années 1970 pour la Société
Coopérative HLM de Brétigny et du Hurepoix. Les
pavillons blancs présentent d’originales toitures à
pan unique.
|
PONT
SAINT JEAN (rue du)
Cette voie est dénommée
ruelle Saint-Jean sur un plan de 1812. Elle tire son nom du
pont qui traverse la voie de chemin de fer (voir Pont Saint-Jean).
[PV G1]
Étampes en lieux
et places, 2003, pp. 68, 69, 116 et 100.
|
|
|
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 464-465. Saisie:
Bernard Gineste, mai 2007.
|

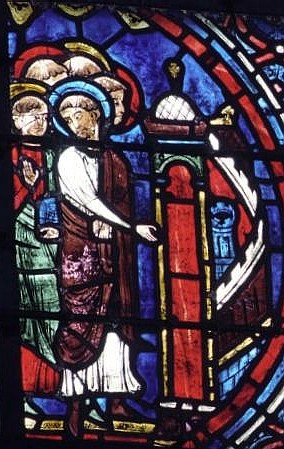

 Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La
première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,
celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),
la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes
de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où
il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition
de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste
il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement
pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison
de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon
Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La
première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,
celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),
la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes
de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où
il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition
de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste
il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement
pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison
de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon 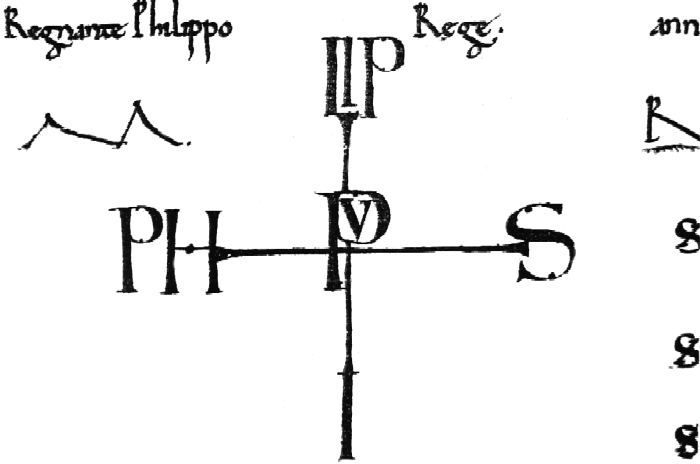 Fleureau a simplifié
le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage
de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte
utilise délibérément une expression typiquement biblique,
Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur
Dieu”, qui désigne régulièrement
dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,
26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;
V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques
XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique
déjà l’expression Domus Dei désignait un
temple.
Fleureau a simplifié
le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage
de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte
utilise délibérément une expression typiquement biblique,
Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur
Dieu”, qui désigne régulièrement
dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,
26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;
V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques
XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique
déjà l’expression Domus Dei désignait un
temple.