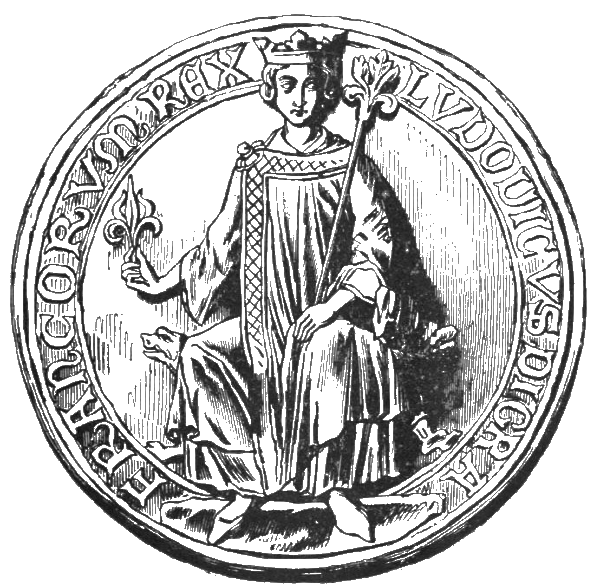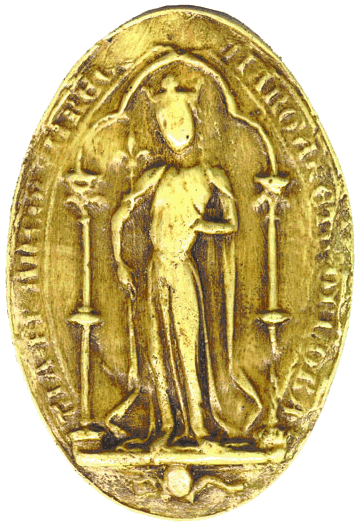Essais historiques sur la ville
d’Étampes
Étampes, Fortin, 1836
Chapitre XII et Notes XI et XII, pp. 169-181 & 221-235. |
Étampes
de 1226 à 1319
|
CHAPITRE
DOUZIÈME
ÉTAMPES DE
1226 à 1319
SUIVI DE
NOTE XI, LE CHIEN PÊCHEUR
NOTE
XII, CHARTE DE CHARLES IV DIT LE BEL
CHAPITRE XII. Étampes sous
le règne de saint Louis. — Blanche de Castille. — Marguerite de Provence. — Maison des pères
Cordeliers. — Chien pêcheur. — Premiers comtes apanagistes
d’Étampes. — NOTE XI: Le Chien Pêcheur.
— NOTE XII:
Charte de Charles IV dit le Bel.
Le territoire d’Étampes n’avait cessé
jusqu’au treizième siècle de faire partie du domaine de la
couronne. Englobé d’abord dans le royaume de Bourgogne, au temps du
roi Gontran, nous l’avons vu ensuite passer entre les mains de Clotaire II,
quand ce dernier prince devint seul maître de toute la monarchie. Depuis
cette époque jusqu’au règne de saint Louis, il n’avait jamais
été détaché de l’héritage de nos rois.
Mais depuis Philippe Ier, les souverains y nommaient un vicomte pour y percevoir
leurs droits et exercer leur juridiction. Par eux l’histoire a conservé
le [p.170] nom de Gui, fils de Hugues du Puiset.
Ce seigneur acquit ce titre par son mariage avec la fille de Marchis qui
possédait déjà cette dignité. On voit par là
que cette charge, du moins à cette époque, était héréditaire
et non une simple commission. Le vicomte Gui n’imita pas l’exemple de la plupart
des seigneurs, qui se révoltèrent contre Louis-le-Gros. Il
lui demeura au contraire constamment fidèle; et plus d’une fois on
le vit combattre vaillamment à côté de son prince, partageant
avec lui tous ses dangers (1).
La période où nous entrons nous montre
la ville d’Étampes sortant de la dépendance directe de la couronne,
pour devenir durant quelques années le brillant apanage d’illustres
souveraines. La première qui se présente est Blanche de Castille,
femme du roi Louis VIII, et princesse aussi distinguée par ses vertus
que par son habileté et son courage. Son époux l’avait déclaré
en mourant régente du royaume, durant la minorité du roi son
fils. Mais de puissans seigneurs, tels que Philippe, comte de Clermont, Thibaut,
comte de Champagne, Pierre, duc de Bretagne, Robert, comte de Dreux, et plusieurs
autres, sous prétexte qu’il était honteux pour la France d’être
gouvernée par une femme étrangère, s’étaient ligués
contre elle. La régente, à cette nouvelle, avait équipé
une armée, et s’était mise en campagne contre ses ennemis.
Déjà la plupart d’entre eux, soumis avant de combattre, s’étaient
réconciliés avec leur souveraine; mais le duc de Bretagne et
le comte de la Marche persistaient dans leur rébellion. Sommés
de [p.171] comparaître devant le parlement
du roi, à Chinon, ils avaient refusé de s’y rendre. Feignant
plus tard un vif désir de rentrer dans les bonnes grâces de
leur jeune monarque, ils vinrent à Vendôme, accompagnés
seulement des gens de leur maison. Le roi, d’après l’avis de la régente,
s’achemina vers eux avec peu de forces. Mais à mesure que le prince
approchait, les rebelles faisaient secrètement avancer des troupes
de leur parti aux environs d’Étampes et de Corbeil. Le jeune Louis,
ne se doutant nullement du piège qu’on lui tendait, poursuivait sa
marche en assurance, quand tout à coup, arrivé à Châtre
(1) sous Montlhéry, il fut averti par
le comte de Champagne, ou, suivant une tradition, par quelques gentilhommes
du pays d’Étampes, du danger qui le menaçait (2). Le roi se retira aussitôt dans le château
de Montlhéry, d’où il fit connaître incontinent à
sa mère le péril dans lequel il se trouvait. La reine Blanche
instruisit sur le champ les Parisiens de la trahison des perfides, et de
la position critique de leur souverain. Le peuple de la capitale, ému
par les prières de cette mère affligée, prend soudain
les armes, accourt délivrer son roi, et le ramène triomphant
à Paris.
|
 (1) Voy. l’Art de vérifier
les dates, t. II [bib] . – Chron. de Morigny.
(1) Voy. l’Art de vérifier
les dates, t. II [bib] . – Chron. de Morigny.
(1) Aujourd’hui Arpajon.
(2) Chron. du sire
de Joinville.
|
Ce fut
peu de temps après cet événement, que la reine Blanche
reçut des mains de son fils la terre et seigneurie d’Étampes,
avec celles de Pontoise, de Dourdan, de Corbeil et de Melun. Ces divers domaines
lui furent concédés en dédommagement de son douaire,
dont elle s’était désistée [p.172]
en faveur de son fils Robert, lors du mariage de ce prince (1237) avec Mathilde,
fille aînée de Henri 1er, duc de Brapant. Ainsi la ville d’Étampes
et son territoire. devinrent dès lors la propriété
de la reine Blanche de Castille, à la charge toutefois de leur retour
après sa mort à la couronne de France.
Le règne de la mère de saint Louis dans ces
contrées, n’est guère connu que par ses bienfaits, ou par ceux
qu’elle répandit ailleurs, à l’aide des revenus de ses nouveaux
domaines. Elle les fit servir en effet à ces pieuses largesses dont
l’histoire de sa vie nous offre tant d’exemples; et le nom d’Étampes
se retrouve ainsi dans les nombreuses donations dont elle enrichit mainte
église et plusieurs monastères. Dans l’abbaye de Notre-Dame
la royale du lys, qu’elle avait fondée près de Melun, et dotée
de pareilles aumônes, la reine Blanche avait rassemblé de jeunes
orphelines de bonne maison, «qui ne trouvaient pas à se marier, dit un vieil historien,
parce que la plus grande partie de la noblesse française allait, par
dévotion, à la guerre en la Terre-Sainte, d’où peu retournaient.» La vallée d’Étampes,
où brillent tant d’autres beaux souvenirs de gloire ou de fidélité,
ne doit point répudier celui d’avoir vu jadis les produits de son sol
consacrés ainsi à l’entretien de ces nobles filles, dont les
pères, morts pour la France au champ d’honneur, n’avaient laissé
à leurs enfans en héritage que la renommée de leurs exploits.
|
|
Il me reste à parler d’une autre abbaye construite vers cette
époque dans l’enceinte même d’Étampes, et dont [p.178] quelques-uns attribuent aussi la fondation
à la reine Blanche de Castille.
|
|
|
C’est le couvent des pères Cordeliers, situé dans
la paroisse de Saint-Gilles, et dont la mémoire se conserve
encore dans le quartier de la ville désigné aujourd’hui par
ce même nom. A cette période du treizième siècle,
Étampes possédait déjà plusieurs asiles ouverts
à la souffrance, ou consacrés à la prière et
aux austères labeurs: La reine Blanche ne devait point régner
sur ces mêmes lieux sans y laisser quelque monument de son passage
et de sa pieuse munificence. Si l’on en croit donc un vieil historien, ce
fut par ses soins qu’on vit s’élever ce vaste monastère des
Cordeliers, dont il ne reste aujourd’hui que quelques parties (1). La tradition du pays, en rapportant que cette
abbaye était l’une des plus anciennes de l’ordre Séraphique
établies en France, et qu’elle fut fondée du vivant même
de saint François d’Assise, s’accorde parfaitement avec le témoignage
de l’écrivain. Le seul aspect de cet antique bâtiment ne permettait
guère d’ailleurs de douter qu’il n’eût été l’ouvrage
de quelque personnage puissant. On chercherait du reste vainement des documens
plus précis et plus exacts sur son origine et sa fondation. Les registres
et les titres des pères Cordeliers d’Étampes devinrent tous
la proie des flammes, lorsqu’en 1567 les calvinistes, s’étant emparés
de la ville, incendièrent leur maison et leur belle église,
dédiée sous l’invocation [p.174]
de saint Jean-Baptiste. Mais quelques années après, grâces
[sic] aux secours de Henri III et de plusieurs seigneurs, l’église
et le couvent furent rebâtis. Les habitans d’Étampes concoururent
aussi par leurs aumônes à cette réédification,
et obtinrent du roi la permission de prendre le bois nécessaire dans
la forêt de Dourdan (1). La nouvelle église
des Cordeliers fut décorée avec magnificence. Les principaux
mystères de la Passion étaient, dit-on, représentés
en bas relief sur le retable du grand autel avec une délicatesse merveilleuse;
et d’admirables vitraux peints ornant les croisées, laissant pénétrer
dans le temple un jour mystérieux.
|
(1) Voy. le Livre de
la naissance et du progrès de l’ordre de Saint-François,
par le P. F. de Gonzague, écrit en latin et imprimé à
Rome l’an 1587 [bib].
(1) Voy. Archives de l’Hôtel-de-Ville.
[Montrond suit ici de très près,
quoique sans le citer, dom Basile Fleureau, Antiquitez d’Estampes,
Paris, Coignard, 1683, pp. 145-146, et notamment par ce renvoi aux archives
de l’Hôtel de Ville, ici (B.G.)]
|
Le même
écrivain qui attribue à la reine Blanche la fondation du couvent
des Cordeliers d’Étampes, remarque qu’il fut en divers temps le séjour
de plusieurs hommes insignes par leur science et leur piété
(2). Il cite entre autres un nommé Louis
de la Plaine qui devint la victime de la fureur des calvinistes, lorsque dans
le seizième siècle, ils s’emparèrent de la ville.
Ce monastère ainsi relevé de ses ruines par les soins de
Henri III et les aumônes des habitans d’Étampes, subsistait
encore en l’année 1789. Vers cette époque l’église fut
détruite, et les religieux dispersés. Mais sur les débris
de leur maison, on a vu dans ces derniers temps se former un autre asile.
Les dames religieuses de la Congrégation, appartenant à
l’ordre fondé au dix-septième siècle par le B. Fourier,
curé de Mattaincourt, ont acheté ces murs [p.175] sis non loin d’un terrain qui fut jadis leur
héritage; et c’est là que de vénérables sœurs,
dévouant leurs soins à l’instruction des jeunes filles pauvres,
poursuivent en paix de nos jours le cours interrompu de leurs premiers bienfaits
(1).
S’il m’était
permis de mêler quelques souvenirs moins graves à l’austère
sujet qui nous occupe, je pourrais peut-être égayer ici le
lecteur, en rappelant l’histoire non d’un chien savant, tel que les
Munito de nos jours, dont on applaudit les talens stériles,
mais d’un barbet vraiment utile autant qu’ingénieux; et qu’une tradition
badine prétend avoir été pendant plusieurs années
le pourvoyeur adroit du réfectoire des pères Cordeliers. Sa
pêche aux écrevisses était une invention aussi singulière
que nouvelle; et elle doit être rangée parmi les notions dont
on pourrait conclure que l’instinct chez certains animaux approche quelquefois
tellement de la raison qu’il semble se confondre avec elle. Il parait du
reste que l’adresse de ce barbet, et l’utilité que les Cordeliers
en retiraient, l’avaient rendu célèbre, puisqu’un des habitans
d’Étampes ne dédaigna pas de lui consacrer un poème
entier. Nous en rapportons les principaux fragmens à la fin du volume,
et nous y renvoyons le lecteur pour qu’il puisse juger à la [p.176] fois du mérite de l’ouvrage et de
l’adresse du héros (1).
|
(2) Fr. de Gonzague. —
Voir l’ouvrage cité plus haut [bib].
(1) Sur l’ancien terrain qu’occupaient autrefois les
religieuses de la Congrégation, on a construit, il y a dix ans environ,
un grand et beau bâtiment dit aujourd’hui le grenier d’abondance. Il
est situé au milieu de vastes jardins, et il fut ainsi établi
par les soins de MM. d’Arblay pour servir de magasin de subsistances. Il a
pris depuis peu une autre destination.
(1) Le chien pêcheur, ou le barbet des Cordeliers
d’Étampes, poème héroï-comique en latin et en
français, fut composé en l’an 1714 par Claude-Charles Hémard
de Danjouan, jeune habitant d’Étampes. Les vers latins en sont purs,
élégans et corrects. La traduction en vers français,
du même auteur, mise en regard du texte, nous semble inférieure.
Mais malgré quelques tournures de phrases singulières et des
expressions souvent un peu triviales, elle n’est pas dépourvue elle-même
de finesse et d’originalité. (Voir à la note XI [ici] à la fin du volume, les fragmens de
ce poème.)
|
A la mort de Blanche de Castille (1er décembre 1252) la seigneurie
d’Étampes rentra dans le domaine de la couronne. Mais quelques années
après, elle en fut détachée encore pour composer avec
d’autres terres le douaire de la reine Marguerite de Provence, femme de saint
Louis. Cette illustre princesse avait suivi le roi dans la croisade, et elle
s’était distinguée par des traits de fermeté et de courage
dignes de son héroïque époux. Son pouvoir sur la ville
d’Étampes se signala aussi par de pieux bienfaits (2).
Nous ferons ici une remarque
importante, et cette remarque, applicable aux pages qu’on vient de lire,
peut l’être aussi en quelque sorte à plusieurs points de nos
précédens récits. Plus d’un lecteur sera surpris de
ne voir les règnes brillans de saint Louis, Blanche de Castille et
Marguerite [p.177] de Provence, liés
à l’histoire particulière d’Étampes, que par le souvenir
des dotations religieuses dont ils gratifièrent cette contrée
ou quelques territoires voisins. Mais si, dans cette occasion comme ailleurs,
nous avons paru donner trop de place à des détails du même
genre, à défaut de faits plus intéressans, qu’on veuille
bien se rappeler que durant le moyen âge , la science, bannie de la
cour et des villes, s’était réfugiée presque toute entière
au fond des cloîtres. Quand les monastères recueillaient seuls
alors l’histoire des faits et gestes de nos aïeux; n’était-il
pas naturel qu’ils s’attachassent surtout à fixer la mémoire
des événemens où leur nom et leurs intérêts
se trouvaient mêlés? Ainsi lorsque nos regards, fouillant dans
nos annales, découvrent à peine quelques faibles traces d’actions
plus importantes, ils rencontrent souvent de minutieux détails sur
une foule de fondations qui n’ont plus pour nous aujourd’hui qu’un bien mince
intérêt. Si des passages plus précieux de nos fastes
nationaux sont aujourd’hui perdus, n’en accusons donc que l’ignorance de
nos pères; mais ne blâmons point l’historien des anciens âges,
lorsque, parcourant un champ trop souvent stérile, il s’en vient
humblement demander aux abbayes antiques les seuls documens que leurs chroniques
aient conservés.
La seigneurie d’Étampes
retourna de nouveau entre les mains des rois de France, à la mort de
la reine Marguerite (20 décembre 1295): mais elle en sortit bientôt
encore. Le roi Philippe-le-Hardi avait ordonné en mourant, que Louis,
l’un de ses fils, fût apanagé de 15,000 livres de pension annuelle,
assignées sur des terres nobles en [p.178]
baronnie. Philippe IV, dit le Bel, fidèle aux dernières volontés
de son père, céda à son frère, en paiement de
cette somme, la jouissance perpétuelle pour lui et ses descendans,
de la prévôté et châtellenie d’Étampes, d’Évreux,
Gien et autres lieux.
|
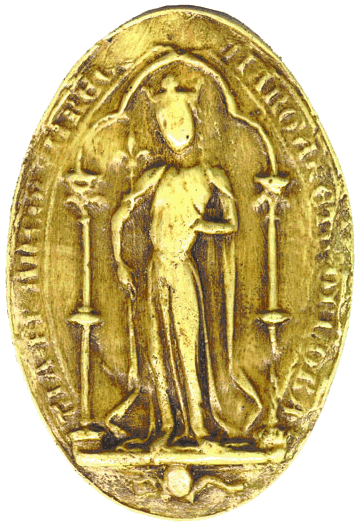
(2) Le
douaire de Marguerlte de Provence avait été assigné par
son contrat de mariage sur la ville et le comté du Mans; mais le roi
Louis IX ayant dans la suite donné ses biens à son frère
Charles d’Anjou, pour augmenter son apanage, transporta sur d’autres domaines
le douaire de cette princesse; et c’est alors que le territoire d’Étampes,
avec ceux de Corbeil, Dourdan, la Ferté-Aleps, etc., devint sa propriété.
|
Quelques auteurs
ont cru reconnaître dans ce même prince Louis, premier comte
d’Évreux, le premier comte apanagiste d’Étampes; mais leur
opinion n’est appuyée sur aucun solide fondement. Dans des titres
des années 1309 et 1313, nous voyons le frère de Philippe-le-Bel,
se qualifier fils de roi de France, comte d’Évreux; mais il
ne prend nulle part le titre qu’on a voulu si gratuitement lui attribuer.
|
|
Louis d’Évreux
figure avec honneur dans plusieurs événemens importans des
annales de la France. Sa fidélité envers son souverain ne se
démentit jamais; et dans une occasion mémorable, il sut le
défendre même au péril de ses jours. C’était à
la fameuse bataille de Mons-en-Puelle, gagnée par Philippe-le-Bel,
contre les Flamands (1304). Avant que la victoire se décidât
pour les Français, un échec inattendu avait menacé nos
troupes. Le roi avait été désarçonné;
l’oriflamme qu’on portait près de lui venait d’être abattue,
et ses gens se voyaient de toutes parts entourés d’ennemis. Soudain,
Louis d’Évreux, aidé de nobles chevaliers, accourt au fort
de la mêlée, délivre son frère, et en sauvant
le roi, concourt puissamment au gain de la bataille (1). [p.179]
|
(1)
Chron. de Guill. de Nangis. —
Chron. de Pierre d’Oudrighert.
|
Quant aux actions
de Louis d’Évreux qui se rattachent plus particulièrement à
l’histoire d’Étampes, il est juste de rappeler le titre qu’il fit publier
le 24 mars 1309, en faveur des habitans de son territoire. A cette époque
la vallée d’Étampes n’était point, comme il parait qu’elle
le fut plus tard, découverte et dégarnie de bois, Une vaste
et belle garenne occupait alors, dit-on, toute la plaine des Sablons, et
s’étendait sur les collines près de la ville et du château
(1). Or, il arriva que les lapins, les lièvres
et autres bêtes, dont cette garenne était l’habituel asile,
causèrent de si grands dommages sur les terres voisines, que les habitans
d’Étampes, de Brière et de Villeneuve, voyant ainsi leurs labeurs
sans fruit et inutiles, s’en plaignirent hautement. Ils présentèrent
une supplique à leur seigneur, afin qu’il leur permît de détruire
un bois si fatal à leurs récoltes, lui offrant un dédommagement
pour les revenus qu’il pouvait en tirer. Le prince Louis, touché des
justes plaintes de ses vassaux, consentit à leur demande; et moyennant
la somme de 2,000 livres tournois, il leur vendit cette belle forêt,
qui ne tarda pas sans doute à tomber sous la hache des nouveaux possesseurs.
|
(1)
C’est ce même lieu qu’on nommait plus communément la Varenne,
par le changement du G en V, selon un usage ordinaire chez nos aïeux [Montrond suit ici de très près, quoiq ue
sans le citer, dom Basile Fleureau, Antiquitez d’Estampes, Paris,
Coignard, 1683, pp. 145-146, ici (B.G.)].
|
C’est en vertu
des clauses exprimées dans ce titre de vente, que les habitans d’Étampes,
plusieurs siècles après, revendiquaient le droit de chasser
librement sur les terres des environs, pour détruire le gibier qui
ravageait leurs blés ou leurs vignobles. [p.180]
|
|
A la mort de
Louis d’Évreux, ses deux fils exécutèrent le partage
que leur père avait fait de ses biens (1319). L’aîné hérita
du comté d’Évreux, et Charles, son puîné, reçut
à son tour le territoire d’Étampes, Gien-sur-Loire et d’autres
seigneuries. Le second de ces princes épousa Marie, comtesse de Biscaye,
petite fille d’Alphonse X, roi de Castille, et de Blanche de France, fille
de saint Louis. C’est vers cette époque que le roi Charles IV, dit
le Bel, érigea en faveur de Charles, son cousin, la baronnie d’Étampes
en comté (1). Cet événement
ne doit point passer inaperçu dans l’histoire de cette ville. On découvre
ici encore une nouvelle preuve de cette constante affection dont nos souverains
lui donnèrent tant de marques. Nous avons vu le territoire d’Étampes
possédé tour à tour par deux reines célèbres,
mère et épouse du plus saint de nos rois. Si cette seigneurie,
rentrée un instant dans le domaine de la couronne, en sort de nouveau,
c’est pour devenir le brillant apanage de princes du sang royal, frères
ou fils de monarques. Quelques années se sont écoulées
à peine, et voilà que Charles-le-Bel, jette des regards flatteurs
sur ce même territoire, et à cause de l’aménité
du lieu, de l’abondance, de la richesse de ses fruits, transforme
son titre de baronnie en un nom plus élégant (2). Dans la suite des temps,
nos rois feront plus encore, ils érigeront en duché le sol de
la vallée d’Étampes. Enfin [p.181]
quand ils voudront doter d’un bel et gracieux présent, les nobles dames
dont la beauté aura su gagner leur cœur, c’est encore cette riante
vallée qu’ils choisiront pour leur offrir les gages de leur amour.
|
(1)
La charte donnée à cette occasion, est datée du mois
de septembre 1327. On conserve encore aux Archives du royaume (Trésor
des chartes), l’original même de ce titre. Voir ci-après, à
la note XII, à la fin du volume, une copie de cette pièce [ici].
(2) Voy. les termes mêmes
de l’acte d’érection [ici].
|
Ici je dois borner la première partie de ma tâche. Cette
course paisible à travers les différens âges d’une cité
n’est point pour l’historien dénuée de charme et d’un vif intérêt.
Mais, comme le voyageur qui visite des contrées diverses, il doit s’arrêter
en certains points de sa carrière. De là il fixe des yeux le
chemin qui lui reste encore à parcourir, et parfois il s’effraye à
l’aspect des aspérités de la route. Si pourtant, durant ce
temps, il voit ses premiers récits obtenir un favorable accueil, il
sent que ses forces ne défailleront point; car alors il a reçu
un précieux encouragement à de nouvelles veilles, à
de nouveaux efforts.
|
|
CHAPITRE
XII. Étampes sous le
règne de saint Louis. — Blanche de Castille. — Marguerite de Provence. — Maison des pères
Cordeliers. — Chien pêcheur. — Premiers comtes apanagistes
d’Étampes. — NOTE XI: Le Chien Pêcheur.— NOTE XII: Charte de Charles IV dit le Bel.
|
|
NOTE
XI.
(Chap. XII, p.176)
LE CHIEN PÊCHEUR,
ou
Le Barbet des Cordeliers d’Étampes
POÈME HÉROÏ-COMIQUE, en latin et en français.
[p.222]
|

Æmilius Bayard
delineavit, Ettling sculptavit, anno 1868.
|
|
CANIS PISCATOR.
Qua per odoriferos Stemparum Naïades
hortos
Implicuere duos, undis concordis, amnes
Nympha Loë, germana Loës et Junia Nympha,
Est antiqua domus sacris habitata colonis,
(Seraphidas dixere pio cognomine Patres,)
|
LE CHIEN PÊCHEUR
Dans ce charmant vallon où Loëte et sa soeur
Unissent deux ruisseaux d’inégale grosseur,
S’élève un bâtiment d’architecture antique,
De tout temps habité par l’Ordre Séraphique.
|
|
Frondibus umbrosis et amœnæ
cespite ripæ
Grata domus, grati jucundior arte Catelli,
Non huic de trivio genitor, nec degener ipse
Fert oculis atavos et totam pectore gentem:
|
Un verger le couronne et des
arbres épais
Y donnent à qui veut le couvert et le frais.
Par mille autres endroits ce séjour est aimable,
Mais un Barbet surtout le rend considérable.
Issu d’illustre race, il porte dans ses yeux
Le beau feu qu’y jetta le sang de ses ayeux.
|
|
Crispula cæsaries,
patrium Barbatulus unde est
Cognomen, vultique* refert animoque leones,
Viribus inferior, per quas nec tendere cervis,
Se neque fulmineos valeat committere in apros
(Nam quis Seraphidis non sic venantibus, usus?)
Liminis hinc custos latratibus impiger arcet
Quos auferre videt potiùs quàm
afferre paratos;
|
Des flots de ses longs poils
l’élégante frisure
Imite du lion la vaste chevelure.
La nature, il est vrai, par une heureuse erreur,
Le revêtit d’un corps bien moindre que son cœur.
Aussi n’étant pas né pour la chasse ordinaire,
Inutile talent dans un bon Monastère,
Il se borna d’abord à garder la maison,
Aboyant le passant, quelquefois sans raison,
Lorsqu’il le voit surtout vêtu de telle sorte
Qu’il vient en demander plutôt
qu’il n’en apporte.
|
* Vultique, lisez vultuque (B.G.)
|
Idem blandus heris, notoque
affabilis ori,
Quisquis Seraphicis incesserit ornamentis.
Sed cui commissa est beneolentis cura culinæ, [p.223] [p.224]
Gratior is, quotiesque pium vectigal ab urbe,
Hinc collectitium, perâ bipatente,
lyæum
Inde refert cererem, sub pondere fessus amico,
Obvius it peram Barbatulus ambit odoram,
Quàque potest gratum reduci testatur amorem.
|
Aux
Pères, comme il doit, toujours il rend honneur [p.224] [p.225]
Aux Frères fait sa cour, et
surtout au quêteur.
De plus loin qu’il revoit ce moissonneur habile
Courbé sous le doux faix des présents de la ville,
Par l’odeur attiré comme par un aimant,
Il court, en sa façon lui fait son compliment.
|
|
At simul assandas verubus transfigere
carnes
Viderat, invisæ tum vertere terga culinæ,
Quærere tum latebras, longi memor ille laboris
Suspensam versare rotam qui sæpe coactus,
Sisyphus infœlix refluumque Ixionis orbem.
..........
..........
..........
|
Mais aussi lorsqu’il sent le
temps du souper proche,
Il craint plus que le feu le maudit tourne-broche.
Quel supplice en effet! toujours en action,
Pour le plaisir d’autrui tourner comme Ixion!
..........
..........
..........
|
|
Ecce sed ecce dies, nativis
currere ripis
Quo permissa Loë dudum captiva. Nec olim
Qui nunc est, mediam cursus fuit ire per urbem.
Qua tulit ingenium, pratis errabat amœnis
Nympha Loë, nostras incassùm viseret arces
Sæpè rogata Loë. Congestis, haud mora, cives
Molibus impedière fugam: tumet illa redundatque
Illatam sibi vim indignata, sed ire necesse est,
Ac licèt in pronas rapiat se plurima valles.
Parte tamen meliore sui invisam alluit urbem,
Urbem invita beat, centum variata per artes,
Dum sibi quisque rapit, gratamque moratur in hortis
Hospitem et irriguâ fœcundat gramina Nymphâ.
Ne tamen hinc Stempana sibi gens speret amicam
Neu sibi concessi gratetur præmia Cancri. [p.225] [p.226]
|
Enfin il arriva ce moment souhaité
Qui tira le talent de son obscurité.
C’étoit ce jour heureux où la Nymphe captive,
Pour quelque temps retourne à son aimable rive,
Rive qu’elle forma, qu’elle chérit toujours,
Où malgré tous nos vœux l’entraîneroit son cours,
Si de nos citoyens l’audacieuse ligue
N’opposoit à ses flots une puissante digue.
Après combien d’efforts! que de
rudes combats!
Mortels, de ce succès ne vous élevez pas.
Vous sentirez le poids de toute sa vengeance:
Elle entrera chez vous malgré sa répugnance;
Mais si vous profitez du fruit de son séjour,
Vous ne pourrez jamais mériter son amour.
|
|
Quod dedit ambiguum est, videas
in munere et iram:
Bella minax totusque tibi denunciat hostem.
Scillicet a summo cataphractum vertice corpus
Tergeminæ cinxere manus, Briarea putaras*,
Insuper et bifidis armant hastilia chelis,
Nec, quamvis se retrò ferat, minùs
inde timendus;
Parthica tela gerit certum fugitivus in ictum.
Nec satis: at celeres mutabile corpus in annos
Anguis more dedit spolium ponentis et ævum:
Ignibus ut Phœnix, juvenescit Cancer in undis.
Hinc animi, hinc fortis ridere pericula virtus,
Nec, si fortè** manum sævum
truncaverit hostis,
Sit labor: est jactura levis reparabilis artus.
Ah! digitus fixus quoties horrentibus hæsit
Cancer! et excussam vellent amittere prædam
Prædones avidi, jam lucrum exitiale perosi!
Ah! fœdi quoties piscantum sanguine fluctus
Victor et hostilis se ingurgitat amne cruoris!
Irrita sic Nymphæ recidebant dona malignæ:
Vimineæ ei* quos nassæ vel inescat
arundo
Subdola, rara tamen, nec erat par præda labori;
Nullusdum veram potiendi noverat artem.
Scilicet egregio laus hæc servata Catello
Ut novus Alcides recidivam frangeret hydram.
Fulserat ille dies, miseris subducere Cancris
Quo fluvium; solitique Loën permittere Cives
Ingenio, certas, purgetur ut alveus, horas.
Commata rumpuntur, rapido simul impete torrens [p.227]
[p.228]
Effugit: attonitos linquunt sua flumina pisces.
Qualis hians refugos captat cum Tantalus amnes,
Sic refluas Cancri mirantur cedere lymphas:
Se quoque retro ferunt patriam retinere fugacem
Si valeant; medio quærunt in flumine flumen.
|
Le don qu’elle vous fait
vous déclare la guerre.
L’Écrevice est terrible et sur l’onde et sur terre;
Quoique cet ennemi recule quelquefois,
Ne vous y fiez pas, prenez garde à vos doigts. [p.226] [p.227]
Il n’est en tout son air rien qui ne vous
menace;
Il a le casque en tête, il porte la cuirasse,
Et comme Gérion, par six bras défendu,
Il perce jusqu’au sang le pêcheur éperdu.
On voit l’onde rougir, et la Nymphe outragée
S’applaudit en secret d’être si bien vengée.
Elle boit à longs traits la sanglante
liqueur,
Et pour comble de rage en nourrit le vainqueur.
Pour lui, par un bienfait à nul autre semblable,
Comme un nouvel Achille, il est invulnérable.
Ainsi lors quelquefois, dans ses affreux combats,
Que pour sauver le corps il abandonne un bras,
Un autre bras succède et bientôt le remplace.
De là cette valeur, de là vient cette audace
Qui lui fait prodiguer ces membres étonnants,
Mille fois emportés, mille fois renaissants.
Bien plus, son corps entier souvent se renouvelle,
Il quitte son écaille, en prend une plus belle,
Et tel que le Phénix, reproduit tout nouveau,
Dans son sépulchre même il trouve son berceau.
Tel étoit le présent de la Nymphe
hautaine,
Si l’on en profitoit, ce n’étoit pas sans peine.
Et la peine toujours surpassoit le profit.
L’Hydre trouva l’Hercule enfin qui le défit.
Trois hyvers écoulés, on lève la barrière,
Qui dans un lit forcé captive la rivière.
Le fleuve impétueux s’échappe en un moment,
Et laisse les poissons hors de leur élément.
Comme un autre Tantale on y voit sur les rives
L’Écrevice cherchant les ondes fugitives. [p.228] [p.229]
|
* putaras, lisez putares
(B.G.)
**
et non fortes comme écrit
Pinson (B.G.)
* et non
pas si comme écrit Pinson (B.G.)
|
Plebs ruit interea, pisces
rapiuntur inermes:
Rete manus: nec Seraphides cessare, sed altâ
Succintus tunicâ vacuum se mittit in alveum
Horrea Cancrorum, fœtas et piscidus ædes
Herboreâ scrutans ripâ. Canis ipse secutus,
Ut mos, olfaciens, huc errabundus et illuc
Dum fert ora cavis explorans naribus hostes,
Vellera corripiunt contracto forcipe Cancri,
Prædam quippe rati stringuntque tenacibus ulnis.
Excutit ille jubas, vultumque in terga retortus
Tela timet, dextramque ululans implorat herilem.
Hic simul aspexit, monstrum simul admiratus:
Ergo Canes undis venantur, dixit, in ipsis
Arte novâ! Tyrius (narrat sic fama) Catellus
Muricis inventor, patulis conchylia testis
Littore dum quærit, rutilantia purpurat ora.
Tu melioris ades, Barbatule, muneris autor:
Purpura nil nobis: sed egentibus utilis esca.
|
Alors chacun s’empresse à
prendre part au gain,
Et les poissons, ce jour, se pêchent à la main.
Tous profitent du temps, il n’est pas jusqu’au Frère
Qui, les bras retroussés, en tunique légère,
Ne cherche l’Écrevice en ses antres profonds.
Barbet le suit aussi, Barbet fait mille bonds;
Et sans crainte foulant le bourbeux marécage,
Va flairant dans les trous qui sont sous le rivage,
L’Écrevice aussi-tôt le prend pour un appas,
Et de sa double serre entr’ouvrant le compas
Par ses crins le saisit; un autre vient ensuite.
Le Barbet vers son maître à l’instant prend la fuite.
Que vois-je, juste Ciel, s’écria celui-ci,
Barbets en ce pays pêchent-ils donc aussi?
De la pourpre autrefois ils montrèrent l’usage,
L’Écrevice est pour nous un plus grand avantage.
|
|
Dixit, et insoliti captus
dulcedine lucri,
Rursùs inire jubet, panemque immittit ituro.
Involat ille celer, prædâque superbus opimâ
Mox redit. O domini quæ gaudia, qui complexus!
Ille referre vicem promptusque capescere jussa, [p.229] [p.230]
Quidlibet amplecti docilis. Quid multa? Catellum
Informavit herus piscarier, ire sub ipsos.
|
Il dit, et sans délai,
d’un signe de la main
Il lui marque sa route en lui jettant du pain.
La fortune à l’envi, Barbet, te favorise;
Tu retournes chargé d’une nouvelle prise.
Qui pourroit exprimer le plaisir, le transport
Dont le Frère est ravi le revoyant à bord?
Dans ses bras il le prend, le baise, le caresse;
Barbet en sa façon, répond à sa tendresse,
Et par reconnaissance autant que par honneur,
Se porte à son devoir avec plus de vigueur. |
|
Mox ubi consuetis rediêre
canalibus, amnes
Neve recursantum jam suffocetur aquarum
Vortice, pelliceo circumligat ora capistro,
Haud aliter quàm cùm teneri illaqueantur aselli,
Ne lac nocte bibant quod heri sitit aspera tussis.
|
Lorsque dans son canal la
Nymphe est revenue,
Toujours avec succès la pêche continue.
On le voit enhardi, méprisant le danger,
Se jetter dans les eaux, sous les flots se plonger. [p.230] [p.231]
Le Frère plus prudent prend une gibecière,
En fait à son plongeur comme une muselière.
Le nouvel amphibie étant ainsi masqué,
Contre un double ennemi ne sera plus risqué.
|
|
Addit et inventam Cancros arcessere
fraudem,
Lardo terga linit coriumque effingit inunctum.
Ille dato, qualis victurus Olympia, signo
Præcipitat, fundoque catus se sternit in imo.
Nec mora, de toto concurrere flumine, Cancri,
Quos hærere simul sentit, velut horridos* hystrix
Emicat. Ergo renidenti Fraterculus ore
Detrahit annumerans, perâque capace recondit.
Nec semel est fecisse satis, sed sæpè sub amnes
Ire, redire Canis, numerumque implere coactus
Quem sibi Seraphicæ poscunt dispendia cœnæ.
|
Mais pour mieux amorcer l’imprudente
Écrevice,
Le Frère ajoute encore un nouvel artifice.
De certain composé de sympathique odeur
Il parfume le poil de l’athlète pêcheur.
L’ennemi le croit mort, saisit son appanage.
Le Barbet ressuscite et revient à la nage.
Tel qu’on voit quelquefois du milieu d’un buisson
Le dos armé de traits sortir un hérisson,
Tel on voit le Barbet reparoître avec gloire
Chargé de toutes parts du fruit de sa victoire.
Le Frère en souriant le décharge aussi-tôt,
Au fond d’un vaste sac met la pêche en dépôt,
Puis vers un autre endroit à l’instant le renvoie
Se charger, s’il se peut, d’une nouvelle proie.
Il ne l’en quitte point qu’après la quantité
Qu’il juge suffisante à la Communauté. |
* horridos, lisez horridus (B.G.)
|
Sin levis, impatiens, tergo
rediisset inani,
Tum caperans frontem, nodosæ verbere zonæ
Increpat. At supplex veniam velut ille precatus
Sternitur exululans, functusque labore supremo
Concutit inde pilos faciemque aspergit herilem,
Et multo hinc illinc depexus tergora linctu,
More triumphantis dominum prævertit ovantem
Ire domum properans, ad amicæ regna culinæ,
Hic ubi miratur calido dum Cancer aheno
Æstuat, ut subitam donarit purpura mortem. [p.231] [p.232]
|
Même si quelquefois,
par trop de promptitude
Il s’en revient à vuide, alors d’une voix rude,
Il lui frappe les flancs des nœuds de son cordon,
Par ses cris le Barbet lui demande pardon.
Mais lorsqu’il a fini sa pénible carrière,
Et secoué trois fois son humide crinière,
Dont un léger brouillard jusqu’au Frère jaillit,
D’une langue légère enfin il se polit.
Alors tel qu’un César montant au Capitole,
Glorieux et content vers le logis il vole. [p.232] [p.233]
C’est là que le vainqueur pour comble de plaisir,
Sur un ardent brasier voit l’ennemi rougir.
Il en tressaille d’aise, en repaît sa colère,
(Leçon qu’apparemment il ne prit pas du Frère,)
Et contemple étonné le caprice du sort
Qui lui donne la pourpre en lui donnant la mort.
|
|
Hinc honor, hinc pretium nostro
crevêre Catello,
Utilitas simul unde venit, venit unde voluptas.
Nam quibus insulsum sæpissimè cœna legulem,
Sæpius heu! fuerat, densis hinc fercula stipant
Seraphidæ Cancris et egestas copia facta est.
Scilicet extremas famâ vulgante per oras,
Advena quisque erat, lepidum, mora nulla Catellum
Visere, et hospitio Patrum invitatus aperto
Non expectatos epuli miratur honores,
Anceps hæc mensis infertur ut esca secundis
Morice fulgenti: molles enucleat artus, [et non Murice]
Quæque medullosos celant femoralia succos
Exuit, et surgens stimulandi verrit aceto.
Nempè cibus stomachoque levis, gratusque palato
Dote valet geminâ, dapis et medicaminis instar.
Sic pascebat heros et herûm pascebat amicos
Ære Canis nullo: sed nec sine fœnore messis.
Largiter effuso quamquam renuentibus auro
Lætus abit, lætosque Patres conviva relinquit.
Muneris in partem veniebat muneris autor,
Nec jam quisquiliæ, vilis fastidia mensæ,
Crusta sed omne genus, blandique fuêre susurri.
Nec misero deinceps placuit vexare rotatu
Lucrificas exercentem melioribus artes
Auspiciis, fluvioque velut Pactolus in aureo
Regnat Seraphicæ Barbatulus arbiter undæ.
|
Ainsi notre Barbet devint considérable,
Joignant par ce moyen l’utile à l’agréable.
Avant lui quelquefois et toujours trop souvent
Le simple potager nourissoit le couvent.
Par ce nouveau secours, du sein de l’indigence,
On vit avec surprise éclore l’abondance.
L’Étranger qu’attiroit ce fait prodigieux,
Goûtoit avec plaisir ce mets délicieux.
Sur la fin du repas cette viande ambiguë
De son brillant éclat réjouissoit la vuë.
Le vinaigre aiguisant l’appétit émoussé,
A manger de nouveau chacun se sent pressé.
La chair en est salubre, agréable et légère,
Enfin à peu de frais on faisoit bonne chère.
Le voyageur content de l’hospitalité,
En partant signaloit sa libéralité.
Barbet avoit aussi sa part de ses largesses,
Quantité de reliefs et beaucoup de caresses.
Ainsi n’étoit-ce plus ce rôtisseur chétif,
Il exerçoit un art beaucoup plus lucratif,
(Un autre tourne-broche avoit rempli sa place,)
Il n’étoit occupé qu’à sa paisible chasse.
Comme en un fleuve d’or ce pactole pêcheur
Faisoit de sa maison la richesse et l’honneur. [p.234] [p.235]
|
|
Proh superi! humanis quænam
est fiducia rebus.
Quam breve quod dulce est! dictum pudet: area laudis. [p.233] [p.234]
Quæ fuit, infandæ spectacula præbuit
iræ.
Causa necis virtus, nimio dum fervidus estu
Irruit infrænis, nullo moderante magistro,
Indignata Loë tumidis involvit in undis.
Proh pudor! infestis fecit convivia Cancris.
Ergo diu cuncti luxere, diutiùs ille
Qui præcepta dabat, lepidâ formarat et arte,
Unus in ore Canis: Barbatulus, sæpè ciebat
Eheu non auditurum, neque responsurum!
|
Que la fortune, hélas!
par un seul tour de roue,
Des plus nobles projets insolemment se joue!
Qui jamais l’eût pensé, que dans ces mêmes lieux
Qui furent les témoins de ses faits glorieux,
Le vainqueur succombant sous les traits de l’envie,
Pour toute récompense, y dût perdre la vie?
Son audace, il est vrai, lui procura la mort.
(Le Frère étoit absent,) il veut prendre l’essort,
Sans ce guide fidèle et sans sa muselière,
Téméraire il se lance au fond de la rivière.
La Nymphe cette fois saisit l’occasion,
Et satisfait enfin sa longue aversion.
Elle anime ses flots, excite une tempête.
En vain le Barbet nage, en vain lève la tête,
Il fallut succomber. O ciel! il ne vit plus!
Pour le chercher, hélas! que de soins superflus!
Chacun est attentif si le Barbet abboye.
L’Écrevice à son tour en avoit fait sa proye.
|
|
At quoniam revocare nefas,
nec verter fatum
Seraphidæ possunt, invisæ margine lymphæ
Effigiem posuêre Canis, sub imagine carmen.
— «Hic piscator hic est cujus
solertia nuper
Aurea Seraphicæ renovarat sæcula genti,
Quem sors eripuit postquam invida, regnat egestas
Longum heu! regnatura, nisi tu forte, viator,
Pellis et auriferum supplet tua dextra Catellum.» —
|
Tous et sur-tout le Frère
en pleure amèrement;
Et pour l’éterniser par quelque monument,
Sur ce bord on élève un riche cénotaphe
Où l’on grave ces vers en forme d’épitaphe.
— «Tel étoit ce Barbet
de qui l’habileté
Suppléa si long-temps à notre pauvreté.
Hélas! il ne vit plus. Nous sommes sans ressource,
La Parque en nous l’ôtant, nous a coupé la bourse.
Qui peut nous consoler dans un si grand malheur?
Qui peut nous secourir? Ta charité, Lecteur.» —
|
|
Ludebat
CLAUDIUS CAROLUS HÉMARD DE DANJOUAN,
Stempanus adolescens, anno 1714
|
Traduit
par l’Auteur.
|
|
CHAPITRE
XII. Étampes
sous le règne de saint Louis. — Blanche
de Castille. — Marguerite
de Provence. — Maison
des pères Cordeliers. — Chien
pêcheur. — Premiers
comtes apanagistes d’Étampes. — NOTE XI: Le Chien Pêcheur. — NOTE XII: Charte de Charles IV
dit le Bel.
|
|
|
|
NOTE XII.
Charte de Charles IV, dit le
Bel,
portant érection de la baronie d’Etampes en Comté. (1327.)
(Chap. XII, p.180.)
Carolus Dei gratia Francorum,et Navarrae Rex. Ut ordo
dignitatum congruâ dispositione servetur, Regiae Majestatis circumspectio,
merita personarum, convenientiamque locorum diligenter attendens, ad decorem
Reipubliae personas, et loca quibus convenit, insigniis praerogativae potioris
attollit. Hanc sanè considerationem primitùs frequenter, et
providè revolventes, ad carissimum, et fidelem Karolum de Ebroicis,
consanguineum nostrum, ejusque Baroniam de Stampis convenienter direximus
aciem nostrae mentis, dignum, et congruum arbitrantes, ut inclyta praefati
consanguinei nostri, qui claris natalibus, ex stirpe nostrâ regiâ
non ambigitur descendisse, nobilitas [p.238]
praedictae Baroniae de Stampis amoenitate loci, copia feodorum, rerum, et
fructuum opulentiâ ab antiquis temporibus praepollenti, perpensioris
nobilitatis obtineat, per nostrae regiae liberalitatis munificentiam titulum
superaddi: dictaque Baronia per regiam Majestatem in nomen elegans, et elegantiae
dignioris transfusa, praefato consanguineo nostro, juxta sui conspicuitatem
honoris, ejusque successoribus, ad quos ipsam Baroniam devenire continget,
nobilius adaptetur. Ea propter notum facimus, universis, tam praesentibus,
quàm futuris, quòd nos Baroniam praedictam, praesenti statuto
pragmaticè diffinito, in Comitatum duximus erigendam: et dignitate
comitali, de speciali gratia, perpetuo exornandam: dictumque consanguineum
nostrum praedicti Comitem Comitatus; cum honore pleniore comitali, de nostrae
regiae plenitudine potestatis constituimus, et creamus: dilectis, et fidelibus
nostris Paribus Franciae, Ducibus, Comitibus , Baronibus, caeterisque nobilibus,
Justiciariis, et subditis regni nostri Franciae, praesertim ipsius subditis
Comitatus, praesentium tenore mandantes, ut ipsi praedictum Comitem, consanguineum
nostrum, ejusque in Comitatu hujus modi successores, ex nunc, et in perpetuum,
ut Comites venerantur: et ad honores, privilegia, libertates, Comitibus solitas
exhiberi, quibus eumdem consanguineum nostrum, ejusque in Comitatu praedicto
posteros successores praesentibus insignimus, et etiam communimus, recipiant
et admittant: ipsosque tractent eum debita reverentia, ut Comites in agendis:
Nostro in aliis, et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum, et stabile
permaneat in futurum, nostrum praesentibus litteris fecimus apponi sigillum.
Actum [p.239] Parisius, anno Domini millesimo
trecentesimo vigesimo septimo, mense septembris. Per Dominum Regem. Tho. Théor.
(Extrait du Trésor
des Chartes, aux Archives du royaume. Au titre Étampes, f° 124,
n°4.)
L’original de cette pièce qu’on peut voir
au Trésor des Chartes, est sur parchemin, orné d’un très
beau sceau pendant en cire verte, retenu par un lacet de soie verte et rouge.
Le roi y est représenté sur son trône, soutenu par deux
lions , portant dans la main droite son sceptre , et à la gauche la
main de justice. Autour, on lit cette inscription: Carolus Dei gratiâ
Francorum, et Navarrae Rex.
FIN .
|
 (1) Voy. l’Art de
vérifier les dates, t. II. – Chron. de Morigny.
(1) Voy. l’Art de
vérifier les dates, t. II. – Chron. de Morigny.
(1) Aujourd’hui Arpajon.
(2) Chron. du sire
de Joinville.
|
CHAPITRE
XII. Étampes sous le
règne de saint Louis. — Blanche de Castille. — Marguerite de Provence. — Maison des pères
Cordeliers. — Chien pêcheur. — Premiers comtes apanagistes
d’Étampes. — NOTE XI: Le Chien Pêcheur.— NOTE XII: Charte de Charles IV dit le Bel.
|
|
|
BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Clément-Melchior-Justin-Maxime
FOURCHEUX DE MONTROND (dit Maxime de MONTROND ou de MONT-ROND), «Chapitre
douzième» & «Note
XI. Le Chien Pêcheur», Essais historiques
sur la ville d’Étampes (Seine-et-Oise), avec des notes et des
pièces justificatives, par Maxime de Mont-Rond [2 tomes reliés
en 1 vol. in-8°; planches; tome 2 «avec des notes... et une statistique
historique des villes, bourgs et châteaux de l’arrondissement»],
Étampes, Fortin, 1836-1837, tome 1 (1836), pp. 169-181 &
221-235.
Réédition numérique
illustrée en mode texte:
François BESSE, Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE [éd.],
«Maxime de Montrond: Essais historiques
sur la ville d’Étampes (1836-1837)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-montrond.html,
2012.
Réédition
numérique de ce chapitre: François BESSE & Bernard GINESTE [éd.],
«Maxime de Montrond: Étampes
de 1226 à 1319 (1836)» [édition numérique
illustrée en mode texte], in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-montrond1836chapitre12.html,
2012.
Sources
alléguées par Montrond
Franciscus GONZAGA (Francisco
GONZAGA, religieux franciscain, évêque de Mantoue, 1531-1611),
De origine seraphicae religionis Franciscanae ejusque progressibus,
de regularis observanciae institutione, forma administrationis
et legibus libri IV, opus in quatuor
partem divisum, cum figuris aeneis [in-f°;
4 parties en 1 volume; pièces liminaires, 1364 p.; indices], Romae
(Rome), ex typ. Dominici Basae, 1587, p. . Dont
une
Réédition [in-4°], Venetiis (Venise),
ex typographia Dominici Imberti, 1603.
1) [Claude-Charles HÉMARD DE DANJOUAN], Le
Chien pêcheur ou le Barbet des Cordeliers d’Estampes, poëme héroï-comique
en latin et en françois [in-8°,
15 p., vers 1720] [sans
lieu ni date] [non vidi].
2) Révérend Père Pierre-Nicolas
DESMOLETS [continuateur], A.-H. de SALLENGRE [†], Continuation des Mémoires
de littérature et d’histoire [11 vol. in-8°], Paris, 1726-1731
[aliter: (11 vol. in-12), Paris, 1730-1732),R.P. DESMOLETS, Mémoires
de littérature, t. X, pp. ?-? [non vidi].
3) Michel de CUBIÈRES-PALMÉZEAUX
[pseudonyme de Jean Antoine LEBRUN-TOSSA (1760-1837), alias Père
Ignace de CASTEL-VADRA, DORAT-CUBIÈRES, ENÉGISTE-PALMÉZEAUX,
Monsieur de MARIBAROU, MÉTROPHILE, C. de PALMÉZEAUX, C.-D.
TAVEL, chevalier de MORTON], Épître à Gresset, au
sujet de la reprise du ‘Méchant’ par les Comédiens français
qui a eu lieu... en 1811. Suivie de deux ouvrages de ce poète célèbre
qui ne sont dans aucune édition de ses œuvres, et d’une épître
à un jeune provincial intitulée: ‘l’Art de travailler aux
journaux’, par l’ex-R. P. Ignace de Castelvadra [Par J.-A. Lebrun-Tossa.]
[in-8°; 93 p.; les deux poèmes attribués ici à
Jean-Baptiste-Louis GRESSET, le Chien pêcheur et La Musique,
poème ne sont en fait pas de cet auteur], Paris, Moronval, 1812.
[non vidi].
4) Maxime de MONTROND, «Note XI (Chap. XII,
p. 176). Le Chien Pêcheur ou Le Barbet des Cordeliers d’Étampes.
Poème héroï-comique en latin et en français»
[édition en fait partielle], in ID., Essais historiques sur la ville d’Étampes. Tome 1,
Étampes, Fortin (& Paris, Debécourt), 1836, pp. 221-235.
Dont une mise en ligne par le Corpus Étampois,
http//www.corpusetampois.com/che-19-montrond1836chapitre12.html#chienpecheur, 2012.
5) Ernest MENAULT (1830-1903), L’intelligence
des animaux [in-16, XVI+351 p.; dédié à Paul Boudet,
ancien ministre de l’intérieur, avec une brève lettre de celui-ci
acceptant cette dédicace; nous ne savons pas avec certitude si les
gravures étaient déjà insérées dans
les deux premières éditions], Paris, Hachette [«Bibliothèque
des merveilles»], 1868 [au moins douze éditions française
de 1868 et quatre anglo-saxonnes de 1869 à 1885; petite partie du
texte français: pp. 217-219 de l’édition de 1913; gravure de
Bayard p. 217].
6) Paul PINSON, Le Chien Pêcheur ou
le Barbet des Cordeliers d’Estampes, poëme héroï-comique
en latin et en françois, suivi de trois hymnes sur SS. Can, Cantien
et Cantianille et d’une hymne grecque inédite sur S. Basile reproduite
en fac-simile, par Claude-Charles Hémard de Danjouan, précédés
d’une notice biographique et généalogique sur l’auteur,
Paris, Léon Willem [72 p.], 1875.
7a) Bernard GINESTE [éd.], «Claude-Charles
Hémard de Danjouan: Le Chien Pêcheur (1714)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-18-hemard-chienpecheur.html,
2003.
7b) Bernard GINESTE [éd.], «Claudius-Carolus Hemarida
Danjuanus Stempanus: Canis Piscator (1714)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-18-hemarida-canis.html,
2003.
Maurice-François
DANTINE (1688-1746), Ursin DURAND (1682-1771) & Charles CLÉMENCET
(1703-1778), L’Art de vérifier les dates des faits historiques,
des chartes, des chroniques et autres anciens monumens depuis la naissance
de Notre-Seigneur, par des religieux bénédictins de la congrégation
de S. Maur [in-4°; 7 parties en 1 volume], Paris, G. Desprez, 1750.
François CLÉMENT (1713-1793),
[éd.], L’Art de vérifier les dates des faits historiques,
des chartes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis la naissance
de N.-S. 3e édition, par un religieux bénédictin de
la congrégation de S. Maur [in-f°; 3 volumes], Paris, A.
Jombert jeune, 1783-1787.
De SAINT-ALLAIS [éd.], L’Art de
vérifier les dates..., depuis la naissance de Notre-Seigneur...
par un Religieux de la congrégation de Saint-Maur, réimprimé...
et continué... par M. de Saint-Allais [in-80; 19 volumes; table],
Paris, 10 rue de la Vrillière, 1818-1830.
De SAINT-ALLAIS [éd.], L’Art de
vérifier les dates... avant l’ère chrétienne... mis
en ordre par M. de Saint-Allais [in-f°], Paris, 1820.
David Baillie WARDEN [éd.], L’Art
de vérifier les dates. 4e partie. Chronologie historique de l’Amérique,
par M. D. B. Warden [in-8°; 10 volumes & 1 volume de tables;
L’Art de vérifier les dates depuis l’année 1770 jusqu’à
nos jours formant la continuation ou 3e partie de l’ouvrage publié
sous ce nom par les religieux bénédictins de la congrégation
de Saint-Maur. T. IX-XVIII. Le volume de table est relatif aux vol.
9 à 12 de cette 3e partie], Paris, A. Dupont & Roret & A.-J.
Dénain, 1826-1844.
Tome I, p. 217 (de quelle édition?):
établit que l’interdit a été proclamé en janvier
1200 à Vienne en Dauphiné pour l’Interdit, et non à
Dijon.
Toute critique, correction
ou contribution sera la bienvenue. Any
criticism or contribution welcome.
|