Voici un nouveau document
à verser au dossier un peu maigre de l’histoire
du onzième siècle étampois.
Il s’agit de quatre notices rédigées sur
deux parchemins à la fin du XIe siècle et au
début du XIIe. Toutes sont relatives au village
de Vierville, actuellement en Eure-et-Loir, mais où
étaient alors possessionnés plusieurs nobliaux
étampois. Du reste Vierville releva du baillage
d’Étampes tout au long de l’Ancien Régime.
Ces notices
ont déjà connu une édition
fragmentaire et une traduction partielle par Édouard
Lefèvre en 1867 dans ses Documents
historiques et statistiques sur les communes du canton
d’Auneau, mais personne ne semble y avoir pris
garde depuis, ni être retourné consulter
les originaux beaucoup plus détaillés pourtant
disponibles aux Archives départementales
de Chartres*.
Thion Chef-de-Fer,
fils d’Étienne Chef-de-Fer, était
au départ un nobliau possessionné
notamment à Denonville (également
aujourd’hui en Eure-et-Loir, mais relevant alors
du pays d’Étampes). Cette famille était vassale
des châtelains de Courville-sur-Eure, qui l’étaient
eux-mêmes des sires de Gallardon, eux-mêmes
dépendant de l’autorité des sires de Fréteval.
Thion avait épousé une fille du vidame de Chartres
Guerry dénommée Hersent, qui lui avait donné
deux enfants, à savoir Hardouin Chef-de-Fer et sa
sœur Milsent, elle-même mariée à Gauthier
II d’Aunay-sous-Crécy.
Thion Chef-de-Fer, du vivant de son épouse,
prit l’habit des moines de Marmoutier,
apparemment à leur prieuré de Chuisnes,
fondé semble-t-il vers 1080. Il entreprend alors,
vers 1090, d’acquérir, au bénéfice
des moines, tout le village de Vierville. Il convainc
d’abord son gendre Gauthier et sa fille Milsent,
qui l’avait eu en dot, de leur céder tout ce qu’ils
y détenaient.
Mais cela obtenu, la tâche ne fait
que commencer. La seigneurie de Vierville est
en effet morcelée en un grand nombre de fiefs
qu’il importe de récupérer de ci
de là, avec à chaque fois l’accord des
parents du donateur ou du pseudo-donateur (car
la plupart de ces donations sont en fait des ventes
déguisées). La détention
des biens fonciers est alors régie par le
système féodal, qui est une structure
pyramidale où chaque transaction, don, vente
ou échange nécessite l’accord de tous
les échelons de cette pyramide, avec à
chaque fois l’accord de tous les ayant-droit de chaque intervenant.
|

*
Les remarquables érudits
de l’ancien département de Seine-et-Oise
de la fin du XIXe siècle et du début du
XXe, débordés par la tâche,
n’ont pas pu explorer toutes les ressources documentaires
du pays chartrain. Depoin fait deux fois allusion à
nos notices mais en les situant aux Archives du département
de l’Eure. Quant à Merlet, dans son inventaire-sommaire
des Archives d’Eure-et-Loir publié en 1897, il ne
paraît pas connaître l’édition partielle
qu’en avait donnée Lefèvre en 1867.
En 1912, Métais cite nos notices mais en donne un résumé
plutôt confus, largement erroné.
|
Ces nombreuses transactions
se déroulent en différents lieux,
dont certains seulement sont cités expressément,
où Thion se déplace pour solliciter
l’accord des personnes concernées.
Plusieurs habitent à Étampes. Ces
transactions ont un caractère essentiellement
oral et rituel, et c’est pourquoi il est absolument
nécessaire d’enregistrer à chaque fois
le nom des personnes qui pourraient éventuellement
en témoigner s’il s’élevait une
contestation du donateur ou de ses ayant-droit,
ce qui se produit fréquemment, et comme c’est
apparemment déjà le cas du vivant de Thion. Au
total sont mentionnées d’une manière ou
d’une autre plus de deux cents personnes.
C’est une
lourde tâche que de les identifier une par
une, en essayant d’en retrouver la trace dans d’autres
documents de la même époque, soit
du côté étampois, soit du côté
chartrain. C’est ce que j’ai entrepris ici
en consacrant à chacune des personnes nommées
une notice où se puissent enregistrer au fur
et à mesure toutes les données disponibles,
éparpillées dans divers documents dont
certains ne sont pas encore édités. Cette
tâche ne sera pleinement terminée que lorsqu’auront
été collectées toutes les données
disponibles sur toutes les personnes connues dans le
secteur à la période considérée,
tâche qui prendra plusieurs années*. La recherche est en effet
compliquée par le fait que toute enquête sur les personnages
concernés nécessite des recherches dans
au moins quatre de nos départements actuels:
Essonne, Eure-et-Loir, Yvelines et Loiret, sans parler
de ce qui se pourrait trouver à Paris. Or la présente
première édition de ce texte ne représente
qu’un an de travail.
|
*
Je dois remercier ici Michel
Martin de m’avoir communiqué un
relevé onomastique numérisé de son
cru, qui m’a aidé à repérer plusieurs
données intéressantes et complémentaires
dans des documents que je n’avais pas encore consultés.
|
Il semble que la rédaction
de nos quatre notices s’échelonne
de la fin du XIe siècle (entre 1092 et 1096
pour les dix premières) au début de XIIe,
peut-être sur plus d’une dizaine d’années,
au fur et à mesure des succès
qu’enregistre le moine Thion Chef-de-Fer. La première
est celle à laquelle j’ai donné
le nom de A, au début du premier parchemin.
Elle est reprise, détaillée et complétée
par la notice B, qui occupe le deuxième parchemin.
Plus tard, apparemment au début du XIIe siècle,
sont notées de nouvelles transactions
à la suite de la notice A sur le premier parchemin:
ce sont les notices C et D.
|
|
Ces quatre notices sont ici
traduites et annotées. Après
un bref commentaire, on y joint et on joindra, en
Annexe 6, 7 et 8, le texte de quelques dizaines d’autres chartes
mettant en scène les mêmes personnages,
déjà éditées pour la plupart,
mais ici traduites pour la première fois.
Ce sont des chartes qui ne concernant
pas directement le pays d’Étampes. Par ailleurs
en effet je renvoie et renverrai à d’autres
chartes où apparaissent les mêmes personnages,
mais qui méritent chacune d’être éditées
à part dans notre Corpus Étampois.
|
|
On notera que cette
édition, qui n’a rien de définitif,
prend le risque de traduire des
textes qui présentent un grand nombre
de données prosopographiques et toponymiques,
c’est-à-dire un grand nombre
de noms propres. Il s’y glissera donc presque nécessairement
des erreurs, ou des hypothèses
qui ne s’imposent pas. On mise ici sur l’indulgence
des internautes et des chercheurs, et surtout
sur leur réactivité. N’hésitez
pas à nous communiquer vos réactions
ou suggestions, quelles qu’elles soient.
Merci de nous signaler également
toutes les coquilles ou incohérences que
vous constateriez dans ce travail, qui n’a pas encore
acquis sa forme définitive
Bernard Gineste, 11 mai 2008
(révisé en janvier 2009)
|
|
|
A. Pays d’Étampes sous influence
chartraine
Les notices que nous éditons ici concernent
donc un village situé dans une zone frontière
relevant à la fois du pays d’Étampes et de celui
de Chartres, et il est nécessaire pour en comprendre
les données d’avoir une idée générale
de la situation du point de vue chartrain, situation nettement
mieux connue que celle du pays étampois à la même
époque, pour laquelle une synthèse serait actuellement
prématurée.
Il existe à l’époque considérée
un comte de Chartres (comes), un vicomte de Chartres
(vicecomes), et un vidame de Chartres (vicedominus).
1. Le comté de Chartres appartient
alors à la famille des comtes de Blois. A Thibaut
III (1037-1089) succède son fils Étienne-Henri
(1089-1102), époux d’Adèle d’Angleterre, fille
de Guillaume le Conquérant. Étienne-Henri part
en Palestine de 1096 à 1098, puis de 1101 à 1102,
date de sa mort lors la bataille de Rama, en Palestine. Il laisse
un enfant de neuf ans qui sera Thibaud IV dit le Grand (1102-1152),
sous la régence d’Adèle, sœur d’Henri Ier d’Angleterre,
amie d’Yves de Chartres et d’Anselme de Cantorbéry,
jusqu’en 1107. Le comte n’apparaît pas ni n’est même
mentionné dans nos notices; le secteur semble dépendre
alors seulement du vicomte, Hugues Blavons.
2. La vicomté de Chartres fut
donné en effet en 1073 par Thibaud III à Hugues
Ier du Puiset, dit Blavons, cadet d’un vicomte précédent,
Évrard. Hugues Blavons s’était emparé
du château royal du Puiset en 1067, profitant des troubles
de la minorité du roi Philippe Ier. En 1079, le nouveau
seigneur du Puiset, désormais vicomte, mène
une fronde victorieuse contre l’autorité du roi, dont l’armée
est battue à plates coutures devant le Puiset.
Marié
à la fille d’un autre grand vassal du roi, Guy
Ier de Monthléry, il meurt selon les conjectures de Dion, reprises
sans examen par Depoin, en 1094: mais nous trouvons dans le
Cartulaire de Saint-Père une charte
de lui datée expressément de 1096.
C’est
à sa cour, réunie en pleine Beauce à
la grange de Boisville-Saint-Père, et non pas à
celle du roi de France, que le chevalier étampois
Payen fils d’Anseau donne son assentiment à la donation
de Vierville aux moines de Marmoutier.
C’est une bonne preuve de l’éclipse que connaît
alors l’autorité royale dans le secteur, dont les
historiens ne paraissent pas avoir pris la mesure jusqu’ici.
En revanche, vers 1123, c’est-à-dire sous Louis VI,
qui a vengé en 1111 l’humiliation du Puiset, le
consentement du même Payen d’Étampes à des
donations dans le même secteur se fera en présence
du roi.
3. Le Vidamé de Chartres d’abord
tenu par un certain Renaud était passé à
son premier fils Aubert, mort en 1032, puis à son
cadet Hugues I encore vivant en 1059. En 1063 nous voyons
que c’est son fils Guerry qui a pris le relais; il est paraît
être mort vers 1089, date à partir de laquelle nous
voyons sa veuve Helsent tutrice de leur fils Hugues II.
Guerry et Helsent avaient eu également
une fille dénommée Hersent, qui avait épousé
le chevalier Thion Chef-de-Fer et lui avait donné deux enfants, Hardouin
Chef-de-Fer et Milsent. Il avaient eu aussi un deuxième fils, Étienne, qui fut plus tard abbé
de Saint-Jean-en Vallée, puis patriarche de Jérusalem,
de 1128 à 1130.
Helsent et son fils
Guerry étaient possessionnés dans le secteur, comme
on le voit par les trois exemples suivants, respectivement à Roinville-sous-Auneau,
Manterville et Vierville:
1) En 1079 il est mentionné
que l’église Saint-Georges de Roinville-sous-Auneau
est détenue pour moitié par Hersent (et par son fils Hardouin
Chef-de-Fer), et pour moitié par Ade, veuve
du vidame Hugues I et mère du vidame Guerry.
2) Helsent était possessionnée
tout près de là à Manterville,
comme on le voit d’une des ses
donations vers 1108 au bénéfice du monastère de Saint-Jean-en-Vallée.
3)
Hugues détenait la moitié de
Vierville, dont il était aussi le dominus
capitalis, seigneur principal, notion qui reste à éclaircir,
mais qui semble supposer que lorsque le village avait été
légué en fait à sa sœur Hersent (qui l’avait elle-même
donné à sa fille Milsent), on avait
réservé les droits de son frère aîné
sur ce bien.
Un fait est
de plus à remarquer, comme particulièrement troublant et
intéressant pour l’histoire d’Étampes: tant à Vierville
qu’à Manterville la seigneurie est partagée entre la famille
vicomtale de Chartres et certains Étampois, qui paraissent de ce
fait avoir une ascendance commune. Une moitié de Vierville est
tenue par Gauthier de Guillaume, fils de Bernoal d’Étampes,
et la villicatio ou mairie de Vierville est tenue par
Payen fils d’Anseau. Or nous retrouvons le même Payen fils d’Anseau
possessionné à Manterville lors de la donation qu’en fait
Helsent vers 1108.
Tout semble indiquer que Payen fils d’Anseau
était apparenté à la famille des vidames de Chartres,
dont son père était sans doute sorti à la génération
précédente. Nous y reviendrons.
4. La
châtellenie d’Auneau est alors tenue par Hugues de Gallardon, fils aîné d’Hervé
Ier de Gallardon, mort en 1092, et de Béatrice
d’Auneau, elle-même fille de Guy Ier de Montlhéry
et d’Hodierne de Gometz, sœur d’Alais de Montlhéry.
Hugues de Gallardon est par suite le neveu de la femme
d’Hugues Blavons du Puiset, vicomte de Chartres.
C’est
à cette période semble-t-il que se
dessine pour des siècles le sort de cette zone frontière
relevant à la fois de Chartres et d’Étampes. Le secteur d’Auneau dépendait à
l’origine du puissant comté de Rochefort, dont les seigneurs
étaient vraisemblablement possessionnés à
Étampes même, d’où sans doute l’actuelle
rue au Comte, dont le nom est attesté dès
1237, bien avant qu’il y ait eu des comtes d’Étampes.
Mais ce comté
de Rochefort fut progressivement démembré,
et la seigneurie d’Auneau tomba vers cette époque
dans la zone d’influence des vicomtes de Chartres, eux aussi
possessionnés à Méréville, à
Étampes, et à Morigny.
|

Denier de Thibaud III de Chartres (1050-1090)
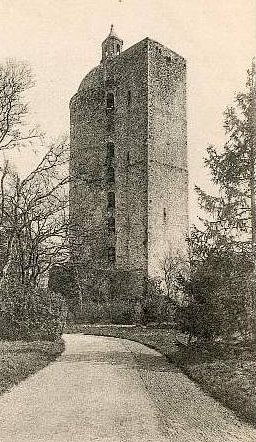
Donjon
d’Auneau, élevé par
Hugues de Gallardon entre 1090 et 1100
|
B. Les familles des donateurs principaux,
Gautier et Milsent
1. La
famille d’Aunay. Le donateur principal de Vierville est
un certain Gautier d’Aunay. J’ai réuni en
Annexe 7 toutes les chartes que j’ai
trouvées dans le secteur qui relatives à cette
famille et je crois avoir établi les faits suivant.
Gautier I d’Aunay-sous-Crécy
(près de Dreux) est son premier membre connu. Il
paraît essentiellement possessionné en Beauce,
et, mentionné dès les alentours de 1067, il est
mort avant 1082. Gautier, qui semble avoir épousé
une sœur du chevalier Hugues de Nonant-le-Pin, laisse cinq
fils: Gounier, Jocelyn, Gautier II, qui est notre homme, donateur
de Vierville, Arnoux et Garin.
Rainaud d’Aunay est son frère
cadet; il est aussi appelé, d’après
l’une de nos notices, Rainaud des
Têtières, hameau
d’Unverre en Dunois où il est possessionné.
Il paraît encore vivant à l’époque de la
donation de Vierville, vers 1094, et paraît même survivre
à son neveu Gautier II.
Gounier
succédant à son père
Gautier, s’appelle d’abord Gounier de Molitard,
près Châteaudun, ce qu’il indique qu’il est
possessionné de ci de là depuis Dreux jusque
dans le pays dunois. Je propose d’identifier ce personnage
à un chevalier du même nom qui tenait Bayeux
en 1105 pour le compte le duc de Normandie Robert Courteheuse,
et qu’Orderic Vital nous dit avoir été un neveu
d’Hugues de Nonant-le-Pin, lui même gouverneur de Rouen
à la même époque: il est alors fait prisonnier
par Henri Beauclerc, roi d’Angleterre. Dès 1108 nous le
voyons de retour au pays, et qualifié de Saint-Avit,
ayant récupéré cette terre après la
mort de son frère cadet sans descendance. Vers 1115 il
paraît résider pour un temps à Orléans.
Il vit longtemps, sans doute près de quatre-vingts ans, car on
a encore trace de lui vers 1146.
Jocelyn paraît être mort
jeune et sans postérité.
Gautier II reçoit Saint-Avit-les-Guespières
en héritage; il épouse Milsent, fille
du chevalier Thion Chef-de-Fer, qui reçoit en
dot Vierville, possession de sa mère Hersent, dame de
Denonville, qui le tenait elle-même de son père le vidame
Guerry, son frère aîné Guerry en demeurant le dominus
capitalis; mais, sans postérité, ils cèdent
Vierville aux moines de Marmoutier dont Thion Chef-de-Fer
a pris l’habit du vivant de sa femme.
Nous voyons Gautier résider avec sa femme,
au moment de la donation, à Saint-Avit-les-Guespières,
où ils ont un régisseur particulier de
ce domaine, tout à fait en dehors de notre secteur.
Une charte de Saint-Père
de Chartres nous le montre en conflit avec ce monastère
au sujet de l’église d’Épeautrolles, entre
Saint-Avit et Chartres, qui avait été donnée
aux moines par Hugues de Dreux. Avec sa femme il est cité
cependant comme bienfaiteur par l’obituaire de Saint-Jean-en-Vallée
Chartres.
Après
la mort de Gautier, ses biens semblent être retournés
à son frère aîné, qui prend
nom Gounier de Saint-Avit, vers 1108.
Arnoux d’Aunay ne nous est connu
que par deux de nos notices (qui en revanche ne mentionnent
ni Gounier ni Jocelyn, le premier peut-être absent
alors de la région, et le second mort jeune sans descendance).
Garin, témoin de l’une de
nos transactions, par contre est bien documenté, et
nous connaissons même les noms de ses cinq enfants survivants.
Il fut surnommé Torcul,
c’est-à-dire Pressoir,
sans doute parce qu’il
pressurait ses tenanciers, surnom qu’il transmis à son fils
Aubert, dit Payen Torcul.
2. La famille Chef-de-Fer. Si Vierville
est aux mains de Gautier II d’Aunay, c’est que sa femme
Milsent l’a reçu en dot, de sa mère Milsent,
fille du vidame Guerry, sœur du vidame Hugues
et dame de Denonville, qui avait
épousé un chevalier du château de Courville-sur-Eure,
Thion Chef-de-Fer, lui-même possessionné,
semble-t-il, à Chuisnes.
Étienne
Chef-de-Fer est cité
entre 1048 et 1060, avec ses deux fils Thion et
Aimon.
Un Vivien Chef-de-Fer est cité dans
le Vendômois vers la même époque (de 1065 à
1069) dans l’entourage du chevalier Guismand de Vendôme (fils
de Guismand de la Chappe et d’Aimeline fille d’Hugues Doubleau, ce dernier
fondateur de Montdoubleau et fidèle d’Eudes II de Chartres).
C’est sans doute l’un de leur parents proches.
Thion Chef-de-Fer, fils
d’Étienne, est cité à Courville entre 1064 et 1079 comme témoin,
avec son oncle Aimon et son fils Hardouin. Puis en 1079, avec sa femme Hersent et son fils Hardouin comme possessionné à
Roinville. Vers 1080 à Bréthencourt comme s’étant
fait moine de Marmoutier. Viennent ensuite nos notices,
antérieures au moins pour les premières
à 1096, et postérieures à 1092.
Hardouin est ensuite
cité à plusieurs reprises, notament par une
charte qui précise qu’il est un chevalier du sire
de Courville. Il aura lui-même un fils nommé
Hugues.
Je donne
en Annexe 6 tout ce que j’ai trouvé
pour l’instant sur cette famille.
|

Henri Ier
Beauclerc d’Angleterre,
qui prit Bayeux en 1105 à Gounier
d’Aunay,
frère de notre Gauthier II d’Aunay

La sorte
de heaume qui donne
son nom à la famille Chef-de-Fer
|
A Vierville Gautier détient (du chef de sa femme)
le village même de Vierville, l’église
avec l’enclos qui l’entoure, où est le cimetière,
la dîme et de droit de sépulture afférents,
et une terre de deux charrues qui doit constituer la réserve
seigneuriale, exploitée directement par les serfs du
maître des lieux. Gautier et Milsent paraissent seigneurs
de tout le finage, qui est donné à fief à différents
exploitants principalement étampois, où sont prélevés
le champart, redevance en nature due à la moisson, et les autres droits coutumiers, tant dans le village même
qu’à l’extérieur.
Il s’agit d’un fief qui est tenu pour
une moitié du vicomte de Chartres, dominus capitalis
du village. Ce dernier terme est ambigu. Faut-il comprendre
que le dominus capitalis est le détenteur du droit de chevage, exigible
de chaque résident? Je tendrais plutôt à croire
qu’on est plutôt en présence ici d’un principe féodal
formulé explicitement à une époque ultérieure,
et qui réserve à la branche aîné d’une famille
le droit de récupérer un bien qui tomberait en déshérence
par extinction de la branche cadette qui l’a reçu en partage. Quoi qu’il en soit, l’autre moitié du village
est tenu par Gautier en fief d’un Étampois, Guillaume fils de
Bernoal.
La pyramide féodale paraît
ici relativement complexe, car on remarquera que l’autorisation
du seigneur d’Auneau paraît requise pour
ce qui est des donations de Gautier et de Guillaume fils de Bernoal,
mais non pas pour celle du vidame de Chartres. Il faut donc intercaler
le seigneur d’Auneau dans cette pyramide entre le vicomte de Chartres,
seigneur principal du village, et Guillaume d’Étampes.
Intervient-il ici comme héritier de droits ayant
appartenu originellement à la châtellenie de Rochefort?
Quoi qu’il en soit, Vierville,
reçu en dot par Milsent, était une possession
de sa mère, dame de Denonville, qui l’avait
elle reçu en dot, en même temps que Denonville et que,
nous le savons par ailleurs, la moitié de l’église
Saint-Georges de Roinville-sous-Auneau. L’autre moitié de cette église
de Roinville-sous-Auneau était détenue par Ade, veuve
du vidame Hugues et mère du vidame Guerry. L’avait-elle reçu
en douaire de son mari, ou apportée en dot? Il nous manque certains
chaînons pour démêler avec certitude l’origine de la
situation complexe que nous constatons vers 1094. Ainsi nous constatons
qu’ont alors des droits sur Vierville deux descendants de lits différents
de la vidamesse Ade, Hugues fils de son premier mari Guerry, et l’Étampois
Payen, petit-fils de son second mari Jocelyn II de Lèves.
Gautier d’Aunay, qui réside
en fait avec sa femme Milsent dans son propre fief de
Saint-Avit-les-Guespières, n’exploite pas lui-même
ce domaine, qui est donné en fief, depuis sans doute
déjà la génération précédente,
à des gens du pays d’Étampes, qui ont acquis
au fil du temps des droits et des possessions héréditaires
difficiles mais non impossibles à démêler.
Ainsi par exemple
l’Étampois Aubert fils d’Anseau, détient pour sa part deux tenures, avec le champart
afférent. Il les a données en fief à un certain
autre Étampois.
Plus curieusement son
frère aîné Payen fils d’Anseau détient
ce qui semble être la mairie du village (villicatio),
c’est-à-dire probablement le titre de régisseur
(villicus ou major) et surtout les revenus
et droits afférents à cette charge. Il l’a donnée
en fief aux deux frères Arnaud fils d’Aubrée
et Godéchal fils d’Oury: deux tiers au premier, le troisième
tiers au deuxième. Il y détient certainement aussi
des tenures comme son frère cadet.
***
D’où viennent les
droits sur Vierville (comme aussi à Manterville) des Étampois
Payen et Aubert fils d’Anseau? Selon toute apparence de leur père
Anseau: car il faut l’identifier, contrairement à ce qu’en
a écrit jadis Joseph Depoin, avec un certain Anseau fils de
Jocelyn, c’est-à-dire de Jocelyn II de Lèves, qui avait
épousé la même Ade ou Adèle après la mort
de son premier mari.
Adèle avait eu de son premier mari le vidame de Chartres
un fils, Guerry, qui lui succéda et eut lui même pour
fils Hugues II. Après la mort d’Hugues Ier, après 1059,
Adèle se remaria avec Jocelyn II de Lèves dont elle
eut, outre Jocelyn III, un Anseau fils de Jocelyn qui s’installa à Étampes, et qui fut le père de notre Payen fils d’Anseau (dont
le véritable nom de baptème était Isembard). De la
sorte Guerry et Anseau étaient frères utérins, et
par suite, l’Étampois Payen fils d’Anseau et le vidame Hugues
II fils de Guerry, cousins germains, issus tous deux de la vidamesse
Adèle, dont tout indique qu’elle avait été la
première détentrice de la seigneurie de Vierville.
|

Cérémonie d’hommage
féodal (XIIIe siècle)
|
Avec les deux frères Arnaud et Godéchal,
nous atteignons semble-t-il le plus bas niveau de la pyramide
seigneuriale et nous nous rapprochons de celui des exploitants
réels du village. Ils sont frères, mais par
un parent seulement, situation à l’époque extrêmement
fréquente; et nous ne savons pas lequel, car l’un
est dit fils d’Aubrée (cette femme étant apparemment
celle qui a donné son nom au hameau d’Aubray dans le territoire
de l’actuelle commune, toute proche, de Mérobert), et
l’autre fils d’Oury de Vierville. Cet Oury dit de Vierville était
selon toute apparence déjà lui-même fieffé
des vidames de Chartres, sans doute surtout au titre de sa femme
Aubrée.
1. Arnaud, qui est Étampois,
et que nous connaissons par ailleurs comme bienfaiteur
de l’abbaye de Morigny, est le mieux loti. Il tient en fief
la moitié du village, à savoir semble-t-il la
partie que Gautier tient lui-même du vidame de Chartres;
il a de plus pris à fief de Payen d’Étampes
les deux tiers du fermage (villicatio) de Vierville.
2. Godéchal pour sa part réside
à Méréville; il détient huit
tenures, dont il perçoit le champart et les dîmes
afférentes, plus le tiers restant du fermage (villicatio),
et encore d’autres menus biens et droits, qu’il finit par
donner intégralement, sentant la mort venir, contre le droit
de revêtir à son dernier jour l’habit monachal qui le
mettra sous la protection de saint Benoît.
3. Amaury Roux d’Ablis, autre
Étampois, tient encore à fief deux tenures d’Aubert,
frère cadet de Payen.
Par ailleurs, apparemment quelques années plus
tard, deux autres exploitants nous sont signalés
par leurs donations; ils exploitent peut-être des alleux
échappant à la pyramide féodale,
car aucun consentement n’est donné à leurs donations,
hormis celles de leurs propres parents et collatéraux;
cependant on peut aussi penser qu’il s’agit de terres qu’ils
tenaient en fief des donateurs précédents, et
qu’ils étaient donc, dès avant leurs donations,
passés sous la seigneurie des moines de Marmoutier:
4. Rainaud
fils de Thiou donne une terre non identifiée
du nom de Lomlu.
5.
Geoffroy de l’Eau, ou de l’Ève, ou de Lèves,
fils de Félicie, enfin, donne également
une terre d’une charrue et trois tenures. C’est sans doute
le fils d’un Thibaud de l’Eau (ce qui se disait en ancien français
de l’Ève), ou
de Lèves signalé à Étampes en
1082 par une charte de Philippe Ier. Dans le cadre de l’hypothèse
que nous avons développée plus haut au sujet d’Anseau,
qui serait Anseau de Lèves, on pourrait imaginer que ce Thibaud
ait été son frère, également installé
à Étampes, et que notre Geoffroy ait été
un autre cousin de Payen fils d’Anseau.
|

Labour au XIe siècle
(Saint-Zénon de Vérone)
|
E. Installation de nouveaux serfs
Les donateurs, Gautier et son épouse Milsent, envisagent
dès le départ la faculté pour les donataires
d’installer à leur gré de nouveaux
hôtes sur le terroir de Vierville.
De fait Hersent et Hardouin,
mère et frère de Milsent, à la sollicitation
de Thion Chef-de-Fer, leur ex-époux et père,
donnent à cet effet ultérieurement aux moines quatre
familles de colliberts, c’est-à-dire
de serfs, celles des fils et filles d’un certain Geoffroy.
On entrevoit aussi
dans le secteur un certain Constance, serf
des moines de Marmoutiers originaire de leur prieuré champenois de Ventelay; ils paraissent
gérer leurs ressources humaines, comme on dit aujourd’hui, à l’échelle nationale.
|
|
F. Résumé des 18 transactions
1. Gautier d’Aunay
se rend à Marmoutier pour poser l’acte de donation
du village de Vierville sur l’autel de saint Martin. — 2. Milsent Chef-de-Fer
fait le même don à Saint-Avit-les-Guespières:
elle donne rituellement un rameau de sureau à un serf censé
représenter le prieur de Marmoutier de passage à
Chuisnes. — 3. Arnaud fils d’Aubrée, chez lui à
Étampes, donne la moitié de Vierville qu’il tient à
fief de Gautier, plus une part de l’autre moitié du village qu’il
tient à fief de l’Étampois Payen fils d’Anseau, avec l’accord
de son frère Godéchal fils d’Oury. —
4.
Hardouin Chef-de-Fer, frère de
Milsent, consent à Chuisnes à la donation faite par sa sœur. — 5. Le vidame de Chartres Hugues
fils de Guerry, seigneur principal de Vierville, et sa mère
Helsent, de qui Gautier tient à fief la moitié
de Vierville, consentent à la donation. — 6. Guillaume fils de Bernoal d’Étampes,
de qui Gautier tient à fief la deuxième moitié
de Vierville, consent, à Étampes, à la donation. — 7-8. Godéchal fils d’Oury donne progressivement
tout ce qu’il détenait à Vierville. — 9. L’Étampois Amaury Roux
d’Ablis donne aussi ce qu’il détenait à
Vierville, avec l’accord de sa femme et de ses deux fils,
et l’autorisation d’Aubert d’Étampes de qui il
tenait ce bien à fief. — 10. A la grange de Boisville-la-Saint-Père (qui paraît
un fief chartrain de la famille d’Aunay), en présence
du vicomte de Chartres Hugues I du Puiset, dit Blavons, un
envoyé de l’Étampois Payen fils d’Anseau, frère
aîné d’Aubert, autorise en son nom les donations
d’Arnaud et de Godéchal: il donne rituellement
son gant. — 11. A Auneau, Hugues de Gallardon, seigneur
du lieu, autorise les donations faites par Gautier, Guillaume
fils de Bernoal et Arnaud fils d’Aubrée. — 12. Arembour, veuve de Godéchal
et leur fils Eudes consentent la donation du défunt Godéchal. — 13. Anseau Robert fils de Béguin
et sa mère Eudeline consentent à la
donation de Godéchal et d’Amaury. — 14. Hersent et son fils Hardouin
Chef-de-Fer, à Chuisnes, donnent quatre familles de
serfs pour mettre en valeur Vierville.
— 15. Gautier d’Aunay et sa femme Milsent Chef-de-Fer
consentent, à Chartres, à cette donation.
— 16-17. Rainaud fils de Thiou donne la terre
de Lomlu, moyennant des contre-dons à lui-même et aux siens. — 18. Geoffroy fils de Félicie et son
épouse Gile donnent une terre à Vierville.
|

|
G. Datation précise de nos transactions
Malgré
tous mes efforts je ne suis arrivé à
trouver qu’une fourchette chronologique relativement large
pour ces transactions, qui ont dû de toutes façons
s’étaler sur plusieurs années.
Malgré le
grand nombre de personnes concernées, nous sommes
en manque de dates précises à une époque
où l’usage ne s’est pas encore généralisé
de dater tout document écrit.
Il serait intéressant
par exemple de dater la période précise où
fut en fonctions le prieur de Marmoutier Robert de Vierzon,
mentionné par les transactions 2 et 4.
La transaction
10 est antérieure à 1096, date du départ
en croisade de son témoin Nivelon II de Fréteval,
qui ne reviendra pas au pays avant 1108.
La transaction
11 est postérieure à 1092, date de la mort
d’Hervé de Gallardon, puisqu’elle nous montre son fils
Hugues de Gallardon agissant en seigneur et maître du secteur
d’Auneau en lieu et place de son
père.
La
transaction 12, qui prend place après plusieurs
donations de Godéchal fils d’Oury de Vierville,
et même après sa mort, est cependant antérieure
à 1098, date à laquelle son témoin Hardouin,
prieur d’Épernon, semble déjà remplacé
dans cette charge par un certain Guillaume.
En
revanche les transaction 16 à 18 peuvent avoir
été conclues bien des années plus tard,
par exemple dans les premières années du XIIe siècle,
quoique du vivant de Thion Chef-de-Fer; car il semble bien que
Gautier d’Aunay lui-même soit alors décédé;
d’ailleurs l’écriture des notices C et D est très
nettement du XIIe siècle; mais il est vrai qu’elles ont
pu être recopiées tardivement sur le premier manuscrit,
sans pour cela être être elles-mêmes fort tardives.
|
|
|
NOTICE A
(première partie du
premier parchemin)
| Notitia de
Vervilla quam dedit nobis Gualterius
de Alneto. Carnoti. |
Notice
sur
Vierville, que nous a donné Gautier
d’Aunay. Chartres
|
Nouerint omnes
posteri quod Gauterius de Alneto et
uxor eius Milesindis dederunt beato Martino
Maioris Mona[2]sterii et nobis suis monachis
pro animabus suis uillam quandam quę dicitur
Veriuilla et ecclesiam et decimam et sepulturam
et terram [3] ad duas carrucas cum decima et
camparcio et omnes hospites qui in eadem uilla
hospitari uoluerint ita ut nobis reddant omnes [4]
consuetudines nec alicui respondeant de aliquo nisi
nobis, preter camparcium quod retinuerunt
sibi extra uillam: hoc red[5]dent eis in eadem
uilla, non alias deferentes. Pepigerunt uero
nobis, si illud quod retinuerunt sibi vellent dare
quandoque uel uendere [6] nulli alii se daturos
uel uendituros nisi nobis. Vnam aream tantum
retinuerunt sibi in eadem uilla ad domum sibi faciendam,
[7] de qua tamen reddent nobis omnes consuetudines
sic alii hospites. Factum est hoc apud Sanctum
Auitum in domo ipsius [8] Gauterii, presente patre uxoris
eius Milesindis* Teudone Capite de Ferro, et Rotberto de Virsone nostris
monachis, [9] quibus ipsa Milesindis* dedit hoc
donum per unum baculum, quoniam id maxime pertinebat
ad eam, et Archembaldo [10] famulo Theudonis monachi
et Theudone milite de Cramisiaco.
* corrigé par une deuxième main: Milesendis.
|
(2) Que tous nos successeurs
sachent que Gautier d’Aunay et sa femme
Milsent ont donné à saint
Martin de Marmoutier et à nous ses
moines, pour le salut de leurs âmes, un
certain village appelé Vierville, l’église,
la dîme, le droit de sépulture,
une terre de deux charrues avec sa dîme,
et son champart et tous les tenanciers qui
voudraient être accueillis dans le dit village
sous condition de nous rendre tous les devoirs
coutumiers et de ne dépendre de personne d’autre
que de nous, exception faite du champart qu’ils
se sont réservé en dehors du village;
on le leur donnera dans le dit village, sans le
transporter ailleurs. Mais ils nous ont promis que
si un jour ils voulaient donner ou vendre ce qu’ils
se sont réservé, ils ne le donneraient
ni ne le vendraient à personne d’autre
qu’à nous. Ils se sont réservé
seulement un emplacement dans le dit village pour
s’y construire une maison, mais ils nous rendront pour
elle tous les devoirs coutumiers comme les autres
hôtes. Cela s’est fait à Saint-Avit dans
la maison du dit Gautier, en présence du père
de son épouse Milsent, Thion Chef-de-Fer,
et de Robert de Vierzon, nos moines, à qui la
dite Milsent a fait cette donation par le moyen d’un bâton,
puisque c’est surtout à elle que cela appartenait;
ainsi que d’Archambaud, serviteur du moine Thion,
et du chevalier Thion de Crémisay.
|
Concessit
hoc etiam donum nobis Harduinus [11] Caput
de Ferro frater ipsius Milesindis* apud Choinam in claustro nostrorum
monachorum. Qui etiam huic dono inter[12]fuerunt:
Teudo Caput de Ferro pater ipsius Harduini,
Tetbaldus prior, Rotbertus prior claustri Maioris
Mona[13]sterii, Euanus, Ebroinus, Guastho, Fulco,
Gingomarus Erneisius, Odo famulus.
* corrigé par une deuxième main: Milesendis.
|
(4) Cette
donation en notre faveur a été
aussi autorisée par Hardouin
Chef-de-Fer, frère de la dite Milsent,
à Chuisnes dans le cloître
de nos moines. Ont aussi assisté
à cette donation: Thion Chef-de-Fer, père
du dit Hardouin; le prieur Thibaud; le prieur
du cloître de Marmoutier, Robert; Évain;
Évroin; Gaston; Foulques; Gimard Ernèse;
le serf Eudes.
|
Hoc etiam donum
ipsius [14] Gauterii de Alneto et uxoris eius Milesindis* concessit nobis Hugo filius
Guerrici et mater eius Helisindis, a quibus [15]
habebat idem Gauterius in feuo partem unam illius uillę Veriuillę,
testibus istis: Iuone filio Norberti, [16] Tetbaldo
filio Stephani, Pagano filio Girardi Mariscalci, Guarino
filio Amalrici Biseni**, Alberto filio [17] Alberti d’Vlmeio.
* corrigé par une deuxième main: Milesendis.
** corrigé par une deuxième
main: Besenis.
|
(5) Cette
donation du dit Gautier d’Aunay et de sa
femme Milsent en notre faveur a encore été
autorisée par Hugues fils de
Guerry et sa mère Helsent, de qui
le dit Gautier tenait en fief une part du dit village
de Vierville, en présence des témoins
suivants: Yves fils de Norbert; Thibaud
fils d’Étienne; Payen fils de Girard
Maréchal; Garin fils d’Amaury Bisen;
Aubert fils d’Aubert d’Ormoy.
|
Aliam uero
partem huius sepe dictę uillę Veriuillę concessit
nobis Guillelmus filius Bernoalii
de [18] Stampis, quam habebat ille Gauterius
in feuo ab illo. Testes sunt huius rei Arraldus
patruus illius Guillelmi, [19] Bernoalius
abbas Sanctę Marię de Stampis, Albertus frater
eius, Godefridus* de Bardul Villa, Haubertus [20]
filius Haimelini, Hugo Bornus, Vrso de Petris,
Bernardus clericus iuuenis, Gaufredus
clericus [21] de Sancto Sigio, Arnaldus filius Balduini,
Harpinus de Stampesio, Petrus filius Gerberti
Barbati, [22] Eblonius frater Arraldi, Teudo
monachus Caput Ferri.
* corrigé
par une deuxième main:
Godefredus.
|
(6) Quant à
l’autre partie de ce village plusieurs
fois mentionné de Vierville,
sa donation en notre faveur a été
autorisée par Guillaume,
fils de Bernoal d’Étampes, parce que
le dit Gautier la tenait de lui en fief. Les
témoins de cette affaire sont: Airaud,
oncle paternel du dit Guillaume; l’abbé
de Notre-Dame d’Étampes Bernoal; son
frère Aubert: Geoffroy de Baudreville;
Aubert fils d’Aimelin; Hugues Borgne; Ours de Pierrefitte;
le jeune clerc Bernard; le clerc de Saint-Cyr,
Geoffroy; Arnaud fils de Baudouin; Harpin de l’Étampois;
Pierre fils de Gerbert Barbu; Éblon frère
d’Airaud; le moine Thion Chef-de-Fer.
|
Sciendum
est etiam quod Godescalis filius [23] Hulrici
de Veruilla concessit sancto Martino et
nobis monachis suis decimam de sex hospitibus
qui erant [24] in eadem uilla. Huius concessionis
testes sunt hi: Teudo Caput Ferri, Galdinus
filius Ausuei de Mereruilla, Lisiardus de Stampis,
Rotbertus filius Arraldi, Herbertus de Danonuilla.
|
(7) Il faut
savoir encore que Godéchal fils
d’Oury de Vierville a concédé
à saint Martin et à nous ses
moines la dîme de six tenanciers
qui se trouvaient dans le dit village. Les témoins
de cette autorisation sont les suivants:
Thion Chef-de-Fer; Gaudin fils d’Ausoué
[Lisez: Ansoué]
de Méréville; Lisiard
d’Étampes; Robert fils d’Airaud; Hébert
de Denonville.
|
NOTICE B
(deuxième parchemin)
Cette deuxième
notice reprend d’abord les choses
au début en les précisant.
Il semble en fait qu’il y ait eu deux cérémonies
de donation, la première par Gautier
à Marmoutier, la deuxième par son épouse,
qui était la propriétaire réelle
du bien en question, à Saint-Avit.
| Noticia
de Veriuilla quam dedit Gaulterius de Alneio
beato Martino Maioris Monasterii et monachis
eius. CARNOTIS |
Notice
sur
Vierville, que Gautier d’Aunay a donné
à saint Martin de Marmoutier
et à ses moines. Chartres
|
Nouerint
posteri nostri quod Gauterius de Alneio et
uxor eius Milesendis et Ernaldus filius
Alberedę dederunt beato Martino Maioris
Monasterii et nobis monachis suis, pro animabus
ipsorum, totum corpus uillę quę dicitur [2] Verisuilla,
id est quicquid in ipsa hospitari poterimus
Carnotensibus arpennis nichil sibi omnino retinentes
ex ea. Dederunt etiam sancto et nobis terram ad
duas carrucas ab omnibus consuetudinibus
absolutam, ecclesiam quoque cum decima, et omnibus
quę ad ipsam [3] attinent. De exteriori uero terra nichil
omnino retinuerunt, sed sancto et nobis omnia
dederunt, excepto camparcio quod in ipsam uillam et non
alias eis deferetur, et hoc etiam, quod si quantumlibet
de eadem* exteriori terra propriis bubus colere
uoluerint, faci[4]ent in cimitherio unam uel
duas domos si eis placuerit, et de ipsis reddent
censum monachis. Conuenit etiam hoc inter ipsos
et monachos, quod si aliquid eorum quę sibi retinuerunt
uel dare uel uendere uel commutare uoluerint, non** facient alicui nisi nobis
[5] Z
* Le scribe
avait oublié eadem et l’a ajouté
au-dessus de la ligne.
**
Pour non, l’le
scribe de la notice D utilise exactement
la mêm abréviation
que pour A, ce qui tend à démontrer
que la main qui a rédigé
D est la même qui avait mis A par
écrit.
|
(2) (3) Que nos
successeurs sachent que Gautier d’Aunay et son
épouse Milsent ainsi qu’Arnaud fils
d’Aubrée ont donné à saint
Martin de Marmoutier et à nous ses moines,
pour le salut de leurs âmes, le corps entier
du village appelé Vierville, à savoir
tout ce que nous pourrons y loger d’arpents chartrains,
sans rien s’en réserver du tout. Ils ont encore
donné au saint et à nous une terre de
deux charrues libre de tout droit coutumier, ainsi qu’une
église avec sa dîme et tous les biens
afférents. Quant au finage ils ne s’en
sont rien réservé du tout, mais
ont tout donné au saint et à nous,
excepté le champart. Il leur sera apporté
au village même et non pas
ailleurs. Et encore ceci: s’ils souhaitent cultiver
une partie du finage (autant qu’il leur plaira
avec leurs propres bœufs), ils se feront une,
voire deux maisons, dans le cimetière, si
c’est leur volonté, et ils en paieront le cens
aux moines. Il a été convenu
entre eux et les moines que s’ils veulent donner ou
vendre ou échanger quelqu’un des biens qu’ils
se sont réservés, ils ne le feront
à personne d’autre qu’à nous.
|
Ipsum hoc
donauit predictus Gaulterius in capitulo
Maioris Monasterii, et ipsam donationem
super altare posuit, testibus multis, tam
monachis quam militibus et famulis. Z
|
(1) Le susdit
Gautier a fait la dite donation au chapitre
de Marmoutier, et il a posé la dite
donation sur l’autel en présence
de nombreux témoins, tant moines
que chevaliers et que serfs.
|
Quod etiam
predicta Milesendis auctorizauit postea
apud Sanctum Auitum in domo ipsius Gaute[6]rii
mariti sui, et quia eadem uilla maxime
pertinebat ad ipsam, dedit eam domno Rotberto
de Virsone monacho pro sancto et monachis aliis
et Archenbaldo famulo per baculum uice ipsius
monachi, presente eodem uiro suo Gaulterio de
Alneio et Theudone Capite Ferri [7] patre ipsius
et Theudone milite de Cramisiaco et Rotberto
maiore suo de Sancto Avito qui ambo cum ea* erant. Z
*Le mot ea a été
oublié, et le scribe a mis a sa
place une croix; il a fait suivre erant d’une autre croix, puis
a écrit ea.
|
(2) La susdite
Milsent y a encore donné
sa permission à Saint-Avit, dans
la demeure du dit Gautier son mari, et,
parce que le village lui appartenait surtout
à elle, elle l’a donné au moine
monsieur Robert de Vierzon au bénéfice
du saint et des autres moines, et au serf Archambaud,
par le moyen de la baguette, en lieu et place
du dit moine, en présence de son dit mari
Gautier d’Aunay, et de son père à elle
Thion Chef-de-Fer, ainsi que du chevalier de
Crémisay Thion, et de Robert, son régisseur
de Saint-Avit, qui tous deux étaient
avec elle.
|
Predictus
etiam Ernaldus filius Alberedę qui sepedictę
Veriuillę medietatem tenebat de
Gaulterio predicto dedit sicut superius determinauimus
hoc donum beato Mar[8]tino et nobis,
nec non etiam duas partes uillicationis predictę
uillę quam* tenebat de Pagano filio Anselli dedit, in domo sua apud Stampas,
concedente fratre Godiscale, cui domnus
Theudo Caput Ferri dedit propter hoc ipsum X solidos
et beneficium nostrum utrique ipsorum. Si uero idem
Er[9]naldus aliquando desiderans fieri monachus precatur,
dato quicquid de eadem uilla sibi retinuerat omnino,
sic eum ad monachilis habitus conuentum nostrum admittemus.
Huius igitur donationis et concessionis sunt testes:
Albertus filius Gondagri, Albertus filius Anselli,
Petrus filius [10] Erardi, Rainerius filius Alberti,
Gaufredus filius Girelmi, Godefredus de Balduluilla,
Arnulfus maior de Roureio, Paganus filius Harduini, Rainaldus
Teuldi filius, Iohannes filius Pagani, Hugo minerius*, Herbertus de Danunuilla. Z
* sic.
*ou bien Minerius?
|
(3) En outre le
susdit Arnaud fils d’Aubrée, qui tenait
en fief du susdit Gautier la moitié
du souvent mentionné Vierville, en
a fait le don, comme nous l’avons indiqué
plus haut, à saint Martin et à
nous; et en plus de cela, il a donné deux
parts du fermage du susdit village qu’il tenait en
fief de Payen fils d’Anseau, dans sa demeure d’Étampes,
avec l’autorisation de son frère Godéchal,
à qui monsieur Thion Chef-de-Fer
a donné pour cela deux sous, ainsi qu’une
place chez nous à tous deux. Si donc le
dit Arnaud, désirant un jour se faire moine,
en fait la demande, une fois qu’il aura donné
tout ce qu’il s’est réservé
dans le dit village, nous l’admettrons dans notre
communauté de vie monastique. Ainsi
donc de cette donation et autorisation sont témoins:
Aubert fils de Gondagre; Aubert fils d’Anseau;
Pierre fils d’Airard; Rainier fils d’Aubert;
Geoffroy fils de Gireaume; Geoffroy de Baudreville;
Arnoux régisseur de Rouvray; Payen fils d’Hardouin;
Rainaud fils de Thiou, Jean fils de Payen; le minier
Hugues*; Hébert de Denonville.
* ou bien Hugues Minier.
|
Idem etiam
donum concessit et auctorizauit nobis
Hardu[11]inus Caput Ferri apud Coina,
frater predictę Milesendis in claustro monachorum.
Qui etiam huic dono interfuerunt,
Teudo Caput Ferri pater ipsius Harduini, Tetbaldus
prior, Rotbertus prior claustri Maioris
Monasterii, Euanus, Ebroinus, Guastho, Fulco,
Gingomarus, Odo famu[12]lus. Z
|
(4) Le même
don en notre faveur a été
autorisé et permis, à
Chuisnes, par Hardouin Chef-de-Fer,
frère de la susdite Milsent, dans le
cloître des moines. Ceux qui ont assisté
à cette donation sont: Thion
Chef-de-Fer, père du dit Hardouin;
le prieur Thibaud; le prieur du cloître
de Marmoutier, Robert; Évain; Évroin;
Gaston; Foulques; Gimard; le serf Eudes.
|
Hoc ipsum
donum fecit predictus Gaulterius de Alneio
concedi a Hugone filio Guerrici et matre
ipsius Helisendę, qui eiusdem uillę est
capitalis dominus, a quo etiam habebat idem Gaulterius
medietatem prefatę Veriuillę in feuo. Huius concessionis
testes sunt: Iuo filius Norberti, Tetbaldus [13]
filius Stephani, Paganus filius Girardi Mariscalis,
Guarinus filius Amalrici Biseni, Albertus de
Vlmeio. Z
|
(5) Le susdit
Gautier a obtenu l’autorisation de la
dite donation auprès d’Hugues fils
de Guerry et de sa mère Helsent, lui
qui est le seigneur percevant le chevage du dit
village, de qui le dit Gautier tenait encore la
moitié du susdit Vierville en fief. De
cette autorisation sont témoins: Yves fils
de Norbert; Thibaud fils d’Étienne; Payen
fils de Girard maréchal; Garin fils
d’Amaury Bisen; Aubert d’Ormoy.
|
Hoc ipsum
donum annuit et auctorizauit Guillelmus
filius Bernoali de Stampis et dedit beato
Martino et nobis, a quo sepedictus Gaulterius
habebat in feuo medietatem prefate Veriuillę.
Domnus etiam The[14]udo Caput Ferri dedit
propter hoc ipsum ei X solidos et de beneficio
beati Martini reuestuit eum. Huius rei sunt
testes: Arraldus patruus ipsius Guillelmi, Ebulo
frater eius, Bernoalus abbas Sanctę Marię de
Stampis, Albertus frater eius, Godefredus de Bauduluilla,
Aubertus filius Hamelini, [15] Hugo Bornus, Vrso
de Petris, Bernardus clericus iuuenis, Gaufredus
clericus de Sancto Sigio, Ernaldus filius Balduini,
Harpinus de Stampis, Petrus filius Herberti Barbati,
Teudo Caput Ferri. A
|
(6) Cette
donation a été consentie
et permise et faite par Guillaume fils de Bernoal
d’Étampes à saint Martin et à
nous, parce c’est de lui que le souvent mentionné
Gautier tenait en fief la moitié
du susdit Vierville. Monsieur Thion Chef-de-Fer
à cet effet lui a donné dix sous
et il l’a vêtu de neuf par un effet de la générosité
de saint Martin. De cette affaire sont témoins:
Airaud oncle paternel du dit Guillaume; son
frère Éblon; Bernoal abbé
de Notre-Dame d’Étampes; son frère
Aubert; Geoffroy de Baudreville; Aubert fils
d’Aimelin; Hugues
Borgne; Ours de Pierrefitte; le jeune clerc Bernard;
le clerc de Saint-Cyr, Geoffroy; Arnaud fils
de Baudouin; Harpin d’Étampes; Pierre fils
d’Hébert Barbu; Thion Chef-de-Fer.
|
Sciendum preterea
quod Godiscalis filius Vlrici dedit beato Martino
Maioris Monasterii [16] et nobis monachis
eius tertiam partem uillicationis totius predictę
Veriuillę et decimam totius terrę quam in
ea habebat. Huius doni sunt testes: Teudo Caput
Ferri, Gaudinus filius Ansei de Merer Villa,
Lisiardus de Stampis, Rotbertus filius Arraldi,
Herbertus de Danouilla. Z
|
(7) Il faut
savoir en outre que Godéchal fils
d’Oury a donné à saint Martin de
Marmoutier et à nous ses moines le tiers
de tout le fermage de tout le susdit Vierville
et la dîme de toute la terre qu’il y détenait.
De cette donation sont témoins:
Thion Chef-de-Fer; Gaudin fils d’Ansoué
de Méréville; Lisiard d’Étampes;
Robert fils d’Airaud; Hébert
de Denonville.
|
Postea uero
dedit [17] idem Godiscalis eidem sancto
et nobis octo hospitalia quę in predicta
Veriuilla habebat, et quicquid denique
in ea habebat, excepto terragio quod illi qui
in predictis hospitalibus hospitabuntur deferent
ei, uel ad Mereruilla uel ad Bertolcuriam,
ad quod horum [18] ipsi placuerit, ita tam ut
unus predictorum hospitum de quo securus erit seruet
idem terragium*, ei, et nullus eorumdem colat alicuius terram ante illam quam
de ipso habemus. Cui etiam dedit ob hoc domnus Teudo Caput
Ferri monachus XXX solidos Carnotensis monetę, et
beneficum nostrum. Pepigit [19] quoque ei quod quando mortuus
fuerit, sepeliet eum monachus qui in predicta Veriuilla morabitur
ad ęcclesiarum nostrarum quamlibet, si tamen hoc ipsi mandauerit.
Huius rei testes sunt: Gaulterius de Stampis, Amalricus
Rufus de Ableis, Girbertus major de Seenuilla. [20], Richerius
mercator de Stampis, Herbertus de Danunuilla. Z
* Le scribe avait oublié terragium et l’a ajouté
au-dessus
de la ligne.
|
(8) Mais après
cela le dit Godéchal a donné,
au même saint et à nous,
huit tenures qu’il avait dans le dit Vierville,
et pour finir tout ce qu’il y possédait,
excepté le terrage. Ceux qui seront
établis sur les susdites tenures
le lui apporteront, soit à Méréville
ou bien à Bréthencourt,
au lieu qu’il lui plaira, de telle manière
qu’un seul des susdits tenanciers, auquel il
fera confiance, aura la garde de son terrage, et qu’aucun
des susdits ne cultivera la terre de qui que ce soit
d’autre avant celle que nous tenons de lui. Pour cela
monsieur Thion Chef-de-Fer lui a encore donné
trente sous de monnaie chartraine, et une place chez nous.
Il lui a aussi promis que, quand il sera mort, il sera
enterré par le moine qui résidera au dit
Vierville, dans celle de nos églises qu’il voudra,
si du moins il le lui demande. De cette affaire sont
témoins: Gautier d’Étampes; Amaury
Roux d’Ablis; le régisseur de Sainville,
Gibert; le marchand d’Étampes Richer;
Hébert de Denonville.
|
Sciendum quoque
quod Amalricus Rufus de Ableis dedit in eadem
sepedicta Veriuilla beato Martino et nobis
monachis eius duas ut ita dicam hospitalitates
et quicquid omnino ibi habebat, nichil
[21] inde sibi retinens propter campartium,
quod ei ad Stampas uel ad Bertoucuriam
portabitur, quod unus eorum duorum qui ibi hospitabuntur
uersabit ei, de quo securior erit, qui etiam
nullam aliam terram colent ante eam de qua reddent
ei terragium. Factum est autem [22] hoc apud Stampas,
concedente Alberto filio Anselli de cuius casamento
erat eadem terra, concedentibus etiam uxore
sua, id est Amalrici eiusdem, duobusque filis
et filia, dante sibi propter ipsum Teudone Capite Ferri
monacho X solidos. Huius [23] rei testes sunt: Ernaldus
filius Alberedę, Christoforus Rex, Obertus de Stampis,
Girbertus canonicus, Guillelmus de Stampis Veteribus,
Rotbertus de Cimiterio, Baldricus de Fossato,
Herbertus de Danunuilla. T.
|
(9) Il faut
savoir aussi qu’Amaury Roux d’Ablis a donné
dans le souvent mentionné
Vierville, à saint Martin et à
nous ses moines, deux, pour ainsi dire, tenures,
et tout ce qu’il y détenait, ne
s’en réservant rien du tout, mis à
part le champart, qui lui sera porté
soit à Étampes ou bien à
Bréthencourt, et que l’un de ceux qui les
tiendront lui versera, celui en qui il aura le plus
confiance; ils ne cultiveront en outre aucune autre
terre avant celle de laquelle ils lui paieront
le terrage. Cela a été conclu à
Étampes, avec l’autorisation d’Aubert fils
d’Anseau, de la mouvance de qui relevait la dite
terre; avec l’autorisation de son épouse,
c’est-à-dire de celle d’Amaury, et celle
de ses deux fils, et de sa fille; le moine Thion
Chef-de-Fer lui donnant pour cela dix sous. De cette
affaire sont témoins: Arnaud fils d’Aubrée;
Christophe Roi; Obert d’Étampes; le chanoine
Gibert; Guillaume des Vieilles Étampes;
Robert du Cimetière; Baudry du Fossé;
Hébert de Denonville.
|
Preterea quoque
sciendum quod Paganus filius Anselli concessit
et [24] dedit in grangia Boesuillę beato
Martino Maioris Monasterii et nobis per cyrotecam
Anselli filii Aremberti idem donum uillacationis
totius iam dictę uillę, quod dederant Ernaldus
filus Alberedę et Godescalis filius Vlrici,
testibus his: Alberto filio Anselli, qui hoc
fecit ab eo conce[25]di, Gaulterio de Alneio,
Hugone uicecomite Castelliduni, Hugo de Puteolo,
Niuelone filio Fulcherii, Guarino de Friesia.
Z.
|
(10) En outre
il faut savoir que Payen fils d’Anseau
a autorisé et donné, dans
la grange de Boisville, à saint Martin
de Marmoutier et à nous, au moyen du
gant d’Anseau fils d’Arembert, la dite donation
de Vierville, qu’avait opérée Arnaud
fils d’Aubrée et Godéchal
fils d’Oury, en présence des témoins
suivants: Aubert fils d’Anseau, qui a obtenu
cette autorisation, Gautier d’Aunay; Hugues
vicomte de Châteaudun; Hugues du Puiset;
Nivelon fils de Foucher; Garin de Friaize.
|
Sciendum quod
Hugo de Gualardone concessit et auctorizauit
in domo monachorum de Alneello et dedit
predicto sancto [26] et nobis idem ipsum
donum Veriuillę, quod dederant Gauterius
de Alneio et Guillelmus filius Bernoali et Ernaldus
filius Alberedę, rogatu domni Teudonis Capitis
Ferri et Costabli monachorum. Huius doni
sunt testes: Guido filius Serli, Amalricus filius
Raherii, Marinus prepositus [27] de Alneello,
Rotbertus Britto, Iohannes Vitulus, Rotbertus
de Adunuilla et Adelelmus frater eius, Hugo Canis, Osmundis
de Gualardone. T.
|
(11) Il faut
savoir qu’Hugues de Gallardon a
autorisé et permis, dans la maison
des moines d’Auneau, et qu’il a accordé,
au susdit saint et à nous, la dite
donation de Vierville opérée
par Gautier d’Aunay, Guillaume
fils de Bernoal d’Étampes et Arnaud
fils d’Aubrée, à la supplique
des moines monsieur Thion Chef-de-Fer
et Costable. De cette donation sont témoins:
Guy fils de Serlon; Amaury fils de Rahier;
le prévôt d’Auneau Marin; Robert
Breton; Jean Veau; Robert d’Adonville et son frère
Aleaume; Hugues Chien; Osmond de Gallardon.
|
Preterea sciendum
quod Eremburgis uxor predicti Godiscalis
filii Vlrici et Odo filius ipsorum concesserunt
donationem quam idem Godescalis fecerat
[28] de Veriuilla beato Martino Maioris
Monasterii et nobis monachis eius, testibus,
Gaudino filio Ansue de Merervilla, Rainardo
Farinardo, Baldrico de Fossato, Harduino priore
Sparronensi et Ermengiso famulo eius, Gaufredo de
Moreth, Odone de Paniceriis, [29] Rainaldo de Alneio.
Cui, id est Aremburgi, dedit domnus Theudo
Caput Ferri tres solidos propter hoc ipsum donum. T
|
(12) En outre
il faut savoir qu’Arembour, épouse
du susdit Godéchal fils d’Oury, et
Eudes, leur fils, ont autorisé la
donation que le dit Godéchal avait opérée
de Vierville à saint Martin de Marmoutier
et à nous ses moines. En sont témoins:
Gaudin fils d’Ansoué de Méréville;
Rainard Farinard; Baudry du Fossé;
Hardouin prieur d’Épernon et son
serf Ermengise; Geoffroy de Moret; Eudes de
Pannecières; Rainaud d’Aunay. Monsieur Thion
Chef-de-Fer lui a donné, à
savoir à Arembour, trois sous en raison
même de cette donation.
|
Notum sit omnibus
tam futuris quam presentibus quatinus
illud donum quod Godiscal et Amalricus
de terra quę Veriuilla dicitur beato Martino
et monachis dederunt, [30]
illud ipsum donum Ansellus Rotberti filius Beguini et
Odelina mater eius pro sua suorumque salute partimque
propter VII solidos quos Teudo monachus ob hoc
Odeline tribuit nobis concesserunt. Huic dono interfuerunt:
Radulfus Gauscelini filius de Danunuilla et
Gaufredis clericus. [31] Ex nostra autem parte:
Gaulterius famulus, et de Extolui Gaulterius*,
et de Ludone Fulchaldus*. T.
* Le manuscrit porte bien de Extolui Gaulterius et de Ludone Fulchaldus, peut-être parce que ces éponymes avait été
surajoutés à
la première rédaction au
dessus de la ligne, comme on le constate souvent dans
les originaux, et qu’il ont été mal
reportés dans notre texte. On a une inversion analogue en C32-33.
|
(13) Qu’il
soit connu de tous, tant présent qu’à
venir que la donation du village appelé
Vierville qui avait été opérée
par Godéchal et Amaury à
saint Martin et aux moines, cette même
donation, Anseau Robert fils de Béguin
et sa mère Eudeline nous l’ont autorisée,
pour leur salut et celui des leurs, et pour une part
à cause des sept sous que le moine Thion a
donné à cet effet à Eudeline.
A cette donation ont assisté: Raoul fils
de Gauscelin, de Denonville, et le clerc Geoffroy.
Et de notre côté: le serf Gautier, Gautier
de Léthuin et Fouchaud de Ludon.
|
Nouerint omnes
nostri successores quod Hersendis et filius
eius Harduinus Caput Ferri dederunt
pro suis suorumque animabus beato Martino
et monachis Maioris Monas[32]terii, admonitione
Teudonis Capitis Ferri iam monachi, patris
predicti Harduini, quatuor familias collibertorum
de Danonisuilla, id est Gaufredum cum filiis
filiabusque suis. Vnde et donationem fecerunt apud
Coinam domno Tetbaldo priori Coinę pro [33] domno
abbate per ramum sebuci. Cuius rei testes sunt, de
monachis: Teudo Caput Ferri, Harduinus prepositus
Carnotensis, Guarinus clericus. De laicis: Hugo
Malueil, Guerrisius filius Herberti, Rotbertus de
Dallei Monte, Rainaldus famulus Gau[34]fredis de Bello
Monte, Guillelmus Rufus de Coina et alii plures.
|
(14) Que tous
nos successeurs sachent que Hersent
et son fils Hardouin Chef-de-Fer ont donné,
pour le salut de leurs âmes et de celles
des leurs, à saint Martin et aux moines
de Marmoutier, sur les représentations
de Thion Chef-de-Fer désormais moine, père
du dit Hardouin, quatre familles de
colliberts de Denonville, à savoir Geoffroy
avec ses filles et ses filles. De quoi ils
ont aussi fait la donation à Chuisnes au prieur
de Chuisnes monsieur Thibaud tenant lieu de monsieur
l’abbé par le moyen d’une tige de sureau.
De cette affaire sont témoins, du côté
des moines: Thion Chef-de-Fer; le prévôt
de Chartres, Hardouin; le clerc Garin; et du
côté des laïcs: Hugues
Malveil; Guerrise fils d’Hébert; Robert de
Dolmont; le serf de Geoffroy de Beaumont, Rainaud; Guillaume
Roux de Chuisnes; et de nombreux autres.
|
Hoc ipsum
donum concesserunt Gaulterius de Alneio
et uxor eius Milesendis predictę Hersendis
filia, sororque prefati Harduini aput* Carnotum,
testibus istis: Iuone filio Herberti,
[35] Rotberto Flagello, Guarino
de Baillole, Hugone de Tracheto, Gaulterio de Sancto
Germano, Harduino de Adonis Villa, Arnulfo fratre Gaulterii
de Alneio.
* sic.
|
(15) Cette
même donation a été
autorisée par Gautier d’Aunay et sa
susdite femme Milsent fille d’Hersent, sœur
du susdit Hardouin, à Chartres, en présence
de ces témoins: Yves fils d’Hébert;
Robert Fléaud; Garin de Bailleau;
Hugues de Tracy; Gautier de Saint-Germain; Hardouin
d’Adonville; le frère de Gautier d’Aunay,
Arnoux.
|
NOTICE C
(deuxième partie du
premier parchemin)
Cette notice
a été portée
sur la partie du premier parchemin qui restait
vierge, mais par une autre main que la première
et dans une écriture caractéristique
du XIIe siècle.
[25] Nouerint nostri presentes
et posteri sancti Martini monachi quod
Rainaldus Tetulfi filius quandam terram
que Lomlu [26] uocatur sancto Martino tribuit* tota ex integro
et quicquid in ea habebat, concedente Petro
fratre eius et matre eius que Ermentrudis dicitur, ac
conce[27]dentibus sororibus eis, Arenburge scilicet
et Roscelina atque Ascelina. Testes huius donationis
sunt isti: Albericus presbiter, [28] Guido Serlonis
filius, Arraldus de Dordano, Hungerius de Villa Illa,
Milo Bosonis filius, Albertus Vaslinus, Gualterius
faber, Raherius molen[29]dinarius, Rodbertus Grimaldi
filius, Albertus Burchardi filius.
Huius donationis
gratia nostri, monachi, id est
domnus Teudo qui Caput de Ferro dicitur [30]
ac domnus Constabilis Rainaldo et matri
eius ac sororibus certisque parentibus XXti
Vque solidos denariorum dederunt**, Petro autem
fratri germano Vque, [31] Falconi autem unam
spatam et Majoris Monasterii beneficium. Quod
uidit et audiuit Arnulfus de Alneto, Guarinus frater
eius, Rainaldus de [32] Testiariis, Herueus armiger.
Ex parte monachorum adfuerunt isti: Tamueius presbiter,
Guauterius de Anglica Terra famulus, de Venti[33]laio,
Constancius famulus et Guauterius de Veruilla famulus.
* Le scribe a oublié:
sancto
Martino tribuit, et l’a lui-même
ajouté au dessus
de la ligne.
** Il a aussi ajouté:
dederunt au dessus de la ligne.
|
(16)
Que tous les moines de saint Martin,
présents aussi bien qu’à
venir, sachent que Rainaud fils de Thiou
a offert à saint Martin une certaine
terre qui s’appelle Lomlu, dans son
entier, indivise, et tout ce qu’il y possédait,
avec l’autorisation de son frère
Pierre et de sa mère qui s’appelle Ermentrut,
ainsi qu’avec l’autorisation de ses
sœurs, à savoir Arembour et Rosceline ainsi
qu’Asceline. Les témoins de cette donation
sont les suivants: le prêtre Aubry; Guy fils
de Serlon; Airaud de Dourdan; Hongier de Villeau;
Milon fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron Gautier;
le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert
fils de Bouchard.
(17) A cause
de cette donation, nos moines, à
savoir monsieur Thion, surnommé
Chef-de-Fer, et monsieur Costable ont donné
à Rainaud et à sa mère,
ainsi qu’à ses sœurs et à
certains parents: vingt-cinq sous; à
son frère de père et de mère
Pierre: cinq sous; à Faucon, une épée
et une place à Marmoutier. Cela a été
vu et entendu de: Arnoux d’Aunay; son frère
Garin; Rainaud des Têtières;
l’écuyer Hervé. Du côté
des moines, y ont assisté: le prêtre
Tamoué; le serf Gautier d’Angleterre,
le serf Constance de Ventelay*, et le serf de Vierville Gautier.
* De Ventelay se rapporte à ce
qui suit et non à ce qui précèce,
comme nous l’apprend une autre charte du
prieuré de Bréthencourt (ici donnée en Annexe 6e). On constate une autre inversion
du toponyme éponyme en B 31.
|
NOTICE D
(troisième partie
du premier parchemin)
Notificamus
successoribus nostris quod Godefredus
de Aqua filius Felicie [34] et Gila uxor
eius dederunt sancto Martino Maioris
Monasterii et monachis eius terram ad unam
carrucam et tres hosticias in uilla quę Veruilla
[35] dicitur et totum scilicet quicquid
in ea possidebat pro salute animarum suarum et suorum
antecessorum. Dederunt tamen monachi eis
in caritate so[36]lidos XXXta Vque Stanpensis
monetæ. Huic donationi affuerunt plures
ex parte monachorum et ex parte illorum. Ex parte
illorum fuerunt [37] hii: Rotbertus medicus de Stampis,
Amalricus Rufus, Harduinus clericus, Guarinus quidam
famulus eorum. Ex parte monachorum fuerunt hii:
Tamueius presbiter [38] de Stonno, Adelardus de Bertoldicuria
et Rodbertus eiusdem Adelardi socius. Monachus
qui hoc donum recepit et ceteris fratribus Maioris Monasterii
detulit, [39] domnus Teudo Caput Ferri fuit. Sciendum
uero est quod isdem* Teudo eis
beneficium Maioris Monasterii tribuit, ea scilicet
conuentione ut si [40] aliquo tempore ad monasterium
pergerent ab abbate et ceteris fratribus omnibus reciperent.
*Lisez: idem.
|
(18) Nous faisons savoir à
nos successeurs que Geoffroy de l’Eau fils de
Félicie et son épouse
Gile ont donné à saint Martin
de Marmoutier et à ses moines une terre
d’une charrue et trois tenures au village qui
s’appelle Vierville, ainsi que tout ce qu’il
y possédait, pour le salut de leur
âmes et de celles de leurs prédécesseurs.
Les moines leur ont cependant donné
par charité 35 sous en monnaie d’Étampes.
A cette
donation ont assisté bon nombre
de personnes du côté des moines
et de leur côté. De leur
côté il y a eu ceux-ci: le
médecin d’Étampes Robert;
Amaury Roux; le clerc Hardouin; un certain
Garin leur serf. Du côté des moines
il y a eu ceux-ci: le prêtre de Léthuin
Tamoué; Allard de Bréthencout; et Robert
compagnon du dit Allard. Le moine qui a reçu
ce don et l’a fait connaître aux autres
frères de Marmoutier a été
monsieur Thion Chef-de-Fer. Il faut savoir
que le dit Thion leur a accordé une place à
Marmoutier, à savoir qu’il a été
convenu que si un jour ils veulent gagner
le monastère, ils aient gain de cause
auprès de l’abbé et des autres
moines.
|
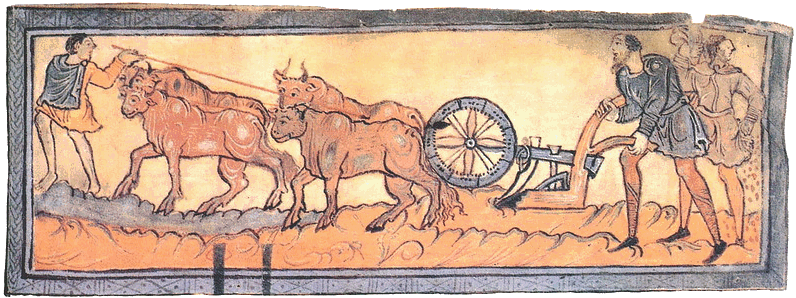
|
|
ANNEXE 1
RÉPERTOIRE
DES LIEUX CITÉS
Notes de toponymie
Le secteur de Vierville sur la carte de Cassini
(1756)
de Ableis (B 19, 20):
Ablis
Le
contexte ne permet pas de préciser
le genre de ce toponyme, qui paraît
ici à l’ablatif pluriel. En 1218, une
charte du Cartulaire de l’abbaye
du Porrois (n°53) porte le féminin (apud
Abluyas), qui permettrait de supposer ici un nominatif
*Ableae ou *Ableiae.
Cependant il faut sans doute reconnaître ici une
forme indéclinable. Dans le Cartulaire des Vaux-de-Cernay, on trouve ultérieurement
trois formes indéclinables concurrentes,
Abluies vers 1168
(n°XXXI, p. 49), en 1207 (n°CXLV, p. 160), 1227 (n°CCLXXV,
p.261), 1240 (n°CCCXCIX, p. 366), 1241 (n°CCCCIV,
p. 370), 1243 (ibid. n°CCCCXVII, p. 383), Abluis
en 1239 (n°CCCXCVI, t. I, p. 363), 1241 (n°CCCCIX,
p. 375), 1246 (n°CCCCXLIV, p. 405), 1300 (n°DCCCCXC,
p. 980), 1321 (n°MXLIV, t. II, p. 62), et
Ablues en 1227 (n°CCLXXV, p. 261). Ultérieurement
on trouvera aussi de Ablusiis,
pour qualifier Geoffroy d’Ablis (célèbre inquisiteur mort
à Lyon entre 1316 et 1319). On a avancé une étymologie fondée
sur un anthroponyme romain Apilius,
hypothèse assez gratuite, et qui, outre un
très difficile passage du p ou b, expliquerait mal pourquoi
le mot semble toujours avoir été perçu
comme pluriel.
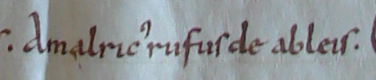 Aujourd’hui commune du canton
Saint-Arnoult-en-Yvelines, arrondissement
de Rambouillet (Yvelines).
Aujourd’hui commune du canton
Saint-Arnoult-en-Yvelines, arrondissement
de Rambouillet (Yvelines).
Lieu
éponyme d’Amaury Roux d’Ablis
(Amalricus Rufus de Ableis), qui
paraît cependant résider à Étampes
(transactions 8 et 9).
|
Adunuilla (B 27),
Adonis Villa (B 35): Adonville
Voici la seule
graphie ancienne que donne Merlet dans
son Dictionnaire
topographique du département
d’Eure-et-Loir de 1861 (pp. 1-2): Adunvilla (1202, charte de l’abbaye de Belhomert).
A
titre de comparaison, notons plusieurs graphies anciennes données
pour le toponyme lorrain Haudonville (Henri Lepage, «Dictionnaire
géographique de la Meurthe», in Mémoires de
la Société d’archéologie lorraine, 2e série,
III, 1860, p. 129): Haidonvilla (1156, 1164), Haidunvilla
(1182), Hadunvilla et Haydunville
(1186), Adonvilla (1195), Haldonville (1393),
Hadonville (1414), Hauldonville (1433).
Aujourd’hui hameau de la commune
de Denonville (canton d’Auneau,
arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir).
Merlet (ibid.) note que le fief d’Adonville
relevait du duché de Chartres et ressortissait
pour la justice à Auneau.
Lieu
éponyme de trois nobliaux mentionnés
par la notice B. Il est d’abord question d’un Robert d’Adonville et
son frère Alleaume (B 27), témoin
à Auneau d’une concession d’Hugues de Gallardon
(transaction 11), puis d’un Hardouin d’Adonville,
témoin à Chartres d’une
concession de Gautier d’Aunay (transaction 15): tous
trois paraissent des nobles voire des chevaliers. |
Alneellum (B 24, 26): Auneau
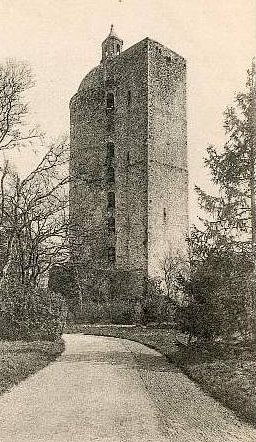 Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.6): Auneellum (1111, charte
de l’abbaye de Bonneval);
Alnetellum, 1130 (id.);
Alneolum (cartulaire des Vaux-de-Cernay,
p. 48); Alneelum, 1172 (charte
de l’abbaye de Josaphat); Auneel
(1279, charte de l’abbaye de l’Eau);
Aulnel (1469, registre des contrats
du chapitre de Chartres); Aulneau
(1565, terrier de Reboulin);
Saint-Remy d’Auneau (1736, pouillé).
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.6): Auneellum (1111, charte
de l’abbaye de Bonneval);
Alnetellum, 1130 (id.);
Alneolum (cartulaire des Vaux-de-Cernay,
p. 48); Alneelum, 1172 (charte
de l’abbaye de Josaphat); Auneel
(1279, charte de l’abbaye de l’Eau);
Aulnel (1469, registre des contrats
du chapitre de Chartres); Aulneau
(1565, terrier de Reboulin);
Saint-Remy d’Auneau (1736, pouillé).
Actuellement chef-lieu de
canton et de la communauté de communes
de la Beauce alnéloise (arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir). Alors siège
d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Bonneval.
Merlet (ibid.) note qu’Auneau était d’une part une
baronnie vassale du duché de Chartres
et ressortissant pour la justice au bailliage de
Chartres; il ajoute d’autre part que c’était chef-lieu
d’un doyenné dépendant de l’archidiaconé
de Chartres et comprenant les paroisses d’Auneau,
Aunay-sous-Auneau, Béville-le-Comte,
la Chapelle-d’Aunainville, Denonville, Francourville,
Gellainville, Gouillons, Houville, Léthuin,
Levesville-la-Chenard, Louville-la-Chenard, Maisons,
Mondonville-Saint-Jean, Moutiers-en-Beauce, Oinville-sous-Auneau,
Ouarville, Prasville, Prunay-le-Gillon,
Roinville-sous-Auneau, Saint-Germain-la-Gâtine,
Sours et Villeau.
C’est chez les
moines d’Auneau, en présence du prévôt
(prepositus) d’Auneau, Marin, qu’a lieu
la concession d’Hugues de Gallardon (transaction
11).
De fait Hugues de Gallardon était
alors seigneur d’Auneau, seigneurie qu’il tenait
de sa mère, fille du seigneur de Rochefort.
|
Alnetum (A titre,
1, 14; B 31), Alneium
(D titre, 1, 6, 11, 24,
25, 28, 33, 34): Aunay-sous-Crécy,
et non Aunay-sous-Auneau
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet pour Aunay-sous-Crécy:
Alnetum (vers 1080), Alaretum
(sic selon Merlet, 1110, charte de l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée),
Altum et Covetum (vers 1250,
pouillé), Alnetum-juxta-Covetum
(1310, charte de l’abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois),
Saint-Martin d’Aunay-sous-Couvé
(1736, pouillé). Notons aussi, pour mémoire,
celles qu’il donne pour Aunay-sous-Auneau (p.6): Aunetum (1118, charte de
l’abbaye de l’Ouïe);
Alnetum (1389, id.); Alnetum-sub-Alneolo
(1432, charte de l’abbaye de Josaphat); Saint-Éloy
d’Aunay-sous-Auneau (1736, pouillé).
Il ne s’agit pas d’Aunay-sous-Auneau,
comme l’ont cru Lefèvre et Depoin, commune du
canton d’Auneau dans l’arrondissement
de Chartres (qui était
un fief vassal du duché de Chartres
et ressortissant pour la justice au bailliage de
Chartres), mais d’Aunay-sous-Crécy, commune du canton
de Dreux.
1)
Gautier, époux de Milsent et gendre de Thion Chef-de-Fer,
en tire son nom dans les notice A et B. Il est accompagné
une fois de son frère Arnoux (transaction 15).
2) Dans la notice
C, sans doute postérieure à sa mort, c’est
son frère Arnoux qui est titré d’Aunay
(transaction 17), accompagné cette fois de son frère
Garin.
3) La notice B
cite aussi un Rainaud d’Aunay (transaction 12), qu’il faut
identifier à Rainaud des Têtières, cité
juste après Arnoux et Garin (transaction 17).
Le recoupement
des données présentées par un certain
nombre de documents du temps permet d’affirmer qu’un certain
noble, originaire d’Aulnay-sous-Crécy et possessionné
depuis Dreux jusqu’au pays Dunois, eut deux fils, Gautier
I d’Aunay et Rainaud d’Aunay dit aussi des Têtières.
Gautier I a eu lui même six fils: Gounier titré tantôt
d’Aunay, tantôt de Molitard et tantôt de Saint-Avit;
Jocelyn; Gautier II d’Aunay; Arnoux; et Garin surnommé Torcul.
Cette famille est
clairement possessionnée depuis le secteur de Dreux jusqu’au
pays dunois.
|
Anglica Terra (B 32): Angleterre
S’agit-il de l’Angleterre, conquise
en 1066 par le duc de Normandie Guillaume,
ou bien d’un lieu-dit Angleterre,
comme il en existe bien
par exemple dans la commune d’Andeville
(canton de Méru, arrondissement de Beauvais,
Oise)? Ce surnom semble
avoir été porté par des personnes de condition modeste.
C’est ainsi par exemple qu’un Guillaume d’Angleterre, de statut incertain,
est cité entre des cuisiniers et un tailleur comme témoin
d’une transaction des moines de Marmoutiers en 1072, en Vendômois
(Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, n°XLIX, p.
49.)
Ce
nom d’Angleterre donne son nom à un
serf des moines de Marmoutier, Guauterius
de Anglica Terra, témoin quelque part entre Aunay et Vierville
des contredons des moines à la parentèle
de Rainaud fils de Thiou après la donation de
la terre de Lomlu (transaction 17).
(a) Ce serf nous est aussi connu, Gaulterius
de Anglica Terra, par une charte
du prieuré de Bréthencourt d’environ
1080, dont nous donnons le texte en Annexe
6e.
(b) Un autre (?) Gautier d’Angleterre, Gaulterius
de Anglia, de statut incertain, est témoin, apparemment à
Marmoutier même, d’une transaction relative à la terre de
Bezai, en Vendômois, sous l’abbé Bernard soit entre 1081
et 1099 (Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, n°CLXXXI,
p. 259).
|
Aqua (D 33): l’Eau
ou L’Ève ou Lèves, lieu-dit
non identifié
Il existe un
lieu dit l’Eau près
de Chartres (actuellement Eau-lès-Chartres,
hameau de la commune de Ver-lès-Chartres),
mais cette dénomination n’est attestée
par Merlet (p.62) qu’à partir du XIIIe
siècle, lors de la fondation en ce lieu d’une
abbaye féminine cistercienne par Isabelle, comtesse
de Chartres): Pentoison (1226,
Cartulaire de l’Eau, p.9); Panthoison
(1229, cartulaire de Saint-Père-en-Vallée,
p. 686); Pantoison (1229, charte
de l’abbaye de l’Eau); Aqua-prope-Carnotum
(1230, id.); Pontoison
(1259, id.); l’abeie de l’Iau-de-lez-Chartres
(1279, id.).
Il faut par ailleurs
remarquer que le latin aqua
peut représenter un toponyme en ancien
français L’Ève
ou Lève (car eau
se dit alors ève, d’où le
mot actuel évier), qui pourrait
constituer une latinisation curieuse mais possible du
lieu-dit chartrain de Lèves, et ce d’autant que
le prénom Geoffroy est bien attesté à cette époque
dans la famille de Lèves, par Geoffroy de Lèves, seigneur
du Tartre-Gaudran, chanoine de Notre-Dame de Chartres, qui sera évêque
de Chartres de 1116 à 1149.
Ce lieu dit donne son nom
à un certain Geoffroy de Aqua
fils de Félicie, époux d’une
certaine Gile (Godefredus de Aqua filius
Felicie et Gila uxor eius), qui
possède des biens à Vierville et
les donne, à Étampes (transaction 18).
(a) Ce lieu-dit,
où qu’il se trouve, donne apparemment son nom à
une famille clairement installée à Étampes, car nous trouvons comme témoin
d’une charte purement étampoise
de 1082 un certain Thibaud de l’Eau,
Tetbaudus de Aqua (éd.
Prou, p. 276, l. 8, seule occurence du toponyme
dans toutes les chartres de ce monarque).
(b) Ce Thibaud est probablement le père
de notre Geoffroy, la notice D datant vraisemblablement
du début du XIIe siècle.
(c) Il faut noter
cependant la présence d’un chevalier apparemment chartrain
Roger de Aqua à Courville en mars
1094, dans la liste de témoins suivante: Philippa; son fils Yves; Nivelon, Garin de Friaize,
Hardouin Chef-de-Fer; Thibaud fils de Suger;
Fron fils de Themier; son fils Yves; Yves fils d’Hébert;
Roger de l’Eau (Rogerius de Aqua), monseigneur
l’évêque, etc (Nous éditons ce texte
en Annexe 6g).
|
Baillolis
(B 35): Bailleau
Il existe trois Bailleau
en Eure-et-Loir, tous trois dans l’arrondissement
de Chartres: 1)
Bailleau-le-Pin (canton d’Illiers-Combray,
arrondissement de Chartres),
pour lequel Merlet donne: Baliolus
(vers 977, cart. de Saint-Père),
Bauliolum (vers 1165, cart. du
Grand-Beaulieu), Balliolum de Pinu
(1215, ch. du chapitre de Chartres),
Balliolum-Pinus (1221, ibid.), Balliolum-Pini (1270,
ibid.), Balliolum-Spini (vers 1250, pouillé),
Baillotum-Pini (1626, pouillé),
Saint-Chéron
de Bailleau-le-Pin (1736, pouillé);
2) Bailleau-l’Évêque
(canton de Mainvilliers) pour lequel Merlet donne:
Baliolum (vers 977),
Baliolis-villa (vers 1080, cart de
Saint-Père), Bajulolium (vers
1123 (cart. de Josaphat), Balliacum
(1148, charte du chapitre de Chartres),
Ballolium domini episcopi (1224,
id.), Saint-Étienne
de Bailleau-l’Evesque (1736, pouillé),
Bailleau-les-Bois (1793); et enfin 3) Bailleau-Armenonville,
dit aussi tout simplement Bailleau
(canton de Maintenon, arrondissement de Chartres),
pour lequel Merlet donne: Baillolium
(vers 1250, pouillé), Balliolum-sub-Galardone
(1626, pouillé), Saint-Martin
de Bailleau-sous-Gallardon (1736, pouillé).
Il doit s’agir de
Bailleau-le-Pin tout proche
de Saint-Avit-les-Guespières, dans le même
canton d’Illiers-Combray, et sur la route de cette ville à Chartres.
Cette localité donne son
nom à un certain Garin (Guarinus de Baillole), témoin à Chartres du consentement
donné par Gautier d’Aunay et sa
susdite femme Milsent au don de quatre familles de
colliberts de Denonville par Hersent (transaction 15).
|
Bardul Villa (A 19), Balduluilla (B 9), Bauduluilla (D 13):
Baudreville
Ces trois anciennes graphies alternatives
du toponyme de Baudreville sont intéressantes,
car elles illustrent bien à quel
point il faut se méfier des apparences
en matière de toponymie. En effet,
on serait tenté en première analyse
de faire remonter Baudreville
à un hypothéthique
*Baldrici Villa, «domaine de Baudry»
(comme dans le cas du Beaudrevilliers
du Loiret, dans la commune de Bondaroy,
qui s’écrit dans les chartes de Philippe
Ier: Baldrivillare,
Baldrevillare et
Baldricivillare). Il existe aussi
Baudreville dans le département
de la Manche, et un autre, lieu-dit de la
commune d’Erceville dans le Loiret: mais ils n’ont
pas forcément la même origine
étymologique, comme on va le voir.
Les
trois graphies divergentes de notre notice
sont en effet d’accord pour attester qu’au
XIe siècle le R de
Baudreville était
encore un L, ce qui ne peut s’accommoder d’une
telle origine.
La troisième graphie trahit
la véritable prononciation
de la première
syllabe au XIe
siècle, qui est déjà
la nôtre, bau-.
On prononçait quelque chose comme *Baudoulville.
La deuxième est une rétroversion
mécanique de Bau-
en Bal- (par analogie, cf. Baudouin,
Balduinus). La troisième
est la plus intelligente. L’auteur essaie de reconstituer
l’anthroponyme qui est à la base du
toponyme, et il s’inspire avec raison de la forme
Bardoul, qui était illustrée
encore de son temps par le fameux
Hugues Bardoul.
Baudreville
était donc au départ le
domaine (villa) d’un certain
Bardulf, sous la forme
Bardoul. *Bardoulville a d’abord donné par assimilation
*Baldoulville,
d’où *Baudoulville
au XIe siècle; ultérieurement,
par rhotacisme, *Baudourville,
et pour finir, par métathèse,
Baudreville.
Les anciennes
graphies de ce toponyme données par
Merlet (p.10) confirment ces conjectures faites
avant d’avoir pu le consulter:
Baudorvilla
(v. 1250, pouillé),
Bauldrouville
(1542, terrier de Reboulin);
Baudreville (1626, pouillé);
Saint-Fiacre de Baudreville
(1736, pouillé).
Actuellement
commune du canton de Janville (arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir).
Lieu éponyme
d’un certain Geoffroy
de Baudreville, témoin
deux fois à Étampes, la première d’une donation d’Arnaud
fils d’Aubrée (transaction
3), la deuxième fois d’une
concession de Guillaume fils de
Bernoal d’Étampes (transaction 6).
|
Bellus Mons (B 34): Beaumont (hameau de Chuisnes)
Il s’agit d’un toponyme assez courant.
Il était par exemple représenté
à l’époque de Philippe
Ier à Beaumont-sur-Oise, siège
d’un comté. Notre lieu-dit est ici mentionné
parce qu’un des témoins est le serf
ou domestique d’un certain Geoffroy de Beaumont
(Rainaldus famulus Gaufredis de Bello Monte). Or précisément
nous trouvons la
signature
de Geoffroy comte de Beaumont, $ Gaufredi
comitis Bellimontis dans une charte de Philippe Ier donnée
à Paris le 27 mai 1067, mais que Prou
considère comme un faux d’époque composé
entre 1071 et 1073 (p. 90, l. 37). C’est une fausse piste.On trouve en effet plusieurs Beaumont
dans notre secteur: un Beaumont à Chalo-Saint-Mars
(canton et arrondissement d’Étampes,
Essonne), un autre à Valpuiseaux (canton et arrondissement d’Étampes,
Essonne). En Eure-et-Loir le Dictionnaire
topographique de Marlet, page 12, ne signale
pas moins de cinq Beaumont.
Mais l’un d’eux s’impose absolument.
C’est un hameau
de la commune de Chuisnes, où témoigne
précisément notre Rainaud. Il est
cité en 1300 par le Polyptique
de Chartres sous le nom de Bellus
Mons, et en 1346 par une charte du chapitre
de Chartres sous le nom de Beaumont-soubz-Courbeville;
Le bois de Beaumont
est mentionné en 1527 par une charte du
chapitre de Chartres.
Aujourd’hui
hameau de la commune de Chuisnes (canton de Courville-sur-Eure, arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir).
Ce lieu donne son
nom à un certain Geoffroy, dont le
serf Rainaud est témoin, à Chuisnes,
de la donation par Hersent et Hardouin, ex-épouse
et fils de Thion, de quatre familles de colliberts
en provenance de Denonville (transaction 14).
(a) Nous possédons
une charte de ce prieuré faisant état d’une
donation de Hardouin Chef-de-Fer, où apparaît pour
témoin le même Geoffroy de Beaumont, cette fois
en personne.
|
Bertolcuria (B 17),
Bertoucuriam (B 21), Bertoldicuria (D 38): Bréthencourt
Les scribes de nos notices, et
d’autres, semblent penser qu’il s’agissait au départ
d’un anthroponyme masculin, Bertold-Berthoud, comme
le marque très nettement la troisième graphie. Un
autre copiste, vers la même époque, écrit pareillement: Bertolcor
(Archives départementales d’Eure-et-Loir, H. 2261).
On
pourrait donc croire en première analyse à l’exactitude
de cette rétroversion supposant une étymologie
«Cour de Berthold», de même
que dans le secteur Berthouvilliers, hameau
de la commune de Neuvy-en-Beauce au canton de Janville,
représente un «Villier de Berthold»
et Baudreville, au même canton
de Janville, un «Domaine de Bardoul».
Cependant une charte des environs de 1080, rédigée
à Bréthencourt même en présence
de la dame du lieu, écrit, bien différemment,
Bertildis Curia (charte éditée ici en
Annexe 6e): il s’agit donc plutôt d’un anthroponyme
féminin, Berthilde, Berthaut (cf. Brunehilde-Brunehaut, Richilde-Richaut,
Mathilde-Mahaut, etc.), puis, par métathèse, Brétaud.
Une autre charte encore datée d’environ 1110, porte également
Bertildis Curia (Archives d’Eure-et-Loir,
H 2256)
Autres preuves
d’une prononciation vernaculaire en -haut, le
Cartulaire de Saint-Père de Chartres
interprète cette terminaison comme un diminutif
masculin en -ellus, et écrit, dans un acte daté
précisément de 1137, Bretelli Curia;
et une autre charte du prieuré de Bréthencourt en
date de 1176 porte de Bertotcurte (Archives d’Eure-et-Loir, H 2256).
Quant à
la transition de *Brétaucourt à l’actuel
Bréthencourt, elle ne présente
pas la moindre difficulté. Nous constatons déjà
dans nos notices déjà un flottement entre les
son -an- et -au-, dans
le cas de l’anthroponyme Ansoué écrit d’abort
Ausoué (A 24: Ausueus de Mereruilla, B 16: Anseus de Merer Villa; B 28:
Ansue
de Merervilla). Cette confusion
existe d’ailleurs encore de nos jours à Étampes,
où j’ai lu début juin 2008, dans la copie
d’une collégienne, enrevoir pour au
revoir.
C’est un exemple intéressant
des erreurs que pouvaient commettre les scribes du XIe
siècle dans leur compréhension
des toponymes dont ils percevaient nettement le fonctionnement
étymologique sans pour autant être à
l’abri d’erreur de détail.
Aujourd’hui
lieu-dit de la commune
de Saint-Martin-de-Bréthencourt
canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines, arrondissement
de Rambouillet, Yvelines), alors siège
d’un prieuré de l’abbaye de Marmoutier.
1) La notice B précise que deux donateurs,
Godéchal et Amaury Roux d’Ablis, continueront
à percevoir le champart de Vierville au lieu
qui leur agréera, soit à Méréville
pour l’un, et à Étampes pour l’autre, où
ils résident respectivement, ou bien à
Bréthencourt, où se trouve sans doute
le grenier des moines de Marmoutier pour le secteur (transaction
8 et transaction 9).
2) La notice C mentionne par ailleurs pour
témoins un Allard de Bréthencout
et Robert compagnon du dit Allard
(transaction 18).
(a) Une charte conservée aux Archives d’Eure-et-Loir, H.2261, datée par l’inventaire
également de 1090 environ, et donnée
plus bas en Annexe 6e, mentionne
comme prieur de ce lieu un certain Geoffroy (Godefredus de Balae, prior
de Bertolcor), en présence de Thion
Chef-de-Fer déjà moine.
|
Boesuilla (grangia Boesuillę) (D 23): Boisville-la-Saint-Père
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.23):
Bodasivilla
(vers 954, Cartulaire de Saint-Père-en-Vallée); Boesvilla (vers 1090: c’est notre
occurrence, et la date
est celle qui est supposé par
l’inventaire des Archives d’Eure-et-Loir),
Boasi Villa (vers
1100, Cartulaire
de Saint-Père-en-Vallée),
Boeinvilla (vers 1250, pouillé),
Boivilla (1252, charte
du chapitre de Chartres),
Besvilla (1270, charte de l’abbaye de Bonneval), Boevilla-Sancti-Petri (1272, charte du chapitre de Chartres),
Boyville-la-Saint-Père
(1366, registre des contrats
du chapitre de Chartres), Boivilla-in-Belsia
(1626, pouillé),
Saint-Laurent de Boisville-la-Saint-Père
(1736, pouillé).
Aujourd’hui
commune du canton de Voves (arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir), alors siège
d’un prieuré dépendant de l’abbaye
de Saint-Père-en-Vallée. Merlet note
que le fief de Boisville-la-Saint-Père ressortissait
pour la justice à Janville.
C’est dans la grande de Boisville
que l’Étampois Payen fils d’Anseau, représenté
par Anseau fils d’Arembert, a autorisé
les donations opérées par Arnaud fils d’Aubrée et Godéchal
fils d’Oury, en présence
notamment d’Hugues Ier
du Puiset dit Blavons, d’Hugues
vicomte de Châteaudun et de son beau-frère
Nivelon fils de Foucher de Fréteval
(transaction 10).
(a) La famille
d’Aunay semble avoir été possessionnée
à Boisville, car une notice du Cartulaire de Saint-Père
(dont nous donnons le texte en Annexe 7b)
nous montre Gautier I d’Aunay consentir à la donation
de la voirie d’Honville par son vassal Gautier fils de Fléaud,
et une autre son frère Rainaud d’Aunay témoin
à Quémonville (Annexe 7f).
(b)
Nous savons entre autres par une charte de
Philippa de Courville en date de mars 1094 (Cartulaire
de Saint-Père de Chartres, éd. Guérard,
tome II, pp. 499-500, texte donné ici en
Annexe 6g) qu’Hardouin
Chef-de-Fer comme Garin de Friaize étaient
vassaux (fideles feodalesque nostri) du seigneur
de Courville, qui lui-même rendait hommage à
son suzerain (patronus) Nivelon de Fréteval.
(c) L’absence
lors de la cérémonie de la grange
de Boisville du chaînon féodal intermédiaire
entre la famille Chef-de-Fer et le sire de Fréteval,
c’est-à-dire celle de Giroie (Gerogius),
s’explique sans doute par le fait que c’est alors sa veuve
Philippe (Philippa) qui tient Courville au nom
de leur fils Yves.
|
Britto (B 27): Breton ou plutôt
Berthon
Breton,
en latin Britto ou Brito,
est un anthroponyme assez bien représenté
dans le secteur à cette époque
en temps que patronyme. C’est sans doute en fait une variante
par métathèse et par analogie de l’anthroponyme Berthon,
de même que Berthaucourt est déjà devenu alors Bréthaucourt
(Bréthencourt), et que surtout, dans le secteur,
Berthoni Villare (Cartulaire de Saint-Père,
p. 53) est devenu Bretonvilliers, lieu-dit d’Aunay-sous-Auneau
(aussi représenté à Maisse en Essonne, où
la même étymologie est la plus vraisemblable).
|
Carnotum
(aput) (B 34), Carnotis (A titre;
B titre), Carnotensibus
arpennis (B 2), Carnotensis monetę
(solidos) (B 18), Carnotensis
(Harduinus prepositus Carnotensis)
(B 33): à Chartres,
arpents chartrains,
monnaie chartraine, Hardouin
prévôt de Chartres
Le
toponyme se décline (B 34); dans
le titre Carnotis il faut sans doute
voir la forme indéclinable du toponyme (comme
souvent à cette date pour Étampes,
Stampis).
Chartres
(préfecture de l’Eure-et-Loir)
est le siège du diocèse dont relève
Vierville (A titre, B titre) et bien que ce village
appartienne depuis toujours au pays d’Étampes,
il se trouve clairement dans une zone frontière.
Les moines de Chuisnes
y comptent les surfaces en arpents chartrains
(B2, transaction 1) et payent un noble de Méréville,
Godechal, en sous chartrains (B 18, transaction
8). Le don à Chuisnes par l’ex-épouse
de Thion, Hersent, et par leur fils Hardouin,
de quatre familles de serfs en provenance de Denonville
se fait en présence du prévôt de Saint-Martin
de Chartres, Hardouin (B 33, transaction 14), et
l’autorisation donnée à cette donation par
Milsent et son mari Gautier d’Aunay est enregistrée
à Chartres (B 34, transaction 15).
|
Castellidunum (B
24): Châteaudun
La possession de certain
biens à Châteaudun est confirmée
aux moines de Marmoutier par l’évêque
de Chartres Renaud vers 1190: le prieuré de Châteaudun
avec la chapelle dans laquelle demeurent les moines
et avec l’église Saint-Jean de la Chaîne
(prioratum Castridunense, cum capella in qua manent
monachi et cum parrochiali ecclesia Sancti Johannis de
Cathena).
Chef-lieu d’arrondissement
de l’Eure-et-Loir.
Le vicomte de Châteaudun
Hugues (avec son beau-frère
Nivelon fils de Foucher de Fréteval) est témoin de l’autorisation
donnée par l’Étampois
Payen fils d’Anseau fils d’Arembert aux
donations opérées par Arnaud fils d’Aubrée et Godéchal
fils d’Oury (transaction 10).
C’est sans doute qu’il est alors avec eux à la
cour de d’Hugues Ier
du Puiset, dit Blavons (qui n’est pas mort avant 1096).
|
Cimitherium (B 4);
Cimiterium
(B 23): Cimetière
Rappelons que le mot
de cimetière est d’origine purement chrétienne
et qu’il signifie étymologiquement
“dortoir” (dans l’attente de la résurrection).
Michel Lauwers a montré récemment
que les cimetières, pendant une courte parenthèse
constituée par les dixième
et onzième siècle, sont curieusement
devenus des lieux de vie et d’habitation. Nos notices confirment
pleinement cette vue.
 Il est
question d’une part du cimetière de
Vierville où Gautier d’Aunay et sa femme
Milsent se réservent le droit d’édifier
une ou deux maisons, et d’autre part d’un cimetière
qui donne son nom à un certain Étampois,
Robert du Cimetière (Rotbertus de Cimiterio), sans qu’on sache de quel cimetière
il s’agit. Il est cité
juste avant un Baudry du Fossé (Baldricus
de Fossato): ils sont témoins de la donation d’Amaury Roux d’Ablis à
Étampes (transaction
9).
Il est
question d’une part du cimetière de
Vierville où Gautier d’Aunay et sa femme
Milsent se réservent le droit d’édifier
une ou deux maisons, et d’autre part d’un cimetière
qui donne son nom à un certain Étampois,
Robert du Cimetière (Rotbertus de Cimiterio), sans qu’on sache de quel cimetière
il s’agit. Il est cité
juste avant un Baudry du Fossé (Baldricus
de Fossato): ils sont témoins de la donation d’Amaury Roux d’Ablis à
Étampes (transaction
9).
Rappelons
que les fouilles de l’été 2007
opérées par l’INRAP sous la direction
de Xavier Peixoto ont mis à jour
des sépultures du XIe siècle rue de
la République devant l’Hôtel-Dieu
jusqu’au portail de la collégiale Notre-Dame,
et plus haut, près de Saint-Basile. Ci-contre un cliché
de Jacques Corbel lors d’une fouille plus haut dans la rue de
la République, au niveau de la place Romanet, derrière
Saint-Basile, où été mis à jour
une trentaine de squelettes.
Voir:
Michel LAUWERS [né en
1963], Naissance
du cimetière: lieux sacrés
et terre des morts dans l’Occident
médiéval [22 cm; 393 p.; bibliographie
pp. 343-382; index], Paris, Aubier
[«Collection historique»], 2005 [ISBN
2-7007-2251-5; 24€].
Jacques CORBEL, “Le gisant de Saint-Basile”, in ID.,
Le Blog du Flâneur Étampois,
http://flaneur-etampes.over-blog.com/article-6993248.html, 2007, en ligne en 2008.
|
Choina (A
11); Coina (B 11, 32a, 32b, 34): Chuisnes
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.49),
les premières tirées de chartes
du prieuré de Chuisnes: Vicus
Choinensis (v. 1020); Choina
(v. 1045); Cheoni (v. 1050);
Chonia (1117); Chuenia (1239);
Chuinia (1258); Chuene,
Chuyne (1338); Chuisnes
(1473); les autres tirées d’autres sources:
Chenua (1215, charte de la
léproserie du Grand-Beaulieu);
Chenia (cartulaire du Grand-Beaulieu, p.34),
Chuesne (1384, charte de l’abbaye
de Saint-Jean-en-Vallée); Saint-Martin
de Chuisnes (1736, pouillé).
Commune du canton
de Courville-sur-Eure, arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir, alors siège
d’un prieuré dépendant de l’abbaye
de Marmoutier, fondé vers 1080.
1)
C’est à Chuisnes qu’Hardouin vient donner
son autorisation à la donation de Vierville
faite par sa sœur Milsent (A 11 = B 11, transaction
4).
2) C’est encore à Chuisnes
qu’il vient avec sa mère Hersent faire la donation
de quatre familles de colliberts de Denonville (B
32, transaction 14). Il y a
en effet à Chuisnes un cloître (A
11 = B 11), dont le prieur s’appelle Thibaud (domno Tetbaldo priori Coinę), qui représente l’abbé de Marmoutier.
Chuisnes donne aussi son nom à un témoin
ce cette même transaction qui y réside,
Guillaume Roux de Chuisnes (B 34).
(a) En 1083 le prieur est un certain Thierry
(témoin de la donation par Giroie de Courville de Saint-Nicolas
de Courville à Marmoutier, AD28, H.3385, éditée
dans le Cartulaire de
Saint-Jean-en-Vallée, n°2, p. 2: Theoderic
prior de Chonia).
(b) Le 29 novembre
1119 c’est un certain Henri (accord entre les les
moines de Saint-Jean-en-Vallée et ceux de Marmoutier,
Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°20, p. 14: S. Henrici Choiniae prioris).
|
Cramisiacum
(A 10 = B 7): Crémisay
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.56):
Cramisium
(v. 1050, charte du prieuré de
Vieuvicq); Cramisiacum (v. 1080,
ibid.); Crémisy
(1380, note d’Illiers).
Hameau aujourd’hui
disparu de Saint-Avit-les-Guespières.
A
ne pas confondre avec le moulin de Crémisay dans la paroisse
de Villevillon, appelé Crimisium vers 1070
(Charte du prieuré de Vieuvicq ), Moulin
de Crémisé en 1677 (Registres
de Villevillon), Moulin de Crémisay
en 1691 (Registres de Villevillon); ni avec Cramoisy, commune du canton de Montataire, arrondissement
de Senlis, département
de l’Oise (in territorio Vilcassino villam quae dicitur
Cramisiacum au début du IXe siècle,
Cramisiacus en 859, Villam Cramitiacum
en 875, Guillelmus de Cramisiaco en 1007,
apud Cramesy en 1136, Vuillelmum
de Cramiseio en 1150, Cramoisi en 1177,
1358 et 1530, Cremoisi en la diocesse de Beauveiz
en 1273, Johannes de Cramoysiaco en 1269, Cramoisy en 1349, 1480
et 1585, Kramoisi en 1363).
Ce hameau donne son
nom à certain chevalier, Thion de Crémisay
(Theudone milite de
Cramisiaco), qui se porte témoin
de la donation de Vierville effectuée
à Saint-Avit par Milsent selon le rite
(transaction 2).
|
Dallei Mons (D 32): Dolmont
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.60), à
qui celle-ci a échappé:
Daullomons
(1246, charte du chapitre de Chartres);
Daulemont (1259, nécrologe
du chapitre de Chartres);
Dalemont (1274, charte du
chapitre de Chartres); Domnont
(1280, id.); Dalimons
(1300, polyptique de Chartres); Dallimons
(1351, registre des contrats du chapitre de Chartres);
Dromont (1555, terrier des
Sandarville). Merlet note que le fief de Dolmont était
vassal du duché de Chartres.
Une autre graphie ancienne a échappé
à Merlet, tant est déficient le précieux
index que Guérard à donné dans son édition
du Cartulaire de Saint-Père, ou bien
lui a paru ne pas devoir être retenue, entre 1116 et 1124: Allemont (p.307:
Radulfus de Allemont, corrigé dans le
titre donné par le Cartulaire, p. 306,
Radulfo de Dallemont).
Dolmont, actuellement faubourg
de Saint-Georges-sur-Eure (canton de Courville-sur-Eure,
arrondissement de
Chartres, Eure-et-Loir).
Dolmont donne son
nom à un certain Robert de Dolmont, qui est témoin
à Chuisnes de la donation par Hardouin de quatre
familles de colliberts de Denonville (transaction 14).
|
Danonuilla
(A 24), Danunuilla (B 10; 20, 23, 30), Danouilla (B 16),
Danonisuilla (B 32):
Denonville
Voici les graphies
anciennes que donne Merlet (p.59): Danunvilla (vers 1080, charte du
prieuré de Bréthecourt);
Danonis-Villa (1109, id.);
Danonvilla (vers 1250, pouillé);
Denonvilla-in-Belsia (1626,
pouillé); Saint-Léger
de Denonville (1736, pouillé). Merlet note que
le fief de Denonville était vassal
d’Étampes et y ressortait pour la justice.
Il a relevé de fait ultérieurement,
très clairement et sans contestation, du
bailliage d’Étampes.
Aujourd’hui commune du canton d’Auneau
(arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir).
(1) Denonville donne
son nom à un certain Hébert
de Denonville, dont le nom conclut quatre listes
de témoins de quatre transactions différentes
toutes passées à Étampes:
1° celle d’Arnaud fils
d’Aubrée, faite à Étampes
(transaction 3); — 2° une première
donation de Godéchal
fils d’Ourly, sans doute à Méréville
(transaction 7); — 3° une autre donation du même
Godéchal, à
Étampes (transaction 8); — 4°
une donation d’Amaury Roux d’Ablis avec l’autorisation d’Aubert fils d’Anseau, à Étampes (transaction 9). Cette position systématique en fin de liste
indique peut-être que de Hébert
était le clerc de la famille Chef-de-Fer.
Voyez en effet ce qui suit:
(2) Denonville donne son
nom également à un certain Raoul fils
de Jocelyn de Denonville, témoin en même
temps qu’un certain clerc Geoffroy (Radulfus
Gauscelini filius de Danunuilla et Gaufredis clericus) du consentement donné à la donation
de Godéchal par Anseau Robert fils
de Béguin et sa mère Eudeline, apparemment
dans le secteur de Méréville (transaction
14).
(3) Enfin ce sont
quatre familles de colliberts de Denonville
qui sont données par Hersent et Hardouin,
respectivement ex-épouse et fils de Thion
Chef-de-Fer, à
savoir Geoffroy avec ses filles et ses
filles, qui sont données aux moines de
Marmoutier par Hersent et son
fils Hardouin Chef-de-Fer, apparemment
pour coloniser des terres de Vierville (transaction
14).
Il
est clair que les Chef-de-Fer étaient
possessionnés à Denonville, mais
semble-t-il seulement du fait d’Hersent, ex-épouse
de Thion et mère d’Hardouin et de Milsent,
car une charte de Chuisnes faisant état d’une
donation d’Hardouin Chef-de-Fer le qualifie de chevalier
du château de Courville (de l’autre côté
de Chartres). |
Dordanum (B 28):
Dourdan
Hippolyte
Cocheris (qui malheureusement ne cite pas ses sources)
donne, dans son
Dictionnaire des anciens noms
de communes de Seine-et-Oise: Dortenco (monnaie mérovingienne),
Dordinga
(936), Dordingha
(956), Dordeneus villa (936),
Doringa (956), Drodinga
villa (956), Dordingum
(986), Dordinchum (1147),
Dordentium (1120),
Dourdain, Dordan (1174),
Dordanum (1222), Dordam
(1257), Durdactum (1514).
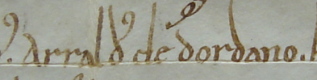 Chef-lieu de canton de l’arrondissement d’Étampes (Essonne).
Chef-lieu de canton de l’arrondissement d’Étampes (Essonne).
Dourdan donne son
nom à un certain Airaud de Dourdan (Arraldus de
Dordano), témoin de la donation de
Lomlu, vraisemblablement à Vierville même
(transaction 16).
|
Extolui (B 30);
Stonnum (C 38): Léthuin
Voici les
graphies anciennes extrêmemement variées
que donne Merlet (p.101-102) pour ce toponyme qui
a donné du fil à retordre aux scribes
qui voulaient lui donner une forme latine, et qui devait
alors se prononcer quelque chose comme *L’Estoin.
Les premières
dans des chartes du prieuré de Léthuin:
Leston (vers 1050);
Stoniae (vers 1120); Stonium
(1154); Lestonium (1209);
Lestuem (1210); Lestolium
(1215); Lestuen-in-Belsia,
Lestoen (1230); Estolium (1231);
Leustonium (1247) Lestun-en-Beaulce
(1487); les autres ailleurs: Estonium
(vers 1120, charte du prieuré d’Épernon);
Lestem (vers 1250, pouillé);
Lestunum (1365, registre des contrats
du chapitre de Chartres); Lestuing
(1466, charte de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée);
Scone (1653, carte de Sansom
d’Abbeville); Saint-Germain et Saint-Protais
de Lestuin (1736, pouillé). Il est clair que le L initial du toponyme
a été le plus souvent ressenti par
les clercs, à tort ou à raison, comme
un article, et qu’il a donc été omis en
latin. La possession de l’église de Léthuin (ecclesiam
de Lestonio)
est confirmée aux moines de Marmoutier
par l’évêque de Chartres Renaud
vers 1190. Merlet note
que le fief de Léthuin ressortissait
pour la justice au bailliage d’Orléans.
Actuellement commune du canton
d’Auneau (arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir).
C’était
alors le siège d’un prieuré de l’abbaye
de Marmoutier.
Les notices C et D mentionne comme
premier témoin des moines pour deux transactions
un certain prêtre Tamoué (Tamueius
presbiter, transaction 16), la notice D
précisant qu’il est prêtre de Léthuin
(Tamueius presbiter de Stonno,
transaction 16).
Léthuin
donne aussi son nom à un certain
Gautier d’Extolui, témoin du côté des moines,
et vraisemblablement moine lui-même, sans doute
à Vierville même ou à Léthuin,
du consentement d’Anseau Robert fils de
Béguin et de sa mère Eudeline à la donation de Vierville par
Godéchal et Amaury (transaction 13).
Une charte des environs
de 1090 conservée aux archives départementales
de l’Eure-et-Loir sous la cote H.2406, que j’éditerai
l’un de ces jours, mentionne le don par Baudry Tuault, Baldricus
cognomento Tuellus, de huit arpents de terre à Léthuin,
apud Leston.
Une autre charte des
environs de 1120 conservée sous la même
cote, que j’éditerai également l’un
de ces jours, mentionne le don par Aubert fils d’Anseau,
Albertus Anselli filius, de tout ce qu’il possédait à Noir-Épinay,
quidquid in Nigro Spineto habebat in
corpore ville et deforis juxta villam. Chartes citées
ici, pour l’instant, d’après l’Inventaire-Sommaire
de Merlet, p. 261.
La possession
de l’église de Léthuin est confirmée
aux moines de Marmoutier par l’évêque
de Chartres Renaud vers 1190 (AD28, H.2234, d’après Merlet, Inventaire-Sommaire, p.237: ecclesiam de Lestonio).
|
Fossatum (B 23, 28): le
Fossé
Il s’agit d’un
secteur à Étampes.
Ce Fossé d’Étampes
donne son nom à Baudry du Fossé (B
23: Baldricus de Fossato), cité juste avant un Robert
du Cimetière (Rotbertus
de Cimiterio): ils sont témoins, témoin de la donation d’Amaury Roux
d’Ablis à Étampes
(transaction 9).
|
Friesia (D 25):
Friaize
Voici les graphies
anciennes que donne Merlet (p.76): Friaxa (vers 1080, charte du prieuré
de Chuisnes); Friase (vers
1150, charte de la léproserie
du Grand-Beaulieu); Friessa (vers
1160, charte de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée);
Friesia (1168, charte de
la léproserie du Grand-Beaulieu);
Friasia (1171, id.); Friesa (1207, charte
de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée);
Freisia (1223, charte de la léproserie
du Grand-Beaulieu); Frieze
(1518, terrier de Landelles);
Saint-Maurice de Friaize (1736, pouillé).
Actuellement
commune du canton de la Loupe (arrondissement
de Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir).
Friaize donne son
nom à Garin de Friaize (vassal d’Yves de II de Courville dont les sources
conservées nous gardent des traces de 1079
à 1120) dont l’importance est marquée
par le contexte puisque, quoi qu’en fin de
liste, il est mis sur le même plan qu’Hugues
Blavons du Puiset, Hugues vicomte de Châteaudun
et Nivelon de Fréteval; il est témoin
avec eux de l’autorisation donnée
par l’Étampois Payen
fils d’Anseau (en fait représenté par
Anseau fils d’Arembert) aux donations opérées
par Arnaud fils d’Aubrée
et Godéchal fils d’Oury (transaction
10); il est alors avec eux à la cour
de d’Hugues Ier du Puiset, qui n’est
pas mort avant 1096.
Nous
savons entre autres par une charte de mars 1094
(Cartulaire de Saint-Père de Chartres,
éd. Guérard, tome II, pp. 499-500,
texte donné ici en Annexe
6g) que Garin de Friaize comme Hardouin
Chef-de-Fer étaient vassaux
(fideles feodalesque nostri) du seigneur de Courville,
qui lui-même rendait hommage à son suzerain
(patronus) Nivelon de Fréteval. L’absence
lors de la cérémonie de la grange de
Boisville du chaînon féodal intermédiaire
entre la famille Garin et le sire de Fréteval,
c’est-à-dire celle de Giroie (Gerogius),
s’explique sans doute par le fait que c’est alors (en
1094 du moins) sa veuve Philippe (Philippa)
qui tient Courville au nom de leur fils Yves cf. notre
Annexe 6g).
|
Gualardo (B 25,
27): Gallardon
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.77):
Galerdo (1024,
charte du prieuré d’Épernon);
Walardo (1028, charte de l’abbaye
de Coulombs); Galardo (1094,
charte de l’abbaye de Bonneval); Galardo
(vers 1100, charte du prieuré d’Épernon);
Galardum (vers 1130, cartulaire
de Thiron); Gaillardon (plan de Châtillon);
Saint-Pierre de Gallardon (1736,
pouillé). Alors prieuré
dépendant de l’abbaye de Bonneval. Merlet note que
c’était le chef-lieu d’une seigneurie du chapitre
de Chartres dont dépendaient les mairies de
Gallardon, Bleury, Écrosnes et Germonval.
Aujourd’hui commune
du canton de Maintenon (arrondissement de
Chartres, Eure-et-Loir).
Gallardon
donne son nom à Hugues de
Gallardon, qui consent, dans la maison des moines
d’Auneau, la donation de Vierville opérée
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils
de Bernoal d’Étampes et Arnaud fils d’Aubrée
(transaction 11).
Gallardon donne aussi son
nom à un certain Osmond
de Gallardon, témoin de ce même
consentement (transaction
11).
Selon Coüard
et Depoin, (Liber Testamentorum, p. 98, note
384), Gallardon appartint d’abord à Aubert le Riche,
qui eut trois fils: Aubert II, Garin et Thion. Aubert II n’eut
que deux filles. Il légua Thimert à Froheline,
épouse de Gasce, et Gallardon à Haubour (Hildeburge),
épouse d’un certain Hébert de Paris. Hébert
et Haubour eurent pour fils Hervé I de Gallardon.
Hervé eut pour enfant: Hugues I, Garin, Guy, Milon et
sans doute un certain Geoffroy de Gallardon, ainsi que la bienheureuse
Haubour (Hildeburge), épouse de Robert d’Ivry. A la
mort d’Hugues I, sans doute en Palestine, qui ne laissa qu’une
fille, son frère Garin lui succéda. Garin mourut
à son tour peu après, laissant un fils mineur,
Hugues II, dont Guy fut pour un temps le tuteur.
|
Lomlu (C 25): lieu non
identifié dans le terroir de Vierville
La formation de ce toponyme est caractéristique
du secteur où il se trouve,
où l’élement final
–lu est bien représenté.
On trouve encore en effet rien que dans ce canton
d’Auneau deux noms de communes ainsi formés:
Ardelu et Orlu.
Considérant que le
village d’Orlu (commune du canton d’Auneau, arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir) est à deux
kilomètres de Vierville, on peut se
demander si ce nom de Lomlu n’a
pas pu évoluer naturellement en Orlu. Voici les formes anciennes
que donne Merlet (p.135) pour Orlu: Orleium
(1154, charte de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée);
Orliacum (1162,
id.); Orli (1285, charte du chapitre
de Chartres); Orliarum locus (1435,
registre des contrats du chapitre de Chartres);
Saint-Médard d’Orlu (1736, pouillé).
Il faudrait imaginer d’abord un rhotacisme (Lomlu
devenu *Romlu ou *Rolu), puis une métathèse
(*Rolu devenu Orlu). En
effet dans le même secteur on voit évoluer
le nom de Baudreville dans le même sens:
Baudulvilla (vers 1090) en Baudorville
(1250) puis en Bau(l)drouvilla (1542),
Baudreville (1626). Pareillement pour
le nom de Dolmont, qui connaît une évoution
provisoire du même genre au XVIe siècle: Daulemont (1259), Dromont
(1555). De même Rotelu,
hameau de Videlles près La ferté-Alais
(orthographié ainsi au XIIe siècle
et à nouveau de nos jours) est devenu Ortelu
à l’époque de la carte de Cassini au
milieu du XVIIIe siècle (et encore à
l’époque de Gustave Estournet en 1944).Mais je ne crois pas trop moi-même
à cette hypothèse, car nous ne
voyons pas dans la suite qu’Orlu ait appartenu aux moines
de Marmoutier.
Cette terre de
Lomlu est donnée par Rainaud fils
de Thiou, vraisemblablement à Vierville même
(transaction 16), moyennant des contre-dons (transaction
17).
|
Ludo (B 30):
Ludon
Voici la seule
graphie ancienne que donne Merlet (p.106):
Lueton
(vers 1080, cartulaire de Saint-Père-en-Vallée,
p. 225). Merlet note que le fief de Ludon était
vassal de Frécot.
Hameau de la commune de Saumeray
(canton de Bonneval, arrondissement
de Châteaudun, Eure-et-Loir), à
8 km de Saint-Avit-les-Guespières.
Ludon donne son nom à
un certain Fouchaud de Ludon, témoin du côté
des moines, et vraisemblablement moine lui-même, sans doute à Vierville même ou à Léthuin, du consentement d’Anseau Robert fils
de Béguin et de sa mère Eudeline à
la donation de Vierville par Godéchal et Amaury
(transaction 13).
|
Maius Monasterium (A, 1-2, 12-13; B
titre, 1, 5, 15, 24, 28, 31-32; C 31, D 34, 38, 39), monasterium (D 40):
Marmoutier
L’Abbaye
de Marmoutier se dressait au nord
de la Loire, face à l’ancienne ville
de Tours, au lieu où
se retirait pour prier saint Martin,
évêque
de Tours de la fin du IVème siècle.
Les dépendances
de cette abbaye bénédictine
s’étendaient dans une
bonne partie de la France. Il en subsiste les vestiges d’une
ancienne église abbatiale plus
grande que la cathédrale de Tours,
et les grottes où séjournait Saint Martin.
C’est aujourd’hui un lieu-dit de la commune
de Sainte-Radegonde, dans le canton de Tours (Indre-et-Loire),
où s’élève un
établissement d’enseignement privé.
Liste des abbés de Marmoutier pendant
cette période: Aubert (1037-1063/1064), Barthélémy (1064/1084),
Bernard de Saint-Venant (1084-7 avril 1100), Heugaud/Hilgot (1100-10
août 1104), Guillaume de Nantes (Nanticensis, natif en
fait de Combourg, 1105-1124). La doantion
de Vierville eut donc lieu sous l’abbatiat de Bernard. Je n’ai pas pour
l’instant pu consulter de relevé des prieurs de Marmoutier.
(1) Robert de Vierzon,
prieur de Marmoutier, est représenté
à Saint-Avit-les-Guespières, lors
de la cérémonie d’investiture de Vierville,
par un serf du moine Thion (transaction 2).
(2) En revanche
il assiste personnellement, à Chuisnes,
au consentement donné par Hardouin et Hersent
à cette donation (transaction 4).
Voici une liste non exhaustive de prieurés
dont la possession est confimée
aux moines de Marmoutier dans son diocèse
par l’évêque de Chartres Renaud
vers 1190 (AD28,
H.2234, d’après Merlet, Inventaire-Sommaire, p.237): le prieuré de Saint-Thomas d’Épernon
avec l’église paroissiale
du dit lieu (prioratum
Santi Thomae Sparnonensis cum parrochiali ecclesia ejusdem loci);
l’église Saint-Pierre et l’église
Saint-Jean qui sont dans la même
place forte (ecclesiam Sancti Petri, ecclesiam
Sancti Johannis, que sunt in eodem castro);
le prieuré de Chuisnes
avec l’église du dit lieu (capellam
de Bello Loco, prioratum de Chonia, cum parrochiali
ecclesia ejusdem loci, ecclesiam Sancti Marini); l’église
de Saint-Avit (ecclesiam Sancti Aviti);
le prieuré de Châteaudun
avec la chapelle dans laquelle demeurent les moines
et avec l’église Saint-Jean de la Chaîne (prioratum
Castridunense, cum capella in qua manent monachi et cum
parrochiali ecclesia Sancti Johannis de Cathena).
On notera
que n’y sont pas mentionnés en temps que
prieurés mais seulement en tant qu’églises,
Léthuin (ecclesiam
de Lestonio, ecclesiam de Villeael), ni
Bréthencourt ni Vierville,
cette dernière église cependant
mentionnée juste après celle de Bréthencourt
(ecclesiam Sancti Martini de Bertoldi Curia, cum capella
Beate Marie Magdalene de castro, ecclesiam de Vervilla).
On remarquera
que nos notices parlent précisément
d’Épernon (et de son prieur
Hardouin, Harduino priore
Sparronensi, B 28, également connu par un acte
en date de 1092, et tandis que nous le voyons remplacé en 1098
par un Guillaume), de Chuisnes et de son prieur
Thibaud, Tetbaldus
prior Coinę, B 32; c’est à Chuisnes
que sont passées trois des transactions
en question, la dernière en présence
d’un certain Guillaume
Roux de Chuisnes, Guillelmus Rufus de Coina,
de Saint-Avit, où est passée
une transaction, de Châteaudun,
dont le vicomte Hugues, Hugo uicecomes Castelliduni, B 25, est présent à l’une des transactions,
et de Léthuin, dont viennent
deux témoins, le prêtre Tamoué,
Tamueius presbiter de Stonno, C 32 et D 34-38, et un certain Gautier de Léthuin, Gaulterius
de Extolui, B 31.
Il est aussi question
indirectement d’un prieuré champenois
des moines de Marmoutier à
Ventelay dont est originaire le
serf Constance, de Ventilaio, Constancius, C 32-33.
|
Mereruilla (A 24; B 17, 28),
Merer
Villa (B 16): Méréville
L’étymologie
de ce toponyme n’est pas évidente. Même
graphie vers 1105 dans le Liber testamentorum, qui mentionne comme témoin
un Stephanus de Merervilla (voir notre Annexe 7). Cocheris note seulement
(sans référence comme
d’habitude), «Merezvilla
et Mereville (1262)».
Le Cartulaire de
Saint-Père de Chartres (p.402)
contient une charte non datée entre 1069
et 1079 (p.CCCL) faisant état d’une donation
d’un Ingelgerius de Merervilla,
mais il est notable que dans la suite de ce document
(et dans le titre) le copiste porte une orthographe
différente, Ingelgerius de Merravilla
(titre et p.403), Galterius de Merravilla
(p.403). L’éditeur, Benjamin Guérard,
porte dans le Dictionnaire géographique
qu’il a mis en annexe (p828): «MERERVILLA , MERRAVILLA,
peut-être Mérouville.
Il y a plusieurs hameaux nommés Mèreville.
V. aussi MERREVILLA. MERREVILLA, Marville-Moutier-Brulé.»
Hors de notre secteur
on trouve peu de piste. 1) Dans le Calvados
Merville est noté
Matervilla en 1078 (cartulaire
de l’abbaye de la Trinité de Caen),
Merravilla en 1268. 2) Le Méréville
de Meurthe-et-Moselle a une autre
étymologie, car il s’écrit encore
au XIe siècle Amerelli
villa. Dans le Calvados Merville est noté
Matervilla en 1078 (cartulaire
de l’abbaye de la Trinité de Caen), Merravilla
en 1268. Notons ici à titre de
curiosté ce qu’Henri Lepage a écrit
des dénominations anciennes du Méréville
de Meurthe-et-Moselle: «MÉRÉVILLE, canton de
Nancy (Ouest). — Amerelli villa. 1065.
H. L. [= Histoire de
Lorraine par Dom Calmet], I, c. 456. — Sylva
de Amerelli villa. 1094. Ib., c. 498 [=
titre de fondation du prieuré de Saint
Tiébaut (actuellement ferme Saint Thiébaut)]. — Ameralli villa. 1105. Ib., c.
516. — Merevilla. 1127-1168. — Abb. de
Clairlieu. — Merelvilla. 1183.
Ib. — Mereiville. 1349. Tr. des ch., 1. Fiefs de Lorraine,
n° 21. — Le fief de Méréville
relevait de la châtellenie de Nancy, bail, de cette
ville. — Doy. du Saintois, dio. de Toul.»
(Henri Lepage, «Dictionnaire géographique de
la Meurthe», in Mémoires de la Société
d’archéologie lorraine, Seconde série IIe volume, Nancy, Lepage, 1860,
p.167). Quoi qu’il en soit, cette rétroversion
suppose ou atteste une aphérèse
(disparition de l’élément
initial), en reconstituant un anthroponyme
Amerel, formé
sur la même racine germanique que dans
Aimon ou Aimeric, avec
un suffixe latin -ellus. Cet anthroponyme doit
être à l’origine,
me semble-t-il, des patronymes modernes
Emerel,
Emereau, Aimereau,
Hemerel,
Haimerel et Hemereau.
Mais
cette piste ne paraît pas concerner notre
Méréville, où on n’a
aucune raison de soupçonner une aphérèse.
Il est certain qu’à
l’époque de notre charte, le nom du personnage
qui a donné son nom à Méréville
est devenu méconnaissable et l’on prononce
Mérerville sans reconstituer de génitif
de l’anthroponyme, probablement sorti de l’usage
et que le scribe ne tente pas de reconstituer. Cet
anthroponyme est sans doute, à mon sens,
Mérier (qui a survécu
comme patronyme) et qui dérive selon toute
apparence d’un anthroponyme germanique
Mar-hari (latin théorique
Marharius, Mararius).
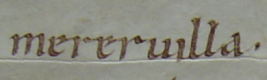 Chef-lieu de canton,
arrondissement d’Étampes, Essonne.
Chef-lieu de canton,
arrondissement d’Étampes, Essonne.
1) C’est à Méréville
(B 16) qu’habite habituellement Godéchal
fils d’Oury de Vierville, puisque libre
choix lui est donné de recevoir son champart
à Méréville ou à Bréthencourt
(transaction 8), de la même façon que
pour Amaury Roux, qui est clairement un Étampois, le champart
sera porté à son gré à Étampes
ou à Bréthencourt.
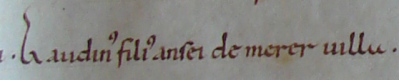 2) Méréville donne
son nom à un certain Gaudin fils d’Ansoué de Méréville (transaction 7, A 24: Galdinus
filius Ausuei de Mereruilla, B 15: Gaudinus filius Ansei de
Merer Villa: B 28: Gaudino
filio Ansue de Merervilla), témoin de la première donation de Godéchal,
peut-être à Méréville
(transaction 7), puis, à
Méréville sans doute également,
du consentement de sa veuve et de son fils Arembour
et Eudes (transaction 12), avec des nobliaux du pays,
Geoffroy de Moret et Eudes de Pannecières.
2) Méréville donne
son nom à un certain Gaudin fils d’Ansoué de Méréville (transaction 7, A 24: Galdinus
filius Ausuei de Mereruilla, B 15: Gaudinus filius Ansei de
Merer Villa: B 28: Gaudino
filio Ansue de Merervilla), témoin de la première donation de Godéchal,
peut-être à Méréville
(transaction 7), puis, à
Méréville sans doute également,
du consentement de sa veuve et de son fils Arembour
et Eudes (transaction 12), avec des nobliaux du pays,
Geoffroy de Moret et Eudes de Pannecières.
|
Moreth (B 28):
Moret
Au milieu
du IXe siècle, le Cartulaire de Saint-Père
de Chartres enregistre la possession
d’une petite ferme à Malaredum
(éd. Guérad, 1840, p. 53: in
pago Stampense, in villa quæ dicitur Malaredus,
mansum unum); il s’agit peut-être de
Moret, bien qu’on ait aussi proposé, avec plus
de vraisemblance, Melleray, à Oinville-Saint-Liphard;
car la possession de ce manse est confirmée
par Rainfroy évêque de Chartres, tandis
que Moret est du diocèse de Sens.
Moret, hameau de la commune
de Méréville, chef lieu de canton, arrondissement d’Étampes,
Essonne.
Moret donne son nom à
un certain Geoffroy
de Moret, témoin
semble-t-il à Méréville
du consentement à
la donation de Godechal de sa veuve Arembour et de son
fils Eudes (transaction
12), avec des nobliaux du pays, Gaudin
fils d’Ansoué de Méréville et Eudes de Pannecières.
|
Paniceriae
(B 28): Pannecières
Il s’agit
évidemment de Pannecières
dans le Loiret. Il existe au moins six communes ou lieux-dits
homonymes avec quatre graphies différentes qui s’expliquent par le fait que le
nom commun qu’elles reflètent n’a jamais, très
curieusement, été relevé par
les auteurs des dictionnaires usuels, et qui était
pourtant très répandu comme le montre la toponymie:
Panissières
(canton de Feurs, arrondissement de Montbrison,
Loire) et Pannessières
(canton de Conliège, arrondissement
de Lons-le-Saunier, Jura); un Pannecière
à Chaumard (Nièvre), un Panissière à
Lamure-sur-Azergues (Rhône), un Panissière à
Meyrieu-les-Étangs (Isère),
un Panissière à Bosjean
(Saône-et-Loire). Relevons
peut-être aussi la commune de
Panissage (Isère).
L’étymologie
de ces toponymes est transparente et dérive
du latin panicum, “panic” (sorte de milet).
Littré porte la définition
suivante: “PANIC (pa-nik), s. m. Genre
de plantes graminées dont fait partie le
milet. Le panic d’Italie, ou milet à grappe,
panicum italicum, Linnée. Le grand
milet, ou panic, panicum jumentorum,
Persoon. — ÉTYM. Lat. Panicum,
qui vient probalement de panus,
fil.”. Cependant la forme panic
me paraît de formation savante, tandis que
le Lexique de l’ancien français de
Godefroy porte de fait un mot panil, substantif
masculin disparu, dont il donne pour définition
“panic”, et qui me paraît formé sur une
forme diminutive (paniculum, paniclum). Le
Dictionnaire Robert de 1977 est plus
instructif: «“PANIC (-nik’)
ou PANIS (-niss’), n. m., lat.
panicum, dérivé de panus,
“fil de tisserand”. Bot. Plante monocotylédone
(Graminées), herbacée, annuelle
ou vivace, cultivée comme céréale
ou plante fourragère. Panic millet.
Voir Mil 2, Millet. Panic d’Italie (“milet
des oiseaux”). Panic ou Panis germanicum.
Voir Moha.»
Commune
du canton de Malesherbes, arrondissement
de Pithiviers, Loiret.
Pannecières donne son nom à un certain Eudes de Pannecières, témoin à Méréville
du consentement à la
donation de Godechal de sa veuve Arembour et de son fils Eudes
(transaction 12), avec des nobliaux du pays,
Gaudin fils d’Ansoué
de Méréville et Geoffroy de Moret.
|
Petræ (A 20; B 15):
Pierrefitte
Ce toponyme
Petræ, littéralement “les Pierres”, clairement
étampois (puisqu’il s’agit
d’une liste de témoin étampois)
s’est conservé ailleurs, en pays chartrain sous
la forme Pierres. Voici les graphies
anciennes que donne Merlet (p.143)
cette commune homonyme
au canton de Chartres-Sud-Est, autrefois
du canton de Maintenon:
Petra-ficta (774,
diplôme de Carloman); Petræ
(vers 1125, cartulaire de Thiron);
Petra (1240, charte du prieuré
d’Épernon); Saint-Gervais
et Saint-Protais de Pierres (1736, pouillé).
On y constate donc a
même alternance Pierres / Pierrefitte
qu’à Étampes.
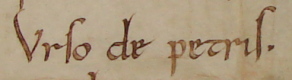 Aujourd’hui
Pierrefitte, hameau d’Étampes, au singulier puisqu’il ne reste plus guère
qu’un seul menhir debout, les autres
ayant été détruits à
l’époque moderne.
Aujourd’hui
Pierrefitte, hameau d’Étampes, au singulier puisqu’il ne reste plus guère
qu’un seul menhir debout, les autres
ayant été détruits à
l’époque moderne.
Ce toponyme donne
son nom à un nobliau étampois: Ours
de Pierrefitte (Urso de Petris, littéralement:
“des Pierres”), témoin
à Étampes du consentement de
Guillaume, fils de Bernoal, à
la donation de Vierville par Gautier
(transaction 6). Il s’agit vraisemblablement d’Ours
II fils de Thion II, bien connu par ailleurs, et dont se plaint
notamment l’évêque saint Yves de Chartres.
|
Puteolum
(b 24): Le Puiset
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.143):
Puteolum
(1095, charte du prieuré
de Saint-Martin de Chamars); Puisat (vers 1120,
id.); Puseatum
(1122, charte
de l’abbaye de Bonneval); Puteacensum
castrum (1129, charte de l’abbaye de Thiron);
Pusiacum (1179, charte du chapitre
de Chartres); Puteacum (1217, charte de la léproserie du Grand-Beaulieu); Puysatum (1230, id.);
Pusatum (1232, charte
de l’abbaye de Bonneval); Puisiolum (1240,
charte de la léproserie du Grand-Beaulieu);
Puisatum (1299, charte
de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée);
Pusacium (Orderic Vital, t. II, p. 412);
Le Puisas (Chanson d’Antioche,
vol. II, p. 112).
Commune
du canton de Janville (arrondissement
de Chartres, Eure-et-Loir).
Le Puiset donne
son nom à son seigneur Hugues Ier du Puiset,
qui n’est pas mort avant 1096, rebelle à son suzerain
le roi de France Philippe, à qui il a infligé
un sévère défaite en 1079 devant
le Puiset, et à la cour duquel il ne reparaîtra
jamais. Le seigneur du Puiset, vicomte de Chartres,
est témoin du consentement
de l’Étampois Payen
fils d’Anseau (en fait représenté
par Anseau fils d’Arembert) aux donations opérées
par Arnaud
fils d’Aubrée et Godéchal
fils d’Oury (transaction 10).
Il ne peut pas s’agir
d’Hugues II, seigneur du Puiset de 1097 à
1106 puisque pendant qu’il en fut le seigneur,
avant de partir en Palestine dont il ne reviendra
pas, Nivelon de Fréteval, qui signe aussi,
était déjà parti en Palestine, dont
il ne reviendra pas avant 1108.
Il semble bien qu’à
cette date encore Hugues du Puiset soit plus puissant
dans le secteur que le roi de France Philippe Ier.
Il a à sa cour le vicomte de Châteaudun,
le seigneur de Fréteval, le seigneur de Friaize,
et deux des plus puissants chevaliers d’Étampes,
Payen et Aubert, les deux fils d’Anseau fils d’Arembert. Personne ne paraît songer à faire appuyer
ces donations par un acte de l’autorité royale.
|
Roureium
ou plutôt Rovreium
(B 10): Rouvray
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet: Rubridum
(vers 1080, charte de l’abbaye de Saint-Denis-en-France);
Rivereium (vers
1250, pouillé); Rouvrayum-Sancti-Dionysii (1626,
pouillé);
Rouvray-les-Chaumes (1793).
Il s’agit
d’après le contexte très
vraisemblablement de Rouvray-Saint-Denis,
actuellement commune du canton
de Janville, arrondissement de Chartres, car il est
question du maire ou régisseur
de Rouvray juste après un
certain Geoffroy de
Baudreville, village distant
de 7 km de Rouvray-Saint-Denis et situé dans le même
canton.
Le maire ou régisseur
de Rouvray-Saint-Denis, Arnulfus maior
de Rovreio, est témoin
à Étampes de la donation
d’Arnaud fils d’Aubrée (transaction
3).
|
Sancta Maria
de Stampis (A 19, B 14):
Notre-Dame d’Étampes
On notera cette rétroversion
Sancta-Maria, tandis qu’on
aura plutôt, ultérieurement
Beata-Maria.
Collégiale
fondée autour de l’an mil.
L’abbé de Notre-Dame
d’Étampes, Bernaol (A 19: Bernoalius
abbas Sanctę Marię de Stampis, B 14:
Bernoalus abbas Sanctę Marię de Stampis)
est témoin à Étampes du consentement donné
par son parent Guillaume fils de
Bernoal d’Étampes à la donation
de Vierville (transaction 6).
|
Sanctus Avitus (A 7; B 5, 7): Saint-Avit-les-Guespières
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet:
Sanctus-Avitus-Guesperiae
(vers 1250, pouillé);
Sanctus-Avitus-juxta-Guesperiam
(1359, registre des contrats du chapitre de Chartres);
Saint-Avy-la-Guespière
(1485, charte du prieuré de Nottonville);
Sanctus-Avitus-prope-Illerium
(1541, charte de l’abbaye de Thiron). La possession
de l’église de Saint-Avit est confirmée aux moines
de Marmoutier par l’évêque de Chartres Renaud vers 1190
(ecclesiam Sancti
Aviti).
Commune du canton de Brou
(arrondissement de Châteaudun, Eure-et-Loir),
à 22 km de Chuisnes, à 48 km de Denonville,
à 56 km de Vierville. Merlet note qu’il y avait là un prieuré
dépendant de l’abbaye de Saint-Calais.
Saint-Avit est
selon toute apparence le lieu de résidence
habituel de Gautier d’Aunay et de sa femme Milsent.
Ils y ont leur demeure (domus), où
Milsent accomplit le rite de la donation de Vierville
en donnant un rameau de sureau au serf Archambaud, représentant
un moine de Chuisnes qui n’a pas fait le déplacement
(comme le précise la la notice B alors que
la notice A avait masqué le fait). En revanche
est présent un certain Thion de Cramisay,
hameau de saint-Avit, qui leur est peut-être apparenté
(transaction 2). La même notice précise
un témoin oublié par la première
rédaction, Robert,
son régisseur de Saint-Avit (B 7: Rotberto
maiore suo de Sancto Avito).
|
Sanctus Germanus (B 35): Saint-Germain
Merlet (p.164) ne relève
pas moins de huit Saint-Germain
dans le diocèse de Chartres entre lesquels
il est difficile de trancher.
Plutôt
que du lieu-dit d’Alluyes appelé Saint-Germain,
au canton de Bonneval, qui n’est qu’à
9 km de Saint-Avit-les-Guespières,
il doit s’agit de Saint-Germain-le-Gaillard, à
5,5 km de Chuisnes, et comme cette commune dans l’orbite
de Courville-sur-Eure, où se trouve un château
dont dépendent les chevaliers de la famille
Chef-de-Fer.
Cette localité donne son
nom à un certain Gautier (Gaulterio de Sancto Germano), témoin à Chartres du consentement
donné par Gautier d’Aunay et sa
susdite femme Milsent au don de quatre familles
de colliberts de Denonville par Hersent (transaction
15).
|
Sanctus Sigius (A 21; B 15): Saint-Cyr-la-Rivière
Cette graphie étonnante
reflète en fait une prononciation vernaculaire
où le R final s’est amui, comme l’atteste
aussi une graphie Sanctus-Ciacus attestée
en 1116 selon Merlet pour le hameau de Saint-Cyr
dans la commune de Senonches (arrondissement de
Dreux, Eure-et-Loir) qui reflète clairement
une prononciation *Saint-Cy. L’identification de ce lieu est légèrement
douteuse, car il peut s’agir théoriquement
autant du hameau de Saint-Cyr dans la commune de
Senonches (arrondissement de Dreux, Eure-et-Loir), que de Saint-Cyr-sous-Dourdan (canton de
Saint-Chéron, arrondissement d’Étampes,
Essonne) ou de Saint-Cyr-la-Rivière. Le contexte pointe cependant vers cette dernière
solution. Pour Saint-Cyr-la-Rivière
Hippolyte Cocheris donne seulement (sans
références, comme d’habitude),
S. Ciricus
et S. Ciriacus.
Saint-Cyr-la-Rivière,
au canton de Méréville,
arrondissement d’Étampes, Essonne.
Saint-Cyr
donne son nom à un certain Geoffroy
clerc de Saint-Cyr (Gaufredus clericus
de Sancto Sigio), qui apparaît
dans une liste de témoins clairement étampois du consentement donné par Guillaume, fils de Bernoal d’Étampes,
à la donation de Vierville (transaction
6).
Une
charte de 1222 conservée aux archives départementales
de l’Eure-et-Loir sous la cote H.2368, que j’éditerai
l’un de ces jours, mentionne un bail donné
à un certain Thomas clerc de Saint-Cyr d’Étampes,
Thome clerico de Sancto Ciriaco
Stampensi, c’est-à-dire de Saint-Cyr-la-Rivière.
|
Seenuilla (B 19):
Sainville
Voici les graphies anciennes
que donne Merlet (p.143): Segetis-Villa, c’est-à-dire
“domaine”, villa, de la “récolte”, seges,
segetis (1084,
charte du chapitre de Chartres); Sainvilla
(vers 1130, charte du chapitre de Saint-Jean-en-Vallée);
Seenvilla (1208, charte de
l’abbaye de Saint-Chéron);
Saivilla (vers 1250, pouillé);
La maladrye du Petit-Saintville
(1487, charte de prieuré de Léthuin);
Saint-Pierre de Sainville (1736,
pouillé). Ajoutons-y une graphie plus ancienne encore
Sigenvilla (1067, charte de Philippe Ier).
Je ne cacherai pas ici mon opinion, suivant laquelle il s’agit
étymologiquement d’une “domaine de Seguin” où
l’anthroponyme revêtait probablement
sa forme “Sewin”.
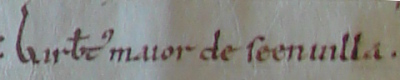 Sainville est ici représenté
par le “maire”
ou plutôt régisseur
Gibert (Girbertus major de Seenuilla). Cette mairie appartenait au monastère
de Saint-Benoît-sur-Loire. La
charte de Philippe Ier de 1067 nous montre aussi comme
témoin un maire
de Sainville, au milieu d’autres maires de domaines
appartenant à Saint-Benoît-sur-Loire;
mais le texte est lacunaire et l’on ne connaît
pas l’étendue de la lacune (quelques lettre ou plusieurs mots?): Gilbertus, major ipsius
terræ, et frater ejus Rodulfus
All[...] major
Sigenvillæ, Gosfridus, major d’Alton,
c’est-à-dire:
“Gibert, régisseur de la dite terre [probablement
Saint-Pierre d’Étampes] et son
frère Raoul All... régisseur
de Sainville, Geoffroy régisseur d’Authon”. Apparemment en 1067
le maire de Sainville est déjà
le frère d’un certain Gibert lui aussi maire,
et le Gibert de notre notice, maire de Sainville à
la génération suivante, est vraisemblablement
le fils de l’un d’entre eux, sans doute de Raoul.
Il apparaît comme témoin à Étampes
de la donation de Godechal (transaction 8).
Sainville est ici représenté
par le “maire”
ou plutôt régisseur
Gibert (Girbertus major de Seenuilla). Cette mairie appartenait au monastère
de Saint-Benoît-sur-Loire. La
charte de Philippe Ier de 1067 nous montre aussi comme
témoin un maire
de Sainville, au milieu d’autres maires de domaines
appartenant à Saint-Benoît-sur-Loire;
mais le texte est lacunaire et l’on ne connaît
pas l’étendue de la lacune (quelques lettre ou plusieurs mots?): Gilbertus, major ipsius
terræ, et frater ejus Rodulfus
All[...] major
Sigenvillæ, Gosfridus, major d’Alton,
c’est-à-dire:
“Gibert, régisseur de la dite terre [probablement
Saint-Pierre d’Étampes] et son
frère Raoul All... régisseur
de Sainville, Geoffroy régisseur d’Authon”. Apparemment en 1067
le maire de Sainville est déjà
le frère d’un certain Gibert lui aussi maire,
et le Gibert de notre notice, maire de Sainville à
la génération suivante, est vraisemblablement
le fils de l’un d’entre eux, sans doute de Raoul.
Il apparaît comme témoin à Étampes
de la donation de Godechal (transaction 8).
Vers
1127, le régisseur de Sainville est un certain
Ascelin (Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°40, p. 25: Ascelinus major de Seinvilla).
|
Sparronensis (Harduinus prior)
(B 28): d’Épernon
Voici les
graphies anciennes d’Épernon que donne
Merlet (p.143), les premières dans
des chartes du prieuré d’Épernon:
Sparro (1024 [erreur probable de Merlet à
corriger en 1052]); Sparnaicum
(1095); Esparnonium (vers 1120);
Esparlo (vers 1150);
Parlo (1208);
Espernonne (1450); les autres ailleurs:
Esparlum (cartulaire de
Thiron); Sparnonium (vers 1130, charte
du prieuré de Bréthencourt); Sparlo
(vers 1130, charte de l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée);
Sparnotum (vers 1140, charte
de prieuré de Chuisnes);
Sperno (1415, id.); Esperlio
(chron. Trivetti); Asparlo
(Orderic Vital, t. III, p. 347); Esparnon
(1282, charte du chapitre de Chartres);
Esparno (vers 1297, cartulaire des Vaux-de-Cernay,
p. 949); Espernon, qui jadis s’appelait
Autrist, puis Espierremont (1603, terrier de Dancourt).
Commune du
canton de Maintenon, arrondissement de Chartres,
Eure-et-Loir, où les moines de Marmoutier
avaient un prieuré.
Le prieur d’Épernon
Hardouin, avec son serf Ermengise, est témoin
de la concession faite
par Arembour, veuve de Godéchal fils
d’Oury (transaction 12) peut-être à Étampes,
ou bien quelque part dans le pays de Méréville
(les témoins étant des nobliaux
de Méréville, de
Moret et de Pannecières). Cet Hardouin est
le premier prieur connu du prieuré Saint-Thomas
d’Épernon (dont le roi Henri Ier a entériné
la fondation par une charte donnée à
Étampes en 1052). Il est aussi connu par une
charte de 1092 entérinant à Blois
un accord passé devant le comte Étienne
(Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois).
Il
paraît être mort avant 1098, date à
laquelle le prieur de Saint-Thomas s’appelle Guillaume.
Un
accord en date de 29 novembre 1119 entre les les
moines de Saint-Jean-en-Vallée et ceux de Marmoutier
(Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°20, p. 14) nous montre que le prieur de Chuisnes
s’appelle alors Henri (S. Roberti Sparnonensis prioris).
Voir: Émile LEDRU, «Le Prieuré
Saint-Thomas d’Épernon»
(daté 1897), in Charles MÉTAIS,
Archives du diocèse de Chartres. III.
Pièces détachées pour servir
à l’Histoire du diocèse de Chartres. 1er
volume. Études et documents publiés
par L. l’Abbé Ch. Métais, Ch. Honoraire
de Chartres [448 p.], Chartres, Ch. Métais,
1899, pp. 293-340, spécialement pp. 327 et 328.
|
Stampae (A 18,
19, 24; B 8, 13, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 22, 23; D 37),
Stampis Veteribus
(B 23bis), Stanpensis moneta (D 36): Étampes,
les Vieilles-Étampes,
monnaie d’Étampes
L’étymologie d’Étampes
(chef-lieu d’arrondissement de l’Essonne)
n’est pas établie. Toponyme attesté
depuis l’époque mérovingienne.
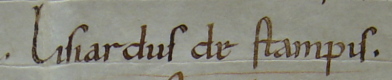 Étampes
est le lieu de résidence de plusieurs
témoins, et celui de plusieurs transactions,
bien que cela ne soit pas indiqué explicitement.
Voici les données explicites.
Étampes
est le lieu de résidence de plusieurs
témoins, et celui de plusieurs transactions,
bien que cela ne soit pas indiqué explicitement.
Voici les données explicites.
Deux transactions
sont localisées explicitement à
Étampes, la donation d’Arnaud fils d’Aubrée,
chez lui (in domo sua apud
Stampas, B 8, transaction 3) et
celle d’Amaury Roux d’Ablis (Factum
est autem hoc apud Stampas, B 21-22, transaction
99), ce dernier habitant également Étampes
puisque contrat précise que son champart
lui sera réglé soit à Bréthencourt,
soit à Étampes (B 21:
ad Stampas uel ad Bertoucuriam).
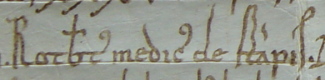 Neuf personnages tirent leur nom ou leur
dénomination d’Étampes:
Neuf personnages tirent leur nom ou leur
dénomination d’Étampes:
1) Guillaume fils de Bernoald d’Étampes (A
18-19: Guillelmus filius Bernoalii
de Stampis; B 13: Guillelmus filius Bernoali de Stampis)
qui consent, à Étampes,
à la donation de Vierville par Gauthier
d’Aunay (transaction 6).
2) Bernoal abbé
de Notre-Dame d’Étampes (A 19: Bernoalius abbas Sanctę
Marię de Stampis, B 14: Bernoalus
abbas Sanctę Marię de Stampis),
témoin du même consentement (transaction
6).
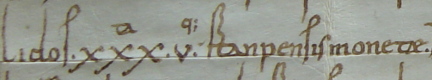 3)
Harpin
d’Étampes
(B 15: Harpinus de
Stampis), également témoin
de ce consentement, quoique la première
rédaction l’appelle plutôt Harpin
de l’Étampois (A
21: Harpinus de Stampesio)
(transaction 6).
3)
Harpin
d’Étampes
(B 15: Harpinus de
Stampis), également témoin
de ce consentement, quoique la première
rédaction l’appelle plutôt Harpin
de l’Étampois (A
21: Harpinus de Stampesio)
(transaction 6).
4) Lisiard d’Étampes (A 24 = B 16: Lisiardus de Stampis) témoin,
peut-être à Étampes,
de lapremière donation de Godéchal fils d’Oury (transaction 7).
5) Gautier d’Étampes (B 19: Gaulterius
de Stampis), témoin de la donation
de Godéchal effectuée à
Étampes (transaction
8).
6) Richer marchand d’Étampes (B 20: Richerius mercator
de Stampis), témoin
de la même donation de Godechal effectuée
à Étampes
(transaction 8).
7) Obert d’Étampes (B 23: Obertus de Stampis), témoin de
la donation d’Amaury Roux d’Ablis à
Étampes (transaction
9).
8) Guillaume des Vieilles Étampes (B 23: Guillelmus
de Stampis Veteribus), témoin
de la même donation d’Amaury Roux d’Ablis
à Étampes
(transaction 9).
9) Robert médecin d’Étampes (C 37:
Rotbertus medicus de Stampis)
témoin à Étampes de la donation par
Geoffroy de l’Eau d’une
terre de Vierville (transaction 18).
Il faut y joindre
d’autres personnages dont les noms renvoient
clairement à des toponymes étampois:
Baudry du Fossé (B 23: Baldricus de Fossato), Robert du Cimetière (B 23: Rotbertus de Cimiterio), cités juste après
Guillaume des Vieilles
Étampes (B
23: Guillelmus de Stampis Veteribus): ils sont témoins, témoin
de la donation d’Amaury Roux d’Ablis à
Étampes
(transaction 9), et encore Ours
de Pierrefitte (Urso de Petris,
littéralement: “des Pierres”), témoin
à Étampes du consentement de Guillaume, fils de Bernoal, à la donation de Vierville
par Gautier (transaction 6).
|
Stampesium (A 21):
l’Étampois (le pays
d’Étampes)
C’est à ma connaissance
la première occurence de ce terme, qui paraît
synonyme du tour plus classique
pagus Stampensis.
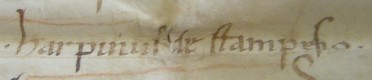 Ce toponyme donne son nom à
Harpin de l’Étampois, du moins dans la première version de la
transaction n°6, opérée à
Étampes (A 21: Harpinus de Stampesio),
car dans sa deuxième rédaction il s’appelle
tout simplement Harpin d’Étampes (B 15: Harpinus
de Stampis).
Ce toponyme donne son nom à
Harpin de l’Étampois, du moins dans la première version de la
transaction n°6, opérée à
Étampes (A 21: Harpinus de Stampesio),
car dans sa deuxième rédaction il s’appelle
tout simplement Harpin d’Étampes (B 15: Harpinus
de Stampis).
|
de Stonno (B 38): Léthuin;
voir de Extolui
|
Testiariae (de) (B
32): les Têtières.
Ce terme
de Têtière est encore en usage dans
la microtoponymie du pays chartrain, et désigne, au moins
en patois beauceron, la partie élevée d’un
champ ou d’un tertre, aussi appelée sommière;
et c’est ainsi par exemple qu’une
terre de la commune de Vierville s’appelle encore
la Têtière à Tureau, au témoignage de
Raymond Bouquery (voir notre bibliographie).
Il s’agit ici
d’un hameau de la commune d’Unverre dans le Dunois
(arrondissement de Châteaudun).
Ce toponyme donne
son nom à un certain Rainaud des Têtières, témoin en un lieu indéterminé
des contre-dons des moines à Rainaud
fils de Thiou et à sa parentèle
après la donation par Rainaud fils de Thiou de la terre de Lomlu
(transaction 17).
Il n’est
pas douteux que ce
Rainaud des Têtières, cité
après la mort de Gautier, juste après
Arnoux d’Aunay et son frère Garin (B 32: Arnulfus
de Alneto, Guarinus frater eius,
Rainaldus de Testiariis) soit à identifier avec le Rainaud d’Aunay (B 29: Rainaldus
de Alneio), frère
des précédents et témoin
de la transaction 12. Son neveu Gounier d’Aunay,
aîné de Gauthier II, est lui même qualifié
ailleurs, comme nous le montrerons, Gounier de Molitard,
puis Gounier de Saint-Avit.
|
Trachetum (D 34):
lieu-dit non identifié: Tracy.
Ce toponyme est difficile.
Il qualifie un certain Hugues, témoin
à Chartres du consentement de Gautier
d’Aunay et de sa femme Milsent Cherf-de-Fer
à la donation par Hardouin de quatre famille de collierts
de Denonville (transaction 15).
Liste des témoins:
Yves fils d’Hébert; Robert Fléaud;
Garin de Bailleau; Hugues de Tracy; Gautier
de Saint-Germain; Hardouin d’Adonville; le frère
de Gautier d’Aunay, Arnoux.
Ce qui ne nous aide pas, c’est
que tant Bailleau et Saint-Germain peuvent pour
leur part être identifiés difficilement.
On cite ultérieurement
un Giraud ou Girard de Tracheto, auteur
de Vies des frères prêcheurs (Vitae
fratrum ord. Praedicatorum a Geraldo de Tracheto),
au XIVe siècle [B.-M. REICHERT (éd.),
Fratris Gerardi de Tracheto O.P.
Vitae fratrum ordinis praedicatorum necnon Cronica ordinis
ab anno 1203 usque ad 1254, ad fidem codicum manuscriptorum
accurate recognovit notis breviter illustravit Benedictus
Maria Reichert (24 cm; 362 p.), Romae ("Monumenta ordinis
fratrum praedicatorum historica" 1), 1896.
Il existe un Traceium
dans la Calvados, aujourd’hui Tracy (Narcisse
de Caumont, Statistique monumentale
du Calvados, Caen, Hardel, 1857, t. III, p. 566:
Ecclesia de Tracheio), un autre Tracy
dans l’Oise près Compiègne et un Tracy-sur-Loire
dans la Nièvre.
Dans notre secteur,
rien. S’agirait-il d’une altération
de Tron-
en Tra-? De fait il existe un lieu-dit le
Tronchet, à Chalo-Saint-Mars; en 1177
ou 1178, une charte de Jocelyn d’Auneau a pour témoin
un Ricardus de Troncheio
(Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs, t. II, p. 365): Depoin
propose alors
Le Tronchay-Maquereau, comm. de St-Arnoult-des-Bois,
ca. Courville, ar. Chartres (Ibid.,
n. 372), mais pourquoi pas Le Tronchet
étampois, plus proche?
Il
reste cependant que cette supposée altération
de Tron- en Tra- ne paraît
pas bien explicable, ni bien satisfaisante.
Il s’agit donc sans doute d’un lieu-dit Tracy, homonyme
de celui du Calvados, aujourd’hui disparu.
|
Ventilaium (B
32-33): Ventelay
Il s’agit de Ventelay,
en latin Ventiliacum ou Ventilaium
(canton de Fismes, arrondissement de Reims,
Marne). Thibaud Ier de Blois, comte de Chartres,
de Blois, de Châteaudun, de Tours, de Sancerre,
et de Champagne avait fondé en 1040, de concert
avec sa mère, un prieuré de Marmoutier
à Ventelay, près de Reims (Henry Arbois
de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes
de Champagne, 1859, p. 380).
Les moines de Marmoutier
paraissent avoir envoyé à Vierville
un des serfs de leur prieuré champenois
de Ventelay, près de Reims, qui est témoin quelque part entre Aunay et Vierville des contredons
des moines à la parentèle de Rainaud
fils de Thiou après la donation de la terre de Lomlu,
Constance de Ventelay (transaction 17).
Ce moine nous est aussi connu par une
charte du prieuré de Bréthencourt datée
environ de 1080 et dont nous donnons le texte en
Annexe 6e.
|
Vervilla (A titre, 23; B 33; C 34), Veriuilla (A 2,
15, 17, 18; D 1, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25,
27, 28), Verisuilla (D 2): Vierville
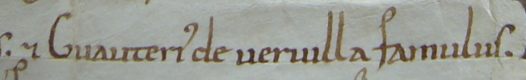 Mise à part une graphie
aberrante et isolée,
Verisvilla, la rétroversion
latine habituelle de ce toponyme
est Verivilla, «Domaine
de Vérus». Toutefois, à quatre
reprises, transparaît ce qui doit
être prononciation vernaculaire du XIe siècle,
Vervilla,
«Verville», d’où notre
Vierville.
Mise à part une graphie
aberrante et isolée,
Verisvilla, la rétroversion
latine habituelle de ce toponyme
est Verivilla, «Domaine
de Vérus». Toutefois, à quatre
reprises, transparaît ce qui doit
être prononciation vernaculaire du XIe siècle,
Vervilla,
«Verville», d’où notre
Vierville.
Citons ici Lefèvre (1867):
“L’origine de Vierville est très-ancienne,
si l’on en juge par les noms latins
que ce lieu porte dans les chartes du moyen-âge:
Verisvilla, Verivilla, Vervilla,
Viervilla. Nous y trouvons deux étymologies:
Veris-villa (la ville
ou résidence du printemps, par opposition avec
la résidence de l’hiver — Hyemis-villa
— Janville. — Veri Villa,
la villa ou ferme de Verus, appellation
toute romaine. Cette dernière semble
justifiée par les ruines anciennes que nous
allons exhumer”. L’argument de l’existence
de ruines romaines n’a guère de valeur,
car de nombreux lieux d’occupation gallo-romaine ont
été rebaptisés au cours des
âges et on a fort peu d’exemples avérés
de conservation d’un toponyme gallo-romain pour des villages
de cette taille. Surtou l’élément final -ville
n’est pas compatible avec une étymologie gallo-romaine.
On remarquera
que dans le cas du lieu-dit homonyme
Vierville-sur-Mer, en Normandie,
on rapporte ce nom à un anthroponyme
germanique Wivar,
car on trouve antérieurement
pour ce lieu-dit les graphies Wiarevilla
(1158) et Viarvilla
(1264). Cependant cette
évolution n’est pas supposable dans une région
comme la notre ou le W- initial s’altère régulièrement
en G-.
Il reste donc à
supposer que nous sommes en présence d’une aphérèse
par déglutination (de même que dans le cas bien
documenté du village voisin de Manterville,
Ermentardivilla en 1111, Mentarvilla en 1257);
le toponyme originel était vraisemblablement *Agobertivilla, prononcé *Aiverville ou *Averville,
domaine d’un certain Aivert, évolution
bien attestée localement, dès le XIe siècle,
de l’anthroponyme Agobertus, représenté notamment dans
le cas de l’évêque de Chartres dont nous donnons
une charte de 1055 environ (Annexe 6a) et
qui la signe Aivertus.
Commune du canton d’Auneau,
arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir.
|
Villa Illa (B 28): Villeau
Voici les
graphies anciennes que donne Merlet (p.189):
Villeel (vers 1125, cartulaire
de Josaphat, p. 26); Vilael
(vers 1250, pouillé); Villaelli
(1300, polyptique de Chartres);
Villeolum (1626, pouillé);
Saint-Jean de Villeau (1736, pouillé).
Actuellement commune du canton
de Voves (arrondissement de Chartres, Ruere-et-Loir).
Ce lieu donne son
nom à un certain Hongier, Hungerius
de Villa Illa, témoin
de la donation, vraisemblablement à Vierville
même, de la terre de Lomlu par Rainaud fils de Thiou (transaction 16).
Les moines de Marmoutier
avait là un prieuré, dont les Archives
départementales de l’Eure-et-Loir conservent
deux chartes de cette époque, l’une de 1080
environ (H.2416: apud villam
Viledellum nuncupatam) et l’autre de 1096 (H.2418).
Au reste la possession de l’église
de Villeau est confirmée aux moines de Marmoutier
par l’évêque de Chartres Renaud
vers 1190, juste après celle de Léthuin
(AD28, H.2234, d’après
Merlet, Inventaire-Sommaire, p.237: ecclesiam de Lestonio, ecclesiam de
Villeael).
|
Virso
(A 8 = B 2): Vierzon
Lefèvre
dans son édition partielle de 1867
a porté erronément de
Ursione (qui n’a pas de sens) au lieu que
le manuscrit porte de Uirsone. Il s’agit
de Vierzon, chef-lieu d’arrondissement du Cher. La Chronique des Seigneurs d’Amboise
(éd. Marchegay et Salmon,
Chroniques d’Anjou, t. 1,
1866, p. 210) cite au Xe siècle un
Ernulfus de Virsone. Une charte
de Marmoutier des environs de 1037 (éditée
1844 par Benjamin Guérard en annexe au Polyptyque
de l’abbé Irminon, p. 356) porte
la signature d’une moine Geoffroy de Vierzon (S.
Gausfredi de Virsone).
Vierzon donne son
nom au prieur de Marmoutier, Robert de
Vierzon (Rotberto de Uirsone),
à qui Milsent fait
la donation, nominalement et bien qu’il soit
absent de Saint-Avit, de Vierville (transaction
2), mais que nous voyons plus tard présent à
Chuisnes (transaction 4).
Il ne s’ensuit pas que que personnage
vienne d’aussi loin, car Robert de Vierzon n’est peut-être
que de Vieuvicq, à la limite des pays chartrain
et dunois.
En effet plusieurs chartes datant de la période
de 1050 à 1090, et relatives au prieuré
que Marmoutier avait à Vieuvicq, aux confins
des pays chartrain et dunois, font allusion à
des alleux qui y avaient appartenu à un certain
Geoffroy de Vierzon (Gausfredus de Virsonio) puis
à son fils, un certain clerc Humbaud, Uncbaldum
clericum filium Gausfredi de Virsonio (1061);
Unbaldus de Virsone (vers
1070); ex alodiis Humbaud
que fuerunt Huncbaldi de Virsone in confinio pagorum Carnotensis
atque Carnotensis (vers 1070). Textes cités ici
d’après l’Inventaire-sommaire de Merlet, sous les cotes H.2500 et H.2501, p. 271.
|
Vlmeium (A 17;
B 12). Ormoy
Ulmeium est une variante
fort courante en latin médiéval pour
Ulmetum (“lieu planté d’ormes”, de ulmus, “orme”). Il existe bien des Ormoy dans
le secteur dont trois en Eure-et-Loir (une commune du canton
de Nogent-le-Roi dans l’arrondissement de Dreux,
un lieu-dit de la commune de Dammarie,
dans le canton de Chartres-Sud-Est, et
un lieu-dit de la commune de Courbehaye dans le canton
d’Orgères-en-Beauce, arrondissement
de Châteaudun) et deux en Essonne,
Ormoy (commune du canton de Mennecy) et Ormoy-la-Rivière
(commune du canton d’Étampes).
Le contexte ne permet malheureusement pas ici
de trancher.
Cet Ormoy non identifié
donne son nom à un certain
Aubert (B
12: Albertus
de Vlmeio), témoin
de l’autorisation (en un lieu indéterminé)
de la donation de Gautier d’Aunay par Hugues
fils de Guerry et sa mère Helsent; son père appelé aussi Aubert déjà
en prenait nom (A 17: Alberto filio Alberti d’Vlmeio) (transaction 5).
|
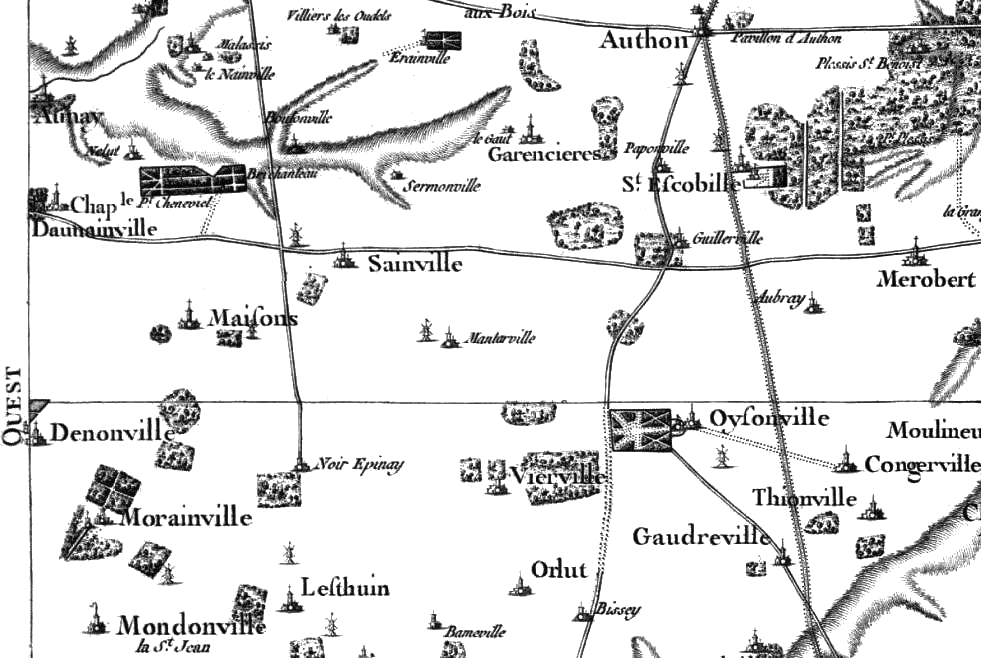
Le secteur de Vierville sur la
carte de Cassini (1756)
|
ANNEXE 2
RÉPERTOIRE
DES PERSONNES CITÉES
Notes de prosopographie
Ce
document mentionne nominativement plusieurs dizaines
de personnes dont un certain nombre sont mentionnées
par ailleurs dans des documents de même
époque, dont l’analyse est à chaque fois
nécessaire. L’analyse de ces données est
en cours, mais elle est loin d’être terminée.
Aimelin (Haimelinus,
A 20, Hamelinus, B 14),
père d’Aubert
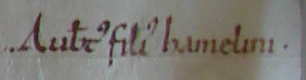 C’est le père d’un certain Aubert
(A 19-20: Haubertus
filius Haimelini, B 14:
Aubertus filius Hamelini), témoin
à Étampes du consentement de Guillaume
fils de Bernoal à la donation faite par Gautier
(transation 6).
C’est le père d’un certain Aubert
(A 19-20: Haubertus
filius Haimelini, B 14:
Aubertus filius Hamelini), témoin
à Étampes du consentement de Guillaume
fils de Bernoal à la donation faite par Gautier
(transation 6).
|
Airard, père de
Pierre (Erardus,
B 10), père de Pierre
C’est le père
d’un Pierre, témoin
à Étampes de la donation d’Arnaud
fils d’Aubrée et du consentement de son frère
Godéchal fils d’Oury de Vierville (transaction
3).
(a) Airard est aussi connu en
temps que tel par deux chartes étampoises
de Philippe Ier, l’une de 1082 en faveur de Notre-Dame
d’Étampes, qui nous fait connaître son
deuxième fils Hugues, frère cadet d’Airard
(p. 276, l.11: Petrus
Airardi filius et Hugo frater ejus);
(b) l’autre en faveur de la famille
d’Eudes le maire de Chalo-Saint-Mard, non datée
précisément, la date de 1085 apparaissant
seulement dans une interpolation du XIIIe siècle
(éd. Prou,
p. 425, l. 4: Petrus filius Erardi 1082).
(c) Une charte de Guy le Large de Pithiviers,
datée de 1070 environ, nous fait
connaître encore un troisième
fils d’Airard appelé Thibaud peut-être
décédé entre-temps. Elle porte
la signature d’un Pierre d’Étampes, qui
fut avec Thibaud, fils d’Airard (Bruel, Chartes
de Cluny, tome IV, n°3438:
S. Petri de Stampis,
qui fuit cum Tetbaldo filii Arardi). On notera que Depoin,
généralement très fiable, porte ici par
erreur Airaud
au lieu d’Airard dans une note de son
édition du Liber Testamentorum, note
255, Araudi pour Arardi).
On est donc fondé
à croire qu’Airard d’Étampes
a eu au moins trois fils, Thibaud, sans doute mort
jeune, Pierre, aîné des survivants à
l’époque de notre notice, et Hugues.
|
Airaud frère de Bernoal
I d’Étampes et d’Éblon
(Arraldus patruus illius Guillelmi,
A 18, Arraldus patruus
ipsius Guillelmi, B 14, Arraldus,
A 22)
Airaud
est témoin à Étampes de la transaction
6. Il est l’oncle paternel du donateur Guillaume fils
de Bernoal (A 18 = B 14); son frère Éblon
est également témoin de la même transaction
(A 20: Eblonius
frater Arraldi; B 14:
Ebulo frater
eius).
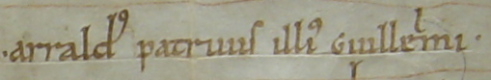 Le père commun
de ces trois frères étampois,
Bernoal I, Airaud et Éblon, était peut-être
Geoffroy, lui-même fils du premier vicomte connu
d’Étampes, Roscelin et frère cadet de Marc,
successeur de Roscelin. En effet une notice du Liber Testamentorum
de Saint-Martin-des-Champs datée par Depoin
du début du XIIe siècle (n°XXVII, p. 36), mais qu’il faut peut-être dater
plutôt d’avant nos transactions, cite comme témoin,
avant même Payen fils d’Anseau, un certain
Bernoal fils de Geoffroy fils de Roscelin (Interfuerunt autem ex parte ejus: Bernoalus filius Godefridi
filii Roscelini, Paganus filius Anselli, etc.)
Le père commun
de ces trois frères étampois,
Bernoal I, Airaud et Éblon, était peut-être
Geoffroy, lui-même fils du premier vicomte connu
d’Étampes, Roscelin et frère cadet de Marc,
successeur de Roscelin. En effet une notice du Liber Testamentorum
de Saint-Martin-des-Champs datée par Depoin
du début du XIIe siècle (n°XXVII, p. 36), mais qu’il faut peut-être dater
plutôt d’avant nos transactions, cite comme témoin,
avant même Payen fils d’Anseau, un certain
Bernoal fils de Geoffroy fils de Roscelin (Interfuerunt autem ex parte ejus: Bernoalus filius Godefridi
filii Roscelini, Paganus filius Anselli, etc.)
On peut aussi
s’interroger sur leur parenté avec Bernoal II,
alors abbé de Notre-Dame d’Étampes
et son frère Aubert (Albertus), cités
juste après eux comme témoins de la
transaction 6, ainsi qu’avec les autres Bernoal dont
nous parlerons sous ce nom.
D’autres documents mentionnent
Airaud en temps que père de deux personages,
Ours et Arnoux.
(a) Une charte du Cartulaire de Longpont
(éd. Marion, n°CCCXVIII, p. 254)
datée des environs de 1100 nous fait connaître
deux fils d’Airaud (Adraldus) qui est alors
encore vivant quoique proche de la mort: Arnoux (Arnulfus,
Adraldi filius, de Stampis) qui donne alors aux
moines de Longpont une terre située à Favières;
et Ours, alors décédé (pro
anima fratris sui defuncti Ursonis).
(b) Le même cartulaire
de Longpont contient une charte de la même
époque où Arnoux fils d’Airaud est cité
comme témoin juste après Geoffroy
de Moret (éd. Marion, N°CCCXV, p. 253: Gaufredus de Moreto; Arnulfus,
filius Arraldi). Rappelons que ce Geoffroy
de Moret apparaît comme témoin de notre
transaction 12 (B 28: Gaufredo de
Moreth).
(c) Une troisième
charte non datée de ce cartulaire (n°CCCXXVI,
pp.258-259) nous montre Arnoux fils d’Airaud
(Arnulfus, filius Arraldi de Stampis) témoin d’une donation d’un certain Bernoal
d’Étréchy très vraisemblement
apparenté aux deux Bernoal d’Étampes
(Ce Bernoal a alors un fils survivant Hugues,
Hugo, et un fils décédé
Thibaud, Tebaldus). |
Airaud
(Arraldus,
A 24, B 16), père
de Robert.
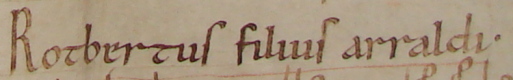 Cet Airaud est
le père d’un certain Robert, témoin
de la première donation de Godéchal
(transaction 7) qui semble avoir lieu quelque part
dans le pays étampois, entre Étampes
et Méréville. Nous n’avons aucune
bonne raison de l’identifier à Airaud
frère de Bernoal I d’Étampes et d’Éblon,
et d’en faire un frère d’Arnaud et Ours,
quoi qu’on ne puisse l’exclure
a priori.
Cet Airaud est
le père d’un certain Robert, témoin
de la première donation de Godéchal
(transaction 7) qui semble avoir lieu quelque part
dans le pays étampois, entre Étampes
et Méréville. Nous n’avons aucune
bonne raison de l’identifier à Airaud
frère de Bernoal I d’Étampes et d’Éblon,
et d’en faire un frère d’Arnaud et Ours,
quoi qu’on ne puisse l’exclure
a priori.
|
Airaud de Dourdan (Arraldus de Dordano, C 28)
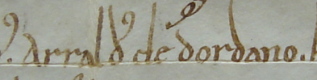 Airaud de Dourdan est le troisième
témoin de la donation par Rainaud fils de
Thiou de la terre de Lomlu (transaction 16).
Airaud de Dourdan est le troisième
témoin de la donation par Rainaud fils de
Thiou de la terre de Lomlu (transaction 16).
D’après sa place, c’est un nobliau.
Sont témoins avant avec lui:
le prêtre Aubry
et Guy fils de Serlon; et après lui: Hongier de
Villeau; Milon fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron
Gautier; le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud;
Aubert fils de Bouchard.
|
Allard de Bréthencourt (Adelardus
de Bertoldicuria, D 38 bis)
Témoin
de la donation
de Geoffroy de l’Eau fils de Félicie
(transaction 18) avec
son compagnon (socius) Robert, peut-être
à Vierville. L’étude des chartes de
Brétencourt nous en apprendra peut-être
plus sur ce personnage.
|
Alleaume, frère
de Robert d’Adonville (Adelelmus frater
eius, B 27)
La notice B
mentionne trois nobliaux qualifiés d’Adonville.
Il est d’abord question d’un Robert d’Adonville et son frère
Alleaume (B 27), témoins à
Auneau du consentement donné par Hugues de Gallardon
aux donations
faites par Gautier d’Aunay, Guillaume
fils de Bernoal d’Étampes et Arnaud fils
d’Aubrée (transaction 11); plus tard un Hardouin
d’Adonville sera témoin à Chartres
d’une concession de Gautier d’Aunay (transaction 15): tous
trois paraissent des nobles voire des chevaliers.
Rappelons qu’ultérieurement,
selon Merlet, le fief d’Adonville relevera du duché
de Chartres et ressortissait pour la justice
à Auneau.
Des recherches plus poussées aux
archives départementales de Chartres nous
en apprendront peut-être
plus sur ces personnages.
|
Amaury fils de Rahier Ier de Mondonville (Amalricus filius Raherii,
B 26)
C’est l’un des témoins à
Auneau du consentement donné par
Hugues de Gallardon aux donations faites
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal
d’Étampes et Arnaud fils d’Aubrée
(transaction 10).
Il est cité
en deuxième place, après Guy
fils de Serlon, mais avant et avant le prévôt
d’Auneau, Marin.
Il
s’agit d’Amaury fils de Rahier Ier de Mondonville (Amalricus filius Raherii). Mondonville est un hameau de la commune d’Amilly, canton
de Lucé, arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir.
(a) Nous le connaissons
en effet par ailleurs comme auteur d’une donation à
l’abbaye parisienne de Saint-Martin-des-Champs, avant 1096
(Liber Testamentorum, acte n°80). Il donne alors une terre dans son fief, de l’aveu de son seigneur,
Garin de Gallardon (frère d’Hugues de Gallardon mentionné
par notre transaction 11). Sa femme s’appelle Richaut (Richildis)
et ses fils Rahier II et Jocelyn (Raherius et Joscelinus).
Plus tard, Mabile, veuve de Garin remariée à Aimon
Roux d’Étampes, contestera cette donation.
(b) On possède aussi le texte d’une notice
enregistrant une donation d’Amaury sur son lit de mort (Cartulaire
de Saint-Père, n°LVI, p. 309) qui ajoute à
la liste de ses enfants les noms de ses filles Libour et Eustachie
(annuentibus conjuge sua Richilde, filiis Raherio, Joscelino,
Guarino, Pagano, Amalrico, filiabusque Letburge et Eustachia)
et qui nous donne le nom de sa sœur, fille
de Rahier I, Godhaut (Godechildis ejusdem soror).
|
Amaury Roux d’Ablis (Amalricus Rufus de Ableis,
B 19, 20, Amalricus Rufus, D 37,
Amalricus,
B 22, 29)
1) Amaury Roux d’Ablis est témoin,
apparemment à Étampes de la deuxième
donation de Godechal. Il est sans doute chevalier
car alors cité en deuxième position
après Gautier
d’Étampes; viennent ensuite le régisseur
de Sainville Gibert; le marchand d’Étampes
Richer, et Hébert de Denonville (transaction 8).
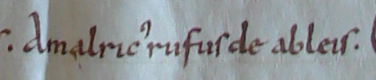 2) Il donne
lui même juste après cela un
bien à Vierville, en se réservant
le champart, qu’il percevra à son gré à
Bréthecourt, c’est-à-dire semble-t-il
au grenier des moines, ou bien à Étampes,
ce qui tend à indiquer que c’est là
son lieu de résidence habituel (A titre de
comparaison, Godéchal se réservait le
droit de percevoir le champart à Brétencourt
ou à Méréville). Du reste, cette
transaction se passe clairement à Étampes,
car les témoins en sont: Arnaud fils d’Aubrée, Christophe
Roi, Obert d’Étampes, le chanoine Gibert,
Guillaume des Vieilles Étampes, Robert
du Cimetière, Baudry du Fossé
et Hébert de Denonville. La transaction se fait avec l’autorisation de son épouse,
c’est-à-dire de celle d’Amaury, et celle
de ses deux fils, et de sa fille (transaction 9).
2) Il donne
lui même juste après cela un
bien à Vierville, en se réservant
le champart, qu’il percevra à son gré à
Bréthecourt, c’est-à-dire semble-t-il
au grenier des moines, ou bien à Étampes,
ce qui tend à indiquer que c’est là
son lieu de résidence habituel (A titre de
comparaison, Godéchal se réservait le
droit de percevoir le champart à Brétencourt
ou à Méréville). Du reste, cette
transaction se passe clairement à Étampes,
car les témoins en sont: Arnaud fils d’Aubrée, Christophe
Roi, Obert d’Étampes, le chanoine Gibert,
Guillaume des Vieilles Étampes, Robert
du Cimetière, Baudry du Fossé
et Hébert de Denonville. La transaction se fait avec l’autorisation de son épouse,
c’est-à-dire de celle d’Amaury, et celle
de ses deux fils, et de sa fille (transaction 9).
3) Il tenait cette terre en fief d’Aubert
fils d’Anseau (frère de Payen) qui donne
son consentement (transaction
9).
4)
La donation faite par Amaury (ainsi que celle
de Godéchal) reçoit ultérieurement, sans doute à Vierville même ou à
Léthuin, le consentement d’Anseau
Robert fils de Béguin et de sa mère
Eudeline, on ne sait à quel titre
(transaction 13).
5) Enfin Amaury Roux
est témoin de la donation de Geoffroy de l’Eau fils de Félicie
et de son épouse Gile (transaction 18). Il est alors cité
en deuxième position après le médecin
d’Étampes Robert; viennent ensuite:
le clerc Hardouin et un certain Garin serf de Geoffroy
et Gile.
(a)
Cet Amaury résidant à Étampes est vraisemblablement
à identifier avec un certain Emmauricus, Stanpensis
oppidanus, vir egregius, marié, avec des enfants (filiis
suis et uxore concendentibus), signalé par la Chronique
de Morigny (f°62v°) comme l’un de ses bienfaiteurs, qui
a donné à cette abbaye la chapelle de Saint-Julien,
dont nous savons qu’elle était du côté de la
Tour de Brunehaut, près Morigny. Reste à déterminer
ce que veut dire ici oppidanus Stanpensis, car ce mot
d’oppidanus a en latin médiéval tantôt
l’acception de châtelain, tantôt tout simplement celle
d’habitant.
|
Amaury Bésen,
père de Garin Bésin (Amalricus Bisenus,
ultérieurement corrigé
en Amalricus Besenus, A 16, Amalricus Bisenus,
B 13), père de Garin Bésin.
C’est le père d’un
certain Garin témoin du consentement d’Hugues fils de Guerry et sa mère
Helsent à la donation de Vierville
par Gautier d’Aunay (transaction 5).
(a) Nous savons par ailleurs
par une charte de Philippe Ier que ce Garin s’appelait
lui aussi Bisen
(éd. Prou, p. 21,
l. 7: Guarinus
Basinus): il signe en 1060 une charte de l’évêque
Aivert de Chartres ensuite confirmée
à Étampes par Philippe Ier.
(b) Garin appellera son propre fils aîné
Amaury. Voyez notre article Garin Bésin.
|
Anseau Ier père
de Payen et d’Aubert d’Étampes (Ansellus, B 8,
9, 22, 23, 24)
On
prononçait probablement encore Ansel
au XIe siècle, mais nous adoptons ici des orthographes
normalisées. Il est probable par ailleurs que
Ansellus, Anseau, est un hypocoristique d’usage
pour Anselmus, Anseaume.
Cet Anseau est le
père défunt de Payen (B 8,
23), qui est clairement chef de famille dès
la transaction 3, et d’Aubert (B 9, 22, 24a).
(a) Joseph Depoin s’était
jadis persuadé que cet Anseau,
père de Payen et d’Anseau, était lui-même
le fils d’un certain Gautier d’Étampes (Walterius
de Stampis) mentionné par le
Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs,
avant 1096, comme le père d’un Pierre
et d’un Anseau.
(b)
Or Gautier d’Étampes (Gaulterius de Stampis) intervient comme témoin de notre
transaction 8. Il semble donc que Depoin se soit fourvoyé.
En effet nous le voyons ici témoin à Étampes alors que Depoin suppose être
son petit-fils y agit en chef de famille (dès la
transaction 3) et que son arrière-petit-fils
supposé Jean est suffisamment âgé
pour être témoin (dès la même
transaction 3).
(c)
Il me semble plutôt que cet Anseau est l’Anseau fils de
Jocelyn (Ansellus, Gauslini filius) que mentionne une
notice du Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(n°XXVII, pp. 34-36), notice que Depoin date sans argument
du début du XIIe siècle mais qui pourrait au contraire
être antérieure à nos transactions. En effet
la notice en question évoque en deux temps, d’abord la donation
de Gautier, puis, après lamort de Gautier. Si j’ai raison, Payen
serait né d’une première union d’Anseau, qui épousa
ensuite Haugart, sœur d’un certain Geoffroy, qui ne peut-être
que le frère de Marc, vicomte d’Étampes, et fils comme lui
de Roscelin.
Nous voyons d’ailleurs au passage que Gautier,
loin d’être le père d’Anseau, était apparemment le
mari d’une fille que Haugart avait eu d’un premier lit (Walterius qui habebat privignam uxoris
ejus).
Surtout, dans la seconde partie de cette notice,
qui prend place après la mort d’Anseau, nous voyons précisément
surgir comme deuxième témoin, après Bernoal
fils de Geoffroy fils de Roscelin (Geoffroy paraissant mort lui aussi
), Payen fils d’Anseau, qui n’intervient que comme témoin,
après la mort de son père, n’ayant pas de droit sur
le bien naguère cédé par sa belle-mère
Augart.
On notera que le lieu-dit concerné
par la donation est mal identifié par Depoin qui parle
de Janville. Mais le texte, qui porte en fait Al Junvilla
(sic), est certainement corrompu, et, comme il est dit que
ce lieu-dit se trouve à côté de Gouillons (terra
nostra quam habemus apud Al Junvillam que est juxta Goelliolum), ce qui ne s’accorde pas avec Janville, qui en est distant
d’une trentaine de kilomètres, il faut certainement corriger,
à mon sens, Abunvilla, Abonville, commune
jouxtant bien, elle, celle de Gouillons.
(d) On comprendrait ainsi
comment il peut se faire que Payen fils d’Anseau détienne
la villicatio du villlage d’un village tel que Vierville,
dont est seigneur principal le vidame de Chartres. Son père
Anseau aurait été le fils de Jocelyn II de Lèves
et d’Adèle (Adila, Ada), veuve d’Hugues Ier (lui-même
vidame de Chartres, au moins jusqu’en 1059). Ainsi donc Guerry et
Anseau auraient été frères utérins,
et par suite, l’Étampois Payen fils d’Anseau et le vidame Hugues
II fils de Guerry auraient été cousins germains, issus
tous deux de la vidamesse Adèle.
|
Anseau fils d’Arembert (Ansellus filius
Aremberti, B 24)
Cet
Anseau fils d’Arembert qui représente
à Boisville-la-Saint-Père
Payen fils d’Anseau paraît être
l’un de ses hommes liges (transaction 10).
Nous connaissons ce personnage
par ailleurs.
(a) Anseau fils
d’Arembert fut aussi témoin de
la charte étampoise de Philippe Ier en faveur d’Eudes
de Chalo (charte dont la date de 1085 est très
douteuse). Voici le texte adopté
par Prou (p. 425, l. 2): Anselmus
(avec une variante Ansellinus)
filius Aremberti (avec
une variante Aramberti); Fleureau (p. 79) porte Anselinus filius
Aremberti. On observe
d’autres flottements entre les anthroponyme
Anselmus et Ansellus
dans les chartes de Philippe Ier éditées
par Prou (p. 280, l. 29; p. 281, ll. 6 et17;
p. 428, l.3). Il faut donc
conclure à l’identité
de ces deux Ansel ou Ansellin fils d’Arembert.
(b) Anseau fils d’Arembert (Ansellus
filius Arenberti) est aussi mentionné par la Chronique
de Morigny comme un bienfaiteur de cette abbaye, à laquelle
il a donné la moitié de l’église d’Étréchy
(f°62v°), l’autre moitié étant donnée
par Aimon fils de Sénhaut (Haimo filius Senechildis de
Firmitate Bauduini).
(c)
Il a aussi donné à cette abbaye (noster Ansellus), selon la même Chronique de
Morigny (f°63), un sixième de l’église
Saint-Germain de Morigny, un autre sixième étant
donné par le moine Élie (dont deux cousin s’appellent
Geoffroy et Bernard), deux autres par Ours et Arnaud les fils d’Aubrée,
les deux sixièmes restant n’étant pas encore récupéré
par les moines à l’époque de la Chronique.
|
Anseau Robert fils de Béguin et d’Eudeline
(Ansellus Rotberti
filius Beguini, B 30)
La
deuxième partie du nom de ce personnage
est au génitif (Ansellus Roberti),
ce qui indique qu’il s’agit ici d’un patronyme
qu’il a hérité de son père Béguin,
qui devait donc lui-même s’appeler Béguin
Robert. Anseau et sa mère, sans
doute à Vierville même ou à Léthuin, consentent aux donations opérées par
Godéchal et Amaury (transaction 13).
|
Ansoué de Méréville
(Anseus de Merer Villa, B
16, Ansua, génitif Ansue,
de Merervilla,
B 28, Ausueus de Mereruilla, A 24), père de Gaudin.
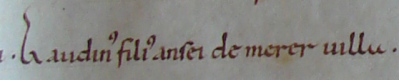 Ansoué, dont le nom a donné
du fil à retordre à nos scribes, qui
hésitent sur la rétroversion latine
à lui donner, était un chevalier possessionné
à Méréville et apparement défunt,
dont le fils Gaudin est témoin, quelque part
entre Étampes et Méréville,
de deux transactions relatives aux donations de Godéchal
fils d’Oury de Vierville, l’une de son vivant (transaction
7), l’autre après (transaction 12).
Ansoué, dont le nom a donné
du fil à retordre à nos scribes, qui
hésitent sur la rétroversion latine
à lui donner, était un chevalier possessionné
à Méréville et apparement défunt,
dont le fils Gaudin est témoin, quelque part
entre Étampes et Méréville,
de deux transactions relatives aux donations de Godéchal
fils d’Oury de Vierville, l’une de son vivant (transaction
7), l’autre après (transaction 12).
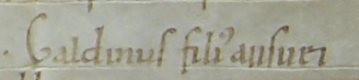 Il était
peut-être apparenté à
la veuve de Godéchal, Arembour, qui paraît
résider, au moins depuis le décès
de Godéchal, dans le secteur de Méréville.
Le nom de leur fils Eudes doit être aussi rapproché
de celui d’Eudes de Pannecières (transaction 12).
Il était
peut-être apparenté à
la veuve de Godéchal, Arembour, qui paraît
résider, au moins depuis le décès
de Godéchal, dans le secteur de Méréville.
Le nom de leur fils Eudes doit être aussi rapproché
de celui d’Eudes de Pannecières (transaction 12).
(a) Il ne faut probablement pas l’identifier à
un certain chevalier Anseis, père d’un certain Payen témoin
à Longpont vers 1110 (Moreherius miles,
Paganus filius Anseis), avec d’autres Étampois
(éd. Marion, p.191), et vivant vers 1105 (Anseius miles, Moreherius
miles, ibid. p. 203), encore qu’il ait bien existé un
Moreherius de Stampis (ibid., p. 225).
Le flottement dans la transcription de la
première syllabe (Au- dans la première rédaction,
An- dans la deuxième) ne doit pas nous étonner
daans un secteur où on constate qu’on passe facilement de *Brétaucourt
à l’actuel Bréthencourt. Cette confusion existe d’ailleurs encore
de nos jours à Étampes, où j’ai lu début
juin 2008, dans la copie d’une collégienne,
enrevoir pour au revoir.
|
Archambaud, serf du moine Thion (Archembaldus
famulus Theudonis monachi, A 9-10, Archenbaldus famulus,
B 6)
La première
rédaction nous dit simplement que ce domestique
du moine Thion a été témoin
à Saint-Avit-les-Guespières, au domicile
de Gautier d’Aunay, de la donation de Vierville
Milsent; la deuxième précise qu’il
y remplaçait le prieur de Marmoutier, qui n’avait
pas fait le déplacement de Saint-Avit, et que c’est à
lui que Milsent a donné rituellement le
bâton d’investiture,
baculum (transaction 2).
|
Arembert (Aremberti, B
24), père d’Anseau (Ansellus).
Arembert est le père d’un
Anseau qui paraît être un homme lige
de de Payen fils d’Anseau, qu’il représente
lors d’une cérémonie
d’armortissement
dans la grange de Boisville-Saint-Père (transaction 10).
Cet Arembert est aussi mentionné par
la charte étampoise pour Eudes de Chalo (trafiquée au XIIIe siècle
et daté douteusement 1085),
Arenbertus, père d’Anselmus,
altération d’Ansellus
(éd. Prou, p.
425, l. 2; on observe d’autres flottements entre
les anthroponyme Anselmus
et Ansellus dans les chartes de Philippe
Ier éditées par Prou, p. 280, l. 29; p.
281, ll. 6 et17; p. 428, l.3; quant au texte de
Fleureau, étonnamment négligé
par Prou, il porte alors Anselinus;
il est plus que probable,
de toutes façons, qu’Ansellus
et Anselinus étaient des formes
hypocoristiques d’Anselmus).
|
Arembour, épouse de Godéchal fils
d’Oury (Aremburgis,
B 29, Eremburgis
uxor predicti Godiscalis filii Vlrici,
B 27)
Arembour, veuve de Godéchal fils d’Oury,
avec leur fils Eudes, leur fils, donnent leur
consentement à la donation de Godéchal,
se trouvant alors apparemment dans le secteur
de Méréville, puisque les témoins
sont alors notamment Gaudin fils d’Ansoué de
Méréville, Geoffroy de Moret et Eudes de Pannecières
(transaction 12). |
Arembour, fille de Thiou (Arenburgis, C 27)
Fille de Thiou et
d’Ermentrud, sœur de
Rainaud, Pierre, Rosceline et Asceline, elle
consent à la donation de la terre de
Lomlu opérée par son frère
Rainaud (transaction 16). Elle fait ensuite
partie de ceux qui reçoivent un contre-don (transaction
17).
|
Arnaud fils d’Aubrée
et sans doute d’Oury de Vierville
(Ernaldus filius Alberedę,
B 1, 7, 24, 24, 26, Ernaldus, B 8-9), frère
de Godéchal
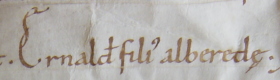 1)
Arnaud tenait à fief de Gautier
d’Aunay la moitié de Vierville, sans doute celle que ce dernier
tenait à fief de Guillaume fils de Benoal
(cf. transaction 3 et transaction
7).
1)
Arnaud tenait à fief de Gautier
d’Aunay la moitié de Vierville, sans doute celle que ce dernier
tenait à fief de Guillaume fils de Benoal
(cf. transaction 3 et transaction
7).
2) Arnaud fils d’Aubrée tenait à fief
de Payen d’Étampes les deux tiers de la mairie (villicatio)
de Vierville, le tiers restant étant détenu par son
frère Godéchal (cf. transaction 3).
3) Il
concède les unes et les autres. Cette donation se fait chez lui à Étampes
(in domo sua apud Stampas) (transaction 3).
4) Cette donation se fait
avec l’accord de son frère Godéchal
(B 8: concedente
fratre Godiscale),
à qui monsieur Thion Chef-de-Fer a donné
pour cela deux sous, ainsi qu’une place chez
nous à tous deux (transaction 3).
5) Les donations qu’il effectue nécessitent
aussi le consentement de Payen fils d’Anseau,
donné par l’intermédiaire d’Anseau fils
d’Arembert à la grange de Boisville-Saint-Père
en présente d’Hugues du Puiset; elle est nécessaire
pour ce qui concerne les deux tiers de la villicatio (transaction
10).
6) La donation d’Arnaud nécessite enfin
le consentement d’Hugues de Gallardon, pour la part
de Vierville qu’il tient en fief de Guillaume via Gautier, vassal
du seigneur d’Auneau pour ce bien-ci. Hugues de
Gallardon donne donc à Auneau son consentement à la donation
d’Arnaud en même temps qu’à celles de
Gautier et de Guillaume fils de Bernoal
(transaction 11).
(a) Cet Arnaud fils d’Aubrée nous
est également connu par la
Chronique de Morigny, qui rapporte
que les fils d’Aubrée Ours et
Arnaud (filii Alberee Urso et Arnaldus)
ont donné aux moines de Morigny
chacun le sixième de l’église de Saint-Germain
qu’ils détenaient (f°63). On notera
que le premier sixième en fut donné par Anseau fils
d’Arembert (noster Ansellus), selon la même
Chronique de Morigny (f°63), personnage
qui intervient aussi pour représenter Payen fils d’Anseau
lors de notre transaction 10.
Il semble donc qu’Oury, veuf et père de Godéchal,
avait épousé Aubrée, veuve et mère
d’Ours, et qu’ils avaient eu ensemble pour fils Arnaud. On peut
donc légitimement se demander si le premier mari d’Aubrée
n’avait pas été Thion II d’Étampes, fils d’Ours
I et père d’Ours II, qui doit peut-être être
identifié à Ours de Pierrefitte.
(b)
Quant à sa mère Aubrée, c’est elle
qui très probablement qui a donné son nom
au hameau d’Aubray dans la commune de
Mérobert (Essonne), non loin de Vierville
(Eure-et-Loir), qui est appelé Albereth dans une charte de Saint-Jean-en-Vallée
à Chartres antérieure à
1130.
|
Arnaud fils de Baudouin (Arnaldus filius Balduini,
A 21, Ernaldus filius Balduini,
B 15)
Cet Arnaud est témoin à Étampes
du consentement donné par Guillaume fils de
Bernoal à la donation de Gautier d’Aunay (transaction
6). |
Arnèse (Erneisius,
A 13).
Surnom
ou nom de famille porté par un certain
moine de Chuisnes, Gimard (Gingomarus
Erneisius), qui disparaît dans la deuxième
rédaction (B 11: Gingomarus)
|
Arnoux d’Aunay, frère
de Gautier II (Arnulfus
de Alneto, C 31,
Arnulfus frater Gaulterii
de Alneio, D 34)
Arnoux
d’Aunay est le frère de Gautier
d’Aunay et paraît lui succéder comme chef
de famille.
1) Il est témoin
à Chartres de la dernière transaction
enregistrée par la notice B: du consentement
donné son frère aîné Gautier
à la donation par son beau-frère de quatre
familles de colliberts: Arnulfus frater Gaulterii de Alneio (transaction 15).
2) Dans la notice C, qui
paraît plus tardive et peut-être du
début du XIIe siècle, alors que Gautier
est probablement mort, il est cité comme témoin
de la donation par Rainaud fils de Thiou et sa mère
Ermentrut de la terre de Lomlu, ou plutôt des contre-dons
des moines à la parentèle de Thiou,
quelque part entre Aunay et Vierville. Il n’est plus alors cité comme frère de
Gautier, mais lui-même titré
d’Aunay; en revanche est cité
après lui, et pour la première fois,
leur frère cadet Garin: Arnulfus de Alneto, Guarinus
frater eius (transaction 17).
(a) Un Arnoux d’Aunay est mentionné
après 1062 (ce qui n’est malheuresement pas très précis)
par une notice de Marmoutier pour le Vendômois (éd. De
Trémault, Cartulaire pour le Vendômois,
Paris, Picard, 1893, n°LXXXVII, p. 138: Arnulfo de Alneto).
(b) Entre 1075 et 1085 le même
Cartulaire mentionne un Arnoux qui est peut-être le même,
qualifié de Spelteriis, toponyme qui recouvre
peut-être Épeautrolles, où nous voyons Gauthier d’Aunay
émettre de son côté des revendications sur l’église
du lieu (ibid., n°22A, p. 310: Arnulfus de Spelteriis).
|
Arnoux, régisseur
de Rouvray-Saint-Denis (Arnulfus maior de Roureio, B 10)
Ce maire, c’est-à-dire
régisseur, Arnoux est simple
témoin de la deuxième donation
d’Arnaud fils d’Aubrée, au domicile de ce dernier
à Étampes (transaction 3).
|
Asceline, fille de Thiou
(Ascelina, C 27)
Fille de Thiou et d’Ermentrud,
sœur de Rainaud,
Pierre, Arembour et Rosceline. Elle
consent avec eux à la donation de la terre de
Lomlu opérée par son frère
Rainaud (transaction 16) et fait ensuite partie de la
parentèle qui reçoit des contredons (transaction
17).
|
Aubert fils d’Anseau (Albertus filius
Anselli, B 9, 22, 24).
Aubert
fils d’Anseau est le frère cadet de Payen fils
d’Anseau.
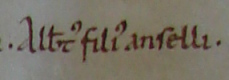 1) Il est
témoin de la donation d’Arnaud fils
d’Aubrée, au domicile de ce dernier
à Étampes
(transaction 3).
1) Il est
témoin de la donation d’Arnaud fils
d’Aubrée, au domicile de ce dernier
à Étampes
(transaction 3).
2) Lui-même détient
un bien à Vierville, deux tenures,
qu’il avait données à fief à
Amaury Roux d’Ablis, et il consent à la donation
de ce dernier (transaction 9).
3) C’est lui qui
obtient le consentement de son frère Païen
fils d’Anseau aux donations opérées
par Arnaud fils d’Aubrée et
Godechal fils d’Oury (transaction 10).
4) Il est donc le premier
témoin cité de la cérémonie
qui se déroule dans la grange
de Boisville, avant même le vicomte
de Châteaudun Hugues et le seigneur du
Puiset Hugues, Nivelon fils de Foucher et Garin
de Friaize, lorsque ce consentement est donné,
au nom de Payen, par Anseau fils d’Arembert (transaction 10).
(a) Il est aussi cité comme témoin
par la charte accordée par
Philippe Ier à Notre-Dame
d’Étampes en 1082 (éd. Prou,
276, l. 7) et cela juste avant Bernoal, abbé
de Notre-Dame d’Étampes.
L’on est donc naturellement porté
à se demander si Aubert fils d’Anseau
et Aubert frère de Bernoal abbé
de Notre-Dame d’Étampes ne pourraient pas être
une seule et même personne; d’où
il découlerait encore et surtout que
l’abbé de Notre-Dame serait aussi à mettre
au nombre des fils d’Anseau: mais rien ne l’indique
positivement).
(b) Il sera encore cité en 1106
par une charte de Philippe Ier, qui nous fait aussi
connaître son fils Mainier (éd. Fleureau,
p. 483; éd. Menault, p. 41; éd. Prou, p.
390, ll. 15-16): Alberto ejusdem
Pagani fratri, Manerio ejus filio.
(c)
Une charte de Louis VII en date de 1162 environ, en faveur du monastère
des Vaux-de-Cernay, le mentionnera encore en temps
que père d’un certain Guy (Guido, filius
Auberti de Stampis, concedente filia sua Adeliza
et genero, dedit vineas quas habebat apud Estrecheium
sicut eas libere possidebat, et hoc per manum Ludovici
regis Francorum, t.1, pp. 34-35, elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte24/);
à moins qu’il ne s’agisse alors d’un certain Aubert fils d’Isembard
cité par le cartulaire de Longpont (n°CVIII, CCXXXVI &
CCLXXXI).
(d)
Il est possible qu’il faille l’identifier
au suivant, s’il est le père du Rainier qui
est témoin avec lui, et d’autres,
de la donation d’Arnaud fils
d’Aubrée, au domicile de ce dernier
à Étampes
(transaction 3: Aubert
fils de Gondagre; Aubert fils d’Anseau;
Pierre fils d’Érard; Rainier fils
d’Aubert; etc.).
|
Aubert père de Rainier (Albertus,
B 10), père
de Rainier.
Peut-être
à identifier avec Aubert fils d’Anseau.
En effet cet Aubert est
le père d’un certain Rainier qui témoigne
en même temps qu’Aubert fils d’Anseau
de la donation
d’Arnaud fils d’Aubrée, au domicile de
ce dernier à Étampes
(transaction 3).
|
Aubert frère de l’abbé Bernoal
(Albertus frater eius, A 19, B 14).
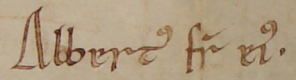 Avec son frère Bernoal abbé de Notre-Dame d’Étampes (cité comme
tel par deux chartes de Philippe Ier en date respectivement
de 1082 et 1104), il est ici témoin,
à Étampes, du
consentement donné par Guillaume, fils
d’un autre Bernoal, à la donation opérée
par Gautier d’Aunay et Arnaud fils d’Aubray (transaction
6)
Avec son frère Bernoal abbé de Notre-Dame d’Étampes (cité comme
tel par deux chartes de Philippe Ier en date respectivement
de 1082 et 1104), il est ici témoin,
à Étampes, du
consentement donné par Guillaume, fils
d’un autre Bernoal, à la donation opérée
par Gautier d’Aunay et Arnaud fils d’Aubray (transaction
6)
Rien ne nous permet d’identifier à
l’un de ses homonymes, qui suivent. On notera cependant
que dans la charte de 1082 précitée,
on trouve mentionné dans la liste des témoins
Aubert fils d’Anseau. S’il fallait identifier ces
deux Anseau, il faudrait aussi faire de notre abbé
un fils d’Anseau, frère de Payen d’Étampes.
|
Aubert
Ier d’Ormoy (Albertus d’Vlmeio,
A 17), père d’Aubert II d’Ormoy
Seigneur d’un Ormoy à identifier, probablement
dans le pays chartrain, alors probablement décédé,
dont le fils s’appelle aussi Aubert d’Ormoy. Il
n’est plus mentionné dans la deuxième
rédaction (B 13) de la transaction 5.
|
Aubert II fils d’Aubert Ier d’Ormoy (Albertus filius
Alberti d’Vlmeio,
A 16-17, Albertus de Vlmeio,
B 13)
Cet Aubert fils d’Aubert,
seigneur d’un Ormoy
à identifier, probablement dans le pays chartrain d’Ormoy, est témoin du consentement
donné par Hugues fils de Guerry et
sa mère Helsent à la donation de
Gautier d’Aunay (transaction
5). On constate de fait fréquemment
dans les chartes du temps que le nom du père n’est
pas donné quand il est le même que celui du fils.
|
Aubert fils de Gondagre (Albertus filius
Gondagri, B 9)
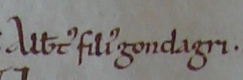 Cet Aubert paraît un personnage
considérable, vu qu’il est cité
comme le premier des témoins,
à Étampes, de la donation d’Arnaud
fils d’Aubrée, avant même Aubert
fils d’Anseau et Pierre fils d’Érard (transaction
3).
Cet Aubert paraît un personnage
considérable, vu qu’il est cité
comme le premier des témoins,
à Étampes, de la donation d’Arnaud
fils d’Aubrée, avant même Aubert
fils d’Anseau et Pierre fils d’Érard (transaction
3).
(a) Nous voyons par ailleurs la signature
d’un certain Geoffroy fils de Gondacre,
Gauffredi filii Gundacri
dans une charte de Philippe Ier en date de 1074
ou 1075 (éd. Prou, p. 179, l. 5), confirmant
une charte peut-être de dix ans antérieure
de Geoffroy de Gometz (Gometz, canton
de Limours, arrondissement de Palaiseau, Essonne),
charte qui donne aux moines de Marmoutier, encore
eux, le domaine de Bazainville (canton de Houdan, arrondissement
de Mantes-la-Jolie, Yvelines).
(b) Vu la rareté
de cet anthroponyme, conjuguée à
la proximité géographique
des secteurs concernés, et à l’intérêt
marqué pour la cause des moines de
Marmoutier, on est naturellement porté à
conclure jusqu’à preuve du contraire que
l’Aubert de notre notice est un frère de
ce Geoffroy.
|
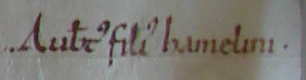 Aubert
fils d’Aimelin (Haubertus filius
Haimelini, A 19-20,
Aubertus filius Hamelini,
B 14)
Aubert
fils d’Aimelin (Haubertus filius
Haimelini, A 19-20,
Aubertus filius Hamelini,
B 14)
Ce personnage
est témoin à Étampes
du consentement de Guillaume fils de Bernoal à
la donation faite par Gautier (transation 6).
|
Aubert Vaslin (Albertus Vaslinus, C 28)
Ce personnage paraît
être un chevalier; en tout cas
il est plus considéré que le
forgeron et le meunier du village où il se
porte témoin de la donation de la
terre de Lomlu; il est cité en sixième
position: le prêtre
Aubry; Guy fils de Serlon; Airaud de Dourdan;
Hongier de Villeau; Milon fils de Boson; Aubert Vaslin;
le forgeron Gautier; le meunier Rahier; Robert fils
de Grimaud; Aubert fils de Bouchard (transaction 16).
|
Aubert fils de Bouchard (Albertus Burchardi
filius, C 29)
Ce personnage semble faire partie d’une
petite communauté rurale où il
ne joue pas les premiers rôles; il est
cité comme le dernier des dix témoins
de la donation de la terre de Lomlu, après
le forgeron et le meunier. Voici la liste: le prêtre
Aubry; Guy fils de Serlon; Airaud de Dourdan; Hongier
de Villeau; Milon fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron
Gautier; le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert
fils de Bouchard (transaction
16).
|
Aubrée
(Albereda, B 1, 8, 23, 24,
26), mère d’Arnaud
et sans doute son frère de Godéchal
Mère
d’Arnaud fils d’Aubrée,
à elle a sans doute légué
ses droits sur Vierville, et de Godéchal.
Elle est aussi sans doute mère de Godéchal,
qui donne son consentement à la donation
d’Arnaud en temps que frère (B 8: concedente fratre Godiscale).
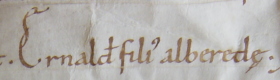 (a) Elle nous
est aussi connue, sous la graphie Alberea, par la Chronique de Morigny,
qui rapporte que les fils d’Aubrée Ours et
Arnaud (filii Alberee Urso et Arnaldus)
ont donné aux moines de Morigny
chacun
le sixième
de l’église de Saint-Germain
qu’il détenait (f°63).
(a) Elle nous
est aussi connue, sous la graphie Alberea, par la Chronique de Morigny,
qui rapporte que les fils d’Aubrée Ours et
Arnaud (filii Alberee Urso et Arnaldus)
ont donné aux moines de Morigny
chacun
le sixième
de l’église de Saint-Germain
qu’il détenait (f°63).
(b) Elle paraît
aussi avoir donné son nom au hameau d’Aubray
dans la commune de Mérobert (Essonne),
non loin de Vierville (Eure-et-Loir), qui est appelé
Alberetum et
Albereth vers 1127 dans des chartes de Saint-Jean-en-Vallée
(Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°37, p. 23 et n°40, p. 25).
|
Aubry, prêtre (Albericus presbiter,
C 27)
Le prêtre Aubry est le premier
témoin cité de la donation
par Rainaud fils de Thiou de la terre de Lomlu
(peut-être Orlu). Sont témoins avec
lui: Guy fils de Serlon;
Airaud de Dourdan; Hongier de Villeau; Milon
fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron Gautier; le
meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert fils
de Bouchard (B 27-29).
L’étude des
chartes du prieuré de Chuisnes permettra
sans doute de l’identifier plus précisément.
|
d’Aunay (de Alneto):
d’Aunay-sous-Crécy
Les
présentes notices mettent en scène
trois personnages qualifiés d’Aunay: Gautier II
et des frères Arnoux et Garin. Cette famille n’est
pas originaire d’Aunay-sous-Auneau, comme l’a cru Depoin,
mais très certainement d’Auneau-sous-Crécy
près de Dreux, à ce qu’il ressort de plusieurs
indices convergents:
(a)
Gounier d’Aunay est possessionné à
Raville, commune de Chérisy, près de Dreux.
(b)
Un certain Hugues de Rua-Nova partage
avec lui cette possession. Il s’agit apparemment
de La Rue Neuve, dans la commune des Bréviaires (Yvelines).
(c)
Gauthier II d’Aunay revendique des droits sur la
dîme d’Épeautrolles
qui a été donnée aux moines de
Saint-Père de Chartres par un certain Hugues de Dreux.
(d)
Le seul lien conservé entre cette famile et
le canton d’Auneau est la possession par Gautier II de Vierville,
qui lui vient de son épouse Milsent Chef-de-Fer.
Je donne ci-après
la liste des quatre premières générations
de cette famille, selon l’état actuel de mes
recherches (mai 2008).
(1)
X. d’Aunay-sous-Crécy.
(2a) Gautier I d’Aunay,
apparemment marié à une sœur de d’Hugues de
Nonant (fils sans doute d’Aitard de Nonant); ses fils qui suivent
en (3).
(2b)
Rainaud d’Aunay, dit aussi des Têtières (commune
d’Unverre) sans alliance ni descendance connues.
(3a)
Gounier d’Aunay, aussi appelé Gounier de
Molitard (commune de Conie-Molitard), puis de Saint-Avit
(Saint-Avit-les-Guespières), sans descendance connue.
(3b)
Jocelyn, sans descendance connue, sans doute mort
jeune.
(3c)
Gautier II d’Aunay, époux de Milsent Chef-de-Fer, sans descendance connue.
(3d)
Arnoux d’Aunay, sans descendance connue.
(3e)
Garin d’Aunay, dit Torcul, père de cinq enfants
qui suivent.
(4a)
Adam.— (4b) Aubert d’Aunay
dit Payen Torcul.— (4c) Galeran.—
(4d) Hébert.—
(4e) Arembour. —
(4f) Perronelle.
(5) Gautier III d’Aunay, d’ascendance inconnue, cité
vers 1120-1130.
|
Barbu (Barbatus, A 21, B 15), surnom d’un
certain Gibert ou Hébert.
Ce
surnom somme toute assez rare est porté
par un certain Gerbert (première
rédaction, A 20: Gerberti Barbati), ou Hébert (deuxième rédaction,
B 15: Herberti Barbati), père apparemment
défunt d’un certain Pierre, témoin
semble-t-il étampois de la donation d’Amaury Roux
et du consentement d’Aubert fils d’Anseau à cette
donation (transaction 9).
|
Bardoul (Bardul
Villa, A 19, Balduluilla,
B 10, Bauduluilla,
B 14) personnage qui a donné son
nom à Baudreville
Il
s’agit peut-être d’Hugues Bardoul (cité
entre autres par les chartes de Philippe Ier,
éd. Prou, p. CXLIV; p. 15, l. 1; p. 17, l. 8;
p. 276, l. 6).
|
Baudry
du Fossé (Baldricus de Fossato,
B 23, 28)
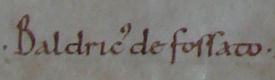 1)
Ce Baudry est témoin à Étampes
du don qu’y fait Amaury Roux d’Ablis de deux
tenures à Vierville, ainsi que du consentement
donné par Aubert fils d’Anseau à cette
donation (transaction 9).
1)
Ce Baudry est témoin à Étampes
du don qu’y fait Amaury Roux d’Ablis de deux
tenures à Vierville, ainsi que du consentement
donné par Aubert fils d’Anseau à cette
donation (transaction 9).
2) Il est encore témoin, cette fois apparemment dans le secteur de Méréville,
du consentement donné par Arembour,
veuve de Godéchal fils d’Oury, et
Eudes, leur fils, à la donation du dit Godéchal.
|
Baudouin (Balduinus,
A 21, B 15), père
d’Arnaud.
C’est
le père apparemment défunt d’un certain
Arnaud, témoin à Étampes
du consentement donné
par Guillaume fils de Bernoal à
la donation de Gautier d’Aunay (transaction
6).
|
Béguin
(Beguinus, B
30), père d’Anseau Robert, probablement lui-même
dénommé Béguin
Robert
Béguin
est mentionné comme l’époux
défunt d’une certaine Eudeline et le père
d’un certain Anseau Robert.
Anseau et sa mère, sans doute à Vierville même ou à
Léthuin, consentent aux donations
opérées par Godéchal
et Amaury (transaction 13).
Comme son fils s’appelle Anseau Robert (Ansellus
Rotberti filius Beguini), il faut croire
que Robert représente ici un patronyme qui
aura été transmis par Béguin à
son fils Anseau.
La deuxième partie du nom de
ce personnage est au génitif, ce qui indique
qu’il s’agit ici d’un patronyme qu’il a hérité
de son père Béguin, qui devait donc
lui-même s’appeler Béguin Robert.
|
Bernard, jeune clerc
(Bernardus clericus iuuenis,
A 20, B 15)
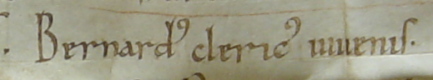 Ce jeune clerc Bernard, à
Étampes, avec un autre clerc, Geoffroy
clerc de Saint-Cyr (A 20-21, B 15: Gaufredus
clericus de Sancto Sigio), est témoin
du consentement donné par Guillaume
fils de Bernoal d’Étampes à la
donation de Gautier d’Étampes (transaction 6).
Ce jeune clerc Bernard, à
Étampes, avec un autre clerc, Geoffroy
clerc de Saint-Cyr (A 20-21, B 15: Gaufredus
clericus de Sancto Sigio), est témoin
du consentement donné par Guillaume
fils de Bernoal d’Étampes à la
donation de Gautier d’Étampes (transaction 6).
Faut-il
identifier ce clerc Bernard au chapelain
homonyme de Philippe Ier qui contresigne sa charte étampoise
de 1082 en faveur de Notre-Dame d’Étampes
(Rotbertus et Bernardus, cappellani)? Rien ne nous permet pour l’instant de l’affirmer, d’autant
qu’il serait alors qualifié jeune après au
moins douze ans de carrière; mais on se souviendra que
les officiers de la chancellerie du roi étaient
essentiellement recrutés parmi ses chapelains,
précisément.
|
 Bernoal d’Étampes
père de Guillaume (Bernoalius de Stampis, A
17-18, Bernoalus de Stampis,
B 13, Bernoalus, B 26), à
ne pas confondre avec son homonyme
abbé de Notre-Dame d’Étampes).
Bernoal d’Étampes
père de Guillaume (Bernoalius de Stampis, A
17-18, Bernoalus de Stampis,
B 13, Bernoalus, B 26), à
ne pas confondre avec son homonyme
abbé de Notre-Dame d’Étampes).
1) C’est le père
apparemment défunt de Guillaume d’Étampes,
qui donne son consentement à la donation
de Gautier d’Aunay (transaction 6).
2) L’un de ses frères
survivants, témoin de la dite donation,
est Airaud (qualifié d’oncle
paternel de Guillaume, A 18: Arraldus
patruus illius Guillelmi; B 14:
Arraldus patruus
ipsius Guillelmi).
3) Un autre de ses frères
survivants, également témoin,
est Éblon (qualifié de
frère d’Airaud, A 20: Eblonius frater Arraldi; B 14: Ebulo frater eius).
Le
père commun de ces trois frères étampois,
Bernoal I, Airaud et Éblon, est était
peut-être Geoffroy, lui-même fils cadet de
Roscelin et frère de Marc vicomte d’Étampes. En effet une notice
du Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
datée par Depoin sans argument du début
du XIIe siècle (n°XXVII, p. 36) cite comme témoin,
avant Payen fils d’Anseau, un certain
Bernoal fils de Geoffroy fils de Roscelin
(Interfuerunt autem ex parte
ejus: Bernoalus filius Godefridi filii Roscelini,
Paganus filius Anselli, etc.)
***
Ce nom
est rare, et parfois semble-t-il mal compris
des scribes car le deuxième élément
qui le compose est peu productif; c’est, selon Ernst
Wilhelm Förstemann (Altdeutsches
Namenbuch, Bonn, P. Hanstein, Bonn,
1901-1916, col 1219), -valah. Il faut peut-être considérer
les graphies avec un D (Bernodalius, Bernoardus, Bernoaldus)
comme une rétroversion infondée. L’extrême
rareté de cet anthroponyme et la concentration
de toutes ses occurences connues dans le pays d’Étampes
et dans ses alentours immédiats permet d’affirmer que
tous ceux qui le portent sont étroitement apparentés.
Malheureusement, pour l’heure, les données
disponibles ne sont pas suffisamment claires pour comprendre
exactement lesquels il faut identifier et quels sont
les liens qui unissent les différents porteurs
de ce nom.
Citons:
(a) Le Cartulaire de
Notre-Dame de Paris cite un Bernoal
Potin vers 1079 selon Depoin (quoique
l’éditeur Guérard dise plutôt
1085), Bernodalius
Potinus (n°XVI,
p. 324) et son fils Baudouin,
témoins d’une donation de Guy, seigneur de La Ferté
(Guido de Firmitate), et de son épouse
Alais (Adeleisda). Le
même Bernoal Potin donne aux moines de Morigny
l’église de Cerny (Chronique de Morigny,
éd. Mirot, p. 4: Ecclesiam de Serni
dedit nobis Bernodalius Potinus).
(b) Un certain Bernoal, frère
d’Adam de Milly est témoin en 1080 à
Melun de deux chartes de Philippe Ier (éd. Prou, p. 260, l. 2 & p. 262,
l. 20: Adam de Milli et Bernodalius frater ejus).
(c) Adam de Milly a lui-même un fils
appelé Bernoal, cité vers 1095 puis vers 1100 (Cartulaire
de Longpont, n°CCXXII, p.196: Bernaole filius; n°CCXCI,
p. 235: Bernoala filius ejus).
(d)
L’abbé de Notre-Dame d’Étampes,
qui suit (et qui avait pour frère un
certain Aubert), cité aussi en temps que tel par
deux chartes de Philippe Ier (en 1082 et 1104).
(e) Une charte non datée
du Cartulaire de Longpont (éd. Marion, n°CCCXXVI, pp. 258-259) nous montre Arnoux fils d’Airaud d’Étampes
(Arnulfus, filius Arraldi de Stampis) témoin d’une donation d’un certain Bernoal
d’Étréchy (Bernoardus de Estrichio) très vraisemblement apparenté
aux deux Bernoal d’Étampes (Ce Bernoal
a alors un fils survivant Hugues,
Hugo, et un fils décédé
Thibaud, Tebaldus).
(f)
Un certain Bernoal de la Ferté, sans
qu’on sache bien clairement s’il s’agit de
Bernoal Potin (éd. Mirot, p. 4: Bernodalius
nobilissimus de Firmitate) et sa
femme Mahaut puis leur fils Lisiard sont cités
par la Chronique de Morigny parmi
ses bienfaiteurs: ils donnent aux moines l’église
de Guigneville; après la mort de Bernoal, Mahaud
donne encore un encensoir et un calice d’argent doré,
et Lisiard le grand vitrail du chevet de l’église
(éd. Mirot, pp. 3-4: Ecclesiam de
Guinevilla dedit nobis Bernodalius nobilissimus de Firmitate,
et uxor ejus Mathildis, quae nobis fecit thuribulum
argenteum magnum, et calicem similiter argenteum deauratum,
quae et prima ecclesiae fundamina jecit, et in aliquantam
altitudinem eduxit, et Lisiardus Flandrensis filius
eorum, qui nobis vitream majorem in capitio fecit.)
(g) Une charte du
Cartulaire de Longpont non
datée (n°CXI) mentionne un Gaufredus Bernoala témoin d’une donation du chambellan
Ougrin, chevalier étampois bien connu du début
du XIIe siècle, à l’occasion des
obsèques de son épouse. Joseph
Depoin (La Chevalerie étampoise, p. 75) propose
la correction Gaufredus Bernoalii, «Geoffroy (fils) de Bernoal»; mais cette correction
à absolument irrecevable, car ce personage est en fait cité
six fois par le même cartulaire, toujours de la même manière
(n°CXI, p.135: Gaufridus Bernoala; n°CXL, p.148: Gaufredus
Bernoala; n°CXLIII, p.150: Gaufredus Bernoala;
n°CCIV, p.186: Gaufredus Bernoale; n°CCLXXXIV,
p.230: Gaufredus Bernoala; n°CCCIX, p.249: Gaufredo Bernoala).
Nous avons déjà vu ces graphies Bernoala et Bernoale.
On se rappellera de plus que selon Förstemann, l’étymon est précisément
Bern-valah. Est-ce une coïncidence? Quoi qu’il en soit,
selon Depoin (Chevalerie étampoise, pp.
84-85), «ce Gaufroi (Gaufredus) ne fait qu’un
peut-être avec le Gaufroi Sauvage (Godefredus Silvaticus),
prévôt royal d’Etampes en 1141», ce dernier
ayant probablement, à ce qu’il me semble, donné son nom
au hameau de Villesauvage.
(h) Vers 1135, une charte conservée
par le Cartulaire de Longpont signale un Bernoale
de Saviniaco (n°CXXXVIII, p.147, Bernoale étant
d’après le contexte un ablatif)
(i) Vers le début du
XIIe siècle (selon les éditeurs), un
Bernoal fils de Geoffroy fils de Roscelin (Bernoalus
filius Godefridi filii Roscelini) est le premier
témoin cité à Étampes d’une
transaction enregistrée par le
Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(éd. Coüard et Depoin, p. 36), avant
même Payen fils d’Anseau: Bernoalus
filius Godefridi filii Roscelini; Paganus filius
Anselli; Arnulfus de Alvers; Rainaldus de Dordingo; Teobaldus
filius Ursonis; Nivardus Burdinus.
(j) Un Bernoalius
est encore cité en 1123 par une charte
de Thomas abbé de Morigny (Cartulaire
de Saint-Jean en Vallée de Chartres,
n°31, p.18; id. n°32, p. 19), comme le père
d’un certain Jean, moine de Morigny, juste après
un moine appelé Hugues de la Ferté
(S. Hugonis de Firmitate, Johannis
filii Bernoalii). La
donation est faite avec le consentement de Payen fils
d’Anseau (Pagano Anselmi filio), et l’accord passé
avec le monastère de Saint-Jean-en-Vallée a
notamment pour témoins Payen et ses quatre fils, dont
Jean, ainsi que par Geoffroy de Moret. Ce Jean fils de Bernoal est sans
doute un frère du Guillaume de nos notices sur Vierville.
(k)
Le Cartulaire de Josaphat
cite encore vers 1147 comme témoin d’une
donation de Barthélémy le Riche d’Étampes
officialisée à Chalo un certain
Bernoal ou Bernaud, son gendre (texte cité
par Depoin, Chevalerie étampoise,
p. 91, alléguant Ms. lat. 10102, fol. 41:
Testes Johannes, Bernaudus generi ejus).
On peut cependant se demander ici si cette graphie
Bernaudus
peut représenter le même anthroponyme
Bernoal que nous étudions ici. J’en doute fort,
malgré l’autorité de Depoin et son flair
souvent remarquable.
(l) On trouve encore vers 1155
un Bernoal de la Ferté (Bernodalius de Feritate) dans une charte
de l’abbaye d’Yerres éditée en 1944
par Estournet (et traduite par moi ici: http://www.corpusetampois.com/che-20-estournet1944lafertealais.html#piece1).
Merci de me signaler tout autre porteur
de cet anthroponyme qui viendrait à votre connaissance.
***
Voici pour comparaison les
seuls Bernoal que j’ai trouvés
pour l’heure hors de notre secteur:
(a) Les premiers sont
des serfs mentionnés à l’époque
carolingienne par le Polyptyque
de l’abbé Irminon (éd. Guérard,
1844, t. II, p. 274: Bernoalus colonus et uxor
ejus nomine Sigrada; cf. Theodor Aufrecht & Adalbert
Kuhn, Zeitschrift für vergleichende
Sprachforschung auf dem Gebiete des deutschen, griechischen
und latineischen, Berlin, 1852, p. 241:
«Bernoala
(Pol. Irm. s. 90) und Bernoalus (ebendaselbst
s. 274) steht fuer Bernvala und Bernvalus»).
(b) Amalgardus
colonus et uxor ejus colona, nomine Berta. Isti
sunt eorum infantes: Bernoala, Bernoardus (ibid.,
p. 90).
(c) Un autre est mentionné
comme prieur de Saint-Marien d’Auxerre
puis abbé de de 1203 à 1206 (Abbé
Lebeuf, Mémoires concernant
l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre,
p. 521, citant p. 66 le latin frater
Bernodalis prior).
|
Bernoal abbé de
Notre-Dame d’Étampes (Bernoalius abbas
Sanctę Marię de Stampis,
A 19, Bernoalus
abbas Sanctę Marię de Stampis, B
14).
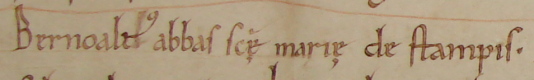 L’abbé de Notre-Dame a pour
frère un certain Aubert, témoin
avec lui du consentement donné à Étampes
par Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
à la donation de Gautier d’Aunay (transaction 6).
L’abbé de Notre-Dame a pour
frère un certain Aubert, témoin
avec lui du consentement donné à Étampes
par Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
à la donation de Gautier d’Aunay (transaction 6).
Il est évident
que cet abbé et son frère Aubert
sont apparentés à Guillaume et à
son défunt père Bernoal, mais à
un degré qui nous échappe.
(1) Bernoal est le premier
abbé de Notre-Dame d’Étampes dont
le nom nous ait été conservé,
et il est mentionné en temps que tel par
une charte de Philippe Ier de 1082 en faveur de Notre-Dame
(éd. Prou, p. 275, l. 4: Bernodalio
tunc temporis eorum abbate; le passage suivant est
corrompu et Prou n’a pas vu que certains mots avaient
été déplacés par un copiste
maladroit, p. 276, ll. 5-6 et 7: tunc temporis
ipsius ecclesie abbas... Bernodalius).
(2)
On remarque d’ailleurs que cette charte favorise
aussi les moines originaires de Saint-Germain de Fly (qui
n’occupent pas encore Morigny) en officialisant leur
infiltration dans le chapitre de Notre-Dame. Comme par ailleurs
le nom de Bernodalius est aussi représenté
à Morigny et à Étréchy,
et que nombre des premiers bienfaiteurs des moines de Morigny
paraissent possessionnés dans le secteur de la
Ferté et d’Étréchy, il en faut conclure
avec une quasi certitude que l’abbé Bernoal lui-même
était membre d’une famille de la Ferté.
|
Berthaut (Bertoldicuria, D 38, Bertolcuria, B 17, Bertoucuriam, B 21), dame qui a probablement donné son
nom à Bréthencourt, littéralement
Cour (de ferme) de Berthaut.
Les scribes de nos notices
et d’autres semblent penser qu’il s’agissait au départ
d’un anthroponyme masculin, Bertold-Berthoud; cependant
une charte des environs de 1080, rédigée
à Bréthencourt même en présence
de la dame du lieu, écrit Bertildis
Curia (AD28,
H2253, charte que éditée ici en
Annexe 6e): il s’agit
donc plutôt d’un anthroponyme féminin, Berthilde-Berthaut
(Cf. Brunehilde-Brunehaut).
Autre preuve d’une prononciation vernaculaire en -haut,
le Cartulaire de Saint-Père de Chartres
interprète cette terminaison comme un diminutif
masculin en -ellus, et écrit, dans un acte
daté de 1137, Bretelli Curia.
C’est un exemple intéressant
des erreurs que pouvaient commettre les contemporains
dans leur compréhension des toponymes dont
ils percevaient nettement le fonctionnement étymologique
sans pour autant être à l’abri d’erreur
de détail.
|
Bésin
(Besenus, A 16c, Bisenus, A 16, B 13), nom
de famille
Ce nom de famille
est porté par un certain Amaury,
père apparemment défunt d’un certain
Garin (Guarinus
filius Amalrici Biseni), témoin
du consentement d’Hugues fils de
Guerry et sa mère Helsent à
la donation de Vierville par Gautier d’Aunay
(transaction 5).
Cet anthroponyme n’est
représenté qu’une fois,
sous la forme Basinus
dans les chartes conservées de Philippe Ier, et il s’agit alors du même
personnage qu’ici, sous le nom de Guarinus
Basinus (éd. Prou, p. 21, l. 7),
qui signe en 1060 une charte de l’évêque
Aivert de Chartres ensuite confirmée
à Étampes par Philippe Ier.
On voit par là qu’il s’agit bien d’un patronyme
transmis de père en fils.
|
Borgne
(Bornus, A 20, B 15), nom ou surnom porté par
un certain Hugues
Hugues le Borgne
apparaît parmi des témoins du pays
étampois du consentement donné par Guillaume
fils de Bernoal à la donation de Gautier d’Aunay.
Ce surnom ou patronyme est apparemment
relativement rare; c’est pourquoi il est
difficile de voir une coïncidence dans le fait
que nous trouvons un Hébert le Borgne mentionné
par la Chronique de Morigny
comme l’un des premiers bienfaiteurs de cette abbaye.
Cet Herbertus
Bornius (folio 63 r°) donne Bléville
(Belovilla), au tournant du XIe et du
XIIe siècle, à son heure dernière
(ibid., folio 69r°). Il laisse
une sœur dont le mari Geoffroy conteste la donation
(ibid., folio 69 v°). Bléville
se trouve dans la commune de Césarville-Dossainville
(canton de Malesherbes, arrondissement
de Pithiviers, Loiret).
|
Boson
(Boso, C 28), père de Milon
Père
d’un certain Milon témoin de la donation
de la terre de Lomlu par Rainaud fils de Thiou (transaction
16).
|
Bouchard (Burchardus,
C 29), père d’Aubert.
Bouchard est un personnage
de condition modeste (inférieur en
dignité au forgeron
Gautier et au Meunier Rahier), apparemment défunt,
dont le fils Aubert se porte témoin de la donation
de la terre de Lomlu par Rainaud fils de Thiou
(transaction 16).
|
Breton (Britto, B 27), surnom
ou patronyme porté par un certain
Robert (Rotbertus
Britto).
Ce nom ou
surnom pose des problèmes.
Voir notre
article Robert Breton.
|
 Chef-de-Fer
(Caput de Ferro,
Caput Ferri,
passim), nom de famille porté
par Thion et son fils Hardouin
Chef-de-Fer
(Caput de Ferro,
Caput Ferri,
passim), nom de famille porté
par Thion et son fils Hardouin
 1) Pandulf Chef-de-Fer (Lombardie,
Xe siècle). Ce surnom est attesté déjà
en Italie au Xe siècle, où il est porté
par Pandulf Ier, appelé Tête de Fer (Pandolfo Testaferrata
ou Capodiferro, Pandulfus Caput Ferreum dans le latin des
Annales Beneventani), prince lombard mort en mars 981, prince
de Bénévent et de Capoue de 943 à 981, et prince
de Salerne à partir de 978.
1) Pandulf Chef-de-Fer (Lombardie,
Xe siècle). Ce surnom est attesté déjà
en Italie au Xe siècle, où il est porté
par Pandulf Ier, appelé Tête de Fer (Pandolfo Testaferrata
ou Capodiferro, Pandulfus Caput Ferreum dans le latin des
Annales Beneventani), prince lombard mort en mars 981, prince
de Bénévent et de Capoue de 943 à 981, et prince
de Salerne à partir de 978.
2) Vivien
Chef-de-Fer (Vendôme, années 1060) est mentionné
à quatre reprises par des chartes de Marmoutier pour le Vendômois
(éd. de Trémault, Cartulaire de Marmoutier pour le
Vendômois, Paris, Picard, 1893); c’est apparemment un ami
ou un féal du chevalier Guismand de Vendôme (fils de Guismand
de la Chappe et d’Aimeline fille d’Hugues Doubleau, ce dernier fondateur
de Montdoubleau et fidèle d’Eudes II de Chartres). En août
1065, après une donation de Guismand faite en présence du
comte Foulques, il fait partie des témoins de la donation du manse
(n°XXXIII, p. 56: testes de mansure traditione: … Vivianus Caput
Ferri); vers 1066, il est témoin d’une convention entre les
moines et Guismand (n°XXVIII, pp. 43-44: Testes hinc
sunt: Vivianus Caput ferri — Drogo de Aziaco — Thomas homo ejus);
il témoigne devant le comte Guy de Vendôme que Guismand a
bien vendu un moulin aux moines, puis se porte témoin du jugement
rendu, apparemment en 1069 (n°XXXII, p. 52: de qua emptione cum
haberet testem Vivianum Caput ferri, judicatum est calumniam ejus injustam
esse… p. 54: de nostris:… Vivianus Caput Ferri). Il est témoin
enfin d’une autre transaction à une date indéterminée
(n°LXXI, p. 113: Vivianus Caput de Ferro). Il est possible qu’il
soit le frère du chevalier Étienne Chef-de-Fer que nous voyons
de son côté chevalier des sires de Courville-sur-Eure, à
87 kilomètres de là; mais rien ne l’indique positivement.
3) Guillaume
Chef-de-Fer (1269) est un clerc (Guillelmus Caput Ferri)
mentionné le 17 avril 1269 par la correspondance administrative d’Alphonse de
Poitier (n°1098, f°34).
4) Jehan Chief-de-Fer, Dame Ameline
Chief-de-Fer et Olivier Chief-de-Fer (vers 1292), d’après
le registre de la taille du lieu, habitent à Paris; le premier
est un courroier résidant rue de Quiquempoist (Hercule Géraud,
Paris sous Philippe-le-Bel d’après des documents
originaux, Paris, Crapelet, 1837, pp. 70 et 86), la seconde habite
la même rue (p.70), le troisième aussi (p.90), bien que
vers 1308, selon le censier de Saint-Merry,
il habite rue Symon Franc (éd. L. Cadier et C. Couderc,
Cartulaire et censier de Saint-Merry de Paris, p.178). Apparemment de la
même famille de courroyer, Guillaume et Phelippe Chief-de-Fer
(vers 1313) sont recensés à leur tour par le registre
de la Taille de Paris: Crestienne, femme de Guillaume, et Phélippe
habitent tous deux la même rue de Qui-qu’en-pois (éd. J.-A.
Buchon, Chronique métrique de Godefroy de Paris,
suivie de la taille de Paris, en 1313, Paris, Verdière, 1827,
pp. 74 et 75).
5)
Au XVIe siècle encore un duc de Savoie, Emmanuel Philibert
(1528-1580) est surnommé Chef-de-Fer (Caput Ferreum):
c’est dire qu’il ne faut pas chercher nécessairement de
liens généalogiques entre tous ceux qui portèrent
ce surnom (et il faut prendre garde à les distinguer de
ceux qui portèrent un surnom dérivé de toponyme
tels que Cap-Feret).
D’autres documents chartrains, que nous donnons
en Annexe 6, nous font connaître
la famille de chevaliers qui dans le secteur porta ce surnom sur
au moins trois générations, depuis le père
de Thion, un certain Étienne, mentionné vers 1055
(Voyez notre Annexe 6a). Nous
reprenons ici ce qu’écrit Joseph Depoin dans sa
Chevalerie étampoise,
p. 82, et que nous
avons déjà mis en ligne:
Etienne
apparaît dans un acte épiscopal
pour l’abbaye de Saint- Père entre
1048 et 1060, avec ses deux fils Thion et Aimon: «Stephanus
Caput-de-Ferro et filii ejus Teudo et Amo»
[Collection MOREAU, XXIV, 152].
Vers 1083 [Depoin
corrigera plus tard lui-même: en 1079 (B.G.)],
Thion Chef-de-Fer est cité comme l’un des
seigneurs de l’église Saint-Georges de Roinville
lorsqu’elle fut donnée à Saint Martin
des Champs; il y consentit, ainsi que sa femme Hersende
et leur fils Hardoin. Plus tard Hardoin ayant réclamé,
le prieur Orson transigea en lui offrant cinq sous,
et à son fils Hugues des bottes et des souliers [Liber
Testamentorum, nn. XXXVIII et XXXIX, p. 49-52].
Toute cette famille reparaît
dans l’entourage de Giroie de Courville, lorsque
ce châtelain donne à Marmoutier, du consentement
de Geofroi Ier, évêque de Chartres
(1064-1084), l’église Saint-Nicolas fondée
par son père Ives Ier et dont il vient de chasser
les chanoines. On cite alors à ses côtés:
«Teudo, filius Stephani Caput de Ferro cognominati;
Harduinus filius ejus; Haimo frater ejus» [Collection
MOREAU, XXVIII, 157-168].
Hersende survécut à son mari
[N.B.:
Depoin paraît ignorer que Thion-Chef-de-Fer
n’a quitté ce bas-monde qu’en se faisant
moine (B.G.)]; elle est
nommée dans un acte où son fils Hardoin
agit comme seigneur de Denonville et sa fille Mélissende
comme dame de Vierville: celle-ci avait pour mari Gautier
d’Aunay-sous-Auneau [Archives de l’Eure (Lisez: de l’Eure-et-Loir,
B.G.), H 2254]. Hardoin fut
aussi l’un des chevaliers du sire de Courville; il est appelé
eu effet: «Harduinus miles dictus Caput Ferreum
de castro Curvavilla» [Archives de l’Eure
(Lisez:
de l’Eure-et-Loir, B.G.),
H 2309]. Les moines de Saint-Père de Chartres concédèrent
à Hardoin, à sa femme nommée aussi
Hersende, et à leur fils Hugues les revenus de la
sacristerie, l’un des offices de leur communauté, à
condition qu’il fournit tous les ans un cheval de service
au monastère [Ms. lat. fol. 461.]
Nous avons mis en Annexe 6 tout ce que nous avons trouvé
sur cette famille dont nous ne connaissons que six membres: Étienne,
ses fils Aimon et Thion (époux d’Hersent de Denonville),
les enfants de Thion, Hardouin et Milsent (épouse de Gautier
II d’Aunay), Hugues enfin, fils d’Hardouin.
|
Chien
(Canis, B
27), nom de famille porté par un certain
Hugues.
Hugues Chien (Hugo Canis) paraît être
un chevalier d’Hugues de Gallardon: il
est témoin à
Auneau de son consentement aux donations de
Gautier d’Aunay,
Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée (transaction 11).
Il s’agit ici du nom
d’un patronyme bien représentée en
pays chartrain mais aussi à Étampes. Un Eudes Chien par exemple
(Oddo Canis) est témoin à
Chartres entre 1081 et 1089 de la donation de l’autel de
Roinville-sous-Dourdan (Liber testamentorum,
p. 11).
Dans notre notice est aussi mentionné
un Girbertus canonicus
(B 23, transaction 9) visiblement étampois
qui est selon toute apparence le
Gislebertus Canis mentionné
en 1112 comme le dernier abbé
de Saint-Martin d’Étampes (éd.
Fleureau, p. 479).
En Étampois, comme je l’ai
montré (Cahier d’Étampes-Histoire 6,
pp. 76-79) ce patronyme est à l’origine
(prononcé Chan) de deux toponymes,
*Chan-Cul (Canisculus) devenu ultérieurement
*Chan-Dos (Champdoux) d’une part,
et Chanval d’autre part.
|
Christophe Roi ou Leroi (Christoforus
Rex, B 23)
Christophe
Roi est témoin à Étampes,
en compagnie d’autres Étampois, du don qu’y
fait Amaury Roux d’Ablis de deux tenures à
Vierville (transaction 9).
Sur son surnom, ou patronyme,
voyez notre article Roi.
(a) L’existence à
Étampes d’un Roi (Rex) est à nouveau
attestée à Étampes
en 1226. A cette date, une charte de l’archevêque
de Sens Gautier Cornu entérine le partage du centre
ville entre les deux paroisses de Notre-Dame et de
Saint-Basile (Fleureau, Antiquités,
p. 404). L’un des points de répère alors
donné est la maison de Sainte-Croix
d’Étampes qui est à côté
de la maison de Roi de Corbeil (juxta domum Regis
de Corbolio), passage qui a d’ailleurs été
mal compris par les historiens d’Étampes depuis
Louis-Eugène Lefèvre a voulu en tirer la
preuve que les locaux de la Boucherie appartenaient au
roi.
|
Constance, serf
(de Ventilaio Constancius famulus, C
33)
Le
serf Constance de Ventelay, qui appartient aux moines de Bréthencourt
comme son compagnon Gauthier d’Angleterre, est témoin
des contre-dons opérés par
les moines en échange de la donation de la terre
de Lomlu par Rainaud fils de Thiou (transaction 17).
Ce serf des moines
de Marmoutier est originaire de leur prieuré champenois
de Ventelay près de Reims, de Ventilaio.
(a) Il nous est aussi connu, avec
Gautier d’Angleterre, par une charte du prieuré de Bréthencourt
datant environ de 1080 et dont nous donnons le texte
en Annexe 6e.
|
Coscable (Coscablus monachus,
B 26, domnus
Constabilis, C 30)
Le
moine Coscable (dont le nom signifie tout simplement,
dans le français du temps, Constant), porte
comme Thion Chef-de-Fer le titre de dom
Coscable, ce qui semble simplement signifier
qu’il est moine.
1) Coscable accompagne
Thion pour aller demander à Hugues de
Gallardon son consentement aux donations de Gautier d’Aunay, Guillaume fils
de Bernoal d’Étampes et Arnaud
fils d’Aubrée,
consentement accordé à Auneau (transaction
11).
2)
Coscable s’associe à nouveau à Thion
pour offrir à Rainaud fils de Thiou
et à sa famille différents contre-dons
en échange de la donation de la terre de Lomlu
(transaction 17).
|
Éblon
frère d’Airaud (Eblonius frater
Arraldi, A 22, Ebulo
frater eius, B 14), et donc comme
lui oncle de Guillaume fils de Bernaol d’Étampes.
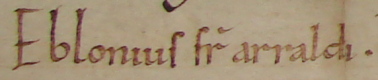 J’ai choisi ici arbitrairement
la forme Éblon plutôt
que la forme Ebles: en fait l’une
et l’autre alternaient en ancien français selon
que ce nom soit dans la phrase sujet (Ebles)
ou complément d’objet (Éblon).
J’ai choisi ici arbitrairement
la forme Éblon plutôt
que la forme Ebles: en fait l’une
et l’autre alternaient en ancien français selon
que ce nom soit dans la phrase sujet (Ebles)
ou complément d’objet (Éblon).
Éblon
est le frère d’Airaud, avec qui
il est témoin à Étampes
du consentement donné
par leur neveu Guillaume à la donation de
Gautier d’Aunay (transaction 6).
Il est notable que dans
la première version de la liste des témoins,
il soit placé en fin de liste, comme s’il avait
d’abord été oublié (A 22); tandis
que dans la deuxième version il a été
introduit en début de liste, juste après
son frère Airaud (B 14): tel était
le lot des cadtes survivants. Ce cas est à comparer
à celui de Gautier d’Aunay et de ses deux frères
Arnoux et Garin. Arnoux est mentionné après
Gautier comme son frère tant que ce dernier est
vivant, et Garin ne l’est même pas. Puis, quand Gautier
paraît décédé, Arnoux est cité
Arnulfus de Alneto, et Garin
est alors cité en temps que son frère.
|
Ermengise serf du prieur
d’Épernon Hardouin
(Ermengisus
famulus eius, B 28)
Ermengise, serf d’Hardouin, qui dirige
le prieuré d’Épernon appartenant comme
Chuisnes aux moines de Marmoutier, est témoin avec
son maître du consentement donné à
la donation Godéchal
fils d’Oury de Vierville par sa veuve et son
fils, apparemment quelque part dans le secteur de
Méréville (transaction 12).
|
Ermentrut (Ermentrudis,
C 26), veuve
de Thiou et mère de Rainaud
Veuve
de Thiou, mère de Rainaud,
Pierre, Arembour, Rosceline et Asceline.
Elle consent moyennant finances à la donation
de la terre de Lomlu opérée
par son fils Rainaud (transaction 16) et fait ensuite partie
de la parentèle qui reçoit des contredons (transaction
17).
|
Étienne (Stephanus,
A 16; B 13),
père d’un certain Thibaud
Étienne est le père
apparemment défunt d’un chevalier
vassal du vidame de Chartres Hugues fils de Guerry,
témoin du consentement donné à
la donation de Gautier par Hugues et sa mère Helsent, de qui
le dit Gautier tenait en fief une part du dit
village de Vierville (transaction 5).
Il est à noter que
le père de Thion Chef-de-Fer, qui a lui
aussi était un chevalier du pays chartrain,
sans doute dépendant de la châtellenie de
Courville, s’appelait aussi Étienne.
|
Eudeline (Odelina mater
eius, B 30a, Odelina, D 30b),
veuve de Béguin et mère
d’Anseau Robert.
Eudeline, mère d’Anseau Robert fils
de Béguin, et donc elle-même veuve de
Béguin Robert, en compagnie de son fils, sans doute à Vierville
même ou à Léthuin, consent aux donations opérées
par Godéchal et Amaury (transaction
13).
|
Eudes de Pannecières
(Odo de Paniceriis, B 28)
Eudes
de Pannecières est sans doute un chevalier
du pays de Méréville possessionné
dans ce lieu-dit. Il est témoin avec d’autres
personnages du secteur du consentement donné
à la donation de Godéchal fils
d’Oury de Vierville par sa veuve Arembour et leur fils Eudes
(transaction 12).
Il était peut-être apparenté
à la veuve de Godéchal, Arembour, qui
paraît résider, au moins depuis le décès
de Godéchal, dans le secteur de Méréville,
et qui a donné à son fils le même
nom d’Eudes.
|
Eudes fils de Godéchal
fils d’Oury et d’Arembour
(Odo filius
ipsorum, B 27)
Eudes, fils de
Godechal fils d’Oury et d’Arembour, consent
avec sa mère à la donation qu’avait opérée
(fecerat) son père aujourd’hui
défunt (transaction 12). Ceci semble
dater la rédaction de la notice B d’après
la mort de Godechal, puisque c’est à
sa femme, apparemment veuve qu’est donnée
une gratification, alors que
l’enfant est en âge de donner son consentement, tandis qu’il n’était pas mentionné
jusqu’alors. Il apparaît aussi que
l’accord de la femme de Godechal n’était
pas nécessaire jusqu’alors, et qu’elle
ne peut ici réclamer qu’au titre des intérêts
de son fils. Il s’ensuit que les droits de Godéchal
fils d’Oury de Vierville sur Vierville lui venaient
de ses parents, spécialement sans doute de son
père, mais non de sa femme.
|
Eudes, serf des moines de Chuisnes (Odo famulus,
A 13, B 11-12)
Il
s’agit d’un serf des moines du prieuré
de Chuines. Il assiste à Chuines
au consentement donné à la donation
de Vierville par Hardouin Chef-de-Fer. Liste des témoins: Thion Chef-de-Fer,
père du dit Hardouin; le prieur Thibaud;
le prieur du cloître de Marmoutier, Robert;
Évain; Évroin; Gaston; Foulques; Gimard
Ernèse; le serf Eudes (transaction 4).
Tous ceux qui le précèdent
dans cette liste paraissent être des
moines, comme le confirme ce qui suit.
(a) Eudes, serf des
moines de Chuisnes, est aussi mentionné avec le prieur
Thibaud et le moine Évain comme
témoin d’une donation d’Hardouin Chef-de-Fer à
leur prieuré (dont nous donnons le texte en Annexe 6f): Voici les moines: le prieur Thibaud,
Moïse, Évain, Giraud.
Les laïcs: le prêtre Raoul, son
frère Sichier, Geoffroy de Beaumont, Guillaume Roux, Arnoux,
Gauslin Serve-en-gré, le serf
Eudes, le cuisinier Gauslin, les prêtres Jeannou,
Thierry et Jean.
|
Évain
(Euanus, A 13,
B 11)
Il s’agit d’un
moine du prieuré de Chuines. Il assiste
à Chuines au consentement
donné à la donation de Vierville
par Hardouin Chef-de-Fer. Liste
des témoins: Thion
Chef-de-Fer, père du dit Hardouin;
le prieur Thibaud; le prieur du
cloître de Marmoutier, Robert;
Évain; Évroin; Gaston; Foulques; Gimard
Ernèse; le serf Eudes (transaction
4).
(a) Le moine Évain est aussi mentionné avec le prieur Thibaud et Eudes,
serf des moines de Chuisnes, comme témoin d’une donation d’Hardouin Chef-de-Fer
à leur prieuré (dont nous donnons le texte en Annexe 6f): Voici les moines:
le prieur Thibaud, Moïse, Évain, Giraud. Les laïcs: le prêtre Raoul,
son frère Sichier, Geoffroy de Beaumont, Guillaume Roux, Arnoux, Gauslin
Serve-en-gré, le serf
Eudes, le cuisinier Gauslin, les prêtres Jeannou, Thierry et Jean.
|
Évroin (Ebroinus,
A 13, B 11)
Il s’agit d’un moine du prieuré
de Chuines. Il assiste à Chuines au consentement donné à la donation
de Vierville par Hardouin Chef-de-Fer. Liste des témoins: Thion Chef-de-Fer, père
du dit Hardouin; le prieur Thibaud;
le prieur du cloître de Marmoutier, Robert;
Évain; Évroin; Gaston; Foulques;
Gimard Ernèse; le serf Eudes (transaction
4).
(a) Un moine de ce nom est mentionné
à Brou et/ou à Chartres les 29 et 30 octobre
1104 (Cartulaire de Saint-Père, p. 481).
(b) Un moine
du même nom est prieur d’Orsonville après
1096 selon le Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(note 403, p. 103).
|
Farinard (Farinardus,
B 28), patronyme
ou surnom porté par un certain
Rainard
Rainard (Rainardo Farinardo), témoin apparemment dans le secteur
de Méréville du consentement de la
veuve et du fils de Godéchal à sa donation
(transaction 12).
Il faut sans doute considérer
Farin- comme une épenthèse,
par analogie avec le mot farine, de l’élément
Farn-, qu’on retrouve dans
les patronymes ultérieurs Franon, Farnèse,
Farnoux, Farnier.
|
Faucon
(Falco, C 31)
Ce
Faucon est un chevalier qui fait partie de la
parentèle de Rainaud fils de Thiou ou de
sa femme. Il reçoit, en un lieu indéterminé,
peut-être à Léthuin ou à Vierville, une épée et le droit de se
retirer à Marmoutier pour prix de son consentement
à la donation par Rainaud de la terre de Lomlu
(transaction 17).
|
Félicie (Felicia,
D 33), mère de Geoffroy de l’Eau
Félicie est la mère
d’un certain Geoffroy de
l’Eau ou de Lèves, qui donne, moyennent un
contre-don de 35 sous, une terre d’une charrue
et trois tenures (transaction 18). Il est probable que
Geoffroy tenait cette terre de sa mère, sous quoi
elle ne serait probalement pas nommée ici.
Ce
nom de Félicie est illustré
notamment par une certaine Félicie
de Ramerupt, septième fille de Hilduin (Audouin) ou
Gilduin de Ramerupt (septima filia…Hilduini),
qui épousa le roi Sanche de Galice
(Genealogiæ Scriptoris Fusniacensis
20, éd. MGH SS XIII, p. 256) et fut mère
du roi Alphonse d’Aragon. Or il faut noter que la sœur
ainée de cette Félicie, Béatrice
de Ramerupt (comitis Hilduini de Rameruth maior
natu filia dicta Beatrix) avait épousé
de son côté Geoffroy, frère
aîné du vicomte de Châteaudun
Hugues que mentionne justement notre notice C.
Autre piste relative à
cette Félicie: on note aussi
des Félix dans
la région, qui sont les trois seuls que mentionnent
les chartes conservées
de Philippe Ier: un comte de Dreux (éd.
Prou, p. 424, l. 4: Felix comes Drocensis),
un Serlon Félix (Sarlo
Felix) qui signe vers 1102 avec Payen
d’Étampes (Paganus
de Stampis) un acte non localisé
(p. 372, l.
1) et le chevalier de Pithiviers
Tescelin Felix (p. 255, l. 28: Tescelinus Felix miles Petverrensis).
|
Fléaud
(Flagellus
ou Flagellum,
B 35), surnom ou patronyme porté
par un certain chevalier Robert témoin à
Chartres.
Bien que le latin ait rendu son
patronyme par un mot latin flagellum,
qui rend le français fléau
(à battre le blé), il faut
ici sans doute reconnaître l’anthroponyme
Fléaud (Coüard et Depoin
écrivent plutôt Flahaud), en latin
Fladaldus, Fledaldus
ou Flealdus.
Ce surnom Fléau, Flagellum,
est également porté par un moine de Marmoutier, panetier
au prieuré de Vendôme (Cartulaire de Marmoutier pour
le Vendômois, n°CLXXXVII, p. 267: Bernardi panetarii
nostri cognomento Flagelli).
Notre Robert Fléaud
(B 35: Rotberto Flagello) est témoin à Chartres
du consentement donné par Gautier d’Aunay
et de sa femme Milsent du don de quatre familles de colliberts
de Denonville par Hardouin Chef-de-Fer et sa mère
(transaction 15).
Sur ce que
nous savons de Robert Fléaud et de son fils Philippe,
voyez l’article Robert
Fléaud.
***
Est-il apparenté à Gautier
fils de Fléaud, vassal de la famille d’Aunay?
Comme Robert Fléaud
apparaît en temps que témoin d’une transaction
commune aux Chef-de-Fer et à la famille d’Aunay,
on doit se demander s’il est apparenté à certain
Gautier fils de Fléaud mentionné dans le
secteur tantôt comme vassal de l’une ou de l’autre des ces
deux familles.
(a)
Une donation de Gautier fils de Fléaud (Walterium, videlicet filium Fladaldi) est enregistrée par le Cartulaire
de Saint-Père (p. 203) sous l’abbé Hubert (entre
1067 et 1078). Elle reçoit
le consentement des personnes de qui il tient cette
terre à fief près de Boisville: à
savoir Gautier I d’Aunay et de ses fils, dont notre Gautier
II (VValterius de Alneto... filiique
ejus Gunherius, Gauslinus, Gualterius).
(b)
Vers 1083,
une charte du Liber testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
nous montre Gautier fils de Fléaud (Walterius
filius Fledaldi) avec son fils Rainaud
(Rainaldus) faisant la donation de la moitié
de l’église Saint-Georges de Roinville,
qu’il tenait en fief de Thion Chef-de-Fer, de sa femme
Hersent et de leur fils Hardouin (éd. Coüard
& Depoin de 1905, p.51, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/acte39/).
(c) Gautier fils
de Fléaud (Walterius filius Flealdi)
est cité comme auteur de la donation d’une
vicairie en Beauce datée du 7 mars 1082
(ibid., éd. Guérard, 1840,
p. 238 et surtout, pour la date, p. 423), avec sa femme
Fersent (Fredesindis) et son fils Rainaud (Rainaldus).
Gautier I d’Aunay est donc mort
avant le 7 mars 1082
(d) Une autre charte de Gautier
lui-même (ego Walterius, filius Fledaldi) conservée par ce même cartulaire
(pp.224-225) mentionne son frère Rainaud (Rainaldus).
On y apprend que sa femme et sa belle sœur avait
pour père un certain Bérard (Berardus)
dont le frère s’appelait Guénin (Guaningus).
Ses beaux-parents étaient neveux du moine Foulques
(Fulco monachus).
(e)
Plus tard encore, après
la mort de Gautier I d’Aunay, une charte de Gautier fils
de Fléaud (Ego Walterius, filius Flealdi...
S. Gualterii, filii Flealdi) conservée par
le Cartulaire de Saint-Père (pp.238-239),
sous l’abbé Eustache, 1079-1101) nous donne le nom
de son seigneur, Gounier, évidemment d’Aunay (per
consensum domni mei Gunherii). Gautier mentionne aussi
Lisiard qui semble être son frère (Lisiardus),
sa propre femme Fressent (Fredesindis), son fils aîné
Rainaud ainsi que les frères et sœurs de ce dernier (et
filio meo Rainaldo, cum fratribus et sororibus suis) dont
la liste est un peu confuse (S. Gualterii, filii Flealdi. Fredesindis,
uxoris. Rainaldi, filii ejus. Heliae. Hugonis. Lisiardi. Adeline,
filiae ejus. Elisabeth: littéralement:
Marque de Gautier fils de Fléaud. De Fressent
son épouse. De Rainaud son fils. D’Élie. D’Hugues.
De Lisiard. De sa fille Adeline. D’Élisabeth.)
***
Il
n’y a donc pas trace de parenté entre Robert Fléaud
et Gauthier
fils de Fléaud, bien qu’ils apparaissent dans le même
milieu que Thion Chef-de-Fer et que Gautier d’Aunay.
|
Fouchaud de Ludon
(Fulchaldus de Ludone,
B 31)
Fouchaud de Ludon est témoin du côté des moines,
dont il fait peut-être partie,
sans doute à Vierville
même ou à Léthuin, du consentement d’Anseau
Robert fils de Béguin et de sa
mère Eudeline à la donation
de Vierville par Godéchal et Amaury
(transaction 13).
|
Foucher Ier de Fréteval
(Fulcherius, B 25), père de Nivelon
Foucher, mentionné ici comme
le père de Nivelon, est le deuxième
seigneur de Fréteval, site fortifié
par son père Nivelon Ier. A cette date il
est peut-être encore vivant, s’étant
retiré dans un monastère: on ne connaît
pas la date de sa mort.
Il est assez bien
connu depuis que Charles Métais a rassemblé
de nombreuses données sur lui en introduction
à son édition du cartulaire de Marmoutier
pour le pays de Blois. Nous y renvoyons.
Charles MÉTAIS, «Foucher,
deuxième seigneur de Fréteval»,
in ID., «Notes généalogiques
sur les seigneurs de Fréteval», in ID.,
Marmoutier. Cartulaire blésois
[CXLIII+540 p.], Blois, E. Moreau et Cie, 1889-1891»,
pp. XXVIII-XXXIV.
|
Foulques
(Fulco,
A 13; B 11)
Il s’agit d’un moine du prieuré
de Chuines. Il assiste à Chuines au consentement donné à la donation de
Vierville par Hardouin Chef-de-Fer. Liste des témoins: Thion Chef-de-Fer, père
du dit Hardouin; le prieur Thibaud;
le prieur du cloître de Marmoutier, Robert;
Évain; Évroin; Gaston; Foulques;
Gimard Ernèse; le serf Eudes (transaction
4).
|
Garin de Friaize
(Guarinus de Friesia, B 25)
Garin
de Friaize est (comme Hardouin Chef-de-Fer) un
vassal d’Yves II de Courville,
dont les sources conservées nous gardent des traces
de 1079 à 1120. L’importance de
ce personnage est marquée par le contexte puisque,
quoi qu’en fin de liste, il est mis sur le même plan
qu’Hugues Blavons du Puiset, Hugues vicomte de Châteaudun
et Nivelon de Fréteval; il est témoin
avec eux de l’autorisation
donnée par l’Étampois
Payen fils d’Anseau (en fait représenté
par Anseau fils d’Arembert) aux donations
opérées par Arnaud fils d’Aubrée et Godéchal
fils d’Oury; il est alors avec eux
à la cour de d’Hugues Ier du Puiset, qui n’est pas mort avant 1096 (transaction 10).
(a) On notera par exemple
dans le Cartulaire de Saint-Père
une notice non datée, sous
l’abbatiat d’Eustache (1079-1101),
concernant Garin qui n’était pas encore marié
(éd. Guérard, t. II, p. 323).
(b)
Nous savons entre autres par une charte de mars
1094 (Cartulaire de Saint-Père de Chartres,
éd. Guérard, tome II, pp. 499-500,
texte donné ici en Annexe
6g) que Garin de Friaize comme Hardouin
Chef-de-Fer étaient vassaux (fideles
feodalesque nostri) du seigneur de Courville, qui lui-même
rendait hommage à son suzerain (patronus) Nivelon
de Fréteval. L’absence lors de la cérémonie
de la grange de Boisville du chaînon féodal
intermédiaire entre la famille Garin et le sire
de Fréteval, c’est-à-dire celle de Giroie
(Gerogius), s’explique sans doute par le fait que
c’est alors (en 1094 du moins) sa veuve Philippe (Philippa)
qui tient Courville au nom de leur fils Yves.
(c)
Garin de Friaize est encore mentionné entre
1020 et 1027 en tête des témoins laïcs
d’un amortissement de son seigneur Foulques de Courville,
en compagnie de ses fils Garin et Hugues, ainsi que d’Yves
fils d’Hébert (éd. Merlet, Cartulaire
de Saint-Jean en Vallée, n°28, pp. 16-17:
Garinus de Friessa et filii ejus Garinus et Hugo,
Ivo filius Herberti, etc.), ce dernier étant témoin
de notre transaction 15 (Iuone filio Herberti).
|
Garin de Bailleau
( Guarinus de Baillole,
B 35)
Il doit s’agir de Bailleau-le-Pin tout proche de Saint-Avit-les-Guespières,
dans le même canton d’Illiers-Combray, et sur la route de cette ville à Chartres
(plutôt que des deux autres Bailleau de
l’arrondissement de Chartres, Bailleau-l’Évêque
et Bailleau-Armenonville
près Gallardon).
Ce Garin, sur lequel nous
n’avons rien trouvé pour l’instant, doit
être un chevalier possessionné à
Bailleau; il est témoin
à Chartres du consentement donné
par Gautier d’Aunay et sa susdite femme Milsent
au don de quatre familles de colliberts de Denonville
par Hersent (transaction 15).
|
Garin Bisen, fils d’Amaury (Guarinus filius
Amalrici Biseni, A 16,
avec une correction postérieure
Beseni;
Guarinus filius
Amalrici Biseni, B 13)
Ce Garin est témoin du consentement
donné par Hugues fils de Guerry
et sa mère Hélisende
à la donation de Vierville par Gautier d’Aunay.
Il est cité après Yves fils de Norbert,
Thibaud fils d’Étienne et Payen fils de
Girard maréchal. Après lui est Aubert
fils d’Aubert d’Ormoy (transaction
5).
Ce
personnage nous est autrement connu comme
témoin d’une charte de l’évêque
Agobert de Chartres, Guarinus
Basinus, charte confirmée à
Étampes le 25 novembre 1060 par Philippe
Ier (éd. Prou, p. 21, l. 7), et accordant
à Aubert, abbé de Marmoutier, l’autorisation
de construire une église à Orchaise
(près de Blois) en l’honneur de Saint-Barthélémy.
Il nous est encore connu par une
charte de l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs
que ses éditeurs datent de 1106
(éd. Depoin 1905, pp. 76-77 puis 1912, pp. 79-80)
et qui nous fait connaître les noms de
son fils Amaury (Almaricus, nom qui confirme
l’identification proposée ci-dessus)
et de trois de ses filles, Rosceline (Roscelina),
Richaut (Richildis) et Jocelyne (Gauslena),
ainsi que celui de son beau-père, Eustache
de Boulaincourt (Eustachius de Booloncurte). Sont alors témoins, outre Hugues (II) du Puiset et
son frère Guy (d’Étampes),
Payen fils d’Anseau et son fils (sans doute Jean
d’Étampes).
|
Garin, frère d’Arnoux
d’Aunay (Guarinus frater
eius, C 31)
Témoin, apparemment dans le secteur
de Vierville, des contre-dons opérés
par les moines en échange de la
donation de la terre de Lomlu par Rainaud fils de Thiou,
il est cité pour la première fois,
après son frère Arnoux, lui-même
qualifié d’Aunay: leur frère aîné
Gautier d’Aunay est probablement alors décédé
(transaction 17).
Sur Arnoux d’Aunay, je n’ai trouvé qu’un
Arnoux d’Aunay mentionné à Vendôme, dont il n’est
pas sur qu’il s’agisse du même personnage, peut-être
décédé à son tour sans
descendance, tandis que nous avons gardé plusieurs
traces ultérieures de Garin (Voyez nos Annexes 7).
(a) Une notice non datée
du Cartulaire de Saint-Père
de Chartres (p.451) le cite avec
son frère aîné Gounier (Garinus
de Alneto... annuente Gunherio fratre suo).
(b)
Il est témoin vers 1108 d’une donation de
la vidamesse Helsent, après la mort de son fils Hugues
fils de Guerry (AD 28, H.3114, éd. Merlet,
Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°IX, t. I, p. 7: Garinus de Alneto).
(c)
Une deuxième notice du Cartulaire de Saint-Père de Chartres (pp.463-464) précise
qu’il était surnommé Torcul et qu’il
laissa à sa mort quatre fils, Adam, Payen, Galeran
et Hébert, ainsi que deux filles, Arembour et Perronnelle
(filii ejus Adam, Paganus, Galerannus atque Herbertus,
et filie Eremburgis et Petronilla).
(d)
Son deuxième fils Aubert fut surnommé à
sa suite Payen Torcul, à ce qu’on lit dans une charte
antérieure à 1151 (Métais,
Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat, n°CLXXXIII,
t. I, p. 226-227: Obertus de Alneto qui et Paganus Torcul
dicitur).
Ce surnom de
Torcul porté par notre témoin Garin
d’Aunay, puis par son fils ne doit pas être interprété
«Tort-Cul» au sens de «Cul-Tordu»,
mais «Pressoir», du latin Torculum,
synonyme de Torcular, «pressoir, lieu
où est le pressoir», attesté dès
l’époque classique chez des auteurs tels que
Varon et les deux Pline; ou bien Torculus,
synonyme de Torcularius, «pressureur»,
attesté dès l’époque classique
chez un auteur comme Caton (Agr.1,4; 14,68).
Il est vrai que ce mot de
Torcul, qui peut donc signifier tant
«pressoir»
que «pressureur», n’est pas relevé par le Lexique
de l’Ancien Français de Godefroid;
mais, tout d’abord, ce dictionnaire est loin d’être
exhaustif (nous avons vu par exemple qu’il n’enregistre pas le mot de
panicière pourtant bien attesté par
la toponymie); d’autre part le mot de Torcul
est attesté par la toponymie (le lieu-dit helvétique
Torcul à Bex dans le district
de l’Aigle, au canton de Vau n’est évidemment
pas «un endroit où l´on se tord le cul
à cause d´une montée raide et sinueuse»,
comme on a pu l’écrire, mais un lieu-dit où
se trouvait jadis un pressoir); enfin le mot
Torcul est bien attesté également
en haut-allemand au sens de «pressoir»
(H. F. Massmann, Gedrängtes althochdeutschen
Wörterbuch, oder Vollständiger zu Graff’s
althochdeutsches Sprachschatze, Berlin, Nicolaischen
Buchhandlung, 1840, p. 243: «Torcul, n / Torcula,
f = torcular, praelum»). Ajoutons que
Trocul, Trocu et
Trocut, altérations
probables par métathèse de Torcul,
sont attestés comme patronymes dans la noblesse
d’Ancien Régime.
Il s’agit donc peut-être d’un surnom
caractérisant quelqu’un qui «pressurait»
ses tenanciers en exigeant d’eux des redevances
excessives; Littré donnent deux emplois métaphoriques
analogues en français moderne pour les mots
pressoir et pressurer, chez
Montaigne et Mme de Sévigné.
|
Garin, clerc (Guarinus clericus,
B 33)
Ce clerc est apparemment
un clerc des moines de Chuisnes, c’est en tout
cas l’un de leurs témoins à Chuisnes de
la donation par Hardouin Chef-de-Fer de quatre familles
de colliberts de Denonville (transaction 14)
(a) On notera cependant
que vers la même époque un clerc Garin (Guarinus clericus),
chanoine de Notre-Dame de Chartres (canonicus sancte Marie) est
aussi le premier témoin cité d’une donation d’Hugues de Gallardon
(voyez notre Annexe 6i): c’est donc peut-être
un représentant de l’évêque de Chartres.
|
Garin, serf (Guarinus quidam famulus eorum
i.e. siue: Rotbertus
medicus de Stampis, Amalricus Rufus,
Harduinus clericus, siue:
Godefredus de Aqua filius Felicie
et Gila uxor eius, D 37).
Serf de Geoffroy de l’Eau
(ou de Lèves) fils de Félicie et
de son épouse Gile, témoin en un lieu
indéterminé de leur donation d’une terre d’une charrue et de trois tenures
à Vierville, contre 35 sous en monnaie d’Étampes
(transaction 18).
|
Gaston (Guastho,
A 13, B 12)
Il s’agit d’un
moine du prieuré de Chuines. Il assiste
à Chuines au consentement
donné à la donation de Vierville
par Hardouin Chef-de-Fer. Liste
des témoins: Thion
Chef-de-Fer, père du dit Hardouin;
le prieur Thibaud; le prieur du cloître
de Marmoutier, Robert; Évain;
Évroin; Gaston; Foulques; Gimard Ernèse;
le serf Eudes (transaction 4).
|
Gaudin fils
d’Ansoué de Méréville
(Galdinus filius
Ausuei de Mereruilla, A
24, Gaudinus filius Ansei
de Merer Villa, B 16, Gaudinus filius Ansue de Merervilla,
B 28)
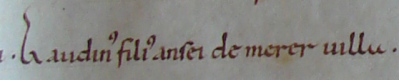 1) Ce Gaudin est témoin,
quelque part entre Étampes et Méréville,
de la première donation de Godéchal.
Voici la liste des témoins: Thion
Chef-de-Fer; Gaudin fils d’Ansoué
de Méréville; Lisiard d’Étampes;
Robert fils d’Airaud; Hébert de Denonville
(transaction 7).
1) Ce Gaudin est témoin,
quelque part entre Étampes et Méréville,
de la première donation de Godéchal.
Voici la liste des témoins: Thion
Chef-de-Fer; Gaudin fils d’Ansoué
de Méréville; Lisiard d’Étampes;
Robert fils d’Airaud; Hébert de Denonville
(transaction 7).
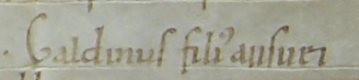 2) Il est ensuite témoin,
apparemment dans le secteur de Méréville
du consentement de la veuve et du fils de Godéchal
à sa donation; en effet témoignent
avec lui deux autres personnages du secteur, Geoffroy de Moret et Eudes de Pannecières (transaction 12).
2) Il est ensuite témoin,
apparemment dans le secteur de Méréville
du consentement de la veuve et du fils de Godéchal
à sa donation; en effet témoignent
avec lui deux autres personnages du secteur, Geoffroy de Moret et Eudes de Pannecières (transaction 12).
|
Gautier d’Étampes
(Gaulterius de Stampis,
B 19).
Gautier
est témoin à Étampes
de la deuxième donation de Godechal.
Voici la liste des témoins:
Gautier d’Étampes;
Amaury Roux d’Ablis; le régisseur
de Sainville, Gibert; le marchand d’Étampes
Richer; Hébert de Denonville (transaction
8).
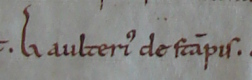 (a) Ce Gautier d’Étampes est
aussi mentionné par le Liber Testamentorum
de Saint-Martin-des-Champs, avant 1096 (n°XL,
p. 52: Walterius de Stampis), comme époux d’une certaine Adèle (Adela)
et père d’un Pierre et d’un Anseau (filii
eorum, Walterii scilicet
et Adelæ, Petrus et Ansellus).
(a) Ce Gautier d’Étampes est
aussi mentionné par le Liber Testamentorum
de Saint-Martin-des-Champs, avant 1096 (n°XL,
p. 52: Walterius de Stampis), comme époux d’une certaine Adèle (Adela)
et père d’un Pierre et d’un Anseau (filii
eorum, Walterii scilicet
et Adelæ, Petrus et Ansellus).
(b) Pour autant Depoin s’est
visiblement fourvoyé lorsqu’il a voulu en faire le père
de l’Anseau qui fut le père de Payen. En effet nous voyons
ici ce Gautier témoin
à Étampes alors
son petit-fils supposé — selon le seul Depoin — y agit en chef de famille (dès la transaction
3), et que son arrière-petit-fils
supposé Jean est suffisamment âgé
pour être témoin (dès la même
transaction 3). En fait, le grand-père de Payen était
Jocelyn II de Lèves.
(c) Nous
pouvons encore préciser que la femme de Gautier, Adèle,
était une fille de Haugart, elle-même fille du vicomte d’Étampes
Roscelin. Haugart l’avait eue d’un premier lit, avant d’épouser,
une fois veuve, Anseau, fils de Joscelin de Lèves et père
d’Isembard dit Payen fils d’Anseau. Notre source est ici une notice
du Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(n°XXVII, pp. 34-36), notice que Depoin date sans argument
du début du XIIe siècle, mais qui en fait fait allusion
à deux transactions, la première avant la mort d’Anseau (et
donc avant nos notices), la deuxième après. Dans la première
nous voyons Anseau, sa femme Haugart, ses beaux-frères Arnaud et
Geoffroy (frère du vicomte Marc, de sorte qu’on peut se demander si
le nom réel de Marc n’était pas Arnaud), ainsi qu’un certain
Gautier, époux de la fille d’un premier de l’épouse d’Anseau
(Walterius qui habebat
privignam uxoris ejus).
(d) Un Gautier d’Étampes
(Galterius de Stampis)
est encore cité par le Cartulaire de Longpont
(éd. Marion, n°CLXXVIII, p.168), vers 1140 selon
Marion, comme témoin d’une donation de Jean fils de Payen (Domnus Johannes
filius Pagani de Stampis) et de sa femme (Eustachia),
en même temps que l’abbé
Thomas de Morigny. Ce n’est sans doute pas le
même, à moins
que la datation proposée par Marion ne soit erronée.
Thomas fut abbé dès 1111.
|
Gautier II d’Aunay (Gualterius de Alneto, A titre, Gauterius de Alneto, A1, 14, Gauterius, A8, 15,
18, B 5-6, Gaulterius de Alneio, B titre, 6, 12, 25, 34, 35, Gauterius de Alneio, B
1, 25, Gaulterius,
B 5, 6, 12, 13)
Nous ne reprendrons
pas ici tout ce que disent nos notices de ce personnage
qui est le principal donateur de Vierville.
Gautier et Milsent ne paraisse
pas avoir eu d’enfants, puisque qu’aucun n’est
mentionné comme consentant à leur donation;
au reste, lorsque Gautier n’est plus mentionné,
dans les deux dernières transactions, seuls le
sont ses deux frères cadets Arnoux et Garin.
Gautier nous est connu
par ailleurs, ainsi que sa femme Milsent Chef-de-Fer.
(a)
Gautier et Milsent sont notamment mentionnés
par les obits du chapitre de Saint-Jean-en-Vallée
de Chartres. Ils lui ont la
moitié de la dîme et de
la terre qu’ils possédaient à Mondonville
(obits du 25 mai et du 16 juillet), dans le même
secteur donc.
(b) Une charte de Louis VII de 1162 confirmant de nombreuses
donations faites à l’abbaye des Vaux-de-Cernay
(éd. Merlet et Moutié, t. I, pp. 31-36)
garde mémoire d’une donation non datée
de Gautier et de sa femme: Gauterius de Alneto
et uxor ejus, concedentibus filiis suis, dederunt tres
arpennos terre ad Aytam, permittente Aschone de Sancto
Remigio, de quorum feodo erat. Il s’agit apparemment
de notre homme.
Voyez notre article sur son frère
Garin.
|
Gautier
de Saint-Germain (Gaulterius de
Sancto Germano, B
35)
Merlet (p.164) ne relève
pas moins de huit Saint-Germain
dans le diocèse de Chartres entre
lesquels il est difficile de trancher.
Il s’agit sans doute de Saint-Germain de Gaillard, à 5,5
km de Chuisnes, et comme cette commune dans
l’orbite de Courville-sur-Eure, et ce Gauthier doit être
un chevalier dépendant comme les Chef-de-Fer
du château de Courville. Gautier est témoin à Chartres du consentement
donné par Gautier d’Aunay et sa susdite
femme Milsent au don de quatre familles de colliberts
de Denonville par Hersent (transaction 15).
Le Cartulaire de Saint-Père
de Chartres nous fait connaître un
Payen de Saint-Germain (Paganus de Sancto-Germano)
par deux transactions qui eurent lieu l’une entre 1101
et 1016 (pp. 559-550) et l’autre entre 1101 et 1120 (p.
282). Comme Payen est un nom d’usage très à la
mode, il n’est pas impossible qu’il s’agisse du même personnage;
ou bien est-ce son fils.
|
Gautier de Léthuin
(Gaulterius de Extolui,
B 31)
Gauthier de Léthuin paraît
être un moine. Il est témoin, sans doute à Vierville
même ou à Léthuin, du consentement d’Anseau Robert fils de Béguin et de sa mère
Eudeline à la donation
de Vierville par Godéchal et Amaury
(transaction 13).
|
Gautier, forgeron
(Gualterius faber, C 27)
Le
forgeron Gautier est cité comme septième
témoin, en un lieu indéterminé,
peut-être Vierville même ou Léthuin,
de la donation par Rainaud fils de Thiou
de la terre de Lomlu transaction 16).
Dans cette liste instructive du point
de vue de la hiérarchie sociale du temps,
il est cité avant le meunier. Voici
la liste: le prêtre
Aubry; Guy fils de Serlon; Airaud de Dourdan;
Hongier de Villeau; Milon fils de Boson; Aubert Vaslin;
le forgeron Gautier; le meunier Rahier; Robert
fils de Grimaud; Aubert fils de Bouchard.
|
Gautier serf de Vierville (Guauterius de
Veruilla famulus,
C 33)
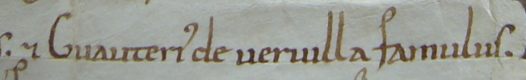 Ce serf Gautier de Vierville
est le dernier témoin cité,
soit à Vierville ou à Léthuin,
des contre-dons opérés
par les moines en échange de
la donation de la terre de Lomlu par Rainaud
fils de Thiou (transaction 17).
Ce serf Gautier de Vierville
est le dernier témoin cité,
soit à Vierville ou à Léthuin,
des contre-dons opérés
par les moines en échange de
la donation de la terre de Lomlu par Rainaud
fils de Thiou (transaction 17).
Nous ne savons pas s’il s’agit
du même que le suivant.
|
Gautier, serf des moines
(Gaulterius famulus
B 31), peut-être le même que le précédent,
ou que le suivant.
Ce serf Gautier est le dernier
témoin cité, en un lieu indéterminé,
du consentement Anseau Robert
fils de Béguin et sa mère
Eudeline à la donation opérée
par Godéchal
et Amaury (transaction 13).
Nous
ne savons pas s’il s’agit du même que le précédent,
ou encore d’un autre, serf de Bréthencourt
qui nous est connu par une charte de ce prieuré
de 1080 environ, et dont j’ai mis le texte en Annexe 6e.
|
Gautier d’Angleterre,
serf des moines (Guauterius de Anglica Terra
famulus, C 32-33)
Témoin
avec son compagnon Constance de Ventelay des
contre-dons opérés par les moines
en échange de la donation de la terre de Lomlu
par Rainaud fils de Thiou (transaction
17).
C’est peut-être
un prisonnier de guerre, postérieurement
à la conquête de l’Angleterre par
Guillaume de Conquérant en 1066, ou bien
qui aura reçu ce sobriquet par suite de quelque
épisode difficile à deviner.
(a) Ce serf nous est connu par une autre charte
du prieuré de Bréthencourt en date
de 1080 environ, et dont nous donnons le texte en
Annexe 6e, où il
apparaît aussi avec Constance de Ventelay.
(b) Un autre (?)
Gautier d’Angleterre, Gaulterius de Anglia, de statut incertain,
est témoin, apparemment à Marmoutier même, d’une
transaction relative à la terre de Bezai, en Vendômois, sous
l’abbé Bernard soit entre 1081 et 1099 (Cartulaire de Marmoutier
pour le Vendômois, n°CLXXXI, p. 259.
|
Geoffroy de Baudreville
(Godefridus de Bardul
Villa, A 19, corrigé
postérieurement en
Godefredus;
Godefredus de Balduluilla,
B 10; Godefredus de Bauduluilla,
B 14)
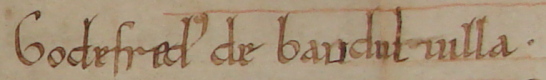 1) Geoffroy de Baudreville est le
sixième des douze témoins à
Étampes de la double donation d’Arnaud fils d’Aubrée
et du consentement de son frère Godéchal
(transaction 3).
1) Geoffroy de Baudreville est le
sixième des douze témoins à
Étampes de la double donation d’Arnaud fils d’Aubrée
et du consentement de son frère Godéchal
(transaction 3).
2) Il est ensuite, toujours à à Étampes, le quatrième ou cinquième des treize
témoins du consentement donné par Guillaume
fils de Bernoal à la donation d’Ernaud
(transaction 6). |
Geoffroy de Beaumont (Gaufredis de
Bello Monte, B 33-34)
Ce
Geoffroy de Beaumont paraît être
un chevalier possessionné dans le hameau du
même nom qui se trouve aujourd’hui dans
la commune de Chuisnes. L’un de ses serfs, Rainaud (Rainaldus famulus Gaufredis
de Bello Monte),
est témoin,
à Chuisnes, de la donation par Hersent
et Hardouin, ex-épouse et fils de Thion, de quatre
familles de colliberts en provenance de Denonville
(transaction 14).
(a)
Geoffroy de Beaumont apparaît lui-même
comme témoin à Chuisnes d’une donation postérieure
d’Hardouin Chef-de-Fer au prieuré du lieu, dont
nous éditons ci-après le texte en
Annexe 6f.
(b) Il ne s’agit évidemment
pas ici du comte homonyme de Beaumont-sur-Oise
(mentionné
par exemple par une charte de Philippe Ier
donnée à Paris le 27 mai 1067, mais
que Prou, p. 90, l. 37, considère
comme un faux d’époque
composé entre 1071 et 1073, portant la
signature de Geoffroy comte de Beaumont,
$ Gaufredi comitis Bellimontis), ni d’un Josfredus de Beaumont, qui
serait mort un 10 janvier 1068 ou 1069 ou 1070, et
qu’on suppose, sans preuve et avec hésitation
être le fils ainé du comte Yves de Beaumont.
|
Geoffroy de Moret (Gaufredus de
Moreth, B 28)
Geoffroy
de Moret est témoin du
consentement à la donation de Godéchal
par sa veuve Arembour et leur fils Eudes (transaction
12).
Voici la liste des
témoins: Gaudin fils d’Ansoué
de Méréville; Rainard
Farinard; Baudry du Fossé; Hardouin
prieur d’Épernon et son serf Ermengise;
Geoffroy de Moret; Eudes de Pannecières;
Rainaud d’Aunay (D 28-29).
Bien
que ce Geoffroy ne paraisse pas ici dans
une position très flatteuse, il semble avoir
été un nobliau important puisqu’il
est cité vers 1090 entre Jean d’Étampes
et Ougrin fils de Gunard, personnages non
négligeables (Cartulaire de Longpont,
éd. Marion, p. 134: Gaufredus de
Moreto). Il est cité aussi comme
témoin d’une donation aux moines de Longpont
juste avant Arnoux fils d’Airaud d’Étampes (éd.
Marion, n°CCCXV, p. 253:
Gaufredus de Moreto; Arnulfus, filius Arraldi).
Il est encore cité
comme témoin vers 1123 par une charte de l’abbé
de Morigny Thomas conservée par le
Cartulaire de Saint-Jean en Vallée
de Chartres dans une liste de nobliaux
étampois (n°31, p. 18:
Gaufridus de Moreth; id. n°32, p. 19),
où l’on voit
apparaître d’autres personnages mentionnés
dans nos notices, dont Payen fils d’Anseau et son fils
Jean, ainsi qu’un Bernoal père d’un moine de Morigny
appelé Jean.
|
Geoffroy de l’Eau (ou de
Lèves?) fils de Félicie
(Godefredus de Aqua filius Felicie,
D 33), fils de Félicie
Ce Geoffroy donne, moyennent un contre-don
de 35 sous, une terre d’une charrue et trois
tenures (transaction 18).
Il est probable que Geoffroy
tenait cette terre de sa mère, sous quoi
elle ne serait probalement pas nommée ici.
(a) On notera ce nom fort rare
de Aqua, dont l’interprétation
est problématique: de l’Eau? ou de Lèves? car
«ève» se disait en ancien français
«ève», d’où notre
mot «évier».
(b) Il est porté justement à Étampes
par le témoin
d’une charte de Philippe Ier, Thibaud de l’Eau,
ou de Lèves, Tetbaudus
de Aqua (éd. Prou, p. 276, l. 8 seule
occurence du toponyme dans toutes les chartres de ce monarque).
(c) Un autre indice de ce que
c’est un Étampois est le fait qu’il soit payé
par les moines en monnaie d’Étampes.
(d) Il faut noter
cependant la présence d’un chevalier apparemment
chartrain Roger de Aqua à Courville en
mars 1094, dans la liste de témoins suivante:
Philippa; son fils Yves; Nivelon,
Garin de Friaize, Hardouin Chef-de-Fer; Thibaud
fils de Suger; Fron fils de Themier; son fils Yves;
Yves fils d’Hébert; Roger de l’Eau ou de l’Ève
ou de l’Eau (Rogerius de Aqua), monseigneur l’évêque,
etc. (Nous éditons ce texte en Annexe 6g).
(e)
Félicie, mère de Geoffroy, était
peut-être l’épouse de ce Thibaud,
car la notice n°17 dans laquelle apparaît
notre témoin, ne date peut-être que du début
du XIIe siècle.
(f) On peut se demander
pour finir si Thibaud n’était
pas un cousin de Payen fils d’Anseau, lui-même fils de l’Anseau
fils de Jocelyn II de Lèves (Ansellus,
Gauslini filius) dont nous parle une
notice du Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(n°XXVII, pp. 34-36): Thibaud de Aqua aurait été un autre
fils de Jocelyn II de Lèves, lui aussi installé à
Étampes.
|
Geoffroy
fils de Gireaume (Gaufredus filius Girelmi,
B 10)
Geoffroy
est le cinquième des douze témoins
à Étampes de la deuxième donation
d’Arnaud fils d’Aubrée (transaction 3).
C’est apparemment un nobliau
étampois.
|
Geoffroy clerc de Saint-Cyr (Gaufredus clericus
de Sancto Sigio, A 20-21, B 15,
Gaufredis
clericus, B 30)
1) Ce clerc Geoffroy
est le neuvième ou dizième des treize
témoins, à Étampes, du consentement
de Guillaume fils de Bernoal à la donation de
Gautier d’Aunay. Il est alors cité juste après
un autre clerc, le jeune clerc Bernard, Bernardus
clericus iuuenis, Gaufredus clericus de Sancto Sigio
(transaction 6).
2) Il est ensuite témoin, quelque
part dans le pays chartrain, des contre-dons que font
les moines à
Anseau Robert fils de Béguin
et sa mère Eudeline en échange de leur consentement
aux donations de Godechal et d’Amaury (transaction
13); il est cité témoin des donateur,
Raoul fils de
Gauscelin, de Denonville, et non du côté
des moines.
(a) On notera que vers 1123
lorsque Jean fils de Payen,
mentionné par nos notices comme
témoin à Étampes (transaction
3), cèdera lui-même à
l’abbaye chartraine de Saint-Jean-en-Vallée (Cartulaire
de Saint-Jean-en-Vallée, éd. Merlet,
n°36, p. 23) ses droits sur Manterville
(Hermentarvilla), commune limitrophe de Vierville,
après la mort de son père Payen
(puisque seuls sont mentionnés les accords
de ses frères et cousins, de sa femme et de son
beau-frère Ferry de Corbeil), la charte
aura encore pour témoin un Geoffroy clerc d’Étampes
(Gaufredus clericus de Stampis), qui est sans
doute notre homme, nettement plus âgé, à
côté d’un Guy clerc de Corbeil (Guido clericus
de Corbolio).
(b) Ce même clerc Geoffroy (Gaufridus clericus)
est encore témoin à Étampes (apud
Stampas) vers 1127 (Cartulaire
de Saint-Jean-en-Vallée, éd. Merlet,
n°36, p. 25).
Il
semble quoi qu’il en soit que le terme de
clerc (clericus) ait ici le
sens technique de scribe (attesté par le
Lexicon de Niermeyer) voire de conseiller
juridique.
|
Geoffroy avec ses fils et ses
filles (Gaufredus cum filiis filiabusque
suis, B 32)
Serf
de Denonville, père de plusieurs
garçons et filles, dont l’ensemble
forme avec lui quatre familles de colliberts
de Denonville, qui appartiennent à
Hardouin Chef-de-Fer et à sa mère.
Ces quatre familles sont
données aux moines de Marmoutier pour coloniser
Vierville par Hardouin Chef-de-Fer (transaction
14).
Le consentement du beau-frère
et de la sœur d’Hardouin, Gautier d’Aunay et
Hersent, est ensuite recueilli à Chartres (transaction
15).
|
Gile
épouse de Geoffroy de l’Eau, ou de Lèves
(Gila uxor eius,
D 34)
Gile (dont le nom Gila
bien attesté dans le pays Chartran par le
Cartulaire de Saint-Père est une évolution
de Gisla, Gisèle)
est l’épouse du Geoffroy de
l’Eau ou de Lèves qui donne une terre
d’une charrue et trois tenures à Vierville
contre 35 sous en monnaie d’Étampes
(transaction 18).
|
Gimard Arnèse (Gingomarus Erneisius,
A 13, Gingomarus, B 11)
Il s’agit d’un moine du prieuré
de Chuines. Il assiste à Chuines au consentement donné à la donation de
Vierville par Hardouin Chef-de-Fer. Liste des témoins: Thion Chef-de-Fer, père
du dit Hardouin; le prieur Thibaud; le prieur
du cloître de Marmoutier, Robert; Évain;
Évroin; Gaston; Foulques; Gimard
Ernèse; le serf Eudes (transaction 4).
Dans la première
rédaction il s’appelle Gimard Ernèse,
mais ce deuxième élement, surnom
ou patronyme, disparaît dans la deuxième.
|
Girard
Maréchal (Girardus marescalcus,
A 16, Girardus mariscalis,
B 13), père de Payen.
Ce Girard Maréchal
est cité ici comme le père
d’un certain Payen, Paganus filius
Girardi Mariscalci, lui
même témoin, quelque part dans le pays
chartrain, avec d’autres chevaliers chartrains, du
consentement donné par Hugues fils de Guerry et sa mère Helsent
à la donation par Gautier de la part de Vierville
qu’il tenait d’eux en fief (transaction 5).
Il
ne semble donc pas y avoir de rapport entre ce
Girard et un certain Girard d’Étampes
que voici. La donation de l’église de Bondoufle
à Notre-Dame de Longpont, effectuée
d’abord à Corbeil par Ferry de Corbeil
fils de Gaudry et par notre Payen fils d’Anseau
d’Étampes, a pour témoin à Longpont
même (où seul Ferry s’est déplacé)
un Girard fils de Girard
d’Étampes, accompagné de son sergent
(serviens) Rainaud de Bondoufle et du frère
de ce dernier Jean (Depoin, Les Vicomtes
de Corbeil, p. 52: Girardus filius
Girardi de Stampis; Raginaldus de Bonduflo serviens
ejus et Johannes frater ejus).
|
Gibert ou
bien Hébert Barbu (Gerbertus Barbatus,
A 21, Herbertus Barbatus, B 15), père de Pierre
Ce personnage dont le nom
précis est incertain (première rédaction, A 20:
Petrus filius Gerberti Barbati; deuxième
rédaction, B 15: Petrus filius Herberti Barbati) est donné pour le père apparemment défunt d’un certain Pierre, témoin
semble-t-il étampois de la donation d’Amaury
Roux et du consentement d’Aubert fils d’Anseau à cette
donation (transaction 9).
|
Gibert, régisseur
de Sainville (Girbertus major de Seenuilla,
D 19)
Gibert est témoin
à Étampes de la deuxième
donation de Godéchal (transaction 8).
Voici la liste des
témoins: Gautier d’Étampes; Amaury
Roux d’Ablis; le régisseur de Sainville,
Gibert; le marchand d’Étampes Richer;
Hébert de Denonville.
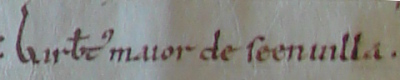 On notera qu’une charte de Philippe
Ier en date de 1067 et relative à notre
secteur, et que j’ai
récemment rééditée
en ligne, présente la signature du
régisseur de Sainville dans un passage
malheureusement lacunaire, cette lacune étant
d’une longueur absolument indéterminée,
peut-être de quelques lettres seulement. Voici la
partie de cette liste qui nous intéresse:
On notera qu’une charte de Philippe
Ier en date de 1067 et relative à notre
secteur, et que j’ai
récemment rééditée
en ligne, présente la signature du
régisseur de Sainville dans un passage
malheureusement lacunaire, cette lacune étant
d’une longueur absolument indéterminée,
peut-être de quelques lettres seulement. Voici la
partie de cette liste qui nous intéresse:
Du
côté de monsieur l’abbé
Hugues, il a y eu des moines: Thoin et Thielin,
prévôt du susdit domaine monastique, et des
laïcs: Gibert, régisseur de la dite terre
et son frère Raoul [lacune
commençant par All ou
all] régisseur de Sainville, Geoffroy
régisseur d’Authon, le chevalier d’Étampes
Thion fils d’Ours.
En latin: Gilbertus,
major ipsius terræ, et frater ejus Rodulfus
All[...] major Sigenvillæ,
Gosfridus, major d’Alton, etc.
Notre notice relative à Vierville,
qui mentionne précisément, vingt à
trente ans plus tard, un régisseur de Sainville
(major de Seenvilla) appelé lui aussi Gibert
(Girbertus), invite à supposer que notre lacune
n’était que de quelques lettres, et que le régisseur
mentionné par notre notice est le neveu de
son homonyme de la génération précédente.
|
Gibert, chanoine
(Girbertus canonicus, B 23)
Le chanoine Girbert est témoin
à Étampes de la donation d’Amaury
Roux d’Ablis et du consentment simultané
à cette donation d’Aubert fils d’Anseau (transaction
9).
Voici la liste des huit
témoins: Arnaud fils d’Aubrée;
Christophe Roi; Obert d’Étampes; le chanoine
Gibert; Guillaume des Vieilles Étampes;
Robert du Cimetière; Baudry du Fossé;
Hébert de Denonville.
Girbert
est-il un chanoine étampois; mais appartient-il
au chapitre de Saint-Martin, ou bien à
celui de Notre-Dame?
(a) Première possibilité,
la plus vraisemblable. Gibert est
un chanoine de Saint-Martin d’Étampes. Ce serait
en ce cas probablement celui qui en fut abbé
jusqu’en 1112. Quoiqu’il n’en porte plus le titre en 1112,
qui vient d’être donné à
l’abbé de Morigny, il est alors encore cité
en tête des chanoines, avant le
magister et le cantor,
sous le nom de Gislebertus Canis (charte de Louis VI selon Fleureau,
Antiquités, p. 479).
J’ai
montré dans un article paru dans un Cahier
d’Étampes-Histoire, puis dans mon
édition en ligne de la charte de 1046 qu’il a
existé au XIe siècle à Étampes
une puissante famille Chien
(prononcé Chan,
en latin Canis). Dans le secteur d’Étampes, les
Chiens ont donné leur nom
à *Chancul (Canisculus, Cul de Chien), devenu ultérieurement *Chendous
(Dos de Chien, Champdoux), d’où l’actuelle ferme de Champdoux;
et à Chanval (Val de Chien), près
Guillerval. Il est probable, d’après la charte
de 1046, que Champdoux a été donné
au tournant du Xe et du XIe siècle à
Notre-Dame d’Étampes par le prévôt
Archambaud, qui était donc lui-même probablement
un Chien.
Rappelons
que notre notice mentionne un autre
Canis, apparemment
chartrain, puisqu’il est cité entre Robert
et Aleaume d’Adonville et Osmond de Gallardon (Rotbertus de Adunuilla et Adelelmus frater
eius, Hugo Canis, Osmundis de Gualardone).
(b)
Deuxième possibilité.
On ne peut exclure la coïncidence
de deux chanoines homonymes, même si nous ne trouvons
pas en 1082 de chanoine de Notre-Dame de ce nom dans
la liste des témoins de la charte de Philippe
Ier en faveur de ce chapitre, que voici; nous y trouvons
en effet Otbertus canonicus, alors que
le témoin cité avant Girbert est un
certain Obert
d’Étampes (Obertus de Stampis); mais notre notice ne dit expressément
pas qu’Obert ait été chanoine.
Le
plus vraisemblable reste que notre chanoine Gibert
est ici le membre de la famille Chien qui deviendra
ensuite le dernier abbé de Saint-Martin.
Ou bien prend-il déjà garde de ne plus employer
le titre d’abbé.
Une
charte du Cartulaire de Saint-Jean-en
Vallée datée des environs
de 1123 mentionne pour témoin à la suite
d’une série de nobliaux très clairement
étampois, un certain Guillaume Chien (Guillelmus Canis); mais comme il est suivi d’autres témoins
pour leur part chartrains, le contexte ne permet pas de trancher
(n°34, p. 21: Johannes filius
Pagani filii Anselmi, Menerius filius Alberti, Guido frater
ejus, Erchenbaudus de Catena, Guillelmus Canis, Paganus
Rufus, Amauricus de Mesteno, etc.). En effet le personnage
qui est cité après lui est apparemment chartrain:
selon une charte de 1096 conservée par le
Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(éd. 1905, pp. 19-20), Payen Roux
était le surnom de Ferry, fils de Seguin, et neveu d’Hugues
de Voves (Habebat autem domnus Hugo duos nepotes, filios
Siguini fratris sui, quorum unus, qui major natu erat, Fredericus
vocabatur et Paganus Rufus cognominabatur; alter vero Mauricius
dicebatur).
Cependant on ne peut être exclure
a priori que ce Guillaume Chien soit le même
que Guillaume des Vieilles-Étampes.
|
Gireaume, père de Geoffroy
(Girelmus, B 10)
Gireaume
est le père apparemment défunt
d’un certain Geoffroy, qui paraît un nobliau étampois,
cinquième des douze témoins à
Étampes de la deuxième donation
d’Arnaud fils d’Aubrée (transaction 3).
|
Godéchal fils d’Oury de Vierville, frère d’Arnaud fils d’Aubrée (Godescalis
filius Hulrici de Veruilla, A 22-23,
Godiscalis filius Vlrici,
B 15, 24, 27a, Godiscalis,
B 17, 29, Godescalis,
B 27b; Godiscalis frater, B 8), époux
d’Arembour et père d’Eudes.
Godéchal est le fils d’un certain
Oury de Vierville, et il est le frère un
certain Arnaud fils d’Aubrée, ce qui semble
signifier qu’il ne partagent qu’un seul parent, qui semble
être Oury de Vierville, puisqu’ils sont tous les
deux possessionnés à Vierville.
Nous connaissons par la
Chronique de Morigny un autre
fils d’Aubrée appelé Ours. Nous ne savons
pas qui était l’aîné, et si Godéchal
est né d’une union d’Ourly antérieure
ou postérieure à son mariage avec
Aubrée.
Godéchal possède
des biens à Vierville, qu’il tenait
probablement de son père (ce dernier étant
qualifié de Vierville par la seule première
rédaction de la transaction
7). Comme Arnaud, il
les tenait à fief de Payen fils d’Anseau,
puisque le consentement de ce dernier est nécessaire,
et recueill par la transaction 10. Néanmoins
il paraît résider à Méréville,
où il est question de lui apporter le terrage
dont il garde la jouissance (transaction 8).
1) Godéchal donne
son consentement à la donation opérée
par son frère (transaction 3)
2) Godéchal donne
lui-même dans un premier temps, apparemment
à Étampes, la dîme de six tenanciers de Vierville
(transaction 7). La deuxième rédaction
est légèrement différente:
elle prétend que Godéchal a donné
(devant les mêmes témoins) le tiers de tout le fermage de tout le susdit
Vierville et la dîme de toute la terre
qu’il y détenait (transaction 7, 2e version).
3) Il donne dans un deuxième temps
huit tenures qu’il avait dans le dit Vierville,
et pour finir tout ce qu’il y possédait,
excepté le terrage (transaction
8).
4) Le consentement de Payen
fils d’Anseau à cette donation (en même
temps qu’à celle d’Arnaud) est recueilli
à la grange de Boisville-Saint-Père,
en présence d’Hugues du Puiset (transaction 10).
5) Le consentement de sa
veuve et de son fils est recueilli moyennant finances,
apparemment dans le secteur de Méréville
(transaction 12).
|
Gondagre, père
d’Aubert (Gondagrus
ou Gondager,
B 9)
Gondagre
est ici cité comme le père d’Aubert,
qui paraît un chevalier d’un assez haut rang,
puisqu’il est le premier cité des
témoins, à Étampes, de la donation
d’Arnaud fils d’Aubrée, avant même
Aubert fils d’Anseau et Pierre fils d’Érard
(transaction 3).
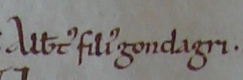 (a) Nous voyons par ailleurs la signature
d’un certain Geoffroy fils de Gondacre,
Gauffredi filii Gundacri
dans une charte de Philippe Ier en date de 1074
ou 1075 (éd. Prou, p. 179, l. 5), confirmant
une charte peut-être de dix ans antérieure
de Geoffroy de Gometz (Gometz, canton de
Limours, arrondissement de Palaiseau, Essonne),
charte qui donne aux moines de Marmoutier, encore
eux, le domaine de Bazainville (Yvelines).
(a) Nous voyons par ailleurs la signature
d’un certain Geoffroy fils de Gondacre,
Gauffredi filii Gundacri
dans une charte de Philippe Ier en date de 1074
ou 1075 (éd. Prou, p. 179, l. 5), confirmant
une charte peut-être de dix ans antérieure
de Geoffroy de Gometz (Gometz, canton de
Limours, arrondissement de Palaiseau, Essonne),
charte qui donne aux moines de Marmoutier, encore
eux, le domaine de Bazainville (Yvelines).
(b) Vu la rareté
de cet anthroponyme, conjuguée
à la proximité géographique
des secteurs concernés, et à
l’intérêt marqué
pour la cause des moines de Marmoutier, on est
naturellement porté à conclure jusqu’à
preuve du contraire qu’il s’agit de
deux fils du même Gondagre
ou Gondacre, apparemment décédé
dès avant 1065.
Le nom de Gondagre est bien représenté
dans les chartes de Marmoutier pour le Vendômois sous différentes
graphies, porté par un nombre d’individus difficile à
déterminer sans une étude approfondie de la question,
mais seulement peut-être trois, l’un au IXe siècle, le
deuxième au XIe et le troisième au XIIe siècle:
1) un Gundacrus en 833 (éd. Trémault, Cartulaire
de Marmoutier pour le Vendômois, Paris, Picard, 1893, n°Ia,
p. 276); 2) un Gundacrius vers 1061 (n°CLXXIII, p. 247); 3)
un Gundacrus avec son fils Mathieu entre 1043 et 1061
(n°CLXXVII, p. 258: S. Gundacri. S. Mathei filius sui); 4)
un Gundacrius/Gundracus le bâtard à plusieurs
reprises (vers 1060, entre 1060 et 1084, vers 1062, en 1064, en 1065 deux
fois et vers 1065: n°XXV, p. 41: Gundraco Bastardo; n°CXXVIII,
p. 221: Gundacrius bastardus; n°LX, p. 98, n°VII, p. 11,
n°XXIII, p. 56, n°XC, p. 145, n°XXXIII, p. 56: Gundraco
Bastardo), 5) un Gundacrius entre 1066 et 1075 (n°XII,
p. 20); 6) un Gundacorius vers 1069 (n°XXXII, p. 54:
Gundacorus) en même temps qu’un certain Vivien
Chef-de-Fer témoin du côté des moines de Marmoutier,
et qui en fait peut-être partie (p.52: de qua emptione
cum haberet testem Vivianum Caput ferri, iudicatum est calumniam ejus
injustam esse; p. 54: Vivianus Caput Ferri) et vers 1070 (n°LXXV,
p. 120: Gundacorus); 7) un Gundragius
vers 1120 (n°LXIVa, p. 379: Gundragio cum filio suo).
|
Grimaud (Grimaldus,
C 29)
Grimaud est le père
apparemment défunt, et condition très
modeste, d’un certain Robert qui est l’un des témoins
de la donation par Rainaud fils de Thiou
de la terre de Lomlu (transaction 16).
Dans la
liste de ces témoins, instructive du point de
vue de la hiérarchie sociale du temps, il est
cité avant le meunier: le prêtre Aubry; Guy fils de Serlon;
Airaud de Dourdan; Hongier de Villeau; Milon
fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron Gautier;
le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert
fils de Bouchard.
(a) Notons la mention
d’un péagier Grimaud, Grimoldus pedagiarius, entre 1119 et 1129, dans
le même canton, par le Cartulaire de Saint-Jean en Vallée
de Chartres; c’était peut-être
le petit-fils du nôtre, selon l’usage onomastique
du temps. Or il est pareillement mentionné
après les forgerons, dont la dignité
paraît donc supérieure à
celle des garde-barrières.
(b)
Voici le relevé de cet acte que m’a aimablement
communiqué Michel Martin, et que je
n’ai pas encore vérifié: Guy
de Rochefort, Béatrice
sa femme, Arnoux
de Garancière, Thomas
d’Authon, Bernard de Boulonville,
Hubert
d’Eddeville, Geoffroy forgeron,
Payen forgeron,
Bourdin de Bréthencourt,
Bérolin son fils,
Grimaud péager (Grimoldus pedagiarius).
|
Guerrise fils d’Hébert de Denonville
(Guerrisius filius
Herberti, B 33) et frère
d’Yves.
Guerrise semble être lui-même un
chevalier du pays chartrain, témoin
à Chuisnes de la donation par Hardouin de quatre
familles de colliberts de Denonville (transaction
14).
|
Guerry,
vidame de Chartres, père d’Hugues II, également
vidame (Guerricus
A 14, B 12), époux d’Helsent.
Guerry était le vidame de Chartres,
dont la veuve Helsent et le fils
Hugues, lui-même vidame,
consentent, apparemment
quelque part dans la pays chartrain, à la donation
par Gautier et Milsent d’une partie de
Vierville qu’il tenait d’eux à fief; Milsent de
fait, étant fille d’Hersent, était la petite-fille d’Helsent
et nièce d’Hugues (transaction 5).
(a)
Voici ce qu’en écrit Depoin dans son
édition du Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs
de 1912, p. 41, note 38: «Renaud, vidame
de Chartres, eut trois fils de sa femme Ode: Aubert,
mort le 10 juillet 1032, Hugues I, qui le remplacèrent
successivement, et Haudoin, chanoine de Chartres. Hugues
était marié dès 1045 à Ade ou
Adèle, dont il eut trois fils: Guerri, Hugues,
Aubert II (Cart. de Marmoutier pour le Dunois,
p. 33). Il prit part au siège de Thimert en 1059. Guerri
succéda directement à son père
(Guérard, Cart. de St-Père
de Chartres, p. 212); il était en charge
en 1063. Hugues fut clerc. Aubert II suivit en Angleterre,
en 1066, Guillaume le Conquérant (Merlet et de Clerval,
Un manuscrit chartrain du XIe
siècle, p. 117).»
(b) Dans une notice du même cartulaire très
précisément datée par
Depoin de 1079, où apparaît Thion Chef-de-Fer
comme encore laïc, et que nous éditons en
Annexe 6d, le vidame Guerry (Werricus vicedominus) est simple
témoin de la donation d’une partie de l’église
de Roinville est faite par les enfants de la veuve de son
père Hugues: 1° Jocelin
III de Lèves, fils du second mari d’Ade, et de Jocelin II; 2°
Aubert et 3° le clerc Hugues, tous deux fils de Hugues et d’Ade. Comme le consentement du vidame Guerry n’est pas requis,
mais qu’il est simple témoin, il s’ensuit que le bien venait
tout entier de la dote d’Ade et que Guerry n’était pas son
fils, comme le croit Depoin, mais plus vraisemblablement celui d’un
premier lit du vidame Hugues I.
(c) Selon l’obituaire de Saint-Jean-en-Vallée
(éd. Molinier, Obituaires de la province de Sens, t. II,
p. 226), Guerry est mort un 10 janvier.
(d)
Selon Lépinois Hugues
I est mentionné de 1048 à 1068, Guerry de 1079
à 1088 et Hugues II de 1089 à 1100 (Histoire de Chartres, t. II, p. 613, sans référence
précise pour la date de 1088). Guerry paraît
donc être mort entre en 1088 ou 1089, laissant deux fils
sous la tutelle d’Helsent, Hugues II et Étienne.
(e)
Le deuxième fils de Guerry, Étienne, sera abbé de Saint-Jean-en-Vallée
puis patriarche de Jérusalem.
(f) Sur sa fille Hersent, voyez ce nom.
|
Guillaume fils de Bernoal
(Guillelmus
filius Bernoalii de Stampis,
A 17-18, Guillelmus,
A 18, Guillelmus filius
Bernoali de Stampis, B 13, 26)
1) Guillaume, à Étampes,
donne son consentement
à la donation de Gautier
pour la partie de ce village que ce dernier tenait
de lui en fief (transaction 6).
Il a pour oncles parternels (patruus) un certain Airaud,
témoin, ainsi qu’un certain Eblon, frère
d’Airaud.
On ne connaît pas
son degré de parenté avec l’abbé
de Notre-Dame d’Étampes homonyme de son père,
ni avec le frère de ce dernier, Aubert.
2) Plus tard, Thion Chef-de-Fer et
son collègue moine Coscable estiment nécessaire
de recueillir, à Auneau, le consentement
d’Hugues de Gallardon à
la donation aux donations opérées
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée.
(a) Cela indique qu’il existe
des liens de sang ou d’alliance entre Hugues
de Gallardon et Guillaume d’Étampes de nature à
permettre à Hugues d’élever des revendications
sur le bien donné par Guillaume.
(b) Enfin, il est vraisemblable
qu’il faut identifier ce Guillaume fils de Bernoal
à un celui qu’une charte de Philippe Ier nous
fait connaître en 1085 avec le titre de
prévot d’Étampes (éd.
Prou, n° CXIV, p. 288, l. 24: Guillermo preposito
Stampis), curieusement mentionné dans la
date de la charte: Fait à Étampes,
l’an de l’incarnation du Verbe 1185, l’an 24 de notre
règne, alors que Guillaume était prévôt
d’Étampes.
|
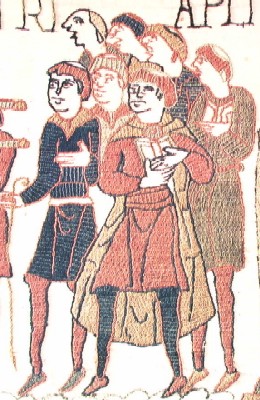 Guillaume des Vieilles Étampes
(Guillelmus
de Stampis Veteribus, B 23)
Guillaume des Vieilles Étampes
(Guillelmus
de Stampis Veteribus, B 23)
Guillaume des Vieilles Étampes est témoin à Étampes du don qu’y
fait Amaury Roux d’Ablis de
deux tenures à Vierville (transaction 9).
Voici la liste des témoins: Arnaud fils d’Aubrée; Christophe Roi; Obert
d’Étampes (Obertus
de Stampis); le chanoine Gibert (Girbertus
canonicus); Guillaume des Vieilles
Étampes; Robert du Cimetière;
Baudry du Fossé; Hébert
de Denonville (D 23).
(a) Ce Guillaume
était un prêtre. En effet
notre notice confirme merveilleusement
une conjecture de Joseph Depoin dans ses éditions
d’une notice du Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs,
où il est question, bizarrement, d’un certain
Willelmus de Stampis sacerdos
Vetulus, littéralement «Guillaume Étampes, prêtre vieux»; Depoin subodorait en 1905 qu’on
avait là une corruption
et qu’il fallait lire Vetulis,
qui s’appliquerait à Stampis:
Willelmus de
Stampis Vetulis sacerdos, «Guillaume, curé du Vieil-Étampes». Dans l’édition de 1912,
il ne reprend pas cette
conjecture audacieuse. Elle était
pourtant entièrement justifiée,
comme le prouve notre notice sur Vierville.
(b) C’était de
plus un prêtre marié, car nous
voyons dans une charte de Louis VI en date
de 1112 deux de ses fils chanoines de Saint-Martin
d’Étampes, Algrinus filius
Guillelmi presbyteri et Guillelmus frater
ejus (Fleureau, Antiquités,
p. 479).
(c) Ce même Augrin des Vieilles-Étampes
est témoin avec son propre fils Arnoux
vers 1123 d’une transaction entre l’abbaye de Morigny
et celle de Saint-Jean-en-Vallée (Cartulaire
de Saint-Jean-en-Vallée, n°31, p.18:
S. Augrini de Veteribus Stampis. S. Arnulfi
filii ejus).
(d)
Une charte du Cartulaire de Saint-Jean-en Vallée
datée des environs de 1123 mentionne pour témoin
à la suite d’une série de nobliaux très
clairement étampois, un certain
Guillaume Chien (Guillelmus Canis);
mais comme il est suivi d’autres témoins pour
leur part chartrains, le contexte ne permet pas à
lui seul de décider s’il est lui-même
étampois ou chartrain (n°34, p. 21:
Johannes filius Pagani filii Anselmi, Menerius
filius Alberti, Guido frater ejus, Erchenbaudus de Catena,
Guillelmus Canis, Paganus Rufus, Amauricus de Mesteno, etc.).
Voyons cela.
Les trois premiers, Jean, Mainier et
Guy sont très clairement étampois.
Le dernier, Amaury de Maintenon, est chartrain.
L’avant dernier est aussi, apparemment
chartrain: selon une charte de 1096 conservée
par le Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
(éd. 1905, pp. 19-20), Payen Roux
était le surnom de Ferry, fils de Seguin, et neveu
d’Hugues de Voves (Habebat autem domnus Hugo duos nepotes,
filios Siguini fratris sui, quorum unus, qui major natu erat,
Fredericus vocabatur et Paganus Rufus cognominabatur; alter vero
Mauricius dicebatur).
Le précédent en revanche,
Archambaud de la Chaîne, paraît étampois.
Vers 1140, son fils Anseau est témoin d’une
donation de Jean d’Étampes à l’abbaye de
Longpont (Cartulaire de Longpont, éd. Marion,
p. 168: Ansellus, filius Archembaldi de Catena). En 1169 Manassé, évêque d’Orléans,
fait allusion à une donation antérieure
et simultanée de Guillaume Lisard
et de Milon des Vieilles Étampes (eleemosinam
Guillelmi Lisardi, & Milonis de Stampis veteribus);
et la charte elle-même est signée à
la fois de Milon des Vieilles Étampes
et d’un Robert de la Chaîne (Milone
de Stampis Veteribus; Roberto de Catena). Cette charte
a été éditée par Fleureau,
pp. 458-459, et je l’ai mise en ligne ici.
Ainsi donc le Guillaume Chien de la charte
de Saint-Jean-en-Vallée paraît bien
appartenir à la série des nobliaux d’Étampes.
Et comme Augrin n’y est pas cité comme dans
d’autres, on est porté à croire que
Guillaume Chien et Guillaume des Vieilles-Étampes
sont une même et seule personne.
|
Guillaume
Roux de Chuisnes (Guillelmus Rufus
de Coina, B 34)
Guillaume
Roux de Chuisnes est un laïc de Chuisnes
qui y est témoin de la donation par Hardouin et sa
mère Hersent de quatre familles de colliberts
(transaction 14).
(a) Il ne semble pas qu’il soit à identifier
avec un certain Guillaume Rouaud (Willelmi filii Rotaldi, Guillelmus Rotaldi) qui apparaît ailleurs comme témoin de trois donations
d’Hugues de Gallardon (voyez notre Annexe 6i).
|
Guy fils de Serlon
(B
26, Guido
Serlonis filius, C
28, Guido
filius Serli)
1) Guy fils de Serlon est d’abord cité en tête
des témoins à Auneau
du consentement donné par Hugues de Gallardon
aux donations faites par Gautier d’Aunay,
Guillaume fils de Bernoal d’Étampes et
Arnaud fils d’Aubrée (transaction 11).
2) Il est ensuite cité
comme le deuxième des témoins
(après le prêtre Aubry) de la donation par Rainaud fils de Thiou
de la terre de Lomlu (transaction 16).
Ce Guy fils de Serlon nous est autrement
connu.
(a) Il est cité par une notice
de l’abbaye parisienne de Saint-Martin-des-Champs,
rédigée entre 1079 et 1096
(éd. Depoin, 1912, t. I, p.
112: Widonem scilicet filium
Serlonis), et relative à
la moitié de la dîme d’Orsonville,
qu’il tenait en fief d’une certaine Élisabeth (épouse de Bouchard de Macy), qui la tenait elle-même de Gautier d’Étampes
(premier témoin de notre transaction 8) et de sa
femme Adèle, cette dernière l’ayant reçue
en dot de son père, un certain Hugues. Guy est alors
accompagné de son fils dénommé Payen.
Extrait: Ainsi donc, puisque nous avons ainsi entrepris
de tout rédiger, venons à ceux
qui, s’ils n’avaient pas donné leur accord,
auraient pu élever des contestations,
à savoir à Guy fils de Serlon, qui tenait
d’Élisabeth et de son mari la susdite dîme:
comment dans le chapitre de Saint-Martin, en présence
de Dieu et de l’assemblée de tous les moines,
ainsi que des très nombreux témoins
prescrits par la loi, il en a autorisé le don, lui
et son fils appelé Payen; à cause
de quoi il a reçu 40 sous et deux pelisses fourrées
en peau d’agneau: il a donné
l’une à son fils, et s’est vêtu
de l’autre.
(b) Il est aussi cité, en compagnie
de Thion Chef-de-Fer encore chevalier, par une autre
notice du prieuré de Bréthencourt datée
d’environ 1080 et dont j’ai mis ici le texte en
Annexe 6e.
|
Hardouin
d’Adonville (Harduinus de Adonis
Villa, B 35)
Hardouin
d’Adonville, chevalier apparemment
possessionné dans ce hameau de Denonville,
est témoin à Chartres du consentement
donné par Gautier d’Aunay et sa femme à
la donation par son beau-frère Hardouin de quatre familles
de colliberts de Denonville (transaction
15).
Liste des témoins: Yves fils d’Hébert; Robert Fléaud;
Garin de Bailleau; Hugues de Tracy;
Gautier de Saint-Germain; Hardouin d’Adonville;
le frère de Gautier d’Aunay,
Arnoux. Le premier est aussi de Denonville,
Yves fils d’Hébert de Denonville.
Hardouin d’Adonville est
sans doute apparenté à
Robert d’Adonville
(de Adunvilla) et son frère Alleaume
qui ont eux été témoins à
Auneau du consentement d’Hugues de Gallardon à
la donation de Vierville. Rappelons les témoins
d’alors: Guy fils de
Serlon; Amaury fils de Rahier; le prévôt
d’Auneau Marin; Robert Breton; Jean Veau; Robert
d’Adonville et son frère Aleaume; Hugues
Chien; Osmond de Gallardon (transaction 11).
Rappelons qu’ultérieurement,
selon Merlet, le fief d’Adonville relevera
du duché de Chartres et ressortissait
pour la justice à Auneau.
|
 Hardouin
Chef-de-Fer (Harduinus Caput de
Ferro, A 10-11, Harduinus,
A 12, B 11, 32, 34, Harduinus Caput Ferri,
B 10-11, filius
eius Harduinus Caput
Ferri, B 31), fils d’Hersent et
de Thion Chef-de-Fer.
Hardouin
Chef-de-Fer (Harduinus Caput de
Ferro, A 10-11, Harduinus,
A 12, B 11, 32, 34, Harduinus Caput Ferri,
B 10-11, filius
eius Harduinus Caput
Ferri, B 31), fils d’Hersent et
de Thion Chef-de-Fer.
Voyez ci-dessus notre article
Chef-de-Fer.
Ajoutons-y que quelques années
plus tard, apparemment après la mort de Thion,
une charte du prieuré de Chuisnes
le mentionne expressément comme chevalier
du château de Courville (miles quidam nomine
Harduinus congnomine Caput Ferreum de castello Curveville):
il donne 23 deniers de cens sur l’église de
Saint-Marin, et réussit de manière amusante
à extorquer un couteau au prieur Thibaud. Nous donnons
ce texte en Annexe 6f.
|
Hardouin, père
de Payen (B 10, Harduinus)
Hardouin
est le père apparemment décédé
d’un certain Hardouin, huitième des
douze témoins, à Étampes,
de la donation d’Arnaud fils d’Aubrée (transaction
3). |
Hardouin,
prévôt
de Chartres (Harduinus prepositus Carnotensis,
B 33)
Le
prévôt Hardouin est témoin à
Chuisnes du consentement du don de quatre familles
de colliberts par Hardouin Chef-de-Fer et sa mère
Hersent. Il est témoin
du côté des moines, avec
Thion chef-de-Fer et le clerc Garin (transaction
14).
Il s’agit
d’après le contexte non pas d’un prévôt
laïc de la ville de Chartres mais d’un moine, officier
ecclésiastique du prieuré de Saint-Martin de Chartres (cf.
Guérard, Cartulaire de Saint-Père,
pp. LXXXIV-LXXXV), comme dans le cas de Marin, prévôt
du prieuré d’Auneau.
|
Hardouin prieur d’Épernon
(Harduinus prior Sparronensis,
B 28)
Le prieur d’Épernon Hardouin, avec son
serf Ermengise, est témoin de la concession
faite par Arembour, veuve
de Godéchal fils d’Oury, apparemment
quelque part dans le pays de Méréville,
trois des témoins étant des nobliaux de Méréville,
Moret et Pannecières
(transaction 12).
Cet
Hardouin est le premier prieur connu du
prieuré Saint-Thomas d’Épernon
(dont le roi Henri Ier a entériné la
fondation par une charte donnée à Étampes
en 1052).
(a) Il est aussi connu par une
charte de 1092 entérinant à Blois
un accord passé devant le comte Étienne
(Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, n°145).
(b) Il paraît être
mort avant 1098, date à laquelle le prieur de
Saint-Thomas s’appelle Guillaume: il est cité parmi les
témoins d’une charte donnée au prieuré de Basainville
par Simon de Neaufle (selon Auguste
Moutié et Adolphe Dion, Cartulaire de Saint-Thomas d’Épernon,
Rambouillet, 1878, p. 132); ce Guillaume est encore prieur en 1114 (éd. ID., ibid.,
n°2, p. 8: Willelmus prior).
Voir: Émile LEDRU, «Le
Prieuré Saint-Thomas d’Épernon»
(daté 1897), in Charles MÉTAIS,
Archives du diocèse de
Chartres. III. Pièces détachées
pour servir à l’Histoire du diocèse
de Chartres. 1er volume. Études et documents
publiés par L. l’Abbé Ch. Métais,
Ch. Honoraire de Chartres [448 p.], Chartres,
Ch. Métais, 1899, pp. 293-340, spécialement
pp. 327 et 328. |
Hardouin, clerc (Harduinus clericus,
D 37)
Ce clerc Hardouin est l’un des quatre témoins
de Geoffroy de l’Eau
fils de Félicie et son épouse
Gile lors de leur donation, en un lieu
indéterminé, d’une terre d’une charrue
et trois tenures à Vierville (transaction
18).
|
Harpin
de l’Étampois, ou d’Étampes
(Harpinus de Stampesio,
A 21, Harpinus de Stampis,
B 15)
Ce Harpin,
ou Herpin, est curieusement qualifié
d’Étampois dans la première rédaction,
et plus normalement d’Étampes dans la
deuxième. Il est le onzième ou douzième
des quatorze témoins, à Étampes,
du consentement de Guillaume fils de Bernoal à
la donation de Vierville par Gautier d’Aunay (transaction
6).
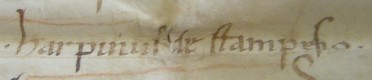 (a) Armand Caillet (Puiselet-le-Marais, village de
France, Largentière, Humbert, 1951,
p.106), cité
par Alain Devalay («Les
seigneurs de Bois-Herpin», in
Cahier d’Étampes-Histoire
8, 2007, p. 55) écrit que ce personnage avait obtenu
vers 1080 l’inféodation d’une rue d’Étampes,
mais on se demande bien d’où il a pu tirer
ce renseignement bien surprenant et dont il est impossible
de tenir compte tant qu’aucune source ne sera trouvée
à son appui. De même il aurait
tenu «le fief des buis, partie occidentale
du finage de la paroisse de Puiselet».
Il s’agit là peut-être de suppositions non documentées
directement, mais très intrigantes: des sources restent certainement
à découvrir, notamment aux Archives nationales, que certains
érudits locaux ont dû parcourir sans pouvoir les exploiter
pleinement.
(a) Armand Caillet (Puiselet-le-Marais, village de
France, Largentière, Humbert, 1951,
p.106), cité
par Alain Devalay («Les
seigneurs de Bois-Herpin», in
Cahier d’Étampes-Histoire
8, 2007, p. 55) écrit que ce personnage avait obtenu
vers 1080 l’inféodation d’une rue d’Étampes,
mais on se demande bien d’où il a pu tirer
ce renseignement bien surprenant et dont il est impossible
de tenir compte tant qu’aucune source ne sera trouvée
à son appui. De même il aurait
tenu «le fief des buis, partie occidentale
du finage de la paroisse de Puiselet».
Il s’agit là peut-être de suppositions non documentées
directement, mais très intrigantes: des sources restent certainement
à découvrir, notamment aux Archives nationales, que certains
érudits locaux ont dû parcourir sans pouvoir les exploiter
pleinement.
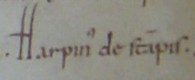 (b) On connaît mieux son fils Hébert
(Herbertus Harpini filius) cité
par une charte de Louis VI de 1112 conservée
par le Cartulaire de Morigny (éd.
Fleureau, Antiquités,
p. 479; éd. Menault, Cartulaire,
p. 41), par une autre de 1120 (Fleureau, p. 496: Menault,
pp. 22-26), qui mentionne un four banal édifié
par Harpin (furni Harpini); par une charte
du Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans (éd.
Thuillier et Jarry, p. 146) qui l’appelle Hébert
le Valet (Herbertus Valestus) et mentionne déjà
le lieu-dit Bois-Herpin (Nemus Arpini).
(b) On connaît mieux son fils Hébert
(Herbertus Harpini filius) cité
par une charte de Louis VI de 1112 conservée
par le Cartulaire de Morigny (éd.
Fleureau, Antiquités,
p. 479; éd. Menault, Cartulaire,
p. 41), par une autre de 1120 (Fleureau, p. 496: Menault,
pp. 22-26), qui mentionne un four banal édifié
par Harpin (furni Harpini); par une charte
du Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans (éd.
Thuillier et Jarry, p. 146) qui l’appelle Hébert
le Valet (Herbertus Valestus) et mentionne déjà
le lieu-dit Bois-Herpin (Nemus Arpini).
(c) Par ailleurs une charte
de Jean, prieur de Notre-Dame de La Ferté,
éditée par Estournet en 1944 et
que j’ai mise en ligne avec une traduction, mentionne
un autre de ses fils, Anseau fils d’Harpin
de Morigny (Ansellus filius Harpini
de Mauriniaco). Elle est contemporaine de l’abbé
de Morigny Aimery (Haimericus, Mauriniacensis
abbas), dont on connaît une charte de 1173
(la dernière charte connue de son prédécesseur
étant de 1169, et la première connue
de son successeur est de 1192, selon Fleureau, Antiquités,
p. 518).
(d) Enfin Estournet fait état
d’une charte inédite (Archives Nationale
S 5150B, n° 32, original) dont il ne donne
malheureusement pas le texte, par laquelle
«Thierry Galeran acheta à Renaud
Bachelier la mouvance des moulins du Saussay
et la fit amortir moyennant 98 sous par Jean, Hugues
et Menier, fils d’Amaury, devant Arnould, prévôt
de Notre-Dame d’Étampes en présence
d’Herbert Valet de Puiselet, Galeran d’Yerres, Pierre
d’Auvers et Guillaume Goaut, prévôt d’Étampes».
Voir: Alain DEVANLAY,
«Les seigneurs de Bois-Herpin»,
in Cahier d’Étampes-Histoire
8, 2007, pp. 55-59, spécialement p. 55.
|
Hébert
de Denonville ( Herbertus de
Danonuilla, A 24, Herbertus de Danunuilla,
B 10, 20, 23, Herbertus
de Danouilla, B 16, Herbertus, B 33, 34), père de Guerrise
et d’Yves
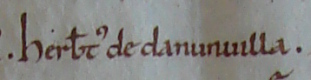 1) Hébert assiste à
Étampes à la donation d’Arnaud
fils d’Aubrée, dont il est de douzième
et dernier témoin; curieusement, il est
omis par la première rédaction de cette
transaction dans la notice A (B 10, transaction
3).
1) Hébert assiste à
Étampes à la donation d’Arnaud
fils d’Aubrée, dont il est de douzième
et dernier témoin; curieusement, il est
omis par la première rédaction de cette
transaction dans la notice A (B 10, transaction
3).
2) Hébert assiste, apparemment à Étampes, la première
donation de Godéchal
fils d’Oury de Vierville, dont il est le cinquième et dernier témoin (A 24 = B 16, transaction
7).
3) Hébert assiste, apparemment
à Étampes, la deuxième donation de Godéchal fils d’Oury de Vierville, dont il est à nouveau le cinquième
et dernier témoin, ces témoins étant
différents (B 20, transaction 8).
4) Hébert assiste à Étampes à
la donation d’Amaury Roux d’Ablis et au consentement
simultané d’Aubert fils d’Anseau, dont il est le huitième
et dernier témoin (B 23, transaction 9).
On peut se demander si cette
position systématique en fin de liste (combiné
à son omission dans la première
version de la transaction) ne peut pas s’expliquer par un
rôle de secrétaire. Il faut de plus remarquer
que dans la notice A, il n’est mentionné
qu’en extrême fin du texte, comme dernier témoin
de la dernière transaction enregistrée,
ce qui pourrait correspondre à la signature d’une
sorte de notaire.
Hébert de Denonville
est au moins un homme-lige de la famille
Chef-de-Fer, qui de fait tient Denonville.
Hébert n’apparaît
plus dans les transactions suivantes, mais
on voit que deux de ses fils continuent à accompagner
Thion Chef-de-Fer lors de ses pérégrinations.
5) Guerrise fils d’Hébert assiste
à Chuisnes à la donation par Hardouin
de quatre famille de colliberts de Denonville.
Il est alors le deuxième des cinq témoins
cités nominativement (B 33, transaction
14).
6) Yves fils d’Hébert assiste à
Chartres au consentement donné par Gautier d’Aunay et sa femme Milsent Chef-de-Fer à la dite donation par Hardouin
de quatre familles de colliberts. Il est alors le premier en tête
des témoins laïcs (B
34, transaction 15).
Guerrise est rangé parmi les laïcs,
en seconde position; Yves est le premier
témoin cité. Il faut supposer qu’il s’agit
d’une famille de chevaliers, ou d’écuyer de
Denonville et d’hommes liges des Chef-de-Fer.
|
Hébert ou bien
Gibert Barbu (Gerbertus Barbatus,
A 21, Herbertus Barbatus, B 14), père de Pierre.
Voyez nos article Gibert Barbu et Barbu.
|
Helsent,
veuve du vidame Guerry, mère du vidame Hugues
II et d’Hersent (Helisindis, A 14,
Helisendis, B 12)
Helsent
est la veuve de Guerry, l’ancien vidame de Chartres,
et la mère de son successeur
Hugues, ainsi que d’Hersent, qu’a épousée
Thion Chef-de-Fer. Avec Hugues, elle consent, apparemment quelque part dans la pays chartrain,
à la donation par Gautier et
Milsent d’une partie de Vierville qu’ils tenaient d’eux
à fief (transaction 5).
(a) Dans l’obituaire
de Saint-Jean-en-Vallée, au 24 avril, date anniversaire de son
fils Hugues, est noté le nom du père d’Helsent, Anschoux
(éd. Molinier, Obituaires
de la province de Sens, t. II, p. 229: Anscolfus,
pater Helisendis vicedomine).
(b) Helsent
est veuve depuis au moins 1079, d’après
une notice du Cartulaire
de Saint-Martin-des-Champs très précisément datée
par Depoin (et où apparaît Thion Chef-de-Fer
comme encore laïc). Voyez
notre article sur Guerry.
(c) Le Cartulaire de Saint-Père de Chartres
contient un petit dossier sur une donation qui
avait été faite par le vidame Guerry avant
sa mort, et qui avait été ensuite confirmée
par sa veuve et son fils et successeur Hugues II,
sauf pour une part qu’il s’était appropriée;
Helsent cependant reprend cette part à son fils
et la restitue aux moines (éd. Guérard,
pp. 561-652).
(d)
Le 23 février 1103, Helsent
(Helisendis), veuve du vidame Guerry (Guerrici
vicedomini), et ses fils le vidame Hugues (Hugone
videdomino) et Étienne (Stephano)
ainsi que leur sœur Elisabeth (Elisabeth) font une
autre donation (ibid.,
p. 563). On y retrouve un témoin,
Thibaud fils d’Étienne (Theobaldo
filio Stephani) qui est le même
que dans notre notice (Tetbaldus filius Stephani, A 16, B 12-13).
(e) Helsent était possessionnée
aussi dans le secteur à Manterville;
vers 1108 elle cède au chapitre de Saint-Jean-en-Vallée
tout ce qu’elle y possédait, en présence
notamment du même témoin Thibaud fils
d’Étienne, qui doit être un de ses vassaux
(Cartulaire de saint-Jean-en-Vallée,
n°7, p. 6, bis).
(f)
Vers la même date, après la
mort de son fils Hugues fils de Guerry, et alors qu’elle
est de plus veuve de son second mari Barthélémy,
elle donne une vigne à cette abbaye (AD 28, H.3114,
éd. Merlet, Cartulaire de
Saint-Jean-en-Vallée, n°IX, t. I,
p. 7: Garinus de Alneto), avec l’accord de son fils
Étienne et de son fils Girard, qu’elle avait eu de Barthélémy.
(g) Selon Lépinois
en effet (Histoire de Chartres, t. II, p.613), la
vidamesse Hélisende, outre qu’elle apporta à son
mari Guerry de grands biens situés à Tréon,
après la mort de Guerry, épousa Barthélemy
Boël ou Bodel, qui prit le titre de vidame et qui était
frère de Foucher Boël ou Bodel, le héros
du siège d’Antioche. Elle eut de ce second mariage
Girard Boël. (Titres de Saint-Père.) Etienne,
second fils de Guerry et d’Hélisende, et frère de
Hugues II et d’Elisabeth, qui fut abbé de Saint-Jean[-en-Vallée],
puis patriarche de Jérusalem (1120), est appelé
quelquefois vidame. (Titres de Saint-Jean et de Saint-Père.)
(h)
Entre 1090 et 1101, nous voyons Barthélémy
prendre le titre de vidame alors qu’il est témoin
de l’affranchissement d’un serf de Saint-Père
(Cartulaire de Saint-Père,
p. 297).
Comme
Helsent est possessionné en plusieurs lieux
où le sont aussi les descendants d’Anseau d’Étampes,
à Vierville, à Manterville, à Roinville,
il est probable qu’il existait entre eux un lien de parenté
étroit.
|
Hersent (Hersendis,
B 31, 34), fille de Guerry, soeur
du vidame Hugues II, ancienne
épouse du moine Thion Chef-de-Fer, mère de Milsent et d’Hardouin Chef-de-Fer, belle-mère
de Gautier II d’Aunay.
Elle
est mentionnée seulement pour la donation
qu’elle fait, à Chuisnes, avec son fils Hardouin,
de quatre familles de colliberts de Denonville (transaction
14).
(a) Hersent est mentionné
comme femme de Thion, encore chevalier, en 1079, lors de la donation
à Saint-Martin-des-Champs de l’église Saint-Georges
de Roiville-sous-Auneau (Voyez notre Annexe 6d). A cette date elle consent avec Thion
et leur fils Hardouin à la donation d’une des moitiés
de l’église, tandis que le consentement requis pour l’autre
moitié est donné par les fils de la vidamesse Ade
(l’un fils de son premier mari le vidame Hugues, Aubert, l’autre
fils de son second mari Jocelin II de Lèves, Jocelyn III; le
vidame Guerry étant seulement témoin, ce qui tend à
démontrer qu’il n’était pas un fils d’Ade, mais d’un
premier lit du vidame Hugues I.
(b) La situation à Vierville
est analogue mais non identique, puisque Milsent, fille de Thion
et d’Hersent, en est dame, tenant le village pour moitié
du vidame Hugues fils de Guerry, et pour moitié d’un Étampois,
Guillaume fils de Bernoal, qui la tenait lui-même du seigneur
d’Auneau, Hugues de Gallardon. On peut donc penser que les droits des
Chef-de-Fer tant sur Vierville que sur l’église de Roinville-sous-Auneau
leur venaient d’Hersent, c’est-à-dire de la famille des
vidames de Chartres.
(c) Hersent est mentionnée comme fille de
Guerry par l’obituaire du monastère de Saint-Jean-en-Vallée
dont son fils Étienne fut abbé (éd. Molinier, Obituaires
de la province de Sens, t. II, p. 229d).
|
Hervé,
écuyer (Herueus armiger,
C 32)
L’écuyer
Hervé est cité comme témoin,
peut-être dans le secteur de Denonville,
des contre-dons opérés par les
moines en échange de la donation de
la terre de Lomlu par Rainaud fils de Thiou (transaction
17).
Témoignent avec
lui: Arnoux d’Aunay;
son frère Garin; Rainaud des Têtières;
l’écuyer Hervé. Du côté
des moines, y ont assisté: le
prêtre Tamoué; le serf Gautier
d’Angleterre; le serf de Ventelay Constance; et
le serf de Vierville Gautier.
|
Hongier de Villeau (Hungerius de Villa
Illa, C 28)
Hongier de Villeau est
le quatrième témoin de la donation par Rainaud fils de Thiou
de la terre de Lomlu (transaction 16).
C’est apparemment un chevalier,
d’après sa place dans la liste:
le prêtre Aubry;
Guy fils de Serlon; Airaud de Dourdan; Hongier
de Villeau; Milon fils de Boson; Aubert Vaslin;
le forgeron Gautier; le meunier Rahier; Robert fils de
Grimaud; Aubert fils de Bouchard.
|
Hugues Ier du Puiset (Hugo de Puteolo,
B 25)
Cet Hugues du
Puiset est témoin
à la grange de Boisville-Saint-Père
du consentement donné par Payen fils
d’Anseau (représenté par Anseau fils
d’Arembert), à la donation effectuée
par Gautier d’Aunay (transaction 10).
1) De quel Hugues du Puiset
s’agit-il?
S’agit-il d’Hugues Ier, d’Hugues
II, ou de Hugues III?
Hugues
Ier, dit Blavons, vicomte de Chartres, serait
mort, à ce qu’on lit partout, en 1094; mais je donne
en Annexe 7i une charte de
lui qui date de 1096.
Son
fils aîné Évrard III lui
aurait succédé avant de partir en croisade
en 1096; mais cette hypothèse doit être révisée,
puisque nous avons vu que son père Hugues Blavons
est toujours de ce monde en 1096. Rappelons qu’avant de partir
en croisade, il vend Morigny au roi Philippe Ier. Il meurt quoi
qu’il en soit en 1097 à Antioche, laissant un enfant
mineur, Hugues III.
Hugues
II, frère cadet d’Évrard, est
de 1097 (?) à 1106 le tuteur d’Hugues III, avant
de lui-même partir en Palestine, où
il deviendra Hugues I de Jaffa. Guy lui succèdera
comme tuteur d’Hugues III de 1106 à 1109,
qui ne sera considéré comme majeur que
vers 1110.
Voici ce qui nous impose
de reconnaître ici Hugues Ier: c’est qu’il
a avec lui Nivelon de Fréteval, qui est parti
avec lui en croisade, et dont nous savons qu’il ne revint
pas en France avant 1108. La transaction 10 a donc eu lieu
avant sa mort, survenue un 23 décembre, pas avant 1096.
Ce qui appuie cette conjecture,
c’est que la transaction 12 a pour témoin
le prieur de Saint-Thomas d’Épernon
Hardouin, connu par une charte de 1092 entérinant
à Blois un accord passé devant
le comte Étienne (Cartulaire de Marmoutier
pour le Dunois), tandis qu’en 1098 le prieur
de Saint-Thomas s’appelle Guillaume.
2) Importance du personnage
Il est particulièrement
notable que l’accord de l’Étampois Payen
fils d’Anseau soit donné à la cour d’Hugues
Blavet, vassal rebelle du roi de France Philippe Ier depuis
1079, comme je l’ai montré dans mon édition en ligne d’une notice de l’abbé
Eustache de Saint-Père;
tandis que ni le nom ni même l’autorité
du roi ne soit jamais mentionnées dans aucune
de nos dix-sept notices.
Son grand-père était
le premier vicomte de Chartres connu, Geldoin,
cité comme tel en 1019, et mort moine vers 1060.
Le fils aîné de Gidoin, Hardouin, second
vicomte, meurt en 1060 et son cadet Évrard Ier
lui succède et meurt entre 1061 et 1066, laissant son
comté de Breteuil à l’aîné
Évrard II. Son troisième fils Hugues Ier dit
Blavons hérite de la vicomté de Chartres.
Hugues Blavons profite de la minorité de Philippe
Ier pour s’emparer du château royal du Puiset en 1067.
En 1073, le comte de Blois Thibaud III, également
comte de Chartres, le fait vicomte de Chartres. En 1079, Hugues
se révolte contre Philippe Ier et défait
l’armée royale devant le Puiset. Il ne reparaît
plus dès lors à la cour et paraît régner
en maître dans le secteur, où l’autorité
royale ne sera rétabli que sous le règne
de Louis VI, spécialement après 1112 et la destruction
du château du Puiset.
Hugues a épousé
Alais de Montlhéry, fille de Gui Ier de Montlhéry
et d’Hodierne de Gometz. Sa femme est la tante d’Hugues
de Gallardon, dont la mère est aussi une fille
de Gui Ier de Montlhéry.
Ses
enfants connus sont: Guillaume, mort jeune;
Évrard III, qui ne lui succèdera que
vers 1110, état auparavant sous la tutelle de ses
oncles Évrard II puis Guy de Méréville,
Gilduin, Galéran, Raoul, Humberge et Eustachie.
On peut se demander si la cérémonie
effectuée en sa présence ne
constitue pas d’une certaine manière une sorte
de reconnaissance, par Payen fils d’Anseau, de sa
suzeraineté au moins sur ses biens de Vierville, qui
relève pourtant théoriquement de la châtellenie
d’Étampes et donc directement de l’autorité
royale.
Il est remarquable
cependant que Payen n’ait pas fait le déplacement,
et qu’il se soit fait réprésenter
par Anseau fils d’Arembert.
|
Hugues, vicomte de Châteaudun
(Hugo uicecomes Castelliduni, B
25)
Hugues vicomte de Châteaudun est témoin d’une autorisation de donation opérée
au nom de Payen d’Étampes
dans la grange de Boisville-la-Saint-Père
(transaction 10).
Voici la liste des témoins:
Aubert fils
d’Anseau, qui a obtenu cette autorisation, Gautier d’Aunay;
Hugues vicomte de Châteaudun; Hugues
du Puiset; Nivelon fils de Foucher; Garin de Friaize
(D 24-25).
Il
s’agit de Hugues III dit Capelle, vicomte
de Châteaudun de 1080 jusqu’au début
du XIIe siècle. Il meurt entre
1110 et 1119.
(a) Il est
cité, Hugo, en 1060 le
11 janvier 1078 en temps que fils du vicomte Rotrou
(Métais et Souancé,
Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou 1031-1079.
Histoire et Cartulaire, Vannes, 1899, p. 19, n°VI; Cartulaire de Cluny,
t. IV, p. 633, n°3517). Une charte non datée
le cite comme vicomte, Hugo
vicecomes Castriduni (Nogent-le-Rotrou,
p. 116, n°XLIX), et une autre entre 1095 et 1100, Hugo vicecomes de
Castroduno (Cartulaire de Marmoutier
pour le Dunois, n°CL, p. 138).
La dernière
charte connue qui le mentionne comme tel,
Hugo vicecomes Castriduni, est datée de 1110-1111 (Cartulaire de Marmoutier
pour le Dunois, n°CLXIV, p. 155)
et la première à mentionner son
fils et successeur Geoffroy III, Gaufridus
de Castroduno, d’une manière qui suppose sa
mort est de 1119 (Merlet, Cartulaire de
l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron, t.
I, p. 37, n°XXI).
(b) Hugues de Châteaudun est le
beau-frère de Nivelon fils
de Foucher, dont il a épousé
la sœur Agnès surnommée
Comtesse.
Voici
ce qui établit ce fait. Une charte
de Foucher, Fulcherius Nevelonis filius,
donnée entre 1072 et 1084 note le consentement
de ses filles Payenne et Comtesse,
filiæ ipsius Comitissa et Pagana
(Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, p.
76, n°LXXXVI). Une charte d’Hugues de Châteaudun,
Hugo vicecomes, datée entre 1080 et
1100, note le consentement de son épouse la
vicomtesse Agnès, uxor ipsius Comitissa (ibid.,
p. 131, n°CXI). Une charte de Nivelon de Fréteval,
Nevelo de Fracta Valle, datée entre
1096 et 1101, enregistre le consentement de sa sœur la
vicomtesse Agnès, Agnes vicecomitissa
soror sua (ibid., p. 56, LXIV). Enfin une autre donation de Hugues, entre 1095 et 1100, note le consentement de sa femme Comtesse, Comitissa uxor
eius (ibid., p. 138, n°CL).
|
Hugues de Gallardon
(Hugo de Gualardone,
B 25)
Hugues
de Gallardon, dans la maison des moines d’Auneau,
consent à la donation de Vierville
opérée par Gautier d’Aunay,
Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée, à
la supplique des moines monsieur Thion Chef-de-Fer
et Costable. De cette donation sont témoins:
Guy fils de Serlon; Amaury fils de Rahier; le
prévôt d’Auneau Marin; Robert Breton;
Jean Veau; Robert d’Adonville et son frère
Aleaume; Hugues Chien; Osmond de Gallardon (transaction
11).
1) Ascendance.
Selon Coüard et Depoin, (Liber Testamentorum,
p. 98, note 384), Gallardon appartint d’abord à
Aubert le Riche, qui eut trois fils: Aubert II, Garin et
Thion. Aubert II n’eut que deux filles. Il légua
Thimert à Froheline, épouse de Gasce, et Gallardon
à Haubour (Hildeburge), épouse d’un certain Hébert
de Paris. Hébert et Haubour eurent pour fils Hervé
I de Gallardon. Hervé eut pour enfant: Hugues I, Garin,
Guy, Milon et sans doute un certain Geoffroy de Gallardon, ainsi
que la bienheureuse Haubour (Hildeburge), épouse de Robert
d’Ivry.
A la mort d’Hugues I, sans doute
en Palestine, qui ne laissa qu’une fille, son frère
Garin lui succéda. Garin mourut à
son tour peu après, laissant un fils mineur, Hugues
II, dont Guy fut pour un temps le tuteur.
Hugues
de Gallardon est le fils d’Hervé Ier de Gallardon
(mort en 1092) et de Béatrice d’Auneau,
elle-même fille de Guy Ier de Montlhéry et
d’Hodierne de Gometz. La mère d’Hugues est
donc la sœur d’Alais de Montlhéry, fille de
Gui Ier de Montlhéry et d’Hodierne de Gometz. Hugues
de Gallardon est donc le neveu de la femme d’Hugues Blavons
du Puiset.
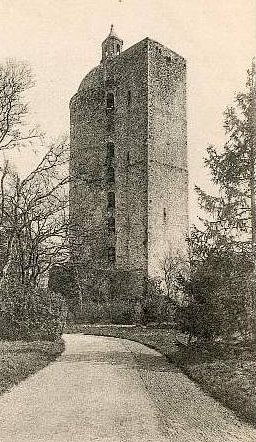 2) Hugues de Gallardon en temps
que seigneur d’Auneau
2) Hugues de Gallardon en temps
que seigneur d’Auneau
Selon
par exemple André Châtelain
("Auneau", in ID., Châteaux forts
et féodalité en Île de France
du XIe au XIIe siècle [507 p.], Paris, Créer, 1983, pp. 91-92) et
d’autres auteurs, c’est
Hugues de Gallardon qui aurait élevé
le donjon d’Auneau entre 1090 et 1100 pour remplacer
une vieille fortification carolingienne appelée
Vieille Cour, emême tremps qu’il faisait passer Auneau
de la vassalité du comte de Rochefort à celle
du comte de Chartres.
Nous le voyons cité par exemple par
une notice du Cartulaire de saint-Père
de Chartres, rédigée par l’abbé
Eustache sous l’épiscopat de saint-Yves, donc
entre 1090 et 1101 (t.II, p.
297).
Le même Cartulaire
de Saint-Père (t.II, p.314) nous le montre voisinant, comme témoin,
avec deux personnages qui sont quant à
eux cotémoins de notre transaction 5, Yves fils
de Norbert et Thibaud fils d’Étienne:
Teobaldus filius Stephani,
Ivo Norberti, Hugo de Galardone (cf. transaction
5: testibus istis: Iuone
filio Norberti, Tetbaldo filio Stephani,
etc.).
Hugues, fils
d’Hervé de Gallardon, il avait pour frères
Garin (Warinus), Gui (Wido) et
Miles ou Milon (Milo), ce dernier
archidiacre de l’église de Chartres
en 1100, et une sœur Haubour (Hildeburgis)
mariée à Robert d’Ivry (notice du
Liber Testamentorum, fol. XL, vers 1105, éditée
et annotée par Depoin, pp. 102-103).
A son départ il n’avait qu’une fille, Mahaut
(unica mea Mahildi) comme le dit sa charte que nous éditons
en Annexe 6i.
La
date du décès d’Hugues de Gallardon
n’est pas connue et plusieurs auteurs supposent qu’il
est mort vers 1101 en palestine, où il serait parti
avec Évrard du Puiset et Nivelon II de Fréteval
en 1096.
3)
Succession
Comme il ne laissait qu’une
fille, son frère Garin lui succéda.
Il avait épousé une certaine Maubelle,
qui après sa mort se remaria à Aimon
Roux d’Etampes, comme on le voit par une notice
du Liber Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs
consacrée à une donation de
son vassal Amaury de Mondonville (voyez ce nom).
Quand Garin mourut à
son tour sur la route de la Palestine, le troisième
de ces frères, Guy exerça sa tutelle sur
Hugues II, fils de Garin. Il paraît s’être alors
réservé la seigneurie d’Auneau, que
nous voyons à partir de 1139 entre les mains de son
propre fils Jocelin, neveu d’Hugues Ier et de Garin de Gallardon.
|
Hugues de Tracy (Hugo de Tracheto, B 35)
Hugues
de Tracy (voyez notre
article sur ce toponyme énigmatique)
est témoin à Chartres du consentement de Gautier
d’Aunay et de sa femme Milsent Cherf-de-Fer
à la donation par Hardouin de quatre famille de
collierts de Denonville (transaction 15).
Liste des témoins:
Yves fils d’Hébert; Robert Fléaud;
Garin de Bailleau; Hugues de Tracy; Gautier
de Saint-Germain; Hardouin d’Adonville; le frère
de Gautier d’Aunay, Arnoux.
|
Hugues II, vidame
de Chartres, fils
de Guerry, vidame de Chartres, et d’Helsent
(Hugo filius Guerrici, A 14; B 12)
Guerry était
le vidame de Chartres, dont la veuve Helsent et le fils
Hugues, lui-même vidame
consentent,
apparemment quelque part dans le pays chartrain, à
la donation par Gautier d’une partie
de Vierville qu’il tenait d’eux à fief (transaction
5).
(a)
Selon Lépinois, le vidame Guerry, fils de Hugues
I, est cité comme tel de 1079 à 1088, et Hugues
II est cité de 1089 à 1100 (Histoire de Chartres, t.II, p. 613); mais cet ouvrage et ancien et ces dates sont données
sans référence; nous avons vu au contraire
qu’une charte précisément datée
par Depoin de 1079 donne clairement à entendre que Guerry
était décédé dès 1079.
Voyez notre article Guerry.
(b)
Le Cartulaire de Saint-Père
de Chartres contient un petit dossier sur une donation
qui avait été faite par le vidame
Guerry avant sa mort, et qui avait été
ensuite confirmée par sa veuve Helsent et son
fils et successeur Hugues II, sauf pour une part qu’il
s’était appropriée; Helsent cependant reprend
cette part à son fils et la restitue aux moines
(éd. Guérard, pp. 561-562).
(c)
A une date située
entre 1102 et 1105, Hugues II, vidame de Chartres, renonce
à ses droits sur les hôtes de Saint-Martin
à Roinville, avec le consentement de sa mère
Helsent et de son frère Étienne et l’autorisation
du comte de Chartres Guillaume et de sa mère Adèle
(Depoin, Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs,
1912, pp. 43-44).
(d)
Le 23 février
1103 (ibid., p. 563) la vidamesse Helsent (Helisendis),
veuve du vidame Guerry (Guerrici vicedomini), et
de ses fils le vidame Hugues (Hugone videdomino)
et Étienne (Stephano) ainsi que de leur sœur
Elisabeth (Elisabeth) font une autre donation. On y retrouve
un témoin, Thibaud fils d’Étienne (Theobaldo
filio Stephani) qui est le même
que dans notre notice (Tetbaldus filius Stephani, A 16, B 12-13).
(e) Selon l’obituaire
de Saint-Jean-en-Vallée (éd. Molinier, Obituaires de
la province de Sens, t. II, p. 229), Guerry est mort un 24 avril.
(f) Voici ce qu’écrit Depoin
sur ce personnage: «Hugues
II, vidame de Chartres, fils de Guerri (cf. note
38) et d’Hélisende, est cité de 1104
(sic) à 1118. Son frère Etienne fut abbé
de St-Jean-en-Vallée et mourut en 1130. Isabeau
ou Elisabeth, leur sœur et héritière,
porta la vidamé de Chartres à son époux
Guillaume de Ferrières.»
(Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs
de 1912, p. 156, note 256).
Notre
notice est la première en date connue des mentions
de ce personnage, entre le moment où son père
meurt et celui où il accède à la majorité
légale.
|
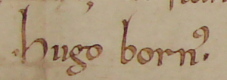 Hugues
Borgne (Hugo Bornus, A
20, B 15)
Hugues
Borgne (Hugo Bornus, A
20, B 15)
Hugues
le Borgne est à Étampes le sixième
ou septième des quatorze témoins
du consentement donné par Guillaume fils
de Bernoal à la donation de Vierville (transaction
6).
La Chronique
de Morigny connaît un
Herbertus Bornius (folio 63 r°)
qui lui est sans doute apparenté, et qui donne Bléville
(Belovilla) à cette abbaye
au tournant du XIe et du XIIe siècle,
à son heure dernière (ibid.,
folio 69r°). Il laisse une sœur dont le
mari Geffroy conteste la donation (ibid.,
folio 69 v°). Bléville se trouve dans
la commune de Césarville-Dossainville
(canton de Malesherbes, arrondissement de Pithiviers,
Loiret).
|
Hugues Chien (Hugo Canis,
B 27)
Hugues est
le huitième des neuf témoins,
à Auneau, du consentement donné par Hugues
de Gallardon aux donations faites par Gautier
d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée (transaction 11).
C’est sans doute un nobliau
du pays chartain, vassal ou arrière-vassal
d’Hugues de Gallardon.
Sur son nom, voyez
notre article Chien.
|
Hugues Malveil (Hugo Malueil,
B 33)
Cet Hugues, dont le surnom est sans doute, qui
semble être lui-même un chevalier du
pays chartrain, est témoin à Chuisnes
de la donation par Hardouin de quatre familles de
colliberts de Denonville (transaction 14).
Sur son surnom, voir
Malveil.
|
Hugues, minier (Hugo minerius,
plutôt que Minerius, B 10)
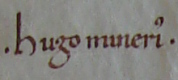 Cet Hugues
est le onzième des douze témoins à Étampes de la donation
d’Arnaud fils d’Aubrée
et du consentement de son frère Godéchal (transaction 3).
Cet Hugues
est le onzième des douze témoins à Étampes de la donation
d’Arnaud fils d’Aubrée
et du consentement de son frère Godéchal (transaction 3).
Je
considère non sans hésitation
que minier est ici, plutôt
qu’un anthroponyme, le nom commun rare d’un officier chargé à Étampes
du minage (minagium), c’est-à-dire
de la mesure du grain au moyen de la mine (mina)
et de la perception de le la redevance seigneuriale afférente
à cette mesure. Voyez notre article
Minier.
|
Jean fils de Payen (Iohannes filius
Pagani, B 10)
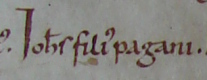 Ce Jean est simple témoin
de la deuxième donation d’Arnaud fils
d’Aubrée (transaction 6).
Ce Jean est simple témoin
de la deuxième donation d’Arnaud fils
d’Aubrée (transaction 6).
Il s’agit du fameux Jean
d’Étampes, qui a été
l’objet de plusieurs confusions dans certaines
chroniques médiévales puis
chez les généalogistes, qui aurait
vécu plus de trois siècles et aurait
été comte d’Étampes et gendre
de Louis VI: on a notamment confondu sa femme Eustachie,
fille de Ferry de Châtillon, avec une prétendue
fille de Philippe Ier homonyme qui n’a d’ailleurs
jamais existé. Nous avons consacré
une page à cette légende, déjà
dénoncée par Dom Fleureau,
mais que perpétuent encore quelques
généalogistes.
Il n’est pas impossible cependant
que son père Payen ait prétendu un
temps au titre de comte d’après
une charte de l’abbaye de Longpont (éd. Marion
CXCII, pp. 178-179) qui parle de Ferry fils de Payen
d’Étampes qui fut comte (Fredericus, filius
Pagani de Stampis, qui fuit comes).
Cependant Fleureau signale que Jean ne prend jamais ce titre
dans les chartes de sa femme Eustachie en faveur du monastère
d’Yerre).
(a)
Jean apparaît aussi notamment comme témoin
d’une charte étampoise de Philippe Ier
en 1106 (éd. Prou, p. 390, l. 15).
(b)
A la génération suivante, Suger,
dans son De administratione (chap.
14), fait allusion à une longue guerre privée
entre le noble et vaillant Jean d’Étampes
fils de Payen (Johannem Stampensem filium Pagani,
virum nobilem et strenuum) et un autre chevalier de Pithiviers
au sujet d’une terre de trois charrue située
à Guillerval, qu’il acquiert en payant la terre
aux deux compétiteurs. Le contrat est signé
par un allié de Jean, Baudouin de Corbeil (favore
parentum et amicorum, videlicet Balduini de Corboilo et multorum
aliorum).
(c)
Une charte de l’abbaye de Longpont, vers 1130,
(éd. Marion, Marion, n°CLXXXIII, p.
174) nous fait savoir que Jean (Johannis de Stampis)
a épousé Eustachie, fille de Ferry
de Châtillon (Eustachia Frederici filia
de Castellonio), veuve de Baudouin de Beauvais
(anteriori marito suo, Balduino scilicet de Belvaco)
qui avait déjà un fils de ce premier lit, Ferry
(Frederico).
(d) Une autre (éd. Marion
CLXXVIII, p.168) nous montre, vers 1140, Jean
(Domnus Johannes filius Pagani de Stampis)
avec sa femme (Eustachia), un des témoins
étant un Gautier d’Étampes (Galterius
de Stampis), le même que dans notre transaction 8 (B 19: Gaulterius de Stampis), un autre l’abbé Thomas de Morigny.
On ne saurait ici
relever toutes les mentions qui sont faites de ce Jean d’Étampes:
il y faudra une page spéciale.
|
Jean Veau (Iohannes Vitulus,
B 27)
Ce Jean est le cinquième des neuf témoins,
à Auneau, du consentement donné par
Hugues de Gallardon aux donations faites
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée (transaction
11).
(a) Le même
Jean Veau (Iohannes Vitulus) apparaît ailleurs comme témoin
d’une donation d’Hugues de Gallardon lui-même, avec Robert Breton,
comme ici (voyez l’Annexe 6i).
(b) C’est
sans doute un nobliau du pays chartain, vassal
ou arrière-vassal d’Hugues de Gallardon. De
fait nous trouvons vers 1168 un Raoul
Veau (Radulfus Vitulus) témoin
d’une charte du neveu d’Hugues de Gallardon, Jocelin d’Auneau,
Joscelinus de Alneolo (Cartulaire
des Vaux-de-Cernay, t. I, p. 49), et à nouveau
entre 1176 et 1180 (ibid. p. 64 bis).
Sur
son nom, voyez notre article Veau.
|
Jocelyn, père de Raoul
de Denonville (Gauscelinus,
B 30)
Jocelyn
est mentionné comme le père
apparemment décédé d’un certain
Raoul, de Denonville, premier témoin cité,
en un lieu indéterminé, du consentement
d’Anseau Robert fils
de Béguin et sa mère Eudeline à
la donation opérée par Godéchal et Amaury Roux
d’Ably (transaction 13).
|
Lisiard d’Étampes
(Lisiardus de Stampis, A 24,
B 16)
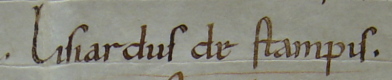 Lisiard
d’Étampes
est témoin de la première
donation de Godéchal fils d’Oury de Vierville
de la première donation de Godéchal
(transaction 7).
Lisiard
d’Étampes
est témoin de la première
donation de Godéchal fils d’Oury de Vierville
de la première donation de Godéchal
(transaction 7).
Voici la liste des témoins:
Thion Chef-de-Fer;
Gaudin fils d’Ansoué de Méréville;
Lisiard d’Étampes; Robert
fils d’Airaud; Hébert de Denonville.
(a)
Il est probable qu’il s’agit du fils de Bernoal
de la Ferté et de Mahaut qui nous est connu
par la Chronique de Morigny comme continuant
les bienfaits de ses parents: ils avaient
donné aux moines l’église de Guigneville;
après la mort de Bernoal, Mahaud donne encore
un encensoir et un calice d’argent doré, et Lisiard
le grand vitrail du chevet de l’église (éd.
Mirot, pp. 3-4: Ecclesiam de Guinevilla dedit
nobis Bernodalius nobilissimus de Firmitate, et uxor ejus
Mathildis, quae nobis fecit thuribulum argenteum magnum, et
calicem similiter argenteum deauratum, quae et prima ecclesiae
fundamina jecit, et in aliquantam altitudinem eduxit, et Lisiardus
Flandrensis filius eorum, qui nobis vitream majorem in capitio
fecit).
(b) On notera que la Chronique
surnomme Lisiard Flandrensis.
Ce surnom Flamand
(ancien français Flamengel
ou analogue) se retrouve curieusement vers la même
époque pour un évêque d’Orléans
(charte de Philippe Ier, éd. Prou, p. 256, l.
1: Raynerius Flandrensis
episc. Aurel.)
Lisiard
signe en 1106 à Melun une charte de Louis VI
(roi associé à son père) en faveur
de Saint-Benoît-sur-Loire (éd. Prou et Vidier,
p. 253-255); voici la liste des signataires après
Louis, où presque tous paraissent étampois,
curieusement, au point qu’on peut se demander
si en fait la charte n’a pas été terminée
contresignée à Étampes:
Signum Guidonis comitis de Rocaforti. Signum Galterii
Tiraldi. Signum Ursionis de Stampis. Signum Erluini. Signum
Lisiardi de Stampis. Signum domni Simonis abbatis Floriacensis.
Signum Gisleberti majoris ville. Signum Aimonis de Stampis.
Signum Arnulfi Bassi. Signum Gisleberti mariscalci. Signum
Rainaldi captivi.
(c) Dans un diplôme de
Philippe Ier donné à Poissy en 1071, par
lequel il donne à Saint-Benoît-sur-Loire
l’église du Petit-Saint-Mars d’Étampes
(éd. Prou, pp. 144-145, cf. p. CXLVI), nous
voyons que le tout dernier signataire est un certain
chambrier Lisiard (Lisias camerarius). Comme on a
plus haut la signature du chancelier Galeran, Prou, qui
fait observer qu’on ne possède qu’une
copie de ce texte, suppose qu’il s’agit d’un
subordonné de ce Galeran. Mais il faut
observer que la signature de Lisias vient après celle
d’un comte Hugues que Prou ne s’est
pas aventuré à identifier ($ Hugo
comes. $ Lisias camerarii); il ne s’agit pas en effet
du frère du roi qui signe plus haut. Comme par ailleurs
ce diplôme pose problème, parce qu’il n’a jamais
été suivi d’effet à notre connaissance,
et qu’on sait qu’il y a eu de vaines contestations des moines
de Saint-Benoît relativement à la donation de
Saint-Martin d’Étampes à ceux de Morigny, faisant
état d’une donation antérieure en leur faveur,
on peut se demander si notre texte n’est pas un faux, ou un grossier
remaniement d’un diplôme d’Hugues Blavons, qui aurait
pris un temps le titre de comte,
et dont Lisiard aurait été le chambrier. Ce ne
sont là évidemment que des hypothèses.
On a une autre trace de prétention au titre de comte,
de la part de Payen fils d’Anseau, dans une charte
du Cartulaire de Longpont,
datée des environs de 1120 (éd. Marion CXCII, pp. 178-179), puisqu’elle
nous parle d’un certain Ferry fils de Payen
d’Étampes qui fut comte (Fredericus, filius
Pagani de Stampis, qui fuit comes).
(d)
Un Guillaume Lisiard apparemment étampois
est aussi cité en 1169 comme l’auteur d’une ancienne donation près
de Mérobes (à Audeville dans le
Loiret), par une charte de l’évêque d’Orléans Manassé
de Garlande, éditée par Fleureau
(Antiquités, pp. 457-459) et dont
j’ai mis en ligne une traduction: feodos nostros in prædicta
villa..., videlicet villam de
Mesrobrai, & eleemosinam Guillelmi
Lisardi, & Milonis de Stampis veteribus.
|
Malveil (Malueil, B 33), patronyme
ou surnom porté
par un certain Hugues.
Ce
surnom ou patronyme représente sans
doute un sobriquet signifiant Celui
qui veille mal, analogue au sobriquet,
représenté en 1082, dans une charte
étampoise de Philippe Ier en faveur de Notre-Dame,
Trop-il-dort (Tropodormit),
acquis par un chevalier qu’on aura surpris
à dormir pendant son tour de garde.
Il est porté par
un certain Hugues qui semble être un chevalier du pays chartrain,
témoin à Chuisnes de la donation
par Hardouin de quatre familles de colliberts de
Denonville (transaction 14).
|
Maréchal
(Marescalcus, A 16, Mariscalis, B 13) surnom
ou patronyme
Maréchal est le surnom ou patronyme
d’un certain Girard Maréchal est cité
ici comme le père d’un certain Payen, Paganus filius Girardi Mariscalci, lui même témoin, quelque part
dans le pays chartrain, avec d’autres chevaliers
chartrains, du consentement donné par
Hugues fils de Guerry et
sa mère Helsent à la donation par Gautier
de la part de Vierville qu’il tenait d’eux en fief
(transaction 5).
Il s’agit selon tout
apparence, d’après le contexte, d’un patronyme
de chevaliers chartrains (qui n’était pas
forcément tiré d’un nom commun car Maréchal
a pu représenter un anthroponyme en lui-même,
comme Godéchal et Ménéchal).
(a) Un Geoffroy Maréchal apparaît comme
témoin d’une donation
(b) A titre de comparaison,
voici un personnage qu’on trouve à Étampes
vers 1090 et qui est lui est bien maréchal
d’après le contexte, qui le cite entre un monnayeur
et un serf: Gaufredus, monetarius;
Willelmus, marescaudus; Raimbaldus famulus (Cartulaire
de Longpont, éd. Marion, n°CIX,
p. 134).
(c) D’autres contexte sont moins clairs, comme dans
le cas de ce Geoffroy Maréchal ou maréchal Geoffroy témoin
d’une donation d’Hugues de Gallardon (voyez notre Annexe
6i), cité avant un cuisinier mais aussi avant les frères
d’Hugues (Guarinus clericus, canonicus sancte Marie; Gaufridus mariscalcus;
Hugo Fulcoini; Albericus coquus; Ansoldus de Mengervilla; Guido et Milo
fratres mei; etc).
(d) Même problème
dans une autre donation citée par la même charte, ou il s’agit
de témoins des moines de Bonneval: Guido de Barzileriis. Hugo
filius Fulchoini. Isembardus Mariscalcus. Teudo de Nemore. Albericus quoquus.
Gaufredus Mariscalcus. Willelmi filii Rotaldi.
|
Marin prévôt d’Auneau
(Marinus prepositus de Alneello,
B 26-27)
Marin est témoin à
Auneau du consentement donné par
Hugues de Gallardon aux donations faites
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal
d’Étampes et Arnaud fils d’Aubrée
(transaction 5).
(a) Il semble s’agir d’après le contexte
non pas d’un prévôt laïc de la ville d’Auneau
mais d’un moine, officier ecclésiastique du prieuré
d’Auneau (cf. Guérard, Cartulaire de
Saint-Père, pp. LXXXIV-LXXXV), comme dans le cas
de Hardouin, prévôt du prieuré de Chartres.
(b) Cependant lorsque ce personnage apparaît
ailleurs comme témoin de deux donations d’Hugues de Gallardon aux
moines d’Auneau (enregistrées par la charte de ce personnage que
nous donnons en Annexe 6i), sous la dénomination:
Marinus prefectus, il semble bien être un laïc
au service d’Hugues et n’est pas rangé parmi les témoins
des moines. La première fois est cité juste après
lui Hardouin Chef-de-Fer, sous la dénomination Hardouin de Denonville
(Marinus prefectus. Harduinus de Danovilla).
|
Martin (Saint) (beato
Martino Maioris Monasterii,
A 1-2; B titre, 1, 15, 24, 28,
sancto Martino
Maioris Monasterii, D 34,
beato
Martino, B 13, 20, 29, 31, sancto Martino, A
23, C 26, predicto sancto, B 25, eidem sancto, B 17,
sancto,
B 2, 3, 6)
Cet anthroponyme
n’est pas autrement représenté
dans nos notices.
|
Mérier (Mereruilla, A 24, B 17, 28, Merer Villa, B 16), personnage qui semble avoir
donné son nom à Méréville.
A l’époque
de notre charte, le nom du personnage qui a
donné son nom à Méréville
est devenu méconnaissable et l’on
prononce Mérerville sans reconstituer
de génitif de l’anthroponyme, probablement
sorti de l’usage. Cet anthropomyne est sans doute cependant
Mérier (qui a survécu
comme patronyme) et qui dérive selon toute
apparence d’un anthroponyme germanique rare
Mar-hari (latin théorique
Marharius, Mararius).
|
Milsent (Milesindis,
A 1, 8, 9, 11, 14, texte corrigé ultérieurement
dans les quatre derniers cas en
Milesendis, Milesendis, B 5, 11,
uxor eius Milesendis, B 1, uxor eius, Milesendis predictę Hersendis filia, sororque prefati
Harduini,
B 34), femme de Gautier
d’Aunay, sœur de Hardouin Chef-de-Fer,
fille d’Hersent et de Thion Chef-de-Fer.
Milsent, fille de Thion Chef-de-Fer
et d’Hersent, sœur de Hardouin Chef-de-Fer, réside
à Saint-Avit-les-Guespières avec
son époux Gautier d’Aunay.
1) Elle donne Vierville aux
moines de Marmoutier en accomplissant chez elle
à Saint-Avit le rite d’investiture avec un bâton
(per baculum) qu’elle donne à un serf
des moines censé représenter le prieur
de Marmoutier, Robert
de Vierzon (transaction 2).
2) Plus tard, à Chartres, elle donne
avec son mari son consentement à la donation
par son frère Hardouin de quatre familles de
colliberts de Denonville (transaction 15).
|
Milon
fils de Boson (Milo Bosonis filius, C 28)
Milon fils de Boson est
le cinquième des
dix témoins, quelque part dans le pays chartrain,
de la donation par Rainaud fils de Thiou
de la terre de Lomlu (transaction
16).
C’est d’après le contexte
apparemment un chevalier: le prêtre Aubry; Guy fils de Serlon;
Airaud de Dourdan; Hongier de Villeau; Milon
fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron Gautier; le
meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert fils
de Bouchard.
|
?
Minier ? (Minerius
ou minerius B 10) qualification d’un certain Hugues
à Étampes
C’est ainsi qu’est titré
un certain Hugues, onzième
des douze témoins à
Étampes de la donation d’Arnaud fils d’Aubrée et du consentement
de son frère Godéchal (transaction
3).
Faut-il considérer ce mot, minerius,
comme un nom propre, surnom ou patronyme
à Étampes d’un Hugues Minier, ou bien comme le titre
d’un officier, le minier Hugues?
Le contexte ou apparaît ce personnage
permet de supposer qu’il n’est pas forcément
chevalier comme ceux qui le précèdent
dans la liste (le seul qui le suive, Hébert
de Denonville, est en fin de liste, systématiquement
dans les listes où il apparaît
et doit être une sorte de notaire).
Par ailleurs,
à moins de corriger arbitraiement en Menerius,
et bien qu’il existe un saint Minère
(Minerius) honoré comme un martyr
à Noyon en Suisse, cet anthroponyme
paraît bien isolé et problématique. Il
n’est attesté ni par le Cartulaire de Saint-Père
ni par aucune charte de Philippe Ier.
C’est pour quoi j’ai tendence
à y voir plutôt le titre d’un officier
chargé à Étampes du minage (minagium),
c’est-à-dire de la mesure du grain au moyen
de la mine (mina) et de la perception de le la
redevance seigneuriale afférente à cette mesure.
Et ce bien que les dictionnaires en usage (de Blaise comme
de Niermeyer) n’accordent pas ce sens au mot minerius,
minarius, auquel il ne donnent que les
suivants: gardeur d’animaux (de menare,
mener), ou bien mineur, sapeur (de minare, miner).
|
Nivelon II fils de Foucher
Ier de Fréteval (Niuelo filius
Fulcherii, B 25)
Nivelon fils
de Foucher est témoin, dans la grange de Boisville-la-Saint-Père, du consentement donné par Payen d’Étampes (représenté par Anseau fils d’Arembert)
à la donation de Gautier d’Aunay, en présence d’Hugues du Puiset et de
son beau-frère le vicomte Hugues de Châteaudun (transaction 10).
(a) Ce personnage est assez
bien connu depuis que Charles Métais a rassemblé de nombreuses
données sur lui en introduction à
son édition du cartulaire de Marmoutier pour
le pays de Blois. Nous savons par exemple que sa sœur,
épouse d’Huhugues de Châteaudun, s’appelait
Agnès et
qu’elle était surnommée Comtesse.
(b)
Mais le plus important pour ce qui nous occupe est
que Nivelon II est parti en croisade en 1096 et qu’il
n’est revenu au pays qu’à une date compris entre 1108
et 1114. C’est donc avant son départ qu’il assiste
à la transaction 10, et c’est donc en présence
d’Hugues Ier du Puiset, dit Blavons. Par ricochet, comme
ce dernier et mort en soit en 1096 ou peu après, notre
transaction est antérieure à 1096.
(c) Nivelon sera encore témoin
à Étampes en 1111, en compagnie cette
fois de son fils Ours (Nevelo, Ursio filius ipsius)
d’une libéralité de Louis VI qui cède
à l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée
son brenage à Manterville, dans le même secteur
(Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°13, p. 9).
Charles MÉTAIS, «Nivelon
II, troisième seigneur de Fréteval»», in ID., «Notes généalogiques
sur les seigneurs de Fréteval»,
in ID., Marmoutier. Cartulaire
blésois [CXLIII+540 p.], Blois, E. Moreau
et Cie, 1889-1891», pp. XXXVIII-XLIX.
|
Norbert, père d’Yves
(Norbertus A 15, B 12)
Norbert
est le père apparemment défunt
d’un chevalier Yves (Iuo filius Norberti) cité
en tête des témoins
du consentement donné par
Hugues fils de Guerry
et sa mère Helsent à la
donation de Gautier d’Aunay, en un lieu indéterminé
du pays chartrain. Voici la liste des
témoins: «Yves fils de Norbert; Thibaud fils d’Étienne:
Payen fils de Girard maréchal;
Garin fils d’Amaury Bisen: Aubert fils
d’Aubert d’Ormoy» (transaction 15).
(a) Le Cartulaire
de Saint-Père de Chartres (p.422,
cf. p. CCCL) enregistre la donation d’une terre par
le même Yves fils de Norbert donne à ce monastère
une terre entre 1069 et 1100 (De terra apud Alonas
ab Ivone, filio Norberti, data).
|
Obert d’Étampes
(Obertus de Stampis, B
23)
Cet anthroponyme représenté
trois ou quatre fois dans les
chartes conservées de Philippe
Ier sous les fomes Obertus, Osbertus,
Otbertus, doit
sans doute être distingué d’Aubert,
qui vient d’Adalbertus, via Albertus.
Obert
d’Étampes est témoin
à Étampes du don qu’y fait Amaury
Roux d’Ablis de deux tenures à Vierville.
Voici la liste des témoins: Arnaud fils d’Aubrée; Christophe Roi;
Obert d’Étampes (Obertus
de Stampis); le chanoine Gibert (Girbertus
canonicus); Guillaume des
Vieilles Étampes; Robert du Cimetière;
Baudry du Fossé; Hébert
de Denonville (D 23).
Comme on voit
que l’auteur de la notice distingue bien Étampes des Vieilles Étampes, c’est-à-dire
de Saint-Martin d’Étampes,
on est fondé à supposer
qu’Obert est au moins apparenté à
un chanoine de Notre-Dame, et que c’est le
même que mentionne la charte de 1082, où
on trouve bien un Otbertus parmi
les chanoines de Notre-Dame.
|
Osmond de Gallardon
(Osmundis de Gualardone,
B 27)
Cet Osmond est le dernier des neuf témoins,
à Auneau, du consentement donné par
Hugues de Gallardon aux donations faites
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal
d’Étampes et Arnaud fils d’Aubrée
(transaction 11).
(a) De fait nous trouvons ailleurs, témoin
de trois donations successive d’Hugues de Gallardon lui-même, un
certain Osmond d’Auneau (Osmundus de Alneel), aussi appelé le chevalier Osmond (Osmundus miles)
à côté de deux témoins de l’entourage d’Hugues
que nous retrouvons également ici: Jean Veau et Robert Breton (Voyez
notre Annexe 6i).
C’est donc un chevalier
possessionné à Gallardon et/ou ou Auneau. Est-il de la famille même d’Hugues
de Gallardon? Il a peut-être été
d’abord oublié du fait de sa jeunesse, et ajouté
ensuite, comme dans le cas de la première
rédaction de la liste des témoins étampoise
du consentement de Guillaume, où pour le
frère d’Airaud, Éblon, remis en début
de liste avec son frère lors de la deuxième
rédaction. |
Oury de Vierville
(Hulricus de Veruilla, A 23, Vlricus, B 14, 23, 26)
Oury de Vierville est le père défunt
de Godéchal (Godescalis filius Hulrici de Veruilla,
A 22-23, Godiscalis
filius Vlrici, B 15, 24, 27a). La deuxième
rédaction ne reprend pas la qualification
de Vierville, que faut-il en penser?
Godéchal est
qualifié d’une part fils d’Oury de Vierville,
et d’autre part le frère d’Arnaud fils d’Aubrée,
ce qui semble signifier qu’il ne partagent qu’un
seul parent, qui semble être Oury de Vierville,
puisqu’ils sont tous les deux possessionnés
à Vierville.
(a) Nous connaissons par
ailleurs un autre fils d’Aubrée appelé Ours.
La
Chronique de Morigny rapporte
que les fils d’Aubrée Ours et Arnaud
(filii Alberee Urso et Arnaldus) ont
donné aux moines de Morigny
chacun le sixième de l’église de
Saint-Germain qu’ils détenaient (f°63).
On notera que le premier sixième en fut donné par Anseau
fils d’Arembert (noster Ansellus), selon
la même Chronique de Morigny (f°63), personnage
qui intervient aussi pour représenter Payen fils d’Anseau lors
de notre transaction 10.
Il semble donc qu’Oury, veuf et père de Godéchal,
avait épousé Aubrée, veuve et mère
d’Ours, et qu’ils avaient eu ensemble pour fils Arnaud. On peut
légitimement se demander si le premier mari d’Aubrée
n’avait pas été Thion II d’Étampes, fils d’Ours
I et père d’Ours II, dit aussi Ours de Pierrefitte.
On notera que la donation que font
ses deux fils de leurs biens de Vierville nécessite
le consentement de Payen fils d’Anseau (transaction
10), ce qui peut laisser supposer qu’Oury les tenait
lui-même à fief de ce dernier, ou du
père de Payen, à savoir d’Anseau.
|
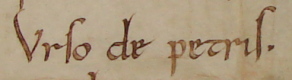 Ours
de Pierrefitte (Vrso de Petris, A
20, B 14)
Ours
de Pierrefitte (Vrso de Petris, A
20, B 14)
Le
texte porte seulement Ours des Pierres,
mais il s’agit presque certainement du
lieu-dit qui s’appelle aujourd’hui Pierrefitte,
où sous l’Ancien Régime encore
on conservait plusieurs dolmens, dont il ne reste qu’un
seul aujourd’hui. Inversement la commune chartraine de Pierres
s’est parfois appelée Pierrefitte.
Ours des Pierres fait partie des plus
hauts personnages du pays d’Étampes témoins
du consentement de Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
à la donation de Gautier d’Aunay
(transaction 6).
Voici la liste des témoins:
Airaud, oncle paternel du
dit Guillaume; l’abbé de Notre-Dame
d’Étampes Bernoal; son frère
Aubert: Geoffroy de Baudreville; Aubert fils
d’Aimelin; Hugues Borgne; Ours de Pierrefitte;
le jeune clerc Bernard; le clerc de Saint-Cyr,
Geoffroy; Arnaud fils de Baudouin; Harpin de l’Étampois;
Pierre fils de Gerbert Barbu; Éblon
frère d’Airaud; le moine Thion
Chef-de-Fer.
L’identité de cet Ours est problématique.
(a) Nous entendons parler
par ailleurs à Étampes, vers la même époque,
d’un Ours II (mentionné en 1096) fils de Thion II (mentionné
de 1064 à 1082) fils de Ours I (mort avant 1064) fils de Thion
I (entre 1008 et 1046). Voyez à cet égard
notre édition
de la Charte donnée par Henri Ier en 1046.
(b) Nous entendons parler aussi
par la Chronique de Morigny d’un Ours frère
d’Arnaud et fils comme lui d’Aubrée. Mais il n’est pas
impossible que cet Ours fils d’Aubrée, inconnu par ailleurs,
ne soit qu’un frère utérin d’Arnaud et que son père
ait été Thion II. La Chronique de Morigny peut très bien de son côté ne l’avoir désigné
comme fils d’Aubray que parce que c’est à ce titre qu’il partageait
avec son frère utérin Arnaud des droits sur le bien
qui fait l’objet de la donation qu’elle relate. En ce cas nous n’aurions
ici qu’un seul et même personnage, sous trois dénomination:
Ours de Pierrefitte, Ours fils de Thion, Ours fils d’Aubrée.
|
Payen
fils d’Anseau (Paganus filius Anselli,
B 8, 23; Pagani,
B 10)
1)
C’est de Payen fils d’Anseau qu’Arnaud fils d’Aubrée
tenait en fief deux
tiers du fermage de Vierville, qu’il donne aux
moines (transaction 3).
2) Jean fils de Payen
est témoin à Étampes de la donation
qu’en fait Arnaud, et du consentement de son frère
Godéchal (transaction 3).
3) C’est de Payen aussi que
Godéchal tient le troisième tiers du fermage de
Vierville (transaction 7 et transaction 10).
4) Le consentement de Payen
a cette double donation est donné officiellement
à la grange de Boisville-Saint-Père,
en présence d’Hugues du Puiset; mais Payen n’a
pas fait le déplacement et s’est fait représenter
par Anseau fils d’Arembert, qui donne son gant en
signe d’investiture (transaction 10).
Nous
ne donnerons pas ici tout ce que nous savons sur
ce personnage important pour l’histoire du pays
d’Étampes. Il y faudrait une page entière,
que nous donnerons ultérieurement.
Notons ici seulement ceci:
(a) Il est témoin à Bourges
d’une charte de Philippe Ier vers 1102 (éd. Prou, p. 372, l. 4: Paganus
de Stampis, et note 1 p. 368).
(b) Il est encore cité en 1106
dans une charte de Philippe Ier datée de Poissy
adressé aux principaux nobles d’Étampes,
dont il fait partie avec son fils Jean:
à Marc, à son fils Hervé,
à Ours, à Aimon, à Payen fils d’Anseau,
à son fils Jean, à Aubert, frère du
même Payen, à son fils Mainier.
Ce passage important est mieux
édité par Dom Basile Fleureau
que par Maurice Prou (éd. Fleureau, p. 483;
éd. Menault, p. 41; éd. Prou, p. 390,
ll. 14-15; cf. Depoin, La
Chevalerie étampoise, p. 75: au lieu de: «Haimoni
Pagani Anselli filio»; il faut lire: «Haimoni;
Pagano Anselli filio…»); on remarquera à
ce sujet que Fleureau injustement négligé,
porte le bon texte conjecturé indépendamment
de lui par Joseph Depoin.
(c) Il est cité dans des diplômes
donnés par Louis VI à Étampes
en 1112 et 1113 (cf. Luchaire, Louis VI
le Gros, n° 144 et n°161) que nous éditerons
ultérieurement en ligne.
(c) Notons aussi une
charte du Cartulaire de Longpont,
daté des environs de 1120, qui pourrait relancer
le débat sur le titre de Comte d’Étampes,
refusé par Dom Basile Fleureau à son
fils Jean d’Étampes comme non documenté
jusqu’à présent, et apparemment inventé
par l’historien Belleforest. Cette charte (éd. Marion CXCII, pp. 178-179) semble garder
la trace que Payen a prétendu au moins un temps
au titre de comte, puisqu’elle nous parle d’un certain Ferry fils de Payen d’Étampes qui fut comte
(Fredericus, filius Pagani de Stampis, qui fuit comes). Cependant Fleureau signale que Jean ne prend jamais ce titre
dans les chartes de sa femme Eustachie en faveur du monastère
d’Yerre). Mais Payen? Le débat est ouvert. Il y a
pu y prétendre un temps, à la fin du règne
de Philippe Ier, particulièrement catastrophique
pour l’autorité royale.
(d) Il
est cité (comme fils d’Anseaume, notez bien, Anselmi),
dans une charte de l’abbé Thomas de Morigny
des environs de 1123, conservée par le Cartulaire
de Saint-Jean-en-Vallée (n°31 p.18),
avec ses fils Jean, Anseau, Geoffroy et Ferry, comme
autorisant une donation par un de leurs vassaux de Manterville
(Pagano Anselmi filio... S. Pagani filii
Anselmi. S. Johannis filii ejus, S. Anselmi filii ejus,
S. Gaufridi filii ejus, S. Frerisi filii ejus). Tout le
dossier de Manterville conservé par ce Cartulaire
mentionne à plusieurs reprises les descendants de Payen.
(e) Il est encore cité par trois autres
chartes du Cartulaire de Longpont, qui nous apprennent qu’il s’appelait
en réalité Isembard. La première est datée
par Marion des environs de 1100 (n°CCLXXXIII,
pp. 229-230), et Payen y est témoin du côté des moines
de Longpont: Isembardus filius Anselli de Stampis qui vocatur
Paganus.
La deuxième n’est pas datée (n°CCXLIII, pp. 206-207), et cite comme témoin le même
Isembardus cognomento Paganus filius Anselli.
La troisième
est datée sans doute par erreur des environs de 1130 par Marion
(n°CLXXX, pp. 170-172): Isembardus cognomento Paganus filius Anselli
de Stampis... domnus Paganus qui et Isembardus... supradictus Isembardus...
Isembardus cognomento Paganus filius Anselli de Stampis...
Isembardus de Stampis qui Paganus dicitur....
Cette même charte nous apprend que Payen
avait épousé Alais, sœur d’un certain Ferry fils de Gaudry,
possessionné à Bondoufle (Aaliz soror ejusdem sepedicti
Frederici, uxor videlicet supradicti Isembardi). La mère de
ce Ferry est une certaine Arembour (Aremburgis). Les autres frères
et sœur mentionnés de ce Ferry sont Geoffroy
(Gaufredus), Bégon (Bego), Gautier Tyreau (Gauterius
Tyrellus) et Mahaut (Mathildis).
La date de
1130 environ donnée par Marion pour cette charte repose apparemment
sur la mention du prieur de Longpont Henri. Mais il mentionne dans son
catalogue des prieurs de Longpont les dates avérées suivantes:
Eude I de Péronne, 1076; Henry, 1086 et 1125; Landry, 1136. Cette
datate de 1130 est certainement fausse, et de beaucoup.
Sson
père Anseau était selon toute apparence fils de Jocelin
II de Lèves. Voyez notre article Anseau.
|
Payen fils de Girard Maréchal
(Paganus
filius Girardi Marescalci, A
16, Paganus filius
Girardi Mariscalis, B 13)
Payen fils de Girard Maréchal est le troisième des cinq
témoins du consentement donné,
quelque part dans le pays chartrain, à la donation
de Vierville par le vidame de Chartres Hugues
fils de Guerry et sa mère Helsent
(transaction 5).
C’est sans doute l’un des
vassaux du vidame. Voici la liste: Yves fils de Norbert;
Thibaud fils d’Étienne: Payen fils
de Girard Maréchal; Garin fils d’Amaury
Bisen: Aubert fils d’Aubert d’Ormoy.
|
Payen fils d’Hardouin
(Paganus filius Harduini,
B 1)
Hardouin fils d’Hardouin est le huitième
des douze témoins, à Étampes,
de la donation d’Arnaud fils d’Aubrée
(transaction 3).
C’est semble-t-il un nobliau
étampois.
|
Pierre fils d’Érard
(Petrus filius Erardi,
B 10-11)
Pierre fils d’Airard est témoin à Étampes de la
donation d’Arnaud fils d’Aubrée et du
consentement de son frère Godéchal fils
d’Oury de Vierville (transaction 3).
(a) Il nous est aussi connu
par deux chartes étampoises de Philippe
Ier, l’une de 1082 en faveur de Notre-Dame d’Étampes,
qui nous fait connaître son frère cadet
Hugues (p. 276, l.11: Petrus Airardi filius et Hugo
frater ejus); l’autre en
faveur du maire de Chalo-Saint-Mard, non datée
précisément, la date de 1085 apparaissant
seulement dans une interpolation du XIIIe siècle
(éd. Prou,
p. 425, l. 4: Petrus
filius Erardi
1082).
(b) Une charte de Guy le Large de Pithiviers,
datée de 1070 environ, nous fait connaître
encore un autre frère de Pierre appelé
Thibaud peut-être décédé
entre-temps. Elle porte la signature d’un Pierre d’Étampes,
qui fut avec Thibaud, fils d’Airard (Bruel, Chartes de
Cluny, tome IV, n°3438: S. Petri de Stampis, qui fuit cum Tetbaldo
filii Arardi). On notera que Depoin, généralement
très fiable porte par erreur Airaud au lieu d’Airard dans une note
de son édition du Liber Testamentorum,
note 255, Araudi pour Arardi).
On est donc fondé
à croire qu’Airard d’Étampes
a eu au moins trois fils, Thibaud, sans doute mort
jeune, Pierre, aîné des survivant à
l’époque de notre notice, et Hugues.
|
Pierre fils d’Hébert
Barbu (Petrus filius Gerberti Barbati,
A 21, Petrus filius Herberti Barbati,
B 15)
Ce personnage dont le nom du père
précis est incertain (première rédaction, A 20:
Petrus filius Gerberti Barbati; deuxième
rédaction, B 15: Petrus
filius erberti
Barbati) est donné
pour témoin semble-t-il étampois
de la donation d’Amaury Roux et du consentement
d’Aubert fils d’Anseau à cette donation (transaction
9).
|
Pierre frère de
Rainaud (Petrus frater eius, C 25,
Petrus frater
germanus, C 30),
et donc sans doute comme lui fils de Thiou.
Frère germain, c’est-à-dire
de père et de mère, de Rainaud,
il est donc fils de Thiou et d’Ermentrude,
et frère d’Arembour, Rosceline
et Asceline. Il consent à la donation
de la terre de Lomlu opérée par son frère
Rainaud (transaction 16).
Il reçoit ensuite pour cela cinq
sous (transaction 17).
|
Rahier Ier de Mondonville,
père d’Amaury (Raherius, B 26)
Ce Rahier est Rahier Ier de Mondonville,
père apparemment décédé
de l’Amaury de Mondonville
qui est témoin à
Auneau du consentement donné par
Hugues de Gallardon aux donations faites par Gautier
d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée (transaction 10).
(a) Il est aussi mentionné (Raherius), en tant que
père d’Amaury, par la notice n°80 du Liber
Testamentorum de l’abbaye
parisienne de Saint-Martin-des-Champs.
(b) La même
notice nous apprend que le fils aîné
d’Amaury s’appelle aussi Rahier (Raherius), selon l’usage onomastique
du temps: Amalricus filius Raherii, assensu uxoris
sue Richildis et filiorum suorum Raherii et Joscelini.
(c) Il s’agit d’une
donation autorisée par Garin de Gallardon, qui succéda
à son frère aîné, l’Hugues de
Gallardon de notre transaction 10: d’où il s’ensuit que
les sires de Mondonville étaient bien vassaux de ceux de
Gallardon, dès l’époque de Rahier Ier vraisemblablement.
|
Rahier, meunier (Raherius molendinarius,
C 28-29)
Le meunier Rahier est cité,
dans un lieu indéterminé, peut-être
à Vierville même ou à Léthuin,
comme huitième témoin
de la donation par
Rainaud fils de Thiou de la terre de Lomlu (transaction
16).
Il est cité après
le forgeron. Voici la liste, instructive
dans une société aussi hiérarchisée:
le prêtre Aubry;
Guy fils de Serlon; Airaud de Dourdan;
Hongier de Villeau; Milon fils de Boson; Aubert
Vaslin; le forgeron Gautier; le meunier Rahier;
Robert fils de Grimaud; Aubert fils de Bouchard (C
27-29).
L’étude des autres
chartes du secteur permettra peut-être
de le localiser.
|
Rainard Farinard (Rainardus Farinardus,
B 28)
Rainard Farinard est le deuxième
des huit témoins, apparemment dans le secteur
de Méréville du consentement donné
par Arembour, épouse du susdit
Godéchal fils d’Oury de Vierville et leur
fils Eudes à la donation du défunt (transaction
12)
Voici la liste des témoins:
Gaudin fils d’Ansoué de
Méréville; Rainard Farinard; Baudry
du Fossé; Hardouin prieur d’Épernon
et son serf Ermengise; Geoffroy de Moret;
Eudes de Pannecières; Rainaud d’Aunay.
(a)
Il s’agit peut-être du
Rainard fils Hermer qui est témoin
avec Geoffroy de Moret, apparemment à
Étampes et vers 1090, d’une donation d’Hugues
de Champigny enregistrée par le
Cartulaire de Longpont (éd. Marion,
n°CIX, pp. 133-134). Voici les témoins d’alors:
Marcus, filius Roscelini; Ansellus de Alvers;
Arnulfus Basseth; ex parte sancte Marie: Ursus Dives,
de Stampis; Aymo, frater ejus; Johannes, filius Anselli
cognomento Pagani; Gaufredus de Moreto;
Wlgrinus, filius Gunhardi; Reinardus,
filius Hermeri; Gaufredus, monetarius; Willelmus,
marescaudus; Raimbaldus, famulus; Teulfus, famulus.
|
Rainaud fils de Thiou
(Rainaldus Teuldi filius,
B 10, Rainaldus Tetulfi filius,
C 25, Rainaldus,
C 30)
C’est
apparemment un chevalier étampois, fils
de Thiou et d’Ermentrud, frère de Pierre, Arembour, Rosceline et Asceline (C 25-27). Il a d’autres parents dont
un certain Faucon.
1) Hardouin
fils d’Hardouin est le neuvième des
douze témoins, à Étampes, de la
donation d’Arnaud fils d’Aubrée (transaction
3).
2) Il donne plus tard lui-même
aux moines de Marmoutier, alors qu’il se trouve
alors semble-t-il en pays chartrain, la terre de
Lomlu, avec l’accord de sa mère,
de ses frères et sœurs (transaction 16).
3) Il reçoit
alors avec sa parentèle vingt-cinq
sous; Pierre reçoit cinq sous; Faucon,
une épée et une place à
Marmoutier (transaction
17).
(a) On notera l’existence d’un Thibaud fils
de Thiou (Teobaldus filius Teoli) premier témoin
cité d’une donation d’Hardouin Chef-de-Fer et de son
fils Hugues à Roinville, dans le Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs,
texte que nous rééditons en Annexe 6h. Comme il apparaît en lien
étroit avec les Chef-de-Fer, on peut songer à en faire
un frère de Rainaud, mais en supposant qu’il serait mort
avant les transactions 16 et 17, où il n’apparaît
pas dans la liste de la parentèle de Rainaud.
|
Rainaud d’Aunay (Rainaldus de
Alneio, B 28) dit aussi
Rainaud des Têtières
(Rainaldus de Testiariis,
C 31-32)
1) Rainaud d’Aunay est le dernier des huit
témoins, apparemment dans le secteur de
Méréville, du consentement donné
par Arembour, épouse du susdit Godéchal
fils d’Oury de Vierville et leur fils Eudes à
la donation du défunt (transaction 12)
Voici la liste des témoins:
Gaudin fils d’Ansoué
de Méréville; Rainard Farinard;
Baudry du Fossé; Hardouin prieur
d’Épernon et son serf Ermengise; Geoffroy
de Moret; Eudes de Pannecières;
Rainaud d’Aunay.
C’est sans doute l’oncle de
Gautier II d’Aunay et frère de Gautier I que nous
font connaître deux notices du Cartulaire
de Saint-Père de Chartres; la première
le mentionne sous l’abbatiat
d’Eustache, c’est-à-dire entre 1079-1101, mais avant la mort de Gautier I, et donc entre
1079 et 1082 (p.294: Gualterio de Alneto, Rainaldo
fratre ejus), la deuxième sans date, mais sans
doute après (p. 368: Rainoldus
de Alneto). On peut aussi imaginer qu’il s’agit d’un fils
de ce dernier, qui serait donc leur cousin.
2) Il est ensuite, sous le nom de
Rainaud des Têtières,
témoin des
contre-dons opérés par les moines
en échange de la donation de la
terre de Lomlu par Rainaud fils de Thiou (transaction
17).
Voici la liste des témoins: Arnoux d’Aunay; son frère Garin; Rainaud
des Têtières; l’écuyer
Hervé.
Il s’agit du hameau
les Têtières de la commune d’Unverre,
près de Brou, dans le Dunois
(arrondissement de Châteaudun), où il est apparemment
possessionné. Il n’y a pas
à s’étonner de cette variation de dénomination,
car nous voyons bien aussi Gounier
d’Aunay prendre lui-même ailleurs le nom de Gounier
de Molitard, et plus tard encore de
Gounier de Saint-Avit.
|
Rainaud, serf de Geoffroy de Beaumont (Rainaldus famulus
Gaufredis de Bello Monte, B 33-34)
Ce Rainaud est le serf d’un Geoffroy de
Beaumont, qui paraît être un chevalier
possessionné dans le hameau du même
nom qui se trouve aujourd’hui dans la commune de Chuisnes.
Rainaud est témoin,
à Chuisnes, de la donation par
Hersent et Hardouin, ex-épouse et fils de Thion,
de quatre familles de colliberts en provenance de
Denonville (transaction 14).
(a) Son maître Geoffroy est lui-même
témoin d’une donation postérieure
de Hardouin au prieuré de Chuisnes, que j’édite
ici en Annexe 6f.
|
Rainier fils d’Aubert
(Rainerius filius Alberti,
B 10)
Ce Rainier fils
d’Aubert est le quatrième des douze témoins
cités, à Étampes, de la donation
d’Arnaud fils d’Aubrée et du consentement
de son frère Godéchal (transaction 3).
Il
faut peut-être identifier son père
avec Aubert fils d’Anseau. En effet Rainier qui
témoigne en même temps qu’Aubert fils d’Anseau
de la donation d’Arnaud
fils d’Aubrée, au domicile de ce dernier Arnaud
à Étampes
(transaction 3).
|
Raoul fils de Jocelyn, de Denonville
(Radulfus Gauscelini filius de Danunuilla,
B 30)
Ce Raoul, de Denonville est le premier témoin
cité, en un lieu indéterminé,
du consentement d’Anseau
Robert fils de Béguin et sa mère
Eudeline à la donation opérée
par Godéchal
et Amaury Roux d’Ably (transaction
13).
|
Richer, négociant d’Étampes
(Richerius mercator de Stampis,
B 20)
Cet intéressant
personnage, négociant d’Étampes, Richer,
est le quatrième des cinq témoins cités,
à Étampes, de la deuxième donation
de Godechal (transaction 8).
Ce
Richer d’Étampes nous
est aussi connu par une charte de 1123 conservée
dans le Cartulaire de Saint-Jean en Vallée
de Chartres (n°18), où
l’on voit apparaître d’autres personnages
mentionnés dans nos notices, dont un Bernoal (Bernoalius)
et Geoffroy de Moret (Gaufridus de Moreth).
|
Robert d’Adonville
(Rotbertus de Adunuilla,
B 27)
Ce Robert est le sixième des neuf témoins,
à Auneau, du consentement donné par
Hugues de Gallardon aux donations faites
par Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal
d’Étampes et Arnaud fils d’Aubrée.
Son frère Alleaume est cité juste après
(transaction 11).
(a)
C’est sans doute un nobliau du pays chartain, vassal
ou arrière-vassal d’Hugues de Gallardon possessionné
à Adonville. Rappelons qu’ultérieurement, selon
Merlet, le fief d’Adonville relevera du duché
de Chartres et ressortissait pour la justice
à Auneau.
(b)
Un Hardouin d’Adonville, chevalier apparemment
également possessionné dans ce
hameau de Denonville, et qui lui est sans doute apparenté,
est témoin à Chartres du consentement
donné par Gautier d’Aunay et sa femme à
la donation par son beau-frère Hardouin de quatre
familles de colliberts de Denonville
(transaction 15).
|
Robert de Dolmont (Rotbertus de
Dallei Monte, B 33)
Ce Robert qui semble être un chevalier
du pays chartrain possessionné à
Dolmont. Il est témoin à Chuisnes
de la donation par Hardouin de quatre familles de
colliberts de Denonville (transaction 14).
(a) Le Cartulaire de Saint-Père
cite, entre 1116 et 1124 un personnage
dont il n’est pas sûr qu’il soit de Dolmont, car le
texte copié donné, p.307: Radulfus
de Allemont, tandis que le copiste a porté en titre, p.
306: Radulfo de Dallemont. Il s’agit donc peut-être plutôt d’Allemant,
village de la commune de Boutigny orthographié, selon
Merlet, Alleman en 1180.
|
Robert fils d’Airaud (Rotbertus filius
Arraldi, A 24,
B 16)
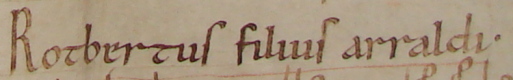 Robert est témoin de la
première donation de Godéchal (transaction
7) qui semble avoir lieu quelque part dans le pays
étampois, entre Étampes et Méréville.
Robert est témoin de la
première donation de Godéchal (transaction
7) qui semble avoir lieu quelque part dans le pays
étampois, entre Étampes et Méréville.
Nous n’avons aucune bonne
raison d’identifier son père à
Airaud frère de Bernoal
I d’Étampes et d’Éblon, et d’en faire
un frère d’Arnaud et Ours, quoi qu’on ne puisse
l’exclure a priori.
|
Robert Breton (Rotbertus Britto,
B 27)
Robert Breton
est témoin à
Auneau du consentement qu’il donne aux donations
de Gautier
d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée (transaction 11).
Il faut savoir qu’Hugues
de Gallardon a autorisé
et permis, dans la maison des moines d’Auneau,
et qu’il a accordé, au susdit saint
et à nous, la dite donation de Vierville
opérée par Gautier d’Aunay,
Guillaume fils de Bernoal d’Étampes
et Arnaud fils d’Aubrée, à
la supplique des moines monsieur Thion
Chef-de-Fer et Costable. De cette donation sont
témoins: Guy fils de Serlon; Amaury fils de
Rahier; le prévôt d’Auneau Marin; Robert
Breton; Jean Veau; Robert d’Adonville et son frère
Aleaume; Hugues Chien; Osmond de Gallardon.
Robert Breton est au moins un chevalier
vassal d’Hugues de Gallardon; mais c’est peut-être
aussi un de ses cousins.
(a) Ce Robert Breton est également témoin
d’un donation d’Hugues de Gallardon dont le texte a été édité
par Édouard Lefèbvre en 1867, et que nous reproduisons en
Annexe 7c.
***
1)
Sur son nom ou surnom Breton
(a) Une difficulté
est présentée par une charte du prieuré de Marmoutier
à Bréthencourt, aussi signée par
Thion Chef-de-Fer déjà moine, et datée
par Merlet des environs de 1080, dont je donne le texte
en Annexe 6e. Elle nous fait connaître
un Garin Breton fils d’Hervé de Gallardon
(Guarinus Britto filius Heruei de Gualardone), c’est-à-dire apparemment du même
père qu’Hugues de Gallardon, Hervé,
mort en 1092.
(b)
Ce Garin Breton
(Warinus Brito) est encore témoin
d’une charte de Hugues II du Puiset confirmant
un accord conclu entre Marmoutier et St-Martin-des-Champs,
relatif à la terre d’Ouestreville et au
cimetière du Puiset, entre 1102 et 1106 (Liber
testamentorum Sancti Martini de Campis, n°LVI,
p. 72).
(c)
Le même est encore témoin
en 1106 (Warinus brito) d’une
donation contestée par Garin Bésin (Warinus
Besenus, qui apparaît aussi lors de notre
transaction 5, Guarinus filius
Amalrici Biseni).
Il semble
inévitable donc d’identifier Garin Breton au frère
cadet d’Hugues de Gallardon, qui lui succéda quand
il mourut sans descendance masculine, en 1096 ou peu après,
et qui mourut lui-même après être parti
en croisade au commencement du XIIe siècle.
Cependant cette
identification entraîne des difficultés;
pourquoi Garin Breton n’est-il pas titré
de Gallardon entre 1102 et 1106?
On se demande
surtout qui sont, dans ce cas de figure, les différents
Breton qui apparaissent dans l’entourage des sires
de Gallardon, car Garin Breton et
Robert Breton ne sont pas les seuls dans
ce cas.
(d) Nous trouvons aussi en effet un certain
Hébert Breton cité comme
témoin juste avant un certain Gautier de Gallardon
(Herbertus Brito, Walderius de Guallardone) entre
1104 et 1114 à Notre-Dame de Chartres lors d’une donation
de dîme à Orsonville (éd. Depoin,
Recueil de chartes et documents de Saint-Martin
des champs, n°144, t. I, p. 227).
(e) La question est encore
compliquée par l’existence d’un certain Robert de Gallardon
fils de Gasce (Robertus de Galardone filius Wathonis).
Sa fille Agnès se fait religieuse, et les fils sont Hugues,
Robert, Simon, le clerc Gautier, Guillaume et Yves (Cartulaire de Saint-Père, p. 409, acté
placé entre 1116 et 1140 par Guérard). Il est
déjà mentionné juste après Hugues
de Gallardon entre 1090 et 1100 selon Guérard:
Hugo de Galardone; Robertus filius Guachonis (ibid.,
p. 313).
***
La situation paraît embrouillée
par l’existence de deux branches de la famille de Gallardon.
Selon Depoin, Aubert II de Gallardon n’avait eu que deux filles.
Aubour, dame de Gallardon, épousa un Hébert, dont
elle eut Hervé, qui eut pour enfants Hugues I de Gallardon,
Aubour, Garin, Guy et Milon. La deuxième fille d’Aubert
II, Froheline, dame de Thimert, épousa Gasce, dont elle
eut Hugues, Gasce et Robert.
Hébert
de Gallardon a eu trois enfants, Hervé, Foucher
et Guibour, d’après le texte d’une dantion qu’il fit
avant 1080 (Cartulaire de Saint-Père,
pp. 223-224: quidam miles Herbertus nomine
de Galardone... una cum consensu filiorum suorum, Hervei
scilicet atque Fulcherii et unica filiae nomine Guiburgis).
Cependant la théorie de Depoin ne rend
pas compte en l’état de tous les faits énumérés
ci-dessus. La question reste ouverte et nous sommes ouverts
à toutes les suggestions. Qui sont Hébert
Breton et Robert Breton? Et pourquoi Robert fils de Gasce
s’appelle-t-il de Gallardon?
***
On peut
se demander si Robert Breton et Robert fils de Gasce (ou Gaston) ne sont
pas un seul et même homme. Voici en effet les Robert qui interviennent
comme témoins des donations successives enregistrées par
la charte d’Hugues de Gallardon que nous donnons en Annexe 6i:
Première donation: Iohannes vitulus...
Osmundus de Alneel (=Osmond de Gallardon)... Robertus Brito
(=Robert Breton)...
Deuxième donation: Robertus filius
Gasthonis... Harduinus de Danovilla (=Hardouin Chef-de-Fer)... Osmundus
de Alneel (Osmond de Gallardon)... Johannes de Sclimonte (=Jean
Veau?)... Seguinus frater Roberti filii Gastonis...
Troisième donation: Robertus de Danonvilla.
Osmundus miles (=Osmond de Gallardon)... Johannes de Sclimonte
(=Jean Veau?)...
Quatrième donation: Robertus Gathonis...
Robertus nigro dorso...
|
Robert Fléaud (Rotbertus Flagellus,
ou Flagellum, B 35)
Robert Fléaud
(B 35: Rotberto Flagello) est témoin à Chartres du
consentement donné par Gautier d’Aunay
et de sa femme Milsent du don de quatre familles
de colliberts de Denonville par Hardouin Chef-de-Fer
et sa mère (transaction 15).
(a) Robert Fléaud
(Roberto Flagello) est cité par le
Cartulaire de Saint-Père de Chartres
à une date non précisée, comme le témoin
du testament d’un certain Gaunard, serf (homo) de
Saint-Père en faveur de ce même monastère
(p. 317: Roberto Flagello, Roberto aurifabro,
Roberto majore, Hernaldo botario, Odone pistore, Gaufrido coquo,
Parente, Christiano scutelario; Rainardo, filio Aventii; Rainerio
Torto, Christiano pelliparo; Odone, filio Gumbaldi).
(b) Il
est encore témoin (Robertus Flagellum),
en même temps que Gautier fils de Fléaud, de
la renonciation d’un certain Hugues fils de Baudouin à un
certain droit coutumier alimentaire (ibid., p. 354: Paganus filius Flaaldi;
Paganus de Dalunvilla, Hugo Bos; Ansoldus filius Godescalli;
Robertus Flagellum, Osbertus monetarius, Suggerius pelliterius,
Christianus pelliterius, Gaufridus cocus, Cochardus, Petrus Vigil).
(c) Il est encore mentionné par le même
cartulaire, sous l’abbé Guillaume, entre 1101 et 1129, comme
témoin de la renonciation de Paulin fils d’Évrard,
chevalier de Leni Villa, à sa revendication
sur une famille de serfs de Saint-Père (ibid.,
p. 415: ex parte ejus,
Roberto Flagello et Helia, milite suo; ex nostra, Huberto filio
Balduini; Christiano pelliterio, Frollando pelliterio, Roberto
marescallo).
(d) Est ensuite
mentionné, entre 1101 et 1129, son fils Philippe
fils de Robert Fléaud, qui est neveu du moine Nivelon
(ibid., pp. 335-336: Philippus filius
Roberti Flagelli nepos domni Nivelonis), et dont l’oncle Étienne de Haimonis Villa
est également moine (ibid.,
p. 480: domnus Stephanus de Haimonis
Villa avunculus ejus). Il est encore témoine
entre 1113 et 1129 (p.483: Philippus
filius Roberti Flagelli).
(e) Il existe aussi un Aimelin Fléaud
témoin de statut indéterminé entre
1130 et 1149 (ibid., p. 365: Hamelinus Flager),
puis encore à une date indéterminée (p.
366, Hamelino Flagello), et enfin, entre 1130
et 1149, noté clairement comme chanoine (p. 389: ex canonicis: Hamelinus
Flael etc.).
(f) Il ne faut pas sans doute intégrer
à cette famille celle de Gautier fils de Fléaud, qui
paraît elle aussi avoir eu des liens avec celle
des Chef-de-Fer. Voyez notre article Fléaud.
|
 Robert
du Cimetière (Rotbertus de Cimiterio,
B 23)
Robert
du Cimetière (Rotbertus de Cimiterio,
B 23)
Robert
du Cimetière est témoin
à Étampes du don qu’y fait Amaury Roux
d’Ablis de deux tenures à Vierville
(transaction 9).
On ne sait pas si ce cimetière
est celui de Saint-Martin d’Étampes,
ou de Notre-Dame, mais il paraît clair qu’il y a sa demeure,
de même que Gautier II d’Aunay envisage d’en construire
une dans le cimetière de Vierville. Voyez notre article
Cimetière.
Rappelons
que les fouilles de l’été 2007
opérées par l’INRAP sous la direction
de Xavier Peixoto ont mis à jour des
sépultures du XIe siècle rue de la République
devant l’Hôtel-Dieu jusqu’au portail de
la collégiale Notre-Dame, et plus haut, près
de Saint-Basile. Ci-contre un cliché de Jacques Corbel lors
d’une fouille plus haut dans la rue de la République, au niveau
de la place Romanet, derrière Saint-Basile, où été
mis à jour une trentaine de squelettes.
Voiyez: Jacques CORBEL, “Le gisant de Saint-Basile”, in ID., Le Blog
du Flâneur Étampois, http://flaneur-etampes.over-blog.com/article-6993248.html, 2007, en ligne en 2008.
|
Robert de Vierzon, prieur de Marmoutier
(Robertus de Virsone, A 8,
Robertus prior
claustri Maioris Monasterii, A 12-13;
B 11, domnus Rotbertus
de Virsone monachus, B 6)
Robert de Vierzon est alors le
prieur de Marmoutier.
1) La première rédaction
semble dire que que Robert était personnellement
présent à Saint-Avit-les-Guespières
lors de la cérémonie d’investiture
de Vierville Milsent, mais la deuxième précise
que Milsent l’a donné
au serf Archambaud,
par le moyen de la baguette, en lieu et place du dit
moine (transaction 2).
2) En revanche il a bien assisté
personnellement, à Chuisnes, au consentement
donné par Hardouin et Hersent à
cette donation, avec le prieur de Chuines,
Thibaud (transaction 4).
Ce Robert était sans doute de Vieuvicq, plutôt
que de Vierzon même.
(a) En effet plusieurs chartes datant
de la période de 1050 à 1090, et relatives
au prieuré que Marmoutier avait à Vieuvicq,
aux confins des pays chartrain et dunois, font allusion
à des alleux qui y avaient appartenu à un certain
Geoffroy de Vierzon (Gausfredus de Virsonio);
(b)
puis à son fils, un certain clerc Humbaud,
Uncbaldum clericum filium Gausfredi de
Virsonio (1061); Unbaldus de Virsone
(vers 1070); ex alodiis Humbaud
que fuerunt Huncbaldi de Virsone in confinio pagorum Carnotensis
atque Carnotensis (vers 1070). Textes cités ici
d’après l’Inventaire-sommaire de Merlet,
sous les cotes H.2500 et H.2501,
p. 271.
|
Robert compagnon
d’Allard de Bréthencourt
(Rodbertus eiusdem
Adelardi socius, D 38)
Il est témoin d’une transaction
non localisée: A cette donation
ont assisté bon nombre de personnes
du côté des moines et de leur côté.
De leur côté il y a eu ceux-ci:
le médecin d’Étampes Robert; Amaury
Roux; le clerc Hardouin; un certain Garin leur
serf. Du côté des moines il y a eu ceux-ci:
le prêtre de Léthuin Tamoué;
Allard de Bréthencout; et Robert compagnon du
dit Allard (C 36-38).
|
Robert, régisseur de Saint-Avit (Rotbertus maior
suus de Sancto Avito,
B 7)
Robert,
régisseur de Saint-Avit pour le compte de Gautier
d’Aunay et de sa femme Milsent Chef-de-Fer,
en compagnie du chevalier Thion de Crémisay, hameau
aujourd’hui disparu de Saint-Avit-les-Guespières, se porte témoin de la donation de Vierville effectuée
à Saint-Avit par Milsent selon
le rite (transaction 2).
|
Robert, médecin d’Étampes
(Rotbertus
medicus de Stampis,
D 37)
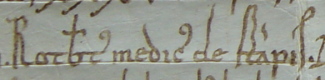 Il est témoin d’une transaction
non localisée: A cette
donation ont assisté bon
nombre de personnes du côté des moines
et de leur côté. De leur côté
il y a eu ceux-ci: le médecin d’Étampes
Robert; Amaury Roux; le clerc Hardouin; un
certain Garin leur serf. Du côté
des moines il y a eu ceux-ci: le prêtre de
Léthuin Tamoué; Allard de Bréthencout;
et Robert compagnon du dit Allard
(C 36-38).
Il est témoin d’une transaction
non localisée: A cette
donation ont assisté bon
nombre de personnes du côté des moines
et de leur côté. De leur côté
il y a eu ceux-ci: le médecin d’Étampes
Robert; Amaury Roux; le clerc Hardouin; un
certain Garin leur serf. Du côté
des moines il y a eu ceux-ci: le prêtre de
Léthuin Tamoué; Allard de Bréthencout;
et Robert compagnon du dit Allard
(C 36-38).
|
Robert fils de Grimaud
(Rodbertus Grimaldi filius,
C 29)
Robert
fils de Grimaud semble faire
partie d’une petite communauté rurale
où son rang est inférieur à
ceux du forgeron et du meunier, après
lesquels il est cité comme témoin
de la donation par Rainaud
fils de Thiou de la terre de Lomlu (peut-être
Orlu). Voici la liste: le prêtre Aubry; Guy fils de
Serlon; Airaud de Dourdan; Hongier de Villeau;
Milon fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron
Gautier; le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud;
Aubert fils de Bouchard (B 27-29).
|
Robert (Rotberti,
B 30), nom de famille.
L’usage
du génitif Roberti
semble bien indiquer que Robert est ici
un nom de famille légué par Béguin
à son fils Anseau Robert.
|
Roi, ou Roué
(Rex,
B 23), patronyme
étampois
Il faut prendre garde à
mon avis à ce que cet anthroponyme n’est pas
nécessairement un surnom imagé.
Rex peut représenter une latinisation
abusive d’un anthroponyme germanique dégradé.
On sait par exemple que Laetitia
représente un anthroponyme germanique
Lethuisa, dégradé
en Lieuse puis par analogie en Liesse, d’où
notre rétroversion en latin classique
Laetitia. De même, nous
avons vu que la latin Flagellum, dans notre notice,
ne retranscrit pas en réalité un ancien
français Fléau, même
s’il est alors compris comme tel, mais beaucoup plus vraisemblablement
Fléaud, c’est-à-dire
une forme dégradé de l’anthoponyme germanique
Fledald. De même, comme
Rodhing a donné Roin
(dans Roinville ou Roinvilliers
par exemple), Rodulfus / Radulfus
a donné Raoul
puis Rou, compris
Roux (comme dans le cas bien connu de Châteauroux
qui est en réalité un chateau de
Raoul, Rodolfus) et donc abusivement rendu en latin par
Rufus.
Aussi
peut-on parfaitement imaginer que Roi,
rononcé Rwé
an ancien français, soit la forme dégradé
d’un anthroponyme germanique Rodwig,
qui, une fois dégradé en
Rwé ou Rwi (comme
Hlodewig a donné Lwi,
écrit Louis). On voit bien
en effet que dans la région l’élément
-wig (ou -wech,
si l’on préfère cette transcription)
a évolué en -wé, comme
le montre le cas de deux anthroponyme rares attestés
par notre notice, Tamoué (Tamueius) et Ansoué, pour
lequel nos scribes hésitent beaucoup (Anseus / Ansua / Ausueus de Mereruilla).
(a)
Un certain Christophe Roi (Cristoforus
Rex) est témoin à Étampes,
en compagnie d’autres Étampois, du don
qu’y fait Amaury Roux d’Ablis de deux tenures
à Vierville (transaction 9).
(b) L’existence à
Étampes d’un dénommé Roi
(Rex) est à nouveau attestée
à Étampes en 1226. A cette date, une
charte de l’archevêque de Sens Gautier Cornu
entérine le partage du centre ville entre les
deux paroisses de Notre-Dame et de Saint-Basile (Fleureau,
Antiquités, p. 404). L’un
des points de répère alors donné est
la maison de Sainte-Croix d’Étampes
qui est à côté de la maison
de Roi de Corbeil (juxta domum Regis de Corbolio),
passage qui a d’ailleurs été mal compris
par les historiens d’Étampes depuis Louis-Eugène
Lefèvre a voulu en tirer la preuve que les locaux
de la Boucherie appartenaient au roi (de France).
(c) Ce patronyme Rex
n’est représenté qu’une
fois dans les chartes conservées de Philippe
Ier, où on le trouve porté
à Blois en 1075 par un certain Thibaud
Roi, Tetbaldus
Rex (p. 190, l. 3 & p. 191, l. 1).
(d)
Un Herbertus Rex est témoin
vers 1127 quelque part dans le pays chartrain proche d’Étampes
d’un don de 40 arpents (Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°40, p. 25).
(e)
Une charte de Philippe II Auguste
de 1187 (Cartulaire de Notre-Dame de Paris,
t. II, p. 372) mentionne un Eudes Roi (Odo
Rex) du côté d’Itteville.
|
Rosceline (Roscelina,
C 27)
Fille de Thiou et d’Ermentrud,
sœur de Rainaud,
Pierre, Arembour et Asceline. Elle
consent à la donation de la terre de Lomlu
opérée par son frère
Rainaud (transaction 16).
Elle fait ensuite partie de la parentèle
qui reçoit les contre-dons des moines
(transaction 17). |
Roux, ou Raoul
(Amalricus
Rufus de Ableis, B 19, 20, Amalricus Rufus,
D 37, Guillelmus Rufus de Coina,
B 33)
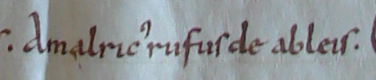 Le surnom Rufus
n’est pas tant porté qu’on
pourrait le croire, et n’est représenté
que sept à huit fois dans les chartes conservées
de Philippe Ier. Il peut représenter
les appellations vernaculaires
Roux,
Le Roux, Roussel
ou Rousseau, mais aussi une évolution de l’anthroponyme
germanique Radulfus, Rodulfus, Raoul, Rou, Roux, comme dans le cas bien connu
de Châteauroux.
Le surnom Rufus
n’est pas tant porté qu’on
pourrait le croire, et n’est représenté
que sept à huit fois dans les chartes conservées
de Philippe Ier. Il peut représenter
les appellations vernaculaires
Roux,
Le Roux, Roussel
ou Rousseau, mais aussi une évolution de l’anthroponyme
germanique Radulfus, Rodulfus, Raoul, Rou, Roux, comme dans le cas bien connu
de Châteauroux.
|
Serlon, père de Guy (Serlus,
B 26, Serlo,
C 28)
Serlon
est le père apparemment défunt d’un
certain chevalier du pays chartrain, Guy fils
de Serlon (B 26: Guido filius Serli; C 28: Guido Serlonis filius) qui est d’abord témoin, à Auneau,
du consentement d’Hugues de Gallardon aux donations
de Gautier d’Aunay, Guillaume fils
de Bernoal d’Étampes et Arnaud fils
d’Aubrée (transaction 11),
puis, quelque part dans le pays chartrain, de la donation
par Rainaud fils de Thiou de la terre de Lomlu (transaction
16).
(a) Il est intéressant de noter que
dans la notice B, son nom est latinisé sur
la base du cas sujet en ancien français (anc.
fr. Serles, d’où lat.
Serlus, Serli, 2e déclinaison),
tandis que dans la notice C, il l’est sur la base
du cas régime (anc. fr. Serlon,
d’où lat. Serlo, Serlonis,
3e déclinaison).
(b) Dans une notice
de
l’abbaye parisienne de Saint-Martin-des-Champs,
rédigée entre 1079 et 1096 qui parle
du même personnage, on opte aussi pour la
seconde solution: Widonem
scilicet filium Serlonis (Recueil, p.112).
|
Tamoué, prêtre
de Léthuin (Tamueius presbiter,
C 32, Tamueius presbiter de Stonno,
D 37-38)
Tamoué est apparemment, pour
employé un terme anachronique, le curé
de Léthuin, où les moines de Marmoutier
possèdent un prieuré dont les terres
jouxtent celles de Vierville.
1) Il est d’abord le premier
témoin cité des contre-dons
opérés par les moines en échange
de la donation de la terre de Lomlu
par Rainaud fils de Thiou (transaction 17).
2) Il est d’abord le premier témoin
cité (du moins du côté des moines)
de la donation par Geoffroy
de l’Eau fils de Félicie et son épouse
Gile d’une terre d’une charrue et trois tenures
à Vierville (transaction 18).
(a) Il nous est aussi connu comme témoin
d’une charte du prieuré de Bréthencourt
en date de 1080 environ et dont j’ai mis le texte en Annexe 6e.
|
Thibaud fils d’Étienne
(Tetbaldus filius Stephani, A 16,
B 12-13)
Ce Thibaud fils d’Étienne paraît
un chevalier vassal du vidame de Chartres
Hugues II fils de Guerry, témoin du consentement
donné à la donation de Gautier par
Hugues et sa mère
Helsent, de qui le dit Gautier tenait en fief
une part du dit village de Vierville (transaction 5).
(a) Alors qu’il est cité,
dans notre transaction 5, juste après Yves
fils de Norbert (testibus istis: Iuone filio Norberti,
Tetbaldo filio Stephani, etc.), on
le voit aussi témoin d’une transaction non datée
enregistrée par le Cartulaire de Saint-Père
de Chartres (t.II, p.314), cité juste avant
lui: Teobaldus
filius Stephani, Ivo Norberti, Hugo de Galardone, et
ce en compagnie
d’Hugues de Gallardon (cité dans notre transaction
11: Hugo de Gualardone).
(b)
Il est témoin également, quelques années après l’affaire de Vierville, entre
1101 et 1115, d’une transaction relatée
par le Cartulaire de Saint-Père
(pp.449-451) et cela juste avant juste avant Gounier d’Aunay
(Theobaldus Stephani filius, Gunherius de Alneto).
La même affaire voit ensuite intervenir Nivelon II fils de Foucher
Ier de Fréteval, accompagné cette fois
de son fils Ours (Nevelo et filius ejus
Urso).
aux moines (éd.
Guérard, pp. 561-562).
(c) Ce même Thibaud
fils d’Étienne (Theobaldo, filio Stephani)
intervient le 23 février 1103 comme témoin
d’une donation de la vidamesse Helsent (Helisendis),
veuve du vidame Guerry (Guerrici vicedomini),
et de ses fils le vidame Hugues (Hugone videdomino)
et Étienne (Stephano), ainsi que de leur
sœur Elisabeth (Elisabeth), dans la
Cartulaire de Saint-Père de Chartres
(éd. Guérard, p. 563).
(d)
A une date située
entre 1102 et 1105, Thibaud (Teobaldus filius Stephani) est encore témoin de la renonciation d’Hugues
II, vidame de Chartres, à ses droits sur les hôtes
de Saint-Martin à Roinville, avec le consentement
de sa mère Helsent et de son frère Étienne
et l’autorisation du comte de Chartres Guillaume et de sa
mère Adèle (Depoin,
Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs,
1912, pp. 43-44).
(e) Il est encore témoin vers 1108 d’une
donation dans le même secteur de la vicomtesse
Helsent, qui cède au chapitre de Saint-Jean-en-Vallée
tout ce possédait à Manterville (Cartulaire
de saint-Jean-en-Vallée, n°7, p. 6,
bis): nous l’y voyons alors accompagné
de son fils, dénommé Fron (Theobaldus
Stephani filius; Teobaldus filius Stephani,
Frodo suus filius).
(f) Et encore d’une autre
donation de la même, d’une vigne, vers la même
date (ibid. p. 7: [Theobal]dus Stephani filius, Frodo ejus
filius), donation dont Garin d’Aunay
(témoin de notre transaction 17) est également
témoin.
|
Thibaud prieur de Chuisnes
( Tetbaldus prior, A 12,
B 11, domnus Tetbaldus prior Coinę,
B 32)
1)
Thibaud, qui dirige alors le prieuré
que possèdent à Chuines les moines de
Marmoutier y assiste à Chuines au consentement
que donne Hardouin Chef-de-Fer à
la donation de Vierville par son beau-frère Gautier
d’Aunay, à un
moment où le prieur du cloître de Marmoutier
lui-même, Robert, a fait le déplacement.
Sont ensuite cités cinq moines (Évain, Évroin, Gaston,
Foulques, Gimard Ernèse) et leur serf serf
Eudes (transaction 4).
2) Plus tard, le même
Hardouin Chef-de-Fer donne aux moines quatre
familles de colliberts de Denonville,
à savoir le serf Geoffroy avec ses filles
et ses filles. Hardouin en investit l’abbé
de Marmoutier en donnant une tige de sureau au prieur Thibaud, son représentant
(transaction 14).
(a) Le prieur
Thibaud est aussi mentionné
avec le moine Évain et Eudes, serf des moines de Chuisnes, comme témoin d’une donation d’Hardouin
Chef-de-Fer à leur prieuré (dont nous donnons le texte en Annexe 6f): Voici les moines: le prieur Thibaud,
Moïse, Évain, Giraud.
Les laïcs: le prêtre Raoul, son frère
Sichier, Geoffroy de Beaumont, Guillaume
Roux, Arnoux, Gauslin Serve-en-gré, le serf Eudes, le cuisinier Gauslin, les prêtres Jeannou,
Thierry et Jean. Lors de cette donation Hardouin
emprunte malicieusement au prieur son couteau, sous prétexte
d’en faire l’objet qu’il déposera symboliquement
sur l’autel; en fait il n’y déposera qu’un bout de bois,
et gardera le couteau.
(b) Il serait intéressant d’établir
quand ce Thibaud a été
prieur de Chuines. Nous voyons qu’en 1083
c’est un certain Thierry qui occupe cette fonction
(Theodoricus prior de Chonia), d’après
le Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée
(éd. Merlet, p. 2 et note de
la p. 1) et que le 29 novembre 1119 (ibid.,
p. 14) c’est un certain Henri (Henricus Choiniae
prior).
|
 Thion
Chef-de-Fer (domnus Teudo
Caput Ferri monachus,
B 18, 26, Teudo
monachus Caput Ferri,
A 22, Teudo Caput
Ferri monachus, B 22, domnus Teudo qui Caput de
Ferro dicitur, C 29, domnus Theudo Caput Ferri,
B 8, 13-14, 29, domnus Teudo Caput Ferri,
D 39, Teudo Caput Ferri pater ipsius Harduini,
B 11, Teudo Caput Ferri, A 24;
B 15, 16, 32, 33, Theudo Caput Ferri,
B 6, Teudo Caput de Ferro, A 8,
12, Theudo monachus,
A 10, Teudo,
D 39), chevalier puis moine, ex-époux
d’Hersent, père d’Hardouin Chef-de-Fer et de
Milsent, beau-père de et de Gautier d’Aunay.
Thion
Chef-de-Fer (domnus Teudo
Caput Ferri monachus,
B 18, 26, Teudo
monachus Caput Ferri,
A 22, Teudo Caput
Ferri monachus, B 22, domnus Teudo qui Caput de
Ferro dicitur, C 29, domnus Theudo Caput Ferri,
B 8, 13-14, 29, domnus Teudo Caput Ferri,
D 39, Teudo Caput Ferri pater ipsius Harduini,
B 11, Teudo Caput Ferri, A 24;
B 15, 16, 32, 33, Theudo Caput Ferri,
B 6, Teudo Caput de Ferro, A 8,
12, Theudo monachus,
A 10, Teudo,
D 39), chevalier puis moine, ex-époux
d’Hersent, père d’Hardouin Chef-de-Fer et de
Milsent, beau-père de et de Gautier d’Aunay.
Nous
ne résumerons pas tout ce que disent nos dix-sept
notices, qui toutes le mentionnent, puisqu’il est à
l’origine de toutes les donations et transactions qu’elle
enregistrent.
Pour ce qu’on sait de lui
par ailleurs, voyez ce que nous en disons à
l’article Chef-de-Fer.
Remarquons qu’il était encore laïc en
1079, d’après une notice éditée
et précisément datée par Depoin
(Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs, éd.
de 1912, pp. 41-42).
|
Thion de Crémisay, chevalier
(Theudo miles de Cramisiaco, A 10; B
7)
Ce chevalier Thion, évidemment
possessionné à Crémisay,
hameau aujourd’hui disparu de Saint-Avit-les-Guespières, se porte témoin de la donation de Vierville effectuée
à Saint-Avit par Milsent selon le
rite (transaction 2).
C’était sans doute
un homme-lige de Gautier d’Aunay, le seul laïc
qui témoigne avec lui est de
régisseur de Saint-Avit pour Gautier et Milsent, Robert.
|
Thiou père de Rainaud (Tetulfus, B 25, Teuldus,
B 10), époux décédé
d’Ermentrut, père de Rainaud, Pierre, Arembour, Asceline
et Rosceline.
(a) On notera l’existence d’un Thibaud fils
de Thiou (Teobaldus filius Teoli) premier témoin
cité d’une donation d’Hardouin Chef-de-Fer et de son
fils Hugues à Roinville, dans le Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs,
texte que nous rééditons en Annexe 6h. Comme il apparaît en lien
étroit avec les Chef-de-Fer, on peut songer à en faire
un autre fils de notre Thiou, frère de Rainaud; mais il
faut alors supposer qu’il serait mort avant les transactions 16
et 17, où il n’apparaît pas dans la liste de la parentèle
de ce dernier.
|
Vaslin (Vaslinus, C 28), surnom ou patronyme porté par
un certain Aubert, Albertus Vaslinus
Ce surnom ou patronyme, bien représenté
à cette période dans le secteur,
est ici porté par un certain Aubert Vaslin
qui paraît être
un chevalier; en tout cas il est plus considéré
que le forgeron et le meunier
du village où il se porte témoin
de la donation de la terre de Lomlu par Rainaud
fils de Thiou; il est cité en sixième
position: le prêtre Aubry;
Guy fils de Serlon; Airaud de Dourdan;
Hongier de Villeau; Milon fils de Boson;
Aubert Vaslin; le forgeron Gautier;
le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert
fils de Bouchard (transaction 16).
(a) Dans
notre secteur le Cartulaire
de Saint-Jean en Vallée de Chartres
conserve une charte de Thomas, abbé de Morigny
mentionnant vers 1123 un certain régisseur
Vaslin et son frère Morin (n°31, p.
18: S. Vaslini majoris, S. Morini
fratris ejus; id. n° 32, p. 19: Vaslinus major,
Morinus frater ejus).
(b) Vers la même date (ibid.
n°33, p. 20) nous voyons une charte (AD28, H.3261)
relative à la même affaire signée
par deux Vaslin distincts, parmi lesquels
il est difficile de se retrouver: un Vaslin de Louville-la-Chenard
(Vaslinus de Laudovilla) et un Vaslin de Mongerville
(Vaslinus de Mongervilla) apparenté visiblement
à Morin/Marin frère du régisseur Vaslin:
Vaslinus de Mongervilla, Adelina uxor Haaberti,
Naintoldis uxor Marini, Bertha filia ipsius Marini, Rostha
filia Vaslini de Mongervilla, tout ce petit monde se trouvant
dans le château d’Auneau (in castro Alnetello).
La curieuse graphie Haabert doit représenter une évolution d’Adalbert
distincte de celle que reflète le plus
classique Albertus, et peut-être
une prononciation dialectale Abert de l’anthroponyme
usuellement prononcé Aubert.
Quoi qu’il en soit ce Haabert
est probablement notre Aubert Vaslin. Il est probable
que notre Haabert-Aubert Vaslin a eu de sa femme
Adeline deux fils, le premier, Vaslin, régisseur
de Mongerville et père de Rosthe, le second, époux
de Nainthaut (Naintoldis) et père de Berthe.
(c) Entre
1123 et 1128, une charte de Saint-Jean-en-Vallée
enregistrant la donation par Jean d’Étampes de tout
ce qu’il possède à Manterville (n°38,
pp. 22-23) mentionne un témoin Garin fils de Vaslin
d’Eddeville (p.23: Garinus filius Vaslini de Eddevilla);
vers 1125 (n°37, p. 23), un certain Vaslin de Denonville
(Vaslinus de Danumvilla) est fidéijusseur
d’une donation d’une rente sur la métairie d’Aubray
(apud Alberetum).
(d) On notera aussi un Vaslin fils d’Arnoux, Vaslinus
filius Arnulphi, chanoine de Saint-Martin d’Étampes en 1112
(d’après la charte de Louis VI de cette date), ce qui signifie
qu’il l’était dès 1106 (date à laquelle la nomination
de nouveaux chanoines fut interdit, les prébendes devant aller
aux moines de Morigny au fur et à mesure de l’extinction du corps).
|
Veau ou Leveau
(Vitulus, B 27), surnom ou nom de famille d’un certain
Jean.
Ce surnom ou nom de famille est porté par un
certain Jean, qui paraît être un
chevalier du pays chartrain, témoin avec
d’autres, à Auneau, du consentement donné
par Hugues de Gallardon aux donations de Gautier d’Aunay, Guillaume fils de Bernoal
d’Étampes et Arnaud fils d’Aubrée (transaction 11).
(a) Nous avons vu que ce Jean Veau (Iohannes Vitulus)
apparaît comme témoin d’une donation d’Hugues de Gallardon
lui-même (voyez l’Annexe 6i).
(b) C’est sans
doute une famille vassale des seigneurs d’Auneau
car nous trouvons à nouveau vers
1168 un Raoul Veau (Radulfus
Vitulus) témoin d’une
charte du neveu d’Hugues de Gallardon, Jocelin d’Auneau, Joscelinus de Alneolo (Cartulaire
des Vaux-de-Cernay,
t. I, p. 49), et à nouveau entre 1176 et 1180 (ibid. p. 64, bis).
(c) Le Cartulaire de Saint-Jean en Vallée
de Chartres mentionne aussi en 1135 un Guillaume Veau (Guillelmus Vitellus).
(d) On peut de plus se demander
si cette rétroversion latine, Vitulus ou Vitellus, ne pourrait pas rendre en fait le même patronyme
vernaculaire que Boviculus, qui serait en ce
cas Bouvet plutôt que Veau ou Leveau (un Geoffroy Bouvet,
Gausfridus Boviculus, vassal d’Hugues Blavons, est témoin d’une
de ses donations en 1096 avec Gautier II d’Aunay,
Cartulaire de Saint-Père, p. 204, un Hugues Lebœuf, Hugo Bos, témoin d’une
donation d’Helsent avec Garin d’Aunay vers 1108, Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée, p. 7).
|
Yves fils d’Hébert
de Denonville (Iuo filius Herberti,
B 34), et frère de Guerrise.
Yves
est témoin à Chartres du consentement
donné par Gautier
d’Aunay et sa femme Milsent Chef-de-Fer
à la dite donation par Hardouin de quatre familles
de colliberts (transaction 15).
Son
frère Guerrise avait lui assisté
à la donation elle-même, dont la cérémonie
s’était déroulée à
Chuisnes (transaction 14).
(a) Nous voyons dans le Liber
Testamentorum de Saint-Martin-des-Champs Yves fils
d’Hébert (Ivo filius Herberti) témoin
d’une transaction d’Hardouin Chef-de-Fer au sujet
de Roinville, dont je donne le texte en Annexe 6h, probablement de la fin du XIe siècle
et en tout cas antérieure à 1105.
(b) Yves fils d’Hébert
est encore mentionné entre 1120 et 1127 comme
témoin laïc d’un amortissement de Foulques
de Courville, cité juste après Garin de Friaize
et ses fils (éd. Merlet, Cartulaire de Saint-Jean
en Vallée, n°28, pp. 16-17: Garinus de Friessa
et filii ejus Garinus et Hugo, Ivo filius Herberti, etc.),
ce dernier étant témoin de notre transaction
10 (Guarino de Friesia).
(c) Le Cartulaire de Saint-Père
de Chartres (p. 303) cite lui aussi Yves fils d’Hébert
(Ivo filius Herberti) comme témoin, vers 1123,
d’une donation de Gautier Sans-Nappe, fils de Rainaud Sans-Nappe,
autorisée par le vicomte Hugues III du Puiset.
|
Yves fils de Norbert
(Iuo filius Norberti, A 15, B
12)
Yves
fils de Norbert est cité en tête
des témoins du consentement donné
à la donation de Gautier d’Aunay par le vidame
Hugues fils de Guerry et sa mère Helsent.
Voici la liste des témoins:
Yves fils de Norbert; Thibaud fils d’Étienne;
Payen fils de Girard maréchal; Garin fils
d’Amaury Bisen; Aubert fils d’Aubert d’Ormoy (transaction 5).
(a) Le Cartulaire
de Saint-Père de Chartres (p.206) cite Yves fils
de Norbert (Ivo filius Norberti) comme témoin
de la donation d’un certain Roger, chevalier apparemment normand,
qui s’est moine à Chartres, avant 1080.
(b) Le même
Cartulaire (p.238) nous le montre
témoin (Ivo filius Norberti), sous l’abbatiat
d’Eustache (1079-1091) d’une donation voirie en Beauce par Gautier
fils de Fléaud qui parle de Gounier d’Aunay, frère
aîné de notre Gautier II d’Aunay, comme de son
seigneur (domni mei Gunheri) en présence du prévôt
de Chartres Guillaume (Willelmus prepositus) et surtout
du vidame Guerry (Guerricus vicedominus). Rappelons qu’à
l’époque de nos notices Guerry est mort.
(c) Alors qu’il
est cité, dans notre transaction 5, juste avant
Thibaud fils d’Étienne (testibus istis: Iuone
filio Norberti, Tetbaldo filio Stephani, etc.),
on le voit aussi témoin d’une transaction
enregistrée par le même Cartulaire
de Saint-Père (t.II, p.314), cité
juste après lui: Teobaldus
filius Stephani, Ivo Norberti, Hugo de Galardone,
et ce en compagnie d’Hugues
de Gallardon (cité dans notre transaction 11:
Hugo de Gualardone).
(d) Le même Cartulaire
(p.422, cf. p. CCCL) enregistre la donation
d’une terre par le même Yves fils de Norbert lorsqu’à
sa dernière heure il se fit moine (De terra apud
Alonas ab Ivone, filio Norberti, data); il nous donne
le nom de sa femme Agnès (Agnes) et de son fils
Geoffroy, outre ses filles dont le nom n’est pas donné
(Filio suo Gaufrido et filiabus). Guérard date cet
acte entre 1069 et 1100; nous pouvons
préciser: entre 1094 et 1100.
|
ANONYMES
|
Anonymes (1):
certains parents (certis parentibus, C 30), membres de
la parenté de Rainaud fils de Thiou qui
sont indemnisés par les moines à
l’occasion de sa donation de Lomlu (transaction 17)
|
Anonymes (2): sa
femme (celle d’Amaury), ses deux fils et sa fille
(uxore sua, id
est Amalrici eiusdem, duobusque filis et filia,
B 22), l’épouse, les deux fils et
la fille d’Amaury Roux d’Ablis, qui consentent
à donation (transaction 9).
|
Anonymes
(3): nombreux témoins,
tant des moines que des chevaliers et des serfs
(testibus multis, tam monachis
quam militibus et famulis, D 5), de la donation
de Vierville par Gautier, à Marmoutier (transaction
1)
|
Anonymes (4): six hôtes
de Vierville (sex hospitibus
qui erant in eadem uilla, A 23-24),
dont les dîmes furent données
par Godéchal fils d’Oury (transaction
7)
|
Anonymes (5): quatre
familles de colliberts de Denonville, à savoir Geoffroy
avec ses fils et ses filles (quatuor
familias collibertorum de Danonisuilla, id
est Gaufredum cum filiis filiabusque suis,
B 31), données par Hardouin et sa mère
Hersent (transaction 14)
|
Anonymes (6):
de nombreux autres témoins (et alii plures, B 34), à
Chuisnes, de la donation de quatre familles
de colliberts par Hardouin et Hersent (transaction 14)
|
|
|
ANNEXE 3
RÉPERTOIRE
DES NOTIONS ÉVOQUÉES
Statuts
des personnes et des biens
Le liens familiaux
filius
(fils): A 14, 15, 16a, 16b, 16c,
16d, 17, 20, 21a, 21b, 22, 24a, 24b; B 25,
28a, 28b, 29a, 29b; C 33; D 1, 7a, 7b, 9a,
9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 12a, 12b, 13a,
13b, 13c, 13d, 14, 15a, 15b, 15c, 16a, 16b, 22a, 22b,
23a, 23b, 24a, 24b, 24c, 25, 26a, 26b, 26c, 26d, 27a,
27b, 28, 30a, 30b, 21, 32, 33, 34.
frater (frère):
A 11, 19, 22, B 25, 30, 31; D 8,
11, 14a, 14b, 27, 35.
uxor
(épouse): A 1, 8, 14;
C 34; D 1, 22, 27, 34. — uir (époux): D 6.— maritus (mari):
D 6.
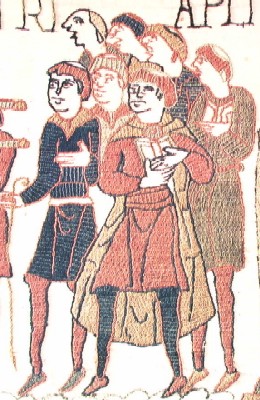 pater (père):
A 8, 12; D 7, 11, 32.
pater (père):
A 8, 12; D 7, 11, 32.
mater
(mère): A 15; B 25, 29; D 12,
30.
filia
(fille): A 22; D 32, 34.
soror (sœur ): B 27, 30;
D 34.
patruus (oncle
paternel): A 18; D 14.
certi parentes
(certains parents): C 30.
antecessores
(prédécesseurs, aïeux):
C 35.
familia (ensemble
de ceux qui sont soumis à l’autorité
du père de famille, y compris et surtout
les esclaves ou serfs que l’on appelle souvent dans
le latin du temps famulus; employé
seulement en parlant d’un en parlant de serfs,
ce qui semble indiquer que le terme signifie surtout
groupe de de serfs): D 32.
Le clergé
monachus (moine):
A 1, 8, 10, 11, 22,; B 25, 29, 32; C 34,
35, 36, 37, 38: D titre, 1, 4a, 4b, 5, 6a,
6b, 6c, 9a, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28,
30, 31, 32, 33. — fratres
(frères = moines): C 38, 40. — monachilis
habitus conventum nostrum (notre
communauté de vie monastique): B 9 b.
— desiderans fieri monachus (désirant
devenir moine): D 9. — iam monachus (désormais
moine): D 32. — monasterium pergere
domnus (monsieur, titre apparemment
réservé aux moines ou à
certains moines): B 29, 30; C 39; D, 7,
8, 13, 18, 26, 29, 32, 33.
abbas (abbé):
A 19; C 40; D 14, 33. — de Marmoutier:
C 40; D 33.— de Marmoutier: A 19; D
14.
prior
(prieur): de
Chuisnes: A 12 a, D 11a, 32. — d’Épernon:
D 28. — de Marmoutier: 12a,
D 11b.
prepositus Carnotensis (Hardouin
prévôt de Chartres):
D 33.
presbiter
(prêtre, curé):
B 27, 32; C 37. —
presbiter de Stonno (curé de Léthuin):
C 37.
canonicus (chanoine):
D 23.
clericus
(clerc): A 19a, 19b; C 37;
D 15a, 15b, 30, 33.
laici (les laïcs):
D 33.

 La noblesse
La noblesse
uicecomes
Castelliduni (Hugues
vicomte de Châteaudun): D 25.
miles
(chevalier): A 10; D 5, 7. — miles de Cramisiaco
(chevalier ed Cramoisy): A 10;
D 7.
caput ferri,
caput de ferro: heaume.
armiger (écuyer):
B 32.
(?)
marescalcus (A 16), mariscalis
(D 13): maréchal (ou
bien est-ce un nom propre?)
socius
(compagnon).
spata
(épée): C 31.
Le Tiers État
famulus
(serf): A 10, 13; B 32, 33a, 33b;
C 37; D 5, 6, 28, 31, 33. —
testibus multis, tam
monachis quam militibus et famulis (en présence de nombreux
témoins, tant chevaliers que moines
et que serfs): D 5. — Archembaldus
famulus Theudonis
monachi (Archembaud serf du moine Thion): A
9-10; cf. D 6. — Harduino
priore Sparronensi et Ermengiso famulo
eius (le prieur d’Épernon
Hardouin et son serf Armangise): D 28. — Rainaldus famulus Gaufredis
de Bello Monte (Rainaud serf de
Geoffroy de Beaumont): D 33-34
— Rotbertus medicus de
Stampis, Amalricus Rufus, Harduinus
clericus, Guarinus quidam famulus eorum
(le médecin Robert d’Étampes,
Amaury Roux, le clerc Hardouin et un certain
Garin leur serf): C 37 — Guauterius de Anglica Terra famulus
de Ventilaio (Gautier d’Angleterre serf
de Ventilaio): B 32-33. — Guauterius de Veruilla famulus
(Gautier serf de Vierville): B 33. — .
 hospes (hôte,
tenancier): 3a, 7, 23; D 18.
— hospitare, hospitari (accueillir
comme tenancier, être tenancier): A
3b; D 2, 17c, 21. — hospitale
(hôtise, sens spécialisé
assez rare du mot qui désigne généralement
un lieu d’hébergement, c’est-à-dire
d’habitude soit un hospice, un hôpital
ou une auberge; pour ce sens, Niermeyer
allègue seulement une charte éditée
pazr Métais dans son édition
du cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois):
D 17a, 17b.. — hospitalitas
(mot employé avec réserve,
duas ut ita dicam hospitalitates;
ce mot est déjà employé
par Grégoire de Tours au VIe siècle
dans le sens d’espace réservé
à l’hébergement): hôtise, tenure
(littéralement: deux si je puis
dire hospitalités; sens non attesté
par le Lexicon de Niermeyer, édition
de 1993).
hospes (hôte,
tenancier): 3a, 7, 23; D 18.
— hospitare, hospitari (accueillir
comme tenancier, être tenancier): A
3b; D 2, 17c, 21. — hospitale
(hôtise, sens spécialisé
assez rare du mot qui désigne généralement
un lieu d’hébergement, c’est-à-dire
d’habitude soit un hospice, un hôpital
ou une auberge; pour ce sens, Niermeyer
allègue seulement une charte éditée
pazr Métais dans son édition
du cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois):
D 17a, 17b.. — hospitalitas
(mot employé avec réserve,
duas ut ita dicam hospitalitates;
ce mot est déjà employé
par Grégoire de Tours au VIe siècle
dans le sens d’espace réservé
à l’hébergement): hôtise, tenure
(littéralement: deux si je puis
dire hospitalités; sens non attesté
par le Lexicon de Niermeyer, édition
de 1993).
collibertus
(collibert, serf): D 32
(autres graphies attestées par Niermeyer:
conlibertus, collibertus,
colibertus, conlibervus, collivertus,
colivertus). En ancien français
selon Godefroy: culvert, «individu
dont la condition était intermédiaire
entre l’esclavage et la liberté,
mais plus près de l’esclavage»;
sens dérivés: «pervers,
perfide, infâme, misérable,
vil, garnement, maraud; indigne, infâme,
horrible, funeste»; d’où:
culvertage: «état du
culvert, servage, asservissement; outrage, affront,
insolence»; culverté:
«méchanceté, malice»;
culvertise: redevance des culverts;
action digne d’un esclave, bassesse, indignité,
fourberie».
faber
(forgeron): B 28.
molendinarius
(meunier): B 28.
?
minerius (minier, mesureur de grain et
percepteur de la redevance afférente,
le minage?): B 10 (ou bien s’agit-il d’un
nom propre, Minier?)
mercator
(marchand): D 20 (Richerius mercator de Stampis)
medicus
(médecin): C 37 (Rotbertus
medicus de Stampis).
prepositus
de Alneello (Marin prévôt
laïc d’Auneau): D26-27. —
Les lieux
 uilla (village):
A 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 24; C 34; D 1,
3, 6, 8, 9, 12, 24.
uilla (village):
A 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 24; C 34; D 1,
3, 6, 8, 9, 12, 24.
corpus uillę
(l’ensemble du village): D 1.
exterior terra
(la terre extérieure au village
lui-même, le finage): D 3a,
3b.
terra
(terre): A 2; B 25; C 34; D 2, 3a,
3b, 16, 18, 21, 22, 29.
carruca
(charrue, unité de superficie
très approximative: ce que peut labourer
une seule charrue): A 3; C 34; D 2.
arpennus (arpent,
unité de surface selon les pays, ici arpents
chartrains): D 2.
area (emplacement):
A 6.
domus (maison,
domicile): A 6, 7; D 4, 5, 8, 25.
grangia (grange):
D 25.
claustrum (cloître):
A 11, 12; D 11a, 11b.
cimitherium
(cimetière, enclos de
l’église): D 4, cimiterio (id.): D 23.
fossatum (fossé):
D 23, 28.
Le régime
féodal
capitalis
dominus: D 11. Selon Niermeyer,
cette expression peut revêtir deux
sens très différents: 1) seigneur
de corps (lord of a serf),
c’est-à-dire seigneur dont la seigneurie
s’exerce non pas sur un bien immobilier,
mais sur une personne (voire sur d’autres
biens mobiliers tels que les chevaux et les
bœufs; au titre de quoi le seigneur
perçoit le chevage);
2) seigneur du seigneur; 3) seigneur principal.
On trouve aussi la précision suivante,
exprimée bien tardivement dans le Fleta, sive
Commentarius Juris Anglicani de
Fleta de John Selden, publié en 1647 (livre VI,
chapitre 1), mais cette observation est surement valable dès
le XIe siècle en France: Dominus capitalis
feodi loco haeredis habetur, quoties per defectum vel delictum
extinguitur sanguis tenentis: “Le dominus capitalis
d’un fief est tenu pour l’héritier à chaque
fois que s’éteint le sang d’un tenancier, soit
par défaut ou par forfaiture”.
 casamentum
(mouvance): D 22. [Casa en
latin classique signifie «barraque»; par suite casare
signifie en latin médiéval
«munir (un serf) d’une tenure» voire «munir
(un vassal) d’un fief»; casamentum a donc pour sens:
«acte de munier un vassal
d’un fief»; «suzeraineté féodale,
mouvance»; «fief»;
pour l’ancien français sous-jacent
chasement, Godefroy porte:
«fief, domaine, propriété».]
casamentum
(mouvance): D 22. [Casa en
latin classique signifie «barraque»; par suite casare
signifie en latin médiéval
«munir (un serf) d’une tenure» voire «munir
(un vassal) d’un fief»; casamentum a donc pour sens:
«acte de munier un vassal
d’un fief»; «suzeraineté féodale,
mouvance»; «fief»;
pour l’ancien français sous-jacent
chasement, Godefroy porte:
«fief, domaine, propriété».]
feuum
(fief; habere
in feuo, «avoir
en fief»): A 15, 18; D 13 [graphies
attestées par Niermeyer:
feu (indéc.),
feo, feus, feuz, fevus, fevum, fivum,
fievum, fevium, fegum, fiodum, feadum, feidum,
foedum, feudum, feuodum, fedum, fedium,
fedum (du gothique fëhu à
comparer avec le gothique faihu:
«bétail,
instrument d’échange, bien meuble».)]
respondere
(appartenir à, ressortir
de): A 4. Il est remarquable que Niermeyer
n’envisage ce sens, dans l’édition
de 1993, que pour des choses.
Dans notre texte ce verbe a clairement
pour sens: «dépendre, relever de
de l’autorité
de quelqu’un», «être l’homme de quelqu’un».
baculum (bâton):
D 9: dedit
hoc donum per unum baculum,
«elle
a opéré cette donation par le moyen
d’un bâton».
ramus
sebuci (rameau
de sureau): D 32-33: donationem fecerunt...
per ramum sebuci,
«ils ont
opéré cette donation par
le moyen dun rameau de sureau» [N.B.: L’orthographe normale
de «sureau» est
sabucum, ou
sabucus, voire
sambucus ou sambucus.]
cyroteca
(gant): D 24: dedit...
per cyrotecam... donum (il a opéré
la donation par le moyen du gant).
Les redevances
coutumières
attinere (être
afférent à une propriété):
D 3.
consuetudo
(coutume, droit coutumier,
redevance): A 4, 7; D 2. — consuetudines reddere
(rendre les devoirs coutumiers,
payer les redevances d’usage): A 4, 7. — terra ab omnibus consuetudinibus
absoluta (terre entièrement libre
de devoir coutumier, de redevances): D 2.
decima (dîme):
A 2, 3, 23; D 2, 16. — dîme
de l’église de Vierville
(A 2; D 2); dîmes perçues
sur certaines terres à Vierville
(A 3; D 16); dîme
perçue sur six tenanciers
à Vierville (A 23); D 2, 16.
camparcium
(champart): A 3,
4; D 3, campartium
(champart): D 21
[La première
graphie n’est pas attestée par Niermeyer,
éd 1993, qui présente:
campipars, campars, champars,
campipartum, campartum, champartum,
campipertum, campertum, champertum, campipardum,
campardum). champardum, campipartium, campartium, champartium].
terragium (terrage,
redevance exigée pour la permission
de cultiver des champs arables créés
par défrichement, consistant
en une part de fruits): D 17, 18, 21 [Autres
graphies: terraticus, terradium]:
ce terme semble synonyme du précédent.
? minerius (minier,
mesureur de grain et percepteur de la redevance
afférente, le minage?): B 10 (ou bien
s’agit-il d’un nom propre, Minier?)
censum (cens):
D 4.
sepultura (redevance
sur la sépulture): A 2 [et
sepelire (ensevelir): D
19].
reddere (rendre, s’acquitter
de): A 3 (consuetudines), 5-6 (camparcium), 7 (consuetudines);
D 4 (censum), 21 (terragium).
seruare (stocker,
surveiller [une redevance
en nature]): D 18 (terragium).
deferre (apporter
[une redevance en nature]): A 5
(camparcium); D3 (camparcium), 17 (terragium).
portare
(transporter [une redevance
en nature]): D 21 (campartium).
uersare
(verser, régler): D 21 (terragium).
Propriété,
gestion et transactions
habere (avoir):
A 15, 18; B 26; D 12, 13, 16, 17a,
17b, 18, 20. — habere
in feuo (avoir en fief): A 15, 18; D 13
tenere
de (tenir en fief
de quelqu’un): D 7, 8.
colere (cultiver):
D 3, 18, 21.
pertinere
(appartenir): A 9; D 6.
medietas
(moitié): D 7, 12,
13.
pars (part
): A 15, 17; D 8, 16.
maior
(maire, régisseur): D 7, 10.
uillicatio
(ferme; voirie): D 8, 16 [du
latin classique uillicus, régisseur
d’une uilla (domaine
rural); sens attestés par Niermeyer
pour uillicatio: travaux des
champs, charge de régisseur de domaine;
pouvoirs ou juridiction d’un maire; cour du maire,
centre administratif d’un domaine; tenure concédée
à un régisseur d’un domaine;
n’importe quelle tenure; droit de voirie ou
viguerie; charge de maire d’un village de franchise;
charge de maire d’une ville; charge d’un dignitaire
du palais (mérovingien); charge ou dignité
d’abbé].
commutare
(échanger): D 4 (uel
dare uel uendere uel commutare)
uendere (vendre):
A 5, 6; D 4.
Don
et contre-don
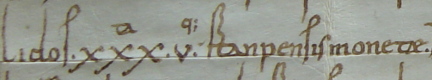 dare (donner):
A titre,
1, 5, 6, 9; B 30; C 34, 35; D titre, 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24a, 24b,
25, 26, 29a, 29b, 21.
— donum (donation):
A
9, 10, 11, 13; C 38; D 7, 10a, 10b, 12,
13, 16, 24, 26a, 26b, 29a, 29b, 30a,
30b, 34. — donare (donner): D 5. — donatio
(donation): B 27, 29; C 36; D 5, 9,
27, 32. —
tribuere (donner): B
25; C 39; D 30.
dare (donner):
A titre,
1, 5, 6, 9; B 30; C 34, 35; D titre, 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24a, 24b,
25, 26, 29a, 29b, 21.
— donum (donation):
A
9, 10, 11, 13; C 38; D 7, 10a, 10b, 12,
13, 16, 24, 26a, 26b, 29a, 29b, 30a,
30b, 34. — donare (donner): D 5. — donatio
(donation): B 27, 29; C 36; D 5, 9,
27, 32. —
tribuere (donner): B
25; C 39; D 30.
super
altare ponere (poser sur l’autel, rite
de donation à une communauté
ecclésiastique):
 concessio (consentement à une
donation relative à un bien sur
lequel on a des droits): A 24; D 9, 12. — concedere
(consentir à une donation
relative à un bien sur lequel on
a des droits): A 10, 14, 17, 23; B 26, 26-27;
D 8, 10, 12, 22a, 22b, 23, 24-25, 25, 27, 30, 34.
— auctorizare (permettre, consentir à une donation relative
à un bien sur lequel on a des droits):
D 5, 10, 13, 25. — concedere
et auctorizare (autoriser et permettre):
D 10, 25.—
annuere (permettre):
D 13. —
annuere et auctorizare
(permettre et autoriser): D13.
concessio (consentement à une
donation relative à un bien sur
lequel on a des droits): A 24; D 9, 12. — concedere
(consentir à une donation
relative à un bien sur lequel on
a des droits): A 10, 14, 17, 23; B 26, 26-27;
D 8, 10, 12, 22a, 22b, 23, 24-25, 25, 27, 30, 34.
— auctorizare (permettre, consentir à une donation relative
à un bien sur lequel on a des droits):
D 5, 10, 13, 25. — concedere
et auctorizare (autoriser et permettre):
D 10, 25.—
annuere (permettre):
D 13. —
annuere et auctorizare
(permettre et autoriser): D13.
sibi retinere
(se réserver): A 4, 5, 6; D 2, 3,
4, 9, 21.
caritas (charité,
affection envers le prochain commandée
par le christianisme): C 35.
solidus
(sou): B 30; D 8, 14, 18, 22, 29, 30.
— solidos
denariorum (sous de deniers, archaïsme
pour sous): D 30.
moneta
(monnaie): C 35; D 18. —
Stanpensis monetæ (monnaie
d’Étampes): C 35. —
Carnotensis monetę (monnaie
de Chartres): D 18.
reuestire (habiller
de neuf): D 14. Il est amusant que ce terme
apparaisse d’abord dans la littérature
en un sens mystique, chez Tertullien
(De Resurrectione, 42, 12). Surtout,
il y a ici une claire allusion au célèbre
épisode de la Charité Saint-Martin,
lors duquel le saint découpe son
manteau en deux pour en donner une moitié à
un pauvre, puisque de beneficio beati Martini reuestuit eum, il l’a vêtu de neuf par un bienfait de
saint Martin.
beneficium
(bénéfice):
B 31; C 39; D 8, 14, 18.
Les moyens du droit
pars (partie contractante):
B 32, 36a, 36b, 36c, 37; D 31.
conuenit
(il a été convenu):
D 4. — conuentio (convention): C 39.
uidisse et audisse
(avoir vu et entendu):
B 31 — adfuisse (avoir été
là): B 32, ou affuisse (id.):
C 36 — interfuisse (avoir assisté):
A 11; D 30.
testis
(témoin): A 15, 18, 24;
B 27; D 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 28, 33,
34.
|
ANNEXE 4
ÉDITION
PARTIELLE DE CES NOTICES PAR ÉDOUARD LEFÈVRE
Documents
historiques..., 1867
| Traduction proposée
par Lefèvre (1867) |
Texte donné par le
même (1867)
|
Nous avons peu de documents sur
Vierville et sur les seigneurs qui l’ont possédé;
voici l’acte le plus ancien que nous ayons trouvé;
il est du XIe siècle:
«Sachent tous nos
descendants que, pour le repos de leurs âmes,
Gautier d’Aunay et sa femme Mélisende ont
[p.297] donné au bienheureux Saint-Martin de Marmoutiers
et à nous, ses moines, la villa appelée
Vierville, l’église,
la dîme, la sépulture, une terre
de deux charrues de labour avec la dîme et
le champart ainsi que tous les hôtes qui voudroient
demeurer dans ladite villa; à condition toutefois
qu’ils nous rendront toutes les coutumes à Vierville
et non ailleurs, et qu’ils n’auront à répondre
que du champart hors ladite villa et qu’ils se sont réservé.
Dans le cas ou les donateurs voudroient donner ou vendre
l’objet de leur réserve, ils ne pourront le faire qu’en
notre faveur, ils ont retenu en outre une place dans la même
villa pour y bâtir une maison, à charge par eux
de nous rendre les coutumes comme les hôtes. Ce fut
fait à Saint-Avit dans la maison même de Gautier,
en présence du père de sa femme, Mélisende,
de Eudes Tête-de-fer et de Robert d’Ursion nos religieux,
auxquels Mélisende a fait ce don par le moyen d’un
bâton (1), comme étant
principale propriétaire des objets donnés:
d’Archambaud, domestique du moine Eudes, et de Eudes, chevalier,
de Cremisay... Cette donation fut faite du consentement de
Guerry et de sa mère Mélisende de qui Gautier
tenait en fief la moitié de la villa de Vierville,
ainsi que l’autre moitié qui appartenoit à Guillaume,
fils de Bernol d’Étampes... Godescal, fils d’Ulric de
Vierville nous abandonna aussi la dîme de ses hôtes
qui étoient dans la même villa. Au nombre des
témoins figurent Hubert de Denonville, et Gautier de Vierville:
|
Ante a. 1080*. — «Noverint
omnes posteri nostri quod Gauterius de
Alneto et uxor ejus Milesendis dederunt beato
Martino majoris monasterii et nobis suis monachis, pro
animabus suis, villam que dicitur
Vervilla et ecclesiam et decimam et sepulturam
et terram [p.298]
ad duas carrucas, cum decima et camparcio et omnes
hospites qui in eadem villa hospitari voluerint; ita
ut nobis reddant omnes consuetudines, nec alicui respondeant
de aliquo nisi nobis preter camparcium quod retinuerunt
sibi extra villam. Hoc reddent eis in eadem villa non alias deferentes.
Pepigerunt vero nobis si illud quod retinuerunt sibi, vellent
dare vel vendere, nulli alii se daturos vel vendituros nisi
nobis. Unam aream tantum retinuerunt sibi in eadem villa
ad domum sibi faciendam, de qua tamen reddent nobis omnes consuetudines
sicut hospites. Factum est hoc apud Sanctum Avitum in domo ipsius
Gauterii, presente patre uxoris ejus Milesendis Teudone Capite
de ferro et Roberto de Ursione (sic) nostris
monachis, quibus ipsa Milesendis dedit hoc donum per unum baculum,
quum id maxime pertinebat ad eam, et Archumbaldo (sic) famulo Teudonis monachi, et Teudone
milite de Cramisiaco.... Hoc etiam
donum ipsius Gauterii de Alneto et uxoris ejus Milesendis concessit
nobis Hugo filius Guerrici et mater ejus Milesendis, a quibus habebat
idem Gauterius in fevo partem unam illius ville Verville.... Aliam
vero partem hujus sepe dicte ville Verville concessit
nobis Guillelmus filius Bernollii de Stampis, quia habebat ille
Gauterius in fevo ab illo…. Sciendum est etiam quod Godescalis filius
Hulrici de Vervilla concessit Sancto-Martino
et nobis monachis suis decimam de sex hospitibus qui erant in eadem
villa. Hujus concessionis testes sunt.... Herbertus de
Danonvilla, Gauterius de Vervilla,
famulus (2)...»****
|
(1) Archiv. d’Eure-et-Loir; fonds de
l’abbaye de Marmoutiers (Note de
Lefèvre).
|
(2) Archiv. d’Eure-et-Loir; fonds de
l’abbaye de Marmoutiers (Note de Lefèvre).
|
Vers le même temps, Geoffroy de
l’Eau donna aux religieux de Marmoutiers une terre
d’une charrue de labour (42 hectares 80 ares environ),
et trois hostises (3) à Vierville et tout ce qu’il
possédait d’ailleurs dans cette villa; en reconnaissance
de cette libéralité les moines lui donnèrent
trente-cinq sols, monnaie d’Etampes (175 francs de
la monnaie actuelle): [p.299]
|
«Notificamus successoribus nostris quod Godefredus
de Aqua filius Felicie et Gila uxor ejus
dederunt sancto Martino majori monasterii et monachis ejus
terram ad unam carrucam et tres hosticias in villa que
Vervilla dicitur, et totum scilicet quicquid
in ea possidebat, pro salute animarum suarum et suorum antecessorum.
Dederunt tamen monachi eis in caritate solidos XXXta
Vque Stampensis monete (4)...»
|
(3) Au XIe siècle, la tenure
d’un hôte, c’est-à-dire sa maisonnette
avec la terre qui en dépendait, se nommait
un hospice, hospitium, hospitiolum,
et plus tard une hostise, hostisia
(Note de Lefèvre).
|
(4) Au XIe siècle, la tenure
d’un hôte, c’est-à-dire sa maisonnette
avec la terre qui en dépendait, se nommait
un hospice, hospitium, hospitiolum,
et plus tard une hostise, hostisia
(Note de Lefèvre).
|
Éditions
1) Édouard
(Pierre-Édouard-Alexandre) LEFÈVRE
(ancien chef de division à la Préfecture
d’Eure-et-Loir, historien de la Beauce, membre
correspondant du Comité des travaux historiques
et scientifiques et de plusieurs sociétés
savantes, historien de la Beauce), «Vierville»,
in ID., Documents historiques et statistiques
sur les communes du canton d’Auneau arrondissement
de Chartres (Eure-et-Loir) [2 volumes in-16,
ou in-12; extrait de l’Annuaire d’Eure-et-Loir
(1867) & (1868)], Chartres, Garnier, 1867-1869, tome
1 (1867), pp. 295-301, spécialement pp. 297-299
[le texte est daté d’avant 1080, ce qui ne se peut
guère; deux erreurs de lecture seulement].
2) Bernard
GINESTE [éd.], «Édouard Lefèvre:
Vierville (1867)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-edouardlefevre1867vierville.html,
2008.
|
ANNEXE
5
ANALYSE
PAR RENÉ MERLET
Inventaire-Sommaire, 1897
|
H.2254. (Liasse.) — pièces,
parchemin.
V. 1090.
— Donation à l’abbaye de Marmoutier
par Gautier d’Aunay, Gaulterius
de Alneio, et Mélissende,
sa femme, de la ville de Vierville,
totum corpus ville que dicitur Verisvilla:
confirmations de ce don par Arnaud, fils d’Alberède,
Ernaldus filius Alberede;
Hardouin Tête-de-Fer,
Harduinus Caput Ferri, frère
de Mélissende; Hugues, fils de Guerry,
et sa mère Hélissende; Guillaume,
fils de Bernoald d’Etampes; Hugues de Gallardon.
— Dons: par Godescald, fils d’Ulric, Godescallus
[erreur de lecture: Godescalis (B.G.)],
filius Hulrici, de Vervilla, et
Éremburge, sa femme, de la dîme
de 6 hôtes qu’ils possédaient à
Vierville; — par Amaury le Roux d’Ablis,
Amalricus Rufus de Ableis, de
deux hostises audit Vierville; — par Hardouin Tète-de
Fer et Hersende, sa mère, de 4 familles
de colliberts à Denonville, quatuor familias collibertorum
de Danonisvilla; — par Renaud, fils de Tétulf,
de la terre de Lomlu, terram
que Lomlu vocatur; — par Geoffroy de l’Eau,
Godefredus de Aqua, d’une charruée
de terre et de trois hostises à Vierville.
|
René MERLET, Inventaire
sommaire des archives départementales
antérieures à 1790,
rédigé par M. René
Merlet,... Eure-et-Loir. Archives ecclésiastiques.
T. VIII. Série H, tome I
[grand in-4°], Chartres, Garnier, 1897.
|
ANNEXE
6
Données sur la famille Chef-de-Fer
6a. Étienne, Thion et Aymon
Chef-de-Fer témoin de la dédicade
de l’église de Chuisnes (vers 1055).
6b. Mention de Thion,
Aymon et Hardouin Chef-de-Fer (entre 1064 et 1089).
6c. Mention du chevalier Thion Chef-de-Fer
à Roinville (1079).
6d. Thion Chef-de-Fer
moine à Bréthencourt (vers 1080).
6e. Donation à Chuisnes d’Hardouin, chevalier
du château de Courville (vers 1090).
6f. Donation d’Hardouin à Chuisnes.
6g. Hardouin témoin à Chuisnes
(mars 1094).
6h. Donation d’Hardouin et son fils Hugues à
Roinville (fin XIe siècle).
6i.
Hardouin témoin d’une
donation d’Hugues de Gallardon (non
daté).
|
|
Étienne,
Thion et Aymon Chef-de-Fer témoins de
la dédicace de Chuisnes
Dotation et dédicace de l’église de
Chuines par Yves de Courville et Aivert de Chartres (vers 1055)
Selon Depoin, Thion (Teudo) est
cité avec son père Etienne (Stephanus
Caput de ferro) et son frère Aymon
(Amo) dans une charte d’Aivert
(Agobardus), évêque
de Chartres, entre 1049 et 1060 (Coll.
Moreau, XXIV. 152). Son texte a été
édité par Mabille dans son cartulaire Dunois, mais
d’après une mauvaise copie de don Martène. En fait
l’original de cette charte, qui est en même temps donnée
par le sire de Courville et par l’évêque de Chartres,
est encore conservé aux archives départementales
d’Eure-et-Loir sous la cote H 2309. En voici le texte,
édité ici pour la première fois d’après
l’original, et traduit.
Texte établi par B.G., 2008
|
Traduction
proposée par B.G. (2008)
|
Notitia de dedicatione
æcclesiæ Cheonii
|
Notice sur la dédicace
de l’église de Chuisnes
|
In nomine sanctę et individuę
Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cum utroque caritatis
genere, utilitatis [corr. utilitatibus] scilicet atque benivolentia
summum bonum adquiratur et
sanctę matris ęcclesię res augere vel auctas servare maxima
pars esse beneficientię multa auctoritate probetur,
|
Au nom de la sainte et indivise
Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Étant considéré que c’est par les deux espèces
de la charité, à savoir par les services rendus
et par la bienveillance, que l’on acquiert le plus parfait des biens,
et vu qu’il est prouvé par de nombreux auteurs qu’accroître
les possessions de notre sainte mère l’Église,
ou préserver ces accroissements, constitue le point principal
de la bienfaisance,
|
ego quoque Ivo de Curvavilla,
spe vitę ęternę promotus, ac pro redemptione animę meę et
fratris me Otranii, uxorisque meę Agathę omniumque filiorum meorum
ac filiarum mearum, hui ęcclesię sanctorum martyrum Gervasii et Protasii
Cheonii a donno Wilelmo Predicatore constructę, in dedicatione
ipsius a donno Aiverto facta tunc temporis Carnotensis ęcclesię,
augeo dotem.
|
moi aussi, Yves de Courville,
poussé par l’espérance de la vie éternelle,
et pour le rachat de mon âme, de celle de mon frère
Otran, de ma femme Agathe, de tous mes fils et de toutes mes
filles, j’augmente la dotation de cette église des saints
martyrs Gervais et Protais bâtie par dom Guillaume le Précheur,
à l’occasion de sa dédicace faite par dom Aivert, présentement
évêque de Chartres.
|
Molendinum etenim unum sub cet
trenchesac qui michi paterno jure contigerat in ipsis fundamentis
ęcclesię viro concesseram religioso scilicet donno Wilelmo,
assensu domini mei Gilduini vicecomitis, filiorumque ejus Arduini
atque Ebrardi, a quibus habeo totam terram Curvavillę, cum ęcclesia
una et omnibus subjacentibis ei, servis vel ancillis, magnis vel
parvis; nunc ad usum monachorum ibi Deo famulantium in perpetua possessione
concedo.
|
Et en effet j’avais concédé
un moulin à côté de Cet Trenchesac
qui me revenait par héritage de mon père, à
l’occasion de la fondation de l’église, à un homme
religieux, à savoir Guillaume le Précheur, avec
le consentement de mon seigneur le vicomte Gidouin et de ses fils
Hardouin et Évrard, de qui je tiens tout le territoire
de Courville, avec une église et tout ce qui en relève,
serfs et serves grands ou petits. Je le concède à
présent pour qu’ils en usent et le possèdent à
perpétuité aux moines qui servent Dieu en ce lieu.
|
Addo autem totam terram Charmeti
cum hospitibus decem et silvula una, et pratum unum quod dicitur
Magnum, omnesque consuetudines burgi cellę illius a sexta feria,
mediante die usque in quarta ejusdem horę, cum uxore mea et omnibus
natis meis atque nepotibus in perpetuo concedo.
|
J’y ajoute toute la terre du
Charmoy, y compris dix serfs et une petite forêt, et
un pré appelé le Grand, ainsi que tous les droits coutumiers
du bourg de ce prieuré depuis le vendredi midi jusqu’au
mercredi même heure, et je concède cela à
perpétuité, de concert avec mon épouse, tous
mes enfants et mes neveux.
|
Ne quis autem hoc donum aliquo
modo infringere presumat, ego Aivertus Dei gratia Carnotensis
episcopus qui inquantum meę fragilitati promittitur hanc dedicationem
perago, omnibus calumpniatoribus hujus doni, nisi resipiscentes
venerint ad emendationem, potestate adeo michi tradita, abnego communionem
ęcclesię et excommunicando et anathematizando a conventu fidelium
catholicorum eitio.
|
Afin que personne n’ose enfreindre
cette donation, moi Aivert, par la grâce de Dieu évêque
de Chartres, qui effectue cette dédicace, à
qui cette tâche est confiée en dépit de ma
fragilité, je dénie à tous ceux qui contesteraient
cette donation la communion de l’Église, s’ils ne venaient
pas à s’amender, et je les expulse par l’excommunication
et l’anathème de l’assemblée des fidèles
catholiques. |
|
Testes
autem sunt isti: Hugo decanus, Arnulfus precentor, Fulcherius, Hugo, Wilelmus
archidiaconi, Radulfus, Guido, Sugerius, Fulbertus, Galterius, Rainaldus,
Aimericus, Johannes, Odo, Radulfus, canonici Sanctę Marię, Rotrudus comes,
Albertus filius Ribaldi, Gaszo de Castello, Hugo vicedominus, Amalricus de
Sparnoto, Simon et Mainerius filius ejus, Aimericus de Vilerez, Wilelmus
de Cusmont, Hato de Digneto, Ivo de Curvavilla, Girouis et Radulfus filii
ejus, Hubertus Mordenz, Galterius et Ivo nepotes eius, Gunterius de Curvavilla,
Stephanus Caput de Fero et filii eius Teudo et Aimo.
|
Et voici les témoins: le
doyen Hugues, le chantre Arnoux, les archidiacres Foucher, Hugues
et Guillaume, les chanoines de Notre-Dame Raoul, Guy, Suger, Foubert,
Gautier, Rainaud, Aimery, Jean, Eudes et Raoul, le comte Rotrou,
Aubert fils de Ribaud, Gasce du Château, le vidame Hugues,
Amaury d’Épernon, Simon et son fils Mainier, Aimery de
Villeret, Guillaume de Cusmont, Haton de Digné, Yves de
Courville, ses fils Giroie et Raoul, ses neveux Hubert Mordant, Gautier
et Yves, Gontier de Courville, Étienne Chef-de-Fer et ses
fils Thion et Aimon. |
|
De monachis:
Genzo prior, Ascelinus cellerarius, Rainfredus, Martinus,
Galterius sacerdotes, Martinus diaconus, Gislebertus, Garinus,
Randuinus laici.
|
Parmi
les moines: le prieur Gance, le cellerier Ascelin, les prêtres Rainfroy,
Martin et Gautier, le diacre Martin, les laïcs Gibert,
Garin et Randouin.
|
Éditions
1) Original: parchemin conservé
aux Archives départementales de l’Eure-et-Loir sous
la cote H 2309.
2) Bernard GINESTE [trad. & éd.], «Dotation et dédicace de l’église de Chuines
par Yves de Courville et Aivert de Chartres (1049-1060)»,
in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant
Vierville (fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06a,
2008.
|
ANNEXE 6b
Mention de Thion, Aymon et Hardouin
Chef-de-Fer
Charte de Geoffroy Ier de Chartres
(entre 1064 et 1089)
Selon Depoin, Thion (Teudo filius
Stephani Caput de Ferro cognominati) est cité
avec son frère Aymon (Haimo)
et son fils Hardouin (Harduinus) comme témoin
de la donation par son seigneur Giroie de Courville de
l’église Saint-Nicolas de cette ville aux moines
de Marmoutier, avec le consentement de Geoffroy Ier, évêque
de Chartres, entre 1064 et 1089 (Coll.
Moreau, XXVIII, 152-168). Je donnerai ici
ultérieurement le texte apparemment inédit
de cette charte, lorsque j’aurai eu le loisir de consulter
le volume en question de la Collection Moreau.
Texte à
venir
|
Traduction
proposée par B.G. (2008)
|
|
(entre 1048 et 1060)
[...] Teudo, filius Stephani Caput de Ferro cognominati;
Harduinus filius ejus; Haimo frater ejus [....]
Collection Moreau,
t. XXVIII, ff. 152-168
|
(entre 1048 et 1060)
[...]
Thion, fils d’Étienne
Chef-de-Fer; son fils Hardouin; son frère Aymon [....]
|
|
|
ANNEXE
6c
Thion
Chef-de-Fer consent à une donation
Don de la terre du
Pendant-Piégeux (entre 1067 et 1078)
Capitulum XCVII.
De terra
data a Roscelino in Pendente
Pediculo.
Ante a. 1080.
|
Chapitre 97.
De
la terre donnée par Roscelin au Pendant-Piégeux.
(entre 1067 et 1078) (1)
|
Notum esse volumus tam præsentis
quam futuri evi Christi fidelibus, nos monachi Sancti Petri,
quoniam
|
Nous voulons qu’il soit connu des fidèles
du Christ tant présents qu’à venir, nous, les moines
de Saint-Père, ceci.
|
terram Pendentis
Pediculi, in conversione Roscelini monachi, frater ejus Gerogius
medietatem quidem sancto Petro dedit in stipendiis fratrum, per
assensum Teudonis qui cognominatur Caput Ferri, cui annualim de parte
nostra debentur duodecim nummi in censu;
|
Lors de l’entrée en religion
du moine Roscelin, son frère Giroie avait donné
à Saint-Père la terre du Pendant-Piégeux (2), du moins la moitié, pour les pébendes
des frères, avec le consentement de Thion Chef-de-Fer, à
qui sont dus chaque année de notre part deux deniers au titre
du cens. |
postea vero ipsa terra a Fulcherio,
filio Girardi, et a Gerogio de Curba Villa ambitione est invasa,
de quorum esse videbatur beneficie. Quibus ut assensum praeberent,
Fulcherio quidem quinquaginta nummorum solidos dedimus, et Gerogio
XXX; atque ipsi super altare sancti Petri guerpum ponentes, eandem
terram possidendam concesserunt, tantum ut in festivitate sancti
Remigii census praedictus reddatur.
|
Mais ensuite la dite terre par
brigue fut usurpée par Foucher fils de Girard (3) et par Giroie de Courville, de qui elle passait
pour être le fief. Et pour qu’ils donnent leur consentement,
nous avons donné cinquante sous à Foucher, et trente
à Giroie. Et ceux-ci ont posé cette cession sur l’autel
de saint Pierre, concédant la dite terre en possession pourvu
que le cens susdit soit versé à la Saint-Rémi.
|
Actum est hoc in æcclesia sancti
Petri publice, videntibus et audientibus his quorum nomina subnotavimus:
Gualterio monetario, Gerogio clerico, Stephano majori, Arnulfo
Rufo; Fulchardo; Stephano, Aventio et Laurentio, [p.221] fratribus, Ascelino majore; Teduino,
Gaudio et Harduino, fratribus; Willelmo, Arraldo, Hildegario et
Radulfo, filio ejus.
|
Cela s’est fait publiquement dans l’église
Saint-Père, et l’ont vu et entendu ceux dont nous avons porté
les noms ci-après: le monnayeur Gautier, le clerc Giroie, le
régisseur Étienne, Arnoux Roux, Fouchard, les frères
Étienne, Avence et Laurent, le régisseur Ascelin, les
frères Thoin, Gaud et Hardouin, Guillaume, Airaud, Augier et
son fils Raoul.
|
NOTES DE BERNARD
GINESTE (2008)
(1) Cette charte est mentionnée par l’auteur
du Vetus Agano (Cartulaire, éd. Guérard,
p.226) comme datant de l’abbé Hubert (1067-1078), à
qui Eustache succède en 1079.
(2)
Ce toponyme (non cité par le Dictionnaire topographique
de Merlet) est difficile, parce que le sens du latin censé
le rendre n’est pas clair. Pediculus, en latin classique,
a déjà trois sens tout à fait distincts:
1. pediculus, i, m: «petit pied, pédoncule»
(de pes, pedis, m: «pied»);
2. pediculus, i, m: «pou» (de pedis,
is, m: «pou»), qui a donné le français
pou via une forme intermédiaire peduculus;
3. pediculus, i, m: ou pediculum, i, n: «fil,
lacet» (de pedica, ae, f: «lacets, lacs»,
qui a donné le français piège); le
Lexicon de Blaise y ajoute deux acceptions en latin médiéval
(mais sans référence, et elles ne sont pas reprises par
le lexique plus récent de Niermeyer): 4. «prison, cachot»;
5. «éminence, élévation». Le participe
pendens pourrait incliner à comprendre: «le
piège suspendu»; mais le sens de «pencher»
est aussi attesté pour pendre en ancien français,
selon le Lexique de Godefroy, et on note en latin classique que
pendulus peut signifier «en pente»; aussi
le cinquième sens proposé par Blaise peut-il reposer
sur sun passage qu’il aura lu où le sens réel était
«terrain en pente». Notre restitution hasardeuse s’appuie
sur l’existence dans la commune de Saint-Georges-sur-Eure, précisément
dans le canton de Courville-sur-Eure où Thion Chef-de-Fer
était possessionné, d’un ruisseau appelé le
Fossé-piégeux (Dictionnaire toponymique
de Merlet).
(3)
Ce Foucher fils de Girard est mentionné par le Nécrologe
de Notre-Dame de Chartres pour avoir vendu l’emplacement du futur
Hôtel-Dieu de cette ville à la comtesse Berthe. Cette
sœur de Thibaud III, après la mort de son mari Alain, duc
de Bretagne, revint finir ses jours à Chartres entre 1050
et 1080 (Lépinois, Histoire de Chartres, 1854,
t. I, p. 332). Foucher est mentionné à deux autres reprises
par le Cartulaire de Saint-Père: avant 1080, il vend
aux moines de Saint-Père sa voirie de Mittainvilliers, dans
l’actuelle commune de Courville (n°LXIX, pp. 194-195; il est par
ailleurs témoin d’un autre acte, également avant 1080 (n°LXXXI,
pp. 206-207).
Éditions
1)
Benjamin GUÉRARD
(directeur de l’École des chartes en 1848,
conservateur au département des manuscrits de la
bibliothèque impériale en 1852), [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp. 220-221 [dont une réédition
numérique par Google, en ligne
en 2008].
2) Bernard GINESTE
[trad. & éd.], «Don de la terre du
Pendant-Piégeux (avant 1080)», in ID. [éd.],
«Thion Chef-de-Fer: Notices
concernant Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06c,
2008.
|
ANNEXE 6d
Mention de Thion Chef-de-Fer en 1079 à Roinville-sous-Auneau
Don de l’église
de Roinville-sous-Auneau (1079)
Nous donnons ici
le texte d’une autre charte
faisant mention de Thion Chef-de-Fer.
Conservée dans une copie de 1118
par le Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs,
au folio 18, sous le numéro
39, elle a d’abord été éditée
par dom Marrier en 1637 dans son Historia
du monastère royal de Saint-Martin-des-Champs
(p. 366), puis par Joseph Depoin et Coüard
en 1905 dans leur édition du Liber
Testamentorum de l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs
(pp. 50-52). Enfin Depoin l’a rééditée
en 1912 avec de nouvelles notes et une datation
plus précise en 1912 dans le premier volume
de son Recueil de chartes et documents de
Saint-Martin-des-Champs (pp. 41-43). On notera que Depoin
se trompe en disant qu’il s’agirait de Roinville-sous-Dourdan, car
il n’est que Roinville-sous-Auneau, en Eure-et-Loir, à détenir
une église Saint-Georges.
Je donne ici la note 40 de l’édition
de 1912, où Depoin explique comment
il est finalement parvenu à la
datation précise de 1079:
Les mentions
relatives
au clergé chartrain permettent
d’affecter une date presque sûre
à cette notice. L’archidiacre Guillaume
et le préchantre Haudoin étaient
encore en fonctions en 1100 (Luchaire,
Annales de la vie de Louis VI,
n°330). Cependant le doyen Enguerran dont il
est ici question, n’est point le second de ce nom,
confondu avec son homonyme cité de 1060 à
1076. La Gallia christiana n’a su
les distinguer, ayant ignoré le décanat
d’Aimar en 1080 (Coll. Baluze, t. 32,
p. 125). Alard qui est ici sous-doyen, est qualifié
archidiacre sous Aimar (ibid). Nous
le reverrons peu après doyen, en 1081 ou 1082.
Il mourut le 8 septembre, en 1082 sans doute, car en
1083 la Gallia note comme exerçant
le décanat Enguerran. C’est Enguerran
II, que nous verrons déjà archidiacre
sous le doyen Alard. Puisque la charte que nous
annotons montre Alard encore au milieu de l’échelle,
il faut que le doyen soit Enguerran Ier,
et la notice, qui fait état de l’arrivée
des moines clunisiens, concerne un fait de 1079,
de très peu postérieur à
l’appel qui leur fut fait. — Le décanat de Jehan
du Grand-Pont, au chapitre de Paris, remonte bien
plus haut que la date de 1083 donnée par la
Gallia (VII, 37). Il a vraisemblement
pris la place du B. Milon quand celui-ci fut
désigné pour l’évéché
de Bénévent qu’il occupa
deux ans (1074-23 février 1076).
Notice de l’édition
de 1905
|
Notice de
l’édition de 1912
|
| Acte XXXIX [fol. XVIII]. (Vers
1083) |
Acte 20 (1079)
A. Original perdu.
B.
Copie de 1118, Liber Testamentorum, fol.
18, no 39.
Edit.
Marrier, Mon. S. Martini historia, p.
366.
|
Gauslin III de Lèves,
fils de Gauslin II Le Riche, sa femme
Eudeline, Ade, veuve du vidame Hugues
I, et son fils Aubert, du consentement du
clerc Hugues, son autre fils, donnent à Saint-Martin
la moitié de l’église
Saint-Georges de Roinville. Geofroi I, évêque
de Chartres, et le grand-archidiacre Heugier
approuvent ce don.
L’autre moitié de l’église
est donnée par Gautier,
fils de Flahaut, vassal de Teudon Chef-de
Fer.
|
Gauslin III de Lèves,
fils de Gauslin II Le Riche, sa femme
Eudeline, Ade, veuve du vidame Hugues
I, et son fils Aubert, du consentement du clerc
Hugues, son autre fils, donnent à
Saint-Martin la moitié de l’église
Saint-Georges de Roinville. Geofroi
I, évêque de Chartres, et
le grand archidiacre Heugier, approuvent ce don.
L’autre moitié de
l’église est donnée par
Gautier, fils de Flahaut, vassal de Thion
Chef-de-Fer.
|
Notes de l’édition
de 1905
|
Texte des deux éditions
|
Notes de l’édition
de 1912
|
(190) [p.43] Gauslin
III de Lèves eut d’Eudeline deux fils, Gauslin
IV et Geofroi (Coll. Moreau, XXV,
29. Cf. n° VI suprà et n° XXXIX).
— Ces notices ont échappé
à MM. Merlet et de Clerval qui ont
confondu divers anneaux de la généalogie
des seigneurs de Lèves (Un manuscrit
chartrain du XIXe siècle).
(224)
[p.50] Renaud,
vidame de Chartres, eut trois fils de sa
femme Ode: Aubert, mort le 10 juillet
1032, Hugues I, qui le remplacèrent
successivement, et Hellouin, chanoine de Chartres.
Hugues était marié dès
1045 à Ade ou Adèle, dont il eut trois
fils, Guerri, Hugues, Aubert II (Cart. de Marmoutier
pour le Dunois, p. 33). — Guerri succéda
directement à son père
(Guérard, Cart.
de St Père de Chartres, p. 212); Hugues
fut clerc.
(225)
[p.50] Puisque,
d’après la notice n°VI, Ade
était mère de Gauslin
III de Lèves, c’est qu’elle avait
eu deux maris, dont le premier fut Gauslin II
Le Riche.
(36)
[p.9] Roinville,
c. Dourdan, a. Rambouillet [Erreur de
Depoin, il ne s’agit pas de Roinville-sous-Dourdan en Essonne,
ancienne Seine-et-Oise, mais de Roinville-sous-Auneau, en Eure-et-Loir
(B.G.)].
(45)
[p.11]
Geofroi I, évêque
de Chartres, élu le 30 juillet 1077, déposé
en 1089, fut remplacé
par le célèbre Ives de
Chartres (Gallia, VIII, 1126).
|
Gauslenus filius G.
Divitis (190)
(37)
et uxor ejus Odelina, Albertus filius
H. vicedomini (224)
(38), Ada mater
ejus (225), annuente Hugone clerico, Deo Stoque
Petro Cluniacensis ecclesie ad obedientiam
Sti Martini de Campis, pro redemptione animarum suarum,
dederunt apud Rodanivillam
(36) (39) medietatem æcclesiæ
Sti Georgii martiris, [p.51] altare scilicet,
annuente Gaufrido Carnotensi episcopo
(45), et Hildegario archidiacono,
et terram unius carruce, et agripennum terre ad
vineam faciendam et ad hortum ac viretum sufficientem,
et omnia hospicia ejusdem ville, cum curiis
et ortis, et medietatem pratorum ac molendinorum,
et furnos, et omnem justiciam ejusdem ville.
|
(37) Gauslin
Ier Le Riche, mari d’Humberge, souscrit,
en 1048, un diplôme de Henri Ier sous
cette forme: "Signum Gauslini casati Carnotensis".
(Lucien Merlet, Cartulaire
de N.-D. de Chartres, I, 90), Gauslin II épousa
Ade qui en 1045 était encore unie
à son premier mari, le vidame de Chartres
Hugues Ier, Gauslin III mari d’Eudeline, et Aubert
II fils du vidame Hugues, étaient donc frères
utérins.
(38)
Renaud, vidame
de Chartres, eut trois fils de sa femme
Ode: Aubert, mort le 10 juillet 1032, Hugues
I, qui le remplacèrent successivement,
et Haudoin, chanoine de Chartres. Hugues était
marié dès 1045 à
Ade ou Adèle, dont il eut trois fils: Guerri,
Hugues, Aubert II (Cart. de Marmoutier
pour le Dunois, p. 33). Il prit part au siège
de Thimert en 1059. Guerri succéda
directement à son père (Guérard,
Cart. de St-Père de Chartres, p.
212); il était en charge en 1063. Hugues fut
clerc. Aubert II suivit en Angleterre, en 1066,
Guillaume le Conquérant (Merlet et de Clerval,
Un manuscrit chartrain du XIe
siècle, p. 117).
(39) Roinville,
ca. Dourdan, ar. Rambouillet (Seine-et-Oise).
[Erreur de Depoin, il ne s’agit pas
de Roinville-sous-Dourdan en Essonne, ancienne Seine-et-Oise, mais
de Roinville-sous-Auneau, en
Eure-et-Loir (B.G.)].
|
(41) [p.8] Alard était
archidiacre sous le décanat
d’Aimar en 1080 (Coll. Baluze,
XXXII, [p.9] 125).
Aimar s’intercale entre deux homonyme
confondus par le Gallia
(VIII, 1197): Enguerran I, de 1060
à 1076 et Enguerran II, cité
en 1083 (Mabillon, De re dipl.,
l. VI, c. 60). Cet Enguerran II est probablement
celui qui fut chancelier sous l’évêque
Arraud (1070, 10 février 1075).
— Alard fut sous-doyen sous Enguerran II, auquel il
sudccéda (Gallia, ibid.). Il
était remplacé par Ernaud dès
1092.
(226)
[p.51]
Jehan du Grand-Pont fut doyen de
Paris de 1083 à 1089 (Gallia,
VII, 37). Le doyen de Chartres est donc
Enguerran II, successeur dès 1083
d’Aimar, qui était en charge en 1080 (note
41 suprà).
Hellouin était encore préchantre,
et Guillaume, archidiacre en 1100 (Luchaire,
Louis VI, 330). Heugier, Heugaud
et Ilbert n’étaient plus alors en fonctions.
(224)
[p.50] Renaud,
vidame de Chartres, eut trois fils de sa
femme Ode: Aubert, mort le 10 juillet 1032,
Hugues I, qui le remplacèrent successivement,
et Hellouin, chanoine de Chartres. Hugues
était marié dès 1045 à
Ade ou Adèle, dont il eut trois fils, Guerri,
Hugues, Aubert II (Cart. de Marmoutier pour
le Dunois, p. 33). — Guerri succéda directement
à son père (Guérard,
Cart. de St Père de
Chartres, p. 212); Hugues fut clerc.
(227)
[p.51] Levesville-la-Chenard,
c. Janville, a. Chartres. Cette paroisse
a pris son nom des Chenard (Chanardus,
Canardus), que nous rencontrons
plus d’une fois dans le Liber testamentorum:
Aimeri (notice XXXVIII), fils de Renaud
(notices XL et LVI), etc.
(192)
[p.44] Robert
Aiguillon II, d’une famille du pays chartrain,
fils de Robert I, fils de Landri, avait
pour frères, outre Goufier, nommé
ici [c’est-à-dire
p. 44], Guillaume I
et Manassé I (App. au Cartulaire
de St Martin, p. 351).
(228)
[p.51]
Germond, fils d’Avesgaud,
seigneur de Maintenon (a. Chartres).
Son fils Mainier, cité dans la notice
XXXIII, donna à Marmoutier, vers 1105,
l’église Notre-Dame élevée
dans l’enceinte de son château (Arch.
d’Eure-et-Loir, H. 2340).
|
Et hoc donum testantur Ingelrannus
decanus (41),
Johannes decanus [p.42]
Parisiensis (226),
Adelardus subdecanus (41) (40), Hilduinus
cantor, Hilgotus, Ilbertus, Willelmus archidiaconus,
Ebrardus capicerius, Giraldus presbiter, Raimbaldus
c[anonicus], Werricus vicedominus (224) (38), Ebrardus
de Lavesvilla (227) (41), Willelmus
prepositus, Rotbertus Aculeus
(192) (42), Radulfus
Lacunella, Germundus filius Avesgoth
(228)
(43), Ebrardus Helmonis filius, Walterius
filius Fledaldi. |
(40) Les mentions
relatives au clergé chartrain permettent
d’affecter une date presque sûre
à cette notice. L’archidiacre Guillaume
et le préchantre Haudoin étaient
encore en fonctions en 1100 (Luchaire,
Annales de la vie de Louis VI, n°
330). Cependant le doyen Enguerran dont il est
ici question, n’est point le second de ce nom, confondu
avec son homonyme cité de 1060 à
1076. La Gallia christiana
n’a su les distinguer, ayant ignoré le
décanat d’Aimar en 1080 (Coll. Baluze,
t. 32, p. 125). Alard qui est ici sous-doyen, est qualifié
archidiacre sous Aimar (ibid). Nous le reverrons
peu après doyen, en 1081 ou 1082. Il mourut
le 8 septembre, en 1082 sans doute, car en 1083 la Gallia
note comme exerçant le décanat Enguerran.
C’est Enguerran II, que nous verrons déjà
archidiacre sous le doyen Alard. Puisque la
charte que nous annotons montre Alard encore au milieu
de l’échelle, il faut que le doyen soit Enguerran
Ier, et la notice, qui fait état de l’arrivée
des moines clunisiens, concerne un fait de 1079, de
très peu postérieur à l’appel
qui leur fut fait. — Le décanat de Jehan du Grand-Pont,
au chapitre de Paris, remonte bien plus haut que la date
de 1083 donnée par la
Gallia (VII, 37). Il a vraisemblement pris
la place du B. Milon quand celui-ci fut désigné
pour l’évéché de Bénévent
qu’il occupa deux ans (1074-23 février
1076).
(41) Levesville-la-Chenard,
ca. Janville, ar. Chartres. Cette
paroisse a pris son nom des Chenard (Chanardus,
Canardus), que nous rencontrons
plus d’une fois dans le
Liber Testamentorum: Aimeri
fils de Renaud etc.
(42) Sur
les "Aiguillon" du pays chartrain,
cf. Depoin, Appendices
au Cartulaire de St-Martin de Pontoise,
p. 351.
(43) Germond,
fils d’Avesgaud, seigneur
de Maintenon (a. Chartres), probablement
gendre de Mainier d’Epernon, témoin
en 1067 (n°12 supra).
Son fils Mainier, cité dans la notice
27, donna à Marmoutier, vers 1105,
l’église Notre-Dame élevée
dans l’enceinte de son château (Arch. d’Eure-et-Loir,
H. 2340).
|
(228)
[p.51]
Germond, fils d’Avesgaud, seigneur
de Maintenon (a. Chartres). Son fils
Mainier, cité dans la notice XXXIII,
donna à Marmoutier, vers 1105,
l’église Notre-Dame élevée
dans l’enceinte de son château
(Arch. d’Eure-et-Loir, H. 2340).
|
Qui etiam Walterius alteram
partem ejusdem æcclesiæ supradicta
ratione, Sto Petro et fratribus Sti Martini dedit,
annuente uxore sua et filiis, testantibus
istis supradictis. Et hoc donum concessit Teudo
Caput Ferri (228)
(44) et uxor ejus Hersendis et Harduinus
filius ejus, quia Walterius illud tenebat
ab illis.
[p.43]
|
(44) Etienne Chef-de-fer
est nommé avec ses fils
Thion et Aimon dans une charte d’Agbert (Agobardus),
évoque de Chartres, entre
1049 et 1060 (Coll. Moreau,
t. 24, p. 192).
|
(229) [p.51] Nocé,
a. Mortagne (Orne). Métais,
Cart. de St-Denis de Nogent,
n°LIX.
|
Hic quoque Teudo idem beneficium
a Werrico filio Engelranni de Noci
(229)
(45), Ste Marie canonico, possidebat,
qui et ipse G. (a) cum sua matre Ermentrude, pro anima
patris sui prefati E. atque omnium amicorum
suorum concessit, positus in æcclesia
supradicta.
|
(45) Nocé,
ar. Mortagne (Orne). Cf. Métais,
Cart. de St-Denis de Nogent, no LIX.
(a) Compl.
"Guerricus." Le
nom de Guerri appartient à la famille
des vidames de Chartres. C’est par Ermentrude,
sa mère, que ce chanoine
de N.-D. de Chartres, originaire du Perche, se trouvait
propriétaire à Roinville.
|
(230) [p.51] Saint-Léger-des-Aubées,
c. Auneau, a. Chartres.
Le ms. porte rorogus.
(231)
[p.51] Dammarie,
c. Chartres. — Rouvray, éc. Illiers,
a. Chartres.
(36)
[p.9] Roinville,
c. Dourdan, a. Rambouillet.
|
Testes sunt: Walterius, Rainaldus
filius ejus; Hugo filius Gauslini;
Warinus filius Gaufredi; Rainaldus
parochus Sti Leodegarii (230) (46), Johannes et Walterius
sacerdotes; Herveus, Warinus
filius Willelmi; Warinus de Domna Maria
(231)
(47); Warinus de Rodanivilla (36) (39); Fulco filius Walterii Albi; Haimericus, Ernaldus,
Ernulfus de Rovroit (231), Rotbertus Costart,
Ernaldus.
|
(46) Saint-Léger-des
Aubées, ca. Auneau,
ar. Chartres. B porte rorogus.
(47) Dammarie,
ca. Chartres. — Rouvray. éc.
Illiers, ar. Chartres.
(39) Roinville,
ca. Dourdan, ar. Rambouillet (Seine-et-Oise).
|
(232)
[p.52] La collégiale
de Saint-Nicolas de
Courville, a. Chartres. — Le surnom de
Cotelle fut porté
par les anciens seigneurs de Courville.
(231)
[p.51] Dammarie,
c. Chartres. — Rouvray, éc. Illiers,
a. Chartres.
|
Et isti sunt testes illius doni:
Baldricus, Gaufridus, Girbertus,
[p.52] canonici
Sti Nicholai Curvavillensis (232)
(48);
Gunterus presbiter Sti Germani;
Warinus Cotella (231)
(48); Hilduinus miles; Werricus filius Herberti
filii Girberti; Constancius Arbalistarius,
Rainaldus nepos Balduini, canonici
Sti Nicholai (232).
(Édité par D.
Marriere,
p. 366)
|
(48)
La collégiale de St-Nicolas de
Courville, ar. Chartres. Le surnom de
Cotelle a été
porté par un des Ives seigneurs de Courville.
|
Texte donné
par Depoin (1905 et 1912)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
Gauslenus
filius G. Divitis et uxor ejus Odelina,
Albertus filius H. vicedomini, Ada
mater ejus, annuente Hugone clerico,
Deo Stoque Petro Cluniacensis ecclesie ad obedientiam
Sti Martini de Campis, pro redemptione
animarum suarum, dederunt apud Rodanivillam
medietatem æcclesiæ Sti Georgii
martiris, altare scilicet, annuente Gaufrido Carnotensi
episcopo, et Hildegario archidiacono, et
terram unius carruce, et agripennum terre ad
vineam faciendam et ad hortum ac viretum sufficientem,
et omnia hospicia ejusdem ville, cum curiis et ortis,
et medietatem pratorum ac molendinorum, et furnos,
et omnem justiciam ejusdem ville.
|
Jocelin
fils de Geoffroy le Riche et son épouse
Eudeline, Aubert fils du vidame Hugues,
sa mère Ade, avec l’autorisation du
clerc Hugues, ont donné à Dieu et à
Saint-Pierre de l’Église de Cluny de
l’obédience de Saint-Martin-des-Champs,
pour le salut de leur âme, à Roinville
la moitié de l’église de Saint-Georges-Martyr,
à savoir l’autel, avec l’autorisation
de l’évêque de Chartres Geoffroy et
de l’archidiacre Haugier, ainsi qu’une terre d’une
charrue, et un arpent de terre suffisant pour y mettre une
vigne, pour un jardin et un verger, ainsi que toutes les tenures
du dit village, avec leurs cours et leurs jardins, ainsi
que la moitié des prés et des moulins, et que les
fours, et que la justice du dit village.
|
Et hoc donum
testantur Ingelrannus decanus, Johannes decanus
Parisiensis, Adelardus subdecanus,
Hilduinus cantor, Hilgotus, Ilbertus, Willelmus
archidiaconus, Ebrardus capicerius, Giraldus
presbiter, Raimbaldus c[anonicus], Werricus
vicedominus, Ebrardus de Lavesvilla, Willelmus
prepositus, Rotbertus Aculeus, Radulfus Lacunella,
Germundus filius Avesgoth, Ebrardus Helmonis
filius, Walterius filius Fledaldi.
|
Et de cette
donation sont témoins: le doyen
Enguerrand; le doyen de Paris Jean; le sous-doyen
Allard; le chantre Audouin; Haugot;
Ilbert; l’archidiacre Guillaume; le chevecier
Ébrard; le prêtre Giraud; le
chanoine Raimbaud; le vidame Guerry; Ébrard
de Levesville; le prévôt Guillaume;
Robert Aguillon; Raoul
Lacunella; Germond fils d’Avesgotus;
Ébrard fils d’Heaumon; Gautier fils
de Fléaud.
|
| Qui etiam
Walterius alteram partem ejusdem æcclesiæ
supradicta ratione, Sto Petro et fratribus
Sti Martini dedit, annuente uxore sua
et filiis, testantibus istis supradictis. Et hoc
donum concessit Teudo Caput Ferri et uxor ejus
Hersendis et Harduinus filius ejus, quia Walterius
illud tenebat ab illis.
|
Lequel Gautier
pour la raison susdite a donné
l’autre moitié de la dite église
à Saint-Pierre et aux frères
de Saint-Martin, avec l’autorisation de son
épouse et de ses fils. Et cette donation a été
autorisée par Thion Chef-de-Fer,
son épouse Hersent et son fils Hardouin,
parce que c’est d’eux que le dit Gautier tenait
cela en fief.
|
Hic quoque
Teudo idem beneficium a Werrico filio Engelranni
de Noci, Ste Marie canonico, possidebat,
qui et ipse G. cum sua matre Ermentrude,
pro anima patris sui prefati E. atque omnium amicorum
suorum concessit, positus in æcclesia
supradicta.
|
Ce même
Thion possédait aussi un
bénéfice qui lui venait de
Guerry fils d’Enguerrand de Nocé,
chanoine de Notre-Dame. Lui ainsi que le dit Guerry,
ainsi que sa mère, pour le salut
de l’âme de son sudit père Enguerrand
et de celles de tous leurs amis, l’ont accordé,
alors qu’il se trouvait dans la dite église.
|
Testes sunt:
Walterius, Rainaldus filius ejus; Hugo filius
Gauslini; Warinus filius Gaufredi;
Rainaldus parochus Sti Leodegarii,
Johannes et Walterius sacerdotes; Herveus,
Warinus filius Willelmi; Warinus de Domna
Maria; Warinus de Rodanivilla; Fulco filius
Walterii Albi; Haimericus, Ernaldus, Ernulfus
de Rovroit, Rotbertus Costart, Ernaldus.
|
En sont
témoins: Gauthier, son fils Rainaud, Hugues
fils de Jocelin, Garin fils de Geoffroy, Rainaud
curé de Saint-Léger, les prêtres
Jean et Gautier, Hervé, Garin fils de
Guillaume, Garin de Dammarie, Garin de Roinville,
Foulques fils de Gautier Blanc, Aimery, Arnaud,
Arnoux de Rouvray, Robert Costart, Arnaud.
|
Et isti
sunt testes illius doni: Baldricus, Gaufridus,
Girbertus, canonici Sti Nicholai Curvavillensis;
Gunterus presbiter Sti Germani;
Warinus Cotella; Hilduinus miles; Werricus
filius Herberti filii Girberti; Constancius
Arbalistarius, Rainaldus nepos Balduini,
canonici Sti Nicholai.
(Édité par D.
Marriere,
p. 366).
|
Et voici
les témoins de cette donation: Baudry,
Geoffroy, Gibert, chanoines de Saint-Nicolas
de Courville; Gonthier prêtre de
Saint-Germain; Garin Cotella;
le chevalier Haudouin; Guerry fils d’Hébert
fils de Gibert; l’arbalétrier
Constance; Rainaud, neveu du chanoine de Saint-Nicolas
Baudouin.
|
Éditions
1) Domnus Martinus MARRIER,
O.S.B. (Dom Martin MARRIER, de l’ordre
de saint Benoît), Monasterii
regalis S. Martini de Campis Paris.
ordinis cluniacensis, historia, libris sex partita,
per domnum Martinum Marrier [in-4°;
XIV+578 p.; «Histoire du monastère
royal parisien de Saint-Martin-des-Champs,
de l’ordre de Cluny, répartie en six livres,
par dom Martin Marrier, de l’ordre de saint
Benoît»], Parisiis (Paris), P.
Cramoisy, 1637, p. 366.
2) COÜARD (archiviste du
département de Seine-et-Oise), Joseph
DEPOIN (secrétaire général
de la Société historique
du Vexin), DUTILLEUX (secrétaire
général de la Commission des Antiquités
et des Arts), DUFOUR (secrétaire
général de la Société
historique de Corbeil-Étampes),
LORIN (secrétaire général
de la Société historique de Rambouillet)
[éd.], Liber testamentorum
Sancti Martini de Campis. Reproduction annotée
du manuscrit de la Bibliothèque nationale
[in-8°; XV+124 p.], Paris, A. Picard &
fils [«Publications de la conférence
des Sociétés historiques du
département de Seine-et-Oise»],
1905, pp. 50-52.
Dont une réédition
numérique à la fois
en mode image et en mode texte par l’École
nationale des Chartes sur son site
Elec:
2b) ÉCOLE
DES CHARTES [éd.],
Liber testamentorum Sancti Martini
de Campis, in ID.,
ELEC (site web) [«Cartulaires
numérisés d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page50/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page51/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page52/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/acte39/
(en mode
texte), en ligne en 2008.
3) Joseph DEPOIN (1855-1924),
Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs, monastère
parisien. Tome I [premier de 5 volumes in-4°],
Chevetogne (Belgique), Abbaye de Ligugé
& Paris, Jouve & Cie [«Archives
de la France monastique» 13, 16, 18, 20,
21], 1912-1921, tome I (1912), pp. 41-43.
Dom Jean BECQUET (1917-2003),
Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs, monastère
parisien, par J. Depoin: Index par dom Jean
Becquet [25 cm; 70 p.], Ligugé,
Revue Mabillon [«Archives de la France
monastique» 51], 1989.
Dont une
réédition numérique
à la fois en mode image et en mode texte
par l’École nationale des Chartes sur
son site Elec:
3b) ÉCOLE DES CHARTES
[éd.], Liber testamentorum
Sancti Martini de Campis, in ID.,
ELEC (site web) [«Cartulaires
numérisés d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page49/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page50/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps1/acte18/ (en mode texte), en ligne en 2008.
4)
Bernard GINESTE [trad. & éd.], «Don
de l’église de Roinville-sous-Auneau», in ID.
[éd.], «Thion Chef-de-Fer: Notices
concernant Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06d,
2008.
Voir aussi sur la mention
de Thion Chef-de-Fer dans cet acte: Susan WOOD, The
Proprietary Church in the Medieval West [1020 p.], Oxford,
Oxford University Press, 2006, p. 588.
|
ANNEXE 6e
Thion Chef-de-Fer
moine présent à Rochefort vers 1080
Don de l’église de Bréthencourt (vers 1080)
Le manuscrit original de la notice qui suit était
jadis conservé aux archives départementales
d’Eure-et-Loir, d’où il a disparu à une
date indéterminée, soit perte, ou vol
crapuleux de généalogiste maniaque, à
une date antérieure à 1995. On trouve à
sa place une mauvaise photocopie d’origine inconnue intitulée
par une archiviste: “Copie du document manquant, Mme
Behen, 26.10.1995”. Cette photocopie, qui a le mérite
d’exister, est par endroit difficilement lisible, et lacunaire
au début de quelques lignes, spécialement en
bas, où un nom de personne et un nom de lieu ne peuvent
être reconstitués.
Ce texte a-t-il déjà
été édité? Je serais très
reconnaissant à toute personne qui pourrait
m’indiquer s’il a déjà été
édité par quelque érudit local
avant la disparition du manuscrit original. Je donne
ici une photo de cette mauvaise photocopie, au cas où
quelqu’un pourrait en tirer plus que je ne l’ai pu.
Quoi qu’il en soit, voici une charte
non datée mais clairement postérieure
à la précédente, où Thion
Chef-de-Fer n’était pas encore moine.
| Texte de la photocopie
du manuscrit H.2253 (1995)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008) |
Noticię fidelium tam presentium
quam futurorum tradere volumus quod
|
Nous voulons porter à la connaissance des
fidèles tant présent qu’à
venir ceci.
|
[2] domnus Guido de Rupeforti comes beato Martino
Maioris Monasterii et Mona[3](c)his inibi servientibus
Domino ecclesiam Bertildis Curię in honorem beati Martini
constru[4](c)tam cum appendiciis suis attribuit,
ea scilicet conditione: quatinus res ecclesię [5] (q)uas
in dominio suo habebat, ecclesię redderet, et eas quas militibus
suis distribuerat [6] (e)idem ecclesię restauraret ad presens
et absolutas ab omni calumpnia et penitus quie[7](t)as
deliberaret.
|
Monseigneur le comte Guy de Rochefort (1) a donné à Saint-Martin
de Marmoutier et aux moines qui y servent le Seigneur
l’église de Bréthencourt (2) construite en l’honneur de saint
Martin, avec ses dependances, étant entendu ce qui suit:
tous les biens de l’église sur lesquels il avait seigneurie,
il les rendait à cette église; tous ceux qu’il
avait distribués à ses chevaliers, il les restituait
à la dite église dès ce moment et il les
remet (3) affranchies de toute contestation
et tout à fait sûres. |
simulque decimum forum sui castri, et omne illud
quod sui milites de [8] sua terra eidem ecclesię
inpertire voluerunt concessit.
|
Et en même temps il a fait don d’une
foire sur dix (decimum forum) de son château
et tout ce que ses chevaliers sur son territoire avaient
voulu imposer à la dite église. |
Hoc autem donum dominus [9] Guido comes ac domna Adelisa
comitissa coniux eius in Castello Novo dederunt. [10] (I)pse
autem postea hoc ipsum donum super altare beati Martini
detulit.
|
Cette donation, monseigneur le comte Guy et madame
la comtesse Alais (4) son
épouse l’ont effectuée au Château
Neuf, mais il a déposé ensuite lui-même
sa donation sur l’autel de saint Martin.
|
Huic dono isti [11] adfuere: Guido filius Serlonis; Albertus
filius Bernardi; Drogo filius eius; Rainaldus qui Canardus [12]
cognominatur & Haimericus filius eius; Herlandus;
Guarinus Britto filius Heruei de Gualardo[13]ne; Serlo filius
Geroardi; Radulfus de Sancto-Leodegario; Rotbertus qui verberat
ad panem; [14] Gauffredus Guasthonis filius; Ermenardus;
Isnardus; Gaulterius forestarius.
|
A cette donation ont assisté: Guy
fils de Serlon (5), Aubert fils
de Bernard, son fils Dron, Rainaud surnommé Chenard
(6) et son fils Aimery, Herland,
Garin Breton fils d’Hervé de Gallardon (7), Serlon fils de Gérouard, Raoul
de Saint-Léger, Robert Fiert-au-pain (8), Geoffroy fils de Gaston, Armenard,
Isnard, le forestier Gautier. |
Quidam autem [15] (e)x nostris monachis
affuerunt: domnus Bernardus Majoris Monasterii panitor;
Harduinus [16] (m)onachus; Drogo; Teudo Caput Ferri;
Haimo; Balduinus. De famulis: Gaulterius [17] (d)e
Anglica Terra; Constantius de Ventiliaco; Gaulterius
Vermandensis. Bernardus presbiter. [18] (T)amueius presbiter.
|
Et certains de nos moines (9) y ont assisté: dom
Bernard, panetier de Marmoutier, le moine Hardouin,
Dron, Thion Chef-de-Fer (10), Aimon,
Baudouin. Parmi les serfs: Gautier d’Angleterre (11), Constance de Ventelay (11), Gautier de Vermandois (11), le prêtre Bernard, le prêtre Tamoué
(12).
|
Hoc etiam sciendum: quod domnus Guido comes ac
domna Adelisa comitissa [19] (conj)ux eius tantum
de suis rebus monachis Fossatensis cenobii concesserunt
ut ipsi in capitulo suo [20] (bea)to Martino et monachis
suis ecclesiam Bertildis Curię annuerunt habere imperpetuum.
|
Il faut savoir aussi ceci: monseigneur le
comte Guy et madame la comtesse Alais son épouse
ont concédé aux moines des Fossés
(12) des biens leur appartenant
de sorte que ceux-ci lors de leur chapitre ont accepté
d’avoir pour saint Martin et ses moines l’église
de Bréthencourt à perpétuité. |
[21] Huic facto adfuit domnus abbas Gulferius; Hilduardus
cantor; Ernaldus subprior; [22] (G)ualterius
Andegavensis; Sigemundus; Normannus; Ernulfus de Ruillio;
Girardus; Adelardus [23] (de ??)stolio; Gaulterius
de Ingelvilario; Guarinus Bauilus; Rainerius; Tetbaltus
[24] (de) Castris; Gausbertus nepos abbatis; Gauffredus
de Creceio; Maingotus. Pueri: [25] (??)erius; Hauricus;
Albertus.
|
A cela ont assisté l’abbé
dom Goufier, le chantre Haudouard, le sous-prieur Arnaud,
Gautier Langenvin, Sigemond, Normand, Arnaud de Rueil,
Girard, Alard de ..... (14),
Gautier d’Angervilliers, Garin Bavil, Rainier,
Thibaud de Châtres [Arpajon] (15),
Josbert neveu de l’abbé, Geoffroy de Crécy,
Maingot. Parmi les enfants: ...ier (14), Aury, Aubert.
|
De nostris autem monachis, affuerunt isti: domnus
Hildegarius [26] (Te)udo Capud Ferri; et Radulfus
de Torciaco miles; et Drogo alius miles ambo [27] apud
(??)naium morantes; et Astho quidam famulus normannus; et
Rotbertus famulus.
|
Parmi nos moines, y ont assisté: dom Haugier,
Thion Chef-de-Fer (9), le chevalier
Raoul de Torcy et un autre chevalier, Dron, qui tous
deux séjournent à ...ay (14),
ainsi qu’un certain serf normand, Aston et que
le serf Robert.
|
NOTES DE B.G. (2008).
(1) Il s’agit de Guy le Rouge.
— (2)
On a ici sans doute la plus ancienne graphie de Bréthencourt,
qui nous en livre l’étymologie réelle,
Berthaud-Cour, où Berthaud (Berthilde)
est un anthroponyme féminin (cf. Brunehaut, de
Brunehilde). —
(3)
Deliberare peut avoir en latin médiéval
tant le sens de décréter que de donner.—
(4) Alais ou Adélaïde si l’on préfère
est la première épouse de Guy
le Rouge. De sa seconde union il aura Lucienne qui
fut fiancé au futur Louis VI en 1104. Il en résulte,
quelque soit l’âge où fut fiancée
cette Lucienne, que notre charte doit être nettement antérieure
au XIIe siècle. — (5) Guy
fils de Serlon. — (6) La famille Chenard (Canardus)
était possessionnée au moins en deux lieux qui
ont pris nom d’elle jusqu’à nos jours, Levesville-la-Chenard et Louville-la-Chenard. Rappelons
que le sobriquet canard n’a désigné
l’animal de ce nom qu’à partir du XIIIe siècle,
avant quoi le mot le désignant était
ane, dérivant du latin anas,
anatis. Canard
a donc été originellement un anthroponymique
sans signification animalière; il aurait signifié
selon Alain Rey “Braillard”, d’un vieux verbe caner,
“caqueter” (Dictionnaire historique); mais je
me demande pour ma part s’il ne s’agit pas tout simplement
d’un anthroponyme de formation classique (surtout du fait de
l’évolution de ca- en ch-, mais
aussi parce que l’Altdeutsches Namenbuch de Förstemann, éd. 1856, col. 467-468, fait état
d’anthroponymes intéressants à cet égard:
Ganna, Gannascus, Gannibald,
Ganefard, et surtout Ganhart). Quoi qu’il en soit, une charte du Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée
(n°33, p. 19) nous apprend qu’au moins à
Manterville, secteur
tout voisin de Vierville, Aimery Chenard était
vassal. — (7) Garin Breton fils d’Hervé de
Gallardon. On peut donc se demander si le Robert
Breton que nous voyons à Auneau signer
précisément auprès d’Hugues
de Gallardon (B 27), autre fils d’Hervé, n’était
pas lui aussi fils d’Hervé. — (8) Robert
Fiert-au-pain.
Je rends ainsi le latin Rotbertus qui verberat ad panem, où le verbe verberare (frapper), suivi
qu’il est de la préposition ad
(à), doit rendre le vieux verbe férir
(cf. “sans coup férir”) plutôt que le verbe battre. Il
peut s’agit d’un chevalier qui lors de quelque épisode
aura embroché une miche de pain. — (9) Pour
comparaison voici la liste des moines témoins d’une
charte de Bréthencourt vers 1100: Eudes de Lethuin (Odo
de Estonio), Martin de la Cour (Martinus de Curte),
Robert prieur de Bréthencourt (Rotbertus prior de Bertildis
Curiæ), Osmond (Osmundus),
Jean (Johannes), Raoul (Radulfus), Clarembaud
(Clarenbaldus); et les serfs: le bouvier Robert (Rotbertus
bubulcus), Hervé (Herveus), le marmiton Rousseau
(Rufullus coculus). On voit que tous les témoins
de notre charte paraissent alors décédés
(AD 28, H 2256). — (10) Thion Chef-de-Fer est
donc moine, ce qui place la rédaction de cette
notice après la précédente, où
il ne l’est pas encore, et avant la suivante, où il
paraît décédé. — (11). Gautier d’Angleterre,
Constance de Ventelay, Gautier de Vermandois. Les deux premiers de ces deux serfs des moines de
Bréthencourt seront également témoins
de leurs contre-dons en retour de la donation de la
terre de Lomlu (C 32-33). — (12). Ce prêtre
qui a curieusement l’air d’être rangé
parmi les serfs du prieuré de Bréthencourt, est cité en tête des témoins pour
les moines de deux transaction: les contre-dons en retour de la donation de la
terre de Lomlu
(Tamueius
presbiter, Guauterius de Anglica Terra famulus, de Ventilaio,
Constancius famulus et Guauterius de Veruilla
famulus); la donation
d’une terre par Geoffroy de Aqua (Tamueius
presbiter de Stonno, Adelardus de Bertoldicuria et Rodbertus
eiusdem Adelardi socius). — (13). Il s’agit
du monastère parisien de Saint-Germain-des-Fossés.
— (14). Le début
de ces mots (quelques lettres seulement) n’apparaît
pas sur la photocopie survivante de l’original disparu.
— (15). Châtres, aujourd’hui Arpajon.
Éditions
1)
Original autrefois conservé aux Archives départementales
d’Eure-et-Loir sous la cote H. 2253, disparu entre 1897 et 1995.
2)
Analyse: René MERLET (archiviste
d’Eure-et-Loir), Inventaire-Sommaire des Archives départementales
antérieurs à 1790, rédigé
par René Marlet, archiviste. Eure-et-Loir. Archives
ecclésiastiques. Série H. 1. Tome huitième
[299 p.; c’est le tome 1 de la série H], Chartres,
Garnier, 1897, p. 239.
|
Prieuré de Saint-Martin
de Brétencourt
H. 2253. (Liasse.) ― 2 pièces, parchemin.
v. 1080. ― Don à
l’abbaye de Marmoutiers par Gui, comte de Rochefort,
Guido de Ruppe Forti, comes et dominus de Berthlodi
Curia, et Alix, de l’église de Brétencourt,
ecclesiam Bertildis Curie in honorem beati Martini
constructam, et approbation de cette donation par
les moines de Saint-Maur-les-Fossés.
|
3) Photocopie d’origine non identifiée
(assez mauvaise et légèrement lacunaire)
aujourd’hui conservée sous la même cote,
avec l’indication manuscrite suivante: «Copie du document
manquant (Mme BEHEN, 26.10.1995)»
3a)
Photographie de cette photocopie, que j’ai mise en
ligne ici.
4) Bernard GINESTE [trad. &
éd.], «Don de l’église
de Bréthencourt (vers 1080)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06e,
2008.
Note et appel à
contribution
Merci à toute personne qui pourrait
nous signaler une édition antérieure
de cet texte, soit égaré ou bien volé
par un généalogiste.
On notera un texte en ligne de 1972 d’un
auteur qui paraît avoir consulté le texte,
ou une de ses éditions, puisque, tout en donnant
les bonnes références archivistiques,
et aucune autre source, il en cite un passage qui n’est
pas repris par l’Inventaire-Sommaire, Bernard de SAINT-LÉGER,
«Robert de Saint-Léger et le pays
d’Yvelines (juin 1972)», in Association
des Saint-Léger de France et d’ailleurs,
http://pagesperso-orange.fr/saintleger/agenda/yvelines.desaintleger.htm,
en ligne en 2008.
|
ANNEXE 6f
Donation à Chuisnes
d’Hardouin, chevalier du château de Courville
(vers 1090)
Cette notice est intéressante
notamment en ce qu’elle cite comme témoins à
Chuisnes cinq personnes déjà mentionnées
par nos notices. On admirera aussi le caractère
malicieux d’Hardouin Chef-de-Fer.
Texte du manuscrit
AD28, donné par Depoin (1905 et 1912)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
Notitia de censu ęcclesię Sancti Marini
Fs.
Carnotum
|
Notice sur le cens de
l’église Saint-Marin
Fs
(?)
Chartres
|
| Litteris his insinuamus
notitię monachorum Maioris Monasterii degentium
post nos in ęcclesia beatorum Geruasii ac Protasii constructa
in loco qui Choina uocatur |
Par le présent
document nous portons à la connaissance des moines
de Marmoutier vivant après nous dans l’église
Saint-Gervais-et-Saint-Protais qui s’élève
au lieu appelé Chuines, ceci.
|
militem quemdam nomine
Harduinum cognomine Caput Ferreum de castello Curvę
Villę dedisse Deo ęcclesięque iam dictę ac nobis uiginti .iii.
denarios census de basilica Sancti Marini quos annualiter
accipiebat a presbitero qui ibi deserviebat Deo.
|
Un certain chevalier
nommé Hardouin (1) et surnommé
Chef-de-Fer, du château de Courville, a donné
à Dieu, à la susdite église et
à nous vingt-trois deniers de cens de la basilique
Saint-Marin, qu’il recevait chaque année du prêtre
qui y faisait le service divin.
|
Cum autem huius rei donum super altare prefatorum
martirum politurus esset, petiit et accepit
a domno Tetbaldo priore tunc huius loci cultellum eius,
ut eum loco doni Deo offeret. Sed tamen lignum quoddam postea
pro eo obtulit.
|
Or, comme il devait parachever la donation
de ce bien sur l’autel des dits martyrs, il a demandé
et a pris à dom Thibaud, qui était alors
prieur de cet établissement, son couteau, afin
de l’offrir à Dieu en signe de sa donation. Cependant
il a offert ensuite un morceau de bois
(2) à
la place.
|
Redditur uero hic census
die festiuitatis Omnium Sanctorum.
|
Ce cens est réglé
le jour de la fête de la Toussaint.
|
Testes huius rei
subter annotati sunt. Monachi autem hii: Tetbaldus prior,
Moises, Euanus, Giraldus. Laici: Radulfus presbiter, Sicherius
frater eius, Gaufredus de Bello Monte, Wilelmus Rufus,
Arnulfus, Gauslinus Seruengre, Odo famulus, Gauscelinus cocus,
Johanulus, Teodericus et Iohannes presbiteri.
|
Les témoins
de cette affaire sont cités ci-après. Voici
les moines: le prieur Thibaud (3), Moïse,
Évain (4), Giraud.
Les laïcs: le prêtre Raoul, son frère
Sichier, Geoffroy de Beaumont (5), Guillaume
Roux (6), Arnoux, Gauslin
Serve-en-gré (7), le serf Eudes (8), le cuisinier Gauslin, les prêtres Jeannou, Thierry
et Jean.
|
NOTES DE B.G. (2008).
(1) Hardouin apparaissant
ici sans que soit mentionné son père Thion,
moine de Marmoutier, il en faut conclure que dernier est mort,
et la charte ne peut dater des environs de 1080, comme
le supposait Merlet. — (2) La sœur d’Hardouin
avait utilisé un bâton pour la donation
de Vierville (per baculum), et Hardouin lui-même
un rameau de sureau (per
ramum sebuci). — (3) Ce prieur Thibaud était déjà
en fonctions lors des transaction précédentes.—
(4) Évain a
déjà été témoin
à Chuisnes du consentement d’Hardouin à la
la donation de Vierville.
— (5) Un serf de ce Geoffroy de Beaumont (Rainaldus famulus Gaufredis
de Bello Monte) a été
témoin de la donation de quatre familles de serfs de Denonville
par Hardouin. — (6) Ce personnage a lui aussi été
témoin de la donation de quatre familles
de serfs de Denonville par Hardouin, sous le nom de
Guillaume Roux de
Chuisnes (Guillelmus Rufus
de Coina) — (7) En vieux français, l’expression “en
gree” ou “en gré” signifie “volontiers”. Le
sens de ce surnom doit être quelque chose, comme “le
serviable”. Cf. ces vers attribués à Garce
Brûlé, poète champenois du XIIe siècle:
Or me doint Deus que je la serve en gré
/ Tant qu’ele m’ait de ma dolor osté. — (8) Le serf Eudes a déjà
été témoin à Chuisnes du consentement
d’Hardouin à la la donation de Vierville.
Comparaison des listes de témoins
à Chuisnes
Consentement d’Hardouin pour Vierville (trans.
4)
|
Don par Hardouin de colliberts (trans. 14)
|
Don postérieur d’un cens
|
Thion
Chef-de-Fer, père du dit Hardouin;
|
du côté
des moines: Thion Chef-de-Fer; le prévôt
de Chartres, Hardouin; le clerc Garin;
|
|
le prieur
Thibaud;
|
|
les moines:
le prieur Thibaud,
|
le
prieur du cloître de Marmoutier, Robert;
|
|
|
|
|
Moïse,
|
Évain;
|
|
Évain,
|
Évroin;
Gaston; Foulques; Gimard Ernèse;
|
|
|
|
|
Giraud.
|
|
et du
côté des laïcs:
|
Les laïcs:
le prêtre Raoul, son frère
Sichier,
|
|
Hugues Malveil;
Guerrise fils d’Hébert; Robert de Dolmont;
|
|
|
le serf de
Geoffroy de Beaumont, Rainaud; Guillaume
Roux de Chuisnes;
|
Geoffroy de Beaumont,
Guillaume Roux,
|
|
|
Arnoux, Gauslin
Servengré,
|
le
serf Eudes.
|
|
le serf
Eudes,
|
|
et de
nombreux autres.
|
le cuisinier Gauslin, les prêtres Jeannou, Thierry
et Jean.
|
BIBLIOGRAPHIE
Éditions
1) Original conservé aux Archives
départementales d’Eure-et-Loir sous la cote H
230.
2) Bernard GINESTE [trad. &
éd.], «Donation d’Hardouin Chef-de-Fer
aux moines de Chuisnes (vers 1100)», in ID. [éd.],
«Thion Chef-de-Fer: Notices
concernant Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06f,
2008.
|
ANNEXE 6g
Hardouin, Garin de Friaize et
Yves fils d’Hébert à Chuisnes en 1094
Donation de Philippe de Courville aux moines de Chuisnes, 1094
La notice qui suit, gardant
mémoire d’une transaction de mars 1094, a été
conservée par le Cartulaire de
Saint-Père de Chartres (éd. Guérard,
tome II, pp. 499-500). Elle est relative à la donation
aux moines de Saint-Père d’une ferme du terroir de
Chuisnes appelée qui s’appelait la Pommeraie.
Texte donné
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
[XLIII.]
Quomodo Philippa et Ivo de
Curva Villa, quinque proceres ipsorum feodati
quicquid consuetudinis habebant in Pomeria nobis
dimiserunt.
|
Comment Philippa et Yves de Courville et
cinq grand seigneurs leurs féaux nous ont affranchis
de tous les droits coutumiers qu’ils détenaient
sur la Pommeraie.
|
[Mart. 1094.]
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus Sancti. Ego Philippa Curvavillensis
et Ivo, filius meus, presentium posterorumque
memorie, hujus carte testimonio, assignamus, quia
|
Au
nom de la sainte et indivise Trinité,
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi Philippa
de Courville et mon fils Yves faisons connaître à
la mémoire de ceux qui vivent à
présent et qui vivront à l’avenir, par
le témoignage du présent document, ce qui suit.
|
bannum
quod a predecessoribus nostris, Ivone scilicet
et Gerogio, in villa que Pomeriata dicitur, habebamus,
pro eorundem et nostris animabus, concedente domino
et patrono nostro Nivelone, domno Eustachio, abbati
Carnotensis cenobii, et monachis ibidem in honore beatissimorum
apostolorum Petri et Pauli Deo militantibus, pro tenoribus
nostris, omni inquietudine absolutum dedimus.
|
L’autorité seigneuriale
que nous détenions à la suite
de nos prédecesseurs, à savoir d’Yves
et de Giroie, pour le salut de leurs âmes et
des nôtres, avec le consentement de notre seigneur
et suzerain Nivelon, nous l’avons donnée à
dom Eustache, abbé du monastère de Chartres
et aux moines qui y combattent pour Dieu en l’honneur des
très saints apôtres Pierre et Paul, pour en
jouir sans souci en ce qui concerne les droits qui nous étaient
dus.
|
| Sed et
huic memoriali pagine commendari decrevimus,
quod Garinus de Friesia, Harduinus Caput Ferri, Tetbaldus
filius Sugerii, Frodo filius Themerii, Ivo filius
ejus, fideles feodalesque nostri, vicariam quam in
prescripta Pomeriata ab atavis quietam habebant, tam
precibus nostris quam meritis, eidem abbati eisdemque monachis
perpetualiter et quiete possidendam concesserunt. |
Mais nous avons de plus voulu
mentionner par le présent mémorial
que Garin de Friaise, Hardouin Chef-de-Fer, Thibaud fils
de Suger, Fron fils de Thémier et son fils Yves,
nos fidèles et féaux, tant sous l’effet de
nos prières que de leurs mérites, ont cédé
au dit abbé et aux dits moines la voirie qu’ils
détenaient de leur aïeux dans la susdite Pommeraie, pour qu’ils en jouissent à jamais et en
paix.
|
Ad hujus
itaque rei testimonium et defensionem, nostra et
plurium aliorum videntium hec et audientium nomina hic
subscribi fecimus.
|
Ainsi donc, pour preuve et
garantie de ces faits, nous avons fait porter ci-après
nos noms et ceux de plusieurs autres qui les ont
vus et entendus.
|
Philippa; Ivo, filius
ejus; Nevelo, Garinus de Friesia, Harduinus
Caput Ferri; Tetbaldus, filius Sugerii; Frodo, filius
Temerii; Ivo, filius ejus; Ivo, filius Herberti; Rogerius
de Aqua, domnus episcopus, Hilduinus precentor; VVido,
filius G. divitis; Giraldas capellanus; Gaufridus, nepos
ejus; Landricus clericus, Haimo prepositus; Herveus,
Robertus, cubicularii episcopi; ipse abbas, Adventius miles,
Laurentius cubicularius, Gunbaldus; Gislebertus, Lorini
filius; Fulchardus; Richardus, gener ejus; Ingelbertus
cocus, Gaufridus cocus, Rogerius cocus, Johannes cocus, Odo
pistor, Salomon major; Gaudius et Teduinus, fratres; Garabatus,
Radulfus Hildegarii.
|
Philippa; son fils Yves; Nivelon, Garin de Friaize,
Hardouin Chef-de-Fer; Thibaud fils de Suger;
Fron fils de Themier; son fils Yves; Yves fils d’Hébert;
Roger de l’Eau (ou de Lèves?), monseigneur
l’évêque, le préchantre Audouin;
Guy fils de Geoffroy le Riche; le chapelain Giraud;
son neveu Geoffroy; le clerc Landry, le prévôt
Aimon; Hervé et Robert, chambriers de l’évêque;
l’abbé lui-même, le chevalier Avence,
le chambrier Laurent, Gombaud; Gibert fils de Lorin;
Fouchard; son gendre Richard; le cuisinier Engebert, le cuisinier
Geoffroy, le cuisinier Roger, le cuisinier Jean, le boulanger
Eudes, le maire Salomon; les frères Gaud et Thouin;
Garabat, Raoul Haugier.
|
Нес
igitur acta sunt anno ab incarnatione Domini MXCIIII°,
mense martii, indictione II, Philippo rege regnante,
[p.500] Ivone
Carnotensi episcopio presidente. His ergo si
quis obviare presumpserit, nisi citissime resipuerit,
quiscunque fuerit, nostro assensu anathema sit. Amen.
|
Ces mesures ont été
prises l’an de l’Incarnation du Seigneur
1904, au mois de mars, en la deuxième indiction,
sous le règne du roi Philippe et le pontificat
de l’évêque Yves. Si quelqu’un donc osait y
faire obstacle, s’il ne s’amende pas au plus tôt, quel
qu’il soit, nous donnons notre accord pour qu’il soit
excommunié. Amen.
|
[20 oct. (sic,
par distraction de l’éditeur)]
XII kalendas octobris
prescripti anni, hoc idem concesserunt Willelmus,
filius Jothonis; et Richerius, frater ejus. Videntibus
et testificantibus Paulo, serviente eorum, et aliis
suprascriptis.
(Édité par D.
Marriere,
p. 366).
|
Le XII des calendes d’octobre
[le 20 septembre] de la susdite année, ont
consenti à la même chose Guillaume fils
de Jothon et son frère Richer, au vu et au témoignage
de leur serviteur Paul et des autres dont les noms
ont été donnés ci-dessus.
|
Éditions
1) Benjamin GUÉRARD (directeur
de l’École des chartes en 1848, conservateur
au département des manuscrits de la bibliothèque
impériale en 1852), [éd.], Cartulaire
de l’abbaye de Saint-Père de Chartres
[2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848 p.], Paris, Crapelet
[«Collection de documents inédits sur l’histoire
de France. 1re série. Histoire politique. Collection
des cartulaires de France» 1-2], 1840, pp. 499-500
[dont une réédition
numérique par Google, en ligne
en 2008].
2) Bernard GINESTE
[trad. & éd.], «Philippa
de Courville: Donation de la Pommeraie aux moines de
Chuisnes (20 septembre 1094)», in ID.
[éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06g,
2008.
|
ANNEXE
6h
Hardouin,
son fils Hugues et Yves fils d’Hébert, fin XIe siècle
Donation d’Hardouin
Chef-de-Fer à Roinville (fin XIe siècle)
Nous donnons
ici le texte d’une autre charte faisant
mention de Hardouin Chef-de-Fer, fils
de Thion Chef-de-Fer. Conservée dans
une copie de 1118 par le Liber Testamentorum
de Saint-Martin-des-Champs, au folio 17, sous
le numéro 38, elle a d’abord été
éditée par dom Marrier en 1637
dans son Historia du monastère
royal de Saint-Martin-des-Champs (p. 368), puis
par Joseph Depoin et Coüard en 1905 dans leur
édition du Liber Testamentorum
de l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs (pp. 49-50).
Enfin Depoin l’a rééditée
en 1912 avec de nouvelles notes et une datation plus
précise en 1912 dans le premier volume
de son Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs (pp. 46-47).
On notera
ce que dans la note 64 de l’édition
de 1912, Depoin précise relativement
à la datation de cette notice:
Cette
notice
serait particulièrement intéressante
à dater, etc en raison de
la quantité de témoins de
marque qui s’y trouvent associés. Un
terminus ad quem indiscutable est fourni
par la mort de Josselin (3 novembre 1096), l’archidiacre
de Josas qui fut un bienfaiteur insigne du prieuré
(cf. n°13 suprà, note 24).
C’est aussi en 1096-97 que le chanoine-chancelier
Vougrin devint archidiacre de Parisis au lieu
et place de Dreux Ier de Mello. Toutefois il faut remarquer
que le chanoine Sévin (le Sevinus
Postellus qui figure en 1076 au nombre des
testes clerici ex parte Sancte Marie,
c’est-à-dire des clercs de Notre-Dame (cf.
Guérard, Cartulaire de N-D.
de Paris, I, 280) n’apparaît dans aucune énumération
des membres du chapitre à partir de
1087. Mais la mention d’Hervé de Montmorency
permet de reculer encore cette date. En effet, son fils
et successeur Bouchard IV eut avec le comte de Beaumont
son beau-frère, Mathieu Ier, une guerre
au cours de laquelle fut détruite l’église
castrale de Conflans-Ste-Honorine, et cette
église, rebâtie après la cessation
des hostilités, fut dédiée
le 21 juin 1086. (Cf. notre étude sur
les comtes de Beaumont-sur-Oise et le prieuré
de Conflans dans le Bulletin de la Commission
des Antiquités et Arts de Seine-et-Oise,
1911). Hervé était encore vivant et
avait conservé la terre de Marly où il
fit élever en 1087, l’église de St-Vigor
(Ad. Maquet, Les Seigneurs de Marly,
p. 48). Hervé avait cédé Montmorency
à son fils aîné, postérieurement
au 25 mai 1081, date où il agit comme tuteur
de Guillaume II de Gometz (Bibl. de l’Ecole des Chartes,
4e série, t. III, p. 357). 1081 est l’année
où un autre témoin de la notice, Hugues
comte de Dammartin, fonda le prieuré de St-Leu
d’Esserent. (Chan. E. Müller, Cartulaire
de St-Leu d’Esserent, p. 1-4). D’autre part,
Hervé d’abord seigneur de Marly ne prit le
nom de Montmorency qu’après avoir hérité
de Thibaud, son frère, postérieurement
au 2 novembre 1071 (Prou, Actes de Philippe
Ier, pp. 7 à 160 pour Thibaud; pp. 94, 159,
308 pour Hervé). La distinction de leurs titres
est sensible dans les souscriptions au diplôme
de Philippe Ier en 1067 (n°12).
Notice de l’édition
de 1905
|
Notice
de l’édition de 1912
|
XXXVIII [fol. XVII°].
(Fin du XIe
siècle)
Édité
par D. Marrier, p. 368 |
Acte 23
A. Original perdu.
B. Copie de
1118, Liber Testamentorum, fol. 17°
n°38.
Édit.
Marrier, Monasterii
Sti Martini de Campis... historia,
p. 368.
|
Hardoin Chef-de-Fer
et son fils Hugues renoncent à
leurs droits sur la terre de Roinville,
moyennant cinq sols; des bottes et des souliers
sont en outre offerts en cadeau à Hugues.
|
Hardoin Chef-de-Fer
et son fils Hugues renoncent à
leurs droits sur la terre de Roinville, moyennant
cinq sols; des bottes et des souliers
sont en outre offerts en cadeau à Hugues
(a).
(a) Nous rattachons cette pièce aux précédentes
dont nous
la croyons voisine. On ne peut lui fixer
une date par les synchronismes. Elle
est antérieure en tous cas à
la mort du prieur Ourson (1er octobre 1105).
|
Notes
de 1905
|
Texte
de 1905 et 1912
|
Notes
de l’édition de 1912
|
(218)
[p.49] Hardouin
Chef-de-fer était
fils de Teudon et d’Hersende, nommés
dans la charte qui suit. Il était
seigneur de Denonville (c. Auneau, a. Chartres)
et maria sa sœur Mélisende à
leur voisin Gautier II d’Aunay-sous-Anneau,
à qui elle porta la terre de Vierville (Arch.
de l’Eure [corrigez: de l’Eure-et-Loir(B.G.)],
H 2254). Teudon avait pour
père Etienne (Stephanus Caput de
ferro) nommé avec ses fils (Teudo
et Amo) dans une charte d’Aivert
(Agobardus), évêque de
Chartres, entre 1049 et 1060 (Coll. Moreau,
XXIV. 152).
|
Harduinus Capud
Ferri (218)
(58) et Hugo
filius ejus condonaverunt monachis Sti Martini
de Campis hoc quod calumpniabant in Roenvilla,
in presentia Ursi prioris ejusdem monasterii;
et inde habuit Ve solidos de caritate, et filius ejus
caligas et sotulares.
|
(58)
Hardoin Chef-de-fer était fils de Thion
et d’Hersende, nommés dans la charte 20.
Il était seigneur de Denonville (ca. Auneau,
ar. Chartres) et maria sa sœur Mélisende
à leur voisin Gautier II d’Aunay-sous-Anneau à
qui elle porta la terre de Vierville (Arch. de l’Eure
[corrigez: de l’Eure-et-Loir
(B.G.)], H 2254).
|
(219) [p.49] Mérouville,
c. Janville, a. Chartres.
(118) [p.31]
Garnier II de Paris, fils de Garnier I, eut,
entre autres enfants, Hugues, seigneur
de Gentilly et de Brunoy. Ce Hugues, qui vivait
en 1138, qualifie de neveu (nepos) Soudan
de Massy. (A.N. K 22, n°98; K 23, n°°33
et 616). Celui-ci doit être
identifié avec Geofroi-Soudan II, fils
de Bouchard de Massy (Ms. l. 9968, n°°85
et 203), seigneur de Vaugrigneuse en 1138 (LL
1043, fol. 6). Bouchard se rattache apparemment
à Soudan I de Massy, père d’Aimon, de Guillaume
et de Jehan (Ms. l. 9968, n°°224, 225); on
sait par ailleurs qu’il était frère
de Thévin de Forges (Ib. n°142);
et d’après l’indication de la notice que
nous annotons ici [p.31],
Soudan I serait un frère de
Garnier II.
(b) [p.49]
Ms. Guarnaci.
(220) [p.49] Mazolin, gardien
du péage établi
à St-Aubin des Bois, c. Chartres.
(221)
[p.49]
Maurepas, c. Chevreuse,
a. Rambouillet. Milon I, fils de Simon
I de Maurepas, est la tige de cette famille.
(222)
[p.49]
Courserault, c. Nocé,
a. Mortagne (Orne). METAIS,Cartulaire
de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou,
no LIX.
(223)
[p.49] Fontaine-Bouillant,
éc. Champhol, c. Chartres.
|
Et hujus concessionis
sunt testes: Teobaldus filius Teoli,
Aimericus Canardus, Jolduinus filius
Raibaldi, Gaufridus major de Meronvilla
(219)
(59),
Warnerius (118)
(75)
filius Guanari (b) (b),
Ivo filius Herberti, Paganus frater
ejus; Frodo Cocceto filius; Mazolinus pedaccerus
Sti Albini (220)
(60);
Milo filius Simonis de Malorepastu
(221)
(61), Salomon
filius Hugonis de Corsosalz (222) (62); Arduinus filius Mazolini
de Fontane (223)
(63),
Stephanus de Corsosalz
(222) (64); Teodon, Warinus,
Jonas, Engelbertus, servientes Sti Martini;
Frodo pellætarius, Goiszelmus pelletarius.
|
(59)
Mérouville, ca. Janville,
ar. Chartres.
(75) Henri Loherenc
ou Lorrain fut reconnu gentilhomme (ingenuus)
par un jugement de la cour royale. Conseiller de Louis
VI, il en reçut, en 1112, les terres d’Aubervilliers,
Triel, Mons, Villeneuve, Ablon, la maîtrise
des criées du vin à Paris, et d’autres
privilèges (R. de Lasteyrie,
Cartul gén. de Paris, t. I, p. 151;
Luchaire, Annales de la vie de Louis
VI, n°136). — En 1117 Louis VI rappelle, au
sujet de la chapelle St-Georges de Champeaux, dépendant
de St-Magloire, que "Henricus Lotharingus,
fidelis noster, predicte capelle reparator et, quibuscumque
modis valet, benignus auxiliator, ad capsam in qua corpus
B. Maglorii requiescit superargentendam (que propter
matris ecclesie necessitatem ex omnium assensu fratrum,
fuit disparata et detecta), XIIi marchas argenti, et ad usus
fratrum 1 torcular apud Karronam (Charonne) villam et quicquid
habebat in vadimonium super II thuribula argentea et calicem
argenteum ejusdem ecclesie dedit." (Ms. I. 5413,
fol. 7).
(b) B Guarnaci.
(60) Mazolin, gardien
du péage établi
à St-Aubin-des-Bois, ar. Chartres.
(61) Maurepas,
ca. Chevreuse, ar. Rambouillet. Milon I, fils
de Simon I de Maurepas, est la tige de cette
famille, qui se rattache sans doute à la maison
de Chevreuse.
(62) Courserault,
ca. Nocé, ar. Mortagne (Orne). Métais,
Cartulaire de Saint-Denis
de Nogent-le-Rotrou, n°59.
(63)
Fontaine-Bouillant, éc. Champhol, ca.
Chartres.
(64) Cette notice
serait particulièrement intéressante
à dater, etc [note
donnée plus haut.] |
Texte
donné par Depoin (1905 et 1912)
|
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
Harduinus Capud
Ferri et Hugo filius ejus condonaverunt
monachis Sti Martini de Campis hoc quod
calumpniabant in Roenvilla, in presentia Ursi
prioris ejusdem monasterii; et inde habuit
Ve solidos de caritate, et filius ejus caligas
et sotulares.
|
Hardouin Chef-de-Fer et
son fils Hugues ont consenti aux moines de Saint-Martin-des-Champs
ce qu’ils leur contestaient à
Roinville, en présence d’Ours,
prieur du dit monastère; et il a obtenu
par là cinq sous à titre de cadeau,
et son fils des bottes et des souliers.
|
Et hujus concessionis
sunt testes: Teobaldus filius Teoli,
Aimericus Canardus, Jolduinus filius
Raibaldi, Gaufridus major de Meronvilla,
Warnerius filius Guanari, Ivo filius Herberti,
Paganus frater ejus; Frodo Cocceto filius;
Mazolinus pedaccerus Sti Albini; Milo filius Simonis
de Malorepastu, Salomon filius Hugonis de Corsosalz;
Arduinus filius Mazolini de Fontane, Stephanus
de Corsosalz; Teodon, Warinus, Jonas, Engelbertus,
servientes Sti Martini; Frodo pellætarius,
Goiszelmus pelletarius.
(Édité par D.
Marriere,
p. 368).
|
Et de cette concession
sont témoins: Thibaud fils de
Thiou; Aimery Canard; Joudouin fils de
Raibaud; le régisseur de Mérouville
Geoffroy; Garnier fils de Ganar; Yves
fils d’Hébert; son frère Payen; Fron
Cocheton fils; Mazolin gardien du péage
de Saint-Aubin-des-Bois; Milon fils de Simon de Maurepas;
Salomon fils d’Hugues de Courserault; Thion,
Garin, Jonas et Engelbert, sergents de Saint-Martin;
le pelletier Fron; le pelletier Joseaume.
|
Éditions
1) Domnus Martinus MARRIER, O.S.B.
(Dom Martin MARRIER, de l’ordre de saint
Benoît), Monasterii regalis
S. Martini de Campis Paris. ordinis cluniacensis,
historia, libris sex partita, per
domnum Martinum Marrier [in-4°; XIV+578
p.; «Histoire du monastère royal parisien
de Saint-Martin-des-Champs, de l’ordre
de Cluny, répartie en six livres, par dom
Martin Marrier, de l’ordre de saint Benoît»],
Parisiis (Paris), P. Cramoisy, 1637, p.
368.
2) COÜARD (archiviste du
département de Seine-et-Oise), Joseph
DEPOIN (secrétaire général
de la Société historique
du Vexin), DUTILLEUX (secrétaire
général de la Commission des Antiquités
et des Arts), DUFOUR (secrétaire
général de la Société
historique de Corbeil-Étampes),
LORIN (secrétaire général
de la Société historique de Rambouillet)
[éd.], Liber testamentorum
Sancti Martini de Campis. Reproduction annotée
du manuscrit de la Bibliothèque nationale
[in-8°; XV+124 p.], Paris, A. Picard & fils
[«Publications de la conférence
des Sociétés historiques du département
de Seine-et-Oise»], 1905, pp. 49-50.
Dont une réédition
numérique à la fois
en mode image et en mode texte par l’École
nationale des Chartes sur son site
Elec:
ÉCOLE DES CHARTES [éd.],
Liber testamentorum Sancti
Martini de Campis, in ID.,
ELEC (site web) [«Cartulaires
numérisés d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page49/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page50/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/acte38/
(en mode
texte), en ligne en 2008.
3) Joseph
DEPOIN (1855-1924), Recueil de chartes
et documents de Saint-Martin-des-Champs,
monastère parisien. Tome I [premier
de 5 volumes in-4°], Chevetogne (Belgique),
Abbaye de Ligugé & Paris, Jouve
& Cie [«Archives de la France monastique»
13, 16, 18, 20, 21], 1912-1921, tome I (1912),
pp. 46-47.
Dom Jean BECQUET (1917-2003),
Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs, monastère
parisien, par J. Depoin: Index par dom Jean
Becquet [25 cm; 70 p.], Ligugé,
Revue Mabillon [«Archives de la France monastique»
51], 1989.
Dont une réédition
numérique à la
fois en mode image et en mode texte par
l’École nationale des Chartes sur
son site Elec:
3b) ÉCOLE DES CHARTES
[éd.], Liber testamentorum
Sancti Martini de Campis, in ID.,
ELEC (site web) [«Cartulaires
numérisés d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page46/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page47/
(en mode
image) & http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps1/acte21/
(en mode texte), en ligne en 2008.
4) Bernard GINESTE [trad. &
éd.], «Donation d’Hardouin Chef-de-Fer
à Roinville (fin XIe siècle)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06h,
2008.
|
ANNEXE
6i
Hardouin,
témoin d’une donation d’Hugues de Gallardon
Charte d’Hugues en
faveur du prieuré des moines de Bonneval à Auneau, éditée
par Lefèvre (1867)
Cette charte fait état de quatre donations
successives, qu’Hugues récapitule solennellement avant son départ
prochain en Terre Sainte (à une date qui reste à déterminer).
Hardouin de Denonville (Harduinus de Danovilla)
fait partie des témoins de la deuxième.
Texte
donné par Lefèbvre (1867)
|
Traduction
proposée par Gineste (2009)
|
Quoniam
que Dei sunt non occultare, sed ut tardioribus tepidioribus que imitanda
proponantur, juxta ejus preceptum lucem coram hominibus concedet lucere,
tam futuris quam presentibus litterali tenacitate volo declarare quia
|
Traduction
à venir.
|
fidelibus ego Hugo, Gualardonensium
dominus, Deo dicatis cenobitalibus in Bonevallensi monasterio, summo
regi, ejusque quorum assunt ibi reliquie martyribus devotè famulantibus,
pro patris mei Henrici [sic (Hervei?) (B.G.)]
absolutione traditi tam honorifice ab ipsis inibi sepulture, et ut ego crebri
eorum adminiculante deprecatione erui a Jehennali tribulatione, paradisique
perfrui merear amena exultatione,
|
|
largitus
sum de meis possessionibus solemni donatione que cartule huic miserendo
nominatim mandavi retinere, scilicet mansum quod Foesvilla vocatur
totum, apud Alneellum castrum noviter extructum, terram
aratri unius culture sufficientem, et furnos qui in ipsa villa facti vel
futuri sunt; decimam quoque culturarum mearum que ibi erunt, nec non ipsius
castelli forum decimam et omne herbarum fructuumque teloneum, et Stagnum
quoddam cum dimidia parte molendini inibi construendi; capellam quoque
castelli, et ad ejus edificationem quindecim libras monete carnotensis, et
quicquid homines mei servi sive liberi illis dederunt, concessi. Huic vero
interfuerunt testes qui hoc audierunt et viderunt: Guarinus clericus, canonicus
sancte Marie; Gaufridus mariscalcus; Hugo Fulcoini; Albericus coquus; Ansoldus
de Mengervilla; Guido et Milo fratres mei; Haimericus
et Herveus balisterii; Rainoldus de Brai; Johannes de Clismunt;
Ivo Gaucherii; Iohannes vitulus; Rainardus clericus; Osmundus de Alneel;
Guillelmus de Viri; Robertus Brito.
|
|
In festivitate quoque ipsius sancti scilicet Nicholai videns
quia nominati fratres jam data honorifice construebant, donum adauxi scilicet
presbiteratus de Eclimonte et decimam culturarum mearum
ubicumque erunt vel fuerint et vinearum que habebam vel habiturus eram
et forum totum quod vulgù fera dicitur in festivitate ipsius sancti.
Nec non apud Galardonem aream molendini que Revacallis nuncupatur;
in castello quoque jam dicto Alneello scilicet quicquid babetur a porta
que respicit Sanctum Romanum et ab officinis fratrum et domos et ortos
usque ad aquam.
|
|
Hii
affuerunt testes: Robertus filius Gasthonis. Guillelmus dapifer. Marinus
prefectus. Harduinus de Danovilla. Osmundus de Alneel. Haimericus
arbalestarius et filius ejus Ansoldus. Ingelbertus de Bunena villa.
Johannes de Sclimonte. Odo de Danovilla. Seguinus
frater Roberti filii Gastonis. Gaufridus filius Milesendis. Guido de Barzileriis.
Durcardus de Ursunvilla. Gaufredus Goignart. Radulphus ex Puteo.
Albericus coquus. Ascelinus de Pomerio. Garinus et Guido fratres
mei cum quibus tunc signo crucis cartulam firmavi.
|
|
Deindè
videns monachos a supra scripta Deo devota congregatione apud nos jam devotos
regulariter jam degere, Deoque ut pote a tanta concione bene extrados in
hymnis et laudibus die noctuque [p.97] deservire, ut talium numerus quorum me credebam plurimum posse
adjuvari precibus, adaugeretur, unde plures vite necessaria haberent donavi.
Scilicet de quatuor redditibus quos habebam, vulgariter pedagia nominales,
decimam partem. Redduntur autem apud Alneellum et apud Hildopontem
et apud Lumret et apud Galardonem. In ipso quoque castello
Galardonis dedi decimam mercatum [pour mercati?
(B.G.)], et de duobus furnis quos inibi habebam cariorem propre
domum Nivelonis situm; tali videlicet tenore quatinus mater mea, dum advixerit,
fructus indè colligat, si vivens eis concedere noluerit voluntate
spontanea. Dedi et apud Veosiam unius carruge terram. Testes ex parte
mea: Guido frater meus. Marinus prefectus. Herveius filius Petri. Herveius
balistarius. Seguinus et Ansoldus de Sanctiul. Robertus de Danonvilla.
Osmundus miles. Garinus Villanus. Johannes de Sclimonte. Germundus
de Sclimonte. Nivelo filius Germundi. Ex parte eorum: Guido de Barzileriis.
Hugo filius Fulchoini. Isembardus Mariscalcus. Teudo de Nemore.
Albericus quoquus. Gaufredus Mariscalcus.
|
|
In alia
quoque festivitate prescripta confessoris, dum missa celebraretur solemnis,
allatus est quidam in redula nimis anxius, cujus pedem tribus ebdomadibus
consumpserat ignis divinus, qui usque ad vesperas inibi adjacens
ipsius sancti auxilium attentius deposcens, Domino quantum apud se ipsius
sancti possent merita demonstrante, subito curatus est. Cujus curationem ego
Hugo audiens, letus adveni, atque precioso confessori terram cultui unius
Karruge sufficientem per cultellum Willelmi filii Rotaldi donavi, apud villam
que dicitur Solaris duorum boum, et apud Voesiam duorum. Testes
Guillelmus Rotaldi. Vulgrinus pelliciarius. Odo pistor de famulis monachorum.
Tebaldus de Pometo. Radulphus de Puteo. Stephanus carpentarius.
|
|
Dominicum
quoque sepulchrum Jerosolymis petiturus, audientibus quibus ipso die, castella
mea et filiam meam commendavi meis [p.99]
fidelibus, Garino quoque fratre meo et uxore mea Agnete atque unica mea
Mahildi audientibus et concedentibus, cunctaque Bonevallensibus fratribus
diversis temporibus diversa per loca donaverant queque eorum caria quam
habebat presens abbas Robertus in manibus continebat recitatis, duo clausa
vinearum que apud Galardonem via publica dividit eis
adauxi; videlicet post meum obitum alterum et presentialiter alterum. Apud
Alneelum quoque post me habendum illis meam propriam
carrucam donavi cum omni apparatu et omnibus illius culturis. Hoc autem totum
ut jam predixi, Garinus frater meus cum uxore mea et filia mea que inde
ob memoriam rei geste, ut pote parvula, unum denarium de abbate accepit,
ad hoc enim eos convocaveram, audientibus testibus subscriptis, concessit.
Testes: Robertus Gathonis. Isnardus de Gaiis. Drogo Alberti. Gaufridus Haganonis
et Radulfus frater ejus. Guillelmus de Sancto-Piato. Guillelmus Gauffridi
Strabonis. Robertus nigro dorso. Garnerius de Sancto Hylario. Guillelmus
Rotaldi. — Hoc autem meum beneficium meis annuens precibus, comes de Petra-forti,
Guido nomine, de cujus fevo erat, cum uxor sua concessit. Testes: ego ipse,
Urso- Ursonis filius, Simon Neelfa.
|
|
Éditions
1) Édouard
(Pierre-Édouard-Alexandre) LEFÈVRE
(ancien chef de division à la Préfecture
d’Eure-et-Loir, historien de la Beauce, membre
correspondant du Comité des travaux historiques
et scientifiques et de plusieurs sociétés
savantes, historien de la Beauce), Documents historiques
et statistiques sur les communes du canton d’Auneau
arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir)
[2 volumes in-16, ou in-12; extrait de l’Annuaire d’Eure-et-Loir
(1867) & (1868)], Chartres, Garnier, 1867-1869,
tome 1 (1867), pp. 96.
2) Bernard
GINESTE [éd.], «Hugues de Gallardon:
Donation d’Hugues de Gallardon au prieuré d’Auneau
(non datée)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe06i,
2008.
|
ANNEXE 7
Dossier sur la famille d’Aunay
7a. Gautier I d’Aunay se porte caution pour un
jardin (vers 1068).
7b. Gautier I d’Aunay et ses fils consentent
à une donation près de Boisville (avant 1079).
7c. Gautier I et Gautier II témoins à
Abonville (avant 1079).
7d. Gautier I d’Aunay renonce à l’église
d’Épeautrolles (entre 1079 et 1082).
7e. Gautier I et Rainaud d’Aunay témoins
d’un affranchissement (entre 1079 et 1082).
7f. Raynaud d’Aunay témoin à Quémonville
(Boisville-la-Saint-Père) (entre 1079
et 1101).
7g. Donation de voiries en Beauce autorisée
par Gounier d’Aunay (7 mars 1082)
7h. Autorisation
par Gounier d’Aunay d’une vente de voiries en Beauce (1082
ou peu après)
7i. Gauthier
II d’Aunay témoin en 1096 (1096)
7j. Obits de Gautier II d’Aunay et de ses alliés
(fin XIe siècle - début XIIe siècle)
7j2. Mentions d’un Gautier d’Aunay témoin, de
son épouse Milsent Chef-de-Fer et de belle-mère
Hersent (avant 1112-vers1114).
7j3. Un Gautier d’Aunay non identifié témoin trente
ans plus tard (vers 1128).
7k.
Gounier de
Saint-Avit donne une terre à Raville près
Dreux (entre 1100 et 1120)
7l. Gounier d’Aunay gouverneur de Bayeux
en 1105 (témoignage
d’Orderic Vital)
7m. Garin d’Aunay témoin d’une donation
d’Helsent (1108 ou 1109)
7n. Gounier d’Aunay renonce à la dîme
de Gouillons (1108 ou 1109)
7o. Gounier d’Aunay renonce à la dîme
de Thivars (après 1115)
7p. Restitution d’une terre par Garin d’Aunay
aux moines de Saint-Père (non datée)
7q. Donation de Garin d’Aunay sur son lit
de mort (après 1130)
7r. Gounier d’Aunay témoin d’une charte du comte
Thibaud (vers 1128).
7r. Donation de Garin d’Aunay sur son lit
de mort (après 1130).
7s. Gounier témoin de plusieurs actes du Cartulaire de
Bonneval
(de 1118 à 1141).
7t. Gounier témoin d’un consentement de Geoffroy IV de
Châteaudun (1140).
7u. Gounier d’Aunay autorise une donation à Unverre
(vers 1146).
7v.
Mention d’Obert d’Aunay
dit Payen Torcul, fils de Garin
(avant 1151)
7w. Répertoire
un peu vieilli des membres de la famille d’Aunay donnée
par Lépinois (1854)
|
ANNEXE 7a
Gautier I d’Aunay se porte
caution pour un jardin
Rosceline restitue un jardin
aux moines de Saint-Père (vers 1068)
Cette
charte date de l’abbatiat d’Hubert, successeur
de Landry, lui-même mort, selon les auteurs,
en 1067 ou 1069; Hubert fut chassé puis rappelé
en 1075, et à nouveau chassé définitivement
en 1078, avant d’être remplacé en 1079
par Eustache (Guérard, Cartulaire
de Saint-Père, pp. CCXLII-CCXLIII). Notre charte
est connue par deux copies, dont la deuxième, un
peu plus tardive, précise qu’elle daterait le la neuvième
année du règne de Philippe Ier. Ce dernier
ayant été sacré en 1059 et ayant succédé
à son père en 1060, on peut donc hésiter
entre 1067 et 1068; mais il ne s’agit sans doute que d’une
date approximative, comme dans le cas de la charte suivante,
tirée de la mention de l’abbé Hubert, dont
on aura porté la première année d’abbatiat.
Vu que le lieu de ce jardin n’est pas mentionné,
il doit s’agir du jardin des moines à Chartres
même.
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
Capitulum LXXIX.
De
orto empto super flumen Audure.
[ Ante a. 1080.]
|
Chapitre 79.
Du jardin
que nous avons acheté au bord de l’Eure.
[vers 1068]
|
|
Notum esse volumus, ego Hubertus abbas,
et omnes monachi cœnobii Carnotensis, quia |
Nous voulons qu’il soit connu, moi l’abbé
Hubert et tous les moines du monastère de Chartres,
ceci. |
quendam ortum, in nostra terra juxta ortum
nostrum situm, quædam mulier, Roscelina nomine,
per XX et amplius annos, a primo seniore suo Gausfrido,
dotis jure, concessum tenuerat; de quo nullum habuit sobolem.
|
Une femme dénommée Rosceline avait
tenu plus de vingt ans un jardin situé dans notre
terre à côté de notre jardin qui lui avait
été donné en dot par son premier mari
Geoffroy, de qui elle n’a pas eu de progéniture.
|
Nunc,
quadrigama, a nobis taxatam peccuniam accipiens,
reliquit perpetualiter possidendum, donumque vel
guerpum, cum presentí suo seniore Huberto, necnon
et filiis tribus quos habuit de Frodone, quibus etiam dedimus
munuscula, super altare apostolorum Petri et Pauli posuit,
|
A
présent mariée pour la quatrième
fois, elle a reçu de nous le prix qui valait
ce jardin et nous en a cédé la jouissance
à perpétuité, et, avec son présent
mari Hubert, ainsi qu’avec les trois fils qu’elle a eus de
Fron, auxquels nous avons donné de menus présents,
elle en a posé la donation ou cession sur l’autel
des apôtres Pierre et Paul.
|
sub praesentia nostri ac nostrorum
servientium, quorum nomina subscripsimus: Bernardus, filius
Vulmari; Stephanus major et Salomon, frater ejus;
Dodo major, Oydelerius, Alcherius mulnarius; Belod,
filius ejus; Fulchardus, Rainaldus agaso, Ascelinus
major, Hugo berbellus, Gislebertus.
|
en notre présence et celle de nos
serviteurs, dont nous avons porté les noms ci-après:
Bernard fils de Voumard, le régisseur Étienne
et son frère Salomon, le régisseur Don, Oidelier,
le meunier Auchier, son fils Bélod, Fouchard, le
palefrenier Rainaud, le régisseur Ascelin, le Hugues
Berbeau, Gisbert.
|
Ex parte mulieris: Walterius de
Alneto et Sugerius, quorum prius astipulator constitutus
est soliditatis.
|
Du côté de cette femme: Gautier
d’Aunay et Suger, dont le premier a été
institué caution pour le tout.
|
(1) In cod. dicto Argenteo,
post nomina testium, addita sunt hæc: Actum
est hoc puplice Carnotis, regnante Philippe rege anno
IX.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 205.
|
Note de Guérard:
Dans le codex appelé
Argenteus, après les noms des témoins,
est ajouté ceci: Cela s’est
fait publiquement à Chartres, sous le règne
du roi Philippe, l’an IX.
|
1)
Benjamin GUÉRARD,
[éd.], Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp. 205.
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard GINESTE [trad. & éd.], «Rosceline restitue un jardin aux moines de Saint-Père
(vers 1068)»,
in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant
Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07a,
2008.
|
ANNEXE 7b
Gautier I d’Aunay et ses
fils consentent à une donation près de Boisville
Gautier fils de Fléaud
donne la moitié de la voirie d’Honville (avant 1079)
Cette
charte date de l’abbatiat d’Hubert, successeur
de Landry, lui-même mort, selon les auteurs,
en 1067 ou 1069; Hubert fut chassé puis rappelé
en 1075, et à nouveau chassé définitivement
en 1078, avant d’être remplacé en 1079
par Eustache (Guérard, Cartulaire
de Saint-Père, pp. CCXLII-CCXLIII). Notre charte
est connue par deux copies, dont la deuxième, un peu
plus tardive, précise qu’elle daterait le la neuvième
année du règne de Philippe Ier. Ce dernier ayant
été sacré en 1059 et ayant succédé
à son père en 1060, on peut donc hésiter
entre 1067 et 1068; mais il ne s’agit sans doute que d’une date
approximative, comme dans le cas de la charte précédente,
tirée de la mention de l’abbé Hubert, dont on
aura porté la première année d’abbatiat.
Hunis-villa peut représenter
théoriquement Oinville-sous-Auneau que Honville
comme le croit Lefèbvre), hameau de Boisville-la-Saint-Père,
mais il faut clairement y préférer Honville,
hameau tout proche de l’actuelle commune de Réclainville.
Et cela d’autant plus que nous voyons Hugues du Puiset
venir assister à Boisville au consentement donné
par Payen d’Étampes à la donation de Vierville
par Gautier II.
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
Capitulum LXXVIII.
De vicaria
Hunis Villæ, et atrii æcclesiæ
Reclamantis Villæ.
[ Ante a. 1080.]
|
Chapitre 25.
De la
voirie d’Honville et du cimetière de l’église
de Réclainville.
[avant 1079]
|
In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.
Ego Hubertus, gratia Dei, abbas, et omnis congregatio
sancti Petri Carnotensis cœnobii, notum esse volumus, tam presentibus
quam futuri evi, sanctæ Dei æcclesiæ fidelibus,
|
Au nom de la sainte et indivise Trinité.
Moi Hubert par la grâce de Dieu abbé, ainsi
que tout le chapitre du couvent de Saint-Père de
Chartres, nous voulons qu’il soit connu des fidèles
de l’Église de Dieu tant d’ajourd’hui que du temps
à venir, ceci.
|
Walterium, videlicet filium Fladaldi, medietatem
vicariæ Hunis Villæ necnon et Reclamantis
Villæ atrii æcclesiæ, ac tocius terraæ quæ ad istas duas villas
pertinet, pro salute suæ et conjugis animæ,
atque pro animabus parentum suorum, sancto Petro concessisse
perpetuo jure; pro eaque accepisse agripennum unum vineæ,
quæ vocatur Radfredus, pro quo nobis offerebantur
XXV libre nummorum.
|
Gautier, c’est-à-dire le fils de
Fléaud, pour le salut de son âme et de celle
de son épouse, ainsi qu’au bénéfice
des âmes de leurs parents, a cédé
à perpétuité à Saint-Père
la moitié de la voirie d’Honville et de
l’enclos de l’église de Réclainville, ainsi
que de toute la terre qui relève de ces deux
domaines; et en échange il a reçu un arpent
d’une vigne dénommée Rafroy, pour lequel on
nous proposait une somme de 25 livres.
|
Huic quoque dono assensum praebuerunt VValterius
de Alneto, cujus beneficio hanc ipsam vicariam supra
dictus Gualterius tenuerat; filiique ejus Gunherius,
Gauslinus, Gualterius, cum patre, assenserunt.
|
A cette donation ont aussi fourni leur consentement
Gautier d’Aunay, de qui le susdit Gautier tenait en fief
la susdite voirie, et ses fils Gounier, Jocelyn et Gautier.
Ils y ont consenti avec leur père.
|
Subscripsimus etiam propinquos VValterii,
eosque qui cum eo fuerunt, quando super altare sancti
Petri hujus rei guerpum posuit, necnon et famulorum
nostrorum nomina, quos inibi habuimus; ut si quis unquam
huic operi calumniari temptaverit, prius a liminibus
sanctæ Dei æcclesiæ sequestratus, et anathematis
jugulo sauciatus, ab uno horum baculo ultionis propellatur,
nisi resipuerit, in inferno inferiori.
|
Nous avons encore marqué ci-dessous
les proches de Gautier et ceux qui se sont trouvés
avec lui, quand il a déposé sur l’autel
de Saint-Père la cession de ce bien, ainsi que les
noms aussi de nos serfs que nous avons eu là; ainsi,
si quelqu’un tentait jamais de contester cette réalisation,
tout d’abord exclu des parvis de la sainte Église
de Dieu, et égorgé par le coup d’une excommunication,
il serait propulsé par l’un de ces bâtons de
châtiment, s’il ne se repentait pas, au plus profond
de l’enfer.
|
Rajenaldus, frater Gualterii. Fredesindis,
[p.205] conjux ejus. Beliardis, soror ejus. Rajenaldus,
filius ejus. Adelina, filia ejus. Gislebertus de
Britiniaco.
|
Rainaud frère de Gautier, Fersent
son épouse, Béliard sa sœur, Rainaud
son fils, Adeline sa fille, Gisbert de Brétigny
[commune de Sours].
|
Nobiscum: Gerogius et Fulco, fratres
et canonici; Erardus canonicus, Gualterius monetarius,
Gilduinus major, Girbertus major, Stephanus major;
Goscelinus et Rodberlus, telonearii; Guarinus pistor, Teodaldus,
Fulchardus, Aventius, Lorinus, Gislebertus, Gunbaldus,
Oydelerius, Laurentius, Rainaldus agaso, Ragenfredus
de Reclamantis Villa (1).
|
De notre côté: les frères
et chanoines Giroie et Foulques, le chanoines Érard,
le monnayeur Gautier, le régisseur Gidouin,
le régisseur Gibert, le régisseur Étienne,
les péagiers Jocelyn et Robert, le boulanger Garin,
Thibaud, Fouchard, Avence, Lorin, Gisbert, Gombaud, Oidelier,
Laurent, le palefrenier Rainaud, Rainfroy de Réclainville.
|
(1) In cod. dicto Argenteo, post
nomina testium, addita sunt hæc: Actum
est hoc puplice Carnotis, regnante Philippo rege anno IX.
Cartulaire de Saint-Père,
pp. 203-204.
|
Note de Guérard:
Dans le codex appelé
Argenteus, après les noms des témoins,
est ajouté ceci: Cela s’est
fait publiquement à Chartres, sous le règne
du roi Philippe, l’an IX.
|
Éditions
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp. 203-204.
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.],
«Gautier fils de Fléaud donne
la moitié de la voirie d’Honville aux moines de Saint-Père (avant 1079)», in
ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville (fin
XIe siècle)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07b,
2008.
|
ANNEXE 7c
Gautier I et
Gautier II consentent à une donation à
Abonville
Gautier fils de Fléaud donne
la voirie d’Abonville aux moines de Saint-Père
(avant 1079)
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
Capitulum LXXXII.
De vicaria Abonis Villa.
[ Ante a. 1080.]
|
Chapitre 82.
De la voirie d’Abonville.
[avant 1079]
|
Notum sit omnibus sanctæ Dei æcclesiæ
fidelibus, quod
|
Que soit connu de tous les fidèles de
la sainte Église ceci.
|
Gualterius, filius Fledaldi, et uxor ejus
Fredesindis, cum assensu Gualterii de Alneto, de cujus
fisco erat, sicut antea dederat Berardus socer ejus, pro anima
patris ac matris fratrisque Guaningi interfecti, vívente
abbate Landrico, ita postea vívente abbate Huberto,
vicariam Abonis Villæ et totius territorii ejusdem villæ,
cum alodo Picati Villaris, sancto Petro gurpivit, de eo quod
injuste sibi usurpaverat, post mortem præfati Guaningi.
|
Gautier fils de Fléaud et sa femme Fressent,
avec le consentement de Gautier d’Aunay de qui relevait
ce fief, de la même manière qu’en avait fait don
antérieurement donné son beau-père
Bérard pour le salut des âmes de son père,
de sa mère et de son frère assassiné
Guénin, du vivant de l’abbé Landry, a de même
cédé à Saint-Père la voirie
d’Abonville et de tout le territoire du dit domaine, y compris
l’alleu de Poisvilliers, qu’il s’était injustement
appropriée après la mort du dit Guénin.
|
Hujus rei testes sunt:
Gualterius de Alneto et filius ejus Gualterius, Evrardus
de Levois Villa, Gualterius Blancardus; Gislebertus, frater
Beringarii; Rainaldus, filius Hugonis de Reclamantis Villa;
Hugo de Treijone, Gunbertus de Raschin Villa, Germundus de
Sancto Albino, Geragius de Haimulfi Villa, Gilduinus major, Stephanus
major, Bernardus, Fulchardus; Ernulfus et Rainaldus, filius ejus;
Tealdus, frater abbatis; Gislebertus et Laurentius, fratres; Adventius;
Oydelerius et Rodbertus, fratres; Gualterius et Adventius, sartores;
Teduinus et Gaudius, fratres; Gausfridus carpentarius; Ingelbertus
et Gausfridus, coci.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 207.
|
Voici
les témoins de cette affaire: Gautier d’Aunay
et son fils Gautier, Évrard de Levesville, Gautier
Blanchard; Gisbert frère de Bérenger;
Rainaud fils d’Hugues de Réclainville; Hugues de
Tréon, Gombert de Raschin Villa (?), Germond
de Saint-Aubin, Giroie d’Ymonville,
le régisseur Gidouin, le régisseur Étienne;
Bernard; Fouchard, ses fils Arnoux et Rainaud; Théaud frère de l’abbé; les frères
Gisbert et Laurent; Avence; les frères Oidelier
et Robert; les tailleurs Gautier et Avence; les frères
Thouin et Gaud; le charpentier Geoffroy; les cuisineirs Engebert
et Geoffroy.
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de
France» 1-2], 1840, p. 207.
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad.
& éd.],
«Gautier fils de Fléaud
donne la voirie d’Abonville aux moines de Saint-Père
(avant 1079)
», in ID. [éd.],
«Thion Chef-de-Fer: Notices
concernant Vierville (fin XIe
siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07c,
2008.
|
ANNEXE 7d
Gautier I d’Aunay renonce à l’église
d’Épeautrolles
(entre 1079 et 1082)
Texte édité par Guérard
(1840)
|
Traduction proposée par Gineste (2008)
|
|
Capitulum XXV.
De calunnia
Spelterolensis æcclesiæ remissa a Gualterio
de Alneto.
[Ante a. 1102.]
|
Chapitre 25.
De la
contestation relative à l’église d’Épeautrolles
abandonnée par Gautier d’Aunay.
[entre 1079 et 1101.]
|
In Christi nomine. Notum esse volumus omnibus nostris successoribus,
ego videlicet Eustachius abbas et omnes fratres cœnobii
sancti Petri Carnotensis, quod,
|
Au nom du Christ. Nous voulons qu’il soit
connu de tous nos successeurs, moi l’abbé Eustache
et tous les frères du couvent de Saint-Père de
Chartres, ceci.
|
postquam Spelterolensis æcclesia
data nobis est a Hugone Drocensi et a filia ejus,
Gausberto et Guarino, necnon et a matre eorum, nomine Osilia,
frater ille quem illuc misimus frequenter a Gualterio
de Alneto injurias et danna pertulit, donec prefato Gualterio
quinquaginta nummorum solidis dedimus: eo quidem pacto,
ut fratrem illum in pace vivere dimitteret, et calunniam
quam de ipsa æcclesia faciebat missam faceret.
|
Après que l’église d’Épeautrolles
nous a été donnée par Hugues
de Dreux et par sa fille, par Jobert et Garin ainsi
que par leur mère nommé Osilia, le frère
que nous y envoyions a fréquemment subi des
outrages et des dommages de la part de Gautier d’Aunay, jusqu’au
moment où nous avons donné au susdit Gautier
une somme de cinquante sous, étant précisé
qu’il laisserait ce frère vivre en paix et qu’il
abandonnerait la contestation qu’il élevait au
sujet de la dite église.
|
Quod libenter annuens, Carnotis publice
super altare sancti Petri guerpum calunniæ
posuit, secum habens Rainbaldum clericum.
|
C’est ce qu’il a fait de son plein
gré, à Chartres, en déposant publiquement
sur l’autel de saint Pierre l’abandon de sa contestation,
ayant avec lui le clerc Raimbaud.
|
Nobiscum vero fuerunt, Gerogius clericus;
Stephanus et Salomon, fratres; Teduinus, Gaudius
et Harduinus, fratres; Oydelerius et Rotbertus, fratres;
Hildulfus et Gausfridus, fratres; Adventius, Fulchardus,
Stephanus, Tescelinus; Ingelbertus et Gausfridus, coci;
Herbertus et Guarinus, pistores.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 251.
|
Avec nous se sont trouvés: le clerc
Giroie, les frères Étienne et Salomon,
les frères Thoin, Gaud et Hardouin, les frères
Oidelier et Robert, les frères Audoux et Geoffroy;
Avence, Fouchard, Étienne, Tescelin; les cuisiniers
Engibert et Geoffroy, les boulangers Hébert et Garin.
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, p. 251.
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Gautier I d’Aunay renonce à l’église
d’Épeautrolles (entre 1079 et 1082)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07d,
2008.
|
ANNEXE 7e
Gautier I et Rainaud d’Aunay
témoins d’un affranchissement
Girouard, serf des moines de Saint-Père,
se rachète (entre 1079 et 1082)
Texte édité par Guérard
(1840)
|
Traduction proposée par Gineste (2008)
|
|
Capitulum XXXVII.
De libertate
Giroardi, pro quodam fisco obtenta.
[Ante a. 1102.]
|
Chapitre 37.
De la liberté
de Girouard, obtenue moyennant un certain fisc.
[entre 1079 et 1082.]
|
|
Giroardus quidam, servus sancti Petri Carnotensis,
ab abbate Eustachio, annuentibus monachis, manumissus,
fiscum seu feudum, quod а monasterio tenebat, eidem
monasterio dimittit, addens etiam X libras denariorum,
|
Un certain Girouard, serf de Saint-Père
de Chartres, affranchi par l’abbé Eustache, avec l’accord
des moines, a cédé au monastère un
fisc ou fief qu’il tenait du dit monastère, y ajoutant
en outre 10 livres,
|
præsentibus, cum abbate Eustachio,
Mainardo, Paulo et Huberto monachis;
|
étant présents avec
l’abbé Eustache les moines Ménard, Paul et
Hubert;
|
testibus: ex parte Giroardi, Gualterio
de Alneto, Rainaldo fratre ejus, Teudone Tronello, Tetboldo
sororio Tronelli:
|
avec pour témoins, du côté
de Girouard: Gautier d’Aunay, son frère
Rainaud, Thion Troneau et le beau-frère de Troneau,
Thibaud;
|
ex parte monachorum, Gumbaldo, Laurentio, Gisleberto,
Gaudio, Gualterio et Adventio sartoribus, Stephano
majore.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 294.
|
du côté des moines: les tailleurs
(sartores) Gombaud, Laurent, Gisbert, Gaud,
Gautier et Avence ainsi que le régisseur Étienne.
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, p. 294.
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd .], «Girouard, serf des moines de Saint-Père,
achète sa liberté (entre 1079 et
1082)», in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07e,
2008.
|
ANNEXE 7f
Raynaud d’Aunay témoin à Quémonville
(Boisville-la-Saint-Père)
Eudes fils d’Ansoud donne
Quémonville aux moines de Saint-Père (entre
1079 et 1101)
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
CLV.
De terra
Camonis Ville ab Odone, filio Ansoldi, nobis data.
|
155.
De la
terre de Quémonville qui nous a été
donnée par Eudes fils d’Ansoud.
|
Legentibus litteras istas certum sit
omnibus, quod Odo, filius Ansoldi, filii Morini,
quando in hoc nostrum sancti Petri videlicet monasterium
venit ad monachatum, donavit ecclesie nostre in elemosinam
totam terram quam habebat in Belsia, apud Communvillam vel
in vicinia, ita liberam sicut et ipse et pater eam, sicut alodum,
possederant.
|
Qu’il soit bien établi pour tous
ceux qui lisent cet acte qu’Eudes fils d’Ansoud fils de Morin,
lorsqu’il est venu pour se faire moine au présent monastère
de Saint-Père, a donné en aumône à
notre église toute la terre qu’il possédait
en Beauce, à Quémonville ou aux environs, aussi
franche que lui-même et son père l’avait possédée
en temps d’alleu. |
Quod ejus donum viderunt et audierunt
hii qui presentes affuerunt, quorum hec sunt nomina: Paganus,
major sancti Martini; Rogerius Unfredi, Dulcinus Odonis,
Hungerius, Avesgotus tinctor, Guillelmus feltreius, Stephanus
sellarius, Herveus de Concreis, Barbo, Budinus, Hugo Pelleve,
Ivo de Porta Morardi, Garinus de Cepei, Rainoldus de Alneto,
Reinerius viarius; Rainardus, filius Iteline; Stephanus clausarius,
Rainardus Aventii, Gislebertus Alboin.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 368.
|
Ont assisté à la donation qu’il
en a faite ceux dont les noms suivent: Payen, le régisseur
de Saint-Martin, Roger Onfray, Doucin Eudes, Hongier, le
teinturier Avesgot, le feutrier Guillaume, le sellier Étienne,
Hervé de Concrez, Barbon, Boudin, Hugues Pellève,
Yves de la Porte-Morard, Garin de Spoir
[commune de Mignières],
Rainaud d’Aunay, le voyer Rainier, Rainard fils d’Iteline, le
gardien de vigne Étienne, Rainard Avence, Gisbert Alboin.
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, p. 368.
Dont
une réédition numérique par
Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], « Eudes fils d’Ansoud donne Quémonville aux
moines de Saint-Père (entre 1079 et 1101)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07f,
2008.
|
ANNEXE 7g
Donation de voiries en Beauce autorisée
par Gounier d’Aunay
Gautier fils de Fléaud
donne toute sa voirie aux moines de Saint-Père
(7 mars 1082)
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
[t.
I, pp.238-239]
Capitulum XIII.
De
vicaria Belsiæ.
Ante a. 1091.
|
D’une voirie en Beauce.
(7
mars 1082)
|
In Christi nomine. Ego Walterius, filius Flealdi,
abbatis sancti Petri Eustachii et sibi conmissæ congregationis
precibus adductus, vicariam omnem quam in omnibus
terris sancti Petri habebam, uxore mea Fredesindi et filio
meo Rainaldo, cum fratribus et sororibus suis, atque etiam
Lisiardo annuentibus, pro animarum nostrarum et parentum nostrorum
redemptione, per consensum domni mei Gunherii, ecclesiæ
sancti Petri in perpetuum dimitto;
|
Au nom du Christ. Moi Gautier fils de Fléaud,
obéissant aux prières de l’abbé
de Saint-Père Eustache et de l’assemblée qui
lui a été confiée, je cède à
perpétuité toute la voirie que je détenais
dans toutes les terres de Saint-Père, avec l’accord
de ma femme Fressent et de mon fils Rainaud avec ses frères
et ses sœurs, et aussi de Lisiard, pour le salut de nos âmes
et celles de nos parents, avec le consentement de mon seigneur
Gounier.
|
accipiens michi in concanbium a prefato abbate et
monachis tres agripennos vinearum, in convalle Sancti
Bartholomei, in clauso qui dicitur Ingelbaudi. Unde etiam
predicti monachi præfatæ uxori meæ duas
auri untias, et filio meo equum argenti marcis sex comparatum donant,
prædicto etiam Lisiardo V addentes solidos.
|
Je reçois
pour moi en échange, du dit abbé et des moines,
trois arpents de vignes dans le val de Saint-Barthélémy,
au clos dit d’Engibaud. En outre pour cette raison les moines
donnnent à ma susdite épouse deux onces d’or,
à mon fils un cheval valant six marcs d’argent, et ils y
ajoutent cinq sous pour Lisiard.
|
Quod etiam posteritati nostræ notum facere
et per succedentia tempora ratum manere cupientes, litterarum
memoriæ tradi voluimus; et manu nostra annotando
firmavimus, atque domnis et amicis nostris ad corroborationem
tangendum obtulimus.
|
Désirant
faire savoir cela à notre descendance et que cela
reste bien établi à travers les âges
à venir, nous avons décidé d’en confier
le souvenir à un écrit, nous l’avons certifié
par une note de notre propre main et nous l’avons présenté
à nos seigneurs et amis pour qu’ils en touchent le
certificat.
|
S. Gualterii,
filii Flealdi. Fredesindis, uxoris. Rainaldi, filii ejus. Heliae.
Hugonis. Lisiardi. Adeline, filiae ejus. Elisabeth.
|
Marque de Gautier
fils de Fléaud. De son épouse Fressent, de son
fils Rainaud. D’Élie. D’Hugues. De Lisiard. De sa
fille Adeline. D’Élisabeth.
|
Ex parte Gualterii: Rodbertus, filius Rodulfi; Hugo,
filius Lamberti; Ivo, filius Norberti; Oydelardus, nepos
Gualterii; Einardus, Raimbaldus presbiter, Lanbertus presbiter.
|
Du côté
de Gautier: Robert fils de Raoul; Hugues fils de Lambert;
Yves fils de Norbert; Oidelier neveu de Gautier; Einard,
le prêtre Raimbaud, le prêtre Lambert.
|
Ex nostra parte: Gausfredus
præsul, Ingelrannus decanus, Adelardus subdecanus,
Gauslinus archidiaconus, [p.239]
Guerricus clericus, Hilbertus de Gurzeis, Gerogius
clericus, Guerricus vicedomnus, Willelmus præpositus;
Tedbaldus, frater ejus; Tedbaldus Farsit, Willelmus Mordens,
Jhotardus, Gunbaldus, Laurentius cubicularius; Fulchardus,
Teduinus et Gaudius, fratres; Hildulfus et Gausfredus, fratres;
Adventius, Stephanus et Salomon, fratres; Ingelbertus, Johannes,
Gausfredus, coci; Gualterius sartor, Ribaldus de Frausino;
Stephanus, filius Dodonis; Radul, filius Hildegarii.
Cartulaire de Saint-Père,
pp. 238-239.
|
De notre côté: l’évêque
Geoffroy, le doyen Engeran, le sous-diacre Allard,
l’archidiacre Jocelyn, le clerc Guerry, Aubert de Gorgel,
le clerc Giroie, le vidame Guerry, le prévôt
Guillaume, son frère Thibaud, Thibaud Farsit, Guillaume
Mordant. Jouard, Gombaud, le chambrier Laurent, Fouchard,
les frères Thouin et Gaud, les frères Audoux
et Geoffroy, Avence, les frères Étienne et
Salomon, les cuisiniers Engibert, Jean et Geoffroy, le tailleur
Gautier, Ribaud du Frêne, Étienne fils de Don, Raoul
fils d’Augier.
|
|
[t.
II, p. 423] XXVIII.
Charta quæ hic
habetur in Cod. jam prodiit superius, pars I, lib. VIII,
с. XIII, p. 238 sq.; subjungemus duntaxat notas quæ sequuntur.
|
[Note de Guérard]
La
charte qu’on trouve ici [dans le codex Argenteus]
a déjà éditée
plus haut [avec le
Vieil Aganon], partie I, livre VIII,
chapitre XIII, pp. 238-239; nous y joindrons seulement les
notes qui suivent.
|
Anno
ab incarnatione Domini MLXXXII°, indictio [sic] V, nonas martii [7 mart. 1082.], regnante
Philippe nobilissimo rege Francorum, Theobaldo comite,....
Galterius vicecomes, etc.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 423.
|
L’an de l’incarnation
du Seigneur 1082, en la 5e indiction, aux nones de mars
[le 7 mars], sous le règne
de Philippe très illustre roi des Francs Philippe,
Thibaud étant comte,..... le vicomte Gautier, etc.
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp.238-239 (tome I) &
423 (tome II).
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Gautier fils de Fléaud donne toute sa
voirie aux moines de Saint-Père (7 mars 1082)», in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07g,
2008.
|
ANNEXE 7h
Autorisation par Gounier d’Aunay d’une
vente de voiries en Beauce
(1082 ou peu après)
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
|
Capitulum XIV.
Donum Gunherii de vicariis.
[Ante a. 1102].
|
Chapitre 14.
Donation par Gounier de
voiries.
[1082 ou peu après]
|
In nomine omnium Conditoris rerum. Notum esse
volumus, ego Eustachius abbas omnisque congregatio
monachorum Sancti Petri Carnotensis, omnibus
fidelibus, tam presentís quam futuri evi, quod
|
Au nom
du Créateur de toutes choses. Moi l’abbé Eustache et tout le chapitre des
moines de Saint-Père de Chartres, nous
voulons qu’il soit su de tous les fidèles présents
et à venir, ceci.
|
Gunherius de Monte Letardi (1),
filius videlicet Gualterii de Alneto, de vicariis quas
in Belsia nobis Gualterius filius Flealdi vendidit, tam
in Abonis Villa quam in aliis locis, assensum libentissime
prebuit, donumque super altare sancti Petri posuit.
|
Gounier
de Molitard (1), fils de Gautier d’Aunay,
a très volontiers donné son consentement
au sujet des voiries que nous a vendues en Beauce Gautier
fils de Fléaud, tant à Abonville que dans
d’autres lieux, et il a déposé cette donation
sur l’autel de saint Pierre.
|
Non
solum de datis vel venditis, set etiam de dandis vel vendendis,
solidam nobis firmitatem dedit, ut a suis militibus acciperemus;
et non solum vicarias quae de ejus beneficio esse noscuntur,
sed etiam terras quas sui milites sancto Petro dare vel vendere
voluerint, assensum præbuit ut habeamus.
|
Non
seulement il nous a donné pleine assurance de recevoir
de ses chevaliers les biens qu’ils nous ont vendus ou
donnés, et non seulement les voiries qui passent
pour relever de son fief, mais il a de plus donné son
consentement pour que nous possédions les terres que
ses chevaliers voudraient donner ou vendre à Saint-Père. |
Quapropter nos eum collegimus in orationibus et in
omnibus nostris bonis operibus, ut particeps præmii
sit nobiscum in regno cœlorum.
|
C’est pourquoi
nous l’associons à nos prières et à
toutes nos bonnes œuvres, pour qu’il participe avec nous
à leur récompense dans le royaume des cieux.
|
Testes concessionis ejus in hac scedula subscribere
usu æclesiastico voluimus. De sua parte: Ansoldus
de Mungerii Villa.
|
Nous avons
voulu noter les témoins de ce consentement sur cette charte
ci-dessous selon l’usage ecclésiastique. De son
côté: Ansoud de Mongerville.
|
De nostra:
Balduinus, frater abbatis; Wibaldus et Rainaldus, filius Ernulfi
Rufi; Fulchardus, Laurentius, Durandus, Richerius, Rodbertus
pelliciarius, Stephanus, Isenbardus, Gualterius de Ver.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 239.
|
De notre côté:
Baudouin le frère de l’abbé; Guibaud
et Rainaud, fils d’Arnoux Roux; Fouchard, Laurent, Durand,
Richer, le pelletier Robert, Étienne, Isembard,
Gautier de Ver.
|
NOTES DE BERNARD GINESTE
(2008)
(1)
Molitard, en latin Mons Letardi, ancienne
commune réunie à celle de Conie-Molitard,
canton de Châteaudun. S’agit-il d’un apanage, alors
que Gautier I est toujours vivant? En 1095, la fille d’un
certain Eudes de Molitard (de Monte-Letardi) consent
à la vente par son mari, Gislard de Chantasmo,
aux moines de Marmoutier, le territoire de Moulon,
de Molonio (Mémoires de la Société
archéologique de Touraine XIV, 1863, p. 107).
S’agit-il du Moulon de Gif-sur-Yvette (Essonne) ou de Moulon
du Gâtinais (Loiret), ou encore de Saint-Georges-sur-Moulon
(Cher)?
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, p. 239.
Dont
une réédition numérique par
Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad . & éd.], «Autorisation par Gounier d’Aunay d’une vente de
voiries en Beauce (1082 ou peu après)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07h,
2008.
|
ANNEXE 7i
Gauthier II d’Aunay témoin en 1096
Hugues Blavons restitue leurs
voiries aux moines de Saint-Père (1096)
Cette
charte, qui met en scène Gautier d’Aunay en 1096,
permet aussi de corriger une erreur de chronologie fort
répandue, relative à la date de la mort d’Hugues
Blavons. Dion avait proposé, d’après des supputations
indirectes, l’année 1094, et cette date a été
reprise sans examen par Depoin, de sorte qu’elle fait actuellement
référence. Aucun de ces deux auteurs ne paraît
s’être avisé que le Cartulaire de Saint-Père
a pourtant conservé une charte d’Hugues Blavons expressément
datée de 1096, c’est-à-dire, en nouveau style,
de mars 1096 à mars 1097. Quant au jour de la date de la mort
d’Hugues Blavons, qui serait prétendument un 23 décembre,
elle est également fausse et repose sur une erreur de traduction
de l’obituaire de Notre-Dame de Chartres.
Évrard
du Puiset, fils aîné d’Hugues Blavons n’a
donc exercé que quelques mois ses fonctions de vicomte de
Chartres avant son départ en croisade en 1096.
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
[t.
I, pp.238-239]
Capitulum XV.
De vicariis redemptis a vicecomite Hugone.
Anno 1096.
|
Des voiries rachetées
au vicomte Hugues.
(1096)
|
In Christi nomine. Ego Eustachius,
cœnobii sancti Petri Carnotensis abbas, et omnis monachorum
congregatio michi a Deo commissa, notum esse volumus
tam præsentibus quam futuris sanctæ Dei ecclesiæ filiis, quod,
|
Au nom du Christ. Moi Eustache abbé du monastère
de Saint-Père de Chartres et toute l’assemblée
qui m’a été confiée par Dieu, nous
voulons qu’il soit connu des fils présents et
à venir de la sainte Église de Dieu ceci.
|
tam ab antecessoribus nostris quam a nobis, vicariæ
quæ erant in terra nostra, vel tutelas per Belsiam,
omnes quidem sub comite Tedbaldo, ab ipsis ad quos pertinebant,
datis justioribus et melioribus rebus, emeramus.
|
Tant par le
fait de nos précécesseurs que de nous-mêmes,
toutes les voiries qui se trouvaient sur notre terre,
toutes les avoueries de la Beauce, nous les avions rachetées
sous le comte Thibaud en donnant à ceux à
qui elles appartenaient des biens au juste prix sinon davantage.
|
Sed, Stephane comite in honore patris succedente,
Hugo vicecomes jure hereditario easdem vicarias reclamans,
ab eodem comite suscepit.
|
Cependant, lorsque
que le comte Étienne succéda à son père,
le vicomte Hugues réclamant les dites voiries au titre
de son héritage, le reçut du dit comte.
|
Nos vero ab inquietudine securi vivere cupientes, precibus
ad hoc vicecomitem fleximus, ut, in nostris orationibus cum uxore
et tribus filiis et filia collectus, easdem vicarias, annuente
Stephane comite, sancto Petro, sicut emeramus, concederet;
|
Quant à
nous, qui désirions vivre à l’abri de l’inquiétude,
nous avons obtenu du vicomte à force de l’en
prier que, associé à nos prière avec
son épouse ses trois fils et sa fille, avec le consentement du comte Étienne, il nous cède les dites voiries, que nous avions
rachetées.
|
et super principale altare sancti Petri, cum uxore
et filiis, donum posuit, videntibus et audientibus
his quorum nomina subscripsimus: Adelidis, uxor vicecomitis;
filii eorum, Ebrardus, Hugo, Guiddo, et filia Unberga. Fideles
eorum, Ernulfus de Domicilio, Gausfridus Boviculus, Petrus
Aper, Gerogius de Fraganis Villa, Guarinus de Alona, Adelardus
præpositus, Gausfridus de Novale, Ansoldus Infans, Rodbertus
Paganus, Gualterius de Alneto.
|
Et il a déposé
cette donation sur l’autel de saint Pierre avec son
épouse et ses fils et filles. Cela a été
vu et entendu de ceux dont nous avons porté les
noms ci-après: Adèle, femme du vicomte; ses fils
Évrard, Hugues et Guy; sa fille Omberge. Ses féaux
Arnoux de Dangeau, Geoffroy Bouvet (Boviculus),
Pierre Sanglier, Giroie de Franville (de Fraganis Villa),
Garin d’Allonnes, le prévôt Allard, Geoffroy de La
Noëlle (de Novale), Anseau L’Enfant, Robert Payen,
Gautier d’Aunay.
|
|
De nostris: Laurentius cubicularius,
Adventius, Gunbaldus, Fulchardus; Stephanus et Salomon,
fratres; Teduinus, Gaudius et Harduinus, fratres; Radulfus
et Richardus, fratres; Leodegarius, Stephanus, Martinus, Rodbertus
pelliciarius; Gualterius, Aventius et Durandus, sartores; Engelbertus
et Gausfridus coci; Durandus pistor.
|
Parmi les nôtres: le chambrier Laurent, Avence,
Gombaud, Fouchard; les frères Étienne et Salomon;
les frères Thoin, Gaud et Hardouin; les frères
Raoul et Richard; Léger, Étienne, Martin, le pelletier
Robert; les tailleurs Gautier, Avence et Durand; les cuisiniers
Engibert et Geoffroy; le boulanger Durand.
|
|
Actum est
hoc Carnotis publice in æcclesia sancti Petri,
anno dominice incarnationis millesimo nonagesimo VI,
regnante Philippo rege in Francia.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 240.
|
Cela s’est fait à
Chartres, publiquement, dans l’église Saint-Pierre,
l’an de l’incarnation du Seigneur 1096, alors que le roi
Philippe régnait en France.
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp.238-239 (tome I) &
423 (tome II).
Dont
une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «
Hugues Blavons
restitue leurs voiries aux moines de Saint-Père
(1096)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07i,
2008.
|
ANNEXE 7j
Obits de Gautier II d’Aunay,
et de ses alliés
Obituaire de Saint-Jean-en-Vallée,
fin XIe siècle-début XIIe
Nous donnons ici des extraits
de l’Obituaire de Saint-Jean-en-Vallée,
de la fin XIe siècle-début XIIe, qui enregistre les
anniversaires à célébrer du décès de
ses bienfaiteurs. Nous y relevons ceux de Gautier, de sa femme et de ses
alliés, en notant surtout celui de sa belle-mère Hersent,
mère de Milsent, dont nous apprenons ici qu’elle était la
fille du vidame Guerry.
Relativement à Gautier
lui-même nous voyons qu’il avait donné, avec son épouse
Milsent, fille de Thion Chef-de-Fer, la moitié de la
dîme et de la terre qu’ils avaient à Mondonville
(obits du 25 mai et du 16 juillet). Comme le note Merlet (Cartulaire
de Saint-Jean-en-Vallée, 1906, p. 3,
n. 3), Renaud fils de Fréaud avait donné au chapitre
de Saint-Étienne l’autel de Mondonville (Raginaudus,
Fredaldi filius, dedit ecclesie Sancti Stephani altare
de Mondovilla, et alodum suum de Osivilla, et agripennum
unum vinearum et dimidium in quadrivio ultra Crucem Tebaldi
(obit du 18 août).
Nous nous arrêtons pour l’instant à
l’hypothèse que Gautier est mort à la fin du XIe siècle.
Il faut noter cependant qu’on trouve mention à plusieurs reprises
vers 1110-1114 d’un témoin Gautier d’Aunay dans le secteur de Liancourt-Saint-Pierre
(Oise), et surtout d’un Gautier d’Aunay dans notre secteur vers
| Texte
édité par Molinier |
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée
|
|
|
[10 jan.]
IIII idus. Ob. Werricus vicedominus [1079-1081], qui dedit decimam Munelis
S. Stephano.
(t.II/1, p. 226b)
|
Le quatrième
jour avant les ides de janvier [10 janvier] est mort le vidame Guerry [1079-1081],
qui nous a donné la dîme du Monceau-Saint-Étienne.
|
[24
apr.] VIII. Kal. Ob. Ugo vicedominus [1089-1101], qui dedit decimam culture
de Muncellis S. Stephano, et decimam vinearum juxta ejus ecclesiam. —
Anscolfus, pater Helisendis vicedomine [XI sæc.]
(t.II/1, p. 229a)
|
Au huitième
jour avant les calendes de mai [24 avril] est mort le vidame Hugues [1089-1091], qui a donné la
dîme du champs du Monceau-Saint-Étienne et la dîme des
vignes situées à côté de son église.
Et Anscoux, père de la vidamesse Helsent [Xe siècle].
|
[10
mai.] VI idus. Ob. Hersendis, Guerrici filia vicedomini [post ann. 1088],
soror Stephani, istius ęcclesię abbatis, deinde patriarchę Ierosolimitani
[post ann. 1128], dono cujus habemus auream tabulam, argentea manilia
(sic), turibulum argenteum, vasa ad missam argentea, unum vinarium, alterum
aquaticum, casulam purpuream, cappas duas, candelabra argentea.
(t.II/1, p. 229d)
|
Au sixième
jour avant les ides de mai [10 mai] est morte Hersent, fille du vidame
Guerry [après 1088], soeur d’Étienne abbé de cette
communauté puis patriarche de Jérusalem [après 1128],
à qui nous devons la donation d’un autel portatif en or, de bassins
d’argent, d’un encensoir en argent, de burettes d’argent, l’une pour le
vin et l’autre pour l’eau, d’une chasuble de pourpre, de deux chapes, de
candélabres d’argent.
|
|
[25 mai.] VIII kal. Ob.
Walterius de Alneto, qui dedit S. Stephano medietatem decimę et terrę
quam habebat apud Mundunvillam.
(t.II/1, p. 229f)
|
Au huitième jour avant les calendes
de juin [25 mai]
est mort Gautier d’Aunay, qui a donné à Saint-Étienne
la moitié de la dîme et de la terre qu’il avait à
Mondonville.
|
[12
jun.] II idus. Ob. Stephanus, abbas S. Johannis et postea patriarcha
Jherosolimitanus [post ann. 1128], in cujus adventu ad ecclesiam nostram
Valeie vallis habuimus viarie partem ad vicedominum pertinentem, villam
etiam quam Moncellos vocamus, habuimus et Ermentarvillam. Preter hec ecclesiam
nostram decoravit XXi capis, XXIIbus palliis, calice aureo et aliis vasis
argenteis, pluribusque beneficiis. Capud etiam ecclesie S. Stephani a
fundamento edificavit et consummavit et domum canonicorum lapideam similiter
reedificavit.
(t.II/1, p. 230a)
|
Le deuxième
jour avant les ides de juin [12 juin] est mort Étienne, abbé
de Saint-Jean et ensuite patriarche de Jérusalem [après 1128];
lors de son arrrivée dans notre communauté nous avons eu
la partie de la voirie du val de Vallée revenant au vidame, et aussi le domaine que nous appelons le Monceau,
ainsi que Manterville. Outre cela il a orné notre communauté
de 20 chapes, de 22 pluviaux, d’un calice d’or et d’autres récipients
d’argent et de nombreux bienfaits. Il a encore édifié et terminé
à partir de rien le chevet de l’église Saint-Étienne,
et fait rebâtir en pierre la demeure des chanoines.
|
[16 jul.]
XVII kal. aug. Ob. Milesendis, uxor Galterii de Alneto, que dedit S.
Stephano medietatem decimę et terre quam habebat apud Mundunvillam.
(t.II/1, p. 230d)
|
Au dix-septième
jour avant les calendes d’août [16 juillet] est morte Milsent, épouse de Gautier d’Aunay, qui a donné à Saint-Étienne la moitié
de la dîme et de la terre qu’elle avait à Mondonville.
|
Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée
(autre version, éditée par Souchet)
|
|
[12
jun.] II idus junii. Ob Stephanus, patriarcha Jherosolymitanus, istius
ecclesie abbas prius [post ann. 1128]. In cujus adventu ad ecclesiam
nostram habuimus Vallis hujus majorem partem ad vicedominum pertinentem,
villam etiam habuimus quam Moncellos vocamus ejus consilio et auxilio.
Preterea pro anima fratris sui Hugonis vicedomini et majorum habuimus
villam quam vocant Ermentarvillam.
(t.II/1, p. 232c)
|
Au deuxième
jour avant les ides de juin [12 juin] est mort Étienne, patriarche
de Jérusalem, avant cela abbé de cette communauté [après
11228]; lors de son arrrivée dans notre communauté
nous avons eu la plus grande part de la voirie de
Vallée qui revenait au vidame, et aussi le domaine
que nous appelons le Monceau, à son initiative et avec son aide. Outre
cela, pour le repos de l'âme de son frère le vidame Hugues et
de l'ême de leurs ancêtres nous avons eu le domaine appelé
Manterville.
|
[6 oct.]
II non. octobris. Ob. Hugo vicedominus, pro cujus anima Helissendis,
mater sua, dedit S. Joanni Ermentardivillam et alia.
(t.II/1, p. 233a)
|
Le deuxième
jour avant les nones d'octobre [6 octobre] est mort le vidame Hugues, pour
le repos de l'âme de qui sa mère la vcomtesse Helsent a donné
à Saint-Jean Manterville et d'autres biens.
|
1) Auguste Longon (1844-1911) [dir.], Auguste
Molinier (1851-1904) [éd.], Obituaires de
la province de Sens [in-4° (28 cm); 4 tomes en 5 volumes
(t.I/1-2: Diocèses de Sens et de Paris, par
M. Auguste Molinier; t.II/1-2: Diocèse de Chartres,
par Molinier; t.III: Diocèses d’Orléans, d’Auxerre
et de Nevers, par Alexandre Vidier (1874-1927) & Léon
Mirot (1870-1946); t.IV: Diocèses de Meaux et de
Troyes, per Armand Boutillier du Retail (1882-1943) & Pierre
Piétresson de Saint-Aubin (1895-1981)], Paris, Imprimerie
Nationale & C. Klincksieck [«Recueil des historiens
de la France. Obituaires» I-IV], 1902-1923, tome II/1, pp. 226-233.
2) Bernard GINESTE [trad. &
éd.], «Obits de Gautier
II d’Aunay et de ses alliés», in
ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07j,
2008.
ANNEXE 7j (2)
Un Gautier d’Aunay témoin un peu plus tard dans le
secteur de Liancourt-Saint-Pierre (Oise)
(Cartulaire de Saint-Père de Chartres,
avant 1112-vers 1114)
Un
Gautier d’Aunay apparaît comme témoin à six reprises
avant 1112 et jusqu’aux environs de 1114 dans le secteur de Liancourt-Saint-Pierre
(Oise), où les moines de Saint-Père de Chartres avaient un
prieuré. Mais il est bien improbable qu’il s’agisse de notre homme,
car il y a bien des Aunay, et bien des Gautier à cette époque.
Nous supposons donc que Gautier d’Aunay est mort sans descendance à
la fin du XIe siècle, d’autant que nous voyons ensuite son frère
aîné prendre le nom de sa terre à une date indéterminée
entre 1100 et 1120.
[p.623] Pars tertia. Ex schedis D. Muley […] [p.630] […]
|
|
|
VIII.
Mathias, filius Girondi de Biauti Curia, concedit monachis
sancti Petri Ledonis Curiæ quicquid habebat apud Fluri.
Ante a. 1112.
«Notum sit omnibus tam presentibus
quam futuris, quod Mathias filius Girondi de Biauti Curia, veniens ad conversionem,
nobis monachis sancti Petri Ledonis Curie dedit quicquid habebat apud Fluri,
tam in terra quam in hospitibus. Donum istud concessit Garnerius de Calci,
de cujus videlicet feodo erat, et Hugo frater ejus. Hujus rei testes affuerunt:
Osmundus de Calvo Monte, Gauterius de Monte Falconis, Drogo de Torleio,
Gauterius Lancea Levata, Petrus de Villula, Hugo de Sancto Gervasio; Gaufridus,
filius Ansculfi; Gauterius de Alneto, Johannes de Vals. Vicariam
hujus supradicte terre concessit nobis Godefridus de Fluri, de cujus feodo
erat ipsa vicaria, audiente Renoldo presbitero, et Bartholomeo, cognato
Godefridi, et Girardo, fratre Bartholomei; Gauterio Male Nutrito, Guillelmo
Britone, Gauterio Piel.» […]
|
|
|
X.
Donatio quam fecit Hugo de Marinis sancto
Petro Ledonis Curiæ.
Ante a. 1112.
«Sciendum quo Hugo de Marinis, pro salute
anime sue et patris et matris et uxoris sur, dedit sancto Petro Ledonis
Curie quinque [p.631] solidos census, in molendino
quod situm est in stagno quod est sub Calvo Monte. Hujus rei donum posuit
super altare sancti Petri vigilia nativitatis Domini. Ordinavit autem predictus
Hugo quod molendinarius supradicti molendini quinque solidos census, uno
quoque anno vigilia natalis Domini, persolveret monachis; quod si non faceret,
monachi haberent potestatem saisiendi ipsum molendinum, donec persolvantur
quinque solidi census. Hujus rei testes affuerunt: Godardus, Rainaudus et
Odo, fratres ejus; Guilelmus, filius Rainaudi; Gauterius de Alneto,
Gauterius de Muntfalcon, Robertus de Pontesiaco, Robertus Grandinus, Garnerius
de Fosseto, Gauterius Blundel. Postea vero, in claustro sancti Petri Ledonis
Curiæ, Osmundus de Calvo Monte prefatum donum, quia de fedo suo erat,
concessit. Hi testes: Drogo de Toleio, Robertus de Tube Villari, Trebuin,
Gauterius de Alneto, Johannes de Vals, Garnerius de Calci,
Hugo de Sancto Gervasio. Idem denique donum concessit in eodem claustro
Robertus, filius Hugonis de Marinis, rogatu patris sui, presente Hugone
de Toleio, et Hugone patre, Joanne de Vals.»
|
|
|
XI.
Donum trium hospitum sancto Petro Leonis Curiæ a Stephano
Picis factum.
Ante a. 1112.
«Notum fieri volumus, quod Stephanus
Picis dedit sancto Petro Leonis Curie tres hospites, Garnerium de Marinis,
cum agripenno suo; Girondum de Fonte, cum agripenno suo; Euvreriam, cum dimidio
agripenno et dimidium curtillum, qui est in via que ducit ad aquam. Ea die
qua mortuus est predictus Stephanus, tres filii ejus, Guerno, Adam et Johannes,
prefatum donum et quecumque donaverat predicte ecclesie concesserunt, et
donum super altere posuerunt. Hi testes: Engerrandus, nepos Stephani Picis;
Henricus de Damelis Curia, Frodo de Teulaio, Hermer major, Guilelmus Brethain,
Robertus sacerdos, Gemelinus, Gauterius de Alneto, Guillelmus Arruntius,
Odo pelliparius, Godardus et Rainoldus, frater ejus; Guillemus Galet, Albertus
Torfrei, Garnerius de Blialcurt.» […]
[p.634] […]
|
|
|
XV.
Donatio Giroldi, filii Haimerici de Ponte Isaræ.
Ante a. 1112.
«Ego Giroldus, filius Hainerici
de Pontesere, pro anima mee conjugis et mea, ut indulgentiam peccatorum
consequi mereamur, do Deo sanctoque Petro Carnotensis cenodii et monachis
ejus, apud Leuncurt morantibus, terram de Corneleia. Continet autem ipsa
terre diurnos octo. Annuente filio meo Rotberto, et filiabus Adalicia et
Hidearde. Videntibus his: Walterio de Montfalcon; Bernerio, Ricardi filio;
Giroldo, fratre suo; Odone farinario; Godardo, Rainoldo, Guarnerio, Odone,
fratribus; Durando Amoroso, Walterio de Alneto, Tedboldo
de Cergi.»
|
|
|
XVI.
Donatio ejusdem Giroldi.
Anno 1112.
«Post hec igitur, revertenti tempore,
augere desiderans beneficium predicte ecclesie, acceptis a monachis quinquaginta
unum solidum nummorum Pontesiorum, eidem ecclesie hospitem unum, cum domo
et curtillo in Leuncurt, infra vallem juxta viridiarium Durandi, et terram
secus viam que pergit ad castrum Calvi Montis ad dexteram euntibus, continentem
diurnos duos, dedi, donumque, cum filio meo Rotberto et filia Hildearde,
super altare sancti Petri Leoncurtis misi, testibus his astantibus, simulque
videntibus et audientibus: Walterio Montfalcon, Walterio de Alneto;
Bernerio, Ricardi filio; Giroldo, fratre suo; Godardo, Rainoldo, guarnerio,
Odone, fratribus..... Actum est hoc anno ab incarnatione Domini millesimo
centesimo duodecimo.» [p.635] […]
|
|
|
XVIII.
Donum ejusdem Stephani de Pice.
Circa a. 1114.
«Poste hec, in sequenti tempore,
idem Stephanus, pro anima sue conjugis Adalicie, cum suo filio Wernone, sancto
Petro cenobii Carnotensis ejusque monachis, Leuncurti Deo servientibus,
unum curtillum cum hospite, non longe ab ecclesia beate Marie situm, in
eodem vico, dedit, donumque super altare sancti Petri per manum Wernonis,
sui filii supradicti, misit. Ipse quoque Werno, in loco eodem, quicquid pater
suus antea supradicte eccelsie dederat, videntibus et audientibus subtitulatis
testibus, concessit. Hugone de Genci, Tedboldo de Spees, Herberto de Beherval,
Walterio Alnei, Durando majore; [p.636] Willemo Brahain; Godefrido, Hilduino, fratribus;
Gisleberto, Hermaro, ejus filio; Goderdo, Odone, fratribus; Warnerio Fossei.»
|
|
ANNEXE 7j (3)
Un (autre?) Gautier d’Aunay témoin en 1128
(Cartulaire
de Saint-Père de Chartres, avant 1112-après 1114)
Un Gautier d’Aunay apparaît
aussi comme témoin vers 1128 dans l’entourage d’Hervé de
Gallardon, dans une charte du Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée
(charte que nous éditerons ultérieurement à part).
Son identité et son ascendance restent à déterminer.
Voici l’édition qu’en avait donnée Édouard Lefèbvre
dès 1867.
Nous
venons de voir le nombre et la composition des hospices de Mantarville; la
charte suivante va nous faire connaître les droits et les charges des
hôtes ou colons, ainsi que les grains et les plantes qu’ils cultivaient.
|
|
|
1128. —
«Nous, chanoines de Saint-Jean, voulons faire connaître à
tous présens et à venir la convention que nous avons passée
avec Thibault du Valgelé. Nons consentons qu’après sa mort,
un de ses fils seulement tienne nos possessions telles que les avait son
père, s’il est reconnu apte à le faire d’après le témoignage
des voisins, et nous donnons deux sous audit Thibault pour venir au secours
de ses frères. Il ne nous paiera aucune redevance pour les ouvrages
qu’il fera par lui-même ou par ses domestiques; mais s’il se fait
aider par des mercenaires pour la réfection des bâtiments ou
des haies ou tout autre chose, nous paierons les frais par moitié.
Les charrois se feront en commun. Les estrains et les pailles de la grange
seront communs entre lui et nous pour la nourriture des bêtes, sans
qu’il puisse en donner aux autres métayers ni en vendre. Nous pourrons
élever des porcs en commun avec ledit Thibault; mais si nous n’en
voulions pas et qu’il ne puisse en avoir que pour l’aide de notre chanoine,
il n’en pourra nourrir que deux, et ceux-là étant morts, il
aura la faculté d’en avoir toujours deux. Pour chaque fromage et
chaque vache il paiera deux sous, si notre chanoine ne veut pas les recevoir.
Il pourra ensemencer une mine de notre terre en chanvre et semer de la guesde
(2) aux extrémités de la terre autant qu’il voudra. Notre
chanoine recevra la dîme et le champart de l’un et de l’autre. S’il
y conduit des ouvriers, il donnera ce qui sera donné suivant le témoignage
de nos chanoines qui desservent l’église de Pontgouin.» [p.245]
Cet accord fut fait dans la tour de Chartres,
en présence du comte Thibault et de son frère Etienne qui confirmèrent
en même temps les dispositions contenues dans la charte de 1123 ci-dessus
rapportée, au sujet du droit de tensement à Mantarville. Au
nombre des témoins nous trouvons: le vicomte Hugues, rédacteur
de l’acte; Guy de Méreville; Hervé de Gallardon, Gautier
d’Aunay; Gonthier de Morville; Amaury de Maintenon; Hugues du Tremblay;
Haimeric de Gas; Hugues de Garancières; Etienne de Denonville; Pierre,
maçon, de Sainville; Guérin de Saint-Cheron; Etienne, abbé
de Saint-Jean; dom Robert d’Eddeville, dom Salomon et dom Bérenger,
tous trois religieux de cette abbaie à Mantarville:
|
(2) Herbe dont se
servaient les foulonniers pour teindre en bleu.
|
|
«Nos
canonici Sancti Johannis notum esse volumus tam futuris quam presentibus
conventionem habuisse cum Teobaldo de Vallegelata post mortem ipsius nos
concedere res nostras quas ipse Teobaldus tenet sicut eas habet, uni filiorum
suorum solum modo, si vicinorum testimonio idoneus fuerit ut eos, pro ut
oportet, procuret, predicto Teobaldo, duos solidos ad Pentecostem ad auxilium
fratrum damus. De his que circa domos nostras faciet opere suo et clientum
nichil persolvemus; si vero mercenarios eum conducere oportebit sive in sepibus
restituendis sive in quibuscumque agendis, pretium communiter dabimus. Stramina
et paleas granchiæ ad pascendas bestias communiter ei concessimus.
Ipsius granchiæ canonici nostri clavem habebunt, et si proprias bestias
apud se habuerint inde pascentur, aliis que non licebit dare commediatoribus
habitis, neque vendere. In plaustris et quadrigis communiter mittemus. In
porcis si cum Teobaldo eos habere voluerimus quæ necessaria erunt communiter
mittemus. Si porcos habere voluerimus neque Teobaldus habere poterit, nisi
per canonicum nostrum preter duos quos ad se pascendum nutriet, et illis
mortuis duos semper habere poterit. De caseis, de vaccis singulis singulos
reddet solidos, si canonicus noster eos accipere noluerit. De semine canabis,
in terra nostra unam asinam seminare poterit, et gesdium in extremitatibus
terra nostræ quantum volet; de utroque Canonicus noster decimam et
campipartem accipiet. Si operarios conduxerit, canonicorum nostrorum [p.246] testimonio ecclesiæ
de Pontegodano servientium ea quae dabuntur dabit... Hec omnia in Turre
Carnotensi coram Teobaudo comite et Stephane fratre ejus ad fidem tenere
pacti sunt et fidei suæ interpositione firmaverunt, tali scilicet conventione
ut Teobaudus comes eos tenere cogat, si aliquo tempore exigere voluerint.
Testes: Hugo vicecomes cujus manu hæc predicta fecerunt; Guido de Merelvilla;
Herveus de Galardone; Gauterius de Alneto; Gunherius de Mervilla;
Amauricus de Mestenon; Hugo de Trembleio; Haimericus de Gaiis; Hugo de Garenceriis;
Stephanus de Danunvilla; Petrus, cementarius de Seinvilla; Garinus de Sancto-Carauno;
in presentia domni Stephani abbatis et fratrum nostrorum domni Roberti
de Eddevilla, domni Salomonis, domni Berengarii apud ipsam Ermentarvillam.»
|
|
Source: Édouard
(Pierre-Édouard-Alexandre) LEFÈVRE
(ancien chef de division à la Préfecture
d’Eure-et-Loir, historien de la Beauce, membre
correspondant du Comité des travaux historiques
et scientifiques et de plusieurs sociétés
savantes, historien de la Beauce), «Mantarville»,
in ID., Documents historiques et statistiques
sur les communes du canton d’Auneau arrondissement
de Chartres (Eure-et-Loir) [2 volumes in-16,
ou in-12; extrait de l’Annuaire d’Eure-et-Loir
(1867) & (1868)], Chartres, Garnier, 1867-1869, tome
1 (1867), pp. 244-246.
|
ANNEXE 7k
Gounier de Saint-Avit donne une
terre à Raville près Dreux
(1100 et 1120 selon Guérard)
Texte
édité par Guérard (1840)
|
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
|
L.
Cyrographum inter nos
et Herveum de Rua Nova et Gunherium de Sancto Avito, continens
conventiones de terra apud Raram Villam ab ipsis data.
|
50.
Charte
contenant les conventions passées entre
nous d’une part et d’autre part Hervé de Rue-Neuve et Gounier de Saint-Avit, au sujet de la terre qu’ils
nous ont donnée à Raville
[commune de Chérisy].
|
… Notum
igitur esse volumus tam futuris et instantibus, quia
|
... Nous voulons
qu’il soit su des gens présents et à venir
ceci.
|
Herveus de
Rua Nova (1) et Gunherius de sancto
Avito (2), animarum suarum utilitati
providentes, sancti Petri Carnotensis monachos humiliter adieruut,
eisque, in loco qui dicitur Rara Villa, de terra sua XXXta
agripennos solutos et quietos in elemosina concesserunt; ita
scilicet, ut monachus qui eidem loco preerit, quoscunque ibi
hospitari voluerit recipiat, et omnes redditus supradicte ville
et justicias extra partem eorum habeat.
|
Hervé
de Rue-Neuve et Gounier de Saint-Avit, agissant dans l’intérêt
de leurs âmes, sont allés trouver humblement
les moines de Saint-Père de Chartres et leur ont cédé
en aumône, au lieu appelé Raville, 30 arpents
de leur terre pour en jouir pleinement et sans contestation,
de telle sorte que le moine qui sera affecté au dit lieu y reçoivent
qui il voudra y installer, et qu’il détienne tous les revenus
du susdit domaine et les amendes données hors de leur
secteur à eux. |
Si autem,
in terra que deforis est, homines sancti Petri aliquid
ibidem manentes forisfactum fecerint, illorum forisfactorum
justicia in manu monachi erit; ita siquidem, ut, si LX
solidorum forisfactum fuerit, ut XV sol. monacho condonare
licebit absque illorum consilio; ex quibus X sol. supradictis
militibus equaliter distribuentur, monachus sibi V retinebit.
Si vero V sol. forisfactum fuerit, similiter usque ad tres sol.
monachus, si voluerit, condonabit; ex quibus duo sol. supradictis
militibus equaliter distribuentur, XII vero nummos monachus sibi
retinebit.
|
Si des
gens de Saint-Père y demeurant commettent un délit
sur le terre qui n’en fait pas partie, les amendes à
verser pour ces délits reviendront au moine. Ainsi, si
un délit de 60 sous a été commis, il sera loisible
au moine de faire une remise de 15 sous sans leur avis,
desquels 10 seront attribués à parts
égales aux susdits chevaliers, et le moine gardera 5 sous.
Et si c’est un délit de 5 sous, le moine, s’il le
veut, fera remise de 3 sous, dont deux seront attribués
à égalité aux susdits chevaliers, et
le moine gardera pour lui douze deniers. |
| Ac si forte
de incendio vel de rapina vel de similibus forisfactum
extiterit, absque predictorum militum consilio monachus
nichil condonabit. Quod si aliquis extraneus aliquid ibidem
forisfecerit, ejusdem forisfacti justicia monachi et
militum erit, nec inde quicquam monacho absque militum consilio
[p.444] condonare licebit. |
Et si par hasard
se produisait un délit d’incendie, de vol ou du
même genre, le moine ne fera aucune remise sans
l’avis des susdits chevaliers. Et si quelque étranger
y commet quelque délit, le jugement du dit délit
sera du ressort du moine et des chevaliers, il ne sera loisible
en aucune manière de faire de remise sans l’avis des
chevaliers.
|
Campipartem
terre que deforis est intra granchiam suam monachus adduci
faciet, cujus duas partes supradicti milites equaliter habebunt,
terciam monachus sibi recipiet.
|
Le moine fera
mener le champart de la terre du finage dans sa grange,
dont les susdits chevaliers auront à parts égales
leus deux tiers, et le moine en recevra le troisième
tiers.
|
Partes illorum
ejusdem terre cultores ad civitatem Aurelianis usque
perducent; unusquisque autem cultorum aut prandium aut denarium
accipiet. Campipartitorem quem voluerit monachus ponet,
qui etiam coram supradictis dominis singulis annis fidelitatem
faciet. Granchiam prius a monacho factam, si aut renovari
aut emendari oportuerit, de communi fiet.
|
Les cultivateurs
de la dite terre apporteront leurs parts jusqu’à la ville d’Orléans, et chacun
des cultivateurs recevra soit un repas ou un denier. Le moine
instituera le champarteur qu’il voudra, qui prêtera
aussi serment de fidélité chaque année
personnellement aux susdits seigneurs.
|
Prenominatis
autem militibus ad granchiam et campipartem custodiendam
servientem suum mittere licebit; sed de rebus monachorum
vel hospitum suorum, nisi sponte sua sibi dederint,
se minime procurabit qui cum campartitore monachorum ad campipartem
capiendam ibit; ita tamen, quod inde eum campipartitor minime
semonuerit…..
|
Il sera
loisible aux susdits chevaliers d’envoyer leur sergent
garder la grange et le champart; mais celui qui ira prendre
le champart avec le champarteur des moines ne tirera en aucune
manière sa sunsistance du bien des moines ni de
leurs hôtes, à moins qu’ils ne lui donnent quelque chose
de leur plein gré; étant entendu cependant que
le champateur ne pourra pas le semoncer sur ce point.
|
Largitionem istam
Herveus et Gonherius, Radulfus Rainardi et Odo, filius
Pagani, et Tescelinus de Trino, ejusdem avunculus, firmiter
se tenere et garentire per fidem plevierunt.
|
Cette donation,
Hervé et Gounier, Raoul Rainard et Eudes fils de Payen,
ainsi que son oncle paternel Tescelin de Tréon, ont promis
avec serment qu’ils la maintiendraient et garantiraient fermement
|
Si quis etiam
deinceps aliquid in eadem terra mali fecerit, nullus eorum
pacem aut concordiam cum eo, nisi per monachi licentiam,
habebit.
|
En outre si
à l’avenir quelqu’un commettait quelque mal sur la
dite terre, aucun d’entre eux ne ferait avec lui paix ni
entente tant que le moine ne le leur permettrait.
|
Ex parte monachorum:
Odo de Geminni; Maurinus, frater ejus; Hugo de Caan,
Odo de vi; Stephanus, famulus monachorum.
|
Du côté
des moines: Eudes de Gémigny [Loiret]; son frère Maurin; Hugues de Caan
(?), Eudes de Vicq [près Montfort l’Amaury]; Étienne,
serf des moines.
|
Ex parte
militum: Goffridus de Saran, Hugo de Reed, Graulfus,
Rainardus de Alodio, Hugo de Bosco; Boninus, famulus Hervei.
Cartulaire de Saint-Père,
pp. 443-444.
|
Du côté
des chevaliers: Geoffroy de Saran [près Orléans],
Hugues de Reed (?), Graoux, Rainard de
l’Alleu, Hugues du Bois; Bonin, serf d’Hervé.
|
NOTES DE BERNARD
GINESTE (2008)
(1) Selon Depoin
(Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, n°49,
vers 1104, p. 45, note 252, au sujet d’un certain
Ansculfus de Nova Rua), «Hugo de Rua
Nova figure parmi les témoins d’un diplôme
donné par Louis VI au palais d’Orléans, en décembre
1112. (A. N. K 21, n°52). Cette famille s’appelle indifféremment
de Nova Rua ou de Novo vico. Cette
dernière forme subsiste aujourd’hui dans Neufvy-sur-Aronde,
canton de Ressons-sur-Matz (Oise).» J’avoue ne pas
comprendre cette dernière remarque de Depoin, car il
est clair que le toponyme vulgaire représenté
par ces deux graphies latines était nécessairement
la Neuve Rue. Aussi aurait-il dû plutôt
suggérer, relativement à son personnage
La Neuve-Rue, lieu-dit Oursel-Maison (Oise).
Notons pour mémoire
un Robertus de Nova Rua en 1206 à Autun. Précisément
il existe aussi un lieu-dit Rue Neuve à
Aillant-sur-Tholon (Yonne).
Il
me semble donc que Depoin s’est égaré
en rapprochant son Ansculfus
de Nova Rua de la famille orléanaise
de Rua Nova
(alias de Vico novo).
L’Ansculfus de Nova Rua attesté à
Pontoise en 1104 tire visiblement son nom de La Neuve-Rue, lieu-dit Oursel-Maison
(Oise).
Le
Robertus de Nova
Rua attesté en 1206 à Autun tire sans
doute son nom de Rue Neuve à Aillant-sur-Tholon
(Yonne).
Le
Hugo de Rua Nova
cité en 1112 à Orléans nous fait
connaître une troisième famille que rien
ne permet d’identifier aux autres, et qui est pour sa part
clairement installée à Orléans.
Le Cartulaire
de Sainte-Croix d’Orléans nous fait d’ailleurs connaître
un autre Hugues de la Rue-Neuve, laïc en 1153 (éd.
Thillier, n°XI, p. 23: et laicis pluribus,
Hugone de Ruanova, etc.) et apparemment chanoine entre
1155 et 1159 (n°VIII, pp. 18-19: S. Domni Hugonis
de Rua Nova), cité en 1173 avec son fils Manassé
(n°LXXXIII, p. 83: Hugo de Ruia nova, Manasses
filius ejus)
Rue signifiant
notamment village dans le français du temps, le toponyme
est aussi rendu en meilleur latin par de Vico-Novo,
et c’est sous cette graphie que ce même Cartulaire
(n°XXIX, pp. 58-59) nous parle, dans une bulle d’Innocent
III de 1134, en même temps que d’un Geoffroy de Rue-Neuve
(Gofredus de Vico novo), un Hervé de Neuve-Rue,
et son neveu Hugues (Herveus de Viconovo, Hugo, nepos ejus).
On remarquera
au passage que la position de l’adjectif par rapport
au substantif, peu naturelle en latin, paraît être
restée singulièrement stable dans ce dernier
cas orléanais, et doit donc refléter la place
réelle de l’adjectif dans le toponyme vernaculaire,
ce qui exclut encore une fois tant Neufvy-sur-Aronde
que La Neuve-Rue d’Oursel-Maison.
D’ou vient donc
le nom de cette famille? Notre charte renouvelle la question
en nous la montrant possessionnée tout près
de Dreux, et vraisemblablement alliée d’une manière
ou d’une autre à la famille d’Aunay-sous-Crécy.
Or il
existe encore de nos jours un hameau La Rue Neuve
dans la commune des Bréviaires, à côté
de Rambouillet, à une cinquantaine de kilomètres
de Raville, de Dreux et d’Aunay-sous-Crécy.
C’est
sans doute l’origine de la famille de cette famille
installée à Orléans.
Récapitulons
les mentions dont nous disposons pour cette famille,
où l’on semble
avoir fait alterner les prénoms Hervé et Hugues: (a) Hervé, possessionné à
Raville près Dreux, résidant à
Orléans, cité en même temps que Gounier
d’Aunay après 1082 (après la mort de Gautier
I d’Aunay-sous-Crécy); Guérard précise:
entre 1100 et 1120.— (b) Hugues, cité en 1112 à
Orléans.— (c) Geoffroy, Hervé et son neveu Hugues,
cités à Orléans en 1134.— (d) Hugues cité
comme laïc en 1153.— (e) Hugues cité apparemment comme
chanoine entre 1155 et 1159.—
(e) Hugues cité avec son
fils Manassé en 1173.— La
famille est encore citée au XIIIe siècle et
donne son nom à une censive à Orléans.
(2)
Le fait que Gounier soit ici qualifié
de Sancto Avito tend à faire penser
que son frère Gautier II étant mort sans
enfant, il aura hérité de ses terre, dont il
prend le nom, oubliant celui de Molitard. Il faut observer
par ailleurs qu’il paraît désormais résider
à Orléans, où on lui apportera le
champart de Raville en même temps qu’à Hugues
de Rue-Neuve. Comment s’est-il trouve en possession de terre
à Raville sur le même plan que ce dernier? On
peut supposer que l’un d’eux a épousé la sœur de
l’autre, et qu’il sera entré en pleine possession de
la dot de sa femme par le décès de cette dernière,
dont le consentement n’est pas mentionné; ou bien sont-ils
cousins, fils de deux sœurs d’Hugues de Nonant-le-Pin, dont
Orderic Vital nous dit qu’il était oncle de Gounier d’Aunay.
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp. 443-444 [dont une réédition
numérique par Google, en ligne
en 2008].
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Gounier de Saint-Avit donne une terre
à Raville près Dreux»,
in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant
Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07k,
2008.
|
ANNEXE 7l
Gounier d’Aunay gouverneur
de Bayeux en 1105
Témoignage
d’Orderic Vital
Le frère aîné
de Gautier II d’Aunay, Gounier, doit être identifié,
à ce qu’il me semble, avec un personnage important
de l’histoire normande de cette époque, que les historiens
de la Normandie, justement, ne paraissent pas jusqu’ici,
sauf erreur de ma part, avoir identifié de façon
satifaisante, et qu’Orderic Vital appelle Gunherius
de Alneio.
Orderic Vital nous
le montre tenant en 1105 la ville de Bayeux pour le compte
du duc de Normandie Robert Courteheuse et defendant
cette ville contre les assauts du roi d’Angleterre Henri.
Orderic
Vital explique l’expédition de Henri Beauclerc
en Normandie comme suscitée par les plaintes lugubres
des églises normandes ravagées, et le premiers
des responsables cités de cette désolation
est notre Gautier d’Aunay:
|
|
«Gautier d’Aunay, qui gardait Bayeux (Gunherius
de Alneio qui Baiocas servabat) et Rainaud de Varenne qui était du parti
du duc ainsi que d’autres auxiliaires du duc rompirent
les traités de paix, capturèrent Robert fils
d’Aymon et de nombreux autres membres
de la domesticité du roi, et ils les retinrent
longtemps en prison, tant par avidité de raçon
que par mépris et haine de celui qui était
leur seigneur. C’est pourquoi ce roi énergique,
lorsqu’il appris cela, ordonna de préparer une flotte»*.
|
* Orderic Vital,
éd. Le Prevost, 1852, t. IV, p.
203 (livre XI).
|
Dans un discours
mis dans bouche de l’évêque de Sée
au roi Henri Beau-Clerc, le duc Robert Courteheuse est
montré comme manquant à ses devoirs. L’insécurité
règne. Robert de Bellême vient d’incendier
l’église de Tournai-sur-Dive. Le duc est indigne:
«Ce n’est pas ton frère qui possède
la Normandie, il ne gouverne pas un peuple qu’il devrait conduire
dans les sentiers de la droiture, mais il est accablé
de paresse et obéit à Guillaume de Conversane, à Hugues de Nonant
commandant de Rouen, à son neveu Gounier, et à
d’autres qui n’en sont pas dignes»*.
|
* Ibid., p.
206: Guillelmo de Conversana et Hugonni de Nonanto qui Rotomago praesidet et Gunherio
nepoti ejus aliisque idignis subjacet.
|
Nous
voyons ensuite le siège de Bayeux: «La
même année, le roi Henri, comme on l’a dit plus
haut, gagna au printemps par mer la Normandie et s’efforça
de récupérer l’héritage paternel
que ravageaient parjures, ravisseurs et brigands. Il accompagna
Élie du Mans avec ses troupes et assiégea la
ville de Bayeux que gardait Gounier d’Aunay. Or Gounier sortit
au devant du roi et avec et lui rendit libre, sans rançon,
Robert fils d’Aymon qui naguère avait été
capturé par lui, mais il refusa de lui rendre la ville
alors que le roi la lui demandait impérieusement.
Le roi donc prit la ville de force et l’incendia totalement en y
mettant le feu, puis il captura le chef de la ville avec ses
fantassins et les chevaliers qui étaient avec lui»*.
|
* Ibid.,
p. 219.
|
Orderic
Vital met ensuite dans la bouche d’Henri Beau-Clerc
un discours au pape, en novembre 1119, où le roi
raconte à nouveau les mêmes événements.
A nouveau Gounier est placé comme le principal
mauvais génie de Robert Courteheuse: «Mon
frère protégeait des gens dont les conseils
étaient pervers et il suivait tous les avis de ceux
qui le rendaient vil et méprisable. Gounier d’Aunay
surtout et Roger de Lacy, ainsi que Robert de Bellême,
et d’autres criminels dominaient les Normands, et sous couvert du
duc, commandaient aux évêques, à tout le clergé,
et au peuple sans défense»*.
|
* Ibid.,
pp. 400-401: Frater enim meus incentores
totius nequitiæ tuebatur, et illorum consilia,
per quos vilis et contemptibilis erat, admodum amplectebatur.
Gunherius nimirum de Alneio et Rogerius de Laceio, Rodbertus
quoque de Belismo, aliique scelesti Normannis dominabantur,
et sub imaginatione ducis præsulibus,
omnique clero cum inermi populo principabantur.
|
Le roi rappelle qu’il a dû enlever Bayeux
à Gounier d’Aunay: «En combattant vaillamment
par les armes et par le feu, j’ai enlevé Bayeux
à Gunhier (Baiocas Gunherio abstuli), et
Caen à Enguerand fils d’Ilbert, et en réprimant
par la guerre les tyrans, j’ai conquis d’autres places fortes
que mon père avait tenues sous sa domination»*.
|
* Ibid.,
p. 401.
|
Nous ne savons pas, sauf erreur
de ma part, ce qu’est ensuite devenu Gounier d’Aunay. On
a remarqué que le roi Henri ne le portait pas
dans son cœur, et on se rappelera que ce prince a gardé
son propre frère Robert Courteheuse vingt-huit ans
dans la prison de Cardiff, c’est-à-dire jusqu’à
sa mort. Il paraît cependant de retour au pays vers
1108.
On
notera surtout pour ce qui nous occupe que Gounier
était au témoignage d’Orderic Vital le
neveu d’un certain Hugues de Nonant, à la même
époque lui-même gouverneur de Rouen pour le
compte de Robert Courteheuse. Il ne s’agit pas de Nonant dans
le Calvados, mais de Nonant-le-Pin (aussi appelé Nonant-sur-Queuge),
beaucoup plus proche du Perche et du pays chartrain. On peut
donc penser qu’Hugues I d’Aunay, père de Gounier I et
de Gautier II, avait épousé une sœur de cet
Hugues de Nonant-sur-Queuge.
N.B. 1: Sur Hugues de Nonant (sans doute
fils d’Aitard de Nonant), oncle de Gounier et donc de Gautier II, frère
de leur mère (bis), voir Orderic Vital, Historiæ ecclesiasticæ
libri tredecem, livre VIII, éd. Le Prevôt, t. 3 (1845),
p. 301, note 1; p. 423, n. 1; t. 4 (1852), p. 181, note 3, p. 206 &
233.
N.B.
2: Sur Aitard de Nonant, Aitardus
alias Aytardus cité par une charte
de Guillaume Ier de 1082 en faveur de la Sainte-Trinité
de Caen (England et alii éd., Regesta regum
Anglo-Normannorum The Acta of William I, 1066-1087,
n°59, p.277 et n°61, pp.289-290)
Éditions
Bernard GINESTE
[trad. & éd.], «Gounier d’Aunay gouverneur de Bayeux en 1105
(témoignage d’Orderic
Vital)», in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer: Notices
concernant Vierville (fin XIe
siècle)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07l,
2008.
|
ANNEXE 7m
Garin d’Aunay témoin d’une donation
d’Helsent
(1108 ou 1109)
Texte
édité par Guérard (1840)
|
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
Donum Helissendis vicedomine de vineis.
|
Donation
de vignes par la vidamesse Helsent.
|
Ego
Helis[endis], Carnotensis vice[domina….. debito] religionis
am………. Ecclesiam Sancti Joh[annis que in subur]bio Carnoti
sita est aliquatenus hon[orare atque reve]rentie mee erga
illam ostendere […..necnon] anime mee necessarium esse cogn[ovi…..
|
Moi Helsent,
vidamesse de Chartres..... sous l’effet de l’amour que
l’on doit porter à la religion... [désirant]
autant que possible honorer l’église Saint-Jean
qui se trouve dans le faubourg de Chartres et manifester
le respect que j’ai pour elle... j’ai reconnu qu’il était
nécessaire à mon âme....
|
... duos
agri]peunos (sic) vinearum quos ad capud ejusdem s[……..] habebam
fratribus loci quia eis foret necessar[ium…….] solutos et quietos
preter censum dedi, pro anima domini mei Bartholomei (a) et mea meorumque filiorum Girardi
et Stephani,
|
.... j’ai
donné aux frères de cet établissement
deux arpents de vignes que je possédais ... au chevet du
dit... , pour en jouir sans entrave ni inquiétude,
hormis le cens, pour l’âme de mon mari Barthélémy
(a), la mienne, et celles de mes fils Girard et Étienne.
|
qui concedentes vadimonium concessionis mecum
super altare posuerunt, in presentia Ivonis episcopi et Huberti
Silvanectensis episcopi (1),
Seranno subdecano et Wilelmo archidiacono, Fulcone archidiacono,
Rainbaldo de Calniaco, Radulfo et Roberto canonicis regularibus,
Gauslino capellano, audientibus et videntibus.
|
Ceux-ci,
consentant à ce don, ont déposé avec
moi la baguette de cession sur l’autel, en présence
de l’évêque Yves, de l’évêque Hubert
de Senlis (1), du sous-doyen Serran,
et l’ont vu et entendu l’archidiacre Guillaume, l’archidiacre
Foulques, Raimbaud de Chaunay, les chanoines réguliers
Raoul et Robert, le chapelain Jocelyn.
|
Hujus autem doni
sunt testes [qui inter]fuerunt, scilicet Robertus Aculeus,
Rainnaldus monetarius, Hugo Bos, [Theobal]dus Stephani filius,
Frodo ejus filius, Aucherus dapifer, [Robertus] de Frainvilla,
Robertus de Murceto, Gradulfus de Blesis, Rainnaldus de
Posterna, Heldemerus magister ……di (b), Garinus de Alneto.
|
De cette donation sont
témoins ceux qui y assistèrent, à savoir:
Robert Aguillon, le monnayeur Rainaud, Hugues Lebœuf, Thibaud
fils d’Étienne, son fils Fron, le sénéchal
Aucher, Robert de Franville, Robert de Murceto (?),
Graoux de Blois, Rainaud de la Poterne, l’écolâtre Audemer
....(b)... Garin d’Aunay.
|
Ut vero hujus
beneficii donum [invio]labiter per succedentia tempora
vigeat, litterarum [monim]ento tradidimus.
Cartulaire de Saint-Jean
en Vallée, n°9, p. 7.
|
Pour la donation
de ce bénéfice reste en vigueur inviolablement
à travers le temps, nous en avons confié le
souvenir à l’écriture.
|
[Note de
Merlet]
(1) Hubert, évêque
de Senlis, fut en relations intimes avec Ives, évêque
de Chartres. Accusé de simonie en 1114, il se
vit interdire l’exercice de ses fonctions, malgré
l’intervention d’Ives de Chartres, qui, en cette même
année, lui donna pendant quelques mois l’hospitalité
dans sa ville épiscopale: «hac aestate eum
apud me detinui [Je l’ai gardé avec moi cet
été (B.G.)]» (Lettre 103 d’Ives de Chartres à Pascal
II). Hubert mourut en l’année suivante 1115.—
La présence du sous-doyen Serannus dans notre
charte prouve que celle-ci est antérieure à
l’année 1109.
|
[Notes
de Gineste]
(a) Barthélémy
Goël ou Godel, second époux d’Helsent, veuve du vidame
Guerry, frère de Foucher Goël ou Godel, qui fut le premier
à entrer dans Jérusalem; il porte lui-même
parfois le titre de vidame, à titre de consort.
(b)
Faut-il lire ici [Gunherius de Monte-Letar]di?
(B.G.)
|
Éditions
1) Original:
parchemin conservé aux Archives départementales
de l’Eure-et-Loir sous la cote H. 3114.
2) René MERLET [éd.], «Vers
1108. Chartres. Donation par la vidamesse Hélissende
de vignes sises au chevet de l’église de l’abbaye»,
in ID., Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée
de Chartres [in-4°], Chartres, Archives d’Eure-et-Loir
& E. Garnier [«Collection de cartulaires chartrains,
publiée aux frais et sous les auspices du Conseil général
d’Eure-et-Loir» 1], 1906, p. 7 (n°9).
3) Bernard GINESTE [trad. & éd.], «Garin d’Aunay
témoin d’une donation d’Helsent (vers 1108)», in ID. [éd.],
«Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07m,
2008.
|
ANNEXE 7n
Gounier d’Aunay renonce à la dîme
de Gouillons
(1108 ou 1109)
Notice de l’édition
de 1912
|
|
Acte 128
(1108-1109)
A.
Orig. S 1347, n°4. Sceau perdu.
B.
Copie de 1129, Liber Testamentorum,
fol. 79’.
C.
Copie de 1209, LL 1351, fol. 106, non collationnée;
les noms des témoins, après «Guido de Rupeforti», sont remplacés
par: «et alii.»
D.
Copie du XVIe s., LL 1353, fol. 132’.
|
Hugues III le Jeune, vicomte
de Chartres, et son suzerain le comte Thibaud IV approuvent
la renonciation de leur vassal Gohier d’Aunay-sous-Auneau
à ses réclamations sur la dîme de Gouillons.
|
Notes de Depoin (1912)
|
Texte édité
par Depoin (1912)
|
Trad. proposée
par Gineste (2008)
|
(114) Gouillons, ca. Janville, ar.
Chartres.
(317) Les limites du gouvernement
de Thibaud IV le Grand, comte de Chartres et de Blois,
vont du 19 mai 1102 au 10 janvier 1152 d’après Aug.
Longnon (Obit. de la Prov. de Sens, t. II, pp. XII-XIII).
(318) Hugues III, châtelain
du Puiset, vicomte de Chartres (1109-1128, d’après
A. de Dion, Les seigneurs du Puiset, p. 12), n’a
pas encore, à ce moment, pris possession du Puiset,
mais exerce déjà les fonctions de vicomte
de Chartres; c’est en cette qualité qu’il agit avec le
concours du comte.
(319) Étienne, fils de Guerri,
vidame de Chartres, mourut en 1130. Il était
abbé de St-Jean-en-Vallée dès 1113;
son prédécesseur était encore en
charge en 1108 (Gallia, VIII, 1311).
(320) Gui le Rouge,
comte de Rochefort (note 74). Sa présence nous
engagerait à dater la charte de 1108, qui aurait
été ainsi la dernière de sa vie.
On le fait même mourir en 1107, mais cette date doit être
rapprochée en raison de la chronologie des abbés
de St-Jean-en-Vallée.
(321) C’est la première
mention qu’on rencontre de cet intéressant
personnage, qui se rattache à la famille d’Engenoul, connétable,
et Baudri, bouteiller de Philippe Ier, témoins en
1067 du diplôme no11. Son surnom lui vient de la
terre de Baudement, ca. Anglure, ar. Epernay (Marne). En 1113
il était l’un des chevaliers de Hugues de Champagne comte
de Troyes (Coll. Duchesne, LXXIV, 96); il passa dès 1118
(coll. Baluze, XXXVIII, 11) au service de Thibaud IV, frère
de Hugues, qui le fit son sénéchal (Luchaire,
Louis VI, n°117, p. 393). En 1132, on le rencontre
au château de Pont avec son frère Engenoul, chanoine
de St-Gervais de Soissons (Ms. lat. 9902, fol. 57). Sa femme Agnès
ayant pris l’habit de Prémontré en 1133 de son consentement
(Duchesne, LXXVI, 85), il entra lui-même à Pontigny,
dont l’abbé l’envoya en 1136, avec douze moines, fonder
l’abbaye de Chaalis (Gallia,
X, 1508). Il mourut le 19 juillet 1142, laissant à l’un de
ses fils survivants, Gui, la seigneurie de Braisne dont il était
en possession dès 1125 et dont il régularisa la collégiale,
dite de Saint-Yves. Une de ses filles fut comtesse de Brienne;
la fille de Gui de Braisne fut comtesse de Bar. Ces alliances justifient
la qualification "nobilissimus" que les monuments
de Prémontré accordent à André de
Baudement. La terre dont il portait le nom tomba en quenouille
après la mort de Baudri fils de Goël, dont la sœur
Heudeborc, déjà veuve sans enfants d’Osbern
de Cailly, porta Baudement à Robert de Picquigny dès
1209 (Ms. lat. 13905, fol. 193; 5423, fol. 37).
(322) Villebon, ca.
La Loupe, ar. Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
|
Notum
sit omnibus hominibus t. f. q. p. quod Goerius de Aneto calumpniabatur
decimam de Goillum (114).
Super
hac vero calumpnia sermo fuit ante Teobaldum comitem
Carnoti (317) et dimisit Goerius
calumpniam, et concessit ecclesie Beati Martini de Campis
in perpetuum predictam decimam, ita quod deinceps nichil ibi
quereret, nec ipse nec heredes ejus.
Hanc
vero concessionem fecit Goerius, vidente et concedente
Hugone de Puteolo, vicecomite (318),
de cujus feodo decima erat, et concedente T.
Ut
autem hec concessio firma vel inconcussa permaneret,
jussit eam T. comes suo sigillari sigillo. Hujus rei sunt
testes: Stephanus abbas de Valeia (319), Guido de Rupeforti (320), Andreas de Baldimento (321), Hugo Mansellus, Erardus de Villabun
(322), Goffridus Infernus, Frodo famulus.
|
Qu’il
soit connu de toutes les personnes présentes
et à venir que Gounier d’Aunay élevait
une contestation relativement à la dîme de Gouillons
(114).
Or il y eut sur cette contestation un débat
devant Thibaud comte de Chartres (317): Gounier
abandonna sa contestation et céda à
perpétuité la dite dîme à
l’église de Saint-Martin-des-Champs, de manière
à ce que rien n’en soit réclamé à
l’avenir ni par lui ni pas ses héritiers.
Gounier a fait cette cession sous les yeux et
avec le consentement d’Hugues vicomte du Puiset
(318), du fef de qui relevait cette dîme, et avec le
consentement de Thibaud.
Et pour que cette cession demeure ferme et inébranlable,
le comte Thibaud a ordonné qu’elle soit scellée
de son sceau.
De
cette affaire sont témoins: Étienne
abbé de [Saint-Jean en] Vallée (319), Guy
de Rochefort (320), André de
Baudement (321), Hugues Manseau, Érard de Villebon (322), Geoffroy Enfer,
le serf Fron. |
Éditions
1) Joseph DEPOIN (1855-1924),
Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs, monastère
parisien. Tome I [premier de 5 volumes
in-4°], Chevetogne (Belgique), Abbaye
de Ligugé & Paris, Jouve & Cie [«Archives
de la France monastique» 13, 16, 18,
20, 21], 1912-1921, tome I (1912), pp. 204-205.
Dont une
réédition numérique
à la fois en mode image et en mode texte
par l’École nationale des Chartes sur
son site Elec:
1b)
ÉCOLE DES CHARTES [éd.],
Liber testamentorum Sancti
Martini de Campis, in ID.,
ELEC (site web) [«Cartulaires
numérisés d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page204/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page205/
(en mode
image) & http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps1/acte138/ (en mode texte), en ligne en 2008.
2) Bernard GINESTE [trad. &
éd.], «Gounier d’Aunay renonce à la dîme
de Gouillons (1108 ou 1109)», in ID. [éd.],
«Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07n,
2008.
|
ANNEXE 7o
Gounier d’Aunay renonce à la dîme
de Thivars
(renonciation rapportée
après 1115)
La
date «vers 1127» proposée
pour cette charte par l’abbé
Métais, éditeur du Cartulaire de Josaphat,
ne paraît être fondée
que sur sur l’indication de l’épiscopat de
Geoffroy II de Chartres, de 1115 à 1148, dont il aura
pris abitrairement la date médiane.
Par
ailleurs le titre qu’il donne à cette charte,
«Donation de l’église et
des dîmes de Thivars par Gohier d’Aunay»,
est clairement erronné, car le sujet réel
de la charte est le don par Geoffroy II de Lèves
aux moines de Josaphat de l’église de Thivars, avec une
dîme qui lui est afférente. Gounier d’Aunay n’est
mentionné que comme ayant antérieurement renoncé,
à une date non précisée, à la
seule dîme, sans qu’il soit fait état de prétention
de sa part sur l’église elle-même.
Il
faut donc sans doute dater la renonciation à
cette dîme par Gounier de la même époque
que celle de Gouillons, pour sa part clairement datée
de 1108 ou 1109, dans le cadre du retour à l’ordre dans
le secteur, à la fin de l’épiscopat de saint
Yves et au début du règne de Louis VI, après
la mise au pas du nouveau seigneur du Puiset, Hugues III.
Texte édité
par Métais (1911)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
XX
De ecclesia
de Thivas cum decima.
|
[après 1115]
De l’église de Thivars, y compris
la dîme.
|
|
Ego Gaufridus, Dei gratia Carnotensis episcopus,
apostolice sedis legatus, omnibus Dei fidelibus presentibus
et futuris. Notum fieri volo quod
|
Moi Geoffroy, par la grâce de Dieu évêque
de Chartres, légat du siège pontifical. Je veux qu’il soit connu de tous les fidèles
de Dieu, présents et à venir, ceci.
|
Gunherius
de Alneto penitentia ductus de his que male egerat, quandam
decimam, ad ecclesiam de Tivas pertinentem, quam tunc
usque contra Dominum tenuerat, in manu mea reddidit et
absque omni deinceps reclamatione et calumpnia dimisit.
|
Gounier d’Aunay,
guidé par le repentir de ses mauvaises actions, a
restitué une dîme relevant de l’église
de Thivars qu’il avait détenue jusque-là
en dépit du Seigneur, et il l’a cédée
sans aucune plainte ou contestation possible à l’avenir.
|
Ego autem
ecclesiam de Tivas cum prefata decima, pro Dei amore, donavi
et concessi monachis et ecclesie Josaphat, juxta Leugas
site, quiete et libere in perpetuum possidendam.
|
Quant à
moi, pour l’amour de Dieu, j’ai donné et concédé
l’église de Thivars, y compris la dite dîme,
aux moines et à l’église de Josaphat, située
près de Lèves, pour en jouir à perpétuité
paisiblement et librement.
|
|
Et ut hoc donum perpetuo duret, scripto illud
commendari et sigilli nostri munimine fecimus confirmari.
Cartulaire de Josaphat,
n°20, t. I, p. 33.
|
Et pour que cette donation vaille à perpétuité,
nous l’avons fait mettre par écrit et certifiée
au renfort de notre sceau.
|
Mss. 10102,
n°88, f. 33 et n°168, f. 155 v°. — Mss. 10103,
n°31, f.13.
|
|
Éditions
1) Joseph
MÉTAIS [éd.], «Vers 1127. Donation de l’église et des
dîmes de Thivars par Gohier d’Aunay», in ID.,
Cartulaire de Josaphat [premier de 5 volumes in-4°],
1911, tome I, p. 33.
Dont une
réédition numérique
à la fois en mode image et en mode texte
par la BNF sur son site Gallica.
2) Bernard GINESTE [trad. &
éd.], «Gounier d’Aunay renonce à la dîme
de Thivars (après 1115)», in
ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07o,
2008.
|
ANNEXE 7p
Restitution d’une terre par Garin d’Aunay aux
moines de Saint-Père
Gounier de Saint-Avit
témoin (charte non datée)
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
CLV.
De terra
a Garino de Alneto et Gunherio filio (sic) ejus reddita.
|
155.
De la terre
restituée par Garin d’Aunay et son fils (lisez: frère) Gounier.
|
|
Memoriam succedentium innovet presens descriptio,
quod Garinus de Alneto illam terram, quam in suis
usibus diutius usurpaverat, humiliter satisfaciens, annuente
Gunherio fratre suo, sancto Petro reddidit.
|
La présente notice fait connaître
à nos successeurs que Garin d’Aunay a humblement fait
réparation en restituant à Saint-Père, avec l’assentiment de son frère Gounier, la terre dont il avait longtemps usurpé les droits
coutumiers, |
His presentibus: Gunherio, fratre ejus; Pagano
Chanardo, Gaufrido coco, Beringerio; Roberto, filio
ejus; Dodone pelliterio, Odone de Gisiaco.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 451.
|
en présence des personnes suivantes: son
frère Gounier, Payen Chenard, le cuisinier Geoffroy,
Béranger et son fils Robert, le pelletier Don,
Eudes de Juziers (?).
|
Éditions
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp. 451 [dont une réédition
numérique par Google, en ligne en 2008].
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.] , «Restitution d’une terre par Garin d’Aunay aux moines
de Saint-Père», in
ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07p,
2008.
|
ANNEXE 7q
Gounier d’Aunay témoin d’une charte du comte Thibaud
Thibaud IV de Blois donne Saint-Martin-au-Val
aux moines de Marmoutiers (vers 1128)
Nous voyons
ici Gounier d’Aunay, frère aîné de Gautier II,
rangé par par Thibaud IV de Blois parmi ses chevaliers, l’an
1128, à Chartres.
Notes de Lépinois
et Merlet (1865)
et de Bernard Gineste
(2008)
|
Texte établi
par Lépinois et Merlet (1865)
|
Traduction de Bernard
Gineste (2008)
|
(a) Thibaut IV le Grand (1093-1151),
comte de Blois, Chartres, Meaux, Châteaudun, sire de Sancerre
et d’Amboise (1102-1151), comte de Troyes et de Champagne (1125-1151).
(b)
Dans le faubourg d e Chartres.
|
XLIII.
Carta
Theobaldi comitis (a), de donatione ecclesiæ Sancti-Martini-in-Valle (b) monachis Majoris-Monasterii.
(1128.)
|
XLIII.
Charte
du comte Thibaud (a) sur la donation
de l’église de Saint-Martin-au-Val (b) aux moines de Marmoutiers.
(1128)
|
(c) Adèle (~1067-1137/1138),
fille de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre,
régente de la principauté de Blois-Chartres, mère
du roi Étienne d’Angleterre, se retire à l’abbaye clunisienne
de Marcigny entre 1120 et 1122.
(d)
Étienne II Henri (†1102), comte
de Blois, Châteaudun, Chartres et Meaux, sire de Sancerre.
(1)
L’abbaye de Saint-Père possédait une des prébendes
de l’église de Saint-Martin-au-Val; la léproserie
du Grand-Beaulieu une autre, et enfin l’abbaye de Saint-Jean recevait
le revenu de l’année de chaque prébende au décès
des chanoines. Pour indemniser ces divers établissements, les
religieux de Marmoutier avaient remis entre les mains d’Yves l’église
de Saint-Nicolas de Courville que cet évêque aumôna
en 1115 à l’abbaye de Saint-Jean, à la charge par ladite
abbaye de donner, chaque année, aux religieux de Saint-Père
et aux confrères du Grand-Beaulieu, pour tenir lieu de leur
prébende, la somme de soixante sous chartrains, quatre muids
de blé froment et autant d’avoine, deux setiers de pois et deux
muids de vin. Cet accord ne reçut son parfait accomplissement
que sous l’évêque Geoffroy, en 1131. (Arch. d’Eure-et-Loir,
fonds de l’abb. de Saint-Jean, H, 44. — Bibl. comm. de Chartres, Livre
noir, n°44, f°86 r°. — Guérard, Cart. de Saint-Père,
p. 374. — Doyen, Hist. de Chartres, t. I, p. 80.)
(e)
Yves de Chartres (~1040-1116) évêque
de Chartres (1079-1116), spécialiste du droit canon, acteur
majeur de la la Querelle des Investitures qui oppose alors la papauté
et l’Empire.
(f)
Pascal II, bénédictin, pape
(1099-1118). |
Ego, Dei gratia, Carnotensis
comes, Tetbaldus nomine, notum fieri presentibus et futuris volo
quod mater mea, Adela (c) comitissa, pro anima comitis Stephani (d), patris
mei, et pro sua suorumque animabus, contulit monachis Sancti-Martini
Majoris-Monasterii Turonensis æcclesiam et prebendas Sancti-Martini-de-Valle
in suburbio Carnotensi (1), ita ut, canonicis
qui tunc ibi erant decedentibus vel vitam suam mutantibus sive prebendas
suas canonico juditio amittentibus, monachi loco eorum succederent,
et aecclesiam illam cum sibi pertinentibus jure perpetuo possiderent.
Quam
mutationem clericalis ordinis in monasticum ordinem debere fieri,
cogente Canonum auctoritate, Ivo, Carnotensis aecclesię tunc venerabilis
episcopi (e) asserebat, dicens se ab antecessoribus accepisse æcclesiam
illam antiquitus monasterium extitisse: habet autem, ut ipse dicebat,
canonica auctoritas ea loca quę aliquando fuerunt monasteria ulterius
non licere fieri habitacula sęcularia.
Igitur,
per consilium ejus et manum, mater mea supradictis monachis prefatam
aecclesiam contulit, et ipsum donum sigillis et literis domni pape
Paschalis Secundi (f) et ipsius episcopi firmatum
est.
|
Moi, par la grâce de Dieu comte
de Chartres, qui suis nommé Thibaud, je veux qu’il soit connu
des gens présents et à venir que ma mère la comtesse
Adèle (c), pour le salut de l’âme
de mon père le comte Étienne (d),
de la sienne et de celles des siens, a donné aux moines de Saint-Martin
de Marmoutier de Tours l’église et les prébendes de
Saint-Martin-au-Val dans le faubourg de Chartres, de telle sorte que,
au fur et à mesure que les chanoines qui y étaient mourront,
ou qu’ils changeront de régime de vie, ou abondonneront
leurs prébendes par suite d’une décision de droit canon,
les moines prennent leur place et possèdent cette église
avec ce qui en relève à perpétuité.
Ce changement de l’ordre clérical
en ordre monastique devait se faire de par l’autorité des
canons, à ce qu’affirmait Yves, alors évêque de
Chartres (e), car il disait qu’il avait appris de ses prédécesseurs
que cette église avait été dans un lointain
passé un monastère; or, à ce que disait le même,
l’autorité des canons établit qu’il n’est pas loisible
à des lieux qui ont été un jour des monastères
de devenir des résidences séculières.
C’est pourquoi, sur son avis et son
autorité banale, ma mère a donné aux susdits
moines la dite église, et la dite donation a été
confirmée par les sceaux et les chartes du pape Pascal II (f) et et
du dit évêque.
|
(g) Yves
de Chartres meurt vers 1116, Pascal II meurt en 1118, Adèle
se fait moniale vers 1121.
|
Verumtamen, quibusdam causis impedientibus,
non statim fuerunt monachi corporali investitura investiti; in quo
intervallo, contigit ipsum papam et ipsum episcopum de hoc mundo migrasse,
et matrem meam vitam monachilem [p.132]
accepisse, et dominium Carnotensis comitatus in manum meam devenisse (g).
|
Cependant, par suite de certains empêchements,
les moines n’ont pas été aussitôt investis par
le rite de l’investiture; entre-temps il est advenu que le dit évêque
et le dit pape ont quitté ce monde, que ma mère a embrassé
la vie monastique et que l’autorité sur le comté de Chartres
est arrivée entre mes mains (g).
|
|
Dolens igitur valde mater mea quod
prefata elemosina non satis plene consummata remansisset, et plurimum
desiderans ut ante mortem suam compleretur, quatinus ejus anima de
hujus mundi carcere securior et lętior solveretur, sepe et sepius, preces
jungens precibus, me rogavit ut, dum michi liceret et ipsa viveret,
ipsam elemosinam perficerem, ne forte, morte vel aliquo periculo prepeditus,
quando vellem perficere non valerem. |
Ainsi ma mère, peinée
que la susdite aumône soit restée insuffisamment consommée,
et désirant qu’elle soit parachevée avant sa mort,
pour que son âme soit délivrée de la prison qu’est
ce bas-monde en plus grande sécurité et joie, c’est plus
souvent qu’on ne saurait le dire que, m’adressant prières sur
prières, elle m’a demandé que, dès que je le pourrais
de son vivant, je parachève cette donation, de crainte qu’empêché
par la mort ou par quelque péripétie je ne puisse la
parachever lorsque je m’y serais décidé
|
(h) On
a là un témoignage direct sur l’usage de demander
leur consentement à des enfants mineurs, qui ne gardaient
pas forcément le souvenir de l’avoir donné, mais qui
y étaient tenu par le témoignage de ceux qui avaient y
avaient assisté.
(1)
Honorius II, pape (1121-1130).
|
Prebebat etiam, testimonium quod ego
aliquando ipsi elemosinę meum, dedissem assensum (h). Tam piis
igitur tamque frequentibus matris me testimoniis et peticionibus
admonitus, perficere elemosinam disposui, dominoque et venerabili
pape, tunc temporis Honorio (1), rem ex
ordine mandavi et ab eo consilium et confirmationem requisivi;
|
Elle fournissait de plus le témoignage
que j’avais moi-même donné un jour mon assentiment à
la dite donation (h). Ainsi donc, poussé
par les témoignages et les demandes si pieuses et si fréquentes
de ma mère, j’ai décidé de parachever cette aumône,
et j’ai scrupuleusement informé le seigneur et vénérable
pape d’alors, Honorius, et je lui ai demandé son avis et sa
confirmation. |
(i) Geoffroy II dit aussi Geoffroy de Lèves, évêque
de Chartres (1115-1148).
|
qui michi in hunc modum rescripsit:
«Deo et tibi, comes Tetbalde, fili karissime, grate referimus
quod religiosos viros et sancta monasteria veneraris et diligis et
pauperes Dei foves et nutris. Tuę quoque bonę voluntati congaudentes,
mandamus ut quod ratio postulat faciendo, aecclesiam illam et prebendas
Sancti-Martini-de-Valle, in manu fratris nostri Gaufredi, venerabilis
Carnotensis episcopi (i), refutes, ut sic demum monachi Sancti-Martini Turonensis
valeant eas de manu episcopi recte suscipere, et nos, si opus fuerit,
debeamus nostram confirmationem supradictis confirmationibus adjungere.»
|
Il m’a répondu en m’écrivant
ce qui suit: «Nous rendons
grâce à Dieu et à toi, notre très cher
fils comte Thibaud, de ce que tu révères et chérisses
les hommes religieux et les saints monastères, et que tu favorises
et nourrisses les pauvres de Dieu. Nous réjouissant aussi de
tes bonnes dispositions, nous te notifions de faire ce que la raison
commande, c’est-à-dire de te désister de cette église
et des prébendes de Saint-Martin-au-Val entre les mains de notre
frère Geoffroy, le vénérable évêque
de Chartres (i), de sorte qu’enfin les moines de Saint-Martin de Tours
puissent les recevoir comme il faut des mains de l’évêque,
et nous, si c’est nécessaire, devions adjoindre nos confirmations
aux susdites confirmations.» |
|
Et quia idem Gaufredus episcopus tunc
temporis Romę erat, precepit ei, ore ad os, ipse dominus papa Honorius
ut quando ego prebendas illas, in manu ipsius, refutassem, ipse
de prebendis et de ęcclesia abbatem et monachos Majoris-Monasterii
investiret, et in usus et potestatem eorum redigendas jure perpetuo
confirmaret. Et ita factum est.
|
Et, comme le dit Geoffroy était
alors à Rome, le pape Honorius en personne lui a prescrit,
en tête à tête que, lorsque je me serais dessaisis
de ces prébendesventre ses mains, lui-même investisse des
ces prébendes et de l’église l’abbé et les moines
de Marmoutier et qu’il leur certifie qu’elle étaient soumises
à leur jouissance et à leur possession par un droit
perpétuel. Et ainsi a-t-il été fait.
|
(j) Mathieu d’Albano (Matthaeus Albanensis) théologien
français, cardinal, évêque d’Albano (dans les
États-Romains), né à Reims, mort en 1134. A la
mort d’Honorius II, il soutiendra activement à travers toute
l’Europe Innocent II contre l’antipape Pierre de Léon dit ’Anaclet
II.
|
Deo siquidem
favente et omnia ad votum nostrum prosperante, vir religiosus, Matheus
nomine, Albanensis episcopus et sedis Romanę legatus Carnotum venerat,
qui, tamquam ad hoc ipsum a Deo transmissus, vices domini pape in
Galliis tunc agebat. Ipse igitur ab episcopo et
a me expetitus, ad ęcclesiam Sancti-Martini-de-Valle venit, ubi,
ipso presente cum ingenti multitudine cleri et populi, prebendas illas
in manum episcopi refutavi,
|
Dieu évidemment favorisant l’affaire
et disposant tout en faveur de notre dessein, un homme religieux du
nom de Mathieu, évêque d’Albano et légat du siège
romain (j) était venu à Chartres, et, comme s’il avait
été envoyé par Dieu spécialement pour
cela, agissait partout en Gaule comme lieutenant du pape. Ainsi donc,
requis par l’évêque et par moi-même, il est venu
à l’église Saint-Martin-au-Val, où, en sa présence,
et en celle d’une foule de clercs et de laïcs, je me suis désisté
de ces prébendes entre les mains de l’évêque.
|
|
sed custodiam rerum exteriorum ipsius ęcclesię
et consuetudines quas in ipsis exterioribus rebus et hominibus eatenus
habueram non dimisi, quin etiam ipsas prebendas, si [p.133] aliquando ipsi monachi quoquo modo,
quod absit, perdiderint, me, ut antea tenueram, deinceps retenturum
coram assistentibus asserui.
|
Cependant je ne me suis pas défait du droit de garde
sur les biens extérieurs de la dite église, ni des droits
coutumiers que j’avais détenus jusqu’alors sur les dits bien
extérieurs ni sur les hommes y résidant. Par ailleurs
j’ai bien dit en présence de ceux qui étaient
là que s’il arrivait un jour que les dits moines, de quelque manière
que ce soit, perdaient les dites prébendes, ce qu’à
Dieu ne plaise, je les détiendrais à nouveau de la même
manière que je les avais détenues antérieurement.
|
(1) Amaury est le plus ancien seigneur de Maintenon
dont nous ayons jusqu’à ce jour rencontré le nom
dans les titres. Il figure, avec les autres grands feudataires du
comté, dans un acte de l’abbaye de Saint-Jean, antérieur
à 1135 (Arch. d’Eure-et-Loir, fonds de Saint-Jean, Inv., n°79),
et nous savons par un titre du Grand-Beaulieu de 1190 (Bibl. de Chartres,
Livre noir, f° 48 v°) qu’il eut la garde du jeune Amaury V,
comte de Montfort (1137-1140), fils d’Amaury IV et d’Agnès de
Garlande, dame de Rochefort. — Le Cartulaire des Vaux-de-Cernay, dans
une note d’ailleurs fort intéressante sur la famille de Maintenon
(t. I, p. 261), dit, par inadvertance et contrairement à la
charte du Grand-Beaulieu rapportée à la page 61 du même
ouvrage, que le pupille d’Amaury de Maintenon fut Amaury II de Montfort
(1087-1089).
(2)
Gohier d’Aunay est le même que Gohonerius de Alneto, dont
le nom se trouve dans une charte de l’abbaye de Thiron, relative à
la vente de Courville faite au comte Thibault IV par Yves de Courville,
en présence d’Etienne, roi d’Angleterre (Arch. d’Eure-et-Loir,
fonds de Thiron, Inv., n°93). Il était fils de Gautier
d’Aunay, et frère de Gautier et Garin d’Aunay, dénommés
dans plusieurs actes de l’abbaye de Saint-Père (Cart.,
p. 204, 207, 451, 503, 603). Les biens de cette famille étaient
situés du côté d’Oinville et de Réclainville
(Ib.). — Les archives d’Eure-et-Loir possèdent un sceau
de Gohier d’Aunay, fils sans doute de celui qui nous occupe en ce moment.
C’est un sceau rond, en cire verte, portant au centre un écu
de.. .. à trois mains de 2 et 1, avec ces fragments de légende:
+ SIG[ILLVM] GOH[ERII] DE A[LNET]O.
(3)
Nous voyons par un titre de Saint-Père de 1101-1129 (Cart.,
p. 478) que Gohier de Morville était fils de Payenne et qu’il
avait pour frère Guillaume, dont le nom se trouve parmi ceux
des témoins d’un accord fait entre le Chapitre et Ursion
de Meslay en 1139. Voir ci-après, n°XLI.
(1)
Thibault Claron fut témoin de plusieurs titres concernant
les religieux de Saint-Père (Cart., p. 284, 286, 365).
(2)
Barbous ou Barbodus, le premier que nous connaissions de cette puissante
famille bourgeoise, était familier du couvent de Saint-Père
(Cart., p. 280 et 294). Nous retrouverons, dans la suite
de ce Cartulaire, plusieurs membres de cette maison qui joua un certain
rôle à Chartres pendant les XIIIe et XIVe siècles,
entre autres Renaud Barbou, familier de Philippe-le-Bel et fondateur
de l’hôpital des Aveugles de Chartres.
(3)
La famille Leroux avait alors à Chartres de nombreux représentants,
dont l’un, nommé Hubert, fut prévôt en 1138.
Adelard, dont le fils Herman prit l’habit à Saint-Père,
figure dans plusieurs actes de ce couvent (Cart., p. 348,
385, 447). |
His ita actis, episcopus de prebendis
et de ęcclesia abbatem Majoris-Monasterii, Odonem nomine, qui et
ipse presens erat, per quendam librum et per cordas signorum (*), investitit
et in manum ei tradidit.
Quę omnia ipse prefatus legatus,
auctoritate Dei et beati Petri et domini papæ Honorii, cujus
tunc vice, ut dictum est, fungebatur, confirmavit.
Nomina eorum qui hęc viderunt et
audierunt hęc sunt: Gualterius, archidiaconus; Ansgerius, archidiaconus;
Salomon, cantor; Galerannus, prepositus; Hainricus, prepositus;
Robertus Bene-Venit; Adelardus, canonicus et capellanus meus; et
multi alii clerici sive canonici.
De monachis Majoris-Monasterii:
Tetbaldus de Columbis; Nicholaus de Baiocis; Gilduinus, frater Galeranni
prepositi; Gualterius Compendiensis; Mauritius monachus, et Gaufredus
Lepus (**); Rainaldus de Castello-Gunterii; Hugo hospitalarius,
et Gualterius subhospitalarius; Tetbaldus, monachus Sancti-Petri
Carnotensis, et multi alii.
Milites mei sive servientes vel
alii homines: Amairicus de Mestenone (1),
et Gunherius de Alneto (2); Gunherius de
Morvilla (3); Ansoldus, telonearius, et
Clemens, filius ejus; [p.133]
Tetbaldus Claronis (1), et Barbous de Sancto-Petro
(2); Vitalis, filius Algardis, et Adelardus
Rufus (3); Paganus major, et Hubertus,
et Hildegarius fratres ejus; Ingelbertus, cellararius; Vitalis, et
Rainaldus frater ejus; Ysacar (***), et Gaufredus, et Robertus,
servientes monachorum de Valle-Sancti-Martini, et multi alii.
De famulis Majoris-Monasterii:
Paganus, camerarius; Johannes, mariscalcus; Gaudinus, miles; Petrus
Martini Radulfus, coquus; Algerius Gazel; Eschivardus; Petrus
Barba et alius Petrus; Gualterius Tardivus, et alii multi.
|
Une fois cela fait, l’évêque
a investi de ces prébendes et de l’église l’abbé
de Marmoutier nommé Eudes, qui était personnellement
présent, par le biais d’un livre et des cordes des cloches (*), et les a remis entre ses mains.
Tout cela, le susdit légat
l’a confirmé, de par l’autorité de Dieu, de saint
Pierre et de monseigneur le pape Honorius au nom de qui il agissait.
Les noms de ceux qui ont vu et entendu
cela sont: l’archidiacre Gautier, l’archidiacre Angier, le chantre
Salomon, le prévôt Galeran, le prévôt Henri,
Robert Bien-Vint, le chanoine Allard mon chapelain et beaucoup d’autres,
clercs ou chanoines.
Parmi les moines de Marmoutier: Thibaud
de Colombes, Nicolas de Bayeux, Gidouin le frère du prévôt
Galeran, Gautier de Compiègne, le moine Maurice et Geoffroy
Lièvre (**), Rainaud de Château-Gonthier,
le gardien de l’hôpital Hugues et le sous-gardien Gautier, Thibaud
moine de Saint-Père de Chartres et beaucoup d’autres.
Mes chevaliers ou sergents ou d’autres
féaux: Aimery de Maintenon (1) et Gounier d’Aunay (2), Gounier
de Morville (3), le percepteur de tonlieu Ansoud et son fils Clément,
Thibaud Claron (1) et Barboux de Saint-Père (2), Vital
fils d’Augard et Allard Roux (3), le régisseur Payen
ainsi que ses frères Hubert et Haugier, le cellerier Engibert,
Vital et son frère Rainaud, Isachar (***), les
sergents des moines Isachar, Geoffroy et Robert, et de nombreux autres.
Parmi les familiers de Marmoutiers:
le chambrier Payen, le maréchal Jean, le chevalier Gaudin,
le cuisinier Pierre Martin Roux, Auger Gazel, Eschivard, Pierre Barbe
et un autre Pierre, Gautier Tardif et de nombreux autres.
|
(4) Mathilde, fille d’Engilbert II, duc
de Carinthie, comtesse de Chartres-Blois et de Champagne. L’obit
de cette princesse est inscrit au Nécrologe sous la date du
jour des ides de décembre.
(k) Hugues
III du Puiset, marié avant 1104 à Agnès de
Blois, avait commencé par s’en prendre au comté
de Chartres, douaire de sa belle-mère Adèle, tutrice
de Thibaut IV, mais fut défait et capturé par Louis
VI en 1111. Libéré, il se rebella à nouveau,
allié cette fois à Thibaud IV et fut fait à
nouveau captif. Il mourut en Terre Sainte en 1132.
|
Porro, in crastinum ipsius diei, nobis positis in Turre mea, Carnoti,
concessit id ipsum comitissa uxor mea, Mathildis nomine (4), me rogante, audientibus et videntibus Hugone,
vice-comite de Pusiato, et multis militibus sive servientibus et
meis et suis, et jamdicto Majoris-Monasterii abbate Odone, cum proxime
nominatis monachis et famulis suis.
|
De plus, le lendemain du dit jour, alors que nous étions
dans mon donjon à Chartres, la comtesse mon épouse, dénommée
Mahaut (4), a concédé la même chose, à ma demande;
et l’ont entendu et vu: Hugues, vicomte du Puiset (k) ainsi que de nombreux chevaliers et sergents,
tant des miens que des siens, et l’abbé de Marmoutier
déjà plusieurs
fois cité, Eudes, avec ceux de ses moines
et familiers qu’on vient de citer.
|
(5) A la suite de cette charte, a été
ajoutée la notice suivante:
Ut vero hec mea antecessorumque meorum
elemosina perpetuo rata foret, cum quadam vice abbas Majoris-Monasterii
prefatus Odo ad me Blesim venisset, primogenitus filius meus Henricus
(Henri-le-Libéral, comte de Champagne après son père),
qui michi jure hereditario in honorem successurus erat, admonitione
mea uxorisque mee jamdicte, Mathildis matris ejus, donum ecclesie
Beati Martini-de-Valle concessit, et hanc concessionem in litteris
meis subscribi, ut cernere est, voluit, sub testibus istis: predicto
abbate, Laurentio priore, Bermundo bajulo, Hugone hospitalario, Gaufrido
Lepore (**) et Guillelmo de Orchesia priore, monachis; me quoque et supradicta
uxore mea Mathildi presentibus; Stephano etiam, camerario meo; Gualterio
de Berno (****); Brunone, filio Hebroini; Garino, filio Cane (*****); Herberto Faceto; Berengario,
preposito; Pagano de Villa-Belfodi; Athone Borrelli et Archembaldo
Gubil, laicis. Actum anno incarnati Verbi M°C°XXX°V°,
indictione XIIIa, epacta IIIIa.
|
Actum anno incarnationis dominicę
M°C°XX°VIII°, indictione VI° epacta XVIIa (5).
(Orig. en parch. Arch. d’Eure-et-Loir,
fonds du Chapitre, C. IX, J, 1.)
|
Fait l’an de l’incarnation du seigneur
1127, indiction VI, épacte XVII (5).
[Addition
(1135)]
Mais
pour que cette aumône de moi-même et de mes prédécesseurs
soit valable à perpétuité, alors que, une fois,
le susdit abbé de Marmoutiers Eudes était venu me voir
à Blois, mon fils aîné Henri, qui devait me succéder
par droit héréditaire dans ma dignité, à
ma demande et à celle de ma susdite épouse, Mahaut, sa
mère, il a autorisé la donation de l’église de
Saint-Martin-au-Val, et il a accepté que cette autorisation
soit portée au-dessous de ma charte, comme on peut le voir,
avec les témoins suivants: le prieur Laurent, le baillli Bermond,
le gardien de l’hôpital Hugues, Geoffroy Lièvre
(**), le prieur d’Orchaise,
tous moines, moi-même étant présent ainsi que
ma susdite épouse Mahaut, et que: mon chambrier Étienne,
Gautier de Berne (****), Brunon fils d’Évroin, Garin filius Cane
(*****), Hébert Facet, le prévôt
Béranger, Payen de Villeberfol, Athon Borrel et Archambaud
Goubil, laïcs. Fait l’an de l’incarnation du Verbe 1135, indiction
XIII, épacte IV.
|
AUTRES NOTULES DE BERNARD
GINESTE
(*) a
investi ... l’abbé ... par le biais d’un livre et des cordes
des cloches. Un rite analogue est attesté en Anjou vers
1135 par Ulger, évêque d’Angers, dans une lettre à
Innocent III, pour le don d’une chapelle (éd. François
Marie Tresvaux du Fraval, Histoire de l’église et du diocèse
d’Angers, 1858, p. 513: sic investitit illam pauperem abbatiolam
de ista Cappela in manibus Albani Abbatis, tradendo ei claves illius
Capellæ, tradendo ei cordas signorum ejus, necnon et chartam constitutionis
ejusdem, insuper et libros, et si qua sunt alia.)
(**)
Lièvre (latin Lepus) est certainement
l’altération de l’anthroponyme Lieffroy.
(***)
Ysacar, anthroponyme biblique, nom d’un des douze patriarche,
neuvième fils de Jacob.
(****)
Ce chevalier Gautier de Berne (Vautherius de Berno,
miles suus) est encore témoin en 1143 de l’hommage rendu
par Thibaud IV à Eudes de Bourgogne pour certains de ses fiefs
(Cartulaire de l’Yonne, t.1, n°CCXXVI), et d’un autre
acte de Thibaud IV en 1149 (ibid., n°CCXCII: Gauterius
de Bernoa).
(*****)
Cet anthroponyme énigmatique filius Cane est encore
attesté en Angleterre vers 1213 (P.H. Reaney et R.M.Wilson,
Dictionary of English Surnames, 1991, p.82: Willelmus
filius Cane) et en 1280 en Belgique (Annales de la Société
historique et archéologique à Maestricht I, 1854-1855,
p.309: Henrico filio Christiani qui filius Cane vulgariter
appellatur). Il est aussi donné au XIe siècle à
un certain Savary fils de Raoul de Beaumont, vicomte de Beaumont-sur-Sarthe
(filiation établie notamment par une charte de 1105: Radulfus
et Savarico filii ipsius Savaricus, éd. J. H. Round, Calendar
of Documents preserved in France illustrative of the history of Great
Britain and Ireland. Volume I, 918-1206, London, 1899, n°669,
p. 237), qui est appelé par Orderic Vital Savaricus filius Cani
(éd. Le Prévost, t.III, 1845, livre VIII, § XVI,
p. 360, note 2), et par une charte datée entre 1087 et 1094
Savericus filius Cane (éd. Round, ibid., 1899,
n°423, p. 142). Le Prévost et d’autres supposent qu’il est
le fils d’une seconde épouse du vicomte de Beaulieu nommée
Cana, qui est peut-être la fille de Gelduin de Pontlevoie
citée par les Chroniques d’Anjou sous le nom de Chane (Paul
Marchegay, André Salmon & Émile Mabille, Chroniques
d’Anjou, 1856, p.166: Genuit autem Gelduinus filium, Gosfridum nomine....,
qui etiam ex eadem uxore Gosfrido unam sororem, Chanam nomine, addidit,
quæ nupuit data Frangalo Filgerairum domino plures filios et filias
peperit.) Cependant on peut se demander s’il ne s’agirait pas plutôt
ici de la rétroversion approximative d’un surnom désobligeant
Fils de chienne.
1) Eugène de BUCHÈRE
DE LÉPINOIS & Lucien MERLET [éd.], Cartulaire
de Notre-Dame de Chartres [28 cm; 3 volumes (CCLII+263 p.; XXXII+429
p.; 438 p.], Chartres, E. Garnier [«Société
archéologique d’Eure-et-Loire»], 1862-1863-1865.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Thibaud IV de Blois donne Saint-Martin-au-Val aux
moines de Marmoutiers (vers 1128)»,
in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant
Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07q,
2008.
|
ANNEXE 7r
Donation de Garin d’Aunay sur son lit de mort
après 1130
Texte édité
par Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
|
LXX.
[1130-1150]
De arpenno terre a Garino Torcul apud Theovas
dato, et a filiis ejus concesso.
|
70.
[entre
1130 et 1150]
De la terre
restituée par Garin d’Aunay et son fils (lisez: frère) Gounier.
|
Quando Garinus de Alneto, qui cognominatus
est etiam Torcul, moriebatur, visitante se domno Udone,
nostro sancti Petri Carnoti scilicet abbate, idem egrotus,
multis qui presentes aderant videntibus, donavit ecclesie
nostre in elemosinam unum arpennum [p.464] terre apud Theovas situm, prope
nostrum quem ibi habemus molendinum; ita videlicet liberum
et quietum, ut et decima de eo nostra sit et terragium.
|
Alors que Garin d’Aunay, surnommé
Torcul, était mourant, lors de la visite que
lui rendit dom Eudes, notre abbé,
c’est-à-dire à celui de Saint-Père
de Chartres, le dit malade, au vu de
tous ceux qui étaient présents, a
donné en aumône à notre église
un arpent de terre situé à Thivars, près
du moulin que nous y avons, pour que
nous en jouissions librement et paisiblement, et de
telle manière que la dîme et le terrage nous
en appartiennent. |
Quod patris sui donum filii ejus Adam,
Paganus, Galerannus atque Herbertus, et filie Eremburgis
et Petronilla, ipso jam defuncto, concesserunt et concedentes,
super altare sancti Petri posuerunt. Cui rei affuerunt testes
hii: Guillelmus de Mongervilla, Ansoldus de Bello Videre, Goslenus
medicus, Ivo de Balneolis, Isembardus de Alberis.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 451.
|
A ce don de leur père ont consenti ses fils
Adam, Payen, Galeran et Hébert, et ses filles Arembour
et Perronnelle, après sa mort, et ils y ont
consenti en la déposant sur l’autel de saint
Pierre. A cette affaire ont assisté: Guillaume
de Mongerville, Ansoud de Beauvoir, le médecin Joscelin,
Yves de Baigneaux [commune de
Theuville], Isembard des Aubées
[Saint-Léger-des-Aubées].
|
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.],
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père
de Chartres [2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848
p.], Paris, Crapelet [«Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. 1re série.
Histoire politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, pp. 451 [dont une réédition
numérique par Google, en ligne en 2008].
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Donation de Garin d’Aunay sur son lit
de mort (entre
1130 et 1150)», in ID.
[éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07r,
2008.
|
ANNEXE 7s
Gounier témoin de plusieurs actes
du Cartulaire de Bonneval
de 1118 à 1141
Au témoignage
de Lucien Merlet:
De 1118 à 1141, nous le
rencontrons souvent comme témoin dans les pièces
du chartrier de l’abbaye de Bonneval.
Cartulaire
de l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron,
Chartres, Garnier, 1883, t. II, p. 57, note 1.
|
ANNEXE 7t
Gounier témoin d’un consentement de Geoffroy IV de
Châteaudun
Geoffroy IV de Châteaudun autorise
la donation d’une terre à Mahelainville (1140)
Au témoignage
de Lucien Merlet:
Gohier d’Aunay
fut témoin de la confirmation faite en 1140 par Geoffroi
IV, vicomte de Châteaudun, du don fait à la maladrerie
de Saint-Lazare de Châteaudun par Renaud de Patay, surnommé
Guiterne, d’une terre à Machelainville, paroisse de Péronville.
Cartulaire
de l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron,
Chartres, Garnier, 1883, t. II, p. 57, note 1.
Voir
aussi Jean Baptiste Bordas & Achille Guenée,
Histoire du comté de Dunois, de ses comtes et de
sa capitale, Châteaudun, Auguste Lecesne, 1850, p. 146,
qui mentionne également sans références ce texte,
et fait de plus mention, également sans référence,
d’un Gautier d’Aunay en 1147.
|
ANNEXE 7u
Gounier d’Aunay autorise une donation à Unverre
Érard de Villebon donne un muids
de blé aux moines de Tiron (vers 1146)
Notes de Merlet
(1883) et B.G. (2008)
|
Texte édité
par Merlet (1883)
|
Traduction par B. Gineste
(2008)
|
(a) Moulin de Beauvais, commune d’Unverre,
canton de Brou.
|
CCLXXXVIII.
Don d’un muid de blé de rente
sur le moulin de Beauvais (a).
(1146 circa.) |
CCLXXXVIII.
Don d’un muid de blé de rente
sur le moulin de Beauvais (a).
(vers 1146)
|
(b) Erardus de Villabon est aussi
témoin d’une charte du même cartulaire vers 1121 (tome
I, p. 70). Villebon, hameau de la commune d’Alluyes, canton de Bonneval.
(1)
Gohier d’Aunay fut témoin de la confirmation faite en 1140
par Geoffroi IV, vicomte de Châteaudun, du don fait à
la maladrerie de Saint-Lazare de Châteaudun par Renaud de Patay,
surnommé Guiterne, d’une terre à Machelainville, paroisse
de Péronville. De 1118 à 1141, nous le rencontrons
souvent comme témoin dans les pièces du chartrier de
l’abbaye de Bonneval. Il était fils de Gautier d’Aunay, et
frère de Gautier et de Garin d’Aunay, dénommés
dans plusieurs actes de l’abbaye de Saint- Père.
(2)
Hugues de Pomeio est témoin de l’abandon
fait en 1118 par Thibaut, comte de Chartres, à l’abbaye de
Bonneval d’un marché libre et de la justice entière de
la ville de Bonneval.
(c) Un
Gauterus de Gandonvilla est aussi témoin
à Blois en 1202 (Cartulaire des Vaux-de-Cernay, éd.
Moutié et Merlet, t. I, p. 138) |
Memorie succedentium notificare
curavimus quod miles quidam, Erardus videlicet de Villabum (b) nomine, volens ire Jerusalem, dedit monachis
[p.57] Tyronensibus, ob
remissionem peccatorum suorum, unum modium frumenti de molendino suo
quod vulgariter Belvetum dicitur, ita ut singulis annis sine ulla intermissione
illum inde in perpetuum habeant.
Concessit autem hoc Gunherius de Alneto
(1), de cujus feodo erat,
audientibus his quorum subnexa sunt
nomina: Herveius decanus, Stephanus presbiter, Erardus ipse de
Villabum, Hugo de Pomeio (2), Paganus
de Manso-Leonci, Galterius de Gandunvilla (c), Jordanus miles.
(Cart. de Tiron, f° 91
v°.)
|
Nous avons pris soin de faire connaître
à la mémoire de nos successeurs qu’un chevalier nommé
Érard de Villebon (b), voulant gagner Jérusalem,
a donné aux moines de Tiron, pour la rémission de ses
péchés, un muids de froment de son moulin appelé
vulgairement Belvet, de sorte qu’ils l’aient dés lors chaque
année sans interruption à perpétuité.
Cela a été autorisé
par Gounier d’Aunay (1), dont c’était le
fief.
L’ont entendu ceux dont les noms sont
portés ci-dessous: le doyen Hervé, le prêtre
Étienne, Érard de Villebon lui-même, Hugues de
Pomeio (2), Payen de Manso-Leonci,
Gautier de Gandunvilla (c), le chevalier Jourdain.
|
Éditions
Lucien MERLET (1827-1898), Cartulaire de l’abbaye de la Sainte-Trinité
de Tiron, 1141-1720 [28 cm; 2 volumes; CXXXVIII+254 p.], Chartres,
E. Garnier, 1882-1883, tome II, pp. 56-57.
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Érard de Villebon
donne un muids de blé aux moines de Tiron (vers 1146)», in ID. [éd.],
«Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe07u,
2008.
|
ANNEXE 7v
Mention d’Obert d’Aunay dit Payen
Torcul, fils de Garin
avant 1151
Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée,
n°CLXXXIII (avant 1151), t. I, p. 226-227:
Obertus de Alneto qui et Paganus Torcul dicitur.
|
|
ANNEXE 7w
Répertoire (vieilli et inexact)
des membres de la famille d’Aunay
(1854)
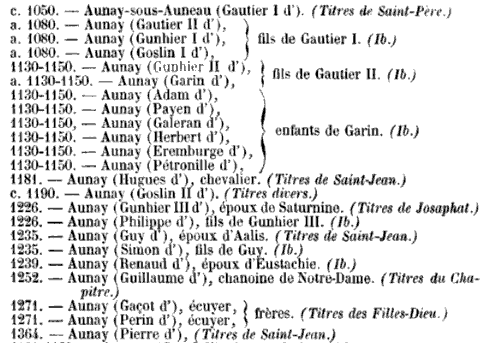 Répertoire
(approximatif) donné par de Lépinois
dans son Histoire de Chartres, 1854, p.
451
Répertoire
(approximatif) donné par de Lépinois
dans son Histoire de Chartres, 1854, p.
451
Critique
Cette reconstitution généalogique
me paraît contredite, en ce qui concerne Gounier et Garin,
par nos notices sur Vierville, qui nous montrent que Gautier II d’Aunay
n’avait pas de descendance. Il n’est pas possible en effet que Gautier
II ait eu des enfants qui ne soient pas mentionnés lors de la
donation de Vierville. Et s’il en avait eu postérieurement à
cette donation, leur consentement aurait été enregistré
dès que possible, après la mort de Gautier II, qui paraît
un fait accompli lors des deux dernières transactions, où
ne sont mentionnés comme témoins que ses deux frèrs
Arnoux et Garin. Aussi le Gounier de Saint-Avit que nous avons signalé
ne peut-il pas être son fils, mais seulement celui qui a hérité
de cette terre après la mort de Gautier II, c’est-à-dire,
presque nécessairement son frère aîné à
qui devait retourner ce bien après l’extinction d’une branche cadette.
Faut-il par ailleurs s’étonner
de voir Gounier, frère aîné de Gautier II, vivre
encore en 1146? La première transaction où il apparaisse
peut parfaitement ne dater que de 1078, à la fin de l’abbatiat
d’Hubert. En supposant qu’il ait eu alors 15 ans (et il pouvait être
plus jeune encore, car on enregistre parfois le consentement de simples
enfants, comme on le voit dans le cas de Thibaud IV, qui rapporte ne
pas se rappeler avoir donner son consentement, fait sur lequel il s’en
rapporte au témoignage de sa mère), et qu’il soit donc
né vers 1063, il aurait eu 42 ans en 1105 lorsqu’il défendit
Bayeux contre le roi d’Angleterre, et, la dernière fois où
il paraît comme témoin, vers 1146, il n’aurait eu que 78
ans. Cela n’a rien d’impossible, et n’oblige donc pas à distinguer
sans autre fondement deux Gounier d’Aunay. A la même époque
par exemple le vaillant Robert Courteheuse mourut en prison à l’âge
d’au moins 82 ans (1051-1052/1134). Si on répugne à faire
vivre si longtemps un chevalier du XIe siècle, on peut aussi imaginer
qu’il y a bien eu un Gounier II, mais il faut alors en faire un fils
de Gounier I, et non pas de Gautier II.
Bernard Gineste, 2008
|
ANNEXE
8
Dossier sur Hugues de Gallardon
8a. Serment d’Hugues de Gallardon au sujet de sa
voirie (1092 ou peu après).
8b. Hugues de Gallardon se porte caution d’un serf
(entre 1092 et 1101)).
8c. Guy de Gallardon approuve une donation de
ses frères Hugues et Garin décédés
(après 1096).
|
ANNEXE 8a
Serment d’Hugues de Gallardon au sujet de sa
voirie
1092
ou peu après
Je donne ici le
texte intéressant d’une notice publiée en
1844 dans un bulletin assez confidentiel qui peut-être
n’a pas été réédité,
où Hugues de Gallardon réitère
devant les chanoines de Notre-Dame de Chartres le serment
de ne pas taxer leurs biens lorsqu’ils passent par
son château, et de ne pas infliger des amendes à
leurs serfs sans avoir préalablement respecté
certaines formes légales:
Je propose de dater ce serment d’Hugues e Gallardon de 1092, date
de la mort de son père Hervé de Gallardon. La date
du décès d’Hugues de Gallardon n’est pas connue
et plusieurs auteurs supposent qu’il est mort vers 1101
en palestine, où il serait parti avec Évrard
du Puiset en 1096.
| Texte
édité par A. Benoît (1844) |
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
Notum
sit omnibus tam præsentibus quàm futuris
sanctæ carnotensis ecclesiæ fratribus,
quod
|
Qu’il
soit connu de tous les frères présents
et à venir de la sainte église de Chartres ceci.
|
Hugo
de Gualardone abjuravit in capitulo beatæ
Mariæ, coràm omnibus tàm clericis quàm
laïcis, sicut et pater suus antè abjuraverat
in præsentiâ comitis Teobaldi, se non
ulteriùs accipere pedagium de re canonicorum communi
aut propriâ quæ duceretur per castrum suum.
|
Hugues
de Gallardon a fait le serment lors du chapitre de Notre-Dame,
en présence de tous les clercs et laïcs, comme
en avait fait serment avant lui son père en présence
du comte Thibaud, de ne pas percevoir de droit de péage
sur les biens communs ou particuliers des chanoines qui transiteraient
par son château.
|
Abjuravit
etiam se nullum ex rusticis beatæ Mariæ,
in viariâ suâ manentibus, moniturum
de justitiâ quàm priùs dicat admonitionis
causam. Moniti autem, sicut suprà diximus, denominatâ
offensionis causâ, ad castrum suum semel ibunt;
et si legale exonium ipse aut serviens suus habuerit, oportebit
eos redire tantùm aliâ vice.
|
Il
a aussi prêté serment qu’il ne sommerait à
comparaître aucun des paysans de Notre-Dame qui
demeurent dans sa voirie avant de lui avoir signifié
la cause de cette sommation. Et ceux qui seront sommés
de comparaître, ainsi que nous venons de le dire, une
fois que le chef d’accusation aura été formulé,
ne se rendront à son château qu’une seule fois; et si
lui-même ou son sergent ont une excuse légitime [pour
ne pas recevoir ceux qui ont été convoqués],
il ne leur faudra revenir qu’une seule autre fois.
|
Quid si aliquis, ad usus
suprà dictos, rusticos proclamaverit et proclamator
legale exonium habuerit, rustico in domo suâ
contramandabitur.
Bulletin du Bibliophile
VI/19 (1844), pp. 1042sq.
|
Si quelqu’un,
selon les usages ci-dessus formulés, somme à
comparaître des paysans, et que celui qui a fait
a une excuse légitime, on signifiera un ajournement
au paysan dans sa propre demeure.
|
Éditions
1) A. BENOÎT (juge suppléant à
Chartres), «Notice sur un obituaire de la cathédrale
de Chartres qui se trouve à la bibliothèque
de Saint-Étienne (Loire)», in
Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire,
publié par J. Techener, sous la direction
de MM. Paulin Paris et G. Duplesis, avec le catalogue
raisonné des livres de l’éditeur VI/19
(juillet 1844), pp. 1039-1044, texte pp. 1042-1043.
2) Bernard GINESTE [trad. & éd.], «Serment d’Hugues
de Gallardon au sujet de
sa voirie (1092 ou peu après)»,
in ID. [éd.], «Thion Chef-de-Fer:
Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe08a,
2008.
|
ANNEXE 8b
Hugues de Gallardon se porte caution d’un serf
(entre 1092 et 1101)
Texte édité
par A. Guérard (1840)
|
Traduction proposée
par Gineste (2008)
|
XLIII.
De terra
a Garino, pro collate sibi libertate , dimissa.
[1090-1101.]
|
43.
D’une terre
cédée par Garin pour prix de son affranchissement.
[entre 1089 et 1101.]
|
Ego Eustachius, Dei gratia,
sancti Petri Carnotensis abbas, .... notum esse volumus....
quia
|
Moi Eustache, par la grâce
de Dieu abbé de Saint-Père de Chartres,
.... nous voulons qu’il soit connu .... ceci.
|
adiit nostrum presentiam
quidam servus sancti Petri, Guarinus nomine, de Bermeri
Villa, obnixe deprecans, ut eum a nodo servitutis absolveremus.
|
S’est présenté
devant nous un serf de Saint-Père du nom de Garin,
de Barmainville, nous suppliant ardemment de le délier
du nœud de la servitude.
|
Quod et fecimus una cum consensu
domni Ivonis (1) episcopi omniumque monachorum nostrorum.
Ipse vero Garinus guerpivit nobis terram quam de sancto Petro
tenebat, addens etiam X libras denariorum....
|
C’est ce que nous avons
fait avec le consentement de monseigneur l’évêque
Yves et de tous nos moines. Mais Garin nous a cédé
la terre qu’il tenait de Saint-Père, y ajoutant
même une somme de 10 livres.
|
Ex
parte Garini fuerunt hii testes: Hugo de Galardone, qui,
pro hac conventione et amore illius, noster homo effectus
est et fidelitatem nobis juravit, omnibusque successoribus nostris
idem facere, quandiu viveret, promisit; Gauslinus, Bartholomeus
vicedominus, Robertus Aculeus;
|
Du côté de Garin
les témoins ont été: Hugues
de Gallardon, qui, pour cet accord et par amour de cet homme
nous a rendu hommage, nous a prêté serment
de fidélité et a promis de faire la même
chose en faveur de nos successeurs tant qu’il vivrait; Jocelyn,
le vidame Barthélémy, Robert Aguillon.
|
ex parte nostra, Stephanus
major et Salomon, fratres; Rogerius, Arroldus agaso, Durandus,
Urso monachus, Bernardus prepositus.
Cartulaire de Saint-Père,
p. 297.
|
De notre côté:
le régisseur Étienne et Salomon, frères;
Roger, le palefrenier Airaud, Durand, le moine Ours, le
prévôt Bernard.
|
[Note de Guérard]
(1) Ivo, Carnotensis præsul sacratus novembri 1090, defunctus decembri 1115.
|
(1) Yves,
évêque de Chartres sacré en novembre
1090 [De nos jours on fait commencer
son épiscopat en 1089 (B.G.)], mort en décembre
1115.
|
Éditions
1) Benjamin GUÉRARD, [éd.], Cartulaire
de l’abbaye de Saint-Père de Chartres
[2 volumes in-4° (27 cm); CCCLXXI+848 p.],
Paris, Crapelet [«Collection de documents inédits
sur l’histoire de France. 1re série. Histoire
politique. Collection des cartulaires de France»
1-2], 1840, p. 297 [dont une réédition numérique
par Google, en ligne en 2008].
2) Bernard
GINESTE [trad. & éd.],
«Hugues de Gallardon se porte caution
d’un serf (entre 1092 et 1100)», in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices
concernant Vierville (fin XIe siècle)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe08c,
2008.
SOMMAIRE
|
|
ANNEXE
8c
Hugues de Gallardon et le prieuré
d’Auneau des moines de Bonneval
Synthèse d’Édouard
Lefèvre, 1867
Prieuré d’Auneau.
(les italiques sont de l’éditeur)
|
Notes de Lefèvre
|
|
Vers
1100 (1) Hugues, seigneur de Gallardon, Auneau
et autres lieux, en reconnaissance de ce que les religieux de Bonneval
avaient fort honorablement enterré Hervé, son père,
leur avait donné plusieurs biens avec la chapelle de Saint-Nicolas
qui était dans son château d’Auneau. Robert, abbé
de Bonneval, y envoya plusieurs religieux de sa communauté, ce qui
donna naissance au prieuré d’Auneau.
|
(1) Voir ci-dessus, page 35,
la note 4.
|
|
Hugues, étant près de partir pour la Terre-Sainte,
confirma aux religieux d’Auneau tous les biens que lui et les siens leur
avaient donnés en plusieurs fois, et il en ajouta de nouveaux, entre
autres un manse (habitation) auprès du château d’Auneau
qui venait d’être construit, une charrue de terre, les fours établis
et à établir dans ladite villa, la foire du château,
la dîme et le tonlieu (2) de toutes les
herbes et de tous les fruits, l’étang auprès du château
avec la moitié du moulin qu’on devait y construire; la chapelle
du château et quinze livres pour contribuer à son érection.
Au nombre des témoins figurent: Ansold de Mongerville (3), Rainold de Brez (4), Jean d’Eclimont (5), Osmond d’Auneau, Guy et Milon frères
de Hugues: [p.95] |
(2) Droit de douane ou d’entrée qui frappait
les denrées et les marchandises transportées par terre ou
par eau, à leur arrivée au quai ou à la porte de la
ville.
(3) Hameau de la commune
de Santeuil.
(4) Hameau de la commune
d’Umpeau.
(5) Hameau de la commune
de Saint-Symphorien.
|
Cir. a. 1100. — «Quoniam que Dei sunt
non occultare, sed ut tardioribus tepidioribus que imitanda proponantur,
juxta ejus preceptum lucem coram hominibus concedet lucere, tam futuris
quam presentibus litterali tenacitate volo declarare quia fidelibus ego
Hugo, Gualardonensium dominus, Deo dicatis cenobitalibus
in Bonevallensi monasterio, summo regi, ejusque quorum assunt ibi reliquie
martyribus devotè famulantibus, pro patris mei Henrici [sic (Hervei?) (B.G.)] absolutione traditi tam
honorifice ab ipsis inibi sepulture, et ut ego crebri eorum adminiculante
deprecatione erui a Jehennali tribulatione, paradisique perfrui merear
amena exultatione, largitus sum de meis possessionibus solemni donatione
que cartule huic miserendo nominatim mandavi retinere, scilicet mansum
quod Foesvilla vocatur totum, apud Alneellum castrum noviter extructum,
terram aratri unius culture sufficientem, et furnos qui in ipsa villa facti
vel futuri sunt; decimam quoque culturarum mearum que ibi erunt, nec non
ipsius castelli forum decimam et omne herbarum fructuumque teloneum , et
Stagnum quoddam cum dimidia parte molendini inibi
construendi; capellam quoque castelli, et ad ejus edificationem quindecim
libras monete carnotensis, et quicquid homines mei servi sive liberi illis
dederunt, concessi. Huic vero interfuerunt testes qui hoc audierunt et
viderunt: Guarinus clericus, canonicus sancte Marie; Gaufridus mariscalcus;
Hugo Fulcoini; Albericus coquus; Ansoldus de Mengervilla; Guido
et Milo fratres mei; Haimericus et Herveus balisterii; Rainoldus de
Brai; Johannes de Clismunt; Ivo Gaucherii; Iohannes
vitulus; Rainardus clericus; Osmundus de Alneel; Guillelmus de Viri;
Robertus Brito.»
|
|
Hugues, touché de la piété des religieux et pour les
aider à continuer les constructions qu’ils avaient convenablement
commencées, leur fit encore plusieurs donations comprenant: le presbytère
d’Eclimont (1); la dîme des terres
cultivées et des vignes en quelque lieu qu’elles soient ou seront;
toute la foire de Saint-Nicolas; l’aire du moulin de Ravalois
(2) à Gallardon; tout ce qu’il possédait
dans le [p.96] château d’Auneau, c’est-à-dire le territoire, les
maisons et les jardins depuis la porte de Saint-Romain et les celliers
(1) des religieux jusqu’à la rivière:
|
(1) Hameau de la commune de Saint-Symphorien.
(2) Voir plus loin l’accord
de 1292.
(1) Officinæ,
in monasteriis dictæ ædiculæ in quibus asserventur quæ
ad victum aut alios usus Monachorum spectant. — Du Cange Gloss.
|
«In
festivitate quoque ipsius sancti scilicet Nicholai videns quia nominati
fratres jam data honorifice construebant, donum adauxi scilicet presbiteratus
de Eclimonte et decimam culturarum mearum ubicumque erunt vel fuerint
et vinearum que habebam vel habiturus eram et forum totum quod vulgù
fera dicitur in festivitate ipsius sancti. Nec non apud Galardonem aream
molendini que Revacallis nuncupatur; in castello quoque jam dicto
Alneello scilicet quicquid babetur a porta que respicit Sanctum Romanum
et ab officinis fratrum et domos et ortos usque ad aquam. Hii affuerunt testes:
Robertus filius Gasthonis. Guillelmus dapifer. Marinus prefectus. Harduinus
de Danovilla. Osmundus de Alneel. Haimericus arbalestarius
et filius ejus Ansoldus. Ingelbertus de Bunena villa. Johannes de
Sclimonte. Odo de Danovilla. Seguinus frater Roberti
filii Gastonis. Gaufridus filius Milesendis. Guido de Barzileriis.
Durcardus de Ursunvilla. Gaufredus Goignart. Radulphus ex Puteo.
Albericus coquus. Ascelinus de Pomerio. Garinus et Guido fratres
mei cum quibus tunc signo crucis cartulam firmavi.»
|
|
Cependant le prieuré prospérait; Hugues voyant que les religieux
passaient les jours et les nuits dans les exercices de dévotion et
du culte divin, désira en augmenter le nombre afin d’avoir une plus
grande part dans leurs prières. A cet effet il leur lit encore de
nouvelles donations, savoir: la dixième partie des revenus de son péage
à Auneau et à Gallardon; la dîme du marché à
Gallardon et des deux fours qu’il y possédait; la terre d’une charrue
à Voise:
|
|
«Deindè videns monachos a supra scripta Deo devota congregatione
apud nos jam devotos regulariter jam degere, Deoque ut pote a tanta concione
bene extrados in hymnis et laudibus die noctuque [p.97] deservire, ut talium
numerus quorum me credebam plurimum posse adjuvari precibus, adaugeretur,
unde plures vite necessaria haberent donavi. Scilicet de quatuor redditibus
quos habebam, vulgariter pedagia nominales, decimam partem. Redduntur autem
apud Alneellum et apud Hildopontem et apud Lumret et
apud Galardonem. In ipso quoque castello Galardonis dedi decimam
mercatum [pour mercati? (B.G.)], et de duobus
furnis quos inibi habebam cariorem propre domum Nivelonis situm; tali videlicet
tenore quatinus mater mea, dum advixerit, fructus indè colligat, si
vivens eis concedere noluerit voluntate spontanea. Dedi et apud Veosiam
unius carruge terram. Testes ex parte mea: Guido frater meus. Marinus prefectus.
Herveius filius Petri. Herveius balistarius. Seguinus et Ansoldus de Sanctiul.
Robertus de Danonvilla. Osmundus miles. Garinus Villanus. Johannes de Sclimonte.
Germundus de Sclimonte. Nivelo filius Germundi. Ex parte eorum: Guido
de Barzileriis. Hugo filius Fulchoini. Isembardus Mariscalcus. Teudo de
Nemore. Albericus quoquus. Gaufredus Mariscalcus.»
|
|
Une autre libéralité fut encore faite par Hugues au prieuré
d’Auneau, à l’occasion d’une guérison miraculeuse due à
l’intercession de Saint-Rémy. Ce pieux seigneur nous raconte ainsi
le fait:
«Le jour de la fête du saint confesseur,
pendant qu’on célébrait une messe solennelle en son honneur,
on apporta dans un petit charriot un malade dont le pied était,
depuis trois semaines, dévoré par le feu sacré
(1). Il resta ainsi couché jusqu’aux
vêpres implorant le secours de Dieu par les mérites du saint,
et il recouvra aussitôt la santé. En apprenant cette cure
merveilleuse, moi Hugues j’accourus tout joyeux [p.98] et je fis don au
précieux confesseur de la terre d’une charrue de labour, savoir
de deux bœufs à Soulaires et de deux autres bœufs à Voise.
En signe d’investiture (1) Guillaume, fils
de Rotald, déposa un couteau sur l’autel:
|
(1) Maladie pestilentielle (espèce d’érésipèle)
connue aussi sous le nom de feu Saint-Antoine, feu de Saint-Fiacre,
mal de Saint-Marcou, de Saint-Main et des Ardents.
Les symptômes de cette maladie qui ravagea en 945 et en 1130 la France
et l’Allemagne, étaient une soif brûlante qu’aucun remède
ne pouvait apaiser. On eut recours à la châsse de Sainte-Geneviève,
qui, au dire des chroniqueurs, arrêta les progrès de la maladie.
(1) La transmission
de la propriété n’était entièrement accomplie
qu’après la célébration de la cérémonie
appelée investiture, qui répondait à la mancipation
romaine. L’insvestiture [sic], qui ressemble
à la saisine actuelle, mettait la chose dans les mains du nouveau
propriétaire, qui auparavant la possédait de droit et non
de fait. La tradition ou ensaisinement consistait dans la remise d’un objet
quelconque à la personne à laquelle on transmettait la propriété.
— Les Mém. de la Société archéologique d’Eure-et-Loir
contiennent un spécimen d’investiturée [sic] au Moyen-Age. — Tom. III p. 135.
|
«In alia quoque festivitate prescripta confessoris, dum missa celebraretur
solemnis, allatus est quidam in redula nimis anxius, cujus pedem tribus ebdomadibus
consumpserat ignis divinus, qui usque ad vesperas inibi adjacens
ipsius sancti auxilium attentius deposcens, Domino quantum apud se ipsius
sancti possent merita demonstrante, subito curatus est. Cujus curationem ego
Hugo audiens, letus adveni, atque precioso confessori terram cultui unius
Karruge sufficientem per cultellum Willelmi filii Rotaldi donavi, apud villam
que dicitur Solaris duorum boum, et apud Voesiam duorum. Testes
Guillelmus Rotaldi. Vulgrinus pelliciarius. Odo pistor de famulis monachorum.
Tebaldus de Pometo. Radulphus de Puteo. Stephanus carpentarius.»
|
|
Enfin Hugues étant sur le point d’aller visiter le Saint-Sépulcre
à Jérusalem, après avoir recommandé à
ses fidèles ses châteaux et sa fille unique Mathilde, du consentement
de cette dernière, d’Agnès sa femme, et de Guérin
son frère, confirma aux religieux de Bonneval toutes les donations
ci-dessus détaillées; il y ajouta deux clos de vignes qu’il
avait à Gallardon et une charrue de terre à Anneau:
|
|
«Dominicum quoque sepulchrum Jerosolymis petiturus, audientibus quibus
ipso die, castella mea et filiam meam commendavi meis [p.99] fidelibus, Garino quoque fratre meo et uxore
mea Agnete atque unica mea Mahildi audientibus et concedentibus, cunctaque
Bonevallensibus fratribus diversis temporibus diversa per loca donaverant
queque eorum caria quam habebat presens abbas Robertus in manibus continebat
recitatis, duo clausa vinearum que apud Galardonem via publica dividit
eis adauxi; videlicet post meum obitum alterum et presentialiter alterum.
Apud Alneelum quoque post me habendum illis meam propriam carrucam
donavi cum omni apparatu et omnibus illius culturis. Hoc autem totum ut jam
predixi, Garinus frater meus cum uxore mea et filia mea que inde ob memoriam
rei geste, ut pote parvula, unum denarium de abbate accepit, ad hoc enim
eos convocaveram, audientibus testibus subscriptis, concessit. Testes: Robertus
Gathonis. Isnardus de Gaiis. Drogo Alberti. Gaufridus Haganonis et Radulfus
frater ejus. Guillelmus de Sancto-Piato. Guillelmus Gauffridi Strabonis.
Robertus nigro dorso. Garnerius de Sancto Hylario. Guillelmus Rotaldi. —
Hoc autem meum beneficium meis annuens precibus, comes de Petra-forti,
Guido nomine, de cujus fevo erat, cum uxor sua concessit. Testes: ego ipse,
Urso- Ursonis filius, Simon Neelfa (1).»
|
|
Comme tout bien patrimonial était censé appartenir à
la famille, c’est-à-dire, non-seulement à l’individu qui le
possédait actuellement, mais encore à tous ceux auxquels il
pouvait échoir un jour par héritage, on avait soin, dans les
donations et dans toutes les aliénations en général,
de les faire approuver par tous les parents, souvent, pour obtenir leur approbation,
quelques présents étaient nécessaires. On en distribuait
aussi aux enfants; car leur consentement ne leur était pas moins demandé,
même lorsqu’ils étaient à la mamelle. C’est ainsi que,
dans la charte qui précède, nous voyons l’abbé de Bonneval
donner un [p.100] denier à la petite fille de Hugues, en mémoire
de la libéralité de son père. Le consentement du seigneur
suzerain de la terre et même de ses enfants, était aussi demandé:
c’est pourquoi la donation de Hugues fut approuvée par Guy, comte
de Rochefort, en présence de témoins.
[Nous ne reprenons pas ici
la suite, qui concerne Jocelyn d’Auneau, vers 1160 (B.G.)].
|
(1) Chart. orig. Titres du prieuré d’Auneau
— Arch. départ. d’Eure-et-Loir — Cette longue charte énumérant
les libéralités de Hugues, est sans date, mais nous croyons
pouvoir la placer vers 1100, année de l’élection de Robert,
abbé de Bonneval.
|
Éditions
1) Édouard
(Pierre-Édouard-Alexandre) LEFÈVRE
(ancien chef de division à la Préfecture
d’Eure-et-Loir, historien de la Beauce, membre
correspondant du Comité des travaux historiques
et scientifiques et de plusieurs sociétés
savantes, historien de la Beauce), «Le Prieuré
d’Auneau», in ID., Documents historiques
et statistiques sur les communes du canton d’Auneau
arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir)
[2 volumes in-16, ou in-12; extrait de l’Annuaire d’Eure-et-Loir
(1867) & (1868)], Chartres, Garnier, 1867-1869,
tome 1 (1867), pp. 94-100.
2) Bernard
GINESTE [éd.], «Édouard Lefèvre:
Donation d’Hugues de Gallardon au prieuré d’Auneau
(1867)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe08c,
2008.
|
ANNEXE 8d
Guy de Gallardon approuve une donation de ses frères
Hugues et Garin
Donation de la terre
de Voise à Auneau, après 1096
Notice de l’édition
de 1905
|
Notice de l’édition
de 1912
|
| LXXXV [fol. XL]. (Vers 1105) |
77. (Après 1096)
|
|
Gui de Gallardon approuve
le don de la terre de Voise, fait par Hugues
et Guérin, ses frères, et de la
terre de Boulonville.
|
Gui de Gallardon approuve
le don de la terre de Voise, fait par Hugues et
Guérin, ses frères, et de la
terre de Boulonville.
|
|
A.
Original perdu.
B.
Copie de 1118, Liber
Testamentorum, fol. 40, n°85.
|
N.B. Je suis ici le texte de l’édition
de 1912, qui est meilleur que le
précédent (pas de virgule
après requisitione,
suppression de la correction arbitraire de
terram en terrae, pas de
point entre Ursionisvilla et ne, etc.), sauf
pour la coquille posterorum,
coquille propre à l’édition
de 1912 pour posteriorum, sans
parler de la mauvaise saisie Gurbivilla de l’édition
en ligne de l’École des Chartes, édition
d’autant plus méritoire qu’on peut
la corriger soi-même à l’aide de l’édition
en mode image (B.G.)
Notes de l’édition
de 1905
|
Texte de l’édition
de 1912
|
Notes de l’édition
de 1912
|
(397) [p.102] Le nom
manque dans le texte, d’ailleurs
très étourdiment transcrit.
Par l’énoncé des témoins,
on voit que l’une des parties en cause se nomme
Gui. — II faut donc ajouter à
Hugues et Guérin,
fils d’Hervé et frères
de la B. Hildeburge mariée à
Robert d’Ivry, deux autres frères:
Gui et Milon,
archidiacre de l’église de Chartres
en 1100. Voir notice LXXX.
(384) [p.98] Gallardon,
c. Maintenon, a. Chartres. — Guérin
de Gallardon avait pour père Hervé
I, seigneur de Gallardon; pour sœur la B. Hildeburge,
religieuse à Saint-Martin de Pontoise après
avoir été mariée à Robert
d’Ivry; pour frère Hugues I, sire de Gallardon,
avec lequel il partit pour Jérusalem en
1096 (Ms. lat. 17139, fol. 61). Il succomba dans le cours du
voyage. Mabile, sa veuve, dont il n’avait pas eu d’enfants,
se remaria à Aimon Le Roux, d’Etampes.
Hervé
I, père de Guérin,
était fils d’Herbert, sire de Gallardon,
qui donna à St-Père de Chartres,
du temps d’un abbé homonyme (1067-1074),
des biens en Dunois lui venant de sa mère
Retrude. Celle-ci était veuve d’Ansoud II
Le Riche de Paris, frère d’Herbert, évêque
d’Auxerre et fils d’Ansoud I et de Raingarde,
ancienne maîtresse du duc Hugues-le-Grand.
La
terre de Gallardon appartenait antérieurement,
avec celles de Bouafle et de Thimert,
à Aubert Le Riche, neveu d’Anne,
abbé de Jumièges. Aubert épousa
Hildeburge de Bellême dont il eut
Aubert II, Guérin et Teudon. Aubert II ne
laissa que des filles. L’aînée, Froheline,
porta Thimert à son mari Gasce; la seconde, qui
épousa Herbert de Paris, eut en dot Gallardon.
(404) [p.103] Hugues fils de Guinemar de Lavardin,
beau-frère de Nivelon III
de Fréteval.
(398) [p.102]
En marge: Beausse.
— Voise, c. Auneau, a. Chartres. |
Notum sit omnibus
per succedentia tempora quod ego (397) (192)
de Gualardone (384) (188), pro anima patris mei et
fratrum et mea, concessi monachis de Sto Martino, absque alicujus
pacti requisitione, quietam, assensu fratris
mei domni Milonis archidiaconi (404) (192), terram de Veosia (398) (193)
quam donavit illis Hugo frater meus,
et Warinus concessit;
|
(192) [p.125] Le nom manque dans le texte,
transcrit à l’étourdie. On
voit, par l’énoncé des témoins,
que l’une des parties en cause se nomme
Gui. — Il faut donc ajouter à Hugues et Guérin,
fils d’Hervé et frères de la B.
Hildeburge mariée à Robert d’Ivry, deux
autres frères: Gui et Milon, archidiacre
de l’église de Chartres en 1100 (Luchaire,
Louis VI, p. 330). Gui de Gallardon
est encore cité dans un texte de 1119 comme témoin
de la dédicace de Morigny (Ib., no
264).
(188) [pp.123-124] Gallardon, ca. Maintenon, ar. Chartres. — Guérin
de Gallardon avait pour père
Hervé I, seigneur de Gallardon;
pour sœur la B. Hildeburge, religieuse à Saint-Martin
de Pontoise après avoir été
mariée à Robert d’Ivry; pour
frère Hugues I, sire de Gallardon, avec lequel
il partit pour Jérusalem en 1096 (Ms. lat. 17139,
fol. 61). Il succomba dans le cours du voyage. Mabile,
sa veuve dont il n’avait pas eu d’enfants, se
remaria à Aimon le Roux, d’Etampes.
Hervé
I, père de Guérin, était
fils d’Herbert, sire de Gallardon, qui
donna à St-Père de Chartres, du
temps d’un abbé homonyme (1067-1074), des
biens en Dunois lui venant de sa mère Retrude.
Celle-ci était veuve d’Ansoud II le Riche de
Paris, frère d’Herbert, évêque
d’Auxerre et fils d’Ansoud I et de Raingarde (Voir
note 6).
La terre de
Gallardon appartenait antérieurement,
avec celles de Bouafle et de Thimert,
à Aubert le Riche, neveu d’Anne,
abbé de Jumièges. Aubert épousa
Aubour (Hildeburgis) de Bellême
dont il eut Aubert II, Guérin et Thion,
Aubert II ne laissa que des filles. L’aînée,
Froheline, porta Thimert à son
mari Gasce; la seconde, qui épousa Herbert de Paris,
eut en dot Gallardon (Append. au
Cartul. de St-Martin de Pontoise,
p. 469).
(193) [p.125] En marge: Beausse. — Voise, ca. Auneau,
ar. Chartres.
|
(399) [p.102]
En marge: Bolonville.
— Boulonville, éc. Sainville,
c. Auneau, a. Chartres.
(a) [p.102] Ms.
terram.
(400) [p.103] Il faut
suppléer ici Gaufredus,
comme on le verra plus bas dans la liste
des témoins, où figurent les trois
fils de Geofroi: Guillaume, Aubert et Gui.
Ce Geofroi est sans doute un cadet de la famille,
car un Aubert de Gallardon fut père de Dreux,
qui avec ses fils Guérin et autres fit une cession
à Bellomer au xiie siècle (Ms. fr.
24133, p. 301).
(401) [p.103] Gautier
Postel souscrit à un jugement
de la cour du roi à Poissy en 1082
(LL 1024, fol. 40). Sa mère était
sœur de Gilbert et fille d’Ours qui céda ses
droits sur l’église de Sausseux à
St-Père de Chartres (Guérard,
Cart., p. 165).
Ce surnom nous
semble la contraction d’une forme primitive
qu’on trouve dans un acte voisin de l’année
1060: «S. Guidonis
Apostoli et Gausberti fratris ejus».
Gui Apostole (Apostolus, Pape) et son frère
sont témoins d’une charte du vicomte
de Chartres, Ebrard I (Coll. Moreau,
XXXI, 156).
(402) [p.103] Guillaume,
l’aîné des fils de Geofroi,
et qui lui avait succédé
comme seigneur féodal de Boulonville.
|
terram [terrae dans l’édition
de 1905] (a) etiam de Bolonvilla
(399) (194) cum silva et omnibus
ad eam pertinentibus, — cujus medietatem [Gaufredus]
(400) (195) dedit eis, factus apud eos
monachus, concedentibus filiis suis Willelmo,
Alberto, Widone, — aliam medietatem dedit eis Adeliza
filia Walterii Postelli (401)
(218), concedente Willelmo,
de cujus fevo erat (402)
(196): sic fratres
mei Hugo et Warinus concesserant solutam
ab omni consuetudine, et quietam eis concessi.
|
(194) [p.125] En marge: Bolonville.
— Boulonville, éc.
Sainville, ca. Auneau, ar. Chartres.
(195) [p.125] Il faut suppléer ici "Gaufredus",
comme on le verra plus bas dans la liste des témoins,
où figurent les trois fils de Geofroi: Guillaume,
Aubert et Gui. Ce Geofroi est sans doute un cadet de
la famille, car un Aubert de Gallardon fut père
de Dreux, qui avec ses fils Guérin et autres fit une
cession à Bellomer au xiie siècle (Ms. fr. 24133,
p. 301).
(218) [p.136] C’est Albericus
Ternellus de Pissiaco
(Tornellus d’après une copie
de D. Estiennot), cité dans une notice
comme accompagnant, à Pontoise, Louis-le-Gros
(né en 1081) encore enfant (Ludovicus
puer), vers 1093: Cf. Cartul.
de St-Martin de Pontoise, p. 25; la note 153 est
à rectifier, l’orthographe Ternellus
étant constante depuis le XIIe siècle
(Ib., Appendices, p. 430). — Dans la notice
126 ce personnage est dénommé
Albericus Terneldus.
(196) [p.125] Guillaume, l’aîné
des fils de Geofroi, lui succéda
comme seigneur féodal de Boulonville.
|
(403) [p.103]
Arnaud, neveu de Constance de Bagneux,
fut prieur de Janville au début
du xiie siècle (note 44
[ci-dessous] et
notice XXVII), puis prieur de St-Martin;
Gautier était en 1096 chambrier du monastère
(note 65 et notice LXXXVI). — Habert de
Roinville et Ebroin d’Orsonville sont aussi des
moines de St-Martin; ils portent le surnom des prieurés
qu’ils administrent.
(64) [p.16] Orsonville,
c. Dourdan, a. Rambouillet. La cure de cette
paroisse, comprise dans le doyenné de Rochefort,
était à la nomination du prieur
de St-Martin-des-Champs.
|
Hæc autem
concessio, facta in manu monachorum Sti Martini,
Arnaldi scilicet subprioris
(403) (197), Walterii camerarii,
Hauberti de Roenvilla (39),
Ebroini de Ursionisvilla (64) (173),
ne vetustate
temporis, a memoria posteriorum possit aboleri,
consensi eis ut litteris annotaretur, et
in capitulo Stæ Mariæ Carnotensis legeretur
et confirmaretur.
|
(197) [p.125] Arnaud, neveu de Constance
de Bagneux, fut prévôt
de Gouillons puis sous-prieur de St-Martin;
Gautier était en 1096 chambrier du monastère.
— Habert de Roinville et Ebroin d’Orsonville
sont aussi des moines de St-Martin ils portent
le surnom des prieurés qu’ils administrent.
(39) [p.41] Roinville, ca. Dourdan,
ar. Rambouillet (Seine-et-Oise).
(173) [p.111] Orsonville, ca. Dourdan,
ar. Rambouillet. La cure de cette
paroisse, comprise dans le doyenné
de Rochefort, était à la nomination
du prieur de St-Martin-des-Champs, La donation
d’Orsonville (terre, église et dépendances)
est confirmées dans la bulle
du 14 juillet 1096.
|
(190) [p.43]
Gauslin III de Lèves
eut d’Eudeline deux fils, Gauslin
IV et Geofroi (Coll. Moreau, XXV, 29. Cf.
n°VI suprà et n°XXXIX).
— Ces notices ont échappé à
MM. Merlet et de Clerval qui ont confondu divers
anneaux de la généalogie des seigneurs
de Lèves (Un manuscrit chartrain
du XIe siècle).
(404) [p.103] Hugues
fils de Guinemar de Lavardin, beau-frère
de Nivelon III de Fréteval.
(405)
[p.103] Courville, a.
Chartres.
(44) [p.10] Guillaume
était encore archidiacre de Dreux,
le 16 août 1100 (Luchaire,Louis
VI, 330).
(406) [p.] Milon
était archidiacre le 16 août
1100 (Luchaire,Louis VI, p. 330).
(400) [p.103]
[Voir ci-dessus]
|
Ex utraque
autem parte hi testes affuerunt: ex parte Widonis,
Rainaldus filius Walterii; Willelmus filius
Gaufredi, et fratres ejus Wido et Albertus;
Walterius de Travucello. Ex parte autem monachorum
Sti Martini, Gauslenus de Leugis (190) (37), Hugo filius Guinemari
(404)
(115), Paganus filius Duranni,
Paganus [de] Curbivilla
(405) (48). De capitulo autem
Beate [Mariæ] hi fratres interfuerunt: Willelmus
archidiaconus (44), Ebrardus capicerius,
Milo archidiaconus
(406) (192), Winebertus, Radulfus,
Ansgerius, Rotbertus, Willelmus filius Haimonis,
Radulfus de Curbivilla (400) (38); Rotbertus et Hugo, ambo
sacristes. |
(37) [p.41] Gauslin Ier Le Riche, mari d’Humberge,
souscrit, en 1048, un diplôme
de Henri Ier sous cette forme: "Signum Gauslini
casati Carnotensis". (Lucien Merlet,
Cartulaire de N.-D. de Chartres, I,
90), Gauslin II épousa Ade qui en 1045
était encore unie à son premier
mari, le vidame de Chartres Hugues Ier, Gauslin III
mari d’Eudeline, et Aubert II fils du vidame Hugues,
étaient donc frères utérins.
(115) [p.83] Nivelon III de Fréteval,
marié à
une fille de Guaimar de Lavardin, nièce,
par Marie sa mère, d’Engebaud
Le Breton de Vendôme et de Barthélémi,
archevêque de Tours qui mourut en 1067 (Cf.
ms. lat. 17129, fol 305). — Les moines de Cluny
occupent déjà St-Martin lors de cette
donation, elle est donc de 1079 au plus tôt.
— Hugues, beau-frère de Nivelon III,
est cité dans une notice postérieure
à 1096 (n°77).
(48) [p.43] La collégiale de St-Nicolas de Courville,
ar. Chartres. Le surnom de
Cotelle a été porté
par un des Ives seigneurs de Courville.
(192) [p.125] [Voir ci-dessus.]
(38) [p.41] Renaud, vidame de Chartres,
eut trois fils de sa femme Ode: Aubert, mort
le 10 juillet 1032, Hugues I, qui le remplacèrent
successivement, et Haudoin, chanoine de
Chartres. Hugues était marié dès
1045 à Ade ou Adèle, dont il
eut trois fils: Guerri, Hugues, Aubert II (Cart,
de Marmoutier pour le Dunois, p. 33). Il prit
part au siège de Thimert en 1059. Guerri succéda
directement à son père (Guérard,
Cart. de St-Père
de Chartres, p. 212); il était en charge
en 1063. Hugues fut clerc. Aubert II suivit en Angleterre,
en 1066, Guillaume le Conquérant (Merlet et de
Clerval, Un manuscrit chartrain du XIe siècle,
p. 117).
|
Texte
donné par Depoin (1905 et 1912)
|
Traduction
proposée par Gineste (2008)
|
Notum sit omnibus per succedentia
tempora quod ego [...] de Gualardone, pro
anima patris mei et fratrum et mea, concessi monachis
de Sto Martino, absque alicujus pacti requisitione,
quietam, assensu fratris mei domni
Milonis archidiaconi, terram de Veosia quam donavit
illis Hugo frater meus, et Warinus concessit.
|
Qu’il soit connu de tous dans la suite
des temps que moi [Guy] de Gallardon,
pour le salut des âmes de mon père,
de mes frères et de la mienne, j’ai
autorisé les moines de saint Martin,
sans en avoir été requis par aucune
des parties, à jouir paisiblement, avec
l’accord de mon frère monsieur l’archidiacre
Milon, de la terre de Voise que leur a donné
mon frère Hugues, avec l’accord de Garin.
|
Terram etiam de
Bolonvilla cum silva et omnibus ad eam pertinentibus,
— cujus [Gaufredus] medietatem dedit eis,
factus apud eos monachus, concedentibus filiis
suis Willelmo, Alberto, Widone, — aliam medietatem
dedit eis Adeliza filia Walterii Postelli,
concedente Willelmo, de cujus fevo erat. Sic fratres
mei Hugo et Warinus concesserant solutam ab omni consuetudine,
et quietam eis concessi.
|
La terre de Boulonville,
y compris sa forêt et toutes ses appartenances,
dont [Geoffroy] leur avait donné la moitié
lorsqu’il s’était fait moine parmi eux avec
l’accord de ses fils Guillaume, Aubert et Guy,
Alais fille de Gautier Postel leur a donné la
deuxième moitié, avec l’accord de Guillaume
de qui c’était le fief. De même
que mes frères Hugues et Garin en avaient concédé
la donation en l’affranchissant de tout droit
coutumier, de même je leur ai concédé
d’en jouir paisiblement.
|
Hæc autem concessio
facta in manu monachorum Sti Martini, Arnaldi
scilicet subprioris, Walterii camerarii, Hauberti
de Roenvilla, Ebroini de Ursionisvilla,
ne, vetustate temporis, a memoria
posteriorum possit aboleri, consensi eis ut
litteris annotaretur, et in capitulo Stæ
Mariæ Carnotensis legeretur et confirmaretur.
|
Et pour que cette concession opérée
dans la main des moines de saint
Martin, à savoir du sous-prieur
Arnaud, du chambrier Gautier, d’Aubert de Roinville
et d’Évroin d’Orsonville, ne puisse sous
l’effet du temps qui passe, s’effacer
de la mémoire de nos successeurs, j’ai
accepté que cela soit mis par écrit, et
que cela soit lu et confirmé lors d’une réunion
du chapitre de Notre-Dame de Chartres.
|
| Ex utraque autem parte
hi testes affuerunt: ex parte Widonis, Rainaldus
filius Walterii; Willelmus filius Gaufredi,
et fratres ejus Wido et Albertus; Walterius de Travucello.
Ex parte autem monachorum Sti Martini, Gauslenus
de Leugis, Hugo filius Guinemari, Paganus filius Duranni,
Paganus [de] Curbivilla. De capitulo autem Beate [Mariæ]
hi fratres interfuerunt: Willelmus archidiaconus, Ebrardus
capicerius, Milo archidiaconus, Winebertus, Radulfus,
Ansgerius, Rotbertus, Willelmus filius Haimonis, Radulfus
de Curbivilla; Rotbertus et Hugo, ambo sacristes [sic]. |
Et voici les témoins de
chacune des parties
qui y ont assisté.
Du côté de Guy: Rainaud fils
de Gautier; Guillaume fils de Geoffroy et ses
frères Guy et Aubert; Gautier
de Travucello. Et du côté
des moines de saint Martin: Jocelin de Lèves;
Hugues fils de Guignemard; Payen fils de Duran
Payen de Courville. Et voici
les frères du chapitre de Notre-Dame
qui s’y trouvèrent présents: l’archidiacre
Guillaume; le chevecier Ébrard; l’archidiacre
Milon; Guignegert; Raoul; Angier; Robert; Guillaume
fils d’Aimon; Raoul de Courville; Robert et Hugues,
tous deux sacristains (?).
|
Éditions
1) COÜARD
(archiviste du département de
Seine-et-Oise), Joseph DEPOIN (secrétaire
général de la Société
historique du Vexin), DUTILLEUX
(secrétaire général de
la Commission des Antiquités et des Arts),
DUFOUR (secrétaire général
de la Société historique de
Corbeil-Étampes), LORIN (secrétaire
général de la Société
historique de Rambouillet) [éd.],
Liber testamentorum Sancti Martini de Campis.
Reproduction annotée du manuscrit de la
Bibliothèque nationale [in-8°; XV+124
p.], Paris, A. Picard & fils [«Publications
de la conférence des Sociétés
historiques du département de Seine-et-Oise»],
1905, pp. 102-103.
Dont une réédition
numérique à
la fois en mode image et en mode texte par
l’École nationale des Chartes sur son
site Elec:
1b) ÉCOLE
DES CHARTES [éd.],
Liber testamentorum Sancti Martini
de Campis, in ID., ELEC
(site web) [«Cartulaires numérisés
d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page102/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page103/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/acte86/
(en mode
texte), en ligne en 2008.
2) Joseph
DEPOIN (1855-1924), Recueil de chartes
et documents de Saint-Martin-des-Champs,
monastère parisien. Tome I [premier
de 5 volumes in-4°], Chevetogne
(Belgique), Abbaye de Ligugé &
Paris, Jouve & Cie [«Archives de
la France monastique» 13, 16, 18, 20, 21], 1912-1921,
tome I (1912), pp. 125-126.
Dom Jean BECQUET (1917-2003),
Recueil de chartes et documents
de Saint-Martin-des-Champs, monastère
parisien, par J. Depoin: Index par dom Jean
Becquet [25 cm; 70 p.], Ligugé,
Revue Mabillon [«Archives de la France monastique»
51], 1989.
Dont une réédition
numérique à la
fois en mode image et en mode texte par
l’École nationale des Chartes sur
son site Elec:
2b) ÉCOLE DES CHARTES
[éd.], Liber testamentorum
Sancti Martini de Campis, in ID.,
ELEC (site web) [«Cartulaires
numérisés d’Île-de-France»
11], http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page125/
(en mode
image), http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps/page126/
(en mode
image) & http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps1/acte79/
(en mode texte), en ligne en 2008.
3) Bernard
GINESTE [trad. & éd.], «Guy
de Gallardon approuve une donation de ses frères
(après 1096)», in ID. [éd.], «Thion
Chef-de-Fer: Notices concernant Vierville
(fin XIe siècle)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html#annexe08d,
2008.
SOMMAIRE
|
Sur
ce texte
1)
Textes originaux: Deux parchemins
conservés aux Archives départementales
de l’Eure-et-Loir sous la cote H 2254.
2) Édition et traduction partielles: Édouard (Pierre-Édouard-Alexandre) LEFÈVRE
(ancien chef de division à
la Préfecture d’Eure-et-Loir,
historien de la Beauce, membre correspondant du Comité
des travaux historiques et scientifiques et
de plusieurs sociétés savantes, historien
de la Beauce), «Vierville», in ID.,
Documents historiques et statistiques sur les
communes du canton d’Auneau arrondissement de Chartres
(Eure-et-Loir) [2 volumes in-16, ou in-12; extrait
de l’Annuaire d’Eure-et-Loir (1867) & (1868)],
Chartres, Garnier, 1867-1869, tome 1 (1867), pp. 295-301,
spécialement pp. 297-299 [le texte est daté
d’avant 1080, ce qui ne se peut guère; deux erreurs de
lecture seulement].
Bernard GINESTE
[éd.], «Édouard Lefèvre:
Vierville (1867)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-edouardlefevre1867vierville.html,
2008.
3) Analyse:
René MERLET, Inventaire
sommaire des archives
départementales antérieures
à 1790, rédigé
par M. René Merlet,... Eure-et-Loir.
Archives ecclésiastiques. T. VIII.
Série H, tome I [grand in-4°],
Chartres, Garnier, 1897, sous la cote H. 2254.
4) Note un peu
confuse de Charles MÉTAIS (1855-1912), Cartulaire
de Notre-Dame de Josaphat [2 volumes; LXII+400 & 448
p.], Chartres, Garnier, 1911-1912, t. 1, p. 37, n. 1.
Un Lisiard d’Étampes fut témoin de la donation
faite à Marmoutier par Gautier d’Aunay et Milesende, sa
femme, de la terre de Vierville. Cet acte fut passé à
Saint-Avit, dans la laison dudit Gauthier, en présence de
Teudon Tête-de-Fer, père de Milesende, et d’Hardouin
Tête-de-Fer, son frère. Teudon et Hardouin s’étaient
faits moines [confusion, Hardouin n’étant
pas moine (B.G.)], et ce dernier résidait dans le
prieuré de Chuisnes. L’acte fut également approuvé
par Guillaume fils de Bernoal d’Étampes alors abbé
de Sainte-Marie d’Étampes [confusion
entre deux Bernoal, le premier père de Guillaume, et le deuxième
abbé de Notre Dame (B.G.)], témoins: Herbert
de Denonville, Amaury le Roux d’Ablis, Hugues de Gallardon, Marin, prévôt
d’Auneau [en fait les deux premiers
sont témoins à Étampes, et les deux autres Auneau
(B.G.)]. XIIe siècle [ou plutôt XIe (B.G.)] (Archives
départementales d’Eure-et-Loir).
|
4) Édition intégrale
critique et annoté: Bernard GINESTE,
«Thion Chef-de-Fer: Notices
sur Vierville (vers 1090)» in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-11-vierville.html,
2008.
Sur
Vierville
Lucien
MERLET, Dictionnaire topographique du
département d’Eure-et-Loir comprenant
les noms de lieu anciens et modernes, rédigé
sous les auspices de la Société
archéologique du Loiret [255 p.],
Paris, Imprimerie impériale, 1861.
Dont une réédition
numérique mise en ligne par
Google.
Édouard
(Pierre-Édouard-Alexandre) LEFÈVRE
(ancien chef de division à la Préfecture
d’Eure-et-Loir, historien de la Beauce, membre
correspondant du Comité des travaux historiques
et scientifiques et de plusieurs sociétés
savantes, historien de la Beauce), «Vierville»,
in ID., Documents historiques et statistiques
sur les communes du canton d’Auneau arrondissement de
Chartres (Eure-et-Loir) [2 volumes in-16, ou in-12; extrait
de l’Annuaire d’Eure-et-Loir (1867) & (1868)],
Chartres, Garnier, 1867-1869, tome 1 (1867), pp. 295-301,
spécialement pp. 297-299 [le texte est daté
d’avant 1080, ce qui ne se peut guère; deux erreurs de
lecture seulement].
Dont une
réédition numérique en
mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Édouard
Lefèvre: Vierville (1867)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-edouardlefevre1867vierville.html,
2008.
Alneellum.
Le passé du canton d’Auneau
révélé par l’archéologie
[revue], Coudray-au-Perche, 1978-?
[non consulté pour l’instant].
Raymond BOUQUERY [dir.],
Les noms de lieux en Eure-et-Loir (Microtoponymie). XI. Canton
d’Auneau (28 1 02). Ouvrage publié sous l’égide de la Société
alnéloise d’archéologie et d’histoire locale [folios dactographiés],
Chartres, Hélio Plans, 1998, item n°1712. «1712. La Têtière
à Tureau. — Champtier avec une levée de bout marquée,
la Têtière, bien connue des laboureurs, où il tournaient
la charrue. Tureau en était-il le possesseur?»
Autre
charte
conservée aux Archives d’Eure-et-Loir
concernant le prieuré
de Bréthencourt.
René MERLET,
Inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790, rédigé
par M. René Merlet,...
Eure-et-Loir. Archives ecclésiastiques.
T. VIII. Série H, tome I
[grand in-4°], Chartres, Garnier, 1897.
|
H.2261
v.1090.
— Confirmation par Simon, comte d’Évreux,
Simon, comes Ebroicensis,
d’un accord fait entre Aimery Sans-Nappes,
Haimericus Sine Napa,
et Geoffroy de Balae, prieur de Bretencout,
Godefredus de Balae, prior de Bertolcor,
pour un moulin sis en la censive du
prieuré et acheté par le dit
Aimery (v. 1090).
|
Sur Marmoutier
et
ses prieurés au Moyen Age: quelques
pistes bibliographiques
 Louis BOUDAN (attribué au
dessinateur), Veüe de l’Abbaye
de Marmoustier Lez Tours, de l’ordre de St
Benoist, Congrégation
de St Maur [aquarelle; feuille de 43,5
cm sur 55,3 cm; aquarelle de 40 cm sur 52],
conservé à la BNF [n°5291
de l’ Inventaire des dessins exécutés
pour Roger de Gaignières (1642-1715)
et conservés aux départements
des estampes et des manuscrits par Bouchot
Henri, Paris, 1891, t. 2], vers 1699.
Louis BOUDAN (attribué au
dessinateur), Veüe de l’Abbaye
de Marmoustier Lez Tours, de l’ordre de St
Benoist, Congrégation
de St Maur [aquarelle; feuille de 43,5
cm sur 55,3 cm; aquarelle de 40 cm sur 52],
conservé à la BNF [n°5291
de l’ Inventaire des dessins exécutés
pour Roger de Gaignières (1642-1715)
et conservés aux départements
des estampes et des manuscrits par Bouchot
Henri, Paris, 1891, t. 2], vers 1699.
D. E. B. P. E. M. B. D. L. C.
D. S. M. (Dom Étienne Badier,
prêtre et moine Bénédictin
de la congrégation de Saint-Maur),
La Sainteté de l’état
monastique, où l’on fait l’histoire
de l’abbaye de Marmoutier et de l’église
royale de S.-Martin de Tours, depuis leur
fondation jusqu’à notre temps, pour
servir de réponse à la "Vie de
S. Martin", composée par M. l’abbé
Gervaise [in-12], Tours, J. Barthe, 1700.
UN MAURISTE [religieux bénédictin
de la congrégation
de Saint-Maur], «L’abbaïe
de Marmoutier près de Tours»
& «Albert abbé
de Marmoutier» [abbé de 1034 à 1064], in Histoire littéraire de la France, où
l’on traite de l’origine et du
progrès, de la décadence
et du rétablissement des sciences parmi
les Gaulois et parmi les François....
Tome VII, Qui comprend le onzième siècle
de l’Eglise, par des religieux bénédictins
de la Congrégation de S. Maur,
Osmont-Huard, 1746 [dont une réédition
au XIXe siècle sous la direction
de Paulin PARIS [27 cm; 883 p.], Paris, V. Palmé,
1866; dont une réédition numérique
en mode texte par la la BNF, 1995, mise en ligne
sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28031k,
en ligne en 2008], pp.
55-57 & 553-554.
Paul
MARCHEGAY, Duel judiciaire entre
des communautés religieuses,
notice historique [pièce; in-8°
extrait de la Bibliothèque de l’École
des chartes; sur des duels entre
les abbayes de Marmoutier, de Ste-Croix de Talmont
et de Ste-Marie d’Angles], Paris, Schneider
& Langrand, 1842.
Étienne-Jean-Baptiste
CARTIER (1780-1859)
[éd.], Charte de 908, contenant
un accommodement devant Thibaut,
vicomte de Tours, d’un procès
entre Marmoutiers et Saint-Martin de Tours,
transcrite, traduite et annotée
[in-16; paginé pp. 435-450; fac-similé],
sans lieu ni date (avant 1859).
André SALMON (1818-1858),
Le Livre des serfs de l’abbaye
de Marmoutier, suivi de pièces relatives
au même objet et accompagné
de notes et d’éclaircissements
[in-8°], Paris, Comptoir des imprimeurs
unis, 1845. Réédition en
1864.
Paul
MARCHEGAY (archiviste du département
des Maine-et-Loire, chartiste),
Les Prieurés de Marmoutier
en Anjou. Inventaire des titres et supplément
aux chartes des XIe et XIIe siècle
[in-8°, XLVIII-88 p.], Angers,
Cornilleau & Maige, 1846.
Dont une recension dans
la Bibliothèque de
l’École des Chartes 2e sér.
T. 2 (1845-1846)
BOILLEAU,
Sceau de l’abbaye de Marmoutier,
en Touraine [pièce; in-8°;
extrait du Recueil de la Société
de sphragistique], Paris,
Boucquin, 1854.
Paul MARCHEGAY, Duel
judiciaire entre des communautés
religieuses, notice historique [pièce;
in-8° extrait de la Revue des
provines de l’Ouest], Nantes, A. Guéraud,
1858.
Étienne-Jean-Baptiste
CARTIER (1780-1859)
[éd.], Charte de 908, contenant
un accommodement devant Thibaut,
vicomte de Tours, d’un procès
entre Marmoutiers et Saint-Martin de Tours,
transcrite, traduite et annotée,
par E. Cartier [in-16; paginé
pp. 435-450; fac-similé], sans lieu
ni date (avant 1859).
Ch.-L. GRANDMAISON (archiviste
d’Indre-et-Loire) [éd.]
& André SALMON (1818-1858),
Le Livre des serfs de l’abbaye
de Marmoutier, publié par feu André
Salmon, suivi de chartes sur le même
sujet et précédé d’un
essai sur le servage en Touraine, par Ch.-L. Grandmaison
[in-8°], Tours, Société
archéologique de Touraine [«Publications» XVI], 1864.
Dont une
récension par Émile MABILLE,
in Revue critique d’histoire
et de littérature 1 (1866)
[dont une réédition en mode image
par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92873q,
en ligne en 2008], pp.
7-8.
Émile MABILLE (1828-1874),
Cartulaire de Marmoutier
pour le Dunois [in-8°], Châteaudun,
Lecesne, 1874.
J. DELAVILLE
LE ROULX, Les Prieurés
de Marmoutier et de Cormery au diocèse
de Coutances [in-8°; extrait
de la Société archéologique
de Touraine], Tours, Rouillé-Ladevèze,
1878.
Auguste MOUTIÉ
(1812-1886) & Adolphe de DION (1823-1909)
[éd.], Cartulaires
de Saint-Thomas d’Epernon et de Notre-Dame
de Maintenon, prieurés dépendant
de l’abbaye de Marmoutier, composés
d’après les chartes originales et divers
autres documents transcrits et annotés
[in-8°; IV+VI+188 p.; extrait des
Mémoires et documents publiés
par la Société archéologique
de Rambouillet IV (1878)], Rambouillet,
de Raynal, 1878.
Alexandre de SALIES,
Cartulaire vendômois
de Marmoutier, annoté, précédé
d’une introduction et suivi de tables,
par M. Alexandre de Salies et publié
par la Société archéologique...
du Vendômois [pièce
(prospectus); in-8°], Vendôme,
Lemercier, 1878.
Alexandre de SALIES,
Les Prieurés de Marmoutier
dans le Vendômois. Prieuré
de Saint-Martin de Lancé, avec
planches [in-8°; 112 p; extrait de la Société
archéologique etc.,
du Vendômois], Vendôme,
Lemercier & fils, 1878.
Paul NOBILEAU [éd.],
Claude CHANTELOU (dom): Cartularium
Turonense. Marmoutier. Cartulaire
tourangeau et sceaux des abbés, publié
par Paul Nobilleau. Précédé
d’une Biographie de l’auteur par dom
P. Piolin (1817-1892) [grand in-8°;
XCV+207 p.], Tours, Guilland-Verger, 1879.
Charles
MÉTAIS (1855-1912),
Accord entre Bonneval et Marmoutier,
1118 (charte inédite)
[24 cm; 6 p.; extrait du Bulletin
de la Société dunoise],
Châteaudun, J. Pigelet, 1887. Dont
une réédition numérique
en mode image par la BNF sur son site Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55474v,
en ligne en 2006.
Charles
MÉTAIS (abbé) [éd.],
Marmoutier, cartulaire
blésois [in-8°; CXLIII+540
p.; planches], Blois, E. Moreau, 1889-1891.
Casimir
CHEVALIER (1825-1893) [éd.],
Edmond MARTÈNE (1654-1739),
Histoire de l’abbaye de Marmoutiers,
de Dom Edmond Martène [2 volumes
in-8°: XX+1362 p.; planches; de
372 à 1792], Tours, Guilland-Verger
et Georget-Joubert [«Mémoires
de la Société archéologique
de Touraine» XXIV-XXV], 1874-1875.
Auguste
de TRÉMAULT (1821-1903),
Cartulaire de Marmoutier
pour le Vendômois publié sous les
auspices de la Société archéologique
du Vendômois par M. de Trémault
[3 volumes in-8° (t.1: 269 p., Vendôme,
Lemercier, 1893)], Paris, A. Picard et
fils, 1893. Dont une réédition
numérique en mode image par la BNF mise en
ligne sur son site Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75010x,
en ligne en 2008.
Philibert
BARRET (1852-1906), Cartulaire
de Marmoutier pour le Perche: N-D. du Vieux-Château,
collégiale de St-Léonard
de Bellême et prieuré de
St-Martin-du-Vieux-Bellême, publié
et annoté par M. l’abbé Barret
[in-8°; 323 p.; texte en latin,
préface et notes en français; chartes
de 940 à 1473], Mortagne, G. Meaux [«Documents
sur la province du Perche3e série»
II], 1894. Dont une
réédition numérique
en mode image par la BNF mise en ligne sur son
site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k914454,
en ligne en 2008.
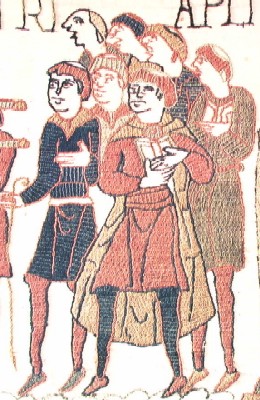 B. de MORRY, Urbain
II et les bénédictins
de Marmoutiers [in-8°; pièce;
extrait de la Revue historique
de l’Ouest], Vannes, Lafolye, 1895.
B. de MORRY, Urbain
II et les bénédictins
de Marmoutiers [in-8°; pièce;
extrait de la Revue historique
de l’Ouest], Vannes, Lafolye, 1895.
Abbé
Charles MÉTAIS, Deux
chartes inédites de saint
Yves [24 cm; 15 p. & 1 dépliant
de fac-similé; chartes de 1090
à 1092 et du 13 mai 1098, texte latin
et commentaire; extrait du Bulletin historique
et philologique (1894)], Paris, Imprimerie
nationale, 1895.
Abbé
P. DELALANDE, Histoire
de Marmoutier, depuis sa fondation
par saint Martin jusqu’à nos jours
[in-8°; 164 p.], Tours, Barbot-Berruer,
1897.
Pierre
LÉVÊQUE (1879-1967),
Trois Actes faux ou interpolés
des comtes Eudes et Robert et du roi
Raoul en faveur de l’abbaye de Marmoutier
[in-8°; 47 p.; extrait de la
Bibliothèque de l’École
des chartes LXIV (1903)], Nogent-le-Rotrou,
Daupeley-Gouverneur, 1903.
Ernest LAURAIN, Un
Acte faux de Marmoutier [in-8°;
8 p.; extrait du Bulletin historique
et philologique (1911)], Paris, Imprimerie
nationale, 1912.
Ernest
LAURAIN [éd.], Cartulaire
manceau de Marmoutier [1 fascicule
(1945) & 2 volumes grand in-8° (25
cm sur 16,5): 1911 & 1945; figures], Laval,
Vve A. Goupil, 1911-1945.
Charles
LELONG (1917-2003), L’Abbaye
de Marmoutier [24 cm; 203 p.; XXXII p.
de planches; bibliographie pp. 185-203],
Chambray-lès-Tours, CLD, 1989.
Sharon
FARMER, Communities of Saint
Martin. Legend and ritual in medieval
Tours [24 cm; XII+358 p.], Ithaca (New York,
USA), Cornell university press, 1991 [ISBN
0-8014-2391-0].
Philippe
RACINET, Le Bois de Nottonville
jusqu’au XVIIIe siècle: pouvoirs
et évolution de l’environnement
du site [24 cm; 36 p.; illustrations],
chez l’auteur, vers 2003.
Philippe
RACINET [dir.], Archéologie
et histoire d’un prieuré bénédictin
en Beauce. Nottonville, Eure-et-Loir,
Xe-XVIIe siècles [27 cm;
504 p.; illustrations; en appendice, choix
de documents; bibliographie pp. 23-26], Paris,
Comité des travaux historiques et scientifiques
[«Archéologie et histoire
de l’art» 21], 2006 [ISBN 2-7355-0569-3;
40 €].
Varia
Émile LEDRU, «Le Prieuré
Saint-Thomas d’Épernon»
(daté 1897), in Charles MÉTAIS,
Archives du diocèse de Chartres. III.
Pièces détachées pour servir à
l’Histoire du diocèse de Chartres. 1er volume.
Études et documents publiés par L.
l’Abbé Ch. Métais, Ch. Honoraire de
Chartres [448 p.], Chartres, Ch. Métais,
1899, pp. 293-340. spécialement p. 327: «Les
prieurs dont les noms ont été conservé
dans les anciennes chartes, étaient: «Au
XIe siècle: Hardoin, Guillaume. Au XIIe siècle:
Garnier, Bertrand, Guillaume, Robert. […] [p.328] […] Hardouin,
1er prieur connu…»
Michel LAUWERS [né en 1963],
Naissance du cimetière:
lieux sacrés et terre des morts
dans l’Occident médiéval
[22 cm; 393 p.; bibliographie pp. 343-382; index],
Paris, Aubier [«Collection historique»],
2005 [ISBN 2-7007-2251-5; 24€].
|
Toute correction, critique ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|
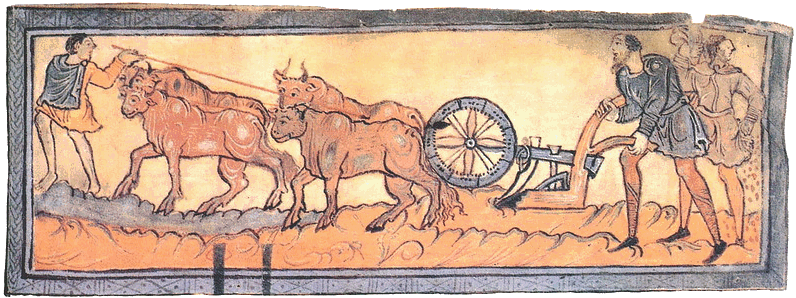
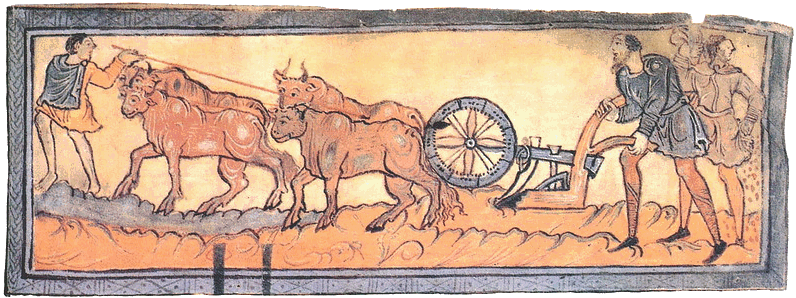

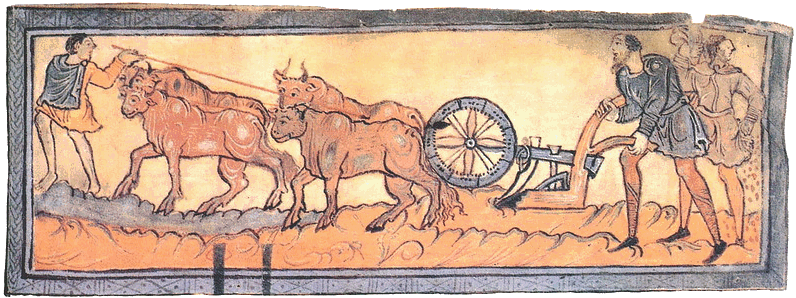
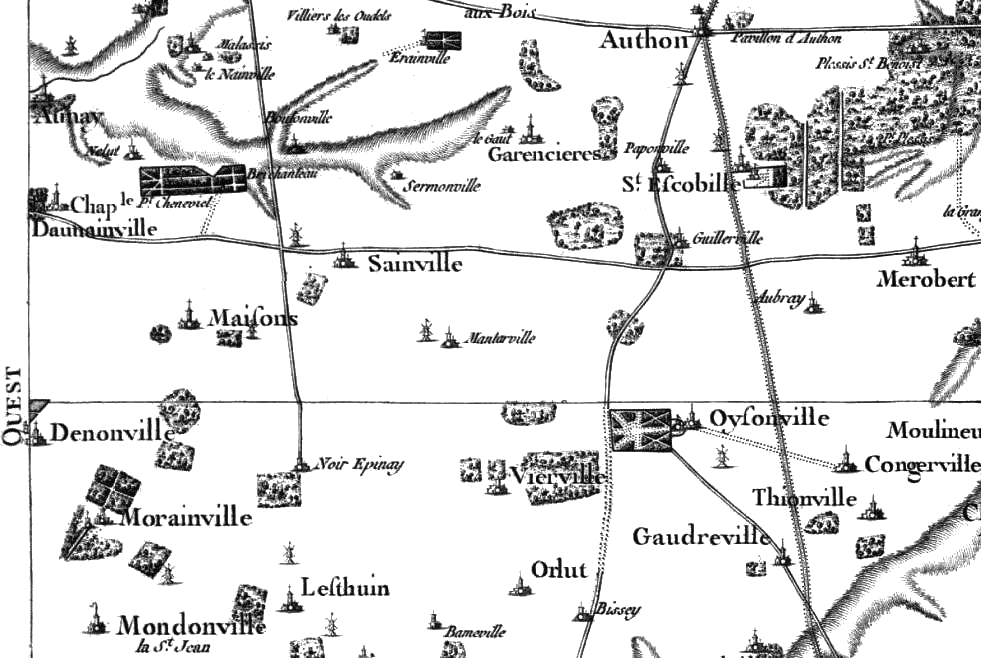
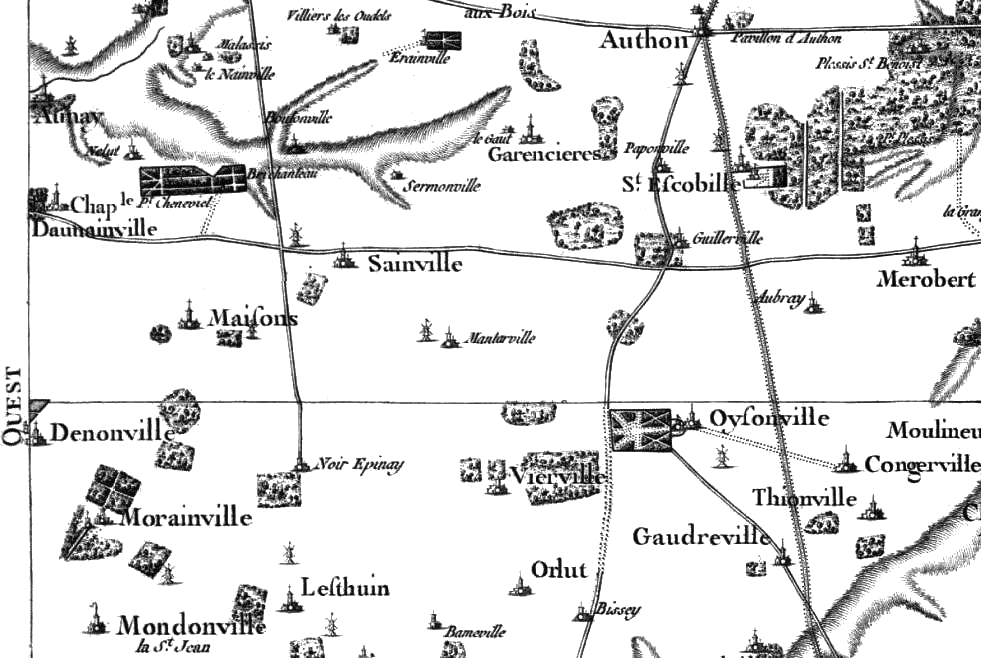
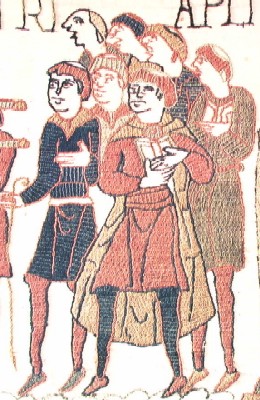 pater (père):
A 8, 12; D 7, 11, 32.
pater (père):
A 8, 12; D 7, 11, 32.
 La noblesse
La noblesse hospes (hôte,
tenancier): 3a, 7, 23; D 18.
— hospitare, hospitari (accueillir
comme tenancier, être tenancier): A
3b; D 2, 17c, 21. — hospitale
(hôtise, sens spécialisé
assez rare du mot qui désigne généralement
un lieu d’hébergement, c’est-à-dire
d’habitude soit un hospice, un hôpital
ou une auberge; pour ce sens, Niermeyer
allègue seulement une charte éditée
pazr Métais dans son édition
du cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois):
D 17a, 17b.. — hospitalitas
(mot employé avec réserve,
duas ut ita dicam hospitalitates;
ce mot est déjà employé
par Grégoire de Tours au VIe siècle
dans le sens d’espace réservé
à l’hébergement): hôtise, tenure
(littéralement: deux si je puis
dire hospitalités; sens non attesté
par le Lexicon de Niermeyer, édition
de 1993).
hospes (hôte,
tenancier): 3a, 7, 23; D 18.
— hospitare, hospitari (accueillir
comme tenancier, être tenancier): A
3b; D 2, 17c, 21. — hospitale
(hôtise, sens spécialisé
assez rare du mot qui désigne généralement
un lieu d’hébergement, c’est-à-dire
d’habitude soit un hospice, un hôpital
ou une auberge; pour ce sens, Niermeyer
allègue seulement une charte éditée
pazr Métais dans son édition
du cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois):
D 17a, 17b.. — hospitalitas
(mot employé avec réserve,
duas ut ita dicam hospitalitates;
ce mot est déjà employé
par Grégoire de Tours au VIe siècle
dans le sens d’espace réservé
à l’hébergement): hôtise, tenure
(littéralement: deux si je puis
dire hospitalités; sens non attesté
par le Lexicon de Niermeyer, édition
de 1993). uilla (village):
A 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 24; C 34; D 1,
3, 6, 8, 9, 12, 24.
uilla (village):
A 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 24; C 34; D 1,
3, 6, 8, 9, 12, 24. casamentum
(mouvance): D 22. [Casa en
latin classique signifie «barraque»; par suite casare
signifie en latin médiéval
«munir (un serf) d’une tenure» voire «munir
(un vassal) d’un fief»; casamentum a donc pour sens:
«acte de munier un vassal
d’un fief»; «suzeraineté féodale,
mouvance»; «fief»;
pour l’ancien français sous-jacent
chasement, Godefroy porte:
«fief, domaine, propriété».]
casamentum
(mouvance): D 22. [Casa en
latin classique signifie «barraque»; par suite casare
signifie en latin médiéval
«munir (un serf) d’une tenure» voire «munir
(un vassal) d’un fief»; casamentum a donc pour sens:
«acte de munier un vassal
d’un fief»; «suzeraineté féodale,
mouvance»; «fief»;
pour l’ancien français sous-jacent
chasement, Godefroy porte:
«fief, domaine, propriété».]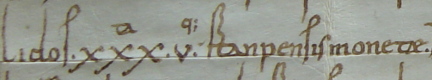 dare (donner):
A titre,
1, 5, 6, 9; B 30; C 34, 35; D titre, 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24a, 24b,
25, 26, 29a, 29b, 21.
— donum (donation):
A
9, 10, 11, 13; C 38; D 7, 10a, 10b, 12,
13, 16, 24, 26a, 26b, 29a, 29b, 30a,
30b, 34. — donare (donner): D 5. — donatio
(donation): B 27, 29; C 36; D 5, 9,
27, 32. —
tribuere (donner): B
25; C 39; D 30.
dare (donner):
A titre,
1, 5, 6, 9; B 30; C 34, 35; D titre, 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24a, 24b,
25, 26, 29a, 29b, 21.
— donum (donation):
A
9, 10, 11, 13; C 38; D 7, 10a, 10b, 12,
13, 16, 24, 26a, 26b, 29a, 29b, 30a,
30b, 34. — donare (donner): D 5. — donatio
(donation): B 27, 29; C 36; D 5, 9,
27, 32. —
tribuere (donner): B
25; C 39; D 30. concessio (consentement à une
donation relative à un bien sur
lequel on a des droits): A 24; D 9, 12. — concedere
(consentir à une donation
relative à un bien sur lequel on
a des droits): A 10, 14, 17, 23; B 26, 26-27;
D 8, 10, 12, 22a, 22b, 23, 24-25, 25, 27, 30, 34.
— auctorizare (permettre, consentir à une donation relative
à un bien sur lequel on a des droits):
D 5, 10, 13, 25. — concedere
et auctorizare (autoriser et permettre):
D 10, 25.—
annuere (permettre):
D 13. —
annuere et auctorizare
(permettre et autoriser): D13.
concessio (consentement à une
donation relative à un bien sur
lequel on a des droits): A 24; D 9, 12. — concedere
(consentir à une donation
relative à un bien sur lequel on
a des droits): A 10, 14, 17, 23; B 26, 26-27;
D 8, 10, 12, 22a, 22b, 23, 24-25, 25, 27, 30, 34.
— auctorizare (permettre, consentir à une donation relative
à un bien sur lequel on a des droits):
D 5, 10, 13, 25. — concedere
et auctorizare (autoriser et permettre):
D 10, 25.—
annuere (permettre):
D 13. —
annuere et auctorizare
(permettre et autoriser): D13.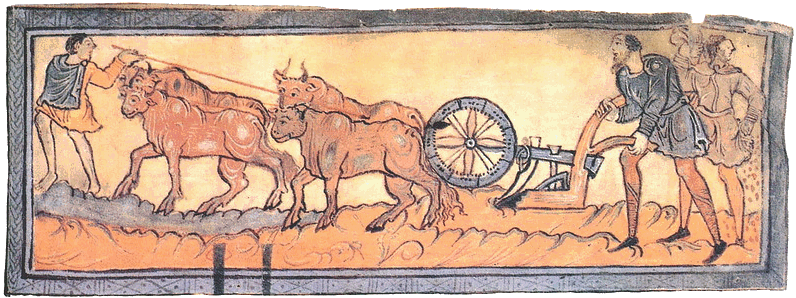
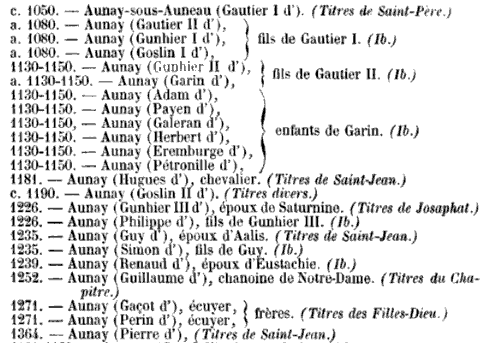
 Louis BOUDAN (attribué au
dessinateur), Veüe de l’Abbaye
de Marmoustier Lez Tours, de l’ordre de St
Benoist, Congrégation
de St Maur [aquarelle; feuille de 43,5
cm sur 55,3 cm; aquarelle de 40 cm sur 52],
conservé à la BNF [n°5291
de l’ Inventaire des dessins exécutés
pour Roger de Gaignières (1642-1715)
et conservés aux départements
des estampes et des manuscrits par Bouchot
Henri, Paris, 1891, t. 2], vers 1699.
Louis BOUDAN (attribué au
dessinateur), Veüe de l’Abbaye
de Marmoustier Lez Tours, de l’ordre de St
Benoist, Congrégation
de St Maur [aquarelle; feuille de 43,5
cm sur 55,3 cm; aquarelle de 40 cm sur 52],
conservé à la BNF [n°5291
de l’ Inventaire des dessins exécutés
pour Roger de Gaignières (1642-1715)
et conservés aux départements
des estampes et des manuscrits par Bouchot
Henri, Paris, 1891, t. 2], vers 1699.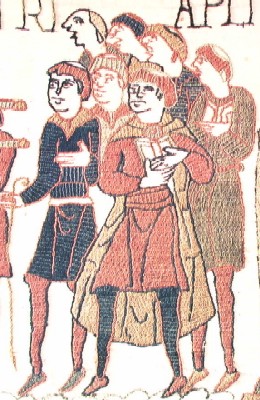 B. de MORRY, Urbain
II et les bénédictins
de Marmoutiers [in-8°; pièce;
extrait de la Revue historique
de l’Ouest], Vannes, Lafolye, 1895.
B. de MORRY, Urbain
II et les bénédictins
de Marmoutiers [in-8°; pièce;
extrait de la Revue historique
de l’Ouest], Vannes, Lafolye, 1895.