
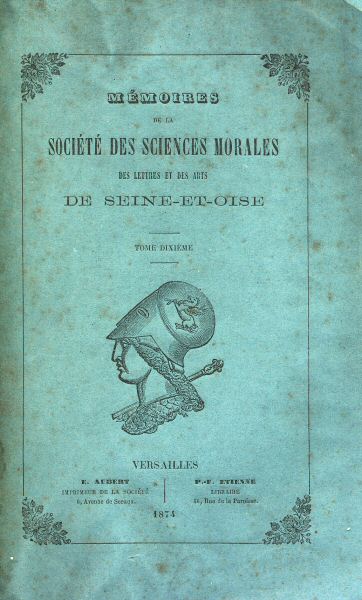
|
|
|
Étude sur
la vie et les œuvres de Fontanes
|

|
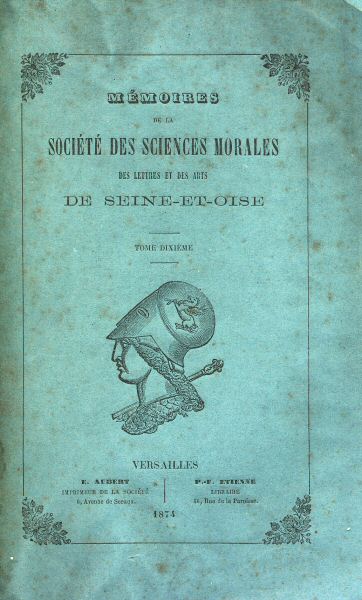
|
|
André Rimbault, né à Étampes,
a fait ses études au Collège de la même ville, où
il a été ensuite professeur d’humanités (c’est-à-dire
de Lettres) avant d’en devenir le Principal, une dizaine d’années
durant, puis de poursuivre ailleurs sa carrière. Ayant pris sa retraite
à Versailles, il y fut élu en 1872 président de la Société
des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, quelques mois avant sa
mort. Cette société publia en 1874 deux études auxquelles
il n’avait pas encore donné ses dernières corrections, l’une
consacrée à Chamfort, l’autre, celle-ci, à Fontanes.
Louis-Marcelin de Fontanes (1757-1821) fut un poète et un professeur de Belles Lettres. C’est lui qui lança Chateaubriand. Napoléon le nomma Grand Maître des Universités. Il fut fait enfin Pair de France par Louis XVIII. |
ÉTUDE SUR
LA VIE ET LES ŒUVRES DE FONTANES Par M. RIMBAULT, membre titulaire. 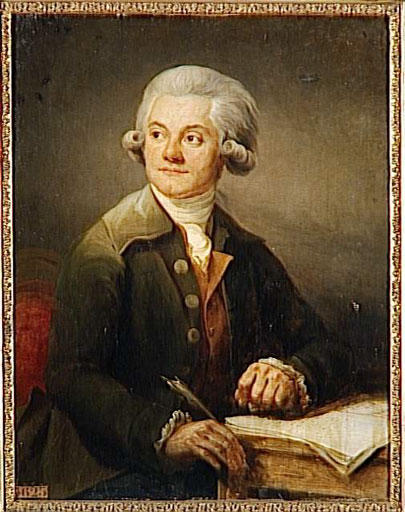 Le XVIIIe siècle, qui occupe une place si considérable dans
l’histoire des travaux de l’intelligence, fut cependant pour la poésie
une époque de déclin.
Le XVIIIe siècle, qui occupe une place si considérable dans
l’histoire des travaux de l’intelligence, fut cependant pour la poésie
une époque de déclin.Ce contraste est la conséquence naturelle de la force qui entraînait alors les esprits vers les sciences positives et la solution des problèmes sociaux. Déjà, dès le commencement de ce siècle, la grande école française avait vu baisser sa gloire, en vertu de cette loi fatale attachée à toute grandeur humaine qui, montée sur le faite, n’aspire plus qu’à descendre. Les grands rôles étaient remplis, les rôles secondaires commençaient. Molière, le profond observateur, fort depuis longtemps, n’avait trouvé pour successeur que le brillant et joyeux Regnard; Racine était remplacé par Crébillon; et, dans la poésie lyrique, J. Rousseau, élevé si haut par quelques-uns de ses contemporains, montrait [p.96] dans ses œuvres l’inspiration factice et ces inégalités choquantes qui sont des symptômes de décadence. Vers cette époque la poésie, déjà affaiblie dans ses représentants, fut attaquée dans sa forme consacrée et vivement combattue par un parti célèbre qui compta dans ses rangs Montesquieu, Fontenelle, Buffon, c’est-à-dire les premiers écrivains du temps. Le génie de Voltaire triompha de cette ligue puissante; mais s’il gagna la cause de la rime, et de la cadence poétiques, il n’en introduisit pas moins lui-même dans ses vers deux éléments corrupteurs, à savoir: les préoccupations philosophiques qui substituent les calculs de l’esprit à l’inspiration spontanée, et cette dangereuse facilité qui, sous une plume peu scrupuleuse, produit aisément la négligence. Un peu plus tard l’école poétique, en se mêlant aux en et en s’imprégnant de leurs doctrines, perdit encore de sa belle et noble simplicité. L’esprit philosophique le détourna de sa voie; le mauvais goût du public l’égara encore. On vit bientôt au sein d’un monde frivole fleurir une école non moins frivole, dont le maître disait en parlant de lui et des siens: «Nous autres, nous semons sans économie, car nous savon que tout ne lève pas.» En effet, produire au jour le jour, vaille qu vaille, telle semblait être la devise de cette école bien faite pour amuser une société folle de plaisirs et qui, voyant avancer l’orage révolutionnaire, se montrait plus soucieuse de se distraire que de le conjurer. Le succès qu’obtint l’école de Dorat, de ce poète qui fut quelquefois brillant, rarement solide, nous montre combien dans les années qui précèdent 89, on était loin des œuvres du grand siècle que pourtant on n’avait pas [p.97] encore appris à mépriser. Racine et Boileau avaient encore des admirateurs, mais ils n’avaient plus guère que des disciples infidèles. Toutefois si le souffle poétique s’altéra, il ne s’éteignit pas, et vers la fin du siècle des œuvres relativement remarquables soit dans le genre lyrique, soit au théâtre, soit dans le genre alors nouveau de l.a poésie descriptive, attestent que, si le génie était devenu rare, la poésie pouvait encore compter de véritables talents. Parmi les poètes dignes de ce nom que la Révolution française trouva dans l’épanouissement de leur réputation, il en est un qui, par sa religieuse fidélité à l’École française du XVIIe siècle, mérita d’être appelé l’héritier direct et le dernier des enfants de Racine. Ce poète c’est M. de Fontanes. Il n’est pas sans intérêt de savoir quelle place lui assigne dans l’échelle poétique de la France Sainte-Beuve, le grand critique qui en 1839 recueillit pour la première fois ses œuvres jusqu’alors bien disséminées, et, il faut le dire, un peu oubliées au milieu du bruit que faisait l’école romantique. «Tout à coup, dit Sainte-Beuve, après ce long espace (le XVIIIIe siècle) et cette interruption qui semblait définitive, un talent reparaît, en qui sourit une chaste et douce ressemblance avec l’aïeul littéraire. Dans le fond des traits, dans le tour des lignes, à travers la couleur pâlie, on reconnaît plus que des vestiges: c’est le rapport de M. de Fontanes à Racine. Il est de cette famille, il s’y présente à nous comme le dernier.» 
Un peu plus loin, il ajoute: «Dernier parent de Racine et adorateur du XVIIe siécle, M. de Fontanes n’est pas étranger au nôtre. Contraire aux nouveautés ambitieuses, il ne résistait pas à celles qui s’appuyaient de quelque titre légitime, de [p.98] quelque juste accord dans le passé. Sur quelques-uns de ces points d’innovation, il devient lui-même la transition et la nuance d’intervalle, comme il convient à un esprit si modéré. Par ses poésies élégiaques et religieuses, il devançait de plus de trente ans et tentait le premier, dans les vers français, le genre d’harmonieuse rêverie. Il semble donner la note intermédiaire entre les chœurs d’Esther et les premières Méditations.» Par la réserve discrète que montre Sainte-Beuve en exprimant ce jugement, il est facile de voir qu’il n’entendait pas faire de Fontanes et de Lamartine deux poètes de la même famille. M. de Fontanes ne fut jamais un novateur. Toute son ambition, comme poète, fut de maintenir l’accord, si lointain qu’il fût, avec ses modèles pour lesquels il eut toujours un culte plein de respect, et sa gloire est d’avoir rappelé leurs qualités, quoique à un degré affaibli. Mais, s’il ne fut pas le père de l’école romantique, il n’est pas moins vrai que, par le ton général de quelques-uns de ses poèmes, on voit que dans sa jeunesse il s’inspira quelquefois de ce souffle nouveau que Bernardin de Saint-Pierre venait de répandre dans ses Etudes de la nature et qui devait bientôt acquérir un charme si puissant sous la plume de Chateaubriand. Quoique cette simple étude n’ait pour objet que le côté poétique de M. de Fontanes, ce serait donner une idée trop incomplète du mérite de cet homme distingué que de ne pas mentionner au moins ses autres titres à la gloire littéraire. II y a dans la carrière de M. de Fontanes trois périodes distinctes: dans la première, qui va de 1778 à 4790, il est poète, tout poète, et, comme beaucoup de ses devanciers, il a trouvé dans les difficultés de la vie [p.99] le stimulant de sa muse. Comme Horace, il a pu dire: Tous ses poèmes les plus importants se rapportent à cette date. Dans la seconde période, c’est-à-dire jusqu’à la fin du siècle, il est surtout publiciste. Il se mêla aux luttes ardentes de cette époque, si grande et si terrible, et s’il n’y prit pas le rôle le plus sûr et le plus profitable à ses intérêts, il suivit (ce qui est plus glorieux) l’impulsion de sa conscience, et, tout en réclamant une sage liberté, il s’attacha à défendre contre l’oppression les droits de la justice et de l’humanité. La troisième période commence et finit avec l’empire: ce fut la plus brillante. Élevé aux honneurs par la seule force de son mérite, affermi dans sa position et parvenu à la pleine maturité de son esprit, il se montra à la fois orateur et critique de premier ordre. Dans ses discours, tous du genre tempéré, on admire la juste mesure des sentiments et des idées, l’accord par fait de la pensée et de l’expression. Par là il est, non plus l’écho lointain, mais la voix même du XVIIe siècle. L’éloge de Washington et le discours au pape sont, au témoignage de M. Thiers, des modèles d’un mérite supérieur. Comme critique, il suffit, pour lui assigner sa place, de rappeler qu’il fut jugé par La Harpe digne de porter le sceptre héréditaire de cette royauté de l’intelligence, dans laquelle le monarque régnant désignait lui-même son successeur et qui, commençant à Voltaire, se continue encore de nos jours dans la personne de l’homme illustre à qui nous devons le magnifique tableau de la littérature du XVIIIe siècle. [100] La grande gloire de Fontanes comme critique (et sous ce rapport l’école romantique lui a quelque obligation), c’est d’avoir marqué lui-même la place de Chateaubriand dans la prose poétique et d’avoir dirigé, corrigé la muse d’abord un peu capricieuse et rétive de son illustre ami. Mais au milieu de changements de fortune et dans les différentes phases de son existence, Fontanes ne cessa jamais d’être poète. Quand les convenances ou les exigences de sa vie officielle ne lui permirent plus de l’être pour le public, il le fut encore par intervalle pour lui-même et pour ses amis. Il était né poète; il en avait dans le caractère l’abandon, les saillies, la naïveté, l’aimable inconséquence. C’était là sa nature intime, celle où il se retrouvait le plus lui-même. Si la couronne poétique est la moins brillante de celles qui entourent sa gloire, si c’est la plus modeste, c’est à coup sûr celle qui lui était la plus chères: double motif pour que nous l’ayons dans ce modeste travail choisie de préférence. M. de Fontanes débuta dans la poésie par une pièce que Dorat, alors son ami, intitula: le Cri de mon cœur. C’est une boutade de jeunesse qui mérite surtout d’être citée par l’influence qu’elle eut ensuite sur la nature de son talent. Fontanes, nous l’avons dit, avait été élevé à l’école du malheur. Cette imagination que la nature avait faite pour sourire ne rencontra que des tristesse au début de la vie. Issu d’une ancienne famille que la révocation de l’édit de Nantes avait condamnée à une vie errante et cachée, élevé par un homme rigide qui n’avait inspiré que des terreurs à son âme sensible, il entrait à peine dans l’adolescence, quand il perdit presque ne même temps sa mère, son père, un frère aîné qu’il chérissait, [p.101] et qui, poète lui-même, l’ initié au commerce des Muses. Une modique pension dont le ministre Turgot avait récompensé les services rendus par son père lui fut retirée, par suite des inutiles mesures d’économie qu’adopta Necker. Il se vit pendant plusieurs années seul, sans appui, sans ressources, dans un état voisin de l’indigence. Sa santé fut gravement atteinte. Alors le désesespoir s’empara de cette âme plus sensible qu’énergique, et il eut un instant la pensée du suicide: le souvenir de son père l’en détourna. Ce sont ces sentiments qu’il exhala dans le Cri de mon cœur, avec bouillonnements d’une âme troublée, et cette ardeur toute juvénile dans laquelle il entrait plus de sincérité que de mesure et de réflexion. Il ne tarda pas à reconnaître que, comme poète, il avait fait fausse route, il en rougit. Aussi ce fut la seule erreur de ce genre (felix culpa), et dès lors il entra, pour n’en plus sortir, dans cette voie de sage modération et de douce sensibilité qui demeure le caractère définitif de sa personne comme de son talent. Les circonstances favorisèrent ce changement. Appelé à Paris par la renommée de son mérite naissant, il y connut les coryphées de la philosophie, si violents dans leurs disputes, et la plupart simples et bons dans les relations privées. Leurs luttes stériles, dans lesquelles l’amour-propre jouait un plus grand rôle que les convictions, lui donnèrent le goût de la conciliation. Il rejeta de son éducation religieuse les terreurs et l’exclusivisme, mais il en conserva soigneusement les principes qui élèvent l’âme et la nourrissent de sentiments consolateurs. D’un autre côté (car il faut le peindre tout entier), jeté dans le tourbillon d’une ville de plaisirs, il ne résista pas à l’entraînement; son, cœur sensible s’ouvrit sans [p.102] peine aux décevantes passions de la jeunesse, et son imagination poétique trouva dans leurs séductions un charme dont le souvenir persistant échauffe encore doucement ses vers quand De ces impressions variées résulte chez lui ce mélange en apparence contradictoire de religion et de philosophie, de morale élevée et de sensualisme épicurien, mélange que la sévère raison ne saurait admettre sans doute, mais qui s’explique dans une âme de poète.Au triste honneur de vivre en sage A quatre ans d’intervalle on voit dans la Forêt de Navarre combien ses idées et sa manière ont changé. Ce poème, le premier en date dans le recueil de ses œuvres, respire, une aimable fraîcheur. Il est à la fois descriptif et enthousiaste, mais avec sobriété. Le plan en est un peu irrégulier, grâce aux digressions, aux souvenirs et aux rapprochements de toute sorte qui s’y rencontrent. En général c’est par l’érudition que dans ses poèmes Fontanes supplée à l’inspiration chez lui toujours un peu courte. Dans celui-ci il n’atteint pas les profondeurs de son sujet; sa forêt est plutôt un gracieux bocage où se jouent toutes les divinités mythologiques qu’y appelle sa riante imagination. Il regrette ces jours heureux où les bosquets voyaient tout l’Olympe errer sous leurs berceaux: Cependant ces rêves, il les fait revivre sous d’autres noms, à la fin de son poème, quand vers le soir il suit sur la lisière de ces bois l’ombre de la belle Gabrielle et de son royal amant.Les bois désenchantés ont perdu leurs miracles. La Forêt de Navarre fut favorablement accueillie; elle établit la réputation de son auteur. Elle montrait dans Fontanes un vrai poète de la nature, qui savait peindre sans enluminure, qui tout d’abord évitait les écueils de la nouvelle école descriptive, et qui, tout en témoignant son admiration pour Delille, opposerait bientôt à son genre la meilleure des critiques, l’exemple. Ce succès attira sur lui les regards, et lui valut l’amitié de Ducis. Dès la même année il adressa à notre poète versaillais une épître où il fait un bel éloge de son nouvel ami, en appliquant à son caractère et à sa vie les considérations les plus élevées sur la dignité qui convient au poète. Dans cette même lettre, au moins dans la première édition qui en parut, il professe certaines doctrines littéraires qu’il a depuis bien modifiées. A cette époque la littérature allemande commençait à pénétrer en France. Dans sa jeunesse Fontanes se sentit du goût pour cette nouvelle forme, qui respirait une vie plus libre. Mais cet écart (comme il l’appela) fut de peu de durée: soit qu’il eût juré fidélité entière aux modèles qu’il s’était proposés, soit qu’il craignît les jugements du grand Aristarque qui avait déjà accordé à ses ouvrages l’honneur d’un éloge public, il abandonna pour toujours l’école germanique, et, comme il arrive quelquefois aux nouveaux convertis, non content d’abandonner, il brûla ce qu’il avait adoré. Ce sentiment de la nature et de la vérité dans l’art que Fontanes avait manifesté dans la Forêt de Navarre et dans son épître à Ducis se montre encore et avec un talent plus [p.104] achevé dans la Chartreuse et le Jour des morts, poèmes religieux et élégiaques dont le premier a mérité d’être dans le Génie du christianisme, et dont le second est resté un morceau populaire comme le Poète mourant de Gilbert, et plus tard la chute des feuilles de Millevoye. Le Jour des morts est une composition pleine d’harmonieuses rêveries où la nature a son rôle. Ce jour froid et sombre, cette bise du nord qui se mêle au son lugubre des cloches, ces feuilles desséchées que le vent emporte, les bois jaunis, les prés défleuries qui ont vu flétrir leur belle parure, tout es d’accord avec le sentiment qui domine, tout y est d’un heureux effet, jusqu’à ce rayon de soleil qui vers le milieu du jour, et après la cérémonie terminée, apporte à la nature, non plus la vie et la fécondité, mais quelques lueurs de consolation. C’est surtout dans les tons mélancoliques de ce poème et de celui qui précède, qu’on trouve cette note lointaine qui fait pressentir l’auteur des Méditations. Par exemple ce passage: Sainte-Beuve, tout en louant les beautés poétiques de ce morceau, se livre à un genre de critique qui peut paraître extraordinaire. Il reproche à l’auteur de n’avoir pas l’esprit du spectacle qu’il nous trace, d’y avoir jeté les couleurs philosophiques du XVIIIe siècle, de ne pas [p.105] — oser nommer le Curé de Village, de ne l’avoir désigné que par ces périphrase: le rustique Fénelon, le pasteur respecté, etc. II l’accuse même d’être en plusieurs endroits en désaccord avec le dogme. L’exemple qu’il en donne mérite d’être cité. Lorsqu’à l’imitation du poète anglais qui a traité le même sujet, Fontanes parle de ces morts obscurs qui, s’ils avaient été de leur vivant placés sur un autre théâtre, eussent été peut-être de grands généraux ou de grands poètes, il s’exprime ainsi:La rêveuse douleur «Depuis quand, dit Sainte-Beuve, la mort pour le chrétien est-elle devenue un doux sommeil et le cercueil un oreiller?» C’est traiter sévèrement un bien joli vers. Pour nous, nous ne sachions pas que la théologie la plus rigoureuse ait jamais condamné ces expressions poétiques et figurées par lesquelles on adoucit les apparences lugubres de la mort dans un dogme qui admet l’immortalité de l’âme et la résurrection des corps. De plus, si de 1’expression poétique et figurée nous allons jusqu’à l’idée philosophique et religieuse, nous y trouvons la consécration de cette grande pensée que l’homme, après sa mort, a plus à recueillir des actions qui lui ont acquis des mérites devant Dieu que de celles qui ont eu de l’éclat devant les hommes, et que, du conquérant qui a étonné la terre par ses victoires et de l’homme modeste qui s’est consacré au bonheur de ses semblables, celui qui doit goûter le repos le plus doux, c’est le dernier. Cette doctrine est celle du poète: l’épisode du vieux Hombert en est la confirmation. [p.106]Eh bien! si de la foule autrefois séparé, Nous avons dit que la période la plus féconde pour le génie poétique de Fontanes va de 1778 à 1790. Durant cette période, il a mérité de prendre place parmi les poètes qui se sont fait un nom dans l’art sévère. Outre les poèmes dont nous venons de parler, toutes ses œuvres les plus importantes, son Essai sur l’astronomie, la première édition du Verger, refait et complété plus lard sous le nom de Maison rustique, sa traduction en vers de l’Essai sur l’homme et les Fragments de la Grèce sauvée sont de cette époque. Il serait difficile d’assigner une date bien précise à ces diverses productions. Fontanes suivait le précepte d’Horace, il laissait reposer ses poèmes avant de les soumettre à l’épreuve de la publicité. Il faisait plus: il les lisait à ses amis et profitait de leurs observations. Jamais poète ne se montra, contre l’ordinaire, aussi docile aux avis. De cette docilité et aussi de l’hésitation qui lui était naturelle, résultent ces innombrables corrections qui vont quelquefois jusqu’à transformer ses œuvres et dont quelques-unes, suivant l’avis de Sainte-Beuve, ont été plus nuisibles qu’utiles, en ôtant à la pensée la fraîcheur de la première inspiration. Fontanes était fait pour réussir dans le genre descriptif et didactique. Il avait la patience du travail, l’esprit observateur. Il entait la nature et était assez maître de son enthousiasme pour le soumettre toujours à l’expression juste. Son talent en prose plus complet que son talent poétique brille, nous l’avons déjà dit, par toutes ses qualités. Dans sa belle préface de sa traduction de Pope, il a tracé des portraits de Lucrèce, de Pascal, de Boileau, d’Horace et de Voltaire qui resteront toujours des modèles du genre. L’Essai sur l’homme est comme l’introduction de ses [p.107] poèmes dans le genre didactique. Nous n’avons pas à nous occuper du fond même de cet ouvrage, puisqu’il s’agit d’une traduction. Du reste il est probable que l’auteur et le traducteur, s’attachant surtout au côté poétique et brillant de la doctrine de Platon se préoccupèrent médiocrement de la portée métaphysique de leur œuvre. Si on leur eût fait voir que la doctrine: tout est servi, tout sert, était grosse d’objections et qu’au fond de leur optimisme pourrait bien se trouver quelque chose du panthéisme de Spinoza, ils eussent probablement été aussi étonnés que le fut Pope quand, de par le docteur Warburton son défenseur, il se trouva être plus chrétien qu’il ne le pensait. Il ne faut demander aux poètes que ce qui est de la nature des poètes. Ce qu’ils saisissent surtout dans les objets, ce sont les impressions. Ils parlent à l’âme sensible bien plus qu’au raisonnement; l’enchaînement logique d’un système n’est pas leur fait; et sous ce rapport, comme le remarque Fontanes, leur empire est plus durable, parce que les systèmes scientifiques changent, tandis que le fond de l’homme est toujours le même. Quoi qu’il en soit, l’Essai de Pope a l’avantage de présenter une morale élevée applicable à tous et dans tous les temps. Cet avantage suffirait pour consacrer le mérite d’un ouvrage dans lequel on trouve une poésie brillante qui triomphe souvent de la sécheresse du sujet par la vivacité des tours, par le mouvement de idées et par cette puissance de création qui, comme dans Lucrèce, quoique à un moindre degré, donne de la vie à l’abstraction. Fontanes, dans sa traduction, s’est attaché à reproduire ces diverses qualités de son modèle, et il l’a fait avec succès. Il est tel passage où, par une certaine [p.108] liberté d’allure, on le croirait original. Celui-ci par exemple: Nous ne quitterons pas ce poème sans citer encore un passage qui, en huit vers, renferme tout un traité de morale:Vois ce dur sauvageon, surpris d’être dompté: Après la traduction de Pope, vient l’Essai sur I’Astronomie. Ce ne devait être qu’un fragment d’un poème sur la nature qu’avait rêvé Fontanes, comme plus tard Lamartine rêva un poème «humanitaire.» Mais la vie est trop [p.109] courte pour réaliser de pareils projets, et puis tous deux furent de cet avis que le poète n’est pas tout l’homme et que le grand combat de la vie est plus utile à la société que les rêveries de l’imagination, si séduisantes qu’elles puissent être. Aussi Fontanes n’a laissé de son projet qu’un fragment, comme Lamartine n’a laissé que deux épisodes.Tout mortel ici-bas a le droit d’être heureux. Malgré on titre modesté d’essai, le poème de Fontanes est, de l’avis de tous les connaisseurs, ce qu’il a fait de plus grand. Nulle part ailleurs sa poésie ne s’élève à cette hauteur; elle est en tout digne du sujet, et c’est à son occasion que La Harpe dit: «Voilà décidément un poète qui tuera l’école de Dorat.» En effet comme cette poésie, toujours noble et majestueuse, sait cependant échapper à l’uniformité! Tantôt l’austérité du sujet est corrigée par de gracieuses fictions. Ainsi, après avoir fait remonter l’origine de l’astronomie aux pasteurs de l’Euphrate, le poète ajoute: Tantôt il nous repose doucement en mêlant aux scènes du ciel des sentiments tout humains:Ainsi l’astronomie eut les champs pour berceau; Ici il peint la majesté de la création: c’est le fiat lux:Tandis que je me perds en ces rêves profonds, Un peu plus loin, avec la rapidité d’un tourbillon, il transporte l’observateur à travers les mondes infinis:Soleil, ce fut un jour de l’année éternelle Après le descriptif enthousiaste, le descriptif pur. Dans le poème du Verger, Fontanes n’avait qu’effleuré un sujet qu’il traite d’une manière plus complète dans la Maison rustique. Ce poème est divisé en trois chants: le [p.111] Jardin, le Verger et le Parc. Ici ce n’est plus seulement dans la forme poétique, mais dans la nature même des idées, que l’on reconnaît l’ami fidèle du siècle de Louis XIV. Cette amitié va jusqu’à la passion, c’est-à-dire jusqu’à l’injustice, et il est curieux de voir, dans la préface de cet ouvrage, une polémique ardente qui étonne de la part d’un homme toujours maître de sa pensée, quand il l’exprimait avec la plume. Il est vrai que ceux qu’il rencontre pour adversaires sont des étrangers, et nous connaissons sa prévention contre les produits exotiques. Il eut tort sans doute de mêler à sa critique des jardins anglais son antipathie pour Shakespeare, et, en raillant les grenouilles de Hirschfeld, de mépriser les copistes allemands du tragique anglais. Mais ce jugement passionné n’a-t-il pas droit à quelque excuse, si l’on considère que, déjà de son temps, Fontanes voyait s’opérer ce singulier revirement dont parlait naguère un de nos meilleurs conférenciers, par lequel des Français, afin de mieux témoigner leur engouement tout nouveau pour la littérature étrangère, donnaient eux-mêmes le signal du soulèvement contre nos gloires passées?Vers ces globes lointains qu’observa Cassini, Mais revenons à la Maison rustique. Ici il se trouve encore l’adversaire, mais l’adversaire toujours respectueux de Delille, non seulement par son style plus ferme et par cette versification serrée et concise qui convient mieux au genre didactique, mais encore par le fond des idées. Sans attaquer l’auteur des Jardins, au talent du quel il rend pleine justice, il insiste sur ce que celui-ci a le plus négligé: le jardin de tout le monde. Il ne veut pas que pour jouir de la nature, il soit nécessaire de posséder la fortune de M. de Girardin. Ce qu’il veut, c’est ce que voulait Virgile lui-même, ce que l’homme le plus modeste peut se procurer à peu de frais: des plantes [p.112] potagères, des fleurs, une ruche, des arbres fruitiers, des eaux. Ce qu’il aime pans nature, c’est la variété, la vie, la fécondité, l’épanouissement. Il ne hait pas la mélancolie, mais il faut qu’elle se retire à l’écart, et ne se répande pas sur tout un jardin qui, ayant tout, est fait pour charmer. On voit qu’il est bien de l’école française, et que son jardin bourgeois doit avoir quelque ressemblance avec celui d’Auteuil. Il ne professe aucun goût pou les grandes pelouses monotones et froides, pour les tons rembrunis, et il ne veut pas qu’on rapetisse la nature par une imitation mesquine de fausses montagnes, de faux rochers, de fausses ruines. «Si vous voulez, dit-il, jouir des accidents de la campagne, allez les chercher où ils sont (il cite le Mont-Valérien, Rueil, Marly, Saint-Germain) et n’ayez pas la prétention de les enfermer dans un espace étroit, où perdant leurs points de vue et leurs proportions, ils perdent leur effet.» Comme un grand nombre de poètes français, mais avec plus de raison que la plupart d’entre eux, Fontanes voulait faire son épopée. Ce fut le rêve de sa vie; il s’était élevé assez haut pour aspirer à la grande gloire. Mais pouvait-il parvenir? Le sujet auquel il s’arrêta fut l’affranchissement de la Grèce par Thémistocle. On ne pouvait faire un meilleur choix. Les riants tableaux de la Grèce, cette terre classique de la poésie et de la liberté, des noms placés à une distance qui leur donne un caractère héroïque, la ressource des fictions mythologiques, tout se réunissait, et cependant le rêve ne fut pas réalisé. Faut-il s’en prendre aux événements de la vie qui, dans l’âge mûr surtout, ne laissèrent pas à M. de Fontanes les loisirs nécessaires pour accomplir un travail de si longue haleine. Malgré les témoignages flatteurs [p.113] et les vives instances de Chateaubriand, on peut croire que quelque chose encore manquait. Si, pour réussir dans une telle entreprise, il suffisait de savoir faire de beaux vers, et même de savoir trouver et soutenir le ton épique, oui, Fontanes eût fait son épopée. Mais cette tension d’esprit nécessaire pour organiser un grand ensemble, l’avait-il? Etait-il bien maître de toutes les idées qui peuvent se présenter dans un ouvrage qui n’admet pas de faiblesses? Avait-il cette puissance de génie qui embrasse à la fois tous les sentiments, toutes les forces de la nature, toutes les situations, toutes les sciences, en un mot qui crée tout un monde? Comparons son premier chant avec les modèles qu’il s’est proposés, car dans ce que nous possédons de son épopée il est facile de reconnaître qu’il avait devant lui Virgile et Homère. Dans le premier livre de l’Énéide, le plus beau chef-d’œuvre d’exposition qu’on connaisse, comme dès le début le poète nous entraîne au milieu de l’action! Là tout est mis en action pour nous émouvoir: le ciel, la terre, les dieux et les hommes, les vents et les flots agissent à la fois, quoique dans un ordre parfait; et une fois emporté dans ce tourbillon, le lecteur s’avance de merveilles en merveilles. Au contraire dans la Grèce sauvée l’exposition est froide et dénuée d’action: c’est de l’histoire mise en vers. Les rapports longuement énumérés de la guerre de Troie avec l’entreprise de Xerxès, les portraits habilement tracés de Thémistocle et d’Aristide, une savante mais pénible description des jeux olympiques: voilà par quels moyens se prépare l’action qui ne [p.114] commencera sans douté qu’au quatrième chant, puisque le deuxième et le troisième, comme dans Virgile, sont remplis par un récit rétrospectif.In medias res Le deuxième chaut renferme un épisode d’une mâle beauté. Ce sont les adieux de Léonidas et de son épouse Amyclé: là encore l’auteur a sous les yeux son modèle. Ce qui fait la force des grands poètes, c’est que, ne perdant jamais de vue la nature, ils savent élever les sentiments les plus simples à la hauteur des plus fortes situations. Dans les adieux d’Hector et de son épouse, qu’est-ce qui excite en nous tant d’émotion et d’attendrissement? C’est qu’à l’héroïsme calme et résigné d’Hector, Andromaque n’oppose que la touchante faiblesse et l’amour de la femme. Ce qu’elle voit dans la catastrophe qui la menace, c’est l’épouse privée de son époux, c’est l’enfant orphelin, la mère sans appui, et Hector lui-même nous touche moins profondément.par sa constance héroïque, que lorsque, cédant lui aussi à un mouvement bien naturel, il dit d’une voix émue que de tous les maux dont il est menacé, aucun ne lui est plus cruel que de se figurer sa chère Andromaque traînée en captive à la suite d’un vainqueur brutal. Ici que dit Amyclé? Jamais ces sentiments de convention ne prévaudront contre le cri de la nature.Je suis épouse et mère, et j’adore mes fils: Non, les poèmes à grande invention n’étaient pas l’élément qui convenait à Fontanes. Homme de goût, écrivain élégant et pur, qui par l’habitude de travailler son expression avait acquis une touche délicate et fine; artiste, plus encore que poète, il n’était pas fait pour [p.115] supporter longtemps le souffle brûlant de l’inspiration. Il le ressentit cependant quelquefois, et plusieurs de ses odes sérieuses, l’ode sur les tombeaux de Saint Denis, l’ode sur l’enlèvement du Pape, ses stances à Chateaubriand atteignent au véritable lyrisme. Mais c’est dans un ordre d’idées moins élevées que nous trouverons les perles les plus fines de ce riche écrin. Esprit modéré et ennemi de toute violence, Fontanes était surtout un philosophe rêveur, un esprit aimable toujours un peu épicurien, cherchant dans la poésie une agréable diversion à la contenance gênée qu’il était obligé de garder dans la sphère où sa fortune l’avait placé. Aussi là où il excelle, c’est dans ces strophes légères qu’il composa dans sa retraite de Courbevoie, en ces moments de loisir et de douce paresse où son esprit se détendait. Là s’abandonnant aux caprices de sa muse mobile, tantôt il invite ses fidèles amis, Joubert et Chateaubriand, à venir partager avec lui les douceurs de son petit manoir; tantôt il décoche quelques traits satiriques sur le mauvais goût du temps. Quelquefois dans sa solitude il fait un retour sur lui-même; il voit arriver la vieillesse, dont il eut toujours quelque frayeur. Un jour sa raison la salue avec bonheur, comme Cicéron: Un autre jour, il oublie la sagesse, et ses vers prennent l’accent du dépit et du regret:Le temps, mieux que la science, C’est dans cette retraite de Courbevoie que, cherchant se dérober à sa gloire, il trouve les plus purs rayons de sa gloire poétique:Le passé, l’avenir, le présent, tout m’afflige; On voit en effet qu’il perdit peu pour sa mémoire. Il serait trop long de passer en revue ces pièces nombreuses , d’une grâce toute grecque, dans lesquelles il se montre le rival plus encore que l’imitateur d’Anacréon et d’Horace. L’ode à un jeune Anglaise, l’ode à un pécheur, l’ode une jeune beauté, cette dernière surtout, sont de petits chefs-d’œuvre dans le genre léger. Beaucoup de ces poésies ont été ou détruites par Fontanes lui-même, ou retranchées de ses œuvres par une main pieuse dont nous devons imiter la discrétion. Toutefois nous ne saurions, sans être taxé d’inexactitude, supprimer entièrement ce côté charmant de l’esprit de notre poète. Une seule citation nous montrera la touche fine et délicate qu’il possédait dans l’ode anacréontique.Au bout de mon humble domaine Il s’agit d’une de ces poésies de circonstance, comme Goethe en recommande à ceux qui ont reçu du ciel l’influence secrète. Un événement, simple en apparence, y donne lieu: le poète s’en saisit, en découvre l’aspect intéressant et l’embellit de son imagination.  Fontanes avait placé dans son cabinet un buste de Vénus.
Ses. visiteurs habituels à cette époque étaient les
membres du grave aréopage qu’il avait associés à ses
travaux pour l’organisation de l’Université naissante. On [p.118] trouva l’idée un peu
frivole, et l’on murmura quelques observations critiques. Fontanes y répondit
par une ode dont nous extrayons les strophes suivantes:
Fontanes avait placé dans son cabinet un buste de Vénus.
Ses. visiteurs habituels à cette époque étaient les
membres du grave aréopage qu’il avait associés à ses
travaux pour l’organisation de l’Université naissante. On [p.118] trouva l’idée un peu
frivole, et l’on murmura quelques observations critiques. Fontanes y répondit
par une ode dont nous extrayons les strophes suivantes:On a dit de Fontanes qu’il fut le poète impérial. Rien ne nous paraît justifier cette qualification. Que par déférence pour l’époque la plus brillante de sa carrière et par une juste appréciation de la maturité de son talent il soit classé parmi les poètes du temps de l’empire, nous le concédons, mais la désignation plus expressive de poète impérial ne lui convient nullement, et, quant à lui, il l’eût repoussée avec force. Il faut dans Fontanes distinguer le poète de l’homme public qui a rendu les plus grands services en aidant à la réformation de ce que la Révolution avait sapé. Comme orateur impérial, il comprit ce qu’il devait à sa haute position et ne se refusa pas à des éloges officiels qu’il ne pouvait omettre sans inconvenance et souvent même sans injustice. Et pourtant, [p.119] même sous ce rapport, des faits devenus célèbres attestent qu’il sut conserver la dignité de la parole en toute circonstance, et au péril de sa fortune et de sa faveur. Quant au poète, il s’est toujours réservé tout entier; c’est en lui que s’était réfugiée toute l’indépendance de l’honnête homme. En vain les offres les plus brillantes lui furent faites pour engager sa muse à brûler quelques grains d’encens devant l’idole, il s’y refusa obstinément, et l’ode sur les embellissements de Paris, la seule où il parle du maître avec éloge, ne fut pas publiée de son vivant. Si quelquefois dans ses vers il s’occupe des événements du temps, c’est plutôt pour déplorer et flétrir dans une secrète intimité des actes condamnés par la conscience publique. Ses stances à Chateaubriand persécuté, l’ode sur la mort du duc d’Enghien, l’ode sur l’enlèvement du pape, dans lesquelles il se montre si vraiment lyrique, l’attestent surabondamment.Je vieillis, mais est-on blâmable Fontanes ne consentit jamais à mettre sa muse au service d’aucun parti. Ses affections personnelles étaient pour la famille qui avait donné à la France Louis XIV et surtout le bon Henri, qu’il exalte si souvent dans ses vers. Mais ce culte était tout intérieur. Quant aux systèmes politiques qui se sont succédé sous ses yeux, il ne leur accorda que ce que tout homme juste ne saurait leur refuser. Ses sympathies pour la Révolution allèrent jusqu’à la Fédération; il composa pour cette fête une ode dans laquelle on lit les vers suivants: Tout ce qu’un pareil enthousiasme pouvait attendre de la Révolution, c’était de n’être pas étouffé par sa main meurtrière; Fontanes en courut plus d’une fois le danger. Sous l’empire les grandeurs ne purent le corrompre; il fut prudent, habile même, mais dans les circonstances graves il ne transigea jamais avec sa conscience; toute sa vie enfin il fut fidèle à cette noble pensée que jeune encore il exprimait dans son épître à Ducis, quand, prenant sa vertu pour modèle, il disait:O peuple magnanime, imite en tout les cieux, Après avoir étudié M. de Fontanes comme poète, il nous reste encore à l’examiner comme orateur et comme critique. Si ce côté de sa réputation littéraire n’est pas le premier par l’importance des œuvres, c’est du moins celui où son talent s’est élevé le plus haut; dans tous les cas, c’est celui qui a le plus contribué à sa fortune, et (peut-être par une conséquence naturelle) qui lui a fait le plus d’ennemis.Ah! puissé-je de loin, guidé par vos regards, Nous avons vu que comme poète M. de Fontanes appartient exclusivement à l’art; nous avons établi, par l’autorité des faits, que sa muse se tient toujours à 1’écart du courant où fut entraîné l’homme public. Dans le choix de ses poèmes, il ne s’inspirait que de ses sentiments intimes et des tendances naturelles de son talent. Au contraire ses discours et ses critiques se rattachent à des conjonctures politiques ou à des luttes littéraires dans lesquelles il s’est trouvé engagé, et auxquelles son mérite [p.121] et sa position lui ont permis de prendre une part considérable. Nous ne saurions donc détacher les œuvres dont nous avons à parler des circonstances qui les ont fait naître, et dès lors notre tâche n’est pas sans difficulté. Les écrits dont il s’agit, quoique déjà loin de nous, touchent encore aujourd’hui à des intérêts et même à des passions qui, par le retour des événements et le mouvement des idées, n’ont pas perdu toute leur vivacité. Aussi n’avons-nous pas l’intention de nous prononcer sur les théories et les doctrines qu’ils renferment, ce qu serait hors de notre cadre et au-dessus de nos forces. Toutefois nous ne nous contenterons pas d’un simple exposé. Il est un autre point de vue qui nous a paru digue d’intérêt, et nous ne voyons même aucun inconvénient à déclarer dès maintenant la pensée qui nous a particulièrement dirigé dans cette simple étude. M. de Fontanes, à propos de quelques-uns de ces écrits, a été plus d’une fois l’objet d’attaques dans lesquelles son caractère personnel a été placé un peu bas. Dans notre complet désintéressement, il nous a semblé difficile d’admettre qu’un écrivain d’une autorité incontestable dans les lettres; d’un autre côté, qu’un homme simple et bon, qui n’usa de sa haute fortune que pour exercer une action bienfaisante, ait sacrifié et sa réputation de critique éclairé et l’honnêteté de sa conscience à de mauvais calculs d’ambition. Nous avons voulu nous faire à cet égard une opinion sincère et motivée. Ainsi chercher l’explication naturelle de la ligne que M. de Fontanes a suivie comme critique; examiner si, à travers les vicissitudes et les difficultés de sa position officielle, il a su conserver dans ses discours la dignité de la parole; en un mot dégager son caractère moral des erreurs [p.122] mêmes dans lesquelles il a pu être entraîné: telle a été notre préoccupation, elle se montrera plus d’une fois dans ce travail. On s’accorde généralement à donner à la prose de Fontanes la supériorité sur ses vers. Cette préférence, que quant à lui il n’eût probablement pas partagée, n’aurait peut-être pas sa raison, si, au lieu des grands sujets qu’il a abordés en poésie, et dans lesquels on sent trop souvent le travail et la gêne, l’insuffisance d’une imagination limitée, il se fût borné à composer de petits poèmes, comme en prose, il n’a fait que des opuscules. La nature de son talent était la netteté, la précision, l’harmonie, l’élégance; mais chez lui l’inspiration ne pouvait se soutenir longtemps. Doué de plus de goût que d’invention, il était plus apte à polir qu’à créer. Nul ne sut mieux donner à la pensée sa forme suprême; mais son esprit, plus brillant qu’étendu, ne pouvait embrasser de vastes horizons. Il n’a jamais écrit de livre; un tel effort n’eût peut-être pas été à sa mesure; mais il a la touche délicate; il excelle dans les compositions qui n’exigent pas de grands développements. De même que quelques petits poèmes d’une grâce parfaite forment sa couronne poétique, de même quelques discours d’une perfection achevée suffisent à sa réputation comme prosateur. Si l’on s’en tenait à ces éléments de comparaison, on pourrait dire que, dans l’un et l’autre genre, il atteignit également à la hauteur qu’il lui était donné d’ambitionner, celle où peuvent élever le goût, l’étude et l’art, à défaut de génie. Cependant on ne peut disconvenir que Fontanes eut pour la forme calme et digne de la prose plus d’aptitude naturelle que pour la langue enthousiaste des poètes. Aussi, tandis qu’il ne trouva sa perfection poétique (perfection [p.123] relative, bien entendu) que dans la maturité de l’âge, il débuta au contraire dans la prose, dès sa jeunesse, par un morceau qui tout d’abord le plaça au premier rang des écrivains de son époque. Nous voulons parler de la belle préface qu’il mit en tête de sa traduction de l’Essai sur l’homme. Ce morceau parut en 1783. Il fit sensation dans le monde des lettres. Un fond si riche de connaissances variées, une raison si élevée, une critique si sûre exprimée avec aisance, finesse et solidité par un jeune homme de vingt-six ans, tout cela devait surprendre en effet à cette époque de littérature frivole. La Harpe en fit le plus grand éloge, et le désigna comme un chef-d’œuvre d’éloquence appliquée aux spéculations du goût. Cette préface fut, par anticipation, pour Fontanes comme la prise de possession du domaine de la critique où il devait régner un jour. Il ne négligea rien pour que sa déclaration de principes y fût aussi complète que possible. Son travail est toute une galerie littéraire, dans laquelle prennent place les plus grands écrivains classiques, tant anciens que modernes. Sous prétexte d’un rapprochement avec Pope comme écrivain moraliste, Lucrèce, Horace, Boileau, Voltaire, Pascal passent successivement par ses jugements, qui sont des jugements de maître. Plusieurs de ces portraits qui ne méritent d’autre reproche que d’être amenés là un peu par force, sont restés des modèles d’appréciation à la fois fins et profonds, comme de style élégant. Nous n’avons pas l’intention de rechercher les nombreux articles de polémique publiés par Fontanes durant sa carrière de publiciste, c’est-à-dire de 1790 à 1802. 11 faudrait pour cela parcourir tous les journaux auxquels il attacha son nom. Nous nous en tiendrons aux morceaux [p.124] choisis avec autant de sollicitude que de goût par l’éditeur de ses œuvres: le reste d’ailleurs ajouterait peu de chose à sa gloire littéraire. Toutefois il est un écrit qui fait trop d’honneur à son caractère et à son talent pour être passé sous silence: c’est l’adresse qu’il composa en décembre 1793 pour les habitants de Lyon, ses concitoyens d’adoption, implorant l’humanité de la Convention contre les fureurs de Collot d’Herbois. On sait comment ce nouveau proconsul fit expier aux habitants de cette malheureuse cité le secours qu’ils avaient fourni à la réaction. Nulle différence n’était faite entre les chefs de la conspiration et les infortunés que la misère avait poussés à leur prêter leurs bras. Des milliers de têtes avaient déjà été sacrifiées à cette affreuse vengeance. Trois citoyens dévoués se décidèrent enfin à porter le cri de la douleur commune à la barre de la Convention, et Fontanes composa pour eux un discours modéré de langage et de sentiments, mais qui emprunte au seul exposé des faits une telle énergie que des frémissements de pitié éclatèrent au sein de cette assemblée que l’horreur du sang n’avait cependant pas toujours attendrie. Voici un passage de ce discours: «A peine le jugement est-il prononcé, que ceux qu’il condamne sont exposés en masse au feu du canon chargé à mitraille, ils tombent les uns sur les autres, frappés par la foudre, et, souvent mutilés, ont le malheur de ne perdre à la première décharge que la moitié de leur vie. Les victimes qui respirent encore, après avoir subi ce supplice sont achevées à coups de sabres et de mousquets. La pitié même d’un sexe faible et sensible a semblé un crime: deux femmes sont traînées au carcan [p.125] avoir imploré la grâce de leurs pères, de leurs maris et de leurs enfants. On a défendu la commisération des larmes. La nature est forcée de contraindre ses plus justes et ses plus généreux mouvements, sous peine de mort. La douleur n’exagère point ici l’excès ses maux; ils sont attestés par les proclamations de ceux qui nous frappent. Quatre mille têtes sont encore dévouées au même supplice; elles doivent être abattues avant la fin de frimaire. Des suppliants ne deviendront point accusateurs: leur désespoir est au comble, mais le respect en retient les éclats; ils n’apportent dans ce sanctuaire que des gémissements et non des murmures.» La pitié de la Convention ne fut pas de longue durée. Collot d’Herbois accourut de Lyon et se justifia. Les trois envoyés furent mis en arrestation et Fontanes, dénoncé par un homme qui avait reconnu dans la supplique la main d’un ancien rival littéraire, fut obligé de se cacher pour se soustraire à la mort. Cependant, au milieu des agitations sociales, sa réputation avait grandi; quand après le 9 thermidor la fin de la terreur et l’apaisement des esprits permirent de reprendre les travaux de la paix, il fut nommé membre de l’institut qui venait d’être créé, et professeur au collège des Quatre_Nations. Dès lors il exposa nettement dans sa chaire sa théorie littéraire, et dans les journaux ses principes politiques. En politique il voulait la modération, la conciliation; il inclinait aux idées monarchiques modifiées par les conquêtes libérales de 89. En littérature il professa le culte de l’école de Racine et de Boileau, et s’attaqua à la nouvelle doctrine qui, pour rabaisser le XVIIe siècle au profit de la révolution, prétendait que le siècle du goût, chez les différents peuples, ne fut jamais celui de la philosophie et de la raison. [p.126] Notons ce fait: il est facile d’y reconnaître le point de départ d’un antagonisme dont nous aurons à parler tout à l’heure, d’un antagonisme devenu célèbre et qui de nos jours pèse encore sur la mémoire de Fontanes. Comme on le voit, les opinions politiques et littéraires du nouveau professeur étaient trop liées les unes aux autres pour ne pas partager le même sort. Elles furent également poursuivies, et, quand arriva fructidor, il fut proscrit avec tous les rédacteurs du Mémorial et se réfugia en Angleterre. Rentré secrètement en France, peu de temps avant le 18 brumaire, il vivait ignoré dans Paris, lorsqu’il fut désigné par Maret à Bonaparte pour prononcer dans le temple de Mars (l’hôtel des Invalides) l’éloge funèbre de Washington. Trois jours seulement lui furent accordés pour prononcer ce discours. C’est sans doute pour cette raison que le portrait de Washington y est faiblement accentué, et peint un peu de fantaisie; qu’on n’y rencontre pas, selon l’expression de Sainte-Beuve, ces traits de forme qui gravent le fond; mais en revanche on y retrouve à un haut degré les qualités ordinaires de l’auteur, le goût, la mesure, un style clair, limpide, l’habileté à insinuer les conseils sous la forme la plus capable de, les faire accepter. Ce discours dans les circonstances où il fut prononcé était une œuvre d’apaisement, un appel à la clémence: les allusions les plus délicates y relevaient avec respect ce que la révolution avait foulé aux pieds; l’ombre même de Marie-Antoinette y recevait un commencement de réhabilitation. L’orateur s’attacha à faire briller dans le héros qu’il célébrait les qualités qu’il aurait souhaitées dans le héros qui l’écoutait, la modération dans la victoire, le bon sens dans l’organisation politique de son pays, et surtout le désintéressement, l’abnégation de soi-même. [p.127] «S’il n’eût été, dit-il, en parlant de Washington, qu’un ambitieux vulgaire, il eût pu accabler la faiblesse de toutes les factions divisées, et lorsque aucune constitution n’opposait de barrière, il se serait emparé du pouvoir, avant que les 1ois en eussent réglé l’usage et les limites. Mais ces lois furent provoquées par lui-même avec une constance opiniâtre. C’est quand il fut impossible à l’ambition de rien usurper, qu’il accepta du choix de ses concitoyens l’honneur de les gouverner pendant sept années; il avait fui l’autorité quand l’exercice pouvait en être arbitraire; il n’en voulut porter le fardeau que quand elle fut resserrée dans des bornes légitimes.» Le discours tout entier est dans cet esprit. Etait-ce là le langage qu’attendait de l’orateur celui qui avait commandé l’éloge? on peut en douter. Pour l’un comme pour l’autre Washington ne fut, pour ainsi dire, qu’un prétexte: l’un, en faisant célébrer le libérateur de l’Amérique, voulait faire penser au sauveur de la France; l’autre, en vantant le désintéressement patriotique du chef d’une république naissante, voulait surtout le proposer comme exemple au chef d’une autre république que des projets ambitieux menaçaient de sa destruction. Cependant le conseil fut reçu d’assez bonne grâce. Peut-être au fond Bonaparte n’était-il pas fâché qu’on le crût encore, pour le moment, sur la ligne de Washington; il avait pourtant déjà fait les premiers pas sur celle de Cromwell. Fontanes reçut donc un bon accueil; son discours d’ailleurs renfermait pour le premier consul des louanges indirectes de nature à le flatter. Celui-ci voulut s’attacher un homme si habile dans l’art de bien dire; et dont le caractère modéré ne pouvait lui donner aucun ombrage; toutefois il ne lui accorda définitivement sa faveur, que quand le suffrage de ses concitoyens l’eut [p.128] élevé aux honneurs de la représentation nationale. Les deux ou trois années que Fontanes passa encore avant d’entrer dans les grandes positions officielles, furent consacrées à la critique. Nous avons dit, dans notre première partie, qu’il reçut de La Harpe le sceptre de cette royauté de l’intelligence qu’il transmit lui-même à l’illustre secrétaire dont l’Académie regrette la perte récente. S’il n’exerça pas une moins grande influence que son devancier et son successeur, il n’a pourtant pas fourni une carrière aussi complète; on ne peut pas dire qu’il ait comme eux élevé son monument. Ses articles disséminés dans le Spectateur du XIXe siècle attestent en général une grande sûreté de goût, mais ne constituent pas un ensemble solide et durable comme le Lycée ou le Tableau de la littérature au XVIIIe siècle. Il a porté sur plusieurs de ses contemporains, Duclos, Marmontel, Mirabeau, et surtout Thomas des jugements que le temps a confirmés; mais sa gloire comme critique est attachée au nom de Chateaubriand, de même que bientôt sa gloire comme orateur sera attachée à celui de Napoléon. On lui doit non-seulement d’avoir lancé dans le monde littéraire le Génie du Christianisme, mais, pour ainsi dire, de l’avoir fait ce qu’il est. C’est une chose remarquable que l’influence des circonstances et des événements de la vie sur nos opinions. Le hasard d’une fantaisie académique avait jeté J.-J. Rousseau dans le paradoxe; le hasard d’une rencontre dans l’exil, et l’amitié qui s’ensuivit, fit du dernier des classiques le promoteur de l’école romantique. Son goût comme critique, et son talent comme écrivain semblèrent faire divorce. Mais est-ce seulement à l’amitié qu’il en faut attribuer l’honneur, et ce divorce n’est-il pas plus apparent que [p.129] réel? Nous avons vu, en analysant les poèmes de Fontanes, qu’il ne se refusait pas aux innovations dans lesquelles il trouvait quelque rapport avec l’école qu’il vénérait, et qu’il fut lui-même, par certaines nuances de ses poésies élégiaques, comme un intermédiaire entre Racine et l’auteur des Méditations. Les divergences d’écoles ne seraient-elles pas un peu comme les côtés d’une pyramide dont l’écart, très sensible dans les couches inférieures, diminue et s’efface à mesure qu’on approche du sommet? S’il en est ainsi, celui qui avait admiré la poésie calme et majestueuse d’Homère, les belles descriptions du Télémaque, les grandes pensées et les images hardies de Bossuet, n’avait pas été sans trouver, dans les pages du Génie du Christianisme, bien des notes en juste accord avec ces modèles. Quoi qu’il en soit, tout ce que fit Fontanes pour les livres de Chateaubriand est touchant d’intérêt. Un père a moins de soin du salut de son fils. Tel qu’il avait été connu d’abord, le Génie du christianisme devait manquer son but: le plan en était incohérent, le style âpre et rude; la pensée avait quelquefois du fiel: ce n’était pas là le caractère d’un livre destiné à faire apaisement. Dans ses longs entretiens avec son ami, dans sa correspondance active, quand ils .sont séparés, Fontanes s’attache à montrer l’esprit qui son vient à ce genre d’ouvrage; il critique les preuves mal appuyées, il veut pour le fond une érudition exacte, et dans le style de l’élévation sans déclamation, de l’émotion sans efforts, un ton général en accord parfait de douceur et de sensibilité avec la nature des idées. II met lui-même la main à1’œuvre, et quand enfin, favorisé par toutes les circonstances, le livre fait son entrée dans [p.130] monde littéraire, deux articles d’un éloge discret, inséré par lui dans le Mercure, font plus, pour le produire, que tout le tapage de La Harpe converti mais usé! Chateaubriand, d’ordinaire si mobile dans ses sentiments comme dans ses idées, conserva toujours pour le talent de Fontanes la plus constante estime, comme pour sa personne la plus tendre affection. «J’ai reçu de lui, dit-il dans ses Mémoires, d’excellents conseils; je lui dois ce qu’il y a de correct dans mon style; il m’apprit à respecter l’oreille, il m’empêcha de tomber dans l’extravagance d’invention et le rocailleux d’exécution de mes disciples.» Un tel aveu sorti d’une telle bouche pourrait suffire à la réputation d’un critique. Malheureusement ici, à côté du nom de Chateaubriand, vient se placer un autre nom, qui fait ombre au tableau, c’est celui de Mme de Staël. Comment un homme qui venait de tendre à l’école moderne une main amie, comment l’admirateur d’Atala fut-il si longtemps sourd à l’auteur de Corinne? II n’est pas sans intérêt de rechercher les causes de cette hostilité qui, malgré la modération relative de la forme, alla sinon jusqu’à l’injustice, au moins jusqu’à l’aveuglement. Le caractère bien connu de Fontanes nous permet d’écarter d’abord toute supposition de basse envie. Personne, moins que lui, ne ressentit les jalousies littéraires. Il savait que Chateaubriand le dépasserait, et il le proclamait sans arrière-pensée. Son caractère modéré, sympathique même, se montrait en toute chose. Dans sa lutte contre M de Staël, s’il emploie parfois l’ironie piquante, il ne va jamais jusqu’à manquer à la délicatesse. Il n’eût certainement pas été aussi loin que Chateaubriand qui, dans une lettre contre cette femme célèbre [p.131] se permit cette phrase peu chevaleresque pour un gentilhomme. «En amour Mmc de Staël a commenté Phèdre; ses observations sont fines, et l’on voit par la leçon du scoliaste qu’il entendait parfaitement son texte.» La forme critique de Fontanes est plus courtoise, plus digne, et ce n’est pas lui sans doute qu’elle voulait désigner quand elle disait avec plus d’amertume peut-être que de modestie: «L’opinion semble dégager les hommes de tous les devoirs envers une femme à laquelle un esprit supérieur serait reconnu. On peut être ingrat, perfide, méchant envers elle, sans que l’opinion se charge de la venger; n’est-elle pas une femme extraordinaire?» Fontanes sans doute fut sévère pour Mme de Staël, mais il ne s’attaqua qu’à son système; il ne fut jamais à son égard ni perfide ni méchant. Il se plaît même plus d’une fois à constater son mérite il approuve son admiration pour Rousseau; après avoir loué dans son livre De la Littérature plusieurs beaux chapitres, notamment sur l’invasion des peuples du Nord, il ajoute: «On indique à l’avance les parties louables pour se dédommager des critiques qu’exigent le goût et la raison, mais qu’on ne voit tomber qu’à regret sur le livre d’une femme célèbre, si recommandable à tant d’égards.» Plus loin, après avoir rappelé les conversations brillantes de M de Staël, ces conversations si pleines de feu et de génie dont ses ouvrages, quelque mérite qu’on y trouve, ne sont, suivant l’expression de M. Villemain, qu’une épreuve affaiblie, il termine en disant: «Ceux qui l’écoutent ne cessent de l’applaudir. Je ne l’entendais pas, quand je l’ai critiquée; si j’avais eu cet [p.132] avantage, mon jugement aurait été moins sévère, et j’aurais été plus heureux.» Voilà, il faut bien le reconnaître, une forme de critique qui p’a rien de personnel ni d’injurieux, et c’est un mérite dont ne pouvaient pas se vanter toujours les adversaires de Fontanes qui ont pris parti pour Mme de Staël. Quelle est donc au fond la raison de son opposition? Etait-ce déférence pour le pouvoir qui poursuivait alors M de Staèl avec une persistance qui atteste plus l’importance de l’opprimée que la grandeur d’âme de l’oppresseur? Que cette considération ait retardé la réconciliation qui se fit plus tard, nous le croirons sans peine; mais l’antagonisme remonte plus haut que les relations de Fontanes avec le premier consul. Nous en avons indiqué tout à l’heure l’origine et le point de départ. Précisons l’état des esprits à cette époque de 1796. Ce fut le moment heureux du Directoire. La France sortie de sa stupeur semblait renaître à l’espérance. On osait former des plans d’avenir. En littérature, comme en politique, on sentait que c’en était fait de l’ancien régime, et que la France avait besoin de respirer un air nouveau. Deux partis se trouvèrent en présence. Le premier rêvait le retour aux formes monarchiques, non plus à ta monarchie absolue de Louis XIV, elle était à jamais condamnée dans l’esprit des peuples, mais à une monarchie libérale qui s’appuierait sur les droits de la nation. Ce même parti, qui comptait dans ses rangs La Harpe, Fievée, Lacretelle, Michaud, voulait aussi la régénération des esprits par le sentiment religieux et une forme littéraire plus libre que par le passé. L’autre parti, plus hardi, tenait à la Constitution de l’an III. Tout en condamnant les hommes de sang qui avaient déshonoré les [p.133] institutions républicaines, il persistait à les considérer comme étant les plus conformes aux progrès des sociétés. Quant à la régénération intellectuelle, il l’attendait du fait même de ces institutions et de la perfectibilité indéfinie de l’esprit humain dont Condorcet avait posé le dogme. Ce parti fut soutenu par des hommes de talent, Garat, Chénier, Daunou, Cabanis, Ginguené, Rœderer, Benjamin Constant. La lutte fut vive, et si le Directoire eût été viable, le programme tracé par Daunou dans son discours à l’ouverture de l’Institut eût pu être réalisé; on eût peut-être consommé, sous un gouvernement républicain, l’alliance des sciences, de la philosophie et des lettres. Telle était la situation en 1796. Fontanes, esprit modéré, timide, peu novateur, fut pour les monarchiens (comme on disait alors par mépris). Tout son passé l’enchaînait à ce parti, lui qui avait quitté la révolution au lendemain de la fédération. M de Staël, d’une imagination plus hardie, d’un cœur plus chaleureux, s’attacha au système de la perfectibilité, et comme le mouvement politique était étroitement uni au mouvement littéraire, l’apologiste de Marie-Antoinette se fit républicaine sans répudier ses anciennes sympathies; exempte de faiblesse comme de duplicité, elle tint à conserver tous ses amis, et, comme ces temples qui, à la même époque servaient le matin au culte catholique, et le soir à celui de la déesse Raison, son salon eut dans chaque décade des jours réservés aux Montmorency, d’autres à Benjamin Constant et aux écrivains du Conservateur. Cette situation suffirait pour marquer la ligne de dissentiment entre Fontanes et M de Staël. On conçoit que cette ligne devint plus profonde encore le jour où Mme de Staël, résumant la doctrine philosophique de ses amis [p.134] républicains sur la perfectibilité, donna son ouvrage De la Littérature. C’était justement la contre-partie du Génie du Christianisme qui n’avait pas encore paru, et dont Fontanes retardait la publication, soit qu’il le jugeât nécessaire dans un intérêt de perfectionnement, soit qu’il entrevît que l’heure favorable allait bientôt sonner, et qu’on ne pouvait que gagner à l’attendre. Le moment était donc critique; le livre De la Littérature était soutenu par son mérite d’abord, puis par l’attrait d’idées nouvelles capables de séduire un peuple à la recherche en effet d’une nouvelle voie. Il avait toutes les qualités qui excitent l’enthousiasme. De plus il entrait le premier dans la lice, et allait prendre les avantages de la position. Fontanes comprit lé danger, et montra d’autant plus d’ardeur à défendre son ami, qu’il n’avait pas besoin pour cela de fausser ses principes littéraires. L’ouvrage de M de Staël remarquable par le talent, était cependant attaquable par plus d’un côté. L’auteur y passait en revue les littératures anciennes, et dominée par cette idée contraire à l’expérience que les lettres doivent grandir avec les institutions républicaines, elle y portait des jugements pour lesquels de profondes études eussent mieux valu que l’enthousiasme. C’est toujours une entreprise dangereuse que vouloir plier l’histoire à une opinion préconçue. Alors, même avec du génie, on tombe dans le paradoxe. C’est ainsi que Mme de Staël donne en littérature aux Romains comme plus républicains la supériorité sur les Grecs; qu’elle refuse à ces derniers la sensibilité; qu’elle fait de la mélancolie un sentiment moderne, comme si l’âme humaine était soumise à la même loi de que les découvertes dans les sciences. La conclusion du livre c’est qu’avec l’austérité des mœurs républicaines (ceci se disait sous le Directoire) le [p.135] caractère de la littérature sera le triomphe de l’esprit du Nord sur celui du Midi, du genre grave sur le genre léger. Ainsi Ossian doit être placé au-dessus d’Homère, et l’école qui nous vient d’Angleterre et d’Allemagne d faire pâlir l’école française du XVIIe siècle. C’était, on le voit, blesser Fontanes par son endroit le plus sensible, et l’on sait, en ce qui concerne la littérature du Nord, que son siège était fait depuis longtemps. Il opposa à ce système toute la force de ses convictions et même, il faut bien le dire, les préjugés de sa religion littéraire. Timide dans ses vers, circonspect dans ses discours, Fontanes était absolu dans sa critique, et cet absolutisme, qui faisait sa force dans le système qu’il avait adopté, devait nécessairement le rendre injuste. Tous les critiques ont de ces lacunes. Cependant l’erreur d’un homme supérieur n’est jamais complète. L’injustice de Fontanes, par rapport au livre de Mme de Staël est moins dans ce qu’il a dit que dans ce qu’il a omis. Il n’avait vu qu’une partie de la vérité. C’est ainsi que plus tard, s’obstinant à nier Lamartine, comme autrefois Boileau devenu vieux avait renié Regnard, il dit au prince de Talleyrand qui l’interrogeait sur le livre des Méditations: «Sans doute il y a de beaux vers dans l’ouvrage de ce jeune homme, mais, ou je me trompe fort, ou il n’a que cela dans le ventre.» Ainsi il méconnut Lamartine parce qu’il ne saisit dans ce talent, si original et si frais pour ceux qui en ont eu la primeur, que le côté par lequel il aura peut-être à redouter la fatigue du temps. Quoi qu’il en soit, Fontanes, trop attaché sans doute au passé, a manqué de pénétration en refusant de reconnaître tout ce que la France. doit à l’intelligence si élevée si généreuse de Mme de Staël, les richesses dont [p.136] elle nous a dotés en abaissant pour nous cette barrière du filin, jusqu’alors si difficile à franchir, les horizons nouveaux qu’elle a ouverts à nos poètes et à nos penseurs, cette vie plus jeune et plus fière qu’elle a imprimée à notre littérature. Ce fut donc là son tort; mais ce tort qu’il nous est bien facile de lui opposer, aujourd’hui que la marche du temps l’a consacré, n’eut rien d’une animosité personnelle et jalouse, il a son explication et son excuse dans les circonstances qui l’ont produit c’est tout ce que nous avons voulu constater. Ce qui nous reste à dire sur M. de Fontanes, n’appartient pas moins à l’histoire qu’à l’analyse littéraire, car ceux de ses écrits que nous avons encore à examiner sont en même temps des actes de sa vie politique. Nous touchons à l’année 1804: le poète et le critique s’effacent pour laisser la place à l’homme d’Etat. Déjà depuis deux ans Fontanes, pressentant sa destinée et ne voulant rien faire qui pût l’entraver, avait déclaré qu’il resterait désormais étranger à la rédaction du Mercure. Soit qu’il craignît de ne plus trouver dans ses nouvelles charges les loisirs nécessaires pour soutenir sa réputation comme écrivain, soit plutôt qu’il jugeât qu’un homme revêtu des plus graves fonctions ne devait pas affaiblir son prestige dans des luttes littéraires, jeter chaque jour sa pensée au vent de la discussion, ou laisser voir trop à découvert une âme de poète, toujours est-il qu’il cessa dès lors d’écrire pour le public. Est-ce à dire pour cela qu’il abdiqua complètement ses anciens titres? Il n’aurait pu sans ingratitude abandonner les lettres qui lui avaient procuré de douces jouissances, qui avaient fait sa gloire, et lui avaient ouvert le chemin de la fortune. D’ailleurs il éprouva plus d’une fois que dans les hautes positions on ne trouve pas toujours le bonheur [p.137] à côté de la considération, et sa nature qui aimait surtout l’abandon, sentait le besoin de réagir de temps en temps, par des plaisirs de son choix, contre la gêne à laquelle sa vie était condamnée. 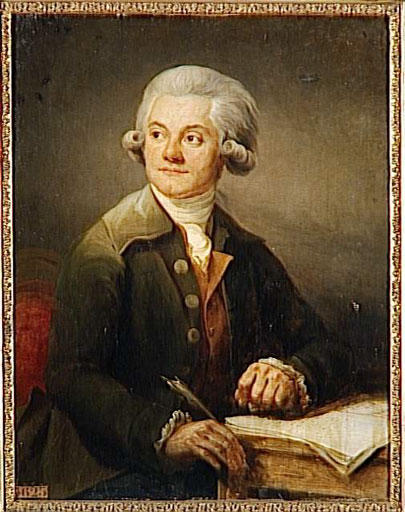 Il continua donc à cultiver la poésie, mais pour lui- même
et pour un petit cercle d’amis fidèles. Chose étrange! ce
fut quand, renonçant aux grands ouvrages, il ne demanda plus à
sa Muse que d’agréables passe temps, qu’elle lui fournit ses plus
pures inspirations. C’est dans sa retraite de Courbevoie, pendant les dix
années du régime impérial, qu’il composa les petites
odes qui, comme nous l’avons vu, forment le plus beau fleuron de sa couronne
poétique.
Il continua donc à cultiver la poésie, mais pour lui- même
et pour un petit cercle d’amis fidèles. Chose étrange! ce
fut quand, renonçant aux grands ouvrages, il ne demanda plus à
sa Muse que d’agréables passe temps, qu’elle lui fournit ses plus
pures inspirations. C’est dans sa retraite de Courbevoie, pendant les dix
années du régime impérial, qu’il composa les petites
odes qui, comme nous l’avons vu, forment le plus beau fleuron de sa couronne
poétique.Durant cette même période, il ne fit pas plus défaut à la critique qu’à la poésie. Mais c’est toujours au milieu de ce même cercle d’amis, dont quelques-uns étaient déjà célèbres, que son esprit si vif et si brillant, son jugement si sûr et si prompt se donnaient carrière et dictaient des arrêts. Il censurait avec eux cette même littérature qu’il attaque avec tant de vigueur dans son ode sur la décadence des lettres françaises; il lisait ou se faisait lire leurs ouvrages, les corrigeait, et, ce qui est digne de remarque, c’est que les idées, les images qui quelquefois se présentaient trop lentement quand il composait pour lui-même, arrivaient toujours avec profusion quand il reprenait les œuvres d’autrui. Et qu’on ne pense pas que ce fut un faible mérite d’avoir ainsi exercé la souveraineté du goût dans un groupe qui comptait parmi les plus fidèles: Chateaubriand, Joubert, Chênedollé, Guéneau de Mussy. Ce n’était pas non plus une âme matérielle et vulgaire, celle qui sut retenir toute sa vie, dans les liens de la plus étroite intimité, des hommes que leurs opinions tenaient souvent très éloignés de sa ligne politique. [p.138] Il est touchant de voir dans toutes leurs correspondances, et particulièrement dans une lettre de Chênedollé, à la mort de M. de Fontanes, l’affection de ces hommes distingués pour celui qu’ils consultaient comme un oracle, et qu’ils regardaient comme l’étoile de leur destinée littéraire. Mais nous avons fini sur ce sujet: revenons à l’orateur officiel de l’Empire, et au futur grand-maître de l’Université. Ici nous trouvons le nom de Napoléon tellement associé à celui de Fontanes, qu’il nous a paru digne d’intérêt de rechercher comment s’établirent entre eux des relations qui devinrent presque aussi nécessaires à l’un qu’à l’autre, et qui soutenues, d’un côté par l’admiration, de l’autre par l’estime, n’allèrent cependant jamais jusqu’à une entière confiance. M. de Fontanes ne manquait pas d’habileté ni peut-être d’ambition: nous ne l’en blâmons pas, puisque, parvenu à une situation élevée, il l’a honorée par son caractère intègre et par les nombreux services qu’il a rendus. De bonne heure il entrevit la haute fortune où était appelé le vainqueur de l’Italie, et l’on peut croire qu’il ne fut pas fâché d’attirer sur lui les regards du jeune conquérant. Deux lettres nous paraissent avoir dû contribuer à le faire distinguer dans le nombre des écrivains de talent parmi lesquels Bonaparte eut à choisir ceux qu’il voulait associer, comme agents secondaires, à ses vastes projets. La première, qui est datée du 15 août 4797, n’était destinée qu’aux journaux, bien qu’adressée au général commandant l’armée d’Italie. C’est une sorte de boutade moitié élogieuse, moitié satirique, dans laquelle l’auteur, faisant une belle part au génie du générai, lui parle des grands desseins qu’il lui suppose avec une liberté de [p.139] langage, qui n’eût plus été tolérée quelques années plus tard, mais qu’on pouvait encore se permettre à l’égard d’un héros de vingt-neuf ans, qui possédait déjà la gloire, mais non encore la puissance. Voici quelques passages de cette lettre, que nous avons abrégée: «Brave général, tout a changé, tout doit changer encore, a dit un écrivain politique de ce siècle. Vous hâtez de plus en plus l’accomplissement de cette prophétie de Raynal. J’ai déjà annoncé que je ne vous craignais pas, quoique vous commandiez 80,000 hommes, et qu’on veuille m’en faire peur en votre nom. Vous aimez la gloire, et cette passion ne s’accommode pas des petites intrigues et d’un rôle de conspirateur subalterne auquel on voudrait vous réduire. Il me paraît que vous aimez mieux monter au Capitole, et cette place est plus digne de vous. Je crois bien que votre conduite n’est pas conforme aux règles d’une morale très sévère; mais l’héroïsme a ses licences, et Voltaire ne manquerait pas de dire que vous faites votre métier d’illustre brigand, comme Alexandre et comme Charlemagne. Cela peut suffire à un guerrier de vingt-neuf ans…. «…….Savez-vous que, dans mon coin, je m’avise de vous prêter de grands desseins? Ils doivent, si je ne me trompe, changer les destinées de l’Europe et de l’Asie…… «…….Ainsi, je ne serais pas étonné que vous eussiez conçu le projet hardi de planter à la fois l’étendard français sur les murs du Vatican et sur les tours du Sérail. Ce serait, il faut en convenir, une étrange manière de renouveler l’empire d’Orient et celui d’Occident….. «……..Vous préparez de mémorables événements à l’histoire. Il faut l’avouer, si les rentes étaient payées, et si l’on avait de l’argent, rien ne serait plus intéressant [p.140] au fond que d’assister aux grands spectacles que vous allez donner au monde. L’imagination s’en accommode fort, si l’équité en murmure un peu…….. «……..Une seule chose m’embarrasse dans votre politique. Vous créez partout des constitutions républicaines. Il me semble que Rome, dont vous prétendez ressusciter le génie, avait des maximes toutes contraires. Elle se gardait d’élever autour d’elle des républiques rivales de la sienne….. Mais vous avez peut-être là-dessus, comme sur tout le reste, votre arrière-pensée, et vous ne me la direz pas……. «……..Suivez vos grands projets, et surtout ne revenez à Paris que pour y recevoir des fêtes et des applaudissements.» Ce mélange singulier de louange, de critique et de conseil, mais où la louange visait si haut, était en somme de nature à plaire à Bonaparte, dans un de ses rares moments de gaîté, et il n’est pas impossible que de ce jour-là il ait noté Fontanes. Mais ce qui l’est moins encore, c’est que cette lettre ait contribué pour une bonne part à la mesure que prit, quinze jours après, le Directoire, en condamnant à la déportation une légion de journalistes, et parmi eux les rédacteurs du Mémorial. L’autre lettre est plus personnelle, et plus directement intentionnelle. C’était à la suite du 18 brumaire. Fontanes, toujours obligé de se cacher, par suite de la proscription qui pesait sur lui, mais sentant bien que le premier consul pourrait se faire un plaisir calculé de dédommager ceux qui avaient à se plaindre du Directoire lui écrivit: «Je suis opprimé, vous êtes puissant, je demande justice. La loi du fructidor m’a compris dans la liste des [p.141] écrivains déportés en masse, et sans jugement….. J’ai souffert, comme si j’avais été légalement condamné, trente mois de proscription. Vous gouvernez et je ne suis pas encore libre...» Après avoir protesté de la modération de ses opinions à toutes les époques, il ajoute: «Si j’ai gémi quelquefois sur les excès de la révolution, ce n’est pas parce qu’elle m’a enlevé toute ma fortune et celle de ma famille, mais parce que j’aime passionnément la gloire de ma patrie. Cette gloire est déjà en sûreté, grâce à vos exploits militaires. Elle s’accroîtra encore par la justice que vous promettez de rendre aux opprimés...» Il termine en disant que «les grands capitaines ont toujours défendu contre l’oppression et l’infortune les amis des arts, et surtout les poètes, dont le cœur est sensible et la voix reconnaissante…» Ce fut un mois après cette lettre que Fontanes prononçait l’éloge de Washington, et de ce moment sa position fut éclaircie. Attaché d’abord au cabinet de Lucien, alors ministre de l’intérieur, il ne resta que peu de temps dans ce poste secondaire, et nommé en 1802 député du département des Deux-Sèvres, son pays natal, il ne tarda pas à être élevé è. la présidence du Corps législatif, qu’il occupa pendant six années consécutives. A la même époque, il fut rétabli sur la liste de l’Institut, d’où il avait été rayé par le Directoire. C’est dans cet intervalle de six années, les plus glorieuses de l’Empire, que se placent les discours qui ont fait la réputation de M. de Fontanes comme orateur officiel. On reconnaît généralement dans ces discours un style correct et élégant, une belle simplicité, un accord parfait entre la pensée et l’expression, l’une toujours [p.142] élevée, l’autre toujours juste et naturelle, enfin cette forme supérieure qui, sentant sa force, dédaigne l’éclat et les faux ornements, caractère d’un esprit en pleine possession de lui-même, et d’un talent parvenu à sa maturité. M. Thiers, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire, dit, en citant l’éloge de Washington et le discours adressé au pape à l’occasion du Concordat, que Fontanes fut le dernier qui ait parlé la langue pure du XVIIe siècle. Sainte-Beuve, en rapportant ce jugement de notre grand historien, le confirme de son témoignage. Il entre à ce sujet dans des développements pleins d’intérêt, et où se révèlent ce coup d’œil pénétrant et ce jugement qui s’impose par sa netteté et sa lucidité, quand il prononce en parfaite indépendance. Après avoir démontré que les meilleurs prosateurs de notre époque, Villemain et Cousin, malgré leurs brillantes et incontestables qualités, mêlent à leur style, l’un certaines nuances spirituelles ou coquettes qui s’ingénient, l’autre de grands airs et une préoccupation de lui-même et de son sujet qui font sourire, il ajoute: «Chez Fontanes rien n’excède, rien n’atteste l’inquiétude personnelle; il peut l’avoir au dedans, mais on ne devine rien; il semble chez lui, il parle sa langue naturelle: c’est le suprême goût.» Cette qualité propre au XVIIe siècle, la perfection dans la simplicité, qui fait le charme des lecteurs attentifs, échappait sans doute à l’imagination rapide de M de Staël, ou peut-être cédait-elle à une petite vengeance de femme quand, faisant allusion au style de M. de Fontanes, elle disait avec plus de piquant que de vérité: «Un style semblable expose peu à la critique. Ces phrases, connues depuis longtemps, sont comme les habitués de la maison; on les laisse passer sans leur rien demander.» [p.143] Elle préférait l’écrivain dont les expressions étonnent ceux qui les lisent pour la première fois. On devine aisément qui elle voulait désigner par là. M de Staël n’aurait peut-être plus aujourd’hui le même goût pour les expressions qui étonnent, s’il lui était donné de voir l’abus qu’on en fait trop souvent pour couvrir le vide de la pensée. Tout en reconnaissant avec MM. Thiers, Sainte-Beuve, Villemain, Chateaubriand, le mérite des discours de Fontanes, nous ne prétendons pas qu’il soit orateur au même titre que Démosthènes ou Mirabeau. Mais nous n’acceptons pas non plus l’appréciation un peu dédaigneuse d’Arnault (un autre adversaire de Fontanes, et celui-là un adversaire ingrat) qui dit qu’on n’est pas orateur pour avoir fait des compliments de cour. Tout genre a sa perfection; l’étendue n’y fait rien, pourvu que le cachet du talent s’y reconnaisse. Il y a telle lettre de Mme de Sévigné qui vaut mieux que tout le Cyrus de Mlle de Scudéry. C’est un mérite de proportionner le cadre au. sujet. Par une raison semblable nous ne comprenons guère non plus qu’un des biographes de M. de Fontanes reproche à sa belle prose de manquer de véhémence, comme à ses vers de manquer du souffle brûlant de l’enthousiasme. Pour la poésie, le défaut est réel: nous n’avons pas à le justifier. Il n’en est pas de même pour la prose. Que la véhémence ne fût pas dans les ressources oratoires de Fontanes, soit; mais dans les conditions où il lui a été donné de porter la parole, il est heureux au contraire que la nature de son talent se soit trouvée d’accord avec les effets qu’il avait à produire. L’orateur qui parle au nom d’une grande assemblée législative, n’a pas liberté de donner carrière à des impressions personnelles. Son [p.144] langage doit être calme, sage, clair et précis comme la loi. Résumer les actes et les sentiments du corps qu’il représente, faire entendre au chef de l’Etat le vœu du pays, quelquefois en désaccord avec sa conduite; louer ce que la nation approuve, conseiller ce qu’elle désire, quand il n’est pas bon de rappeler ce qu’elle condamne, en un mot frapper à la porte du pouvoir sans la briser, selon la belle expression de d’Alembert, tel est l’objet de ces sortes de discours qui demandent de la dignité, de la mesure, de la prudence, quelquefois de l’habileté, rarement de l’émotion. Toutes ces qualités étaient dans le caractère de Fontanes et ce fut là son succès. C’est ici le lieu d’examiner le reproche. qui lui a été adressé d’avoir dans ses discours outré l’éloge de l’empereur à un degré tel que, pour trouver un exemple de pareil lyrisme, il faudrait remonter jusqu’au panégyrique de Trajan. Puisque ce rapprochement a été fait, constatons du moins une différence. Le discours de Pline le Jeune, tel que nous le possédons, est l’œuvre spontanée d’un courtisan qui veut flatter pour un but utile, à ce qu’il prétend, mais qui n’y était tenu par aucune convenance. Rien ne l’obligeait à consacrer un volume entier à la louange d’un homme qu’il avait déjà suffisamment loué dans le sénat. Au contraire les discours de Fontanes étaient réglés par un cérémonial. C’est par là que s’établissaient les rapports du Corps législatif avec le chef de l’Etat. Or qui ne connaît les exigences de ces harangues officielles, faites plus encore pour le public que pour celui à qui elles s’adressent, et qui, destinées à relever le prestige de l’autorité aux yeux de la multitude, commandent à l’orateur de s’inspirer moins encore de ses sentiments personnels que des devoirs de la mission qu’il remplit? [p.145] Si Fontanes a paru quelquefois outrer l’éloge à l’égard d’un homme qui, après tout, a fait de grandes choses, c’est qu’en louant, il voulait aussi instruire et conseiller. Or il savait (l’écrivain latin auquel on le compare le lui avait dit) «que s’il est beau d’instruire les princes de leurs devoirs, cette entreprise délicate, qui annonce presque de l’orgueil, est rendue plus facile par la louange qui fait accepter le conseil.» Mais cette raison elle-même, pas plus que son admiration pour un des plus rares génies dont la France puisse s’honorer, n’entraîna jamais sa conscience dans de honteux compromis. Si nous voulons savoir tout ce qui fut prodigué d’encens nauséabond, à cette époque d’effacement d’une nation devant un seul homme, c’est dans les paroles et dans les actes de ministres complaisants, de Fourcroy entre autres, que nous le trouverons bien plus que dans les discours de Fontanes. Pour lui, il n’oublia pas qu’il appartenait à la nation plus encore qu’au pouvoir. Aussi Chateaubriand lui a rendu justice, en disant «qu’il maintient la dignité de la parole sous un maître qui commandait un silence servile.» Si ce témoignage d’un ami paraît suspect, un adversaire nous en fournira un semblable. Le savant helvétien Stapfer, dans une lettre où il exprime ses inquiétudes sur l’esprit qu’apportera dans l’Université le nouveau grand maître, à cause de ses relations notoires avec ce qu’il appelle la clique de l’ancien Mercure, ajoute: «Néanmoins Fontanes est un beau talent comme écrivain, et le seul fonctionnaire qui sache louer l’empereur avec goût, et même avec une apparence d’indépendance.» Mais qu’est-il besoin de témoignages? Les discours subsistent: parcourons-les, nous trouverons à chaque pas des preuves à l’appui de cette appréciation. [p.146] 
Quand le premier consul, se sentant assez fort pour faire consacrer dans sa famille le pouvoir qui déjà ne devait plus sortir de ses mains, se fit proposer l’empire, Fontanes dans une adresse présentée à cette occasion par le Corps législatif, s’exprime ainsi sur le gouvernement monarchique: «Cette haute magistrature n’est instituée que pour l’avantage commun. Si elle est faible, elle tombe; si elle est violente, elle se brise, et dans l’un et l’autre cas elle mérite sa chute; car elle opprime le peuple, on ne sait plus le protéger. En un mot, cette autorité qui doit être essentiellement tutélaire, cesse d’être légitime, dès qu’elle n’est plus nationale.» Et un peu plus loin, dans le même discours: «On ne verra pas le silence de la servitude succéder au tumulte de la démocratie. Non, citoyen premier consul, vous ne voulez commander qu’à un peuple libre; il le sait, et c’est pour cela qu’il vous obéira toujours.» Vers cette même époque, le Corps législatif, sur la proposition du député Marcorelle, avait décidé d’élever une statue à l’empereur, en reconnaissance de la promulgation du Code civil. En inaugurant cette statue, au nom du corps qu’il représente, Fontanes dit: «La gloire obtient aujourd’hui la plus juste récompense, et le pouvoir en même temps reçoit les plus nobles instructions. Ce n’est point au grand capitaine que ce monument est érigé. Le Corps législatif le consacre au restaurateur des lois…» Tout son discours porte sur l’excellence des lois «qui font plus, dit-il, pour le bonheur des peuples que les trophées guerriers et les arcs de triomphe qui rappellent les malheurs des peuples vaincus.» Quand, le 5 mars 1806, de nouveaux impôt sont demandés [p.147] pour de nouvelles conquêtes, il dit dans sa réponse aux orateurs du gouvernement: «Quelles que soient au dehors la renommée de armes et l’influence de notre politique, le Corps législatif craindrait presque de s’en féliciter, si la prospérité intérieure n’en était pas la suite nécessaire. Notre premier vœu est pour le peuple: nous devons lui souhaiter le bonheur, avant la gloire.» Enfin (car il faut se borner) le 24 août 1807, le ministre Crétet, dans un exposé de la situation de l’empire, ayant vanté les avantages des dernières guerres, Fontanes dans sa réponse fit entendre ces sages paroles: «Pour que la guerre ait de tels avantages, il ne faut pas qu’elle soit trop prolongée, ou des maux irréparables en sont la suite: les champs et les ateliers se dépeuplent, les écoles, où se forment l’esprit et les mœurs, sont abandonnées, la barbarie s’approche, et les générations, ravagées dans leur fleur, font périr avec elles les espérances du genre humain.» Ce sont là de nobles pensées et un beau langage; mais quand on considère que toutes ces choses se disaient au milieu même des splendeurs et des gloires de l’empire, au milieu de l’enthousiasme qu’excitait le succès des grandes batailles, on se demande si un flatteur, un courtisan n’aurait pas su, dans de telles circonstances, trouver un autre thème à développer. Fontanes ne s’en tint pas seulement aux conseils. Il osa quelquefois résister au nom de sa conscience, quand le pouvoir, dans les inquiétudes ou les irritations que lui causait la résistance, se laissa entraîner à des mesures arbitraires, ou mêmes odieuses. C’est ainsi qu’il fit lever l’interdit qui arrêtait la publication du poème de la Pitié de Delille; c’est ainsi qu’il publia son ode à Chateaubriand, [p.148] au moment où celui-ci était persécuté: son dévouement pour ses amis croissait avec leurs périls; c’est ainsi encore que lors du procès Cadoudal, deux commissaires du gouvernement étant venus proposer un décret comminatoire portant la peine de mort contre tout individu qui recevrait chez lui les chefs de la conspiration, il s’opposa à la création des tribunaux extraordinaires, disant «que les lois seules ont le droit de condamner, et que le corps qui les sanctionne doit attendre leur jugement.» Il fut toujours ennemi des mesures violentes. En cela il servait mieux que par de lâches complaisances la cause de l’empire naissant. Il pensait qu’un gouvernement qui s’établit par le sang ne saurait prendre racine dans le cœur d’une nation généreuse. Quand il apprit de la bouche même de Bonaparte l’arrestation et la mort du duc d’Enghien, il témoigna hautement son indignation et s’éleva de toutes les forces de son âme contre cette violation du droit des gens, puisque le jeune prince avait été, enlevé sur une terre étrangère et n’était pas en état d’hostilité. «Il s’agit bien de cela, lui dit le premier consul; après-demain Fourcroy va clore la session législative. Dans son discours il parlera comme il convient du complot réprimé; dans le vôtre vous en parlerez de même, il le faut.» Fontanes protesta qu’il n’en ferait rien, et malgré les emportements de Bonaparte, il tint parole. Au discours fanatique de Fourcroy il répondit en parlant du Code civil et de l’influence des bonnes lois: «C’est par-là, dit-il, en insistant fortement sur les mots, que se recommande encore la mémoire de Justinien, quoiqu’il ait mérité de graves reproches.» [p.149] Ce fut ainsi qu’il rappela le fait qu’il avait ordre d’approuver. Deux jours après le Moniteur, en reproduisant un autre discours de Fontanes, avait dénaturé une phrase qui s’appliquait aux lois; par une habile substitution de mots, cette phrase pouvait être une allusion justificative à la mesure prise trois jours auparavant contre le duc d’Enghien. Fontanes courut aussitôt au bureau du Moniteur, exigea et obtint une rectification. Par cette attitude ferme et digne il gagnait de jour en jour dans l’estime de ses collègues, qui chaque année le portaient presque à l’unanimité en tête des candidats à la présidence; mais il n’en était pas de même du côté de l’empereur. Celui qui avait fait triompher sa volonté dans les conseils de l’Europe, supportait avec peine les leçons et les résistances, si adoucies qu’elles fussent, d’un homme qui lui devait sa fortune. Sa conscience ne pouvait refuser l’estime à un langage toujours conforme aux lois de la justice; mais ses instincts despotiques s’irritaient d’avoir à se heurter contre cette puissance irrésistible de la vérité et de la raison. Une circonstance détermina la fin de la lutte. En 1808, Napoléon avait envoyé d’Espagne douze drapeaux conquis en Estramadure et qu’il destinait au Corps législatif. Ils furent remis par l’impératrice qui dit, à cette occasion, qu’elle était heureuse que l’empereur eût tout d’abord voulu associer à ses triomphes le corps qui représentait la nation. On vit bientôt arriver d’Espagne pour le Moniteur une note fort longue, mais qui est trop curieuse pour que nous n’en citions pas textuellement au moins quelques passages. «Plusieurs journaux ont imprimé que S. M. l’impératrice, dans sa réponse à la députation du Corps législatif, avait dit qu’elle était heureuse que le premier sentiment [p.150] de l’empereur eût été pour le Corps législatif qui représente la nation. S. M. l’impératrice n’a pas dit cela; elle connaît trop bien nos constitutions; elle sait; trop bien que le premier représentant de la nation, c’est l’empereur. «Dans l’ordre de nos constitutions, après l’empereur est le sénat, après le sénat est le conseil d’Etat, après le conseil d’Etat, le Corps législatif…… Ce serait une prétention chimérique et même criminelle que de vouloir représenter la nation avant l’empereur….. «Le Corps législatif, improprement appelé de ce nom, devrait être appelé conseil législatif, puisqu’il n’a pas la faculté de faire des lois, n’en ayant pas la proposition. Le conseil législatif est donc la réunion des mandataires des colléges électoraux…..» Toute la note est dans cet esprit. Fontanes fut sensible à l’injure faite au corps qu’il présidait. Mais le coup partait de haut; il y fallait répondre avec prudence. Quinze jours après, dans le discours de clôture, il fit allusion aux drapeaux envoyés des bords de l’Ebre. Après les félicitations voulues à l’adresse du vainqueur, il ajouta: «Les paroles dont l’empereur accompagne l’envoi de ces, trophées méritent une attention particulière. Il fait participer à cet honneur les colléges électoraux. Il ne veut pas nous séparer d’eux, et nous l’en remercions. Plus le Corps législatif se confondra dans le peuple, plus il aura de véritable lustre. Il n’a pas besoin de distinction, mais d’estime et de confiance.» Si modéré que nous paraisse ce langage, avec nos habitudes politiques d’aujourd’hui, il ne fut pas jugé tel alors. De ce moment l’empereur résolut; de remplacer Fontanes dans le Corps législatif, et l’année suivante il en trouva le moyen, en lui confiant la réorganisation de [p.151] l’Université et en lui donnant une place au sénat. Dès lors, le, rôle politique de Fontanes était terminé: les nouvelles dignités qui lui étaient conférées n’étaient qu’une honorable disgrâce. Il put le reconnaître, quand, à la même époque, ses amis ayant entrepris l’impression de tous ses discours, le ministre de la police s’y refusa en ajoutant que c’était déjà trop de les avoir entendus une fois.  De grandes difficultés attendaient M. de Fontanes au début
de ses travaux pour la réorganisation universitaire. Il eut à
lutter contre le ministère de l’intérieur auquel ressortissait
l’instruction publique, et contre le conseil d’Etat qui n’en voulait pas
abandonner la direction, et contre l’empereur dont les idées absolues
s’imposaient dans toutes les branches de l’administration. Trois fois il
offrit sa démission, alléguant que de toutes ces compétitions
il cherchait vainement la place et le rôle du grand-maître. L’empereur
persista à la refuser. S’il était mécontent des libertés
que s’était permises le président du Corps législatif,
il n’en appréciait pas moins le mérité de Fontanes et
ses grandes capacités. D’ailleurs, et ce fut là sans doute
la raison dominante, son sens pratique lui avait dit que cet homme modéré
était, par ses antécédents politiques et ses sentiments
religieux le plus capable de rapprocher, sur le terrain neutre de l’éducation,
l’empire qu’il avait servi ouvertement et le parti royaliste qu’il avait
toujours ménagé; or, comme il n’entrait pas dans ses habitudes
de rompre avec ceux dont il pouvait avoir besoin, il fit quelques concessions
au grand-maître, et le maintint dans ses fonctions. Les pères
de famille applaudirent à cette décision.
De grandes difficultés attendaient M. de Fontanes au début
de ses travaux pour la réorganisation universitaire. Il eut à
lutter contre le ministère de l’intérieur auquel ressortissait
l’instruction publique, et contre le conseil d’Etat qui n’en voulait pas
abandonner la direction, et contre l’empereur dont les idées absolues
s’imposaient dans toutes les branches de l’administration. Trois fois il
offrit sa démission, alléguant que de toutes ces compétitions
il cherchait vainement la place et le rôle du grand-maître. L’empereur
persista à la refuser. S’il était mécontent des libertés
que s’était permises le président du Corps législatif,
il n’en appréciait pas moins le mérité de Fontanes et
ses grandes capacités. D’ailleurs, et ce fut là sans doute
la raison dominante, son sens pratique lui avait dit que cet homme modéré
était, par ses antécédents politiques et ses sentiments
religieux le plus capable de rapprocher, sur le terrain neutre de l’éducation,
l’empire qu’il avait servi ouvertement et le parti royaliste qu’il avait
toujours ménagé; or, comme il n’entrait pas dans ses habitudes
de rompre avec ceux dont il pouvait avoir besoin, il fit quelques concessions
au grand-maître, et le maintint dans ses fonctions. Les pères
de famille applaudirent à cette décision.Le système adopté par Fontanes dans le choix des [p.152] hauts fonctionnaires de l’Université a été diversement jugé. Quelque opinion qu’on ait à cet égard, il est impossible de ne pas rendre justice à deux sentiments qui l’ont dirigé en cette circonstance. D’abord il pensa qu’il fallait gagner la confiance des familles, en mettant à la tête de l’éducation des hommes d’une grande réputation, de sagesse et de vertu. Ensuite, il tint à honneur de placer le corps enseignant sous le patronage de tout ce qui avait un nom illustre dans les sciences et dans les lettres, quelque cause qu’ils eussent embrassée. Il ne tint compte que du mérite. Etranger lui-même à toute rancune politique ou littéraire, non-seulement il ouvrit les portes du conseil à des adversaires, mais il poussa l’oubli du passé jusqu’à proposer à la nomination de l’empereur des hommes que son despotisme rigoureux avait frappés. Sans doute, et c’est en cela qu’on a pu lui reprocher de n’être pas pratique, il résultait de ces choix si divers un ensemble peu fait pour s’accorder, mais l’administration paternelle de Fontanes, planant au- dessus de tous les dissentiments, vint à bout de bien des difficultés, et, somme toute, il rendit de grands services à l’enseignement public. C’est grâce à lui et à ses résistances que le régime militaire n’a pas complétement envahi les écoles, et transformé les lycées en casernes; il obtint la liberté réclamée pour les institutions privées, et s’il ne put supprimer l’impôt universitaire, il en adoucit la rigueur par de nombreuses dispenses. Il aimait la jeunesse, il aimait l’espérance (comme il l’appelait), il la recherchait, l’encourageait, et c’est sous ses auspices bienveillants que se sont formés et produits les professeurs qui à cette époque ont le plus honoré l’Université par leurs talents. C’est au milieu de ces importantes et pénibles fonctions, [p.153] auxquelles il s’était voué tout entier, qu’il vit s’accomplir en 1814 la révolution qui changeait une fois encore les destinées de la France. Fontanes, nous l’avons vu, était porté par goût pour les princes exilés. Dans son esprit il ne séparait pas les grandeurs littéraires de la France de la famille qui les lui avait données. Ce n’est pas qu’il aimât l’absolutisme de Louis XIV. Son héros, comme roi, c’était plutôt Henri IV dont l’éloge revient à chaque instant dans ses vers. Il aimait la tolérance, et on l’a vu, dans un poème couronné par l’Académie française, célébrer l’édit de Louis XVI en faveur des protestants, sur qui pesaient encore les effets de la révocation de l’édit de Nantes. Son rêve eût été de réaliser avec ce malheureux prince les réformes promises par le serment prêté à la Constitution. Son attachement à ces principes, qu’il montra aux époques les plus agitées de la révolution dans les journaux auxquels il collabora, dut être refoulé sans doute dans le temps de sa haute fortune politique; mais son âme sincère était incapable de dissimuler. Même à cette époque, et jusque dans ses discours officiels, des allusions le ramènent souvent au respect des grandeurs déchues. Napoléon ne s’y trompait pas; aussi écrivait-il un jour au duc de Bassano: «Fontanes veut de la royauté, mais pas de la nôtre; il aime Louis XIV, et ne fait que consentir à nous.» Il n’est donc pas surprenant qu’il ait adopté la Restauration; mais il le fit sans éclat, par inclination et non par calcul. Il n’eut pas le mauvais goût de chercher à flatter le nouveau maître en outrageant l’ancien, et il est faux qu’il ait, comme quelques-uns l’en ont accusé, rédigé lui-même l’acte de déchéance. Il avait salué avec un amour discret la royauté de son culte, mai il conserva [p.154] son admiration pour le génie qui avait, disait-il, plus fondé qu’on n’avait détruit. Lorsque, le 5 mars 1815, en apprenant le débarquement à Cannes, quelqu’un s’écriait devant lui: mais c’est effroyable c’est abominable! Fontanes ajoutait: et qui plus est, c’est admirable! Mais en même temps il s’échappa de Paris, pour se soustraire aux sollicitations qui déjà le pressaient de revenir à la cause de l’empire. Et pourtant il n’avait pas à se louer de la Restauration, dont un des premiers actes avait été de lui retirer ses fonctions de grand-maître. Enfin quand le gouvernement de Louis XVIII se fut affermi, Fontanes, appelé à la pairie, conserva toujours la même mesure dans sa conduite et dans son langage. Fidèle à sa politique de modération, il fut, dans le procès du maréchal Ney, du petit nombre de ceux qui votèrent contre la peine de mort. Libéral, tant que la réaction se montra trop ardente, il se rattacha plus étroitement aux principes monarchiques quand il vit le système contraire dominer la cour, et il se tint à égale distance de La Fayette et du pavillon Marsan. Du reste, sous la Restauration, son rôle politique fut de peu d’importance, et il était loin de le regretter. Sa nature le portait au culte désintéressé des lettres, plus qu’aux luttes parlementaires. Quelques discours académiques qui se rapportent à cette date, notamment celui qu’il prononça à l’installation des quatre sections de l’institut, attestent qu’il n’avait rien perdu, dans ses dernières années, de son beau talent d’écrivain. Il sut même, lui à qui on reprochait de la froideur, trouver des accents émus qui firent une vive impression sur l’Académie, quand recevant M. de Sèze dans cet illustre corps, il rappela en ces termes la condamnation de Louis XVI devant celui qui avait tant fait pour la conjurer: [p.155] «Enfin l’arrêt fatal est porté contre Louis. Ses vertueux défenseurs se voilent le visage et se réfugient dans le désert. Tout a pâli d’effroi, jusqu’à ses juges. Une consternation universelle s’est répandue dans la capitale jusqu’aux provinces les plus reculées, et ce jour-là, dans la France entière, il n’y eut de calme et de serein que le front de l’auguste victime.» Nous terminerons ici cette étude déjà trop longue. La tache à laquelle nous nous sommes limité, ne nous oblige nullement à pénétrer dans tous les détails de cette grande existence due à un grand talent. Ce n’est pas une œuvre en règle que nous avons entreprise, et c’est déjà une prétention de le faire remarquer à ceux qui nous ont entendu. Notre but plus modeste, parce que nous l’avons réglé sur nos forces, a été de rechercher dans les écrits de M. de Fontanes les derniers vestiges d’une école littéraire dont la France aura longtemps le droit d’être fière. Nous l’avons fait pour notre propre instruction, en prenant pour guides les juges les plus compétents. Des études auxquelles nous nous sommes livré, il résulte pour nous que si la poésie de M. de Fontanes manque souvent de chaleur, d’abondance et de mouvement, elle possède des qualités de correction, d’harmonie et d’élégance qui peuvent toujours être proposées comme modèles; que par ces mêmes qualités appliquées à la prose, M. de Fontanes a été très utile à l’idiome national que les luttes de la révolution, par l’exagération des idées et des mots, entraînaient à la décadence; que l’école moderne, loin de le dédaigner, devrait lui savoir gré d’avoir montré dans M. de Chateaubriand ce que peuvent gagner au respect de la langue et du goût le coloris brillant, les vives images, et tous les rajeunissements dont elle a enrichi notre littérature. [p.156] Enfin ne séparant pas l’intérêt de la morale de celui des lettres, nous ai cherché dans le caractère de M. de Fontanes la justification des succès qu’il a obtenus et des sympathies qu’il a excitées, et nous avons été heureux de reconnaître que, comme homme public, il a su conserver à la parole sa dignité alors qu’elle ne pouvait plus prétendre à la liberté, et qu’on ne doit pas lui reprocher la haute fortune où il est parvenu, puisqu’elle a été pour lui la récompense du mérite et l’occasion de faire le bien. |
||
|
APPENDICES
1) NOTE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE DE LÉON MARQUIS Les rues d’Étampes et ses monuments, Étampes, Brière, 1881, pp. 370-371 & 392 RIMBAULT (ANDRÉ), écrivain et philanthrope, né à Étampes le 3 mai 1814, mort le 10 novembre 1873. D’une famille des plus modestes, mais des plus estimée d’Étampes, il fit ses classes avec distinction au collège de cette ville. D’abord maître d’études, ensuite professeur d’humanités dans cet établissement, il en devint principal en 1844. Au bout de dix ans, il passa avec le même titre au collège de Pamiers, et l’année suivante à celui de Chartres. En 1868, après vingt-huit ans de principalat, il prit sa retraite et s’établit à Versailles; [p.371] mais il ne renonça pas pour cela à sa vie active: nommé membre de la commission de surveillance de l’École normale primaire et de la commission d’examen des aspirants au brevet de capacité, il rendit partout de grands services. Il était administrateur de la bibliothèque populaire, trésorier de la caisse des écoles, président de la Société des sciences morales et politiques de Seine-et-Oise au mois d’août 1872. Pendant l’occupation prussienne, il se signala par son dévoûment aux victimes de l’émigration. Tout le monde loue son désintéressement, sa charité et sa modestie, ressemblant sous ce rapport au vénérable abbé Buffet, son beau-frère. Dans les Mémoires de la Société des sciences morales de Versailles, il publia deux études remarquables sur Chamfort et Fontanes. Le premier, qui résida quelque temps à Vaudouleurs, près d’Étampes, mourut victime d’une révolution dont il s’était fait l’apôtre; le second fut élevé par la fortune aux plus hautes dignités de l’empire. Il mourut avant d’avoir pu terminer une étude sur Rivarol, l’un des esprits les plus brillants et les plus singuliers du XVIIIe siècle. Son corps repose dans le cimetière de Notre-Dame d’Étampes, où un beau monument lui a été élevé (1). (1) Études sur Chamfort et Fontanes, par A. Rimbault. Extrait du dixième volume des Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise. — Versailles, imp. de E. Aubert, 1874, in-8 de 108 p.» [cette note est à la p. 392]. [N.B. Sa tombe au cimetière de Notre-Dame ancien n’est pas signalée par Frédéric Gatineau: elle semble avoir disparue, ou bien n’est plus identifiable. (B.G., 2005)] 2) NOTE
D’ANTOINE ANQUETIL
A la suite de l’édition de son allocution du 6 décembre 1872 publiée en 1874 dans le même numéro que cette étude par la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, p. 6. Lorsque M. Rimbault prononçait cette allocution, il ressentait déjà depuis quelques mois les premières atteintes, du mal qui devait l’emporter le 10 novembre 1873. Le 15 mars il présida pour la dernière fois notre réunion hebdomadaire, et déjà l’altération de ses traits trahissait, malgré tous ses efforts, des douleurs qui ne lui laissaient aucun repos. Les études sur Chamfort et sur Fontane qu’on trouvera dans ce volume, disent assez quelle perte a faite notre Société, encore que l’auteur n’y eût pas mis la dernière main et qu’il se proposât d’en compléter ou d’en modifier certains passages, si la mort ne l’eût prévenu. (Note du Secrétaire perpétuel.) |
||
|
|
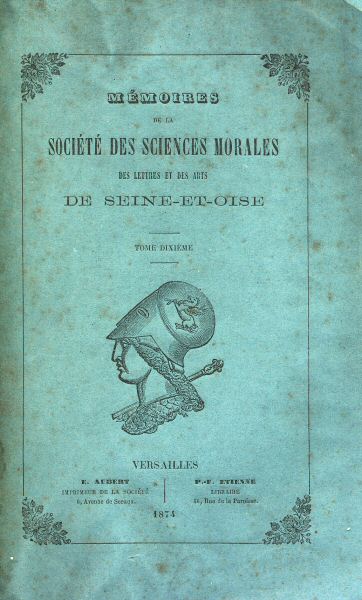 BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIEÉditions 1) article
original: André RIMBAULT, «Étude sur la vie et les œuvres
de Fontanes»
in Mémoires de la Société des sciences morales,
lettres et arts de Seine-et-Oise X (1874), pp. 95-156 [l’auteur étant mort
début 1873].
2) Extrait: André RIMBAULT, Étude sur Chamfort et Fontanes [in-8°; 108 p.; extrait des Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, X; avec une «Notice sur M. Rimbault» de H. de DURAND DE LAUR, vice-président], Versailles, E. Aubert, 1874. 3) Édition numérique en mode image: B.N.F. [éd.], «Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, X (1874)», in Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, pp. 95-156, ligne en 2005. 4) Étude numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «André Rimbault: Étude sur la vie et les œuvres de Fontanes (1873)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-19-rimbault1873fontanes.html, 2005. Autres
publications de Rimbault
André RIMBAULT,
«Allocution à l’occasion l’occasion de son installation comme
Président (6 décembre 1872)», in Mémoires de
la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise
X (1874) [dont une édition numérique en mode image
par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, en ligne en 2005; dont une édition numérique
illustrée en mode texte par le Corpus Étampois,
http://corpusetampois.com/cle-19-rimbault1872allocution.html,
2005], pp.
1-6.
André RIMBAULT, «Étude sur le caractère et les œuvres de Chamfort» in Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise X (1874) [dont une édition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, en ligne en 2005; dont une édition numérique illustrée en mode texte par le Corpus Étampois, http://corpusetampois.com/cle-19-rimbault1873chamfort.html, 2005], pp. 65-94. Sur Rimbault
Émile DELEROT (1834-1912) [Directeur de la bibliothèque de Versailles (1873-1899); cofondateur de l’Union libérale dans les dernières années du Second Empire; spécialiste de Goethe], Versailles pendant l'occupation. Recueil de documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande [grand in-8°; 332 p.], Versailles, Aubert, 1872. Deuxième édition [27 cm; III+332 p.; fac-similés], Paris, Plon & Versailles, Librairie de Versailles, 1873. Troisième édition [in-8°; VIII+496 p.; portrait], Versailles, Bernard, 1900. H. DURAND DE LAUR, «Discours de M. Durand de Laur, vice-président (séance de 15 janvier 1874)» [notices nécrologiques], in Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise X (1874) [dont une édition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, en ligne en 2005; dont un extrait numérique illustré en mode texte édité par le Corpus Étampois, http://corpusetampois.com/cle-19-duranddelaur1874rimbault.html, 2005], pp. 7-31 [il s'agit de trois notices nécrologiques, la dernière consacrée à Rimbault, pp. 7-8 & 27-31]. Léon MARQUIS, «Rimbault, André» [notice calquée sur celle de Durand de Laur], in ID., Les rues d'Étampes et ses monuments, Étampes, Brières, 1881, pp. 370-371, dont une réédition numérique en mode texte par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-marquis-rues06.html#rimbault, 2003. Portraits de Fontanes
Alphonse LAVANDAN, Louis, marquis de Fontanes, grand maître de l’Université (1757-1821) [huile sur toile de 216 cm sur 141, d’après un original de Robert LEFÈVRE], commandée par Louis-Philippe pour le musée historique de Versailles en 1846; conservée au Musée de Versailles, n° d’inventaire MV 4732; INV 4439; LP 6916 [dont un cliché mis en ligne sur la Base Joconde (© Popovitch & RMN), cliché extrêmement rouge, ici retravaillé]. Henri-Pierre DANLOUS (1745-1809) [attribution incertaine], Louis, marquis de Fontanes, grand maître de l’Université (1757-1821) [huile sur toile de 91 cm sur 72], conservée au Musée de Versailles, n° d’inventaire MV 4625 ; INV 9215 ; LP 3380 [dont un cliché mis en ligne sur la Base Joconde (© RMN & Gérard Blot)]. Charles BOUR, Louis de Fontanes [lithographie de 23,9 cm sur 15,8; d’après une peinture de Felix Henri Emmanuel PHILIPPOTEAUX (1815-1884)], sans date [dont une photographie mise en ligne par l’Harvard Law School Library, http://www.law.harvard.edu/library/collections/special/exhibitions/portrait_exhibit/Louis_marquis_de_Fontanes.php, en ligne en 2005]. Publications
plus récentes sur Fontanes
Rémy TESSONEAU [éd.], Correspondance de Louis de Fontanès et de Joseph Joubert (1785-1819). Texte intégral publié pour la première fois d’après les documents autographes avec une introduction et des notes par Rémy Tessonneau [in-16 (18,8 cm sur 12); XXIV+183 p.; portrait], Paris, Plon, 1943. Guy-Édouard PILLARD, Louis Fontanes ; 1757-1821, prince de l’esprit [24 cm; 390 p.; 7 folios de planches; bibliographie pp. 369-381], Maulévrier, Hérault, 1990 [ISBN 2-903851-87-5]. Norbert ALCER (1937-1992) Louis de Fontanes, 1757-1821: homme de lettres et administrateur [21 cm; 498 p.; thèse d’État de Lettre soutenu à l’université de Paris IV en 1988; préface traduite en allemand; bibliographie pp. 388-498], Frankfurt am Main & Berlin & Paris, P. Lang [«Publications universitaires européennes 13, Série XIII, Langue et littérature françaises; Europäische Hochschulschriften13, Reihe XIII, Französische Sprache und Literatur; European university studies13 Series XIII, French language and literature»], 1994 [ISBN 3-631-47269-2]. Beleuchtung der Rede des Grafen Fontanes über die vom französischen Kaiser gemachten Schritte zum Frieden [1 microfiche argentique; 10,5 cm sur 14,8; reproduction de l’éd. de, Deutschland [i.e. Leipzig], 1814], Hildesheim, G. Olms [«Anti-Napoleonische Pamphlete»], 1996 [ISBN 3-487-21910-7]. Norbert SAVARIAU, Louis de Fontanes: belles-lettres et enseignement de la fin de l’Ancien Régime à l’Empire [24 cm; XII+393 p.; bibliographie pp. 369-380; index], Oxford, Voltaire Foundation [«Studies on Voltaire and the eighteenth century» 2002.8], 2002 [ISBN 0-7294-0715-2]. Pierre MOULIN (professeur honoraire d’histoire-géographie au lycée Fontanes), «Biographie de Louis de Fontanes», in Laurent TROUILLARD, L’association des anciens élèves du lycée et du collège Fontanes [de Niort], http://perso.wanadoo.fr/laurent.trouillard/Biographie/BiogrFontTout.htm, en ligne en 2005. Marc FUMAROLI (de l’Académie française, professeur honoraire au Collège de France, membre du Haut comité des célébrations nationales), «Louis de Fontanes, poète et grand maître de l’Université impériale: Niort, 6 mars 1757 – Paris, 17 mars 1821», in DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE (Délégation aux Célébrations nationales), Célébrations nationales 2004, http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2004/fontanes.htm, en ligne en 2005. Merci à Jacques Corbel de nous avoir signalé l’image ci-dessus du tome X des Mémoires de la Société |
|
|