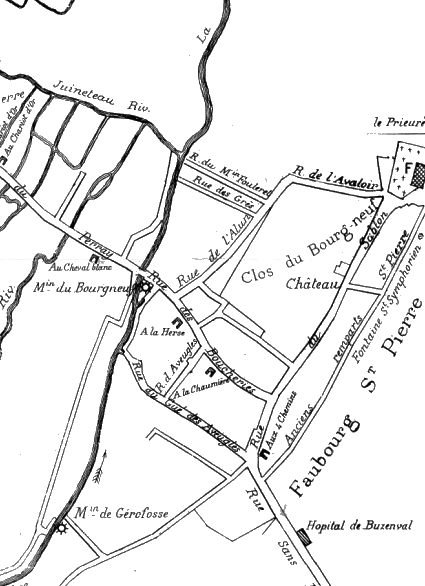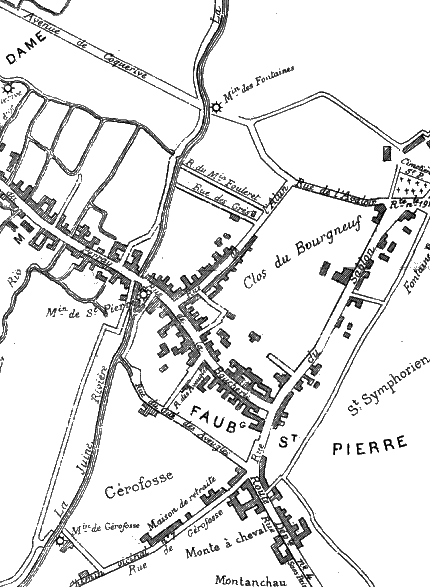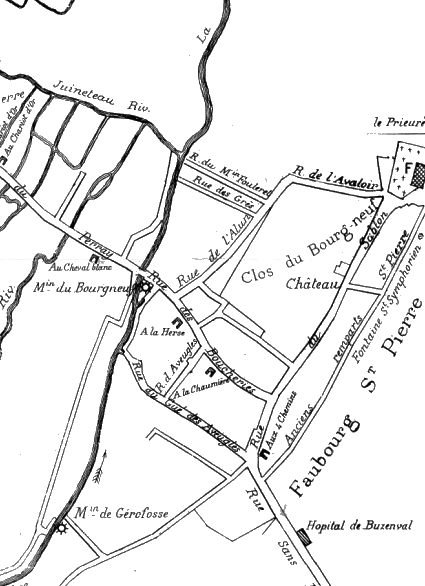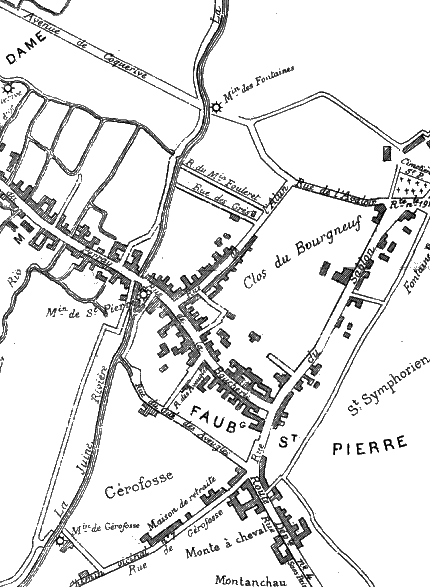|
| Rue de la Boucherie. — Fait suite à
celle du Perray. Elle doit être très-ancienne, car son nom
lui vient vaisemblalement de l’une des trois boucheries qui existaient en
l’année 1186 à Saint-Pierre, Saint-Gilles et Saint-Martin,
lorsque fut établie par Philippe-Auguste la grande boucherie de Notre-Dame
(2). |
|
(2) Fleureau, p. 134.
|
|
|
|
|
À droite, près du pont sur la Juine, est l’ancien moulin
du Bourgneuf ou de Saint-Pierre, qui appartenait en 1788 à Charles-Jean-Marie
de Valory, colonel au 2e régiment de Bourbon-infanterie, gouverneur
et grand bailli des ville, bailliage et duché d’Étampes.
I1 existait en
1552, peut-être longtemps auparavant, et était un moulin à
blé.
Il fut vendu comme bien national, le 16 prairial
an IV, à Claude Béchu, meunier, moyennant 108,925 fr.
Le moulin est appelé aussi Pont-aux-Lièvres
ou moulin Guerraz, du nom de l’un des derniers meuniers.
A côté et joignant ce moulin,
était au XVIe siecle «l’hostel de Pierre Testard, où
pendait puur enseigne l’image de Saint-Martin,» et en face «l’escorcherie
à Damien Fizelier, boucher (3).»
|
|
(3) Archives
départementales, fonds Valory.
|
Dans la rue de la Boucherie, anciennement Grande-Rue-de-la-Boucherie, [p.186] autrefois des Boucheries,
et pendant la Révolution rue des Piques. il y a trois auberges.
A droite, au n°25, celle de la Chaumière,
tenue par M. Breton, et la seule d’Étampes où l’on joue encore
à l’ancien jeu d’esses;
Au n°16, celle de la Herse*, tenue par Mme Dabier;
A gauche, au n°3, l’auberge de M. Chevallier.
Au n°25, on voyait encore, il y a peu
d’années, l’auberge à l’enseigne du Bon-Laboureur.
Anciennement, il y avait encore les auberges
du Cheval-Blanc, de Saint-Christophe et de la
Coignée (1).
|
|
 * Encore ansi dénommée vers 1912,
sur la carte postale ci-dessus, à gauche (B.G.)
* Encore ansi dénommée vers 1912,
sur la carte postale ci-dessus, à gauche (B.G.)
(1) Étampes en 1616. V. Abeille
du 20 juin 1874.
|
Rue du Moulin-Fouleret. — A gauche de la rue
de l’Alun et allant à la rivière. Ainsi nommée à
cause d’un moulin Fouleret ou Folleret, d’ancienneté
«assis sur la Juisne au-dessous du Pont-aux-Lièvres (2),»
et en face de cette rue, moulin qui ne doit pas être confondu avec
un autre du même nom qui était à Gérofosse.
|
|
(2) Archives départementales, fonds Valory.
|
|
|
|
|
Rue de Coquerive. — A gauche de la rue de la
Boucherie, un peu avant le pont sur la Juine. Elle devient bientôt un
chemin longeant la rive gauche de la Juine et aboutissant au moulin des Fontaines
et à l’avenue de Coquerive.
Le 3 mai 1795, les sieurs Dupré et
Berchère voulurent établir un moulin dans cette rue, entre
ceux de Saint-Pierre et des Fontaines mais ils n’obtinrent pas cette autorisation,
«attendu que Dupré n’est propriétaire que d’une seule
berge (3).
Rue de l’Alun. — A gauche de la rue de la Boucherie
et menant à la rue de l’Avaloir. Peut-être existait-il autrefois
dans cette rue une alunière, ou fabrique d’alun, substance
entrant dans la composition de la terre à foulon, car le travail de
la laine a toujours été l’une des principales industries du
pays.
Dans la rue de l’Alun était le presbytère
de Saint-Pierre.
A droite on rencontre la rue Torse, formant
l’équerre et rejoignant [p.187] la
rue de la Boucherie, En 1736, le marquis de Valory fut autorise par le Prince
de Conti à fermer les deux bouts de cette petite rue (1).
|
|
(3) Manuscrit des moulins. — V. la note 94. [Voici
cette note bibliographique n°94 (p.386): Mémoire pour le
citoyen Claude Dupré, imprimeur, et Louise Blanchet Desmolière,
son épouse, contre le nommé Berchère, cy-devant membre
du comité révolutionnaire, existant au 9 thermidor an II. —
Indiqué dans le manuscrit des moulins. (B.G.)]
(1) Archives départementales, fonds Valory.
|
Rue de l’Avaloir. — A l’extrémité
et à droite de celle de l’Alun. Elle conduit à l’antique cimetière
Saint-Pierre, où l’on enterre encore aujourd’hui les habitants de
ce quartier.
L’endroit appelé le Prieuré,
est sur l’emplacement de l’ancienne ferme du Prieuré-Saint-Pierre,
dans lequel il y avait anciennement vingt-quatre religieux. Cette ferme
appartenait encore en 1793 aux Chartreux d’Orléans, prieurs de Saint-Pierre,
qui avaient droit de justice haute, moyenne et basse sur le faubourg.
Une veuve Bredet était receveuse du
prieuré d’Etampes au XVIIe siècle.
Une partie du cimetière Saint-Pierre,
appelé cimetière des Bretons, contenant un demi-quartier
le vignes près l’église, et qui appartenait à la fabrique
Saint-Pierre, fut vendue comme bien national, le 2 janvier 1792, à
Jacques Thibault, chaufournier, pour 105 fr. (2).
|
|
(2) Archives départementales. — V. la note H. [Cliquez
ici]
|
Il y avait dans cette rue, auprès du
Prieuré, un bâtiment «de quatre perches qui servait d’audience
ou d’auditoire au bailli, et appartenait à la Révolution à
l’émigré Charles-Jean-Marie de Valory.» Ce bâtiment
fut vendu, le 8 prairial an II, à Louis-François Besnard,
moyennant 1,265 fr. (3).
|
|
(3) Archives
departementales.
|
La rue de l’Avaloir, autrefois de Lavallouer, plus tard la
Grande-rue-du-Faubourg-Saint-Pierre, devint sous la Révolution
la rue du Faubourg-du-Levant (4).
|
|
(4) Archives
communales.
|
Au nombre des monuments religieux d’Etampes qui ont disparu sous la terreur
est l’église Saint-Pierre, la plus ancienne d’Étampes après
Saint-Martin.
D’après Fleureau, «l’an 644,
un saint homme nommé Leodeboldus, abbé de la célèbre
abbaye Saint-Aignan d’Orléans, fit construire à Fleury-sur-Loire
une église et un monastère….. où il [p.188] assembla plusieurs religieux…
et pour leur donner de quoy subsister il leur laissa de grands biens en
divers lieux, et entre autres tout ce qu’il avait acquis à Étampes
d’une nommée Albune, tant terre que prez.... C’est ce qui donna occasion,
dans la suite, aux religieux de ce nouveau monastère de venir à
Étampes pour y fonder une église sous le nom du même
prince des apôtres, et y bâtir un monastère, où
depuis ils envoyèrent douze religieux sous la conduite et direction
d’un prieur nommé Pierre d’Étampes, pour y établir
la conventualité, qui a duré un temps fort considérable;
et quand elle y a cessé il y avait ordinairement vingt-quatre religieux
de résidence dans ce monastère....»
Le monastère, d’après le même
auteur, aurait été détruit vers la fin de la seconde
race de nos rois (Xe siècle), mais l’église a subsisté;
on en voit encore les traces dans la partie nord-est du cimetière
actuel de Saint-Pierre. |
|
|
Une personne âgée, la veuve Charrier, nous a dit que son père
avait été marguillier à cette église; elle y
a rendu le pain bénit dans son enfance. D’après elle, il y
avait une belle flèche, deux rangs de piliers, une grande porte principale
et une porte latérale donnant sur le cimetière.
La vente des matériaux de l’église
et l’agrandissement du cimetière eurent lieu le 29 prairial an V
(1).
Elle fut démolie en 1804, au mépris
d’un mémoire imprimé en 1791, présenté à
l’administration du district pour la conservation de cette église
par un grand nombre d’habitants de la paroisse, et l’abbé Perrier,
leur curé, député à l’Assemblée nationale
(2).
Le clocher contenait quatre
grosses cloches et une petite, et dans l’église il y avait quarante-neuf
bancs (3).
Le revenu du prieuré,
qui dépendait de l’abbaye de Fleury-sur-Loire, était de 2,000
livres, et celui de la paroisse Saint-Pierre de 1,000 livres en 1618 (4).
|
|
(1)
Manuscrit de l’Hôtel-de-Ville.
(2) V. la note 54. [Voici
cette note bibliographie n°54 (p.382): Mémoire présenté
à MM. les administrateurs du district et à MM. les officiers
municipaux de la ville d’Étampes par les habitants de Saint-Pierre
de la même ville, pour la conservation de leur paroisse. — Paris,
imp. de Vezard et Le Normand, 1791, in-8 de 8 p. (B.G.)]
(3) Note I. Inventaire de l’église
en 1790. [Cliquez ici]
(4) Pouillé de Sens.
|
La ferme dudit prieuré, avec ses dépendances, comprenant [p.189] 121 arpents, qui appartenaient
à la Révolution aux Chartreux d’Orléans, furent vendues
le 12 avril 1791, moyennant 86,600 fr., à Jean-Marie de Valory, colonel
du fer régiment d’état-major
infanterie.
Par suite de folle enchère, ces biens
furent revendus le 2 thermidor an III à Valentin Métivet,
pour 702,100 fr. (1), et par suite de cette nouvelle enchère ils furent
revendus le 8 pluviôse an V à Louis-Nicolas Pia, moyennant 42,475
fr., prix réduit plus tard à 56,538 fr. (2). |
|
(1) Archives
départementales. Le prix de vente est relaté dans les procès-verbaux
de la Convention.
(2) Archives départementales. —
V. la note H. [Cliquez ici]
|
Chemin du Moulin-des-Fontaines.
— Au bout et à gauche de la rue de l’Alun. Classé autrefois
sous le nom de rue qui conduisait à la belle avenue de Coquerive,
c’est plutôt une impasse qu’un chemin ou une rue, car cette voie dessert
exclusivement le moulin dit des Fontaines, construit l’an VIII par
Guettard fils, à 1,000 mètres au-dessous du moulin de Saint-Pierre
(3).
|
|
(3) Manuscrit des moulins.
|
| Rue du
Sablon. — A droite et à gauche, au bout de la rue de la
Boucherie. Aboutissait également à l’église et s’appelait
autrefois la Grande-Rue-de-Saint-Pierre, car du temps de Fleureau (4), «les
Pères chartreux d’Orléans, en qualité de prieurs de
Saint-Pierre, avaient justice haute, moyenne et basse, exercée par
un prévôt, dans le fauxbourg, le long de la grande rue, depuis
l’église jusques au carrefour où est un horme et une table
de grais.» |
|
(4) Fleureau, p. 33.
|
C’est sans doute à cause de la proximité d’un coteau sablonneux
que cette rue a pris le nom de Sablon. Le sable fin ou sablon d’Étampes,
l’un des anciens cris de Paris, faisait du reste dans le pays l’objet d’un
grand commerce.
A l’un des bouts de cette rue est une petite
place où se tient la fête annuelle du faubourg, c’est-à-dire
la Saint-Pierre, et en face de cette place, au n°49, est l’auberge des
Quatre-Chemins. A [p.190]
l’autre bout de la rue du Sablon, à gauche,
est un grand terrain clos de murs appelé le Bourgneuf. C’est
tout ce qui reste du parc et du château du Bourgneuf, qui était
au XVIe siècle la résidence de Roger, conseiller du roi au
XVIIe, de la famille de Cœurs, seigneurs de Bourgneuf, de la mayrerie Saint-Père
et autres lieux (1).
|
|
(1)
Archives départementales, fonds valory. — V. aussi l’inscription
d’une ancienne cloche de Saint-Basile, dont il sera question ci-après.
|
La famille de Valory l’habita au XVIIIe siècle. Louis-Guy-Henri,
marquis de Valory, né en 1692, mort en 1774, gouverneur des citadelles
de Lille et de Rue, grand bailli d’épée de la ville d’Étampes,
y recevait les plus grands écrivains du temps, et notamment Voltaire,
qui y reçut un jour un soufflet d’une servante nommée Trinité.
Il y avait une chapelle dont la bénédiction fut faite le 8
février 1711 par Claude Voizot, doyen de Sainte-Croix d’Etampes (2).
|
|
(2)
Archives départementales, inventaire sommaire.
|
On jouait souvent la comédie à ce château, et c’est
là que logèrent, dit-on, en 1792 les quatre-vingts dragons
envoyés par le gouvernement pour rétablir l’ordre dans la ville.
Charles-Jean-Marie de Valory, colonel au 2e
régiment de Bourbon-infanterie, grand bailli d’épée
de la ville d’Étampes sous le règne de Louis XVI, était
de la même famille. Il dut émigrer en 1795, car il était
suspect comme noble et comme parent de François-Florent de Valory,
garde du corps qui faisait partie de l’escorte du roi au voyage de Varennes.
Tous ses biens furent saisis, puis vendus comme biens nationaux. Une saisie
opérée par Couturier, le 5 décembre 1795, fit sortir
du Bourgneuf une caisse renfermant 290 marcs d’argenterie (3).
|
|
(3)
Proces-verbal de la Convention.
|
On vendit au profit du domaine, de l’an II à l’an VIII, sept maisons,
terres et biens en dépendant situés faubourg Saint-Pierre.
L’un des jardins, clos de murs, s’appelait l’Ouche-aux Barons (4).
|
|
(4)
Archives départementales. — V. les notes J [Cliquez
ici], K [Cliquez ici].
|
Le Bourgneuf, qui était le bien le plus important, fut vendu avec
les bâtiments, le jardin et le parc, le 7 prairial an VIII, à
Jean Prax, moyennant 750,500 fr. (5). [p.191]
|
|
(5)
Archives départementales.
|
Il fut acheté en 1821 par Jean-Joseph Laveissière, marchand
de métaux à Paris, et le 3 octobre 1823 & par Jean-Louis
Blavet, quincaillier, le père de notre président actuel de
la Société d’horticulture, qui le possède actuellement
(1).
|
|
(1) Documents
particuliers.
|
Les Valory descendent d’une illustre famille sénatoriale de Florence,
dont plusieurs membres s’établirent en France et à Venise
dès le XIVe siècle, et produisirent beaucoup d’hommes de génie,
généraux, diplomates, poètes, écrivains. Leurs
armes étaient «d’or à un arbre de sinople au chef de
gueules.»
Plusieurs descendants subsistent encore avec
distinction; deux d’entre eux sont devenus princes italiens (2).
|
|
(2)
Biographie Michaud.
|
En face le château était l’ancien presbytère de Saint-Pierre,
qui servit plus tard de lieu de réunion aux francs-maçons.
Le sceau de la loge de l’Amitié, qui est au musée d’Étampes,
vient sans doute de cet endroit (3). Le presbytère fut vendu le 6
brumaire an V à François Leroux, moyennant 5,400 fr. (4).
|
|
(3) Manuscrit de la bibliothèque
d’Étampes.
(4) Archives départementales.
|
Rue de Gérofosse. —
Fait suite à la rue du Sablon. C’est la route viable du moulin de
Gérofosse, autrefois de Girofosse. Plus
anciennement, c’était le moulin Fouleret, appartenant aux Barnabites.
Ce moulin étant tombé en ruines
lors de la suppression des Barnabites, en 1795, «Hugo Gaudon, propriétaire
d’un grand jardin à Girofosse, le long de la Juine, demanda
l’autorisation de construire un moulin entre le portereau de Vauroux et
le moulin de Saint-Pierre, à l’endroit où il y avait jadis
une usine dont la vanne et le glacis subsistent encore (17 fructidor an IV)…..
Vu une déclaration de feu Crosnier, homme de loi demeurant à
Étampes, section du nord, procureur au bailliage… chargé d’affaires
de la maison des Barnabites, déclaration du 17 prairial an III, demandant
le rétablissement du moulin Fouleret, bâti sur leur propriété
de Girofosse, faubourg Saint-Pierre, exposant la situation des revenus
de la maison insuffisante, à moins de secours de la maison [p.192] de Paris, propriétaire
du fief de Girofosse et du moulin Fouleret... laquelle répondit
que pour le moment elle ne le pouvait, mais prendrait le mémoire
de Crosnier en considération... Le bien étant national, et
le procès-verbal d’ajudication, d’après les lois, tenant lieu
de titres à l’acquéreur.... huit propriétaires consentant
à la reconstruction de ce moulin et trois seulement s’y opposant...
le rapport de l’ingénieur des ponts et chaussées conclut à
la réédification du moulin Fouleret.» (1er vendémiaire
an II) (1). Les vignerons avaient autrefois dans cette rue des pressoirs
«à pressurer vins (2).»
|
|
(1) Manuscrit des moulins.
(2) Archives départementales.
|
C’est à Gérofosse qu’on a établi, il y a environ vingt-cinq
ans, une maison de retraite pour les vieillards des deux sexes, maintenant
pour dames seulement, desservie par les Augustines de l’Hôtel-Dieu.
A la fin du dernier siècle, un nommé
Bellemère demanda l’autorisation de construire un moulin sur sa propriété,
au Gué-du-Crochet, près le pont de pierre; mais sa demande
fut repoussée parce qu’il ne pouvait jouir que de 50 centimètres
de chute (3).
|
|
(3)
Manuscrit des moulins.
|
Rue Sans-Pain. — A gauche, au bout de la rue
du Sablon et menant aux routes d’Étampes à Malesherbes et
à Pithiviers. II y avait à gauche, dans cette rue, le petit
hôpital de Buval ou de Buzenval, qui existait du XIVe au XVIIe siècle,
et dont les biens ont été attribués à l’Hôtel-Dieu
d’Étampes (4). Le revenu de l’hôpital Buval était de
4,000 livres en 1648.
|
|
(4) Bonvoisin, Notice sur les saints martyrs Can, Cantien et Cantianille,
1866, in-12. — Fleureau, p.28.
|
A droite de la rue Sans-Pain, il y avait autrefois le hameau de Montanchau,
qui se réduit aujourd’hui à une seule maison inhabitée
au milieu des champs. Le nom de ce hameau lui vient sans doute de la chaux
que l’on tire en grande quantité de la colline. Non loin de là,
en 1870, il y avait une carrière de chaux hydraulique.
La rue Sans-Pain s’appelait au XVIIe siècle
rue de l’Hôtel-Dieu-de-Buval (5).
[p.193]
|
|
(5) Archives départementales.
|
Ruelle Saint-Symphorien. — Petite ruelle à
droite de la rue du Sablon, et qui menait autrefois à la chapelle
et à la fontaine Saint-Symphorien. La fontaine existe toujours,
mais la chapelle fut détruite après avoir été
vendue, comme bien national venant de la fabrique Saint-Pierre, à
Jean-Élie-François Menault, le 2 janvier 1795, moyennant 1,145
fr. (1).
|
|
(1) Archives départementales.
|
Anciens remparts Saint-Pierre. — Ancienne rue
aujourd’hui déclassée, car c’est à peine un sentier situé
au-dessus de la rue du Sablon. Nous en parlons pour mémoire, car son
nom suffit à justifier l’existence en ce lieu de remparts qui devaient
ceindre le faubourg Saint-Pierre jusqu’à la rivière. Ces murs
existaient, d’après le plan cadastral de 1825, depuis la rue Sablon
jusqu’à la ruelle Saint-Symphorien.
Il y avait encore dans le faubourg Saint-Pierre
les rues du Fillouer et aux Ourches, vers la Mayrerie ou carrefour
de l’Église. |
|
|
Plans du quartier Saint-Pierre, le premier aux XVII et XVIIIe
siècle, le second vers 1881, par Léon Marquis (1881)
|
ANNEXE 1
Notes justificatives H, I,
J et K
relatives au quartier Saint-Pierre
(extrait de la section “Notes justificatives”, pp. 404-405)
[VENTE DE LA FERME DU PRIEURÉ EN 1795]
H. — Pièce imprimée et manuscrite
(affiche): «Département de Seine-et-Oise. District d’Étampes.
Vente de domaines nationaux. La première enchère aura lieu
le 13 messidor an III*, l’adjudication définitive
le 13 thermidor suivant**. La ferme dite du
ci-devant prieuré de Saint-Pierre, située en la commune d’Étampes,
faubourg du Levant, section du nord, consistant en une maison à loger,
colombier, grange ci-devant champarteresse, autre grange, écurie,
bergerie, étable, jardin. Le tout enclos de murs et contigu à
la ci-devant église et au cimetière de Saint- Pierre. Un petit
jardin près de l’ancien auditoire, pièce de courtil et trois
pièces de terre: la première de 36 arpents, tenant au chemin
les Morts; — la deuxième de 36 arpents, tenant au chemin de Brouy;
— la troisième de 8 arpents, tenant aux mêmes, dans laquelle
est un reste de mazure appelée Vieille-Grange-Saint-Père et
l’emplacement devant la ferme... Le tout dépendant des ci-devant chartreux
d’Orléans, et dont Chartes-Jean-Marie Valory s’est rendu adjudicataire
le 12 avril 1791, moyennant 86,6000 liv. — En conséquence, la vente
se fera sur la folle enchère dudit émigré. Signé
Carqueville, Gudin, Dergny, Gabaille, Nasson, Hénin, Crosnier.»
— A Étampes, chez Dupré, imp., in-fol. plano. (Archives départementales.)
|
|
* Le 13 Messidor An III correspond au 1 Juillet
1795 (B.G.).
** Le 13 Thermidor An III correspond au 31 Juillet
1795 (B.G.).
|
[INVENTAIRE DU MOBILIER DE L’ÉGLISE
EN 1790]
I. — Inventaire du mobilier, titres et papiers de l’église Saint-Pierre,
fait le 27 octobre 1790 par Thomas Petit, maire, assisté du procureur
de la commune et du secrétaire greffier. «Le maître-autel
en bois, un rétable en bois, un lutrin et deux siéges, 6 chandeliers
moyens, 14 petits, 3 croix, 2 lampes, une croix de procession, une cuve
pour faire l’eau bénite, un bénitier, 5 bassins à faire
les questes, un autre plus grand servant au cierge pascal, le tout en cuivre;
2 confessionnaux, une chaire à précher, 2 bancs d’œuvre,
49 bancs, 4 tapis, 4 grosses cloches et une petite dans le clocher. Ornements:
25 chapes, 5 chazubles, 4 chapelles garnies de tableaux et rétables.
Argenterie: 2 calices dont un d’argent, un soleil de vermeil, une boîte
d’argent, 2 ciboires dont un de vermeil, 3 vases d’argent pour les saintes
huiles et une petite coupe aussi d’argent pour porter le bon Dieu à
la campagne, une tasse à quester, une croix processionnale et son
bâton. Étain: une fontaine, un plat, une paire le burettes.
Livres: un graduel, un antifonier pour le lutrin, 2 missels, 3 processionnaux, [p.405] 4 livres pour l’office des
morts, un épistolaire, un rituel, un cérémonial de
Sens. —3 soutanes noires, 4 rouges, une robe de bedeau, un habit de suisse,
7 cameaux, 4 surplis, 2 rochets, 11 aubes, 12 nappes d’autel, etc…»
(Suit la nomenclature des papiers et titres de rente, dont un de la maison
le M. La Ragois, seigneur du Bourgneuf, suivant acte de Me Delambon notaire,
le 4 mai 1631). Montant net des revenus 1,136 livres. Signé: Perier,
curé; Perier, secr. greffier; Houllier; Petit, maire; Goupy, procureur
de la commune. (Archives départementales).
|
|
|
[LES SEIGNEURIES DU BOURGNEUF ET DE LA
MAIRERIE EN 1580]
J. — J. Le 26 février
1580, les seigneuries du Bourgneuf et Mairerye, sises faubourg Saint-Pierre,
consistant: «le Bourgneuf, en un grand corps de logis… un courtil
assis près ledit lieu, tenant d’une part à la rue aux Ourches,
autrement appelée la rue du Filloure; un moulin à bled appelé
moulin du Bourgneuf, avec les autres saulx des moulins situez sur ladite
rivière depuis le quay du Crochet jusqu’au lieu appelé le
moulin des Grais…; la seigneurie de Mairerye consiste en une place estant
joignant le prieuré de l’église Saint-Pierre, contenant un
arpent environ, où il y avait un logis, tenant d’une part audit prieuré,
d’autre part à la rue de l’Avallouer, d’un bout sur les marais et
d’autre bout sur le cimetière de ladite église...» (Archives
départementales, inv. somm.)
|
|
|
[DESCRIPTION DU FIEF DU BOURGNEUF AU XVIIIe
SIÈCLE]
K. — Aveu et dénombrement
du fief de Bourgneuf au XVIIIe siècle. « Le château et
lieu seigneurial consiste en un château couvert d’ardoises, vestibule,
grand escalier en icelui; à gauche, un grand salon au bout duquel
est un appartement composé d’une chambre, cabinet et garde-robe,
un autre appartentement y joignant, un autre en aile composé de plusieurs
chambres basses et hautes; à droite dudit vestibule, un salon à
manger an bout duquel est un cabinet et une garde-robe, à la suite
une chambre, un cabinet servant de bibliothèque, et un bâtiment
en aile consistant en une cuisine, grand commun et office; au premier, un
grand corridor communiquant à plusieurs chambres et cabinets, grenier
sur le tout; au midy dudit bâtiment, un jardin contenant un quartier,
et au nord la basse-cour, écurie, vacherie et bûcher. Tout
ce que dessus compris entre les rues Pavée, Torse et du Sablon, contenant
un demi arpent environ... Un moulin faisant de bled farine, faubourg Saint-Pierre,
sur la Juine, avec le sault dudit moulin et tes bâtiments en dépendant,
consistant en une maison ayant deux chambres basses, deux hautes, et petit
jardin à côté le long de la rue des Prés. Et
le droit de pesche en la rivière de Juisne depuis les écluses
de Vauroux jusqu’au lieu appelé la Teste-à-l’Abbé,
paroisse Saint-Germain.» (Archives départementales.)
Dans l’inventaire fait en 1768, après
le décès d’Henriette Le Camus, à la requête
de son mari, Guy-Louis-Henry de Valory, ministre plénipotentiaire
à Berlin, on voit que la bibliothèque du Bourgneuf contenait
1,900 volumes, et les archives 95 articles. |
|
|
|
ANNEXE 2
Bois-Mercier, Bretagne,
Gérofosse et Guignonville
hameaux relevant de l’ancienne paroisse
Saint-Pierre
(extrait de la section “Hameaux, routes collines et rivières”,
pp. 204 et 206-207)
Bois-Mercier. — Bois-Mercier. Hameau ancien
situé à 5,5000 mètres à l’est de la ville, et
un peu à droite de la route de Malesherbes. Autrefois il y avait une
justice auprès de ce hameau, qui était de la paroisse Saint-Pierre.
La ferme de Bois-Mercier est très-ancienne; elle appartenait à
la Révolution à l’émigré Casimir-Louis Valory
et fut vendue le 14 floréal an II, avec 129 arpents de terre, au
sieur Gillotin, moyennant 90,000 fr. (2)
|
|
(2) Archives départementales.
|
Bretagne (la). — Hameau ancien situé
à l’extrémité du faubourg Saint-Pierre, à gauche
de la rue de l’Avaloir, et à 1,500 mètres à l’est de
la ville. Il est ainsi nommé à cause des soldats du duc de
Bretagne qui étaient campés en ce lieu en
1465. [...] [p.205]
|
|
|
Gérofosse. — Hameau situé à
1,300 m sud-est, et comprenant la rue, le moulin et l’asile de ce nom.
A côté est Montanchau,
dont le nom veut dire sans doute mont fait de chaux*; c’était autrefois une maison habitée
par le père Lajoie et servant aujourd’hui de grange.
Si l’on
gravit la colline en suivant le chemin entre les routes de Malesherbes
et Pithiviers, on trouve à droite, à 5 kilomètres
d’Étampes, deux piliers, vestiges d’une ancienne ferme de cette
commune, et à gauche un creux dans un creux dans un champ indiquant
l’emplacement de la Grange-Saint-Père, pillée
à la fin du dernier siècle par la bande d’Orgères
et démolie en 1827.
|
|
* Erreur patente de Marquis, car ce nom
vient du nom de personne Anchaud, comme je l’ai démontré
dans le cahier d’Étampes-Histoire n°7 (2006), p. 121 (B.G.).
|
Le 5 avril 1797, les brigands, avant à leur tète le Rouge
d’Anneau, se transportent à cette ferme habitée par la
veuve Lemaire, son frère Etienne Bélier, ses deux fils, ses
deux filles et deux serviteurs.
Après avoir assassiné le sieur
Étienne Bélier, ils brûlent les pieds de la fermière,
car ces misérables font partie de la bande redoutable des Chauffeurs.
Ils essaient ensuite de violer l’une des filles de la fermière; son
autre frère, Claude Bélier, qui était à la
ferme à l’occasion du décès de leur mère, reçoit
dans le dos un coup de sabre du Rouge d’Auneau. La dame Bétier
mère, morte depuis la veille, n’est pas à l’abri de la fureur
de ces scélérats, car l’un deux, Charles de Paris,
plonge trois fois son sabre dans le corps de cette femme, qui fut ainsi
assassinée après sa mort.
Au bout d’au moins trois heures que dura cette
scène de meurtre et de brigandage, les voleurs partirent, emmenant
avec eux les chevaux de la ferme chargés d’effets de toute espèce
(2).
|
|
(2) Coudray-Maunier, Histoire de la bande d’Orgères,
Chartres, 1858, in-12.
|
A ce récit, nous pouvons ajouter le suivant, grâce à
l’heureuse mémoire d’un contemporain qui a connu l’un des témoins
de [p.207] l’action: en entrant
dans la ferme, les brigands prétextèrent qu’ ils venaient de
la part des administrateurs du district de Corbeil
Pour voir s’il n’y avait pas le personnes suspectes cachées
dans la maison. Les frères Bélier, tous deux très-forts
et très-courageux, se dirent entre eux: «S’il ne sont que trois
ou quatre, nous en aurons bien raison;» mais malheureusement les voleurs
étaient au nombre de onze.
D’après les registres de l’état-civil
d’Étampes, le 17 germinal an V, Claude Bélier a déclaré
que la veille, à la ferme des Granges Saint-Père, hameau d’Etampes,
était décédée Marie Huteau, veuve de Nicolas
Bélier, âgée de soixante-treize ans, native d’Audeville
(Loiret). Ledit jour Savinien Chambon, de la commune d’Orveau, a déclaré
que le même était décédé à ladite
ferme Etienne Bélier, d’Engenville, commune d’Audeville, âgé
de quarante ans.
La ferme des Granges et 52 arpents appartenant
au chapitre Notre-Dame furent vendus, le 7 avril 1791, à Antoine-Louis
Coustard Villiers, ancien administrateur des domaines, moyennant 46,300
fr. (1)
Les pierres
provenant de la démolition de la Grange Saint-Père servirent
en 1863 pour les constructions de l’Abattoir. Cette ferme était
de la paroisse Saint-Pierre.
|
|
(1) Archives départementales.
|
Guignonville. — Ce hameau, situé à
6,300 mètres à l’est d’Étampes, à côté
de Bois-Mercier, renfermait autrefois un ancien château et dépendait
de la paroisse Saint-Pierre.
|
|
|
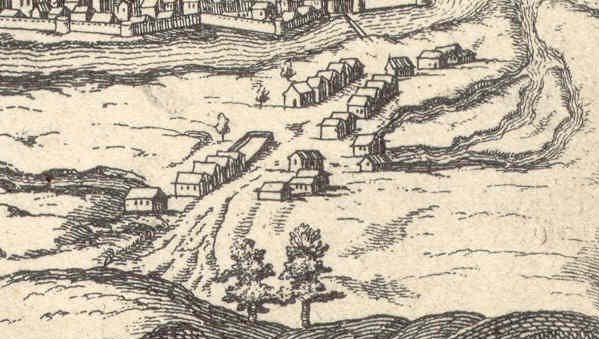
|
Ci-contre, le faubourg Saint-Pierre, à peine ébauché
sur la très mauvaise gravure de Tassin, vers 1630. Rien n’y est fiable,
et l’artiste n’a pas travaillé d’après nature (B.G.)
|
|