Pierre-Ulysse Lejeune
Éditoriaux parus sous l’Occupation
allemande (I)
Abeille d’Étampes, 1940
|
LES COMMERÇANTS
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 26, samedi 24 août 1940 (saisie de Bernard
Métivier)
|
| Nous
ne sentons guère l’avantage, inappréciable pourtant, de disposer
de tous nos organes suivant notre désir. Quand nous avons la bonne
fortune d’être en bonne santé, à moins que nous ne soyons
tenus d’étudier l’anatomie ou la physiologie, nous oublions que nous
avons un estomac, des poumons, un foie, une trachée, des muscles
et des nerfs. |
|
On
ne saurait même dire qu’au moindre appel ces différents organes
s’empressent de nous répondre, tant le mécanisme est indépendant
de notre propre volonté. On digère sans le vouloir, on respire
sans y penser, et notre foie exerce sa fonction glycogénique sans
que nous l’y aidions par nos conseils. La perfection de notre organisme,
quand il est sain, nous fait oublier son existence, et beaucoup de gens ont
vécu sans savoir quelle était l’utilité des sus gastriques
ou des glandes surrénales.
|
|
Pourtant,
il suffit que la moindre chose vienne troubler la marche ordinaire de nos
organes pour que nous nous apercevions combien il est utile d’avoir un bon
estomac et des reins excellents. Alors nous surprenons à penser que
notre organisme, pour être parfait, n’en est pas moins sujet à
des dérangements, et que la santé, qui nous semble naturelle,
est quelque chose d’assez fragile et d’un équilibre précaire.
Il ne suffit pas de dire comme un des plus gros mangeurs de France, qui
s’était fait une renommée de Gargantua: «Le foie, je
ne connais pas ça»*. Quelque jour le foie se
fait connaître, et le Silène** joyeux, qui mangeait et qui buvait, non point comme quatre, mais
comme huit, est emporté comme un mince fétu de paille.
|
* Allusion non élucidée (B.G.).
** Silène: satyre du cortège de Bacchus,
représenté le plus souvent souvent replet, et ivre (B.G.).
|
La tourmente,
qui s’est abattue sur nous au cours de ces derniers mois nous a montré
qu’il en est de même pour les êtres collectifs: les villages,
les bourgs et les villes*. En temps ordinaires les citoyens ne se préoccupent guère
de la façon dont fonctionne leur cité. Il leur semble tout
naturel de se procurer les marchandises, les objets, les denrées,
toutes les choses dont ils ont besoin.
Le ravitaillement s’effectue
si bien qu’on ne peut penser qu’il faille des prévisions pour que
rien ne manque, et que toute personne puisse au gré de ses désirs
et de ses besoins, se procurer se qu’elle demande. C’est ici le pain frais,
là le sel et le beurre, ailleurs la côtelette de mouton ou
le beefsteak, dans une autre boutique la salade et les légumes, dans
une autre encore, les rillettes ou le jambon. Comment s’imaginer que tout
à coup il soit impossible de préparer un repas, et qu’en dehors
de toute question d’argent le simple fait de se nourrir devienne un problème
angoissant? Comment dans une ville, ou la veille encore les boutiques offraient
à tout venant un choix abondant et varié, la situation peut-elle
devenir si différente qu’on ne trouve ni lait, ni pain, ni viande,
ni légumes.
|
*
Lejeune s’inspire ici de l’apologue que Menenius Agrippa imagina en 494
av. J.-C. pour convaincre la classe populaire romaine de renoncer à
son projet de sécession: «Un jour [...] les membres du corps
humain, voyant que l’estomac restait oisif, séparèrent leur
cause de la sienne, et lui refusèrent leur office. Mais cette conspiration
les fit bientôt tomber eux-mêmes en langueur; ils comprirent
alors que l’estomac distribuait à chacun d’eux la nourriture qu’il
avait reçue, et rentrèrent en grâce avec lui. Ainsi le
sénat et le peuple, qui sont comme un seul corps, périssent
par la désunion, et vivent pleins de force par la concorde»
(récit d’Aurélius Victor).
Il est évident que les restrictions alimentaires,
et dont l’Abeille se fait l’écho à la même époque,
créaient de grandes tensions sociales, à Étampes comme
ailleurs, au point que le maire se sent le devoir de prendre la défense
des commerçants contre les rumeurs et les accusations qui devaient
courir, et, plus discrètement, de sa propre administration (B.G.).
|
Pour
si surprenante que soit la chose, des centaines de milliers d’hommes et
de femmes l’ont connue et vécue. Par suite de la perturbation causée
par des circonstances tragiques, ceux qui accomplissaient chaque jour l’humble
devoir de donner à la ville sa subsistance quotidienne, ne pouvaient
plus poursuivre leur fonction. Chacun se rendait compte immédiatement
de ce qu’il y a de complexe dans le ravitaillement d’une ville, et ceux
qui se trouvaient à la tête des municipalités éprouvaient
des difficultés presque insurmontables pour se substituer aux organismes
ordinaires.
|
|
C’est
ainsi qu’est apparue clairement aux yeux la fonction si nécessaire
du commerce. Alors que rien ne semblait plus simple que de distribuer dans
une ville ou dans un bourg les vivres et les approvisionnements d’usage,
on s’aperçut qu’il y avait là une besogne ardue, qui demande
de l’expérience et du savoir.
|
|
Les commerçants
sont une des parties les plus importantes de l’armature qui soutient un
pays. Patients, laborieux, économes, ils veillent sur les biens précieux
dont nous avons besoin, et ils en régularisent l’écoulement.
S’ils stockent des marchandises c’est avec une sagacité, qui évitera
les pertes et le gaspillage, dont nous avons été témoins
au cours des mois qui ont suivi la déclaration de guerre, quand le
commerce cessait d’être libre. Ils veillent sur la qualité
des produits, ils écartent ceux qui sont douteux, ils s’ingénient
à découvrir des marchandises qui ne trouvaient pas tout de
suite un débouché, et qui cependant correspondaient au goût
du public. En ce moment même ils font de véritables prodiges
pour que leurs concitoyens soient à l’abri des privations. On ne
saura jamais le travail que certains d’entre eux ont fourni, pour mettre
à la disposition des enfants et des vieillards, les denrées
nécessaires à leur existence. C’est une lutte quotidienne
et presque toujours ingrate. Il arrive en effet que les prix sont quelquefois
majorés plus qu’il ne faut par certains commerçants, et immédiatement
le reproche de spéculation, qui ne devrait être que particulier
devient général; on confond dans la même réprobation
ceux qui font honnêtement leur métier et ceux qui en abusent.
Tous tombent sous la même vindicte, comme il arrive quand les esprits
irrités par la souffrance ne peuvent plus prendre la peine de distinguer
entre ceux qui sont coupables et ceux qui sont innocents.
|
|
Pourtant,
malgré ces reproches, malgré ces plaintes, les commerçants
n’en continuent pas moins à faire de leur mieux et à maintenir
le niveau de la vie sociale.
|
|
Ils ont
en effet un devoir primordial: celui d’assurer la vie économique
du pays. Ce devoir ne doit jamais s’effacer de leur esprit. Si comme nous
le croyons, la prospérité d’un pays dépend de la façon
dont chacun accomplit sa tâche propre, les commerçants en s’efforçant
de tenir leur rôle d’animateur journalier et en ne tirant de leur
négoce que la juste part, qui doit revenir à tout travailleur,
seront parmi les premiers à reconstruire la nouvelle nation.
|
|
Il est
à souhaiter qu’ils sachent s’organiser, et qu’ils comprennent que loin
de nuire à leur liberté individuelle, une action corporative
bien entendue leur permettra d’étendre leur rayonnement et de contribuer
encore davantage au bien public. Plus que jamais, il faut nous pénétrer
de cette idée qu’un individualisme exclusif est néfaste au
bon ordre d’un pays, et que tous les citoyens vivront avec plus de force
et plus de joie s’ils sentent qu’ils sont unis les uns aux autres par une
étroite solidarité.
P. Lejeune
|
|
|
LE TRAVAIL UNANIME
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 27, samedi 31 août 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Nous
n’avons plus à perdre une heure, une pensée, une parole, une
force quelconque parmi celles qui subsistent encore aujourd’hui dans notre
pays si terriblement éprouvé. L’action doit tout primer. Une
action menée sérieusement, sans étalage, sans parade,
sans ostentation, une action dont nous ne trouverons jamais de meilleur
modèle que dans celle du paysan qui, tout au long d’une année,
besogne sans arrêt ni relâche.
|
|
Bien
qu’il ne faille pas être hanté par le passé, nous ne
pouvons pas oublier que le domaine de l’action ait été tout
à fait délaissé pendant la période qui a précédé
cette guerre*. Il n’était pas question
d’agir, mais seulement de déterminer les meilleures conditions à
réaliser pour pouvoir agir. On s’agitait autour des systèmes,
des techniques et des théories. Chacun présentait sa doctrine.
Il en était de toutes sortes, et chacune devait avoir des résultats
infaillibles. En toute sincérité les résultats de cette
multiplicité de panacées n’ont pas été probants.
Déjà La Fontaine avait établi que le mieux pour se
tirer d’affaires n’était pas d’avoir mille moyens à sa disposition,
mais d’en avoir un seul, qui soit sûr**. Nous ne nous demanderons pas s’il existait un bon et sûr
moyen pour se tirer d’affaire avant 1940, mais nous savons bien qu’il en
est un aujourd’hui sur lequel tout le monde est d’accord. Ce moyen s’exprime
en un seul mot: le travail.
|
* Allusion à
la politique menée avant guerre par le Front Populaire, considérée
comme la source des maux dont la France souffre sous l’Occupation allemande
(B.G.).
** Allusion littéraire
à élucider.
|
C’est
le mot qu’il faut se répéter chaque jour, se remettre en mémoire,
faire sien jusqu’au fond de son esprit et de son cœur. Par tous les moyens,
il faut combattre l’apathie et l’oisiveté. Pour vivre il faut produire.
La production, qui fut presque considérée comme une sorte
de fléau mondial, et qu’on s’efforçait de diminuer en certains
pays par des prohibitions diverses, reprend aujourd’hui sa première
place. Nous manquons ou nous sommes prêts de manquer de toutes choses;
on signale partout des demandes qui ne sont pas satisfaites; dans les villes
des femmes et des enfants, voire des hommes en pleine force, se rangent
patiemment les uns derrière les autres pour obtenir quelques articles
qu’on leur distribue parcimonieusement. Les ateliers réclament des
matières premières, les réparateurs mendient des pièces
détachées, les industries supplient qu’on leur donne du charbon.
Dans tous les domaines, c’est un appel toujours semblable qu’on entend,
appel tragique, mais qui cependant, loin de nous faire trembler, peut au
contraire nous donner des raisons d’espoir.
|
|
L’impitoyable
nécessité va nous obliger en effet à reprendre la route
que nous n’aurions jamais dû quitter, la route étroite où
chaque jour l’homme reforge son énergie et ses volontés. A
la flamme des nouvelles ardeurs, sur l’enclume solide des faits et des réalités,
il va battre le fer avec lequel il s’ouvrira la voie glorieuse de l’avenir.
Chaque citoyen reprendra confiance en lui-même; cessant de compter
sur un État distributeur, qui doit pourvoir à tout, au risque
de tout faire périr, il ne comptera que sur lui-même, et n’attendra
de cet État que l’ordre et la justice, qui lui permettront d’agir
avec certitude. Le citoyen ne mendiera plus, il ne sera plus un quémandeur,
mais dans l’allégresse de ses forces retrouvées, il n’attendra
plus rien que de ses bras et de son cerveau.
|
|
Quand
dans une nation chaque homme se considère comme une force qui marche
et non pas comme une charge qui se fait traîner, l’atmosphère
change, les pensées se font plus claires, les regards sont plus éclatants,
les lèvres plus riantes. Celui qui recherche constamment un appui,
qui jette partout les yeux pour voir où il pourra s’agripper, dont
le seul désir est d’être pendu à quelqu’un ou à
quelque chose, celui-là n’aura qu’une attitude basse et une physionomie
fausse. Il faut d’abord être franc avec soi-même, s’avouer que
l’on n’obtient rien que par l’effort, et que si c’est à des moyens
obliques qu’on doit sa situation et sa fortune, on a simplement triché.
|
|
La tâche
qui s’offre à nous est immense. Elle n’est cependant pas hors de
proportion avec nos ressources. Nous appartenons à une race courageuse
et tenace, dont le défaut est de trop se prêter aux propositions
faciles. Chaque fois qu’elle a suivi les gens adroits, souples, habiles
à présenter toutes choses comme aisées à obtenir,
elle a glissé dans le malheur ou l’infortune*.
Mais chaque fois qu’on a fait appel à son abnégation, à
son sacrifice, à son goût de la peine et du dévouement,
elle a montré des qualités et des vertus, que les autres peuples
lui reconnaissent volontiers.
|
* Nouvelle allusion
à la politique menée avant guerre par le Front Populaire (B.G.).
|
Que Jacques
Cartier* propose à ses compatriotes
d’aller s’établir sur les bords du Saint-Laurent pour faire une besogne
épuisante de défricheurs, et de leurs pioches et de leurs
pelles ils vont jeter les premières assises des villes canadiennes,
tandis qu’ils ouvriront le sol fécond de ces terres nouvelles pour
y faire lever des moissons. Ni le froid excessif, ni la chaleur des tropiques,
ni les climats insalubres de certaines parties de l’Afrique et de l’Asie
ne découragent les pionniers français. Plus l’œuvre est difficile,
plus elle leur agrée. La race aime à combattre l’adversité;
la faim, le dénuement, la privation ne l’effraient pas, pourvu qu’on
lui propose un but honorable. Elle est prête à tout donner si
elle sait que ceux qui la conduisent ne poursuivent pas de but personnel,
et qu’il s’agit de donner une preuve manifeste de ses vertus.
|
* Navigateur malouin (1491-1557), explorateur du
Canada (B.G.).
|
Jamais
plus qu’aujourd’hui la race française n’a eu l’occasion de montrer
ce qu’elle vaut et ce dont elle est capable. Dans l’Europe de demain, il lui
appartient d’apporter la plus précieuse des collaborations. Le monde
qu’il s’agit de construire a besoin de travailleurs intrépides, qui
sauront unir l’audace au courage. Pour l’audace il semble que les français
n’en aient jamais manqué, et qu’ils aient pris plaisir à mettre
du risque dans leurs entreprises. Pour le courage ils ont montré
mille fois que quand ils étaient bien conduits, ils ne reculaient
devant aucun péril.
|
|
C’est
donc avec confiance que nous devons les uns et les autres envisager les
jours qui vont venir. Point de vains espoirs, point d’illusions, point de
rêves: la volonté seulement de donner tout ce que nous avons
de force et d’intelligence, pour que, grâce à un travail opiniâtre
et rude, nous poursuivions et réalisions les destins d’une race dont
tout l’honneur sera de rester fidèle à elle-même.
P. Lejeune.
|
|
|
DROITS ET RECONNAISSANCE
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 28, samedi 7 septembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Chaque
homme pense d’abord à ses droits.
|
|
Qui de
nous ne dit pas ou ne pense pas plusieurs fois dans la journée: «C’est
mon droit. C’était parfaitement mon droit.» Nous nous hâtons
de justifier nos désirs ou nos caprices particuliers en les revêtant
du caractère noble de la justice. La sujétion trop grande
que les peuples ont subie à certaines époques les a jetés
dans un sentiment d’indépendance, qui leur a fait croire qu’en venant
au monde un petit citoyen arrivait muni de tous ses droits comme un ambassadeur
de ses lettres de créance. Descartes avait dit: «Je pense,
donc je suis», nous dirions volontiers: «Je suis, donc j’ai
des droits». Il est naturel de défendre la personne humaine,
et si Jean-Jacques Rousseau a rencontré tant d’admirateurs au XVIIIe
siècle, c’est qu’il exploitait un système naturel*. A défaut de la force qui est le meilleur
moyen pour se défendre, il convient de se mettre sous la protection
du droit**. Mais comme
on abuse de toutes choses, comme on s’arrête difficilement dans le
succès, les protagonistes du droit de l’individu ont demandé
tout pour lui sans exiger aucune contre-partie. De là un déséquilibre
social dont nous venons de faire les frais***.
|
* Il est bien clair qu’il ne s’agit pas ici d’un
éloge de Jean-Jacques Rousseau (B.G.).
** Ce point de vue est
particulièrement remarquable (B.G.).
*** En d’autres termes, les causes profondes de la
défaite française de 1940 sont à chercher, au-delà
des seules errances du Front Populaire, dans les conséquences ultimes
de la Révolution Française. (B.G.).
|
Si dans
une société chaque personne s’arroge des droits sans se sentir
tenue à aucune obligation, il n’est point possible que la société
subsiste longtemps, car elle sera dans la situation d’un commerçant
ou d’un industriel qui paye toujours sans jamais rien recevoir.
|
|
L’honnêteté
veut qu’on paye ce qu’on doit et tout homme doit quelque chose à
la société dans laquelle il vit. C’est grâce à
cette société, représentée d’abord par son père
et sa mère, que l’enfant peut avoir la nourriture qui lui est nécessaire.
Les secours lui viennent encore par d’autres sources, et s’il s’agit d’un
enfant appartenant à une famille pauvre il est redevable aux différentes
œuvres et institutions qui s’occuperont de lui, à commencer par le
dispensaire et l’école maternelle.
|
|
Quand
on parle des droits de l’enfant c’est une impropriété. Il
faut parler des devoirs des parents. Les parents sont tenus de nourrir,
de vêtir, d’élever et d’entretenir leur enfant. Ils ont là
une charge à laquelle ils ne peuvent se dérober.
|
|
Mieux
vaut parler de ce devoir qu’on peut leur rappeler et qui est susceptible
de sanctions que d’un droit, dont le bénéficiaire ne peut user,
et qui est une arme trop lourde pour ses mains débiles. Plus tard
quand l’enfant a grandi, voire même quand il a franchi l’adolescence,
c’est encore des devoirs que les parents et la société ont
envers lui qu’il convient de parler beaucoup plus que des droits qu’il aurait
sur eux.
|
|
Le
devoir implique un sentiment plus généreux que le droit. Il
évoque un effort moral, une volonté de préférer
les autres à soi-même, un désintéressement, quelquefois
total, de ses biens et de sa personne. Il n’en est point toujours de même
du droit qu’on a acquis. A la source de son acquisition, il y a souvent
un avantage et un intérêt particuliers; ce que le droit réserve
à quelqu’un c’est un bénéfice pour lui-même,
une augmentation de sa personnalité, qui se résout en satisfactions
plus ou moins égoïstes. Dans le domaine pur de la beauté
morale il doit céder le pas au devoir qui ne prend sa source que
dans la libéralité du cœur.
|
|
On ne
conteste pas un devoir, combien de fois ne conteste-t-on pas un droit? C’est
une vérité si pleine d’évidence que la plus grande
partie de l’activité humaine s’est depuis des siècles consacrée
à établir quels étaient les droits des personnes.
|
|
Les lois
ne sont jamais si claires et si sûres qu’elles ne donnent lieu à
des interprétations diverses. Il y a des jurisprudences opposées
pour le même texte législatif, qui ne paraît pourtant
susceptible d’aucune équivoque. Chaque personne est persuadée
que la loi joue en sa faveur, et cela nous explique pourquoi les tribunaux
sont encombrés de procès.
|
|
Depuis
qu’il est des lois, l’homme pour ses péchés se condamne à
plaider la moitié de sa vie; la moitié? les trois quarts et
bien souvent le tout. C’est ainsi qu’au XVIIe siècle La Fontaine
dénonçait le goût malheureux de ses compatriotes pour
la chicane*.
|
* Par exemple dans L’Huître et les Plaideurs:
«Mettez ce qu’il en coûte à plaider aujourd’hui; / Comptez
ce qu’il en reste à beaucoup de familles» (B.G.).
|
Si noble
que soit le droit, il faut reconnaître en effet qu’il est souvent
entaché d’un caractère chicanier. Il n’y a pas de chicane
dans le devoir. Le devoir est absolu, sa limite c’est l’abnégation
de soi-même, le don total de ses biens et de sa personne. Il ne s’arrête
qu’avec la mort de celui qui se sacrifie pour ses enfants, pour ses frères,
pour ses amis, pour son idée, pour son honneur ou sa foi. On ne conteste
pas avec le devoir, il ne fait l’objet d’aucune procédure, les termes
dont il s’entoure ne demandent aucune étude préalable; l’enfant
le connaît déjà, alors que le droit n’est pour lui qu’un
vain mot dont les sens lui échappe encore.
|
|
Les âmes
se feront plus belles et plus généreuses, quand elles se demanderont
d’abord ce qu’elles doivent aux autres et non point ce qu’on leur doit. C’est
par la reconnaissance qu’il faut commencer à vivre et non point par
l’exigence. Exigeons moins de l’État et de la société;
donnons-leur davantage. Comme l’enfant doit d’abord penser à s’acquitter
envers ses parents de tout ce qu’il a reçu d’eux, le citoyen doit
d’abord par son attitude et son dévouement envers la Cité s’acquitter
de la dette de gratitude qu’il a contractée naturellement envers
elle. Nous devons au Pays un précieux héritage de vertus,
d’exemples, de grandeur et de beauté qu’il a su conserver à
travers les siècles. Tout ce qu’un pays comme le nôtre offre
à celui qui naît est d’une importance incalculable pour la
santé de son âme et de son corps. Sans doute y a-t-il encore
des déshérités, et à cet égard la communauté
se trouve-t-elle en présence de devoirs qui ne cesseront probablement
jamais, mais même pour eux la société offre encore des
avantages, qu’on ne saurait mépriser.
|
|
Une société
policée, où l’on est sûr de trouver l’ordre et la justice,
où le travail est organisé, où règne une activité
bienfaisante est pour chaque individu la meilleure des sauvegardes. Chaque
citoyen doit être reconnaissant envers cet ensemble d’institutions,
de lois, d’organisations, qui pour imparfaites qu’elles puissent être,
représentent cependant l’effort constant de générations
précédentes.
|
|
La reconnaissance
est un sentiment qui élève les âmes. Nous ne saurions
trop le cultiver. C’est un sentiment qui doit être inscrit au cœur
des hommes de bonne volonté, à ceux qui pensent que pour avoir
quelque mérite, il faut d’abord examiner si l’on a bien acquitté
sa dette quotidienne envers sa Cité et son Pays.
P. Lejeune.
|
|
|
ALLOCUTION DU 7 SEPTEMBRE 1940 AUX JEUNES GENS
(Abeille du 14 septembre 1940)
On prendra
garde que nous n’avons de ce discours que les notes qu’en a pris le journaliste
René Collard, de l’Abeille d’Étampes, de sorte qu’on
ne sait pas si Lejeune a pu relire les paroles exactes qui lui étaient
prêtées. On notera que se trouvaient dans l’assistance deux
personnages qui furent plus tard arrêtés pour fait de résistance
et y perdirent la vie: Louis Moreau, inpecteur primaire d’Étampes
et Pierre Audemard, membre de l’équipe municipale de Lejeune en charge
du Sport.
|
 Au Stade municipal, les jeunes gens sur le terrain
(Photo Rameau.)
Au Stade municipal, les jeunes gens sur le terrain
(Photo Rameau.)
(cliché du 7 septembre 1940 dans l’Abeille du 14 septembre)
En vous
réunissant aujourd’hui, j’ai pensé que c’était le meilleur
moyen pour vous mettre en face de la tâche nouvelle que nous attendons
de vous. Il est nécessaire que, dès maintenant, vous fassiez
l’effort indispensable pour assurer aux œuvres de demain, des hommes solides
et éprouvés. Chaque samedi vous vous retrouverez ici et vous
rendrez plus étroits les liens de solidarité et d’amitié
qui, entre les citoyens, maintiendront pour toujours l’esprit de concorde.
C’est en vous réunissant à des jours et à des heures
fixes, que vous donnerez à la Ville et que vous vous donnerez à
vous-même, un sentiment général de discipline.
Il faut que la discipline soit, chez vous un sentiment
naturel, il faut que vous l’aimiez pour elle-même, pour ce qu’elle
vous apportera de force et de santé. C’est par la discipline qu’on
peut se débarrasser des défauts et des faiblesses qui
entravent notre action; c’est par la discipline que l’individu apprend à
renoncer à soi-même, à suspendre les mouvements impulsifs
de l’humeur et du mécontentement, assurer la pleine maîtrise
de soi dans la peur, comme dans la colère. L’être discipliné
offre un spectacle d’équilibre, il peut résister à tous
les assauts de quelque sorte qu’ils soient.
Vous apprendrez à sentir combien l’autorité est indispensable;
elle ne vous apparaîtra pas comme une brimade inutile, comme la satisfaction
de commander aux autres, et de pouvoir faire plier leur volonté suivant
son caprice, elle vous apparaîtra comme une autre qualité du
caractère. Cette autorité, ce sera celle qui veut qu’un homme
à un moment précis donne l’ordre qui convient.
Vous donnerez à vos concitoyens des exemples d’ordre
et de cohésion. Dispersés chaque jour à leurs occupations
particulières, les citoyens risquent de ne plus se sentir unis et
perdent l’impression d’appartenir à la même cité. Grâce
à vous, grâce aux manifestations que vous ferez ici, grâce
aux défilés qui pourront être organisés, vous
redonnerez aux citoyens la connaissance de l’unité qui doit les régir.
La Ville, devant des jeunes gens pleins de force et d’énergie, reprendra
un sentiment de confiance en elle-même.
Il y a dans la jeunesse un élan et une vivacité
qui se communiquent facilement à la population; si ceux qui vous ont
précédés peuvent vous donner des leçons d’expérience,
vous pouvez donner à votre tour des raisons d’espérer
aux adultes et aux gens âgés.
L’entraînement physique est indispensable, et nous
voulons qu’il soit obligatoire pour former une génération forte
et saine. Que vous soyez à l’atelier ou dans un bureau, qu’il s’agisse
d’une profession commerciale, industrielle ou libérale, ou bien qu’il
s’agisse de ce noble métier de l’agriculture, il faut que les jeunes
gens viennent à ces différentes professions parfaitement armés
dans leur corps, et j’ajoute: dans leur esprit. L’éducation physique
et l’éducation morale s’appuient l’une sur l’autre; nous ferons en
sorte que toutes les deux aillent de pair.
Nous aurons de nombreuses sections sportives, et suivant
vos possibilités physiques, vos aptitudes personnelles, vous pourrez
vous inscrire dans celles qui vous conviendront le mieux. Nous tâcherons
ici de vous réunir le samedi pour vous livrer à certains travaux
dans lesquels vous ferez déjà l’apprentissage de la vie avec
les pelles et les pioches. Nous pourrons entreprendre de travaux utiles aussi
bien pour la Ville que pour les environs. Il faut en effet que vous serviez
toute la cité et que dès maintenant vous pensiez que toute votre
existence est destinée à faire le bonheur de la communauté.
C’est dans la communauté que nous devons vivre, c’est pour elle qu’il
nous faut agir et penser. Je fais appel à vos plus nobles sentiments,
je désire voir en vous les nouveaux Chevaliers de l’époque
moderne.
Soyez comme ces chevaliers qui avaient à la fois
la force physique et le force morale, et qui voulaient faire régner
dans le monde la justice et la bonté.
Je veux que nous terminions cette réunion par
une promesse; comme magistrat j’ai dû prononcer le serment de dire
toujours la vérité et d’être fidèle à l’honneur.
Avant de nous quitter, je vais vous demander de faire serment à la
France de respecter l’idéal et les traditions qu’elle nous a léguées
et qu’elle nous demande de maintenir. Pour le serment, nous levons le bras
aussi haut que possible comme si nous voulions toucher le ciel. Je vous demanderai
d’en faire autant et de dire avec moi dans un élan unanime: « A
la France ».
|
Abeille d’Étampes, 128e année, n°29, 14 septembre1940
(saisie de Jacqueline Pétron)
|
Au service des corps
et des âmes
Le sport obligatoire à Étampes
Les jeunes gens d’Étampes
de 14 à 20 ans étaient invités à se rendre samedi
dernier 7 septembre 1940 au Stade Municipal, en vue de former des sections
de sport et de travail obligatoires comme il s’en crée depuis peu
dans toute la France. [….] M. le Président Lejeune prononça
une allocution. [...] Au reste, voici les quelques passages du discours de
M. Lejeune que nous avons pu noter au vol:
|
|
|
L’EXEMPLE
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 29, samedi 14 septembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
L’histoire
a été traitée au cours des siècles de façons
bien diverses par les écrivains. Les uns ont voulu surtout y voir
une œuvre d’art, où l’imagination, l’éloquence et la poésie
peuvent se donner libre cours, les autres ne l’ont conçue que comme
une œuvre d’exactitude et de précision, où il suffit de mettre
en place les pièces et les documents qu’on a soigneusement contrôlés.
Entre ces deux extrêmes on trouve des historiens qui ont fondu les
deux manières et qui n’ont pas cru que l’art d’écrire et de
présenter heureusement les faits était incompatible avec une
documentation sérieuse et une véritable érudition.
|
|
A
côté de ces soucis d’art et de précision on trouve aussi
chez certains historiens un désir très net de se servir de
l’histoire pour enseigner une haute morale, tout à la fois civique
et personnelle, capable d’influencer les esprits et les cœurs, et de leur
donner des leçons de courage, de désintéressement, de
vaillance et de magnanimité. Tite-Live*
et surtout Plutarque** semblent
s’être rangés parmi ces derniers historiens, et l’on sent que
l’un et l’autre ont voulu que leur œuvre ne fut point seulement une évocation
des temps passés, un rappel des actes accomplis par des hommes illustres,
mais une œuvre de force éducatrice et de puissance morale.
|
*
Tite-Live, historien romain (59 av. J.-C. - 17 ap. J.-C.). ** Plutarque, historien
grec (46-125), auteur de Vies parallèles, dont la lecture
était très en vogue au XVIIIe siècle, forgeant dans
les esprits une inépuisable réserve d’exemples de morale ciivique
(B.G.).
|
Ce que
certains historiens ont fait pour le temps passé, il est possible à
chacun de le faire pour le temps présent. Rien n’empêche un
homme de se considérer dans le milieu où il vit comme chargé
d’une mission de bonté, d’ordre ou d’énergie. Sans avoir des
visées ambitieuses, sans orgueil comme sans fatuité, on peut
entraîner les autres dans une vie droite et honorable. On peut le
faire par l’écrit et par la parole, mais on ne le fera jamais aussi
bien que par l’exemple.
|
|
Les actions
que nous avons sous les yeux suscitent en nous des sentiments, et ces sentiments
s’ils sont d’une nature noble, nous disposent à agir d’une manière
conforme à notre devoir. «Species honestae observentur oculis»,
disait Cicéron*. «Ayez toujours
devant les yeux des images d’honnêteté». Détournez-vous
de tout ce qui est bas, vulgaire, ignominieux. Si vous vous habituez à
élever vos regards, si vous ne les laissez point traîner sur
ce qui salit et déshonore l’âme, vous sentirez en vous comme
une sorte d’ascension.
|
*
Cicéron (106-43 av. J.-C.), Tusculanes 2, 52. Je traduirais
plutôt: «C’est sur les exemples de vertu qu’il faut fixer ses
regards», d’autant que le véritable texte est Obversentur
species honestae animo (B.G.)
|
Que d’images
sinistres avons-nous eues sous les yeux depuis dix ans. Pas un instant la
politique ne nous a permis de reposer nos regards sur un spectacle sain
et réconfortant. Partout des appétits, des cupidités
effroyables, des combinaisons plus louches les unes que les autres, partout
des mensonges et des intrigues. Quand on lisait le journal, on avait hâte
de se détourner d’un tel cloaque. On tournait la page, mais c’était
pour trouver d’autres scandales, des scandales de finance, de spéculation
ou de chantage. L’esprit ne sortait jamais apaisé d’une telle lecture,
et malgré ce que l’accoutumance peut faire pour amortir les réactions,
on sentait monter en soi une insupportable nausée*. Pour certaines
personnes l’indifférence finissait par prendre le dessus. Elles considéraient
le spectacle du monde comme ces vieux critiques de théâtre
qui sont blasés sur toutes les situations dramatiques, et qu’aucune
scène n’est plus susceptible de toucher. Indifférence dangereuse
et qu’on pourrait presque dire coupable, tant elle finit par créer
une sorte de complicité tacite pour le vice et pour le mal. Ces indifférents
souriaient devant les actes les plus déshonorants; plutôt que
de les blâmer, ils prenaient une attitude supérieure et détachée
en se contentant de dire de quelque friponnerie: «C’est humain!»
|
*
On mesure ici l’antiparlementarisme de l’auteur. (B.G.)
|
Par eux
et par leur consentement, l’humanité glissait sur une pente effroyable.
Etre humain, c’était se mal conduire, se rendre coupable de concussion,
jouer sur les deux tableaux, être fourbe et considérer le bien
d’autrui comme le sien propre, en un mot c’était commettre tous les
forfaits. Sous la couleur d’une fausse indulgence, on tolérait ainsi
tout ce qui aurait dû révolter une bonne conscience. Il ne
s’agissait point de pardonner, le pardon consistant à ne point poursuivre
une offense personnelle, il s’agissait de toute autre chose: de la reconnaissance
implicite qu’avait un homme de faire tout le mal possible. «C’est
humain.» Cela voulait dire qu’on aurait eu tort de se fâcher,
de s’indigner, de témoigner de sa répulsion en face d’un vilain
acte. Dans la réalité cette indifférence n’était
qu’une lâcheté. On n’osait pas briser avec un homme, qui était
puissant, qui voyait grandir son pouvoir avec son infamie, et qui l’occasion
aidant, était susceptible de rendre service. On respectait une lame
empoisonnée, dont les atteintes, pensait-on, ne seraient dangereuses
que pour les autres. En fait d’exemple, la plupart des gens ne donnaient
que celui de l’avilissement, de l’abandon, du scepticisme railleur ou découragé.
|
|
Qu’allons-nous
faire? Persévérerons-nous dans cette attitude égoïste,
où, comme un gibier poursuivi, il ne s’agit que de trouver un abri,
de se tapir, et le danger passé de se gîter jusqu’à
la prochaine alerte? Renoncerons-nous à la beauté des gestes
et des attitudes? Cesserons-nous désormais d’être pour les
autres des exemples, pour n’être que des fantômes pâles
et fuyants, que rassure seule la douteuse obscurité? Nous déroberons-nous
à la lumière qui montre les défauts, mais qui fait
éclater les vertus, pour nous réfugier dans l’ombre propice
à toutes ces fautes, à tous les crimes? Il faut au contraire
déchirer les brumes qui nous entourent encore et à travers
le malheur qui nous a frappés, comme un navire à travers une
ténébreuse tempête, avancer courageusement, percer la
zone mauvaise, pour nous hâter vers la clarté qui n’attend
que notre énergie et notre persévérance.
|
|
Plus que
jamais, chaque citoyen doit être pour les autres un exemple: dans
sa conduite, dans son travail, dans sa volonté. Il n’est point de
geste, qui n’ait une valeur d’enseignement, quand il s’accorde avec notre
devoir, et le forgeron qui d’un grand cœur abat son marteau sur l’enclume
comme le paysan qui trace de toute la force de son torse et de ses bras
un profond sillon dans la glèbe, sont d’admirables exemples.
|
|
L’avenir
ne doit pas nous faire peur. Il dépend de nous et de notre volonté.
Si chaque citoyen offre aux autres l’exemple du courage dans l’action entreprise,
nous élèverons une œuvre qui méritera peut-être
d’être mise en comparaison avec quelques unes de celles qui ont fait
l’honneur de nos aïeux. Mais il est nécessaire que quelques
uns commencent à donner l’exemple, ou plutôt il est nécessaire
que dans un mouvement d’émulation générale chaque citoyen
veuille être l’EXEMPLE.
P. Lejeune.
|
|
|
ALLOCUTION DU 15 SEPTEMBRE 1940 AUX JEUNES FILLES
(Abeille du 21 septembre 1940)
On prendra garde
que nous n’avons de ce discours que les notes qu’en a pris le journaliste
René Collard, de l’Abeille d’Étampes, de sorte qu’on
ne sait pas si Lejeune a pu relire les paroles exactes qui lui étaient
prêtées.
|
 Le Sport est au service de la santé et de la
beauté. Les jeunes filles d’Étampes sur le terrain du Stade.
Le Sport est au service de la santé et de la
beauté. Les jeunes filles d’Étampes sur le terrain du Stade.
Au centre: M. Lejeune prononçant son allocution (Photo
Rameau.)
(cliché du 15 septembre 1940 dans l’Abeille du 21 septembre)
Mesdemoiselles,
la semaine dernière nous avons réuni ici les jeunes gens; aujourd’hui
nous vous réunissons à votre tour parce qu’en effet vous constituez
aussi la jeunesse de notre Ville.
Ainsi que je le disais aux jeunes gens, la jeunesse doit
être la principale préoccupation de notre temps. On a trop oublié
au cours de ces dernières années que c’est par la jeunesse
qu’un peuple s’assure de l’avenir; c’est par la jeunesse qu’il peut
réparer les fautes qui ont été commises. Nous nous apercevons
que l’on n’a pas suffisamment pris soin de certaines générations
et que si ces générations n’ont point donné à
la France tout ce qu’elle pouvait attendre de ses enfants, c’est qu’on avait
négligé la formation de la jeunesse et qu’on ne s’était
pas préoccupé suffisamment de lui donner une direction capable
d’influencer sa conduite future; on ne fait rien de bien sans formation et
sans préparation; il faut préparer et former les esprits de
la même manière qu’on prépare un sol où l’on veut
faire croître de belles moissons. C’est la formation qu’on a reçue
dans sa jeunesse qui vous permet dans l’âge mûr d’agir d’une
manière droite et honorable.
En rendant obligatoire la culture des sports, nous n’avons
eu pour but que de poursuivre une voie d’ordre et de discipline indispensable
dans un pays qui vient de subir une épreuve aussi douloureuse que
celle d’hier. Les sports sont en effet une excellente école de discipline;
on y apprend à se commander. De plus, dans les mouvements d’ensemble
que vous ferez ici, vous réaliserez l’union désirable entre
tous ceux et toutes celles qui habitent la même cité. Vous apprendrez
peu à peu à vivre dans une parfaite communauté de vue.
Les sports nous apparaissent comme parfaitement utiles
pour la santé; il est nécessaire que les jeunes filles de France
aient une force physique qui soit susceptible de les aider à supporter
les peines et les fatigues de la vie. Que la femme Française soit
forte et résistante, c’est là un but qu’il est naturel qu’on
se propose dans un pays qui vit des femmes aussi courageuses que Jeanne Hachette
ou Jeanne d’Arc. La force physique n’est nullement incompatible avec les
fonctions naturelles de la femme; il suffit de voir la résistance
physique de celles qui, dans notre pays de Beauce, ne craignent pas de se
livrer aux rudes travaux des champs. C’est une erreur de penser que cette
force s’oppose à la grâce féminine; tout au contraire,
un corps souple et bien entraîné se présentera avec plus
de grâce qu’un corps débile pour lequel chaque mouvement devient
une peine et qui devant le moindre effort est obligé de se contracter
d’une manière gauche et maladroite. C’est par la discipline des muscles
que l’on atteint à l’harmonie des mouvements. Aussi bien, la grâce
est-elle une chose essentiellement différente de la mièvrerie
et du maniérisme. Un corps bien entraîné est simple
dans ses mouvements et c’est cette simplicité qui, en toute chose,
apporte le charme. En pratiquant le sport nous n’entendons nullement oublier
la culture morale; nous sommes persuadés que la culture physique et
la culture morale peuvent aller de pair, qu’elles se fortifient l’une
l’autre et qu’en apprenant ici à vous soumettre à des règles
précises, vous prendrez d’excellentes habitudes qui vous accompagneront
dans vos occupations ordinaires. Nous n’entendons point en adoptant des méthodes
nouvelles, renoncer à nos traditions; tout au contraire nous voulons
que vous demeuriez fidèles à ces coutumes et à ces traditions
d’honneur qui nous ont été léguées par une longue
suite de siècles. C’est à vous que les siècles passés
confient l’héritage précieux d’honneur dont nous pouvons être
fier[s] dans notre pays. La femme n’a cessé de représenter
un idéal auquel nous vous demandons d’être fidèle; idéal
de bonté, d’ordre, de douceur, de bienveillance. Le sport chez vous
sera fraternel, il ne s’agira point de mépriser celles qui ne pourront
pas rapidement acquérir les qualités physiques; il s’agira
au contraire de les encourager et de leur montrer comment elles doivent faire
pour rejoindre leurs camarades mieux partagées; Il y a en toute personne
qui aime le sport un désir d’aider fraternellement celui qui travaille
avec lui [sic]. Chez la jeune fille, ce désir sera encore plus vif
que chez le jeune homme, et nous sommes persuadés que bientôt
vous serez un exemple non point seulement pour la jeunesse, mais encore pour
tous les citoyens de la Ville qui, vous voyant si calmes et si résolues,
sentiront revivre en eux les plus beaux espoirs.
En face de cette nouvelle école dans laquelle
vous entrez, école d’énergie, de vigueur, d’efforts, voyez
donc en quoi vous allez être utiles à votre cité et à
votre pays. Dans ce simple exercice que vous ferez chaque semaine, n’apercevez
point seulement une culture physique nécessaire à la santé
mais tout ce que l’on peut mettre de confiance, d’énergie et de foi
à la dans les jours qui s’ouvrent pour vous et qui seront meilleurs
et plus lumineux si vous voulez bien donner toute votre volonté à
la tâche commune que nous devons tous entreprendre aujourd’hui. |
Abeille d’Étampes, 128e année, n°30, 21 septembre1940
(saisie de Jacqueline Pétron)
|
Le sport au service de la santé et de la beauté
Les jeunes filles d’Étampes
au stade municipal
A
leur tour, les jeunes filles d’Étampes de 14 à 20 ans
étaient invitées à se réunir au Stade municipal
dimanche 15 septembre 1940 à 16 heures. [...] Et voici maintenant
les principaux passages de l’allocution de M. Pierre Lejeune, pris en note
tant bien que mal pour nos lecteurs:
|
|
|
S’ADAPTER
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 29, samedi 21 septembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Le problème
du ravitaillement ne cesse de préoccuper les administrateurs de services
publics. Ce n’est point seulement en matière d’alimentation qu’on
sent une gêne croissante, c’est encore dans les métiers et dans
l’industrie. Nous nous trouvons tout à coup en face d’une situation
nouvelle, dont nous pressentions bien quelques aspects, mais dont nous ne
devinions point l’amplitude.
|
|
Ce
serait commettre une erreur que de croire que nous résoudrons aisément
tous les problèmes qui vont se poser à nous. On n’abandonne
pas subitement une certaine façon de vivre pour en adopter une autre
toute différente sans éprouver des contre-coups sensibles.
|
|
Rien
à ce sujet n’est plus remarquable que la difficulté que nous
éprouvons à nous plier au nouveau système de déplacement
qui nous est imposé. L’automobile nous avait habitués à
une facilité de transport telle que nous n’imaginions plus qu’on
pût se préoccuper de la manière dont on irait d’un lieu
à l’autre. Qu’il s’agit d’un déménagement ou d’une
visite, on avait immédiatement sous la main un véhicule capable
d’emmener plusieurs tonnes ou une voiture légère qui roulait
à cent kilomètres à l’heure. Point de prévisions
à faire; il suffisait de mettre le contact quand on désirait
partir. Si la quantité d’essence était insuffisante pour le
trajet à faire, on était sûr qu’au premier tournant de
la route une pompe offrirait immédiatement le carburant désiré.
|
|
Reportons-nous
en arrière, ou plutôt plaçons-nous dans le temps présent.
Plus de départ instantané. Il faut, si l’on a par hasard un
cheval, savoir s’il a mangé et s’il a bu, dépendre les harnais
et atteler convenablement la bête. Là où il fallait
vingt minutes pour se rendre en quelque endroit, on doit mettre deux heures.
Il n’y avait plus de côtes, les dernières automobiles se flattaient
d’effacer le profil des routes; avec le meilleur cheval du monde, il y a
des montées, comme on disait jadis. Si la montée est rude,
et que la voiture soit chargée, les voyageurs descendent pour soulager
l’attelage.
|
|
La
vitesse, sur laquelle on comptait pour arranger toutes choses, s’éloigne
de nous à toute vitesse, pourrait-on dire. La bicyclette elle-même
devient quelque chose de précieux et de rare qui suscite le désir
et quelquefois l’envie. On ne trouve plus de pneumatiques ni de chambres
à air. Les pièces détachées deviennent aussi
rares que les pièces de monnaie. Il faut prendre soin de cette petite
machine, qui offre un équilibre si charmant, comme d’une porcelaine
de Saxe ou d’un biscuit de Sèvres. Nous n’avons plus le droit de l’abandonner
sur le bord d’un trottoir pour lui faire courir le risque d’une chute malheureuse
ou d’un enlèvement fortuit.
|
|
Si nous
voulons cependant trouver encore une impression de vitesse, il nous reste
à prendre le train. Beaucoup de gens avaient oublié la route
qui mène aux gares de chemin de fer. C’étaient des édifices,
généralement laids, que la plupart des automobilistes ignoraient
complètement, et dont ils songeaient à s’enquérir qu’en
cas de panne irréparable ou d’accident. Maintenant nous en prenons
le chemin tout naturellement. Elles ont un air d’accueil qu’on ne voulait
plus leur prêter, et même si le train s’arrête à
toutes les stations, on se félicite encore de pouvoir le prendre.
Quel cultivateur ne souhaiterait point qu’on rétablit la ligne d’Étampes
à Chartres*, et qu’il fût répondu favorablement à la
demande officielle qui a été adressée à cet effet,
au Directeur de la Société Nationale des Chemins de fer? La
locomotive ressaisit ses droits. Son panache de fumée n’est plus chose
vétuste dont on souriait avec ironie. Il s’orne d’un nouveau prestige
et l’on se ralliera bientôt autour de lui comme faisaient autrefois
les soldats autour de celui d’Henri IV.
Nous nous mettons à
la recherche du temps passé. Ce qu’on croyait révolu pour
toujours, reprend sa place comme ces animaux familiers qu’on chasse du logis
violemment et qui reviennent s’y installer avec une douce obstination, sachant
qu’on finira par les y tolérer. Quelques personnes n’admettent pas
volontiers que l’on abandonne ce que le progrès avait amené:
elles se refusent à adopter une matière de vivre qui semblait
pourtant toute naturelle à nos aïeux. Mais que sert de se fâcher?
La nécessité commande. Plutôt que de s’irriter, il convient
de s’adapter. Si rude que soit le sort, la sagesse veut qu’on le regarde
en face, sans broncher, et sinon avec dépit, du moins avec quelque
hardiesse dans le cœur.
|
*
Il s’agit de la ligne d’Auneau qui avait été inaugurée
en 1893 (voyez-en le récit
ici), et qui servait notamment aux maraîchers de Chalo et
de Saint-Hilaire pour venir vendre leur production au marché d’Étampes.
Son trafic voyageurs, insuffisamment rentable, avait été interrompu
en 1939. D’où cet entrefilet dans l’Abeille du 7 septembre
1940:
|
LIGNE DE CHEMIN DE FER
ÉTAMPES-AUNEAU
M. le Maire de Saint-Hilaire
nous communique la pétition suivante:
Les Maires des communes desservies par la ligne Étampes-Auneau-Chartres
signalent aux Administrations compétentes la pénible situation
dans laquelle se trouve placée toute cette région agricole
du fait de la disparition de tous moyens de transports.
La
remise en marche d’un train journalier résoudrait la question d’expéditions
des grains, pailles, fourrages, betteraves à sucre, rendue impossible
par l’éloignement des grandes gares et la pénurie d’attelages.
Tout en permettant aux campagnards de se déplacer, un train assurerait
aux grandes aglomérations un ravitaillement en lait, beurre, œufs,
volailles et toutes denrées dont une grande parttie se perd faute
de débouchés.
|
(B.G.)
|
On nous
répétait depuis longtemps que nous devrions nous imposer une
grande pénitence. Il y avait encore trop de facilités en France
pour que les gens consentissent à se transformer en pénitents.
Quand la vie est pleine d’attraits, quand elle offre à tous les tournants
des fleurs et des fruits pour continuer la route, il est bien difficile
de choisir, d’adopter la voie dure, malaisée et raboteuse des privations
et des renoncements. Les pénitences s’imposent plus qu’elles ne s’élisent.
Mais s’il ne faut pas trop en vouloir à ceux qui n’ont pas su comprendre
à temps qu’il fallait faire pénitence, il faut par contre
être sévère pour ceux qui n’acceptent point les leçons
de l’adversité et les retours de la fortune.
|
|
C’est
dans la souffrance que l’on fait l’épreuve de soi-même et qu’on
se fortifie. Nous sommes tombés dans la faiblesse, parce que nous
courions sur une surface trop unie et trop égale; le malheur a bouleversé
cette surface; il convient si nous ne voulons point renoncer à une
existence digne et fière que nous cessions d’être faibles et
que désormais tous les coups que le destin nous réserve ne
soient pas pour nous des chocs qui ébranlent notre volonté,
mais bien plutôt des rencontres qui la durcissent.
|
|
| Quand
on voudra nous persuader que des épreuves nouvelles sont devant nous,
quand des esprits, qui volontiers assombrissent l’avenir, nous feront apercevoir
des conjonctions malheureuses, nous adopterons la position du héros
de l’Enéide* en face des prophéties
funestes de la Sybille. Quelle que soit la figure que présente l’infortune,
elle ne nous surprendra pas. Nous aurons préparé notre âme,
et d’avance nous aurons envisagé ce qu’il fallait faire. |
*
Le poème épique latin appelé Énéïde,
qui a été composé par Virgile entre 29 et 19 av. J.-C.,
raconte les pérégrinations et batailles légendaires
d’Énée, qui après avoir échappé de Troie
en flammes, s’en va établir en Italie la lignée dont sortiront
les Romains. Il rencontre au chant VI, à Cumes, en Campagnie, une
prophétesse appelée Sybille (B.G.).
|
«Non ulla laborum,
O virgo, nova mi facies inopinave surgit;
Omnia praecepi atque animo mecum ante peregi.*»
|
*
Énéide VI, 103-105: Aucune de mes
épreuves, ô vierge, ne se dresse devant moi sous un aspect
nouveau ou inattendu: j’ai tout prévu, et j’ai d’avance tout accompli
en pensée (B.G.).
|
Ainsi
préparés et décidés, nous attendrons avec confiance
des jours plus heureux.
|
|
Quand
ils reviendront, nous n’y laisserons point dissoudre nos forces retrouvées,
nous les garderons au contraire intactes pour les transmettre à une
jeunesse mieux instruite dans sa tâche et dans ses devoirs.
P. Lejeune.
|
|
|
NOTRE FAIBLESSE
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 31, samedi 28 septembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
A
côté des qualités que chaque race peut avoir, on peut
aussi trouver des qualités spéciales pour chaque nation. Ces
dernières qualités sont moins tranchées généralement
que celles des races proprement dites, car une nation, si homogène
qu’elle puisse paraître à première vue, comporte toujours
des groupes différents dans leurs origines. Même une petite
nation, comme la Suisse, ne présente pas un caractère ethnique
uniforme; malgré la prédominance germanique on y trouve cependant
des éléments latins. A plus forte raison dans des grands pays
comme la France, l’Allemagne ou l’Angleterre, qui en dépit de leur
unité apparente gardent en elles la marque des juxtapositions successives,
dont s’est fait leur accroissement, ne peut-on s’attendre à une commune
origine.
|
|
Cependant
ce qu’on appelle un peuple, une nation ou un pays, finit par se constituer
à cause du brassage des individus une expression qui lui est propre
et qui le différencie des autres. Il est certain qu’il y a un état
d’esprit espagnol, comme il y a un certain état d’esprit italien.
Si différent que soit un Basque d’un Sévillan, un Napolitain
d’un Piémontais, ils sont unis par une parenté de ton, de manière,
de sentiment, qui n’échappe pas à un étranger. Le langage,
les habitudes, les lois, la littérature, le théâtre,
créent un courant d’action et de pensée. Avec les années
et les siècles chaque nation prend donc un caractère particulier,
et il n’est point contraire à l’observation positive des faits de prêter
à un peuple telles qualités ou tels défauts.
|
|
S’il
convient aux peuples comme aux individus de se perfectionner, et si pour
y parvenir, un des meilleurs moyens pour eux est de rechercher quels ont
leurs défauts, un examen de conscience fait loyalement par les Français
les obligerait à reconnaître qu’ils ont toujours poussé
un peu trop loin le droit d’être légers et frivoles. Je sais
bien qu’ils s’indignent généralement lorsqu’on leur fait ce
reproche, mais plutôt que de s’en fâcher, ne serait-il pas préférable
pour eux d’imiter Boileau qui devant les attaques de ses détracteurs
disait simplement:
«C’est en me corrigeant
que je sais leur répondre.»
|
* Vers
tiré de l’Épître VII de Nicolas Boileau-Despréaux
(1636-1711 ), parue en 1666.
|
Au
reste si nous n’aimons point qu’on nous reproche d’être légers,
nous ne laissons point quelquefois de nous en faire gloire. Nous transposons
alors les adjectifs, ce qui est léger devient spirituel, ce qui est
frivole devient ailé, et tout au contraire ce qui est sérieux
devient pesant, et ce qui est profond passe pour ennuyeux. De cette manière
nous nous tirons indemnes et triomphants du soi-disant mauvais procès
qu’on voulait nous faire.
|
|
Dans
la réalité nous ne sommes point du tout disculpés et
si l’on sait interroger l’histoire, on sera obligé de reconnaître
que nous avons traité souvent avec trop de légèreté
les choses les plus sérieuses. Sans aller plus loin que le XVIIIe
siècle, que dire et que penser de l’insouciance avec laquelle on a
traité le problème des colonies? Du côté de l’Orient
comme du côté de l’Occident, on a négligé une
question considérable, abandonnant sans regret l’œuvre de quelques
hommes courageux, qui nous avaient préparé de belles voies
pour l’industrie et pour le commerce français. Les Indes* et le Canada nous glissèrent entre les mains comme un poids trop lourd
entre les mains d’un enfant. Un écrivain, qui se croyait plus fin
qu’homme du monde, et qui disposait sur le public d’une influence considérable
affichait son dédain pour ces «malheureux arpents de neige» du Canada**.
|
*
Allusion aux aventures de Joseph François Dupleix (1697-1763) qui
avait commencé de tailler aux Indes un immense empire français,
perdu au bénéfice des Anglais par la bêtise d’un ministre
qui le démit de ses fonctions en 1754 .(B.G.)
** Formule de Voltaire qu’il utilisa à plusieurs
reprises et sous diverses formes (voir ici) pour tourner en dérision l’un des enjeux
de la guerre de Sept Ans (1756-1763) entre l’Angletere et la France, qui
perdit alors à jamais le Canada. Il est clair ici que Pierre lejeune
n’aime pas Voltaire, qui a jeté les germes d’une Révolution
dont les excès lui faisait horreurs. (B.G.)
|
En
s’en tenant à quelques mots d’esprit, nous avons souvent compromis
le bien de notre pays*. Faute de vouloir appliquer notre esprit à un problème
difficile, nous n’avons point saisi le moment où la fortune nous était
favorable, et par manque de constance, nous n’avons pas su maintenir un avantage
que nous nous étions acquis. Comme nous disposons de qualités
indéniables, qui nous ont permis en de nombreuses occasions de rétablir
des situations compromises ou de nous assurer des succès rapides,
nous laissons flotter les rênes de l’attelage, nous abandonnons les
rames au courant de l’eau, nous prenons, somme toute, la position la plus
convenable pour nous mettre dans le moindre état de résistance.
Le malheur nous surprend et nous renverse avant que nous ayons aperçu
le danger qui nous menaçait. Il y a déjà bien longtemps
qu’un journaliste avait lancé cette boutade, qu’on avait prise au
pied de la lettre, et qui s’accordait parfaitement avec notre caractère
«Tout s’arrange»; au théâtre peut-être, quand
il s’agit de comédies aimables, qui doivent laisser les spectateurs
sur une bonne impression, mais dans la vie des peuples, c’est beaucoup moins
probable. Vivre pour un peuple est une chose difficile, une opération
qui exige une attention soutenue et une volonté de tous les instants.
Il est permis à un individu d’être léger, négligent,
indifférent à toutes choses, insouciant, il lui est permis
de ne rien prévoir, de se fier au hasard, de «ne pas s’en faire»,
et quelquefois le résultat ne sera pas désastreux pour lui,
mais un peuple ne pourra jamais adapter une telle conduite, et «la
vie de Bohême» ne saurait lui convenir longtemps.
|
*
Nouvelle attaque contre Voltaire.
|
Un peuple
s’il a des dons naturels ne doit jamais s’en faire le dissipateur frivole.
Il est tenu de veiller sur ses biens, sur ses richesses, sur ses valeurs,
et quand il s’agit de valeurs morales, son soin doit être encore plus
vigilant.
|
|
Peu importe
qu’il ait des élans magnifiques si l’effort une fois donné
il perd en quelques instants toute la ferveur qui l’animait. Entretenir la
flamme ne doit pas être seulement un geste symbolique, mais une volonté
de l’âme toute entière.
|
|
Chez nous
cette volonté n’est souvent que sporadique. Elle apparaît soudain,
brille d’un bel éclat et subit avec la même brusquerie une éclipse
totale. Ces alternances peuvent produire quelque temps un effet avantageux;
on est généralement prêt à admirer ceux qui disposent
de grandes facilités, dont ils ne se servent que par intermittence.
On voit là comme une sorte d’élégant détachement.
Le malheur est que l’issue est presque toujours tragique. La Grèce* nous en a donné l’exemple le plus frappant.
Nul pays qui n’ait connu des rétablissements de fortune plus prestigieux.
Malgré la division qui la dévorait, elle trouvait toujours
au dernier moment un sursaut d’énergie pour ressaisir son indépendance.
Pourtant si souple, si adroite qu’elle ait été, cette manière
de jouer constamment avec le sort finit par lui être fatale, et le
passé le plus éclatant n’empêcha point la chute la plus
effroyable.
|
*
Allusion à l’histoire de la Grèce antique, divisée
en cités-états rivaux, qui surent s’unir cependant au Ve siècle
pour repousser l’invasion perse lors des guerres dites médiques,
mais qui finirent par tomber au IVe siècle sous l’autorité
des rois de Macédoine.
|
Il faut
qu’un peuple soit sévère pour lui-même, qu’il prenne
connaissance de ses défauts, et que, s’il se reconnaît des qualités,
il s’applique à les garder fécondes et vivaces. Les marins
disent qu’on ne doit pas jouer avec la mer, parce que la mer ne joue jamais
avec l’homme. Il faut dire aux nations qu’elles ne doivent jamais jouer avec
le Destin, parce que le Destin ne joue pas avec elles.
|
|
Peut-être
n’y avons-nous pas suffisamment songé. Nous ne voulions prendre d’Athènes
que les jeux politiques, qui l’ont épuisée à la fin
de sa magnifique carrière. Il nous semblait que nous étions
assez forts pour vivre au milieu des divisions et des luttes intestines.
C’est avec un cœur léger que nous courions aux abîmes.
|
|
Quand
l’heure du Destin a sonné, nous nous sommes aperçu que la
force, sur laquelle nous comptions, n’était qu’une ombre de force,
qui flottait dans l’air sans consistance, et qui ne pouvait plus s’accrocher
au sol des ancêtres.
|
|
Cette
force saine qui fait les grands peuples, nous ne la retrouverons qu’en étant
sévères pour nous-mêmes, en adoptant une attitude grave
et résolue, et en combattant tout ce qui peut nous diviser pour vivre
dans une union véritable et indestructible.
P. Lejeune.
|
|
|
ACTIVITÉ
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 32, samedi 5 octobre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Les
loisirs ont été fort à la mode durant les dernières
années qui ont précédé la guerre*. Comme on réduisait les heures de travail,
on se préoccupait de la manière dont les gens désœuvrés
pourraient passer leur temps. On se rendait compte en effet qu’entre la
diminution des heures de travail et l’oisiveté, il n’y avait qu’un
pas à franchir, et qu’il est assez dangereux pour l’ordre social
que les gens n’aient rien à faire. Un des avantages du travail est
de fixer l’esprit et d’entraîner le corps; il oblige à prendre
une position, à observer une attitude, à se mettre dans un
certain état d’attention et de compréhension. Dès que
le travail cesse il y a une sorte d’embarras et de gêne, qui se traduit
chez la plupart des personnes par un sentiment d’ennui. Nombreux sont ceux
qui se réjouissant de prendre quelques jours ou quelques semaines
de repos en ont senti l’inconvénient, et ont constaté avec
une certaine amertume qu’il était difficile d’accorder le plaisir
avec l’inaction. La reine de Navarre**, qui écrivit l’Heptaméron, ouvrage d’un caractère
aimable et gai, qui révèle un tempérament généreux,
disait pourtant qu’elle n’ignorait rien de «l’ennui commun à
toute personne bien née». L’ennui menace tout le monde, et
la fille de François Ier avait seulement tort de croire qu’il n’étend
son empire que sur un nombre limité de personnes, à qui la
naissance aurait donné ce singulier privilège. Nul n’en est
exempt, sinon ceux qui ne lui donnent pas le temps de croître, et qui
le combattent en multipliant leurs occupations et leurs travaux.
|
*
Allusion notamment à l’instauration en 1936 des premiers congés
payés par le Front Populaire. Il faut tout de même remarquer
qu’Hitler et Mussolini les avaient eux aussi instaurés avant même
le Front Populaire et que cela ne les a pas empêchés d’écraser
la France... (B.G.).
** Marguerite de Navarre (1492-1549), sœur de François
Ier, surnommée la dixième des muses, écrivit à
une date controversée un recueil inachevé de 72 nouvelles
censées être racontées en sept jours, d’où
son titre grec d’Heptaméron. L’expression ici citée
est tirée d’une lettre à François Ier en date de l’automne
1536, éd. Génin, Paris, Renouard, 1841, p. 332 (B.G.).
|
L’ennui,
qui n’est que le résultat même de l’oisiveté, cause
chez un peuple des ravages véritables. Peut-être est-ce une
des raisons pour lesquelles le pouvoir romain à côté
du pain, qui calmait les appétits, n’oubliait point de prodiguer
les jeux qui distrayaient les esprits: «panem et circenses»*. Il est
seulement à remarquer que les jeux ne sont qu’un mauvais palliatif.
L’homme inoccupé, ou insuffisamment occupé ne tarde pas à
bâiller devant les distractions ou les jeux. Dès qu’ils se substituent
à des occupations régulières, les amusements deviennent
très vite fastidieux.
|
*
Du pain et des jeux, expression attribuée au
poète satirique romain Juvénal (B.G.).
|
Une société
qui ne pense qu’à s’amuser est, si paradoxal que cela puisse paraître,
une société qui s’ennuie. Depuis quelques années les
journées pour nous étaient devenues trop longues et les semaines
paraissaient interminables. Nous ne nous sentions plus resserrés
dans un petit cercle d’heures, nous avions au contraire l’impression qu’elles
étaient trop nombreuses pour ce que nous avions à faire. Cette
léthargie qui s’étendait partout n’était point sans
créer une psychose de doute et de crainte. On est d’autant moins sûr
de soi-même, d’autant moins confiant et ferme qu’on diminue son action
et qu’on s’enferme dans l’immobilité. Rien n’est plus vrai que ce
mot fameux: «vires acquirit eundo, il acquiert des forces en
marchant»*. C’est en marchant; c’est en agissant que les forces se constituent
et s’organisent, toute formation est un mouvement, et une attente morne et
passive ne peut qu’entraîner un affaiblissement et une dissociation
des énergies. Qu’on veuille bien se rappeler notre état d’âme
dans les années qui ont précédé 1939. C’était
un état de pesante expectative. On attendait quelque chose, et on
l’attendait sans faire vraiment rien d’efficace et, disons-le, de viril.
On aurait pu reprendre les termes d’une lettre que madame des Ursins écrivait
à madame de Maintenon*, en cette année 1709, où devant les malheurs de
la France, le vieux roi et ses conseillers étaient tombés
dans une sorte d’abandon: «Est-il bien possible, madame, que tous
les hommes que vous connaissez vous paraissent à bout, et qu’il n’y
en ait point qui imaginent de nouvelles ressources? C’est une marque de
leur abattement qui ne leur fait pas d’honneur; car dans quelque mauvais
état que soient les affaires, les grands esprits et les grands courages
se roidissent contre la mauvaise fortune.»
|
*
Curieuse application du vers de Virgile (Énéide, V,
175), qui parle de la Renommée: «Elle acquiert des forces dans
sa course» (B.G.).
** Lettres inédites de Mme
de Maintenon et de Mme la princesse des Ursins, éd., Paris, Bossange
frères, 1826, t. IV, pp. 246-247 (B.G.)
|
De fait
la mauvaise fortune comme la bonne risquent d’entraîner cette même
paralysie des fonctions créatrices. Quelque soit le sort, favorable
ou défavorable, il ne faut pas qu’il soit pour nous une cause de
diminution. Nous ne devons pas plus nous laisser corrompre par les facilités
et les délices d’une époque d’abondance que nous laisser abattre
par les âpretés, les rudesses et les cruautés d’un temps
impitoyable. D’un côté nous avons à résister
à l’amollissement qui accompagne le plaisir et les satisfactions
obtenues sans effort, de l’autre au découragement qui guette les
souffrances et les longues privations.
|
|
Découragement
comme amollissement engendrent l’inaction. Or dès que l’homme est
inactif, il commence à déchoir. C’est par l’activité
qu’il se sauve de lui-même, de ses défauts et de ses défaillances.
Que le sort veuille le favoriser ou qu’au contraire il veuille l’accabler,
l’homme doit répondre au bonheur comme à l’adversité
en maintenant son toujours son activité au même niveau. Il
doit dans les circonstances les plus diverses s’ingénier à
trouver ce qui lui permettra de garder ce niveau constant. Cette recherche
même, l’aidera à supporter les rigueurs de son destin. L’exemple
de Robinson Crusoë, isolé dans son île, et combattant
ce sentiment amer de solitude, en pratiquant successivement la plupart des
métiers, est à cet égard tout à fait instructif.
Il importait peu à Robinson qu’il réussit pleinement comme
charpentier ou constructeur; ce qu’il voulait c’était d’utiliser
son intelligence et sa force dans une besogne ou elles pouvaient s’épanouir*. C’est au
moins le résultat pris intrinsèquement qui compte en effet
pour assurer notre équilibre intérieur que l’utilisation rationnelle
de nos facultés. A côté du bonheur «qui n’est qu’une
rencontre favorable entre l’inclination du désir et l’issue de l’événement»,
les Grecs plaçaient un autre bonheur, l’eupraxia, le seul qui
dépende de nous et qui n’est «que la satisfaction d’avoir donné
à notre conduite une direction telle que le succès est inséparable
de l’action, parce qu’il ne consiste en rien d’autre que la qualité
de notre activité.»**
Dans la situation où
nous sommes c’est à cet état d’«eupraxia»
que, nous devons nous attacher. Il faut agir suivant les mobiles les plus
nobles et les plus généreux. Notre activité peut être
sûre qu’elle est bonne quand elle tend à servir la communauté.
Il ne faut point nous séparer de nos concitoyens; il faut en travaillant,
en besognant, en accomplissant notre tâche avec joie, penser que notre
activité sera pour tous une source de satisfactions saines et profitables.
|
*
Daniel Defoë (1659-1731), Robinson Crusoë (1719), dans
la traduction de Pétrus Borel (1836): «il est bon qu’il soit
en général remarqué que je demeurais très-rarement
oisif. Je répartissais régulièrement mon temps entre
toutes les occupations quotidiennes que je m’étais imposées».
(B.G.)
** Pierre Lejeune s’appuie ici sur l’analyse que
fait Léon Brunschvicg (1869-1944) de la pensée de Socrate
(470-399) telle qu’elle est rapportée par Xénophon ( 426/430-355)
dans ses Entretiens mémorables. Léon Brunschvicg,
Le progrès de la conscience dans la philosophie
occidentale, première édition, Paris, P.U.F., Bibliothèque
de philosophie contemporaine, 1927, tome I, première partie, premier
livre, § 9: «Ce bien sans ambiguïté (ἀναμφιλογώτατον
ἀγαθόν) (IV, II, 34), Socrate l’appelle l’εὐπραξία; il en éclaircit
l’idée en l’opposant à l’εὐτυχία (III, IX, 14). L’ εὐτυχία
c’est le bonheur qui vient à nous par une rencontre favorable entre
l’inclination du désir et l’issue de l’événement. L’ εὐπραξία,
c’est la satisfaction d’avoir donné à notre conduite une direction
telle que le succès est inséparable de l’action, parce qu’il
ne consiste en rien d’autre que la qualité de notre activité.» (B.G.)
|
Etre actif,
c’est créer autour de soi le meilleur des rayonnements. Le mouvement
entraîne, il finit par convaincre les plus récalcitrants. Si
nous apercevons encore des indifférences et des oppositions, c’est
en redoublant d’activité que nous les ferons céder, comme
à force de chaleur on fait fondre la glace.
|
|
Après
avoir témoigné d’une certaine nonchalance, dont nous n’avons
qu’à déplorer le résultat, donnons, aujourd’hui, un
témoignage tout autre: celui d’une activité qui ne se décourage
point devant les obstacles qui peuvent se dresser devant elle, et qui entend
venir à bout de toutes les difficultés.
|
|
La meilleure
des défenses contre le mauvais sort, c’est la défense active,
celle qui utilise toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes
les volontés, et qui dans cette union des forces finit par créer
une œuvre nouvelle, comme la sève au milieu des jours rudes, froids
ou pluvieux de février et de mars monte inlassablement dans l’arbre
pour y faire épanouir les feuillages du printemps.
P. Lejeune.
|
|
|
L’HONNÊTETÉ
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 33, samedi 12 octobre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
La
bonne opinion qu’on a généralement de soi-même, et qui
ne se perd point avec les mauvaises actions qu’on peut commettre, fait qu’on
s’attribue volontiers des qualités et des vertus, auxquelles on a
jamais sérieusement pensé. Il est des vertus qui nous semblent
naturelles, aussi naturelles que le parfum aux roses et la blancheur à
la neige. En cherchant bien on trouverait effectivement peu de personnes
qui ne pensent point qu’elles sont justes et qu’elles sont bonnes. On leur
ferait injure en leur démontrant que la justice et la bonté
ne sont pas d’un commerce courant, et qu’il est peu d’âmes qui en
soient véritablement capables. C’est qu’il est assez difficile de
tirer vanité d’être injuste ou d’être méchant,
tandis qu’on se targue volontiers d’être impatient ou orgueilleux,
un amour-propre avantageux abandonnant volontiers la patience aux personnes
nées pour être esclaves et la modestie aux âmes médiocres
et timorées. Ces vertus sont comme le bon sens: tout le monde croit
en avoir été pourvu à son berceau. Qui, par exemple
peut penser qu’il n’est pas honnête? On ne trouverait pas une personne
ayant commis un acte indélicat qui ne prétendit se justifier
et ne voulût prouver que si l’acte commis peut apparaître comme
répréhensible en lui-même il n’attaque pas au fond l’honorabilité
de son auteur.
|
|
Les
gens accoutumés à faire des gains injustes, à frauder,
à soustraire par des moyens détournés le bien des autres,
trouvent immédiatement des excuses qui doivent suivant eux les blanchir
de toute mauvaise intention. L’honnêteté n’est pour eux qu’une
chose toute relative; ils se conduisent, disent-ils, comme la plupart de
leurs camarades ou de leurs concitoyens, ne faisant ni plus ni moins que
ce qu’ils voient faire autour d’eux. L’extorsion de fonds devient simplement
un escamotage adroit, qui prouve qu’on est habile en affaires. Un homme politique,
qui s’est enrichi aux dépens de la collectivité, peut avouer
sans rougir qu’il a simplement pratiqué la règle du jeu, et
que si on devait lui en faire reproche, le reproche s’adresserait à
tous ses collègues. Même ne se ferait-il pas conscience d’ajouter
que cet enrichissement est une preuve qu’il sait gérer sa fortune,
et que l’État ne saurait que bénéficier d’un art si
rare et si profitable. On se rappelle ce que dit Saint-Simon* du président
de Maisons**. Ce dernier
s’était rendu coupable de malversations et avait été
congédié: «Les maladroits, dit-il, j’avais fait mes
affaires, et ils me renvoient au moment où j’allais faire les leurs.»
C’est ainsi que pour certaines personnes il n’y a que de l’adresse à
mettre dans sa poche l’argent des autres. Tous les moyens sont bons pour
s’enrichir, et l’on ne s’embarrasse d’aucuns scrupules.
|
*
Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755) mémorialiste majeur
de la cour de Louis XIV. (B.G.).
** René de Longueil marquis de Maisons, dit
le président de Maisons (1596-1677), d’une famille de parlementaires
parisiens, nommé en 1650 surintendant des finances, mais relevé
de ses fonctions à la majorité du roi survenue dès
l’année suivante (B.G.).
|
Quel mal
pour un homme en place d’obtenir d’un entrepreneur, auquel il a confié
un ouvrage important, lui fasse quelque avantage en nature ou en espèces?
|
|
La note
de l’entrepreneur sera peut-être majorée, ou le travail sera
moins bien fait, mais en fermant un peu les yeux, en ne se montrant point
exigeant sur le prix et sur le travail, l’homme en place touchera la somme
qu’il convoite, et se considérera encore comme un honnête homme.
Ce qu’on appelle avec quelque vulgarité, le pot-de-vin, est pratiquement
admis par des hommes qui entendent jouir de la considération générale.
Le mot les offusquerait peut-être, — du moins feraient-ils mine de
s’en offusquer, — mais la chose leur plait et leur est même familière.
Au reste leur adresse est généralement assez grande pour qu’on
ne puisse point administrer des preuves tangibles de leur corruption.
|
|
La convoitise,
le goût du lucre, l’insatiable cupidité ne cessent de travailler
l’esprit des individus. C’est par de perfides insinuations que le démon
de la malhonnêteté s’introduit dans la conscience et finit
par la troubler. Il est rare que le fait malhonnête se présente
avec une crudité repoussante. Il apparait au commencement sous une
forme bénigne et avenante. C’est seulement une imperceptible déviation
de la ligne droite. Combien de gens qui dans la suite ont dû subir
des poursuites pour spéculations illicites n’ont peut-être vu
d’abord dans un bénéfice un peu trop élevé que
la récompense d’heureuses prévisions? N’est-on point tenter
de justifier l’exagération de certains bénéfices en
plaidant que ce n’est là qu’une manière de compenser des pertes
qu’on a faites autrefois ou même des pertes éventuelles?
|
|
Rien n’est
plus attristant que de constater la facilité avec laquelle on s’éloigne
d’une honnêteté véritable. Sans un effort réel,
sans une attention vigilante, on cesse de pratiquer cette vertu, qui est
peut-être la première parmi les vertus sociales. Son absence
est en effet une cause de perturbations dans tous les domaines, ceux du commerce
et de l’industrie, aussi bien que ceux de l’administration et de la justice.
Ceux qui ne paient pas leurs dettes, qui ne livrent pas le travail correspondant
au prix versé, comme ceux qui favorisent l’accès à des
fonctions publiques, en se faisant monnayer leurs faveurs, ou qui conforment
leurs jugements à des ordres reçus, pour obtenir de l’avancement,
concourent également à l’éversion d’une bonne et saine
société.
|
|
La rénovation
d’une nation et d’un peuple ne peut se faire que si ses gouvernants entendent
pratiquer et faire pratiquer partout l’honnêteté. Il faudrait
imprimer un mouvement tel qu’il y eût une véritable conversion
des esprits, et qu’il devint impossible à un malhonnête homme
de pouvoir poursuivre ses actes, tant il craindrait la rumeur et même
la vindicte publique. Si l’on peut impunément être malhonnête,
si celui qui ne respecte pas la foi qu’il doit aux autres obtient la même
considération que celui qui s’attache scrupuleusement à faire
son devoir d’honnête homme, on ne pourra pas élever un peuple,
on le laissera croupir dans un matérialisme grossier.
|
|
L’honnêteté
veut en effet que l’homme se dégage de lui-même, qu’il n’accepte
jamais de composer avec les calculs bas et les gains sordides; elle lui demande
de placer son bonheur dans la satisfaction pure de la conscience, où
rien ne compte que ce qui peut s’apercevoir dans une parfaite clarté.
Elle exige un renoncement aux premiers appétits, qui poussent toujours
l’individu à se procurer immédiatement ce qui peut être
l’objet de jouissance, sans se préoccuper du choix des moyens. Si
c’est l’honnêteté qui dirige et qui commande, il se produit
un changement indubitable dans les esprits, et la moralité de tout
un peuple peut s’en trouver redressée.
|
|
Sans doute
on ne peut espérer que la conversion, dont nous parlions tout à
l’heure, soit générale. Mais si l’honnêteté est
remise à sa place, si on la tient en particulier honneur, on peut
espérer que les groupes d’honnêtes gens finiront par créer
une sorte d’aimantation qui attirera vers des conceptions plus nobles ceux
qui risquaient de s’égarer et de se perdre sur les mauvais chemins.
P. Lejeune.
|
|
|
POUR LA RENTRÉE DES CLASSES
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 34, samedi 19 octobre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Le mois
d’octobre, mouillé des premières pluies d’automne, éclairé
soudain de coups de soleil qui baignent d’une franche lumière les
feuillages à peine jaunis, possède encore la grâce de
la saison, où s’épanouissaient les fleurs et les fruits et
laisse pressentir déjà la dure saison où tout va se
désagréger sous les vents humides et froids de novembre. On
y goûte tout à la fois le charme et le malaise des transitions,
qui s’accompagnent d’une mystérieuse incertitude. Devant nous les
restes d’une saison finissante cachent encore le nu dépouillement
d’une inévitable saison. C’est alors que les enfants les jeunes gens
et les jeunes filles rentrent dans leurs écoles, leurs lycées
et leurs collèges*, et qu’ils vont ouvrir de nouveaux livres, s’initier à
de nouvelles connaissances. Pour eux cette incertitude d’octobre est le
symbole des sentiments qu’ils éprouvent. Ils sont encore imprégnés
de l’atmosphère qui s’était formée autour des études
de la dernière année scolaire, et ils se sentent troublés
en face de celle qui commence, et qui va leur imposer un effort d’assimilation.
Le changement de maître comme le changement de cours n’est pas sans
leur causer une véritable appréhension, et bien que la jeunesse
ne s’arrête point longtemps aux soucis, une ombre légère
passe alors sur son front.
|
*
Abeille d’Étampes du 7 septembre 1940:
|
RENTRÉE DES CLASSES
PRIMAIRES
Par ordre de l’Autorité
supérieure, la rentrée des classes primaires aura lieu le
trente septembre prochain, à l’heure habituelle, dans tout le département
de Seine-et-Oise.
Les classes de vacances qui ont lieu actuellement
cesseront le 21 septembre au soir. Les inscriptions des élèves
nouveaux seront reçues dans les écoles pendant la semaine
du 16 au 21 septembre.
A Étampes, M. le Président de la
Délégation spéciale municipales [Lejeune] s’occupe
de l’aménagement des locaux destinés à ceux qui sont
occupés actuellement par les troupes allemandes. Les familles peuvent
donc être rassurées: à partir du 1er octobre, les classes
primaires fonctionneront régulièrement.
L’inspecteur primaire: L. Moreau.
|
(B.G.)
|
L’appréhension
des parents est plus sérieuse. Chaque année d’études
est une étape, elle détermine pour sa part le sort futur de
l’enfant. On ne prend pas avec indifférence le plus ou moins d’influence
heureuse qu’une classe bien suivie peut avoir sur la formation d’un esprit.
Combien de fois avons-nous entendu dire avec tristesse: «Pour notre
fils, ce fut une année perdue?»* Aujourd’hui plus que jamais
les semaines, les mois et les années comptent. Nous n’avons plus
rien à gaspiller, le temps moins que toute autre chose. Ce ne sont
point seulement les parents qui sont anxieux devant le destin de cette jeunesse
française, c’est le Pays lui-même. Il sent que c’est son avenir
qui se joue avec ces cœurs et ces intelligences, qui suivant la formation
et l’élan qu’on leur donnera, ressusciteront sa grandeur ou prolongeront
sa décadence.
Que va faire cette
jeunesse? Comprendra-t-elle l’importance de la tâche qui l’attend?
Se souciera-t-elle vraiment du rôle qu’elle doit jouer? Elle vient
d’être le témoin de tableaux déprimants; de scènes
tragiques et sanglantes; elle garde devant ses yeux les images d’un exode
général, ou toute une population abandonnait sa maison, ses
fermes, ses terres et s’en allait chercher asile en des lieux qu’elle croyait
paisibles et qu’elle devait à nouveau quitter pour s’en aller plus
loin encore. Auparavant cette jeunesse, pour une bonne part, était
déjà éparpillée sur le territoire; elle s’était
éloignée des grandes villes menacées pour trouver quelque
sécurité dans de moindres agglomérations, elle avait
dû prendre d’autres habitudes et s’était en quelque sorte déracinée.
Ce qu’elle a vu, ce qu’elle
a compris, c’est l’instabilité des choses, la fragilité des
convictions et des espoirs et le peu que compte dans le tourbillon des événements
ce qu’on croyait établi pour toujours. De cet aperçu brutal
sur la vie on peut craindre un ébranlement profond dans l’esprit des
jeunes générations; on peut se demander s’ils ne regarderont
pas l’avenir comme quelque chose de si douteux, de si incertain qu’il est
inutile de s’y préparer avec une application sérieuse. Ce
sont là de légitimes sujets d’appréhension.
Cependant, il faut
compter sur cette qualité particulière aux êtres jeunes,
qui leur permet d’oublier vite le passé et de récupérer
des forces actives. La prostration est un sentiment qu’ils ignorent; ils
ne connaissent que le découragement passager, l’inquiétude
fugitive et la désillusion les effleure à peine. S’il faut
éprouver quelque crainte c’est qu’en cette époque troublée
où nous vivons, où les gens sont un peu comme des aveugles
qui cherchent à tâtons leur chemin, on ne relâche trop
les rênes, on ne donne une trop libre carrière à ceux
et celles qui n’ont pas encore acquis la maitrise de leur conduite.
L’œuvre des parents et
des éducateurs est donc d’administrer la preuve à leurs enfants
et à leurs élèves qu’ils savent se roidir contre la
mauvaise fortune et qu’ils gardent leur volonté intacte à travers
tous les événements.
Ils ont une responsabilité,
dont ils doivent prendre conscience tous les jours. C’est une véritable
garde qu’ils sont tenus de monter autour de la jeunesse. S’ils peuvent sentit
profondément la tristesse de leur époque, ils n’ont pas le
droit de désarmer leur constance et leur courage. A travers la brume
épaisse le capitaine doit continuer à conduire son navire;
ainsi quelles que soient les ténèbres qui peuvent assombrir
le cœur et les pensées des parents et des maitres, les uns et les
autres doivent conserver un regard calme et sûr, une main solide et
ferme, pour que grâce à eux la jeunesse puise entrer bientôt
dans la lumière. Plus que jamais ils doivent être des guides,
et au début de cette année scolaire il leur convient de prendre
les résolutions viriles qui excluent toute licence et tout relâchement. |
*
Sans doute, en temps que président de la délégation
spéciale municipale. Voyez la notre précédente. On donne
ici quatre annonces publiées par l’Abeille d’Étampes
le 28 septembre1940:
|
UNE RÉFORME
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Un décret du 21 septembre
a décidé de lla suppression dansd les lycées et collèges
de la classe de 6eB. Dorénavant, les lycées et collèges
donneront, de la 6e classe à la 3e classe, le seul enseignement classique
réservé jusqu’à présent à la section
A avec le latin et à partir d’une classe à déterminer,
le grec.
L’enseignement moderne qui comportera quatre ans d’étude sans latin
ni grec, sera donné dans les écoles primaires supérieures.
A partir de la classe de seconde, lycées et collèges donneront
dans les deux sections l’enseignement classique et moderne. Dans ce dernier
cycle, ils , ils recevront les élèves des écoles primaires
supérieures qui voudraient poursuivre leurs études en vue
du baccalauréat.
Cette réforme qui entrera progressivement
en application de façon àn réserver les droits acquis
des familles, ne prendra son plein effet qu’à la rentrée d’octobre
1943. Elle s’appliquera dès le 1er octobre prochain à la classe
de 6e seulement. La 5eB est maintenue dans les lycées et collèges
jusqu’en juillet 1941. la 4eB jusqu’en juillet 1941 et la 3eB jusqu’en 1943.
Les élèves actuellement inscrits
en 6eB dans les lycées ou collèges pourront, à leur
gré, être inscrits dans la 6e classique du même établissement,
soit dans l’année préparatoire des écoles primaires
supérieures.
|
|
COLLÈGE ET ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES D’ÉTAMPES
La rentrée des classes,
subordonnée à la mise en état des nouveaux locaux aura
lieu en principe le 4 octobre. Les élèves devront se trouver
dans la cour de l’ancienne Abeille (coin des rues de la République
et du Petit-Panier). L’établissement ne peut recevoir que des externes.
Ne seront admis dans les diverses classesque les élèves reçus
à l’examen de passage ou qui en sont régulièrement
dispensés par un certificat d’admission émanant d’un lycée
ou d’un collège national et qu’il devront présenter d’avance
en se faisant inscrire.
Les classes de la division B (sans latin) vont
disparaître par extinction. En conséquence tout élève
destiné au baccalauréat doit obligatoirement entrer en 6eA
(avec latin). L’examen d’entrée en 6e aura lieu le 4 octobre à
8 h. 30. En sont seuls dispensés les candidats justifiant d’un succès
à l’examen du concours des bourses ou au certificat d’études
primaires. Cet examen comporte les exercices suivants: orthographe et grammaire,
arithmétique et système métrique, compte rendu de lecture.
Les candidats doivent se munir de tout ce qu’il faut pour écrire.
Les élèves admis seront versés
soit en 6eA, soit en classe préparatoire de l’école primaire
supérieure suivant le choix des familles, qui sont informées
que le certificat d’études est obligatoire pour les élèves
de l’école primaire supérieure qui se destinent au brevet
élémentaire.
Une classe élémentaire recevra
dans la mesure des places disponibles les enfants âgés de 11,
10, 9 ans révolus, et de préférence ceux qui désirent
poursuivre, dans les années à venir, les études du second
degré.
Les jeunes filles sont admises dans toutes les
classes comportant l’étude du latin.
Le Principal recevra les familles, samedi, lundi,
jeudi, rue du Petit-Panier, de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à
16 h.
|
|
COURS COMPLÉMENTAIRE DES JEUNES GENS
Le cours supérieur, 2e année
et le C. C. de l’Ecole du Centre, destinés aux élèves
pourvus du Certificat d’études, ouvrira comme les classes primaires,
le 30 septembre dans d’autres locaux.
Les inscriptions seront reçues: 39, avenue
de Paris, le vendredi 27, le samedi 28, de 9 h. à 11 h. et de 14 h.
à 16 h. et le dimanche 29, de 9 h. à 11 h. |
|
MATÉRIEL SCOLAIRE
Les personnes qui auraient
connaissance que du matériel oou des objets scolaires se trouvent entreposés
dans des locaux de la ville, sont invités à en informer la
Mairie d’Étampes.
P. Fontant.
|
(B.G.)
|
La discipline
et l’autorité sont les piliers sur lesquels nous allons construire
la société. La discipline implique le respect de ceux qui commandent
et qui assument les responsabilités; l’autorité suppose chez
ceux qui donnent des ordres la compétence et la dignité. Il
est plus facile d’obéir que de commander, mais l’un et l’autre s’apprennent
également. L’Université doit à la fois former de maîtres
et des élèves. Peut-être le désordre que nous
avons pu constater n’est-il pas seulement le fait des enfants et des défaillances
parmi le personnel enseignant y ont-ils aidé quelque peu?*
|
*
Cette mise en cause des enseignants est à entendre dans le cadre
d’une reprise en main du système éducatif par le maréchal
Pétain, qui a fait exclure les juifs de l’enseignement par son Statut
des juifs publié le 3 octobre 1940. (B.G.).
|
Le maître
ne songeait pas toujours qu’il ne suffit point de distribuer des connaissances,
mais qu’il faut encore former les esprits et les caractères. Or c’est
en apprenant d’abord l’ordre, la discipline, la mesure qu’on opère
utilement sur les jeunes intelligences. S’ils ne se conforment pas à
des règles strictes de conduite, alors qu’ils sont prêts à
recevoir l’empreinte qu’on veut leur donner, il est peu probable qu’on obtienne
d’eux plus tard le respect de ces règles et de ces principes. C’est
dans l’adolescence qu’on prend des premières habitudes qui marqueront
l’homme fortement. Si ces habitudes sont mauvaises il est peu probable qu’on
puisse par la suite y remédier. Rien n’est plus difficile que de
modifier les façons de parler et les manières de se tenir,
qui semblent pourtant des habitudes superficielles. A plus forte raison
celles qui touchent au profond de l’être, et desquelles dépendent
les qualités et les vertus d’un homme.
|
|
Il faut
que nous grandissions le rôle de l’éducateur. Instruire et
éduquer doivent être mis sur le même plan; ils doivent
aussi marcher de pair. Une intelligence n’est vraiment belle que si elle
s’accorde avec des dispositions morales excellentes. Là où
il n’y a point de moralité, l’intelligence risque d’être néfaste
plutôt qu’utile à la communauté: ne connaissant pas
de freins, ses écarts sont d’autant plus terribles qu’elle est plus
ardente et plus vive.
|
|
Il faut
qu’on donne aux enfants le sens du devoir, qu’ils apprennent qu’ils ne sont
point nés pour eux-mêmes, mais pour les autres, et que dans
le retranchement de leurs humeurs et de leurs caprices, il n’y a pas autre
chose que le travail fourni par ceux qui cultivent les jardins et les champs
quand ils en enlèvent ce qui peut gêner et gâter la germination
et le libre développement des fruits généreux qui nous
sont nécessaires.
|
|
Demain
la société est à même de connaître un état
meilleur, mais la condition première pour qu’elle puisse le connaître
est de bien former l’esprit et la volonté des enfants. Cette formation
dépend de leurs parents et de leurs maitres.
|
|
Les uns
et les autres sont responsables de l’avenir, et ils peuvent se persuader
que si leur tâche est lourde, elle est parmi les plus belles qu’on puisse
imaginer.
P. Lejeune.
|
|
|
LAMARTINE
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 35, samedi 26 octobre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
On a fêté
hier, 24 octobre, le cent-cinquantenaire de Lamartine qui naquit en 1790 à Milly. Non point le
Milly, qui se trouve près d’Étampes, et qui s’abrite à
l’orée de la forêt de Fontainebleau, mais le Milly de la Bourgogne,
où dans les journées de septembre, on peut
Écouter le cri des
vendanges
Qui monte du pressoir voisin,
Voir les sentiers rocheux des granges
Rougis par le sang du raisin.*
|
*
Alphonse de Lamartine (1790-1869), La Vigne et la Maison (1857),
premiers vers. (B.G.)
|
Ici c’est
le Milly des menthes odorantes*, là-bas
le Milly des vins parfumés; c’est ainsi qu’en France beaucoup de
pays ont le même nom, comme s’ils voulaient se faire écho et
prouver, qu’éloignés l’un de l’autre, ils ont pourtant le
même cœur.
|
*
Milly-la-Forêt est réputée pour sa menthe poivrée.
(B.G.)
|
Né
parmi les vignobles, Lamartine n’a point senti leur influence, et il n’y
a rien dans son œuvre qui exprime cette exubérance, cette abondance
de gaîté, cette joie de vivre, qui semblent l’apanage naturel
de ceux chez qui Bacchus* aime à faire
de réguliers séjours.
|
*
Dieu du vin. (B.G.)
|
Autant
Rabelais, né sur les bords de cette Loire, qui coule entre les rangs
serrés des vignes, a mis dans son langage ce que je ne sais quoi de
luxuriant, de gras, et de charnu, qui donne à tous ses mots une saveur
de festin flamand, autant Lamartine, parmi les crus les plus célèbres
du monde, a gardé cette limpidité, cette transparence, cette
candeur qu’on trouve dans l’eau de certains lacs, qui semblent faits seulement
pour la blancheur des cygnes.
|
|
Lamartine
ne ressemble pas à l’image que nous nous faisons du Bourguignon.
S’il aime sa terre, dont les vignes pourpres sont la parure naturelle, il
n’y voit pas celle qui produit un des meilleurs vins, il ne pense pas à
l’entretenir soigneusement, à la couver comme un trésor incomparable,
elle n’est pour lui que le lieu de sa naissance, de son éveil à
la vie, des premières tendresses de son âme. Le Bourguignon
qui s’attache à ses biens, qui aime la bonne chère, qui a gardé
le goût des devis joyeux, ne ressemble guère au caractère
élégiaque, abandonné, quelque peu nostalgique de Lamartine.
|
|
Son charme,
c’est en effet celui qu’on éprouve en face des choses qui se délient,
qui se laissent aller au vent qui passe, qui flotte mollement dans le courant
qui les emmène: boucles de cheveux que la brise a nonchalamment défaites,
barques qu’aucune main ne dirige, feuillages d’automne qui laissent tomber
au sol l’or mutilé de leurs souvenirs d’été. Quand
les premières «Méditations» parurent*, ce fut
cet accent nouveau d’un abandon si naturel qui toucha tous les cœurs et valut
au poète une renommée inattendue et subite. On admirait sans
réserve des vers qui ne ressemblaient à aucun de ceux qu’on
avait lus jusqu’alors, qui paraissaient ne rien devoir à l’étude,
à la littérature, à quelque école que ce soit,
et qui coulant avec harmonie donnaient l’impression d’une source mystérieusement
jaillie sous la main d’une Muse, dont ce serait le premier don.
|
* Ce recueil a connu sa
première édition en 1820 (B.G.).
|
Ce qui
touchait les contemporains de Lamartine, comme ce qui nous touche encore aujourd’hui,
c’est dans ces mélodieux poèmes l’absence de toute recherche
et de tout apprêt. On n’y sent point une forme voulue, une curiosité
de style, un désir de surprendre par des inventions de rythme ou des
étrangetés d’expression, c’est le chant pur, et simplement
modulé d’une voix qui sait chanter sans avoir eu besoin d’apprendre.
Le charme naissait de cette liberté, de cet abandon, on pourrait presque
dire de cette négligence. Peut-être serait-ce là pour
le poète l’écueil ou devaient l’attendre les critiques.
|
|
C’est
que pour eux en effet, le génie naturel ne doit pas exclure le travail
et l’application*. Lamartine ne s’en souciait
pas pour faire ses vers. Il les écoutait chanter en lui, mais il
ne pouvait se résigner à contrôler leur chant.
|
*
On voit ici que Lejeune est lui-même poète. Son éditorial
du 21 décembre sera d’ailleurs un poème consacré au
retour des cendres de l’Aignon aux Invalides le 15 décembre (B.G.).
|
Quand
l’ivresse des mots, des cadences et des rimes gonflait son cœur, il se refusait
à modérer son élan, à poser d’avance les jalons
de son œuvre, il se laissait porter par l’inspiration, comme l’hirondelle
par ses ailes quand, dessinant ses courbes gracieuses elle n’en mesure ni
la durée ni l’amplitude.
|
|
Lamartine
ne s’arrête point, comme d’autres poètes, aux ciselures, aux
délicatesses, aux enluminures précieuses des missels et des
livres d’heures; ce n’est point un artiste patient et jaloux des détails,
qui se penche sur l’orfèvrerie des syllabes; il faut renoncer à
trouver chez lui des émaux et des camées*. Son envol
est trop grand pour qu’il puisse s’arrêter à la justesse et
à la précision des miniatures.
|
*
Allusion à la poésie extrêmement travaillée de
Théophile Gauthier (1811-1872) qui avait donné en 1852 un
recueil intitulé Émaux et camées (B.G.).
|
Ses
tableaux s’en ressentiront toujours. C’est par le sentiment qu’ils nous
touchent, par l’émotion prise au moment même où il vient
d’être frappé par ce qu’il voit, mais non point par la couleur,
le dessin, la profondeur qu’il a su leur donner. Ce sont des surfaces douces,
aimables, lumineuses, où tout se confond dans une teinte agréable
mais sans éclat, dont les tons seraient difficiles à déterminer.
|
|
Cette
négligence, qu’on lui a tant reprochée, vient à la
fois de ce qu’il ne s’arrête pas à composer, et qu’il ne prolonge
pas son observation. Il a dans ses mouvements la grâce du cygne, il
n’a pas dans ses regards l’acuité de l’aigle. Ici s’accuse la différence
avec Chateaubriand*, qui fut au commencement de sa carrière son maître
préféré. Jamais dans sa prose comme dans ses vers il
n’a pu conquérir cette maîtrise du verbe, grâce à
laquelle l’auteur des Mémoires d’Outre-Tombe fixe définitivement
les lieux et les choses.
|
|
Il ne
peut se décider à lier fortement la gerbe de fleurs qu’il
a cueillies, il en laisse toujours échapper quelques unes, qui glissent
à terre, comme s’il n’attachait qu’une faible importance à
leur prix. Peut-être est-ce pour se justifier de cette sorte d’insouciance
qu’il a dans une de ses épîtres essayé de prouver que
rien n’était plus vain que la gloire littéraire et qu’il ne
fallait point vouloir attacher à son œuvre le désir de la voir
impérissable:
La gloire a beau s’enfler;
dans les siècles suivants,
Les morts n’usurpent pas le soleil
des vivants.
|
|
Ce n’est
point que, comme tout artiste, il ait été entièrement
dépouillé de ce désir, puisqu’il a dit lui-même:
Et l’amante et l’amant,
sur l’aile du génie,
Montent d’un même vol vers l’immortalité.
|
|
Mais à
certaines minutes de sa vie, il a cru qu’il avait une mission sociale à
remplir*, et son rôle d’homme politique lui a semblé plus
grand que son rôle de poète. C’est en quoi il se trompait,
et c’est par quoi, malgré ce qu’il y avait d’aimable dans son caractère,
il s’est fait des détracteurs et des ennemis, comme Sainte-Beuve
et Delacroix qui goûtaient cependant la beauté de ses poèmes.
D’autres hommes, qui n’avaient ni le talent du premier ni le génie
de l’autre, l’attaquèrent sans aucun égard. Il faut reconnaître
à sa louange qu’il a conservé toujours une très belle
attitude en face des insultes et des calomnies. Les vers qu’il a écrits
dans A Némésis*, sont l’expression même
de son âme:
Mais moi j’aurai vidé
la coupe d’amertume,
Sans que ma lèvre même
en garde un souvenir,
Car mon âme est un feu qui brûle
et qui parfume
Ce qu’on jette pour la ternir.
|
*
Cette problématique n’est-elle pas aussi celle de l’auteur?
(B.G.)
* Poème composé
en 1831 en réponse à une attaque parue dans la revue Némésis
qui lui reprochait d’avilir sa muse en la faisant la servante de ses idées
politiques. (B.G.)
|
Il semble
en effet que rien n’ait jamais terni l’âme de Lamartine. Les malheurs,
les ingratitudes, les médisances, ont pu l’attrister, elles n’ont
jamais été capables de l’aigrir*. C’est un assez bel exemple,
il mérite d’être proposé à tous.
|
*
Ceci sans doute vaut aussi pour l’auteur, qui connaîtra même
la prison lors de la Libération. (B.G.)
|
On ne
lit plus guère les poètes, et Lamartine subit le même
sort que les autres. L’enfance et la jeunesse en prennent quelques reflets
dans leur mémoire et l’âge mûr les oublie. Parfois seulement
quelques vers chantent dans l’esprit, et l’on s’étonne du plaisir
qu’on peut y trouver. De temps à autre ce serait pourtant un aimable
délassement d’entr’ouvrir leurs livres et d’y goûter pour quelques
moments la grâce et la beauté des mots, qui dans l’usage courant
que nous devons en faire, perdent leur mélodie et leurs ailes.
|
|
Le chantre
d’Elvire tressaillirait dans les Champs-Elysées des poètes,
si pour quelques jours on relisait les stances du «Lac» ou du
«Vallon»*.
P. Lejeune.
|
* Poèmes contenus
dans les Méditations. (B.G.)
|
|
LE MARÉCHAL
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 37, samedi 9 novembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Cela se
passait à Souilly, en 1916. Depuis vingt-quatre heures la neige tombait;
elle opposait son doux silence, sa chute inoffensive et mollement indécise
au bruit sauvage des combats qui s’amplifiaient autour de Verdun, à
la chute implacable et meurtrière des innombrables obus. On eut dit
qu’à force de blancheur et de candide volonté elle allait
forcer les hommes à cesser leur lutte. Mais la neige n’empêchait
point les mitrailleuses de poinçonner les ténèbres,
ni les canons d’imposer au sol leur labour circulaire. Dans le village,
où l’on entendait gronder l’horizon, on voyait seulement sous le
crépuscule hâtif, passer des groupes de soldats, qui s’en allaient
au front, dans le feutre neigeux, sans qu’on entendit le roulement de affûts,
le martèlement des fers à cheval, ou le pas de souliers ferrés.
On eut pensé que c’étaient de simples ombres, d’où
la vie s’était retirée, si l’on n’avait pas distingué
de temps à autre le tintement des gourmettes, le frottement des cuirs,
le gémissement des essieux et l’entrechoc des fusils sur les gamelles.
Mais tous les bruits avaient quelque chose de lointain, d’irréel,
comme s’ils n’appartenaient déjà plus aux vivants.
Il se livrait une bataille,
où la mort fauchait si vite les héros qu’ils demeuraient debout
pour l’éternité.
Une vieille citadelle était
menacée. De son sort dépendait l’issue d’une campagne qui
durait depuis plus de deux ans et demi. Sur la petite place de Souilly on
avait vu dès le matin le général de Castelnau, appuyé
sur une canne, aller de long en large, la nuque fortement enfoncée
dans le col de son dolman, la moustache recouvrant le secret de ses lèvres
comme les sourcils broussailleux le secret de ses pensées: seul.
Cette solitude avait quelque chose de frappant. Au moment des grandes résolutions
l’homme ne doit rien demander qu’à lui-même, il ne lui est
plus permis de rien emprunter aux autres: tout emprunt serait une faiblesse.
Ce jour-là le général de Castelnau devait faire le
choix d’un chef: il savait que de ce choix dépendait le sort de Verdun.
Vers la fin du jour
sur la même petite place, des automobiles attendaient. La neige tombait
toujours et ses petits flocons continuaient à couvrir le sol. Trois
généraux se trouvaient réunis là, devant l’église
du village. Deux d’entre eux s’étaient rapprochés l’un de
l’autre. On voyait la silhouette haute et mince du général
de Langle de Cary se pencher sur la carrure courte et ramassée du
général de Castelnau. Tous deux s’avançaient en causant:
on sentait dans leur démarche, dans leurs légers mouvements
de tête, dans l’attention qu’ils mettaient à s’écouter,
qu’il s’agissait d’une question grave, qui n’admettait point qu’on en différât
l’examen, ne fusse qu’un instant, pour y répondre plus tard. Ils portaient
tous deux l’ancien uniforme, le képi rouge à feuilles d’or,
la culotte à bande noire, et les bottes à l’écuyère.
Leur tenue était demeurée la même que celle qu’on portait
avant 1914; guerriers illustres, ils apparaissaient comme les héritiers
d’une vieille tradition militaire. On ne distinguait pas près d’eux
la suite ordinaire d’officiers d’état-major, aucune escorte ne les
accompagnait.
A quelques pas seulement
en arrière on apercevait dans un uniforme bleu d’horizon, les jambes
moulées dans des bandes molletières, s’avançant droit,
avec quelque chose de calme et d’aisé dans la démarche, un
soldat, qui portait en toute son allure une incroyable distinction. Sur sa
figure jeune on était surpris de voir une moustache blanche, et quand
on regardait mieux le képi de drap bleu, sans or et sans feuillage,
on était étonné d’y apercevoir trois petites étoiles.
Derrière les deux autres généraux, qui semblaient préoccupés
et soucieux, il offrait l’image incomparable de la confiance sans présomption,
de la force sans violence, de la volonté sans contraction, il était
l’image même de l’honneur qui affronte le destin sans peur et sans
émoi, la tête aussi libre qu’Œdipe en face du Sphynx. Sans hâte,
sans tâcher de diminuer la distance qui le séparait des deux
autres chefs d’armée, il s’approchait noblement et simplement d’une
heure légendaire et sacrée.
Dans une maison de paysan,
basse, sans aspect, semblable à toutes celles qu’on trouve dans un
village de France, par une porte où des mains chargées d’une
glèbe ancienne avaient fait jouer le loquet, les trois généraux
pénétrèrent. Eux seuls pourraient nous dire ce que
fut cet entretien. Ils en conservent tous les trois le secret.
A travers les âges
viennent se placer ainsi des minutes inconnues où se jouent les destinées
des peuples. Peut-être même ceux qui les ont vécues les
ont-ils oubliées.
Ce soir là
pourtant sortit d’une humble maison une décision qui fut parmi les
plus hautes de la guerre. La défense de Verdun était confiée
au général en bleu d’horizon qui s’avançait si calme
parmi le crépuscule d’hiver: au général Philippe Pétain.
Dans ce village de l’Est
français, il y eut autre chose, ce soir-là, qu’une transmission
de commandement. Ce n’était pas seulement un général
qui, dans le tumulte des combats et dans la confusion des attaques et des
défenses, introduisait une lucidité qui allait étonner
les stratèges, c’était caché sous le voile d’un avenir
brumeux, un homme qui sachant s’adapter à tous les événements,
sans jamais se laisser dominer par leur violence ou leur brutalité,
venait apporter à son pays, dans toutes les circonstances, une merveille
de volonté froide et d’indomptable courage. Partout, dans la guerre
comme dans la paix, il allait être pour la France, le soutien et l’appui,
qu’on sentait toujours prêt à remettre debout les situations
graves ou désespérées. Depuis vingt-cinq ans le Maréchal
n’a cessé d’être présent à l’esprit de tous ceux
qui, devant l’imminence des catastrophes, comptaient sur lui, comme dans
la tempête les passagers espèrent dans l’habileté du
capitaine.
C’est une éminente
qualité chez un homme que de voir les situations. Un regard que rien
ne peut éblouir ni troubler, qui voit autour de lui le déchaînement
des circonstances, sans qu’il perde son acuité, sans qu’il laisse
atteindre sa puissance de discernement, est quelque chose d’exceptionnel,
qu’on peut admirer sans réserve. Qu’il se soit agi de redonner aux
troupes françaises comme en 1917 le sentiment de la discipline, d’en
coordonner toutes les attaques comme en 1918, de distinguer par où
il faut agir pour abréger une campagne coloniale comme il le fit
si bien au Maroc, de remettre de l’ordre dans un ministère, ou de
montrer une souveraine intelligence dans les rapports pénibles, qui
existaient voici deux ans avec l’Espagne, partout le Maréchal nous
a montré qu’il conservait une maîtrise de pensée et
d’action qui ne se laissait entamer ni par les obstacles, ni par les difficultés,
ni par les mauvais vouloirs.
|

Abeille d’Étampes du 7 décembre
1940
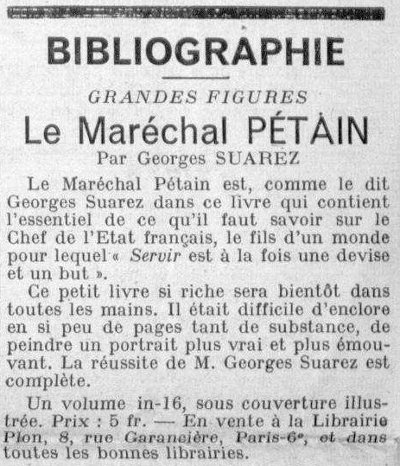
Réclame parue dans l’Abeille d’Étampes
du 14 décembre 1940
|
Ce qui
caractérise le Maréchal, c’est l’intelligence. Une intelligence
constructive, prête à rechercher comment il faut agir, ennemie
de improvisations et des chimères, n’usant d’une critique vive et
sûre que pour distinguer les erreurs et les fautes, jamais pour faire
valoir, aux dépens même du droit et de la justice, une mordante
et cinglante ironie, dont la vanité ne sert qu’à ruiner et à
détruire. Il a mis son intelligence au service de l’État, et
non point à son service. Ce n’est pas pour se faire valoir qu’il n’a
cessé de l’entretenir et de la nourrir chaque jour, c’est pour que
son pays à tout moment puisse compter sur elle. De là cette
sérénité qui n’a cessé d’entourer toutes ses actions.
Quand un homme n’enferme pas son intelligence dans les préoccupations
personnelles, il est exempt de passion. L’amour qu’il donne à une haute
Idée, comme par exemple à sa patrie, n’est pas en effet une
passion, c’est un culte avec tout ce qu’il comporte de suprême dignité.
On n’a jamais pu atteindre le Maréchal. Sa position est demeurée
au-dessus de tous les changements. Marc-Aurèle* disait déjà: «C’est une citadelle
que l’intelligence libre de passions. L’homme n’a pas de plus forte position
où il puisse se retirer pour être désormais imprenable.»
Pour les Français, le Maréchal a dressé cette citadelle
qui, parmi nos malheurs et nos revers, n’a cessé de tenir, et qui
permet aujourd’hui à notre peuple de sauvegarder son honneur.
|
* Marc-Aurèle (121-180)
empereur romain et philosophe stoïcien, auteurs de Pensées
rédigées en grec, dont Lejeune cite ici la sentence VIII,
48, 3.
|
Sa fermeté
demeurera légendaire. La défaite ne l’étonne pas plus
que la victoire; aux variations du destin il oppose la fermeté de
son caractère, aux vicissitudes de la fortune la constance de sa volonté.
S’il peut être un père, il sait aussi bien être un chef.
Il y a dans son âme une intrépidité qui n’éclate
pas par de vaines paroles et par des gestes dramatiques; il joint à
la mesure grecque une discrétion héroïque qu’on dirait
racinienne.
|
|
Peut-être
que s’il fallait établir une comparaison, on pourrait dire qu’avec
son esprit toujours clair, son intelligence toujours bienveillante, son autorité
toujours exacte, il est parmi nous comme un Marc-Aurèle, illuminé
par vingt siècles de christianisme*.
P. Lejeune.
|
*
On est aussi au centre de la pensée de Pierre Lejeune, qui conjugue
essentiellement la religion chrétienne et la tradition philosophique
stoïcienne, dans la lignée de L’Imitation de Jésus-Christ,
ouvrage de piété dû à Thomas a Kempis (v.380-1471),
dont Philippe Lejeune m’a confirmé que c’était bien le livre
de chevet de son père. (B.G.)
|
|
MAINTENIR
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 38, samedi 16 novembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Les
grands vents d’automne* se déchaînent
en ce mois de novembre incertain, humide, brumeux, où passent par
moment des tiédeurs lourdes, comme si quelques feux de l’été,
oubliés quelque part, les réchauffaient au passage. Par moment
leur violence s’accroît, ils arrachent les dernières feuilles,
rebroussent les branches des arbres avec la force irrésistible d’un
fauve qui s’abat sur une proie, font voleter les tuiles et les ardoises,
abattent des enseignes, forent les meules, dispersent dans leur course mille
objets divers. Dans ces rafales les créations de la nature et les
ouvrages de l’homme résistent, s’arcboutent pour n’être point
emportés. La maison s’accroche à ses fondations, l’arbre à
ses racines; poutres et chevrons du grenier cherchent à demeurer enchevêtrés
les uns dans les autres, les branches des ormes et des chênes à
demeurer soudées au tronc. C’est une dure et vaillante résistance,
où s’exprime cette force de conservation, qui depuis le début
du monde, n’a cessé de s’opposer aux forces de destruction.
|
*
L’automne 1940 est dans tout cet article la métaphore du déclin
de la France comparé à celui de l’Empire romain (B.G.).
|
Si la
nature répare les ravages qui sont faits dans ses forêts et
dans ses plaines, l’homme ne perd point de temps à remettre en état
ce que le déchaînement des éléments à
renverser, brisé, arraché. Les échelles se collent
aux murs, les couvreurs remettent les tuiles, les maçons refont un
rapide hourdage* sur la cloison écroulée. La besogne éternelle
recommence; l’homme lutte pour défendre l’héritage des aïeux
et des siècles.
|
*
Maçonnage grossier de moellons et de platras, selon Littré
(B.G.).
|
Cette
lutte pour nous n’est pas seulement celle qu’il faut livrer contre les assauts
des forces physiques. A côté des champs défrichés,
des jardins cultivés, des maisons construites, des monuments édifiés,
qui représentent tous une accumulation de patience et de travail
humains, il y a cette autre construction, qu’ont réalisée
les hommes de bonne volonté, la construction spirituelle et morale,
derrière laquelle ils abritent ce qu’il y a de plus haut et de plus
noble dans leur nature. Héritage de mœurs policés de vertus
personnelles et publiques, de hautes pensées et de nobles aspirations,
qu’il faut garder intact et préserver chaque jour contre les coups
de boutoir, les houles tumultueuses, et les sauvages soulèvements
d’instincts exacerbés, qui veulent se satisfaire gloutonnement sans
autre but que d’assouvir pour un moment leur rage frénétique.
|
|
L’histoire
offre périodiquement le témoignage de ces ébranlements,
qui semblent vouloir tout emporter et ne rien laisser après eux.
Quand Boëce écrivait son livre des Consolations*, il souffrait
moins pour lui-même que pour l’état d’un monde finissant, dont
il avait pu goûter encore l’agonisante eurythmie. Il se demandait
avec anxiété s’il demeurerait quelque chose de cet ensemble
de conceptions, de mœurs, de littérature et d’art, qui avaient fait
l’honneur des Grecs et des Romains. Tout devrait-il s’abîmer dans la
méconnaissance et dans l’oubli? Ne serait-ce qu’une mutilation douloureuse,
ou faudrait-il que les siècles suivants fûssent privés
d’un trésor, où la poésie, la philosophie et le droit
formaient une construction de l’esprit humain, dont l’équilibre était
admirable? De tous ces fastes de gloire ne resterait-il rien qui pût
aller à la mémoire des futures générations?
Boëce, comme la plupart des personnes de sa condition, posait ces questions
angoissantes au moment ou l’Empire de Rome s’écroulait. Pourtant le
trésor de l’ordre gréco-romain ne fut pas perdu. Des hommes
prirent soin de le préserver; comme les Egyptiens, ils surent embaumer
et envelopper de bandelettes ce corps précieux des antiquités
classiques, et ils donnèrent ainsi au XVIe siècle l’occasion
de le faire renaître dans sa beauté victorieuse.
|
*
Boèce (v.470-525), homme d’État et philosophe apès
la chute de l’Empire romain, fut ministre du roi ostrogoth Théodoric,
qui le fit mettre à mort après une dénonciation calomnieuse
de malversation. Avant d’écrire en prison son fameux De la consolation
de la philosophie, il avait élaboré en latin une synthèse
des philosophies néo-platonicienne et aritototélicienne qui
constitua le principal fondement de la pensée du moyen-âge
européen et prépara à terme la Renaissance. Il est
évident que Lejeune établit ici un parallèle implicite
entre sa propre situation et celle de Boèce (B.G.).
|
Les
vicissitudes des nations et des peuples sont inévitables. Comme des
raz de marée les malheurs fondent sur eux, et ils risquent de s’y
perdre entièrement. Une tâche s’impose alors à ceux qui
voient les calamités s’acharner sur leur époque, c’est de maintenir
coûte que coûte ce qui reste debout ou ce qui subsiste, plus
ou moins effondré, de l’œuvre immense léguée par le
passé. Quelles que soient les ruines amoncelées autour d’eux,
ils doivent garder leur énergie; c’est elle qui leur permettra de
faire bénéficier l’avenir de ce qu’ils auront pu soustraire
aux désastres présents.
|
|
Pendant quelque temps, beaucoup des nôtres ont pu craindre qu’ils verraient
quelque chose de semblable à ce que virent les Romains de la décadence.
Mieux éclairé, un peu remis du coup inattendu dont ils avaient
été frappés, ils commencent à se faire de notre
situation une opinion moins sombre. Ils constatent que malgré les
défaillances nombreuses notre peuple ne s’est pas laissé gagné
par la déliquescence qui avait atteint certaines parties de notre
société, et que dans les ruines aussi bien morales que matérielles,
qui jonchent le pays, il sait recouvrer peu à peu sa force et son
équilibre.
|
|
Loin
de vouloir laisser partir à vau-l’eau notre patrimoine acquis à
force de labeur et de constance, nos gens de France ont repris les vieux
instruments de travail, ceux des champs comme ceux de l’atelier et du chantier,
la charrue, la houe, la truelle, la lime, le rabot et la varlope, tout ce
qui sert à fendre le sol, à cimenter la pierre, à ouvrer
le bois, à travailler les métaux. Nos gens ont repris en même
temps la conscience d’eux-mêmes, de leurs qualités personnelles
et des vertus de leur race*. Plutôt que
de tout briser, de transformer la moindre impatience en colère, le
plus léger mécontentement en violence, la première souffrance
venue en révolte, ils ont pensé qu’on devait d’abord chercher
par la raison et par l’application à venir à bout des difficultés
et des obstacles.
|
*
Cette conception quelque peu désuète de la race fait
alors partie du fond commun de la pensée européenne, et de
l’outillage intellectuel de la plupart des historiens. (B.G.)
|
Maintenir
par le travail, maintenir par la vertu, telle est la devise qu’ils veulent
prendre. On ne maçonne bien qu’avec des matériaux solides.
Ces matériaux sont là, nous n’avons qu’à nous en servir.
La France sans doute ne dispose pas de toutes les matières dont un
peuple moderne a besoin, mais elle trouve chez elle le minimum suffisant
pour attendre le moment où elle pourra, suivant l’expression moderne,
«travailler à plein rendement». Elle possède en
tout cas, pour ce qui concerne le domaine moral, des qualités qui
n’ont pas disparu et qui ne demande même qu’à s’affirmer. Ces
qualités n’étaient qu’en sommeil, les Français qui en
étaient les dépositaires avait absorbé on ne sait quel
narcotique, quel poison subtil qui les avaient paralysés; un souffle
maléfique les avait frappé d’engourdissement et de stupeur.
|
|
Ils se
réveillent aujourd’hui, avec chaque heure, ils reprennent conscience
d’eux-mêmes, ils font craquer un à un les liens qu’on* avait passés
autour des vertus de leur race.
On leur avait imposé
le goût de l’inaction et de la paresse, et la race était travailleuse,
elle avait à travers les siècles fait du sol gaulois, un véritable
jardin, à la française, cultivé mètre par mètre
avec dilection et amour.
|
*
Qui est on, opposé à leur race? Il est difficile
de ne pas y voir une allusion à la part que prirent un grand nombre
de juifs dans le gouvernement du Front Populaire dont la figure principale
était précisément Léon Blum, l’un des dirigeants
de la Section Française de l’Internationale Ouvrière, et président
du Conseil de 1936 à 1937 puis de mars à avril 1938. (B.G.)
|
On leur
avait persuadé de ralentir leur action*, et la race aime aller vite,
s’atteler à l’ouvrage, comme un cavalier se met en selle d’un coup
de rein solide et vigoureux.
|
*
Allusion transparente aux congés payés mis en place par le
Front Populaire. (B.G.)
|
On leur
avait fait croire qu’il n’y avait de liberté que dans le désordre
et la violence, et la race avait su montrer un esprit de discipline qui,
malgré les révoltes et les révolutions, se manifestait
quand même dans le respect des autorités établies et dans
l’observation des traditions.
|
|
Ainsi
y avait-il eu pour cette race française une sorte de déviation.
Des hommes qui lui étaient pour la plupart étrangers qui n’avaient
point dans leur sang des aspirations naturelles*
l’égaraient dans de mauvais chemins. Le malheur est venu s’abattre
sur elle, et tout à coup elle s’est ressaisie toute entière.
Dans un état de semi léthargie, agréable par sa molle
inconscience, elle perdait ses qualités et ses vertus; dans la douleur
et la souffrance elle les retrouve, et veut en apporter le témoignage
au monde. La sentence de Sénèque se
confirme ici: ce n’est jamais sans mal qu’on administre la preuve de sa vertu,
Nunquam virtutis molle documentum est**.
|
* Nouvelle périphrase
désignant au moins un certain nombre de juifs, en tant que tels,
comme responsables des maux de la France. La loi sur les dénaturalisations
(qui visait essentiellement les irsaëlites) a été mise
en place par le régime de Vichy dès le 22 juillet 1940. Le
premier statut des juifs, qui les exclut de la fonction publique, du commere
et de l’industrie, date du 3 octobre 1940. Simultanément la loi du
4 octobre autorise l’internement immédiats des juifs étrangers.(B.G.)
|
Déchirée
et meurtrie, la France autour de son chef se roidit pour sauver son héritage
de travail, d’ordre et de loyauté, elle ne s’abandonne pas: elle
maintient.
P. Lejeune.
|
|
|
L’UNITÉ FRANÇAISE
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 40, samedi 30 novembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
L’effort
constant de réunir plusieurs pays qui différaient par la nature
de leur sol et le caractère de leurs mœurs, s’est manifesté
particulièrement sur notre sol où, dès que l’Empire
Romain se fût abîmé devant les barbares, on sentit passer
le désir de ressouder entre elles les diverses parties de la Gaule.
S’il faut en croire Camille Jullian* il y aurait
eu, bien avant l’occupation romaine, entre les peuples qui habitaient l’ancienne
Gaule des liens moins étroits que ceux qui unissent actuellement
les citoyens d’une même patrie, mais qui cependant entretenaient entre
ces habitants une sorte de sympathie ethnique et peut-être religieuse.
Camille Jullian parle de hauts lieux où se seraient réunis
d’une manière régulière les représentants des
différentes tribus gauloises. Depuis des siècles la France
aurait donc cherché son unité.
|
*
Camille Jullian (1859-1933), historien français auteur d’une monumentale
Histoire de la Gaule (1907-1928).
|
Tâche
difficile, âpre, ingrate où les échecs se multiplient
et risquent de décourager les meilleures volontés. Les peuples,
en effet, comme les individus portent en eux-mêmes deux forces dont
la puissance est inégale suivant les temps, une force qui les pousse
à l’unité, une autre qui les pousse à la division.
La Grèce antique si remarquable par l’intelligence et l’art de ses
citoyens n’a jamais pu triompher des forces qui la portaient à se
diviser constamment et, a fini par s’offrir, comme une proie facile, au
conquérant moins éclairé qu’elle-même*. Que d’hommes, pourvus de facultés brillantes,
de possibilités multiples, d’aptitudes et de talents, n’ont pu donner
à leur vie une expression haute et noble, faute d’avoir pu réaliser
dans leur esprit et dans leur âme une parfaite unité de conscience.
Tiraillés perpétuellement entre des velléités
et des désirs, qui s’opposaient les uns aux autres, ils n’ont point
su maintenir dans une direction unique, où chaque pas les aurait fortifiés
dans l’accomplissement de leur œuvre.
|
*
Allusion à la fin de l’indépendance des cités grecques
entrées vers 336 sous la domination de fait du royaume de Macédoine
sous les règnes de Philippe II puis d’Alexandre le Grand. (B.G.)
|
Quand
on contemple l’histoire de la France on est obligé d’admirer la continuité
de pensée, qui l’a inspirée, et guidée à travers
les siècles. Les peuples dont elle est l’émanation spirituelle
n’ont pourtant pas été exempts de ces instincts et de ces
passions qui les portent à se déchirer, à se meurtrir
et, pour ainsi dire, à s’entre-dévorer. Si la France a toujours
voulu réaliser son unité, ce n’est pas sans peines et sans
tourments; comme l’Héraclès antique, il lui a fallu poursuivre
des travaux accablants, et l’on aurait pu croire plus d’une fois qu’épuisée
de fatigue elle finirait par quitter la partie, mais comme le vainqueur
de l’hydre elle aurait pu répéter que le destin finirait plutôt
de se lasser de lui imposer des travaux qu’elle ne se lasserait à
les accomplir. «Defensa jubendo est saeva Jovis conjunx; ego sum
indefessus agendo.»*
|
*
Ovide (43-18 av. J;-C.), Métamorphoses, IX, 198-199: la
cruelle épouse de Jupiter [c’est-à-dire Junon, qui poursuivit
d’abord de sa haine Hercule, né d’une maîtresse de son mari]
s’est lassée de m’imposer des tâches que pour
ma part j’accomplissais sans me lasser. (B.G.)
|
La
France a formé son unité malgré les attaques qui venaient
aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. Elle a su résister
à l’Angleterre, à la Maison d’Autriche, à la monarchie
espagnole*. A l’intérieur elle a su
résoudre dans les premiers temps le conflit des rois et des grands
féodaux ainsi que le problème de l’affranchissement des communes,
et elle a pu passer au travers de la lutte effroyable dans laquelle la maison
de France et la maison de Bourgogne coururent leurs chances pendant de longues
années*. Comment ici ne pas admirer devant l’acharnement des Anglais
à rompre l’unité française cet incroyable mouvement
spirituel qui se traduit par l’intervention miraculeuse de Jeanne d’Arc?
L’âme du pays apparaît ici toute entière, c’est un envol
de grandeur et de pureté, qui met sur notre pays un signe unique
à travers les âges.
|
* Lejeune a sans doute
en tête, successivement, la guerre de Cent Ans, la rivalité
de François Ier avec Charles-Quint, puis Philippe V. (B.G.)
|
Presque
aussitôt après c’est la maison de France qui se trouve divisée
entre le père et le fils. La Praguerie oppose Charles VII au futur
Louis XI. Ce ne fut peut-être qu’un tumulte, mais il nous valut les
paroles de Charles VII au fils ingrat qui, sous de fallacieux prétextes,
troublait le royaume, et qui refusait de suivre son père après
l’entente de Cusset. «Allez-vous en Louis, si vous voulez, les portes
sont ouvertes; si elles ne sont assez larges, je ferai abattre dix toises
de murailles; la maison de France n’est pas si dépourvue de princes
qu’elle n’en ait qui maintiennent sa grandeur et son honneur aussi bien
que vous.» Paroles prophétiques, qui peuvent s’appliquer à
tous ceux qui ont cru emporter la France avec eux et qui se sont aperçus
qu’elle ne manquait jamais d’hommes pour la relever et pour la maintenir
à son rang.
|
|
Au XVIe
siècle, dans le grand mouvement de la Renaissance, qui entraîne
tout le pays, on aurait pu croire que les guerres de religion qui dissimulaient
des ambitions politiques effrénées finiraient par disjoindre
notre sol. En vain les partis cherchèrent à s’élever
sur les ruines qu’ils amoncelaient; la verdeur du sang français ne
prit souci des plaies et des blessures et se moquant des abus avec Rabelais,
chantant la gloire avec Ronsard, illustrant la finesse et le bon sens avec
Montaigne, il ne se laissa point corrompre par les turpitudes mais prit
au contraire comme un cours plus vif et plus généreux.
|
|
Le XVIIe
siècle devra connaître encore un essai d’indivision. Essai
passager, bref, qui vaudra du moins à notre littérature les
pages admirables du cardinal de Retz*. Certains mécontents,
parlementaires et grands seigneurs, poussèrent le peuple à
se révolter. Pendant quelque temps «la Fronde» fera fermenter
les esprits. Mais il semble que ce soit là comme les derniers sursauts
de colère qui agitent les flots avant que la mer n’étale paisiblement
ses ondes sous un ciel haut et serein. Pendant cinquante ans, le gouvernement
royal de Louis XIV donnera à l’unité française sa parfaite
expression. Rien ne lui manquera pour l’assurer, ni la sagesse des grands
administrateurs comme Colbert, ni le génie des prosateurs comme Pascal
et La Bruyère, ni la force éclatante ou l’incomparable harmonie
des poètes comme Corneille et Racine. Un siècle où
la sévérité des colonnades, des portiques, et des escaliers
de parade s’accommode du rire de Molière, où la gravité
qu’un Poussin met dans ses paysages s’accorde mystérieusement avec
l’ironie souriante et naïve que La Fontaine fait passer dans les siens.
Unité française où, dans un décor de discipline
et d’ordre, jouent la grâce et la légèreté, unité
qui mérite d’être exprimée par ce tableau de Gérard
de Nerval, où peignant le charme des rondes enfantines devant un
château plein de noblesse, le poète module cette phrase si
purement musicale: «Des jeunes filles dansaient sur la pelouse
en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d’un français
si naturellement pur que l’on se sentait bien vivre dans ce pays de Valois,
où pendant plus de mille ans a battu le cœur de la France.»*
|
* Jean-François
Paul de Gondi, cardinal de Retz (1613-1679), homme d’État et mémorialiste
français.
* Gérard de Nerval (1808-1855).
Ce passage est extrait du chapitre 2 de Syvie, l’une des nouvelle
les plus célèbre du recueil Les Filles du feu (1854).
|
Le XVIIIe
siècle, vers la fin fera battre ce cœur avec une violence telle que
certains croiront qu’il va se briser. Peut-être dans les poitrines
des corybantes le cœur devait-il battre aussi fort. Le vin des idées
nouvelles agita toute la nation: ce fut comme un enivrement, qui la jeta
hors d’elle-même; mais plutôt que d’y perdre son unité,
d’y voir s’abîmer tout d’un coup l’effort constant des siècles,
la France rassembla tous ses enfants sous un nouveau drapeau, qui, suivant
la parole de La Fayette, devait faire le tour du monde.
|
|
Peut-être
la suite des régimes qui se succédèrent au cours du
XIXe siècle ferait-elle penser que l’unité française
en sortit ébranlée. Cependant, ni les révolutions, ni
les désastres n’y portèrent une atteinte mortelle. Sans doute
apercevrons-nous une légère désagrégation des
volontés, qui plutôt que de se rattacher à une seule
idée crurent se conformer à leur idéal d’indépendance
en s’empressant dans toutes les directions et en donnant l’exemple d’une
dispersion, qui aurait pu être néfaste, mais malgré toutes
les attaques du dedans comme du dehors l’œuvre demeura solide.
|
|
Aujourd’hui
quelle est la situation? Grave assurément. Au point de vue physique,
nous sommes en face d’une sorte de morcellement. Au point de vue moral, nous
assistons à une confusion de pensées et de sentiments, qui
ne sont point propices à l’unité d’action si nécessaire
pour un pays.
|
|
Que faut-il
faire?
|
|
Il faut
se tourner vers le devoir. Or, le devoir est d’accepter les directives qui
nous sont données par le chef de l’État. Ce n’est pas l’esprit
de critique négatif qu’il faut développer en nous, c’est celui
de capacité constructive. Faisons appel à notre intelligence
pour créer et non pour dissoudre. C’est par des actes d’adhésion
que nous devons témoigner de notre énergie, non point pas
[sic] des actes de séparation. Longtemps ce fut chez nous une habitude
de quitter une formation pour en créer une autre. Toute formation
était atteinte à sa naissance de scissiparité*. Il n’y avait de collaborations que conditionnelles.
Et la première condition sous-entendue était qu’elles fussent
éphémères. Notre devoir est de créer entre nous
une collaboration durable. Ce n’est pas aliéner sa liberté
que de se bâtir une maison; aujourd’hui nous devons reconstruire ou
tout au moins consolider le bel édifice qui fut un des chefs-d’œuvre
de l’Europe: l’unité française.
P. Lejeune.
|
*
Scissiparité: mode de reproduction asexuée par division en
deux parties d’un organisme.
|
|
L’ÉQUILIBRE VITAL
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 41, samedi 7 décembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Le
gouvernement prend des mesures pour que les jeunes gens reviennent à
la terre, et qu’ils apprennent à nouveau le noble métier d’agriculteur.
Tout le monde avait constaté le développement inouï des
grandes villes et par contre le dépeuplement accentué des
campagnes. Les villages se vidaient de leurs habitants, les maisons n’abritaient
plus personne; dans certaines contrées on n’y rencontrait plus que
des vieillards. Des bourgs jadis prospères, où les artisans
trouvaient un exercice facile de leur profession, où l’on entendait
le bruit des enclumes et des marteaux, le meuglement des vaches qui rentraient
à l’étable, le hennissement des chevaux qui traînaient
des charrues, des bourgs animés et joyeux étaient maintenant
tristes et muets, attendant pour reprendre un soupçon de vie une
fête patronale éphémère.
|
|
Virgile
s’était-il donc trompé quand il avait prononcé son
éloquente interjection:
«O fortunatos
nimium si sua bona norint / agricolas?»*
Est-ce qu’en réalité le bonheur n’était
point le lot des agriculteurs et rien n’était-il plus pénible
que de cultiver la terre? Il semble tout à la fois que le poète
latin ait peut-être un peu trop embelli la vie rustique et que, d’autre
part, l’attraction des villes ait fait perdre à ceux qui demeuraient
au milieu des champs et des bois la vue des satisfactions qu’ils y goûtaient.
|
*
Oh trop heureux paysans, s’ils connaissaient leur bonheur!.
Vers célèbres, alors connus de tous les collégiens
latinistes, tirés des Géorgiques (II, 458-459), poème
en quatre chants composé entre 36 et 29 avant J.-C. Il faut rappeler
que Virgile était lui-même déjà le chantre officiel
d’une politique de retour à la terre et aux valeurs traditionnelles
initiée par l’empereur Auguste. (B.G.)
|
La
ville avait pour elle tout ce qui séduit et trouble les hommes: le
bruit, la lumière, le nombre. Le bruit attire toujours, quel qu’il
soit; il est le premier élément de distraction; des enfants
qui ne savent quoi faire trouvent un premier amusement à crier à
tue-tête, à claquer des mains et à frapper des pieds.
Au 14 juillet des jeunes gens achètent des amorces et des pétards,
et l’on aime autant dans les feux d’artifice l’éclatement des boules
inoffensives que la couleur des fusées. La lumière n’attire
pas moins, nous sommes tous plus ou moins comme des phalènes, tout
foyer lumineux est une cause d’attraction, nous nous y jetons, dussions-nous
y brûler nos ailes. Dans ces dernières années les boutiquiers
se faisaient concurrence non plus en abaissant leurs prix, mais en augmentant
l’intensité de leur éclairage. Le nombre n’exerce pas une
puissance moins grande sur l’esprit des hommes. Non seulement la bousculade
ne fait pas peur, mais on s’y mêle volontiers; on éprouve le
besoin de participer à un grouillement d’êtres, qui cessent
pour un moment d’avoir une conscience individuelle pour prendre un sentiment
collectif. Aux veilles de fête dans les grands magasins, nul n’est
arrêté par la crainte d’être comprimé, et de subir
des mouvements de roulis qui tour à tour éloignent et rapprochent
du point qu’on veut atteindre; tout au contraire les gens arrivent de toutes
parts, heureux d’être absorbés par le flot de lave qui se déplace
imperceptiblement.
|
|
La campagne
ne présente que le calme et la solitude. Elle n’est pas bruyante,
de temps à autre seulement on entend le bêlement des moutons,
le cahotement d’une faucheuse sur la route, la voix claire d’un coq dans une
cour de ferme. Il faut attendre que la nuit soit vraiment tombée pour
que s’allume ici et là quelque modeste lumière. Point de foule.
Il n’y a de pressés les uns contre les autres que les blés,
les avoines ou les orges.
|
|
Jadis
les communications étaient rares entre la ville et la campagne. L’opposition
entre les deux tableaux ne s’offrait que rarement aux yeux des paysans et
des villageois. Beaucoup d’hommes et de femmes quittaient la vie sans avoir
vu d’autre clocher que celui de leur petite église. Avec le XIXe siècle
tout changea; le chemin de fer fit abandonner la diligence; en quelques heures
on put parcourir un trajet qui demandait autrefois une journée ou
davantage; les usines qu’on construisait un peu partout établirent
des rapports réguliers entre les grands centres et les provinces éloignées,
il y eut une sorte de drainage qui s’accomplit d’abord avec lenteur, et qui
bientôt s’accéléra de telle sorte qu’on fut surpris qu’autant
de jeunes gens quittassent les champs pour aller chercher une place, une
situation, un emploi à Paris, à Bordeaux, à Lille, à
Marseille. L’automobile en facilitant encore plus les déplacements
fit sentir d’une manière plus vive entre la campagne et la ville,
et la tentation devenant plus fréquente, nous assistâmes à
un véritable exode rural.
|
|
Sans doute la
vie d’usine et de bureau n’offrait-elle point que des avantages. Mais il
faut reconnaître qu’on faisait l’impossible pour la rendre agréable.
De tout temps on a plutôt favorisé les gens des villes que ceux
des campagnes. Le pouvoir craint le mouvement des foules, et dans une ville,
il est aisé de grouper des hommes, de les exciter, de monter leur
esprit et de les faire sortir de leurs maisons. Dans les campagnes il n’en
va pas de même. Il faut aller de village en village, se transporter
dans des lieux fort éloignés les uns des autres, convaincre
des esprits, généralement ennemis de tout désordre,
et vaincre l’attachement à l’habitude.
|
|
Aussi
l’émeute, l’insurrection, la révolte sont-ils presque toujours
nés dans les villes, ou l’air lui-même et la vie qu’on y mène
sont peu favorable au sain équilibre des nerfs. C’est pour éviter
ce désordre que les gouvernements accordent généralement
à ceux qui les habitent un traitement préférentiel.
Rome se défendait contre les mécontents en leur donnant du pain
et des jeux «panem et circenses». C’était là
une expression imagée, qui sous-entendait toutes sortes d’avantages.
Les grandes villes l’ont imitée. Sans doute le temps a-t-il apporté
des transformations, on ne va plus au Cirque assister au combat de bêtes
fauves, à des luttes entre gladiateurs et rétiaires, à
des courses de chars, mais on va au cinéma pour suivre les péripéties
d’un drame policier, dans une salle de sport pour voir sur un ring les évolutions
de deux boxeurs, dans un vélodrome pour applaudir l’audace des motocyclistes
sur une piste. Le plaisir qu’on a voulu susciter est toujours le même.
Il convient avant tout de distraire les masses. Une ville ne s’ingénie
qu’à multiplier les distractions pour ses habitants.
|
|
Les hommes
se sont toujours laissé tenter. Il est rare qu’ils aient jamais aperçu
derrière le plaisir factice du moment l’ombre douloureuse du lendemain.
Tout ce mouvement vers les villes a causé les perturbations dont nous
souffrons aujourd’hui. Qu’on le veuille ou non, c’est une chose sérieuse
que la vie. Elle exige tôt ou tard qu’on s’impose des disciplines,
si l’on veut qu’elle soit saine et digne.
|
|
La campagne
pendant des siècles fut la grande régulatrice de la vie sociale.
Elle dominait le pays, lui gardait sa grandeur et sa sévérité.
Dans presque toutes les classes de la société, il y avait
un rattachement direct au sol. La plupart des gens ne la quittaient quelque
temps que pour y revenir un jour. Dans ses mœurs plus simples, dans son travail
obscur et patient, les familles ne cessaient de refaire leurs forces et
leurs énergies. C’était le réservoir naturel où
la France trouvait toujours les hommes nécessaires à ses entreprises.
Les grandes villes n’entrainaient pas vers elles le corps tout entier de
la nation, la campagne aimée et respectée maintenait pour lui
l’équilibre vital.
|
|
L’œuvre
de demain, celle où sont déjà venus se ranger les «ateliers
de la jeunesse», sera de restaurer complètement cet équilibre
et de le mettre à l’abri des instabilités qui faillirent le
compromettre pour toujours. Dans l’atmosphère des villes surpeuplées,
les français s’affaiblirent et s’usèrent; ils y perdirent
leur virilité; au milieu des labours et des semailles, parmi le blé
qui lève, dans la lumière chaude des moissons, avec les soleils
d’automne sur les pampres rougis, dans ces retours des saisons qui donnent
au travail de la terre une heureuse variation qui fortifie et vivifie l’être
tout entier, les jeunes français reconquerront leur patience, leur
courage et leur foi, ces trois vertus que tout paysan porte en lui et qu’il
a puisées dans la terre elle-même, éternellement généreuse
et féconde.
P. Lejeune.
|
*
Les Ateliers de la jeunesse paraissent une institution préexistante
au régime de Vichy puisqu’on en parle dès l’époque
du Front populaire (B.G.)
|
|
|
AVEC UN
CHEF
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 42, samedi 14 décembre 1940
|
On ne
prolonge pas indéfiniment le désordre et le chaos. Un jour vient
où les hommes d’une société sentent qu’il est nécessaire
de rétablir une hiérarchie et d’imposer entre eux les bienséances
et le respect. Pour construire un édifice toutes les pierres ne peuvent
pas être jetées pêle-mêle, il faut qu’elles soient
placées dans un ordre rigoureux, chacune à leur place, et que
les unes soient en bas et les autres en haut. Toutes concourent à
la même tâche, mais elles ne le peuvent faire au même endroit.
Il y a un soubassement comme il y a un couronnement de l’édifice.
Dans une société il est est tout de même, et quand sous
des prétextes divers on ne veut plus admettre cette vérité
élémentaire que tous les hommes ne peuvent être sur
le même plan, on tombe dans la pire des calamités: l’anarchie.
|
|
Depuis
quelques années nous en prenions le chemin. Toute autorité se
voyait compromise; obéir et commander étaient deux mots en
passe de ne plus être français. On s’ingéniait à
persuader les gens qu’il y avait dans l’obéissance un abaissement,
une dégradation pour l’homme. Certaines gens auraient cru qu’ils abdiquaient
leur dignité de citoyen s’ils avaient enlevé leur casquette
ou leur chapeau à une personne plus âgée qu’eux, ou qui
par son poste, sa situation ou son emploi méritait quelques égards.
L’impolitesse était une marque d’indépendance. Des esprits mal
formés prenaient pour un défi courageux ce qui n’était
qu’une absence d’éducation. Des journaux n’étaient point fâchés
que des écoliers fissent pleuvoir des pierres sur un buste de La Fontaine,
parce qu’on les obligeait à apprendre des fables; ils témoignaient
ainsi, disaient-ils, de la verdeur de leurs sentiments et de leur résistance
à se laisser passer un joug*.
|
*
Je n’ai rien trouvé sur ce fait divers. On notera que plus récemment
c’est un président de la République qui s’en est pris à
Mme de La Fayette (B.G.)
|
C’était
comme un prurit d’irrespect. On ne pouvait supporter aucune préséance,
pas plus celle de l’intelligence et de la valeur, que celle du dévouement
ou du travail. Tout le monde devait être jeté dans le même
sac, pêle-mêle, à la façon de ces objets hétéroclites
que ramasse au petit jour l’humble crochet des chiffonniers. Que serait-on
devenu si l’on avait permis à un homme de développer sa personnalité,
de faire valoir ses qualités supérieures et d’assurer son
pouvoir? Tout le régime aurait risqué d’en être compromis.
Un chef aurait pu surgir, un chef qui aurait donné des directives,
des instructions et des ordres, réprimé les insubordinations
aussi bien que les abus, corrigé les négligences, exigé
l’effort et qui n’aurait point subi les influences secrètes et puissantes
des organisations, qui sous des prétextes politiques, ne poursuivaient
que des fins égoïstes et personnelles.
|
|
On voulait
créer une sorte de collectivité grouillante, amorphe, assez
semblable à un amas de larves qui se déplacerait d’un mouvement
inconscient suivant un jeu de volontés onduleuses et fluentes. Pas
de chef qui conduise, qui montre la voie, qui anime et entraîne. Pour
dissimuler l’ombre du pouvoir, dont quelque personne pouvait être
investie, on lui donnait sournoisement un titre bénin, incolore,
une appellation plutôt qu’un titre: représentant, délégué,
secrétaire.
|
|
Prendre
l’allure d’un chef effrayait ces âmes pusillanimes, qui n’osaient
donner des ordres qu’à la condition d’en avoir obtenu l’autorisation.
Ils allaient quêter leur pouvoir, ou plutôt leur mandat, car
ils voulaient laisser entendre qu’ils demeuraient dans une dépendance
parfaite à l’égard de ceux qu’ils allaient conduire*. Tout l’art de ces soi-disant conducteurs consistait
à suivre les mouvements de leurs troupes et à se mettre en
posture de ne les jamais contrarier. S’ils orientaient un peu leur marche
c’était sournoisement, d’une manière toute cachée,
sans qu’on puisse deviner la légère pression qu’ils opéraient.
Chaque fois il fallait trouver un nouvel artifice, une piperie inédite;
l’hypocrisie et le mensonge étaient d’un usage si courant et si naturel
qu’on n’en sentait plus l’ignominie.
|
*
Il me semble qu’on a là ici une critique de fond contre la démocratie
en elle-même (B.G.)
|
Comment
les âmes auraient-elles pu garder la moindre élévation
dans un milieu saturé de lâches complaisances et d’insidieuses
faussetés? La franchise passait pour un ridicule, et le caractère
pour une tare. Dans le pays qui vit naître Corneille et Molière,
Rodrigue devenait un imbécile et Alceste un bélitre*. Tout acte généreux qui rompait avec
le concert sournois des intérêts privés était
considéré comme une abusive grossièreté. Aussi
pour permettre toutes les intrigues et toutes les combinaisons ne fallait-il
point surtout qu’un chef vint à paraître. Un homme qui saurait
prendre toutes ses responsabilités, qui agirait par lui-même,
qui ne ménagerait aucune coterie, aucune association, aucun assemblage
d’intérêts, qui n’aurait pour souci que le bien public et la
grandeur de l’État, un tel homme, qui serait un chef, qui en aurait
l’âme et le caractère, détruirait d’un seul coup toutes
les forces occultes qui opprimaient le pays, et qui épuisaient chaque
jour sa substance. La venue d’un tel homme était donc pour tous ceux
qui pratiquaient une politique d’appétits malsains et de profits suspects
une sorte de malheur qu’il fallait à tout prix conjurer.
|
* Don Rodrigue, héros
du Cid, tragédie de Pierre Corneille (1637), Alceste, héros
du Misanthrope, comédie de Molière (1666).
|
Les événements
sont plus forts que les combinaisons. Après nos revers la France
comprit qu’il n’était possible que de se relever avec un chef. Comme
suite à une sorte de tradition qui veut que dans nos désastres
mêmes le pays échappe à la ruine totale, il s’est trouvé
que, dans une époque où il semblait impossible qu’un homme
ait gardé les qualités d’un chef, il était pourtant
demeuré chez nous quelqu’un qui avait préservé de la
sanie partout envahissante sa volonté, sa pureté de vue, sa
noblesse de pensée et son inaltérable courage.
|
|
Au
Maréchal Pétain la France a confié son sort*.
Dans de telles conjonctures,
c’est une redoutable tâche que d’accepter d’être le chef de
sa nation. Mais justement, c’est en quoi consiste le signe essentiel de
celui qui sait commander: plus la tâche est haute, plus elle est à
sa taille: non point qu’il ait aucune présomption, mais parce que
plus l’effort est difficile et plus il plaît à sa volonté.
C’est sa valeur qui lui fait accepter tous les risques et non point sa témérité.
Il ne s’engage pas sur un terrain qu’il ignore, mais sur un terrain dont
il connaît tous les détails parce qu’il n’a cessé de
penser qu’un jour il y devrait manœuvrer. Il sait tout à la fois délibérer
et donner des ordres. Nulle flatterie ne l’émeut, mais aussi n’entend-il
flatter et séduire personne. Il a la force d’âme suffisante
pour exiger des sacrifices raisonnables de ceux dont il a la charge, et pour
leur refuser des satisfactions passagères, qui compromettraient les
résultats acquis et ceux qu’il prépare. Il échappe à
toute emprise parce qu’il ne considère point l’instable opinion des
individus entraînés dans le tourbillon des désirs et
des craintes immédiats, mais seulement le jugement calme et réfléchi
de l’impartiale Histoire.
|
*
Lejeune retourne ici la ritournelle alors dans tous les esprits, selon laquelle
le Maréchal a fait don de sa personne à la France (B.G.)
|
Alors
qu’avec une cohue de politiciens qui pâturaient le terrain des places,
des recommandations et des influences, les Français ne savaient où
se diriger, erraient comme un navire sans gouvernail, — un bateau ivre, suivant
l’expression de Rimbaud, — avec un chef ils vont se ressaisir, reprendre
le sens de l’énergie et de la propreté morales, refaire le
pays tout entier.
|
|
Ce n’est
pas un paradoxe de dire que tant qu’il y a un chef, il n’y a rien de perdu.
Le chef, en effet, peut dans les moments les plus critiques prendre des
résolutions qui changent la face des choses, il peut rassembler les
forces éparses, regrouper les unités perdues, et leur redonner
une cohésion qui transforme leur puissance d’action. C’est avec un
chef que les hommes ont toujours accompli de grandes choses: c’est avec
le Maréchal Pétain que les Français sauveront encore
une fois leur Patrie.
P. Lejeune.
|
|
|

L’Exposition publique du cercueil de bronze contenant les restes du Roi
de Rome
dans la chapelle Saint-Louis des Invalides, le 15 décembre 1940
(cliché de L’Illustration n°5102
du 21 décembre 1940)
|
LE RETOUR
DE L’AIGLON
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 43, samedi 21 décembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
|
Sire, on
vous a rendu votre fils bien-aimé*.
Nul ne pouvait penser qu’on aurait ranimé
Votre masque éclatant de gloire et de génie*,
Où la mort avait mis sa divine harmonie.
|
5
|
Il semblait
désormais que pour l’éternité
Vous garderiez ce front d’ordre et d’autorité,
Qui pouvait, sans que nul ici-bas vous seconde,
Sans peine et sans effort embrasser tout un monde.
Loin du rocher cruel qui vous retint captif*,
|
10
|
Nul ne
devait troubler votre sommeil pensif.
Reposant pour toujours au fond de votre crypte
Parmi vos souvenirs d’Italie et d’Egypte*,
Vous suiviez seulement, dans la neige* ou l’azur,
De vos aigles partout le vol puissant et sûr,
|
15
|
Qui sur
les monts glacés ou les déserts de sable
Promenaient largement leur gloire ineffaçable.
Pour votre Majesté tout était révolu,
Vous dormiez dans le lieu que vous aviez élu,
Et rien ne pouvait plus sous le bloc de porphyre
|
20
|
Émouvoir
un moment votre pâleur de cire.
Quel que fût près de vous l’illustre visiteur,
Qu’il fût poète ou roi, savant, prince,
empereur,
Que l’on multipliât l’honneur ou la louange,
Pour mieux manifester votre destin étrange,
|
25
|
Depuis
cent ans* ici tout venait se heurter
Au sommeil immortel de votre Majesté,
Pourtant quand les années ont accompli ce nombre,
Vos cendres tout à coup ont tressailli dans l’ombre.
Un rêve du passé plus vif, plus évident,
|
30
|
Soulevait-il
en vous votre cœur haletant?
Vous croyiez-vous encor sur les champs de bataille,
Dirigeant vos soldats, et parmi la mitraille
Sous un soleil ardent, ou sous un ciel brumeux,
Au milieu des canons, des cavaliers poudreux,
|
35
|
Jetant négligemment
d’un grand geste de gloire
Une page nouvelle au livre de l’Histoire?
Toute votre jeunesse en un élan hardi
Paraissait-elle à vous sur le pont de Lodi?*
Était-ce, sous la voûte immense des épées,
|
40
|
Des lances, des drapeaux,
le vent des épopées?
Ou bien à Notre-Dame un cortège éclatant
Saluait-il en vous l’Empereur d’Occident?*
Refaisiez-vous encor vos entrées triomphales,
Au hasard des combats, dans tant de capitales?
|
45
|
Entendiez-vous enfin
cette immense clameur
De vos vieux grenadiers saluant «l’Empereur!»?
Non Sire, vous n’aviez ni grandeur ni superbe;
Comme le paysan qu’on a couché sous l’herbe,
Hors des cris, du tumulte, et des sourds grondements,
|
50
|
Vous reposiez parmi
la paix des ossements.
Ce qui vous réveilla dans la nuit sépulcrale
Ce ne fut pas un bruit de canon ni de balle,
Un cliquetis de sabre, un assaut d’escadrons,
Un fracas d’étriers, de sabots, d’éperons,
|
55
|
Tout un galop épars
de vaste chevauchée
Emportant dans ses rangs la victoire arrachée,
Ce ne fut pas l’écho d’Arcole* ou d’Austerlitz*,
Ce fut dans cette nuit simplement: votre fils.
Un siècle avait passé. Dans votre longue
attente
|
60
|
Celui, dont le portrait
si souvent sous la tente
Avait illuminé vos yeux désenchantés,
Venait après cent ans se mettre à vos
côtés.
Le Duc en habit blanc, ou celui que l’on nomme
Encore parmi nous le petit roi de Rome*,
|
65
|
Près de votre
tombeau venait se consoler
D’avoir pu dans la mort même être un
exilé*.
Et vous, Sire, éperdu d’amour et de tendresse,
Sur vos lèvres brisant le sceau dur qui les
presse,
Vous n’avez, les deux mains sur votre cœur tremblant,
|
70
|
Répété
que ces mots: «Mon enfant, Mon enfant.»
|
|
Vers 1: Le 15 décembre
1940, les cendres de l’Aiglon, alias Napoléon II, jusqu’alors conservées
en Autriche, furent transférées solennellement au Panthéon.
Ce geste politique d’Hitler en direction de Pétain, qui le remercia,
eut des conséquences compliquées à Vichy, dont découla
l’éviction provisoire de Laval.
Vers 3: Philippe Legendre, fils de l’auteur, m’a confirmé
le 22 août 2012 que son père était un admirateur décidé
de Napoléon Bonaparte, qui lui inspira après guerre le texte
d’une pièce de théâtre restée inédite..
Vers 9. L’île de Saint-Hélène.
Vers 12. la campagne d’Italie eut lieu en 1796-1797, et celle
d’Égypte de 1798 à 1801.
Vers 13. Allusion à la campagne de Russie en
1812.
Vers 25. Le transfert des cendres de Napoléon
de saint-Hélène au Panthéon avait eu lieu le 15 décembre
1841.
Vers 38. La victoire de Napoléon au pont de
Lodi le 10 mai 1796 conclut glorieusement la deuxième partie de la
campagne d’Italie.
Vers 41-42. Allusion au sacre de Napoléon à
Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804.
Vers 57. La victoire du pont d’Arcole a eu lieu
le 17 novembre 1796 lors de la première campagne d’Italie. Celle
d’Austerlitz en Tchéquie le 2 décembre 1805.
Vers 63-64. Le titre de roi de Rome, prévu par
la constitution impériale de 1804, fut attribué dès
sa naissance en 1811 à Napoléon II (qui fut par ailleurs officiellement
empereur à deux reprises lors après les deux abdications de
son père, soit du 4 au 6 avril 1814 et du 22 juin au 7 juillet 1815).
Vers 66. Prince français en exil à la
cour d’Autriche (1815-1832), il avait été enseveli à
Vienne dans la crypte des Capucins.
|
P. Lejeune.
|
|
|
AU TEMPS DES RONDES
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 44, samedi 28 décembre 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
Noël!
Noël! Au gui l’an neuf! Vieux cris qui sont venus jusqu’à
nous au travers des siècles, et qui malgré que nous n’en fassions
plus usage, conservent une saveur agreste et rustique, qui s’accorde avec
l’odeur résineuse des pins et la senteur fumeuse des bûches;
c’est ainsi qu’autrefois le gentil peuple de France chantait ses joies et
clamait ses espérances. Peuple léger peut-être, insouciant
sans doute, mais qui jusqu’en sa détresse et ses douleurs gardait
une foi naïve dans la Providence, et trouvait dans sa mémoire
quelque vieil air pour tromper ses ennuis et mettre à travers ses
pleurs la grâce d’un sourire.
|
|
Tout n’a
pas été pour le mieux dans notre pays, et quand on relit l’Histoire
on s’étonne presque d’y trouver tant de pages tristes, amères,
voire même sanglantes, tant de colères et tant de passion.
Pourtant, même aux plus sombres jours il y eut quelque part en notre
pays des gens qui conservèrent un aloi de gaieté franche et
sincère, qui redonnait aux cœurs du courage, et qui les empêchait
de tomber dans un désespoir farouche et brutal.
|
|
Nos gens
de métier et nos paysans n’oubliaient pas au milieu des misères
du temps qu’il faut encore garder un peu de bonne humeur, et que, tels les
pommiers qui dans un mois d’avril grincheux et bourru ont des fleurs sur
leurs branches, on peut encore avoir une chanson aux lèvres quand les
événements sont pénibles et durs. Dans nos vieilles
villes et dans nos villages le caractère des maisons, des cours et
des boutiques avait toujours quelque chose de plaisant et d’ouvert, et les
enseignes qui se balançaient au vent invitaient les chalands d’une
si aimable manière qu’ils ne manquaient point de s’y arrêter.
Les foires étaient pour les contrées et pour les provinces des
occasions de se rencontrer, de revoir ses amis, de «humer le piot»* parmi les bruits pacifiques des bêtes qui
venaient des fermes, veaux, vaches, cochons, chevaux, bœufs, dindons, oies
et canards, les uns meuglant, les autres hennissant, ceux-ci glougloussant,
et ceux-là couincouinant, tandis qu’un maître Aliboron** ne manquait point à
certains intervalles de ponctuer le vacarme par un braiement autoritaire
et sonore. — «Ce jour-là,
dit le vieux chroniqueur, parlant d’une foire en notre pays, il y avait grand’foison
de marchands étrangers en cette ville; et vous savez que marchands
quand ils se trouvent ensemble et ils se sont vus de grand temps, boivent
par usage largement et longuement pour entre eux faire bonne compagnie.»***
Faire bonne compagnie!
N’est-ce pas quelque chose qui soit plein d’évocations et d’invitations
que ce simple rappel des us et coutumes du peuple français. On ne
se réunissait pas pour échanger des plaintes, s’envenimer
le cœur de dires et de propos quinteux, de récriminations coriaces,
de maléfiques déclarations, on entendait s’esjouir et s’esbaudir
aux récits, contes, petites histoires et joyeusetés qui délassaient
l’esprit, et en déliaient les fils, comme on dénoue les cordons
de la bourse au jour des cadeaux.
|
* Humer le piot:
boire du vin (B.G.)
** Maître Aliboron: ces
mots désignaient au moyen âge une personne aussi savante que
l’arabe Al Birouni, contemporain d’Avicenne, mais depuis que La Fontaine
l’a appliqué ironiquement à un baudet dans sa fable Les
voleurs et l’âne, il désigne plaisamment ce dernier dans
l’usage courant. (B.G.)
*** Voici le texte exact
de Jean Froissard (v.1337-après 1404) ): Avint que ce jour de la
mie-août, il y avait grand’ foison de marchands étrangers de
Foix, de Bern ( Bearn ), de France en cette ville; et vous savez que marchands
quand ils se trouvent ensemble et ils ne se sont vus de grand temps, boivent
par usage largement et longuement pour entre eux faire compagnie (éd.
Yanovski, Paris, Firmin-Didot, 1865, p. 397).
|
Nul
ne s’entendait mieux à ces façons de bonne humeur que les
joyeux garçons qui s’exerçaient aux discours et vers latins
sur la Montagne Sainte-Geneviève, et qui pendant plusieurs années
s’entraînaient à pénétrer les secrets des sept
arts, d’abord ceux du trivium qui comprenaient la grammaire,
la rhétorique, la dialectique, puis ceux du quadrivium qui
comprenaient l’arithmétique, la géométrie, la musique,
l’astronomie*. C’était là les
meilleures années de leur vie, celles qui fourniraient matière
à toutes sortes de contes et anecdotes, dont plus tard, retirés
dans quelque bonne ville provinciale, ils réjouiraient leurs auditeurs
à la veillée. Nantis de connaissances, sachant «trive
et cadrive» ils s’en allaient à travers la France et l’Europe
répandre les doctes leçons qu’ils avaient apprises en ce quartier
de Paris, qui depuis des siècles est devenu fidèle à
sa destination de petite cité enseignante. Ils n’en perdaient jamais
la mémoire, et si d’aventure ils se rencontraient plus tard à
Vienne, à Rome ou à Jérusalem, ils se disaient l’un
à l’autre, en se remémorant le temps délectable de
leur jeunesse, «nos fuimus simul in Garlandia» «nous
avons été ensemble en Garlandie». Ils avaient en commun
goûté le plaisir d’apprendre au pays de Garlande, dont le nom
devenu Galande se lit encore aujourd’hui au coin d’une petite rue,
près des bords de la Seine.
|
*
Lejeune retrace ici ce qu’était la vie des étudiants européen
au Quartier Latin durant le moyen âge classique. On remarquera que
la distinction entre le trivium et le quadrivium a été
élaborée au tout premier commencement du moyen âge par
le même Boèce auquel il a fait une allusion élogieuse
dans son éditorial du 16 novembre (B.G.)
|
C’étaient
eux avec nos marchands qui ne craignaient point de passer monts et rivières,
qui faisaient connaître ce langage françois, que par
tout le monde on aimait à entendre parler, pour ce qu’on lui trouvait
de gentillesse, de grâce, de douceur melliflue*, de saveur piquante aussi, car tout se prête
en ce beau langage aux nuances et variétés et il semblait
qu’il fût fait pour venir naturellement succéder à celui
des grecs et des romains.
|
*
Doux comme le miel
(B.G.)
|
En
ce temps les gens de France n’étaient point parfaits, et ils appartenaient
bien à cette nature humaine, à qui ce serait perdue que de
demander qu’elle s’amendât si bien que comme une terre, retournée,
soignée et engraissée, elle ne produisît que de bons
fruits. A toutes les époques les vices et les vertus se mêlent
et s’entrecroisent à la manière de la trame et de la chaîne,
faisant pourtant un tissu différent, suivant l’art de celui qui tisse
l’étoffe. Et il semblait alors que le tisserand eût donné
aux français quelque tour particulier, qu’on ne voyait point aux autres.
C’était parmi tous leurs travers en certain air d’amabilité
qu’il suffisait de quelques paroles bien dites pour faire immédiatement
apparaître, comme il suffit d’une faible lumière pour faire
chatoyer la gorge de certains pigeons. Leur dureté n’était
que superficielle, ils n’avaient une méchanceté persévérante,
opiniâtre, que rien ne peut amollir, ils se laissaient toucher par
la misère, émouvoir par la peine, et quand ils avaient fait
quelques mauvais tours, voire quelques mauvaises actions, ils en témoignaient
affliction et repentir, comme notre François Villon*, qui ne
fut certes pas le meilleur garçon du monde, mais dont le cœur ne cessa
d’être pitoyable**. Ne le fallait-il
point pour qu’il s’attendrît comme il a fait sur le temps de sa jeunesse:
Mais quoi? je fuyois l’escolle,
Comme fais le mauvais enfant.
En excripvant cette parole.
A peu que cueur ne me fent.
Ne montrait-il point des sentiments d’une
touchante émotion dans sa ballade des pendus:
Frères humains,
qui après nous vivez,
N’aiez les cueurs contre nous endurcis.
|
*
François Villon (1431-après 1463) (B.G.)
* Épouvant de la
piété, autant qu’en inspirant (B.G.)
|
Et cette
autre ballade des dames du temps jadis n’est-elle pas pleine de mélancolie?
Depuis des siècles on l’a répétée et chacun
s’est redit à certaines heures ce vers qui exprime si bien le peu
qui reste des choses et des hommes:
Mais où sont les
neiges d’antan?
|
|
Il se
faut garder d’oublier encore cette attitude de chevalerie qui rassurait
toujours dans la plupart des divisions politiques et des guerres quand on
avait affaire à des Français. La plupart d’entre eux restaient
fidèles à cet idéal de dévouement qui les engageait
à venir au secours de ceux qui souffraient et pleuraient, des femmes
abandonnées et des orphelins sans défense. Au fond de leur
cœur ils combattaient pour le droit sciemment violé; c’était
au service de la cause honorable et juste qu’ils entendaient mettre leur
lance et leur épée.
|
|
Ainsi,
bonne humeur, gaieté, chevalerie s’unissaient-ils pour former un caractère,
qui se retrouve dans nos arts et notre littérature d’autrefois, et
qui leur donne une si franche et vivante couleur. Une sorte de candide jeunesse
présidait au destin de la France. Anacréon disait autrefois:
«les muses ont lié l’amour avec des fleurs»*; il semble que ce fussent des liens aussi charmants
qu’elles aient passé autour du pays de Loire, de Bretagne et de Provence.
|
*
Anacréon (550-v. 464 av. J.-C.), poète lyrique grec, poème
XXX (B.G.).
|
Comme
l’image même de cette ceinture avenante dont la France aimait entourer
ses trésors multiples et variés, les enfants et les jeunes
filles dans les villes, bourgs et villages, à toute heure, en toute
saison, faisaient sur les pavés du roi, sur les chaussées fleuries,
et sur les petites places ornées de fontaine d’eau fraîche,
des rondes chantantes qui menaient à travers l’année leur bruit
de tendre et enjouée vaillantise*.
|
*
On corrige ici une coquille (enjouées); vaillantise
est une forme archaïque et poétique de vaillance (B.G.).
|
Des airs
simples, éclos sur les lèvres enfantines comme des pâquerettes
sur une pelouse d’avril, répondaient aux grelots des postillons* qui passaient
avec un grand bruit sur la route. Les joies de l’enfance enchantaient les
soucis et les peines de leur douce et incomparable magie. Se tenant par la
main, laissant leur petit cercle tantôt s’étendre et tantôt
se rapprocher, au gré de leur improvisation ingénue, leurs
lèvres dessinant à peine la pure inflexion des mots, leurs
regards clairs comme des sources, les petites filles de France chantaient
dans toutes nos provinces, de l’Ile-de-France à la Guyenne, de la
Normandie à la Bourgogne.
|
*
Les voitures qui portaient les courriers et transportaient les voyageurs
étaient autrefois équipées de grelot qui annonçaient
leur arrivée (B.G.).
|
La plupart
de ces rondes ce sont perdues. Elles sont parties avec ces dames du temps
jadis, et nous n’avons guère plus de chance de les retrouver jamais.
Quelques-unes portant sont venues jusqu’à nous, mais elles sont moins
anciennes, et ne remontent pas si loin dans notre histoire. Qu’elles ont
de charme encore, et comme on voudrait entendre tout à coup sur la
petite place d’un village, entre deux vieilles maisons, des enfants qui chanteraient
en dansant en rond:
Nous n’irons plus au bois,
Les lauriers sont coupés,
et plus loin dans un bourg:
Au jardin de mon père,
vole, mon cœur vole,
enfin dans la petite ville
d’autrefois:
La tour prends garde, de
te laisser abattre.
S’il était possible
de faire un voyage au pays des rondes, qui de nous ne voudrait se mettre
en route pour rafraîchir son âme et son cœur aux grâces
et naïvetés, qui jadis, comme les pommiers fleuris et les chasselas
dorés, étaient si naturelles au doux pays de France?
P. Lejeune.
|
|
|
ANNEXE
Notice sur le nouveau maire et son équipe
(Abeille d’Étampes du 31 août 1940)
 Lejeune, Chavigny, Fontant, Lerebour
et Audemard (cliché publié par René Collard)
Lejeune, Chavigny, Fontant, Lerebour
et Audemard (cliché publié par René Collard)
| A LA MAIRIE D’ÉTAMPES
|
L’Abeille d’Étampes,
128e année, n° 27, samedi 31 août 1940 (saisie de Bernard Métivier)
|
M. Billecard,
Préfet de Seine-et-Oise, s’est rendu le 22 août à Étampes,
accompagné de M. Junot, chef-adjoint de cabinet. En raison de la situation
nouvelle créée par les événements, le Préfet
a reçu la démission de M. Liger et des membres du conseil municipal.
Après avoir vivement félicité le Maire et ses collaborateurs
d’avoir accepté de prendre en des circonstances difficiles la direction
de la ville, le Préfet les a remerciés de leur décision
de démission prise dans l’intérêt général.
M. Pierre Lejeune, qui a assuré ses fonctions
d’administrateur provisoire de la ville dans des moments tragiques a été
aussitôt désigné par le Préfet pour prendre le
poste de Président de la Délégation Spéciale
Municipale.
|
|
M.
Lejeune sera assisté dans sa lourde tâche par MM. Ulysse Pillas,
Charles Chavigny, Pierre Fontant, Alfred Lerebour et Pierre Audemard (1).
Après une prise de contact entre les membres
de la municipalité démissionnaire et M. Lejeune, qui s’est
effectuée en présence de M. le Préfet, et dans un esprit
de concorde indispensable aux heures graves que nous vivons, celui-ci a félicité
M. Lejeune pour la compétence et le dévouement dont il a fait
preuve pour l’administration de la ville.
Le Préfet a ensuite visité les services
municipaux.
|
(1) Ces nominations ont
fait l’objet d’un arrêté pris par M. le Préfet de S.-et-O.,
le 28 août dernier (Note de l’Abeille). [Cet arrêté
a étét transcrit dans le registre des délibérations
municipales que nous avons mis en ligne, ici.]
|
|
M. Pierre Lejeune
Peut-être est-il utile, à cette occasion,
de faire mieux connaître le Président de la Délégation
Spéciale Municipale à nos concitoyens, encore que pas mal
d’entre eux aient eu maintes raisons de l’approcher depuis sa désignation
comme Commissaire-Maire et qu’un certain nombre aient eu le plaisir d’avoir
affaire à lui depuis sept ans qu’il est installé à Étampes.
M. Lejeune est né en 1885. Après de
brillantes études à Paris, il obtint son doctorat en droit
en 1908. Il fit toute la guerre de 1914 à 1919 et, à son retour,
reprit sa place à la distillerie édifiée par son père
à Montrouge.
De 1924 à 1935, il est successivement juge,
puis Président au Tribunal de Commerce de la Seine. Il devient ensuite
professeur au cours de litiges commerciaux de 1931 à 1936 à
la Chambre de Commerce et de 1936 à 1939 au Tribunal de Commerce.
Au cours des années 1936 et 1937, il est désigné
comme Arbitre dans les litiges du travail où il donne la pleine mesure
de son esprit à la fois équitable, ferme et conciliateur.
Enfin, il est Président du conseil d’administration
de la Banque Populaire de la Région Sud.
Outre les qualités de juriste, d’économiste et d’administrateur
que nous lui connaissons, M. Lejeune possède aussi bien des qualités
littéraires de premier ordre.
En dehors des articles que nos lecteurs peuvent apprécier
chaque semaine dans l’Abeille, sous sa signature il en a publié
d’autres dans de nombreux journaux et revues ainsi qu’un roman intitulé
Guite et Alexandre, dans la Revue Belge et chez l’éditeur
Rieder.
Enfin, mentionnons que notre Président de la
Délégation municipale, chevalier de la Légion d’honneur,
est un fervent sportif. Ancien Président du Cercle Athlétique
de Montrouge, il a acheté et aménagé dans cette ville
— dont son père fut maire durant douze années — un stade comportant
un terrain de football, une piste cendrée, des jeux de boules, des
douches, etc.
Voilà qui, nous en sommes convaincus, fera
plaisir à nos sportifs locaux, lesquels vont trouver à la
Mairie un esprit compréhensif et un incomparable animateur.
|

M. Pierre Lejeune
Abeille d’Étampes du 31 août 1940
|
Nos lecteurs
connaissent maintenant leur Administrateur municipal qui, comme on le voit,
à toutes les qualités requises pour mener à bien les
affaires de la ville. Lorsqu’au cours des relations qu’ils auront l’occasion
d’avoir avec lui, ils auront mesuré toute sa droiture, sa courtoisie,
sa bonne humeur, son entendement, sa bonté, ils s’efforceront à
leur tour de mériter sa sympathie qu’il est disposé, nous
le savons, à ne point marchander aux Etampois au milieu desquels
il est venu volontairement se fixer il y a sept ans avec sa charmante femme
et ses trois fils, et auquel il entend consacrer toute son activité
et tout son cœur.
|
|
|
M. Charles Chavigny
Point n’est besoin, n’est-ce pas, de présenter
notre ami Charles Chavigny à nos lecteurs? Ils le connaissent depuis
toujours. On se rappelle son brillant succès aux dernières
élections cantonales. On peut dire qu’il est peut-être l’homme
le plus populaire du canton et cette popularité se suffit à
elle-même.
|
|
|
M. Ulysse Pillas
M. Ulysse Pillas — papa Pillas — comme on l’appelle,
n’est pas moins estimé et connu. Il est depuis longtemps à
la Mairie d’Étampes et les affaires municipales n’ont pas de secret
pour lui. Sous une écorce un peu rude, il cache un esprit subtil et
un excellent cœur qui lui ont valu l’estime générale.
Ulysse Pillas est chevalier de la Légion d’honneur.
Chacun sait qu’en qualité de premier Adjoint au Maire, il demeura
à son poste dans notre ville durant les tragiques journées
de juin dernier.
|
|
|
M. Pierre Fontant
M. Fontant est également depuis trop longtemps
dans notre ville pour qu’il soit besoin de le faire connaître. Directeur
de la fonderie Lory, il a su déployer dans ses fonctions les plus
hautes qualités d’intelligence, d’organisation, de méthode
et d’entr’aide sociale. Il est le fondateur et Président à
étampes, du Groupement patronal aussi bien chargé de la défense
des intérêts ouvriers que ceux des employeurs. Enfin, esprit
lui-même sportif, il n’a cessé de favoriser la pratique du sport
chez ses collaborateurs.
M. Pierre Fontant est chevalier de la Légion
d’honneur et mutilé de la guerre 1914-1918.
|
|
|
M. Alfred Lerebour
M. Lerebour est particulièrement connu des
cultivateurs auprès desquels il exerce ses fonctions de Président
du Crédit Agricole. Il est lui-même d’une vieille famille agricole
infiniment laborieuse et estimée. Ses avis ses conseils, sont frappés
au coin d’une vieille et savante expérience. Nul doute qu’il ne rende
les plus grands services dans ses nouvelles attributions.
|
|
|
M Pierre Audemard
Tout le monde connait Pierre Audemard à Étampes
et nul n’a pu jusqu’ici refuser sa sympathie à ce brave garçon
travailleur, d’esprit jeune, chic type, toujours prêt à rendre
service.
Petit artisan, il symbolise la France laborieuse,
ingénieuse de demain que les pouvoirs publics devront avoir à
tâche d’honorer et d’encourager, si elle veut retrouver son atmosphère
d’indépendance et de prospérité.
En invitant le modeste et jeune artisan qu’est Pierre
Audemard à se joindre à la Délégation Spéciale
municipale, M. Lejeune a fait acte de bon administrateur qui entend ne négliger
aucun concours social et professionnel, sous la seule condition qu’il lui
soit fourni par de généreux et honnêtes citoyens.
|
|
|
|
|
La suite de ces éditoriaux sera mise en ligne dès que possible.
|
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
Pierre LEJEUNE (maire d’Étampes), Divers articles,
in Abeille d’Étampes, 1940.
Bernard MÉTIVIER
& Bernard GINESTE [éd.], «Pierre Lejeune:
Éditoriaux publiés sous l’Occupation allemande. I
(Abeille d’Étampes, 1940)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-20-pierrelejeune1940editoriaux.html, 2012.
Autres
écrits de Pierre-Ulysse Lejeune
Pierre LEJEUNE,
Droits et obligations des directeurs de théâtre envers
les auteurs. Thèse pour le doctorat [in-8°; 142 p.; thèse
soutenue à la faculté de droit de l’Université de Paris],
Paris, Arthur Rousseau, 1908,
Pierre LEJEUNE, Guitte et Alexandre ou les
bonheurs séparés [in-16 (19 cm); 205 p.; roman], Paris,
Rieder [«Prosateurs français contemporains»], 1929.
Philippe LEJEUNE
(artiste peintre, fils de l’auteur) [éd. & illustrateur], Pierre-Ulysse
LEJEUNE (1885-1958)
[auteur des sonnets], Via crucis [23 x 31 cm; non folioté;
19 folios de sonnets & 15 folios de planches (correspondant aux 14 stations
du chemin de croix catholique, plus une eau-forte
de Philippe Lejeune signée, La Déposition); 75 exemplaires numérotés], Paris, Mémoire
vivante, 1999.
Philippe LEJEUNE [éditeur et illustrateur],
Pierre-Ulysse LEJEUNE (maire d’Étampes pendant l’occupation allemande)
[auteur], Ulysse en prison [22 cm; 107 p.; il
ustrations en noir et blanc et en couleur de Philippe Lejeune; journal
tenu en prison en 1944], Paris, Mémoire vivante, 2009.
Sur le pays
d’Étampes de 1939 à 1945
COLLECTIF, «Le Pays d’Étampes de
1939 à 1945», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-39-45b.html,
depuis 2003.
Toute critique, correction
ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|





