LOUIS-EUGÈNE LEFÈVRE
membre honoraire correspondant de la Société
archéologique de Corbeil et d’Étampes
LA
GRANDE BOUCHERIE DE PHILIPPE-AUGUSTE
ET L’HOTEL SAINT-YON A ETAMPES
Planche I: Grand-Hôtel-Saint-Yon et dépendances.
Façade du côté de la rivière.
Les maisons du Moyen Age existent encore fort nombreuses à Etampes:
si nous ne les distinguons pas, c’est parce qu’elles furent défigurées
au cours des siècles et ont ainsi perdu,
au moins superficiellement, leur caractère spécial. Souvent
on les devine de très vieux logis ou d’antiques échoppes,
sans qu’on puisse déterminer, même à cent années
près, le temps de leur fondation. Quelques-unes, dédaigneuses
des maquillages, usent encore des grâces d’un art suranné pour
avouer leur naissance vers le XVe ou vers le XVIe siècle. Pour d’autres,
c’est un déshabillage fortuit, un décrépissage indiscret
qui révèle à nos yeux amusés ou ravis des structures
désuètes et l’âge vénérable d’une petite
demeure cinq ou six fois centenaire: de quels masques plats et insignifiants
n’ont pas été affublées nos plus vieilles habitations
particulières!
|
|
Nous connaissons ainsi les vestiges d’une construction érigée
au XIIe siècle, le plus vraisemblablement dans la seconde moitié
(1). A vrai dire, il ne s’agit pas d’un ancien logis ou manoir, et les détails
caractéristiques de son origine n’abondent pas, au moins dans l’état
actuel de la maison car il suffirait probablement de décrépir
les murs extérieurs pour dégager de nouvelles particularités [p.6] certaines et retrouver
enfin des formes romanes ou du style gothique primitif.
|
(1) Déjà signalée par M. Max.
LEGRAND, Etampes pittoresque, 2e édit., t. I, p.
180
|
J’ai cru devoir attirer l’attention sur cette construction non seulement
parce qu’elle est un exemple jusqu’à présent unique à
Etampes, mais encore parce que son origine est entourée de circonstances
historiques qui la signalent spécialement et augmentent beaucoup son
intérêt.
La construction dont je veux parler appartient à
la ligne de maisons serrées entre la rue de la Tannerie et la rivière
canalisée qui traverse la ville depuis le XIe siècle (2). Elle
est cachée par un autre petit bâtiment en façade sur
la rue. Mais celui-ci est bien connu de tout le monde, à cause des
marques flagrantes que sa façade sur la rue a conservées du
temps jadis.
|
(2) L. Eug. LEFÈVRE, Etampes et ses monuments aux XIe et XIIe siècles,
mmémoire pour servir à l’étude archéologique
des plus anciens monuments étampois, extrait des Annales de
la Société archéol. du Gâtinais, Paris, A.
Picard, 1907, p. 32.
|
Ce pittoresque logis porte le numéro 15 de la rue de la Tannerie (3),
et s’appela longtemps «le Petit Hôtel Saint-Yon»,
parce qu’il a été une dépendance de l’Hôtel
Saint-Yon proprement dit, autre vieille demeure plus imposante et plus
ornée, à laquelle il est du reste contigu (4).
Le corps de bâtiment en façade
sur la rue ne date peut-être pas du XIIe siècle; en tout cas,
rien dans son aspect ne rappelle l’époque romane ou les débuts
des temps gothiques, et il aurait alors subi plusieurs remaniements importants
vers les XVe et XVIe siècles: on se rappelle sa porte en bois sculpté,
aux panneaux plissés en parcheminure, et que surmonte une niche gothique
vide.
|
(3)
Autrefois rue de la Coutellerie, et dénommée aussi familièrement
rue de la Salle, probablement à cause de la Salle des Plaids, réservée
à cet usage jusques 1518, et non pas à cause d’une auberge,
comme je l’ai lu quelque part.
(4) Les deux propriétés ont été
réunies au moins pendant plusieurs siècles, entre 1607 et 1820.
|
Séparée de ce petit bâtiment par une étroite cour,
et connue seulement des familiers, est la construction un peu plus vaste
qui m’a entraîné à écrire cette étude. Par
bonheur, s’il y a eu là des altérations certaines et graves,
— au XVIe siècle, si l’on en croit la boiserie élégante
d’une fenêtre de style Renaissance, — elles ont laissé subsister
des fragments importants de l’édifice originel permettant de se faire
une idée des dispositions architecturales dans les parties basses. [p.7]
Ainsi nous découvrons, engagées
dans le mur de la façade orientale qui regarde la vallée,
une colonne avec chapiteau et base dont le caractère appartient franchement
au style du XIIe siècle: et il n’est pas certain qu’il n’en existe
pas d’autres invisibles dans le mur dont le pied baigne dans l’eau en tout
cas, il se trouve une autre colonne avec son chapiteau qu’une ouverture
dans le mur a laissés presque entièrement dégagés.
Je ne me crois pas en droit d’en faire état comme de la première,
parce que son chapiteau n’est pas placé au même niveau que l’autre:
il est possible qu’on l’ait simplement baissé pour le faire passer
sous une pièce de bois, en l’espèce un linteau qu’il fallait
soutenir. Du reste. on trouve encore d’autres débris de fûts
de colonnes que l’on a rassemblés pour supporter les poutres du plancher
en divers endroits. Ce sont les seules traces d’art roman qu’on a laissées
à notre curiosité dans la maison, mais elles suffisent, je
pense, à indiquer que le rez-de-chaussée de la façade
était ouvert avec de grandes arcades (5). |
(5) A l’intérieur de la maison, dans l’axe de la première colonne
citée, on découvre encore engagée dans une cloison,
la partie basse du fut d’une autre colonne, distante de moins de quatre mètres,
et dont la base a tout l’air d’être enterrée. Cela laisse donc
encore supposer que le rez-de-chaussée tout entier était une
grande pièce dont le plafond reposait sur une ligne de colonnes. Toutefois
il faut se méfier du déplacement des colonnes: et je m’empresse
de dire que, malgré l’invraisemblable supposition de colonnes apportées
là et engagées dans les murs sans avoir servi à cette
même place, je fais à cet égard toutes les restrictions
néessaires.
|
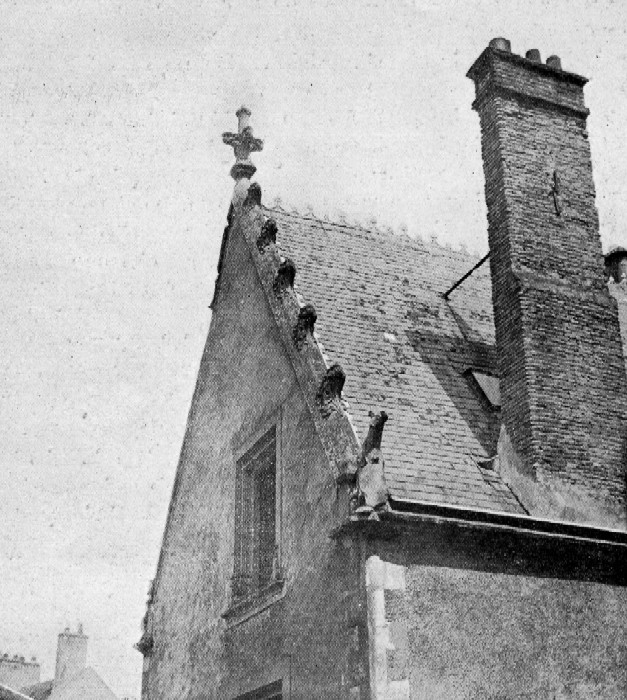
Planche II: Grand-Hôtel-Saint-Yon. Pignon
sur la cour
Je reconnais d’ailleurs bien vite que cette disposition n’a rien de très
extraordinaire. Mais il se trouve que la maison, comme toutes ses voisines
placées dans le même rang, est, ainsi que je l’ai dit, baignée
par une rivière canalisée (6). Les colonnes enfermées
dans le mur de la façade orientale sont donc sur le bord de l’eau,
et le sol du rez-de-chaussée (7) n’était qu’à plusieurs
centimètres au-dessus dit niveau de l’eau de la rivière, comme
celui d’un lavoir ordinaire.
Le bâtiment forme un rectangle ayant environ
13 mètres de long, sur 8 mètres 50 de large. [p.8]
En résumé,
il est supposable que la maison fut construite pour abriter une industrie
ayant besoin d’un accès facile à la rivière, et même
qu’il s’agit d’un abattoir, d’une peausserie ou d’une mégisserie.
En effet, les étaux de boucherie étaient
établis de l’autre côté de la rue, bien avant 1186. Philippe-Auguste
avait fait construire en cet endroit sa Grande-Boucherie sur l’emplacement
des anciens étaux (8). En outre, les bouchers et charcutiers étaient
obligés par des règlements de tuer les animaux «sur
les rivières et non en leurs maisons», comme stipulent
les vieux textes (9). C’est pourquoi notre bâtiment à arcades,
placé entre les étaux et la rivière, doit avoir été
une dépendance de la boucherie, avec la grande maison voisine dont
le nom d’Hôtel Saint-Yon paraît être encore un garant
qu’elle fut la propriété des bouchers.
|
(6)
La rivière a de 4 mètres à 4 mètres 50 de largeur.
(7) Il s’agit en réalité de la
partie la plus inférieure de la maison, à l’origine; mais son
sol, dans l’état actuel des choses, est au dessous du niveau de la
rue, et pourrait être considéré comme un sous-sol: j’ajoute
qu’il y a néanmoins des caves véritables, construites avec
voûtes vers le XVe ou le XVIIe siècle, et dont le niveau est
sensiblement inferieur à celui de la surface de la rivière
elle-même.
(8) FLEUREAU, ouv. cité,
p. 75.
(9) Coustumes des bailliage et pr&vostè
d’Estampes, anciens ressorts et enclaves d’iceluy Bailliage rédigées
et arrestées, au moys de Septembre 1556, par ordonnance du Roy.
Paris, 1557, in-8°. Voici le texte de deux articles intéressants
qui montrent en outre un réel souci de l’hygiène
Art. 185. — N’est loisible à personne
faisant sa demourance en la ville d’Estampes tenir bestes à laines,
porcz, oyes, et canes, sur peine de confiscation desdites bestes, oyes et
canes, et d’amende arbitraire.
Art. 186. — Peuvent néanmoins les bouchers
pour la fourniture de ladite ville, tenir en icelle les dites bestes à
laine pour huit jours seulement, et sont tenuz iceux bouchers tuer leurs
bettes sur la rivière et non en leurs maisons.
Il faut noter que, durant le Moyen Age, on tirait
l’eau des puits pour l’alimentation. On craignait moins d’utiliser les rivières
comme de grands égoûts naturels.
Sur les tueries et escorcheries,
voir C. ENLART, Manuel d’archéologie française, t. II,
p. 257; et DE CAUMONT, Abécédaire, Arch. civ. et mil.,
1869, p. 230-235.
|
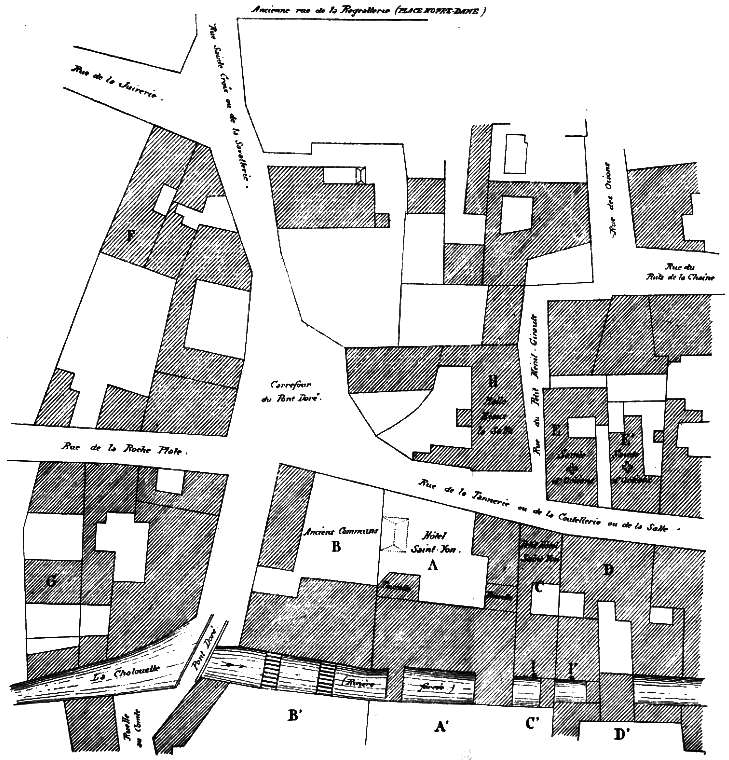
|
ETAMPES.
LA HALLE et ses environs
en 1825 d’après
le plan cadastral du temps.
Dressé par A. Mauduit, géomètre
à Étampes, 1908.
ABCD:
Hôtel Saint-Yon et ses dépendances au XVIIe siècle.
A’B’C’D’: Jardins de
l’Hôtel Saint-Yon.
E E’: Maisons du chapitre
de Sainte-Croix d’Orléans.
F: Cave voûté
avec pilier central (carrée de 7 mètres de côté).
G: Salle voûtée
avec pilier central.
H. La Halle. Ancienne
Grande-Boucherie de Philippe-Auguste, et Salle des Plaids.
I I’: Colonnes à
chapiteaux.
[Cliquez
ici pour télécharcher un plan complet en grand format.]
|
En effet, la famille de Saint-Yon se trouvait, au XIIe siècle, à
la tête de tout le commerce de boucherie qui pouvait se faire dans
Paris. Formant une communauté régie dans ce but par un règlement
spécial (10), les Saint-Yon étaient les uniques détenteurs
des étaux, et, à l’imitation d’un système établi
à Rome dans l’Antiquité, ils possédaient, comme une
charge d’Etat ou un fief transmissible, la surintendance, la juridiction,
la police, la surveillance sanitaire même, sur tout ce qui concernait
le voyage, la vente et le débit des bestiaux dans la grande ville (11).
Il en était ainsi dès le milieu du XIIe siècle,
[p.9] et, en
1182, Philippe-Auguste confirma seulement les privilèges et les coutumes
de la Communauté (12). Enfin, en 1189, celle-ci paraît avoir
réorganisé ses étaux qui, au nombre de vingt-trois,
étaient situés en face du Châtelet, auprès
de la Seine, et connus sous le nom de la Grande-Boucherie.
D’un autre côté,
c’est en 1186 que Philippe-Auguste réforma le commerce de la boucherie
à Etampes. On serait donc tenté de croire que le roi étendit
alors jusqu’ici le privilège de la Communauté de Saint-Yon.
On s’imagine volontiers ces puissants hommes d’affaires réorganisant
et reconstruisant pour le compte du Souverain, tout en lui payant chaque
année une redevance plus forte que celle perçue par lui jusqu’alors.
Mais, s’il n’y a aucun doute sur l’établissement des Saint-Yon à
Etampes, tant s’en faut que nous soyons éclairés sur l’époque
de l’événement et sur le rôle exact joué par leur
Communauté dans cette ville.
|
(10) Ce règlement a été
publié tout au long par le R. P. Jacques DU BREUL, Le Théâtre
des Antiquités de Paris, Paris, 1612, in-4°, p. 787.
(11) Au fur et à messire que les murs
de Paris étaient reculés, la communauté des Saint-Yon
rencontrait dans les nouvelles annexes d’autres privilégiés
avec lesquels elle passait alors des contrats. Elle traitait même quelquefois
avec des privilégiés placés en dehors des murs. Le
cas s’est présenté pour les Templiers en 1182. L’abbaye de
Saint-Germain des Prés possédait également des étaux
indépendants en vertu de très anciens droits, et parce qu’elle
était établie hors l’enceinte.
(12) Un système semblable existait
pour la boulangerie, qui était sous la dépendance du grand
panetier; et d’autres branches d’industrie ou de commerce, fripiers, gantiers,
pelletiers, cordonniers, selliers, bourreliers, etc., avaient un grand chef
en la personne du chambellan royal.
|
Au contraire, non seulement les textes les plus anciens ne font pas mention
des Saint-Yon, comme bouchers d’Etampes, mais ils les écartent plutôt,
tout au moins durant les XIIe et XIIIe siècles.
Voici ce que nous distinguons de plus clair.
Avant 1186, il existait une boucherie dans chaque quartier de la ville, à
Saint-Martin, à Saint-Gilles, à Saint-Pierre, et à
Notre-Dame au lieu que nous avons indiqué. Cette dernière boucherie,
qui était la plus importante, et appartenait à Hugues Nascard
(13), était probablement divisée en plusieurs étaux
avec chacun un tenancier différent. Donc, vers 1186, Philippe-Auguste
se substitua (14) à Hugues Nascard en l’indemnisant certes (15),
mais dans le but de supprimer un intermédiaire [p.10] coûteux et de profiter
seul des augmentations de rente qu’il avait en vue. Tout ceci se trouve confirmé
par des actes postérieurs (16).
Enfin dans l’acte de 1187, comme dans un autre
de 1274, l’autorité complète du suzerain propriétaire
est affirmée sans restriction (17).
La conséquence de tout cela, c’est qu’il
ne faut pas hésiter à prendre à la lettre les termes
précis du diplôme de 1187: Philippe Auguste a fait démolir
pour son propre compte les anciens étaux, et il a fait reconstruire
les nouveaux pour en tirer directement du profit. De sorte que les halles
détruites soit en 1763, soit vers 1835, étaient un édifice
royal (18). De même, selon toute évidence, le petit manoir qui
m’a entraîné à faire la présente étude
et qui fut primitivement, à n’en pas douter, une dépendance
de la Grande-Boucherie, doit être un reste des bâtiments érigés
vers 1186 par Philippe-Auguste. C’est donc un édifice royal ,à
moins cependant qu’il ait été construit par Hugues Nascard
ou l’un des prédécesseurs de celui-ci; il est extrêmement
difficile de se faire une opinion précise à ce sujet.
En tout cas, nous nous trouvons en présence
d’une construction élevée pour servir à une industrie
dérivant de la boucherie: tuerie, peausserie ou mégisserie;
et en considérant la sculpture classique de ses chapiteaux et la belle
proportion de ses colonnes, elle nous [p.11] offre une nouvelle preuve du soin et de l’intelligence
pratique avec lesquels nos ancêtres du Moyen Age installaient leurs
locaux destinés au travail industriel ou commercial.
|
(13) D’après
notre érudit collègue, M. Joseph Depoin, ce nom est devenu
Nacquard.
(14) Il est remarquable combien souvent Philippe-Auguste
a employé ce procédé è Etampes. Quand il casse
la Commune ou quand il supprime l’abbé de Notre-Dame, c’est pour augmenter
les ressources royales et tirer de toutes choses un maximum de rendement.
Nous trouvons dans l’acte de la boucherie une nouvelle application du système.
Voir notre Etampes et ses monuments aux XIe et XIIe siècles,
pp. 21-24 et 62-74.
(15) Avec 100 sols paris. de rente perpétuelle
à prendre sur le revenu de la nouvelle boucherie. A noter que le diplôme
délivré en 1187 était postérieur aux changements
et aux travaux exécutés par Philippe-Auguste. — Cette même
rente fut transférée en 1246 par un nommé Guyard de
Papillon à l’abbaye royale de Villiers près de La Ferté-Alais
(FLEUREAU, ouv. cité, p. 134).
(16) En 1246, saint Louis autorise que
la rente sur les étaux consentie è Hugues Nascard en 1187 passe
à l’abbaye de Villiers sans qu’il soit question d’aucun concessionnaire
général, Saint-Yon ou autre, — En 1274, la reine Marguerite,
devenue dame suzeraine d’Etampes, délivre un acte accordant directement
des baux aux tenanciers des divers étaux de la nouvelle boucehrie,
moyennant 72 livres paris. de rente, lesquels apparemment se payaient encore
au XVIIe siècle (FLEUREAU, ibid., p. 137).
Les tenanciers d’alors s’appellent Guillaume
de La Ferté, Paul Breton, Guillaume de Marie, Pierre Rouault, Jean
Mallard, Jean Catault et Jean Colard; ils possédaient également
des privilèges de famille (FLEUREAU, ouv. cité, p. 136-137).
La Communauté de Saint-Yon s’est peu à peu associé plusieurs
familles qui naturellement devaient être riches et n’ont rien de commun
avec les petits bourgeois ci-dessus: ces familles portaient les noms de Thiberts,
Ladehors et d’Auvergne.
(17) «… quoniam propter stalla Hugonis
Nascardi, quæ destructa fuerunt et eversa, quando stalla nostra Stampis
fieri fecimus…» ; «... in stallis nostris carnificium Stampensium…»;
— «…quod nos carnificibus Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stampensem,
quæ dicitur ad novos stallos…» (FLEUREAU, ouv. cité,
p. 134 et 136).
(18) L. Eug. LEFÈVRE, ouv. cité,
p. 75, note 3.
|
Sur le bâtiment de la Grande-Boucherie construit par Philippe Auguste
et dont les derniers vestiges ont disparu vers 1840, nous savons fort peu
de chose. Aucun dessin, si mauvais soit-il, n’est là pour nous en
donner l’image même imprécise (19). Nous savons seulement par
Fleureau que le bâtiment avait un étage: au-dessus des étaux
se trouvait une grande salle où, depuis un temps indéterminé,
mais vraisemblablement depuis la fondation, se tenaient les plaids,
c’est-à-dire les plaidoiries, les tribunaux civils. La justice, —
qui, dans Etampes, était réservée en principe au roi,
en sa qualité de suzerain, et qui le fut véritablement en fait
pendant fort longtemps, — était rendue dans le Palais royal; seules
les très petites causes abandonnées à un fonctionnaire
étaient jugées ailleurs. Mais quand les rois cessèrent
de rendre la justice eux-mêmes (20), il semble que le palais n’en
resta pas moins réservé pour eux seuls. C’est pourquoi une
salle spéciale était nécessaire, et, comme nous venons
de le dire, à Etampes cette salle se trouvait au-dessus des étaux
de boucherie, et en somme dans une propriété royale (21).
|
(19) Il
est notable combien Etampes a été peu favorisé dans
cet ordre d’idées. L’art du dessin n’y fut sans doute jamais florissant.
C’est seulement vers le milieu du XIXe siècle qu’un simple amateur,
mais dessinateur consciencieux, Lenoir, a commencé à relever
plusieurs monuments intéressants. Ses documents sont précieux.
(20) Ils se faisaient quelquefois remplacer
par la reine ou par le prince héritier designé; mais alors
le principe était sauvegardé. — On a parlé d’une Salle
de Justice construite specialement dans ce but, à la fin du XIe siècle
dans l’enceinte du château de Caen, pour l’usage des Ducs de Normandie
(VERDIER et CATTOIS, Architecture civile et domestique au Moyen Age,
Paris, 1855, t. II, p. 152.)
(21) Au Moyen Age, les salles convenables pour
une telle cérémonie manquaient fréquemment. Aussi l’habitude
se prit de tenir les plaids dans les églises. L’autorité
ecclésiastique en était mécontente, et les conciles
répètent sans se lasser leurs interdictions à ce sujet,
interdictions qui ne paraissent pas avoir eu souvent grand effet.
|
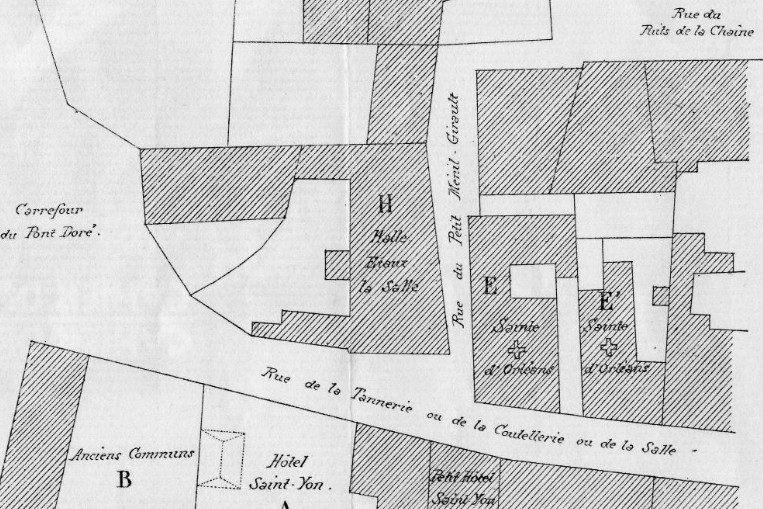
|
LA HALLE et ses environs en 1825
d’après le plan cadastral
du temps.
Dressé par A. Mauduit, géomètre
à Étampes, 1908.
ABCD: Hôtel
Saint-Yon et ses dépendances au XVIIe siècle.
E E’: Maisons du chapitre
de Sainte-Croix d’Orléans.
H. La Halle. Ancienne Grande-Boucherie
de Philippe-Auguste, et Salle des Plaids.
[Cliquez
ici pour télécharcher un plan complet en grand format.]
|
Avant le XVle siècle, quand les habitants ne possédaient pas
encore un hôtel de ville, les grands actes de la vie communale se passaient
dans cette salle avec l’apparat et la solennité aimés du Moyen
Age. Là se faisait l’élection des échevins (22). La
salle de la [p.12]
Halle — car le bâtiment s’est aussi appelé ainsi pendant
longtemps, — a cessé d’être salle d’audience quand les rois
eurent renoncé à utiliser pour leurs séjours le palais
royal devenu trop petit et mal commode. C’est la reine Claude qui consacra
cet abandon, en 1518, en permettant aux habitants d’user de sa «maison
du séjour» (23) pour les séances de justice.
Ensuite le sort
de la salle des plaids devint aventureux. Pendant la Révolution, le
bâtiment fut vendu comme bien national (24): ceci prouve bien son origine
royale.
Au XIXe siècle on y faisait des ventes
publiques; des troupes de passage ou des amateurs locaux y donnaient des
représentations théâtrales (25). Une troupe de comédiens,
celle de la famille Cizos, originaire de Chartres, résidait habituellement
une partie de l’hiver à Etampes: en octobre 1824, pendant un de ces
séjours, une fille naquit, la petite Marie Cizos, qui sous le nom
de Rose Chéri devint célèbre autant pour son talent
que pour sa vertu.
Une plaque de rue perpétue le souvenir
de la Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et de la salle des plaids, mais
seulement en rappelant leur passé dramatique. Une rue qui borde la
place vide est en effet désignée sous le nom de Rue de
l’Ancienne-Comédie.
|
(22)
«La manière de procéder en cette élection étoit,
que les Echevins obtenoient du Lieutenant Général la permission
de faire assembler les habitants. Ceux-ci assemblez, en la présence
du même Lieutenant Général et du Procureur du Roy, en
l’audience où l’on tenait les plaids... le Procureur du Roy requeroit
que l’on fit la nomination des nouveaux Echevins. La nomination faite par
les habitans, le Lieutenant Général prenoit le serment de
ceux qui avoient été nommez par la plus grande partie, de
bien et deuëment gouverner, et administrer les denires communs de la
ville: et après avoir ainsi pris le serment, il prononçoit
un acte de la teneur duquel il paroit qu’il leur donnoit toute l’autorité
qu’ils avoient» (D. B. FLEUREAU, Les Antiquitez d’Estampes,
Paris, 1683, p. 212).
(23) FLEUREAU, ouv. cité,
p. 27.
(24) Léon MARQUIS,
Les Rues d’Etampes, p. 176. —Pourtant Marquis ajoute que
le bâtiment était la propriété de la Coommunauté
des bouchers. En outre, il émet la supposition que la Boucherie de
Philippe-Auguste aurait été démolie en 1763. Mais ceci
est inexact, car le bâtiment, que nous pouvons supposer avoir été
reconstruit, a continué d’être désigné «la
salle d’audience». (Voir MARQUIS, p. 404, note G.).
(25) Sur le plan cadastral de 1825, le bâtiment
est designé «Théâtre». Quand il fut démoli,
les troupes d’amateurs allèrent s’installer dans une maison de la
route de Paris, dite Salle de la Girafe.
|
J’ajoute que la place actuelle représente plus que la superficie de
la halle détruite. En même temps que la vieille construction
royale, on démolit aussi une maison également historique
qui appartenait au chapitre de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans
(26), et qui d’ailleurs était dite «de Sainte-Croix».
C’est elle qui est désignée [p.13] signée en 1226, dans l’acte de limitation
des paroisses Notre-Dame et Saint-Basile (27). Nous avons l’acte de délibération
du directoire, en date du 31 octobre 1791, ordonnant sa vente comme faisant
partie de la seigneurie du Menil-Girault (28). De cet hôtel Sainte-Croix,
je considère comme en ayant fait partie la maison portant n°14,
qui existe actuellement à l’angle de la rue de la Tannerie et de la
Place de l’Ancienne-Comédie, sur la façade de laquelle est
sculptée en pierre une croix à deux branches égales.
Cette maison, qui est très ancienne, possède une cave voûtée
à deux étages.
Pour en revenir aux de Saint-Yon, il est évident
que s’ils ne furent pas les concessionnaires de la boucherie étampoise
aux XIIe et XIIIe siècles, ils ont pu le devenir par la suite; le
fait est très douteux, mais en tout cas, — et c’est tout ce que nous
prétendons aujourd’hui, — ils ont bel et bien possédé
à Etampes la grande demeure qui porte leur nom et dont l’ornementation
soignée révèle le passé à travers le Moyen
Age et la Renaissance. Je crois donc intéressant d’ajouter quelques
mots de plus et sur eux et sur leur logis.
Comme on le conçoit tout de suite, cette
vieille famille de barons tirait son nom du fief de Saint-Yon, près
de Châtres, aujourd’hui Arpajou, qui est à quinze kilomètres
environ d’Etampes ou de Corbeil. |
(26) Dans
cette maison, le représentant du Chapitre d’Orléans exerçait
à Etampes sa justice haute, moyenne et basse sur ses justiciables
d’Etampes ou des environs (FLEUREAU, ouv. cité, p. 37).
(27) FLEUREAU, ouv. cité,
p. 404. — Ce très intéressant acte signé par Gautier
Cornu, archevêque de Sens, confirme une partie de ce que nous avons
dit ci-dessus. On y trouve cette phrase: « … a domo sanctæ
Crucis Aurelianensis quæ est juxta domus Regis ...» La
maison du Roi citée ici ne saurait être son habitation, son
palais du séjour, qui eût été plus respectueusement
désignée, mais une propriété du roi, mise en
opposition avec la propriété du Chapitre d’Orléans
[N.B. Lefèvre se trompe ici lourdement
parce que dans la charte en question, dont le texte est ici tronqué,
Regis représente un nom de famille attesté
à Étampes depuis le XIe siècle, Leroy.
(B.G. (2007)]. Il s’agit, à mon avis, de la Boucherie et de
ses dépendances. Le même acte cita en même temps une
propriété appartenant au Chapitre de l’église Sainte-Croix
d’Etampes, qui au temps de Fleureau, était «renfermée
dans le corps de la boucherie» (p. 405). Tout auprès (juxta)
se trouvait également la propriété, le [sic: ce masculin montre le peu de familiarité
de Lefèvre avec le latin, plaie récurrente de l’historiographie
locale.] domus de l’abbaye de Saint-Denis, mais nous ne savons
pas où exactement. Enfin l’auberge du Coq-en-pâte ne doit pas
avoir changé de place depuis longtemps.
(28) Archives départementales.
En partie publié par L. MARQUIS, ouv. cité, p. 403.
L’hôtel est estimé à 120 liv. de revenu et à
2113 liv. de capital.
|
D’après l’abbé Lebeuf (29), le plus ancien seigneur du fief
serait Hugo miles de Sancto Ionio, cité au cartulaire de Notre-Dame-des-Champs.
Aymon de Saint-Yon est nommé au cartulaire de Longpont dans un acte
passé entre 1086 et 1135. Puis, sous Louis VI existait Païen,
Paganus de Sancto Ionio, dont le vrai nom était
Rogerius et qui servit de médiateur entre son prieuré
de Saint-Yon et l’abbaye de Morigni. [p.14]
A partir de 1133, une série de transactions
interviennent entre eux et plusieurs autres contractants: 1° le roi de
France; 2° les religieux de Saint-Martin des Champs, alors détenteurs
du prieuré de Montmartre; 3° les religieuses qui succédèrent
à ceux-ci dans le même lieu passé au titre d’abbaye.
|
(29) Hist.
de la ville et du diocèse de Paris, t. IV, p. 94, 163 et 164.
|
C’est dans ces derniers actes que les de Saint-Yon se révèlent
les Grands-bouchers de Paris, car il s’agissait pour eux d’acquérir
de vieux bâtiments mitoyens pour donner de l’extension aux étaux
du Châtelet. En 1153, Philippe de Saint-Yon vendit aux religieuses
de Montmartre tout ce qu’il avait de terres ou autres héritages à
Torfou (30), en même temps qu’il remettait au roi le fief qu’il possédait
en ce lieu (31).
Les Saint-Yon acquirent peu à peu une
grande puissance à laquelle leur richesse ne fut sans doute pas étrangère.
A la fin du XIIIe siècle, une de leurs filles, Agnès, épousa
Robert II de Courtenay, Sr de Tanlay, de Ravières et de Saint-Winemer,
qui était issu du roi Louis VI; de même, une arrière-petite-fille
de ce couple, Jeanne de Tanlay, dame de Poissy épousa Jean de Chamigny,
Sr de Saint Yon (32).
|
(30)
Cant. de la Ferté-Alais, arrt d’Étampes.
(31) J’emprunte ces renseignements qui me paraissent
très vraisemblables au P. DU BREUL, ouv. cité, p. 784
et suiv. — Au sujet de Torfou et du roi de France, voir L. Eug. LEFÈVRE,
Etampes et ses Monuments au XIIe siècle, p. 55,
76 et 85.
(32) Le P. ANSELME, Hist. De la Maison royale
de France, p. 445-446.
|
Les Saint-Yon se sentaient puissants et avaient de gros intérêts
à défendre; aussi n’est-il pas surprenant qu’ils aient joué
parfois un rôle politique. Au commencement du XVe siècle, pendant
les guerres des Armagnacs et des Bourguignons, ils se mirent à la
tête des bouchers ou Ecorcheurs, du parti du Duc de Bourgogne
contre le Duc d’Orléans et les Armagnacs, et furent un grave sujet
de troubles. Les revers de la lutte leur firent perdre momentanément
leurs privilèges. Néanmoins, au cours du siècle, Garnier
de Saint-Yon fut échevin de Paris et garde de la Bibliothèque
du Louvre (33). Enfin ils furent pendant plusieurs siècles si étroitement
mêlés aux grands événements de la vie parisienne
que les documents les concernant sont innombrables aux Archives nationales.
La Communauté perdit [p.15]
son droit de juridiction en 1673, mais elle ne fut complètement
et définitivement abolie qu’à l’époque de la Révolution.
|
(33)
La guerre des Armagnacs eut une vive répercussion à Etampes,
en 1411, sans que d’ailleurs le nom de Saint-Yon soit en vue dans les récits,
du moins à ma connaissance. La ville se rendit sans lutte aux alliés
Bourguignons et Parisiens; mais le château-fort résista pendant
quelques jours, et en somme, le pillage ne put être complètement
évité.
|
Jusqu’à présent, le souvenir des Saint-Yon ne s’est perpétué
à Etampes que par leur hôtel. Le mystère le plus singulier
plane sur leur arrivée et leur établissement dans la ville.
Cependant un renseignement encore inédit que j’ai eu la chance de
trouver (34) va mettre les chercheurs de bonne volonté sur une nouvelle
piste.
|
(34)
Je dois cette chance aux fiches bibliographiques de M. Paul Pinson, dont
la publication est en cours (Voir Arrêts). |
Tout d’abord, les Saint-Yon apparaissent dans les environs d’Etampes. Ils
furent propriétaires à Torfou. En 1261, on cite Jehanne, dame
de Saint-Yon et de Méréville (35); en 1293, Isabelle de Saint-Yon
vend à Hugues de Bouville tous les droits qu’elle possède sur
la seigneurie de Milly (36). Enfin il semble que la famille ait commencé
à quitter son ancienne seigneurie patrimoniale de Saint-Yon, sous
Charles VII, quand apparaît un certain de Behene (37).
|
(35)
Max. LEGRAND, ouv. cité, p. 181. — Voir aussi Rec. de Gaignières,
B. N., Est., P E IIa, f°127.
(36) Renseignement communiqué par M.
Paul PINSON.
(37) LEBEUF, ouv. cité,
p. 164. |
Enfin, voici le fait important: nous savons par un arrêt du Parlement
de Paris, en date du 6 octobre 1629, que Denis de Saint-Yon était
alors lieutenant du bailliage d’Etampes, et que Hierosme de Saint-Yon avait,
plus ou moins longtemps avant la même date, occupé le poste
de maître des eaux et forêts du bailliage (38). Le chroniqueur
étampois Pierre Plisson, qui a établi une liste des lieutenants
généraux et particuliers (39) avant le XVIIIe siècle,
ne cite aucun
[p.16] Saint-Yon; son énumération est d’ailleurs
visiblement incomplète à l’époque en question, et cette
lacune explique en partie comment les historiens suivants sont restés
ignorants du fait (40).
Jusqu’à présent, nous ne possédons
aucun document prouvant que l’hôtel qui porte leur nom fut construit
ou restauré par des Saint-Yon. Et même l’écusson gravé
dans le marbre, qui veut attester au moins la propriété, est
moderne.
Du moins, on savait formellement par les titres
qui sont encore en la possession du propriétaire actuel de l’Hôtel
St-Yon (41), quelle fut jadis l’importance de cette demeure, aujourd’hui
divisée entre quatre propriétaires. Elle comprenait les maisons
portant les numéros 15, 17, 19, et tout ou partie de la maison portant
le numéro 13. Les aliénations successives ont commencé
après 1607 pour être complètes en 1820. L’hôtel
proprement dit est passé successivement entre les mains de Jacques
Alleaume (fils de Ferry Alleaume), puis de Hémard de Danjouan qui le
légua à son fils l’abbé Pierre (1675). En 1764, Robert
Darblay, mégissier, en prend possession. En 1665, les Chartreux d’Orléans
perçoivent une rente sur la location.
|
(38)
Nous n’avons pu jusqu’à présent voir cet acte ou sa copie,
car il y a de nombreuses lacunes dans les collections publiques, et M. Pinson
lui-même n’a trouvé que le titre de l’arrêt. Il s’ensuit
que nous ignorons si Denis de Saint-Yon fut lieutenant-général
ou lieutenant particulier. En outre, nous avons retrouvé des lettres
patentes du 18 décembre 1630, dans lesquelles Hiérosme de Saint-Yon
est qualifié lieutenant des eaux et forêts (Arch.
Nat.. Z IE 567, f°318). Il avait donc alors monté en grade.
Il était peut-être le fils d’Antoine de Saint-Yon qui fut lieutenant-général
des eaux et forêts au commencement du XVIIe siècle (Arrêts
de la Cour du 6 juillet 1601, du 15 mars 1603, du 17 mars 1604). Il faut
probablement identifier Anthoine avec le Sr de Sainctyon qui, en 1610, conseiller
du roi, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, publia
un important ouvrage: Les édicts et ordonnances des roys, coustumes
des provinces, règlemens, arrests, etc... des eaux et forests,
Paris. Nous avons trouvé dans cet ouvrage les trois derniers titres
cités ci-dessus; il contient en outre des renseignements précis
sur les règlements et coutumes d’Etampes, concernant les eaux et
forêts, sur la nomination des maîtres et des sergents
dangereux, etc. — Un maître Claude de Sainctyon fut procureur
du roi en la Chambre du Trésor, en 1549 (Arch. nat., Z IA
527, arrêt du 24 Novembre).
(39) L. MARQUIS. les Rues.
(40) Plisson cite comme lieutenants généraux:
Claude Cassegrain en 1568 et Jacques Petau en 1626. Puis comme lieutenants
particuliers: Pierre Le Maire en 1553 et Nicolas Cousté en 1634.
(41) M. Auguste Dujoncquoy, adjoint au
maire d’Etampes.
|
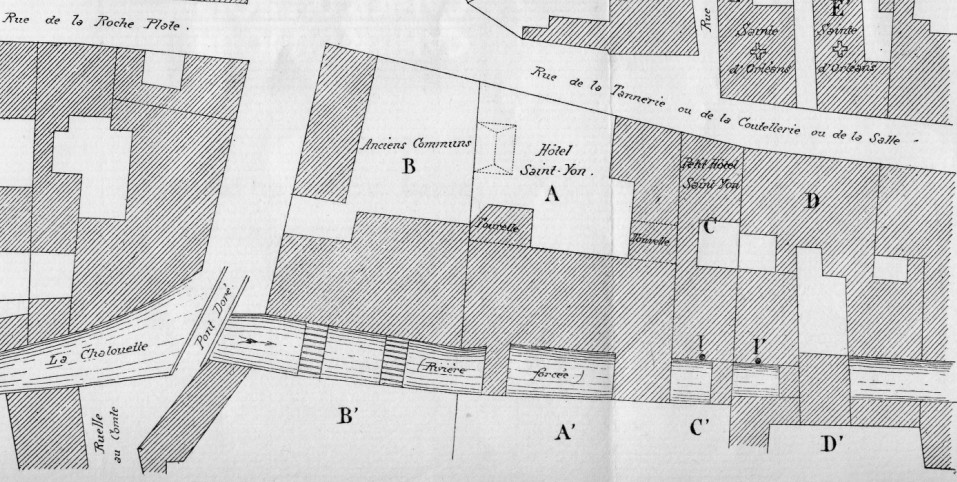
L’immeuble n°19 a désormais perdu son ancien caractère;
on vient de lui enlever son dernier signe distinctif, une grande porte
charretière à arc plein cintre. Là devaient avoir
été reléguées les écuries et les remises
(42).
L’immeuble n° 13 comprend au moins une tourelle
d’escalier et une partie du bâtiment sur la rivière qui appartenaient
jadis au n°15, le Petit-Hôtel-Saint-Yon dont nous avons parlé
au début (43). Le corps en façade sur la rue en a peut-être
été détaché également.
Ainsi au XVIe siècle, et très
probablement depuis fort longtemps, les bâtiments de la propriété
alors détenue par les de Saint-Yon au bord de la rivière canalisée
et presque sans discontinuité, s’étendaient sur une longueur
de 6o mètres environ. [p.17]
Quant à l’hôtel actuel (n°17,
en A sur le plan) c’est une grande construction qui tourne autour d’une cour.
Il a deux étages surmontés de toits très en pente qui
font de vastes combles avec charpentes en châtaignier et lucarnes très
ornées du côté de la rue.
|
(42) Un mèmoire faisant partie des titres
de propriété signale que la ruelle bordant le jardin et dite
«du Pont-Doré», portait autrefois le nom de «Ruelle
au Comte», parce qu’elle aboutissait à la rue du même
nom. L’acte de 1226 mentionne un «vicus Comitis» qui doit sans
doute se trouver en ces parages.
(43) D’après le plan cadastral, le n°15
fait hache sortante sur le n°13; et le n°13 entre de même dans
la maison voisine, n°11.
|
Il est probable que l’hôtel a été bâti en deux
fois (44), mais peut-être avec un court intervalle entre les deux constructions.
Peut-être encore, à cette occasion, a-t-on démoli entièrement
les édifices antérieurs, ou s’est-on contenté de les
rajeunir. Le corps de bâtiment le plus ancien me paraît être
celui qui touche au n°19. Les meneaux de ses fenêtres ont été
enlevés par un marchand de laines au milieu du siècle dernier.
Depuis, une restauration opérée en 1873 par M. Dujoncquoy,
a remis les choses à peu près en état.
L’autre corps de bâtiment,
mitoyen avec le n° 15, est peut-être une annexe très ancienne,
mais, en tout cas, il a une décoration très caractérisée
de la fin du XVe siècle ou du commencement du XVIe. Il s’étend
en travers, d’un côté s’avançant vers la rue, de l’autre
enjambant la rivière. L’aile nord-ouest possède une ornementation
particulièrement soignée, parce qu’elle était du côté
de la rue.
|
(44) A l’intérieur,
on trouve deux grands murs accouplés.
|
Son grand pignon, qui donne sur la cour, a son rampant garni de crochets
ayant toute l’exubérance de leur époque (Pl. II). Il est gardé à droite et à
gauche par deux chiens héraldiques. Celui de gauche est ancien (45);
l’autre ne l’est pas.
|
(45)
Il fut retrouvé intact dans un grenier.
|
Les sculptures bien conservées qui ornent les montants et l’archivolte
de la lucarne de la façade (Pl. III) sont
remarquables par leur style; elles représentent des feuillages qui
s’échappent d’un vase et grimpent enchevêtrés à
des amours. La lucarne rectangulaire est coupée par une croisée,
c’est-à-dire par un meneau et une traverse horizontale. Elle est surmontée
d’un fronton triangulaire refait et plus ou moins inventé par l’architecte
restaurateur (46), ainsi que les deux clochetons qui l’accostent. Il y a
sur la cour deux autres lucarnes semblables et restaurées dans les
mêmes proportions, mais dont les montants et l’archivolte sont simplement
moulurés.
|
(46)
M. Roguet, en 1873.
|
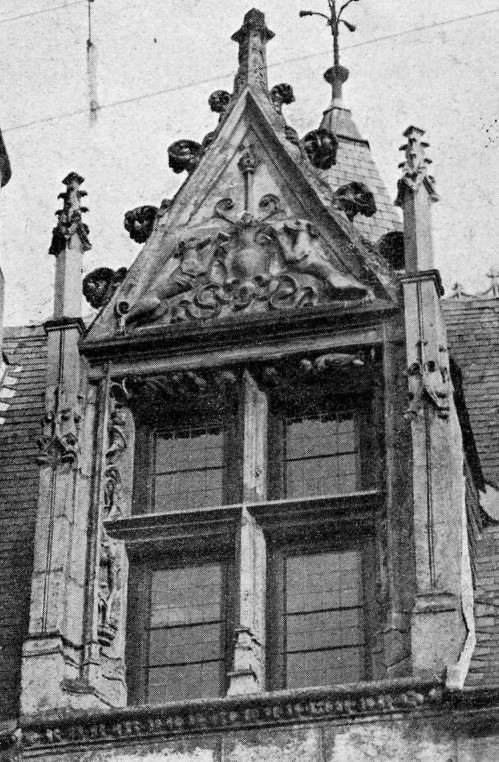
Planche III: Grand-Hôtel-Saint-Yon. Lucarne
sur la façade restaurée
L’hôtel est flanqué de deux tourelles d’escalier, dont une possède
quatre étages, le dernier étant occupé par une pièce
qui accapare toute la cage au-dessus de l’escalier (47). [p.18]
Chaque tourelle
avait sa porte d’entrée ouverte sur la cour. La plus richement sculptée
de ces portes donnait accès dans la tourelle sud: elle a été
malheureusement mutilée; sa structure est changée, et même
elle est engagée dans de nouvelles constructions qui n’en laissent
plus voir qu’un fragment.
|
(47)
Les tourelles d’escalier datant du Moyen Age sont extrêmement communes
à Etampes. Le palais royal en possédait une très élevée
dont la partie supérieure devait être disposée de la
même façon que celle de Saint-Yon (Voir notre étude,
Le Palais royal d’Etampes et sa peinture historique, extrait du Bulletin
de la Commission départementale des Antiquités de Seine-et-Oise,
1909).
|
La porte de la seconde tourelle est parfaitement conservée, et c’est
un bon exemple parmi les plus simples des portes ornées qui furent
érigées à Etampes à la fin de la période
gothique (48). Les fenêtres de la même tourelle ont aussi un
joli caractère dans leur simplicité (Pl.
IV).
Du côté de la rue seulement, toutes
les ouvertures de fenêtres des appartements sont quadrangulaires; toutes
sont divisées en quatre compartiments par une croisée (49).
Les bases des montants et des meneaux sont moulurées de la même
façon que la porte de la tourelle. Sur la façade du jardin,
les fenêtres sont banales à l’exception d’une très bien
conservée, mais qui, étant plus étroite, ne possède
pas de croisée.
|
(48)
Voici les portes étampoises du même style: dans l’église
Notre-Dame, les deux portes de la Sacristie (1514); église Saint-Basile,
deux portes au Sud et une au Nord, plus une quatrième, à l’intérieur;
église Saint-Gilles, portes nord et sud; porte d’une petite construction
sur la Promenade du Port; porte dernièrement déplacée,
d’un ancien petit manoir, rue Saint-Mars. Quelques-unes de ces portes ont
une ornementation beaucoup plus riche, plus complète, étant
abritées sous des larmiers en accolades avec des crochets ou des figurines
animales et un fleuron.
(49) Toutes ces croisées sont l’œuvre
de la restauration.
|
J’ajoute que les faîtières et les girouettes sont modernes.
A l’intérieur, les chambres sont très
vastes, mais sans ornementation aucune, à l’exception d’une pièce
du premier étage, dans le pavillon sur la rue. Celle-ci possède
un plafond à poutrelles avec de nombreuses incrustations. Cette jolie
décoration a malheureusement subi dernièrement un désastre:
un commencement d’incendie a chauffé à l’excès la matière
sans doute résineuse qui bouchait les trous d’incrustation, et ceux-ci
se sont presque tous vidés.
Les quatre plus grandes chambres du bâtiment
principal, superposées deux à deux, possèdent une garde-robe
ménagée dans l’épaisseur du mur du côté
de la rivière, mais non pas, comme on pourrait le croire, avec une
bretèche ouverte au-dessus de l’eau. [p.19]
Ces cabinets font pourtant sur la façade deux
parties saillantes que l’on prendrait volontiers pour des contreforts, malgré
les étroites ouvertures dont elles sont percées.
Enfin je puis signaler encore l’existence d’une
cave avec voûte en berceau légèrement brisé.
En résumé, l’hôtel Saint-Yon
est une grande maison où les ornements assez nombreux ont tous été
exécutés avec beaucoup de soin. A défaut d’une plus
grande originalité, et en raison du sou venir de la haute famille qui
s’y rattache, cela suffit amplement pour qu’il retienne notre attention.
|
|
Planche IV: Grand-Hôtel-Saint-Yon. Tourelle d’escalier
|
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
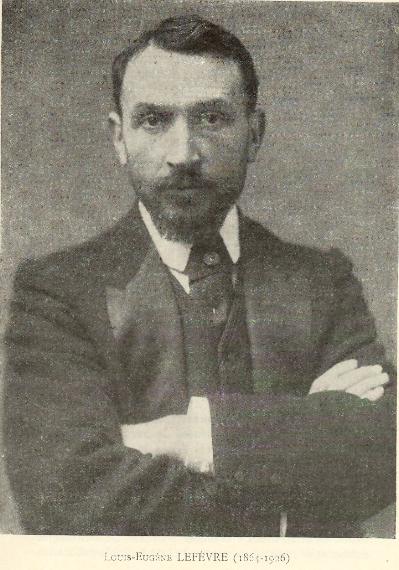 Sur Louis-Eugène Lefèvre
Sur Louis-Eugène Lefèvre
Louis-Eugène LEFÈVRE, «La
Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à
Étampes» [avec un plan sur dépliant et 4 planches photographiques],
in Bulletin de la Société historique et archéologique
de Corbeil, Étampes et du Hurepoix (1909), pp. 32-46.
Louis-Eugène LEFÈVRE, La Grande-Boucherie
de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Étampes
[19 p. (paginées de 1 à 19); plan sur dépliant; 4 planches
photographiques; extrait tiré à 120 exemplaires du Bulletin
de la Société historique et archéologique de Corbeil,
Étampes et du Hurepoix (1909), pp. 32-46], Paris, Picard, 1909. [Je
remercie ici M. Philippe Dujoncquoy de m’avoir prêté son exemplaire,
car le plan de celui des Archives avait été déchiré
par une main indélicate.]
Bernard GINESTE [éd.], «Louis-Eugène
Lefèvre: La Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel
Saint-Yon à Étampes (1909)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-20-lefevre1909boucherie.html,
2007.
F. GIRONDEAU, «Notice
biographique sur Louis-Eugène Lefèvre», in Bulletin
des amis du musée d’Etampes 7 (1929), pp. ?-?.
Dont une rééditon
numérique en mode texte par François JOUSSET, «F.
Girondeau: Notice biographique sur Louis-Eugène Lefèvre
(1929)», in Stampae, http://www.stampae.org/mylibrary/notices/lefevre.html,
en ligne en 2007 [page à laquelle nous empruntons la photographie
ci-contre].
Sur la Boucherie étampoise
Christophe
(Christoffe, Christophle, Christofle, Chrestofle) de THOU
(1508-1582), Barthélémy FAYE (ou FAÏE, seigneur
d’Espeisses) & Jacques VIOLE (1517-1584)
[éd.], Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes,
anciens ressorts & enclaves d’iceluy bailliage, redigées
& arrestées, au moy de Septembre mil cinq cens cinquante
six, par ordonnance du roy rédigées en 1556. Extraict
des registres de la Court de Parlement. Présentées par
maistres Christofle de Thou, Président, Barthelemy Faye, &
Iacques Viole, Coseillers, en la court de ceans, en la presence du Procureur
general du Roy, le vingtsixiesme Iuing. M.D.LVIII [4+60 folios;
avec un poème en latin de Claude CASSEGRAIN, lieutenant-général
d’Étampes], Paris, Jean Dallier, 1557 [dont une remarquable réédition
numérique en mode image: François JOUSSET
[éd.], «Coutumes des baillages et prévosté
d’Etampes», in Stampae, http://www.stampae.org/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=fr&diapo_id=6&diapo_page=1,
2006.
CLXXXV. N’est
loisible à personne faisant sa demourance en la ville d’Estampes
tenir bestes à laine, porcs, oyes, & canes,
[f°25] sur peine de confiscation
desdites bestes, oyes & canes, & d’amende arbitraire..—
CLXXXV.
Peuuent neanmoins les bouchers pour la fourniture de ladite ville,
tenir en icelle lesdites bestes à laine pour huit iours seulement,
& sont tenuz iceux bouchers tuer leurs bestes sur la riuiere & non
en leurs maisons.
|
Dom Basile FLEUREAU
(1612-1674), «XXVII. Divers
Privileges accordez aux habitans d’Estampes par
le Roy Louis VII» [charte de
Louis VII de 1155 affranchissant les bouchers d’une mauvaise coutume], «XXIX. Des choses
memorables arrivées à Estampes sous
le regne de Philippe II. surnommé Auguste» [charte de 1186
dédommageant par une rente perpétuelle Hugues Nascard,
récemment exproprié de sa boucherie, et charte
de 1246 par saint Louis enterinant le transfert de cette rente au
monastère de Villiers] & «XXX.
Des choses memorables arrivées à Estampes
sous le regne de Louis VIII, etc.» [charte de 1274 de la reine
Marguerite en faveur des bouchers étampois, et règlements
des bouchers étampois mis par écrit en 1484], in ID.,
Les Antiquitez de la ville,
et du Duché d’Estampes avec
l’histoire de l’abbaye de Morigny
et plusieurs remarques considerables, qui
regardent l’Histoire generale de France
[in-4°; texte rédigé
en réalité vers 1668], Paris,
J.-B. Coignard, 1683 [dont une réédition
en fac-similé reliée:
Marseille,
Lafittes reprints, 1997; dont une réédition
numérique en ligne
en cours depuis 2001 in
Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2006], pp. 110, 128-129 & 136-138.
Fonds ancien des Archives
Municipales d’Étampes (d’après l’inventaire de 1991 par
Marie-Anne CHABIN que nous avons mis en ligne: http://www.corpusetampois.com/cbe-20-ame-aa1990chabin.html#08boucherie).
AA 168: Ordonnances
royales relatives à l’adjudication de la viande de carême,
1734 [3 pièces; procès-verbaux d’adjudication de la viande
de carême, 1732, 1733, 1736, 1770-1784].
AA 169: Deux mémoires sur la
viande de carême, s.d. [XVIIIe s.] [note manuscrite: Hôtel-Dieu
de Paris]
AA 170: Adjudication de la viande de carême;
convocation de deux rapporteurs parmi les maîtres boulangers
pour relever chaque semaine le cours du pain sur le marché, 1765-1768
[4 pièces].
AA 171: Police des foires et marchés,
règlement de boucherie [ordonnance de police du 7 avril 1759
portant exclusion des bouchers de campagnes; requête des bouchers
de campagnes contre les bouchers des villes, pétition pour la
non-exécution de l’ordonnance de 1759; mémoire populaire
en faveur des bouchers de campagne].
AA 172-177: Dossier de la boucherie:
démolition de l’ancienne boucherie. au bout du marché
Notre-Dame, qui gêne la voie publique et se trouve trop près
de l’église, et construction d’une nouvelle boucherie, rue du
Puits-de-la-chaîne, dans le but de “contribuer à l’embellissement
et à la décoration de la ville”.
AA 172: Maison rue du Puits-de-la-Chaîne
acte de vente à François Maitrot, 1758 ; anciens titres
de propriété et de vente; acte d’acquisition par lean
Barrault, de François Borron, d’une maison rue de la Tannerie,
1669 [13 pièces].
AA 173: Projet de démolition et
de construction d’une nouvelle boucherie: requête des habitants
au duc de Vendôme, requête du maire à l’intendant,
au prince de Conti et au duc d’Orléans, délibération
des bouchers, 1698-1761 [7 pièces].
AA 174: Acquisition d’un terrain et cession
de maisons par Jean-Baptiste Delisle, Pierre Guétard et François
Maitrot à la communauté des bouchers pour la construction
d’une nouvelle boucherie, 1759-1761 [6 pièces].
AA 175: Devis pour travaux de démolition
et de construction, 1761.
AA 176: Approbation par l’intendant de
la démolition de l’ancienne boucherie, 1762.
AA 177: Travaux procès-verbal
de visite de l’ancienne boucherie, adjudication des travaux, procès-verbal
de réception des travaux de la nouvelle boucherie, 1762 [4
pièces.]
|
Léon
MARQUIS, «Usages» [Coutumes d’Étampes,
§185-186], «Industrie et commerce» [résumé des données de Fleureau],
«Place Dauphine» [où se serait dressée encore
en 1825 la Boucherie de Philippe Auguste, qu’il conjecture avoir été
reconstruite après sa destruction de 1763 puisqu’en 1791 un
bâtiment y appartenait encore à la corporation des bouchers]
& «Rue de la Tannerie» [mention
d’une ruelle de la Boucherie], in ID., Les rues d’Étampes
et ses monuments, Histoire - Archéologie - Chronique - Géographie
- Biographie et Bibliographie, avec des documents inédits, plans,
cartes et figures pouvant servir de suppléments et d’éclaircissement
aux Antiquités de la ville et du duché d’Etampes, de Dom
Basile Fleureau [in-8°; 438 p.; planches; préface de
V. A. Malte-Brun], Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions
en fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions
de la Tour Gile, 1996], pp. 63, 90-91 & 174-176.
Louis-Eugène
LEFÈVRE, «La Grande Boucherie de
Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon, à Etampes», in Bulletin de la Société
Historique et Archéologique de Corbeil, d’Étampes et
du Hurepoix 15 (1909), pp. 32-46. Dont un extrait: La grande
boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Etampes
(XIIe et XVe siècles) [in-8°; 19 p. figure et plan],
Paris, Picard, 1909.
Dont un compte-rendu:
«Etampes. La grande boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel
Saint-Yon, par M. L. Eugène Lefèvre», in Conférence
des sociétés savantes, littéraires et artistiques
du département de Seine-et-Oise. 4e réunion (12/14 juin
1908, Étampes), Versailles, Aubert, 1909 [dont une réédition
numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k664342, en
ligne en 2006], pp. 248-249.
Une curieuse
maison du XIIe siècle, à Étampes, La Grande-boucherie
de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon [“Nous ne citons ici
que pour mémoire, l’étude de M. Lefèvre: elle doit
paraître au complet dans le Bulletin de la Société
archéologique de Corbeil et d’Étampes.”]. Au numéro
15 de la rue de la Tannerie, il existe une maison possédant des
vestiges du XIIe siècle, notamment des colonnes à chapiteau.
L’emplacement de cette construction sur le bord de la rivière
et en [p.249] face d’une boucherie construite
par Philippe-Auguste, en rend l’étude particulièrement
intéressante. Il faut encore ajouter qu’elle est mitoyenne avec
l’Hôtel des Saint-Yon, les célèbres bouchers parisiens.
|
Dont une réédition numérique
en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Louis-Eugène
Lefèvre: La Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel
Saint-Yon à Étampes (1909)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-20-lefevre1909boucherie.html,
2007.
Monique CHATENET, «Halle
de Boucher dite Grande Boucherie, dite Boucherie Royale à Etampes
(91)» [fiche d’inventaire], in Service régional de l’inventaire
Ile-de-France, Inventaire [«Notice» IA00126485],
avant 1987, dont plusieurs édition mises en ligne en 2007.
Aire d’étude:
Etampes.— adresse: Ancienne Comédie (place de l’).— époque
de construction: 4e quart 12e siècle; 3e quart 18e siècle.—
année: 1762.— auteur(s): Pommeret Michel Gabriel (maître maçon),
Gaultier Guillaume (maître charpentier).— historique: Halle des maîtres
bouchers dite grande boucherie d’ Etampes fondée par Philippe Auguste
peu avant 1186; primitivement située place Notre-Dame; démolie
et reconstruite place de l’ ancienne comédie en 1762 par l’ entrepreneur
Jean châtelain sur les plans de Michel Pommeret, maître maçon
et Guillaume Gaultier, maître charpentier; détruite entre 1824
et 1828.— couverture (matériau): tuile.— étages: 3 vaisseaux.—
couvrement: voûte en berceau.— couverture (type): toit à longs
pans.— état: détruit.— date protection MH: édifice non
protégé MH.— type d’étude: inventaire fondamental.—
date d’enquête: 1987 AVANT.— rédacteur(s): Chatenet Monique.—
N° notice: IA00126485.— © Inventaire général, 1986.—
Dossier consultable : service régional de l’inventaire Ile-de-France,
98 Rue de Charonne 75011 PARIS - 01.56.06.51.00.
|
Françoise
HÉBERT-ROUX, «Boucherie et bouchers: une longue tradition»
[13 documents figurés, 19 notes], in ASSOCIATION ÉTAMPES
HISTOIRE, Étampes. Travail des hommes. Images de la ville
[260 p.], Étampes, Association Étampes-Histoire, 1994,
pp. 53-77.
Article fort
bien documenté dont voici le sommaire: Les origines.— Le
tournant du XVIIIe siècle (La viande de carême; bouchers
de la ville contre bouchers de la campagne; la construction d’une nouvelle
boucherie).—Les préoccupations nouvelles du XIXe siècle
(la protection du consommateur; la régulation des prix; le souci
de la salubrité).
Il faut noter que
tout le fonds ancien des Archives Municipales d’Étampes, qui
avait échappé à l’attention de Léon Marquis
en 1881 comme de Louis-Eugène Lefèvre en 1909, depuis
soigneusement classé par Marie Anne-Chabin en 1991, a été
minutieusement étudié et utilisé par Françoise
Hébert-Roux en 1995, en même temps d’ailleurs que des fonds
plus récents: 1J4 (Inventaire du fonds des Archives révolutionnaires),
5F3 (dossier “Boucherie”), CM 21 (Registre des délibérations
municipales) & 1M 11.1-17 (dossier “Abattoirs”): bref, un véritable
travail de fond.
|
Bernard GINESTE, «Darnatal»,
in Cahier d’Étampes-Histoire n°7 (2005), pp. 119-120 [sur
l’étymologie du lieu-dit Darnatal, «nouvel étal»,
qui nous permet de localiser la nouvelle boucherie instituée par Philippe
Auguste bien loin de son emplacement ultérieur place Notre-Dame, contrairement
à ce qu’en ont écrit tous les auteurs antérieurs].
Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes,
sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste (1668)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b29.html,
2001-2006.
[Avec traduction des chartes de Philippe Auguste et de saint Louis citée
par Fleureau, ainsi que plusieurs notes et hypothèses nouvelles sur
la boucherie étampoise au Moyen Age]
Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes,
sous le regne de Louis VIII, Louis IX & Philippe le Hardy (1668)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b30.html,
2006.
[Avec traduction de la charte de la reine Marguerite,
paraphrase du règlement
des bouchers étampois, et annotation des documents édités
par Fleureau, ainsi que plusieurs notes et hypothèses nouvelles
sur la boucherie étampoise au Moyen Age].
Sur
l’Hôtel Saint-Yon
Monique CHATENET, «Maison dite Petit Hôtel
Saint-Yon à Etampes (91)» [fiche d’inventaire],
in Service régional de l’inventaire Ile-de-France, Inventaire
[«Notice» IA00126518], avant
1987, dont plusieurs édition mises en ligne en 2007.
Catégorie:
Maison.— aire d'étude: Etampes.— adresse: Tannerie (rue de la) 15.—
parties constituantes: cour; lavoir; jardin potager.— époque de construction:
1er quart 16e siècle; limite 16e siècle 17e siècle.—
année: 1736.— auteur(s): maître d'œuvre inconnu.— historique:
Ensemble hétérogène; façade sur rue conservant
deux baies du début du 16e siècle; arc sur cour de l' allée
construit vers 1600, portant un graffiti: bonnet 1736; lavoir remployant
des colonnes datant peut-être du 12e siècle et un dormant sculpté
de 1600 environ.— gros-œuvre: calcaire; grès; pierre de taille; moellon
sans chaîne en pierre de taille; enduit; pan de bois.— couverture
(matériau): tuile mécanique; tuile plate.— étages:
sous-sol; 1 étage carré.— décor: menuiserie.— couverture
(type): toit à longs pans; appentis.— escaliers: escalier demi-hors-œuvre;
escalier en vis sans jour; en charpente.— propriété privée.—
date protection MH: édifice non protégé MH.— type d'étude:
inventaire fondamental.— date d'enquête: 1987 AVANT.— rédacteur(s):
Chatenet Monique.— N° notice: IA00126518.— © Inventaire général,
1986.— Dossier consultable: service régional de l'inventaire Ile-de-France
98 Rue de Charonne 75011 PARIS - 01.56.06.51.00.
|
Monique CHATENET, «Maison,
15, rue de la Tannerie», «L’hôtel dit de Saint-Yon, 17
rue de la Tannerie» & «De la Grande Boucherie aux abattoirs»,
in Julia FRITSCH & Dominique HERVIER [dir.],
Étampes, un canton entre Beauce et Hurepoix [316 p.],
Paris, Éditions du Patrimoine, 1999, p. 140 (et n. 436 p. 283) [les
colonnes dont fait état Lefèvre seraient tout simplement des
remplois.]; pp. 142-144 (et nn. 441-448 p. 283); pp. 194-197 (et nn. 655-674
pp. 286-287).
|
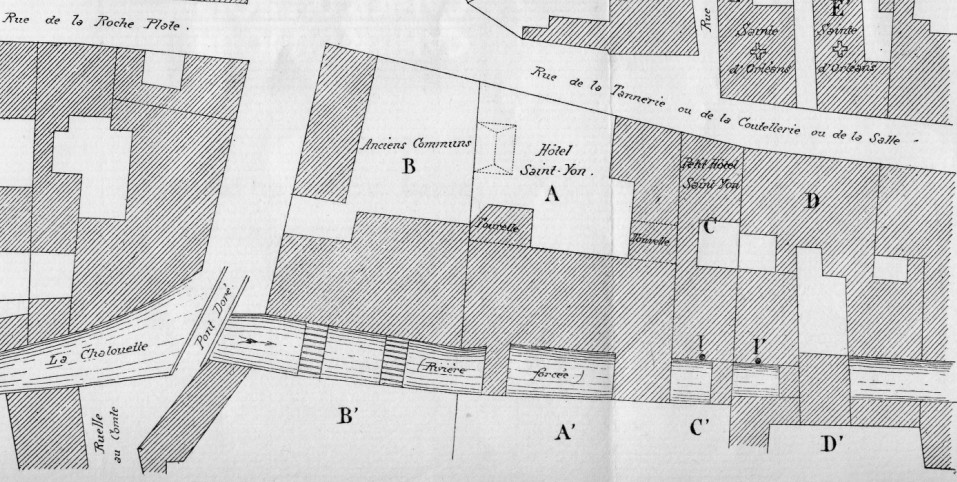
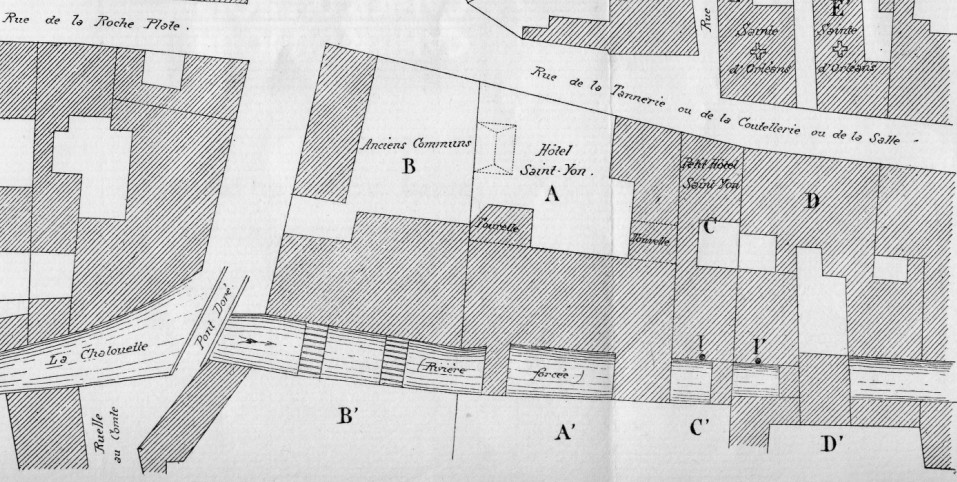
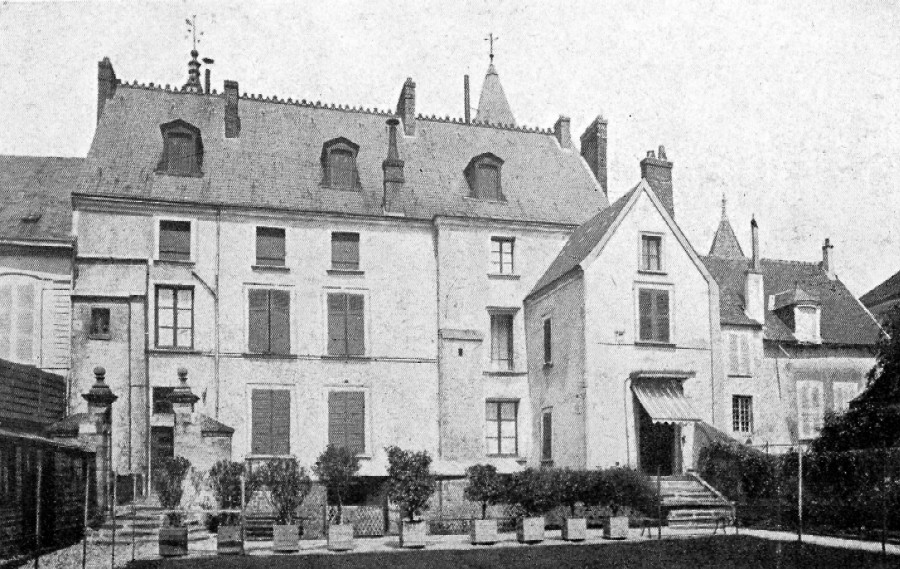
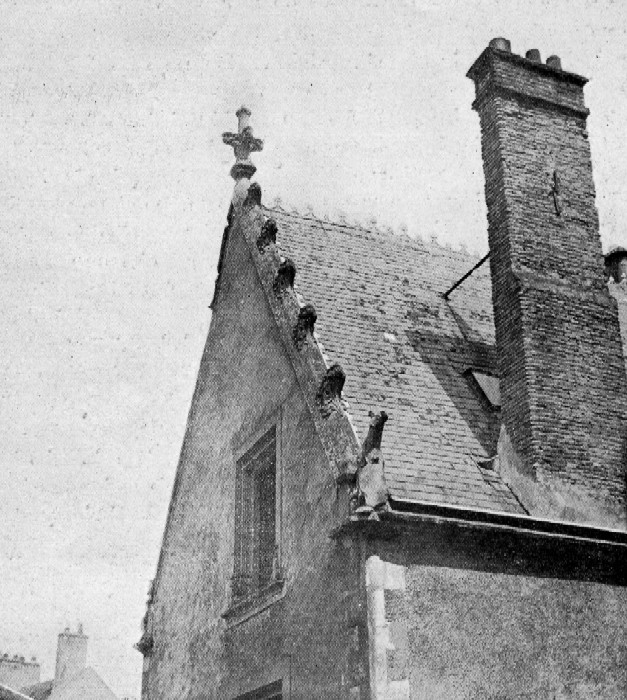
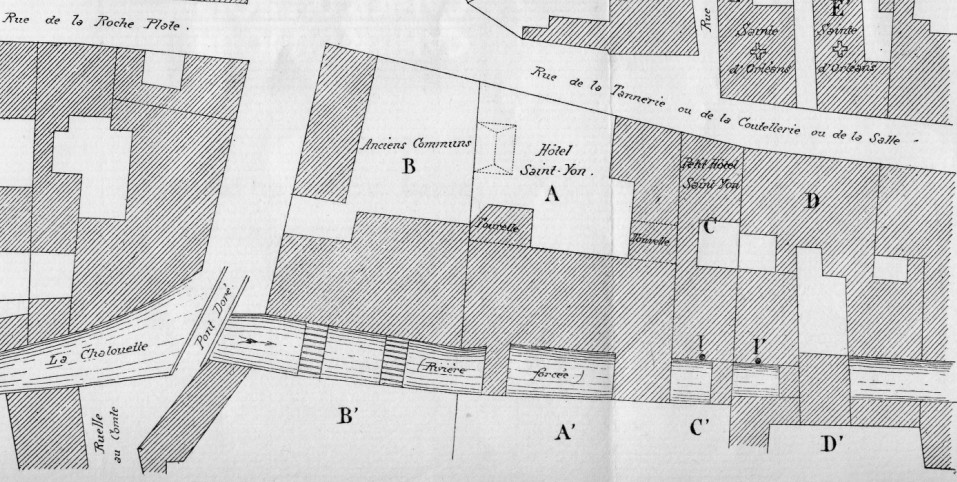
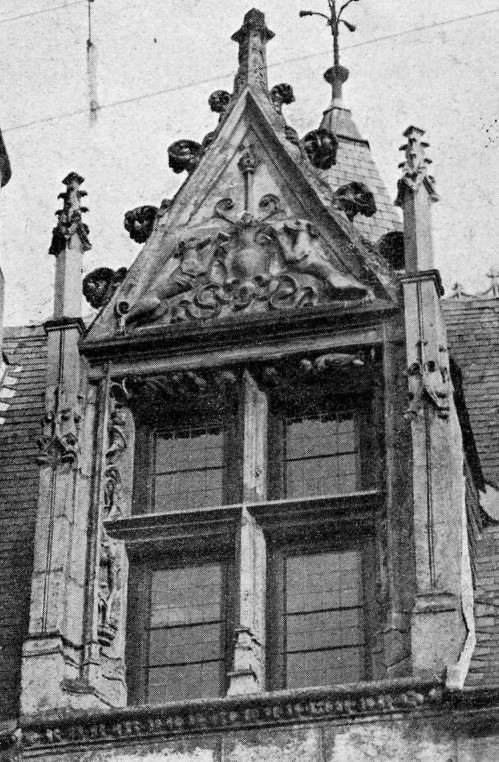

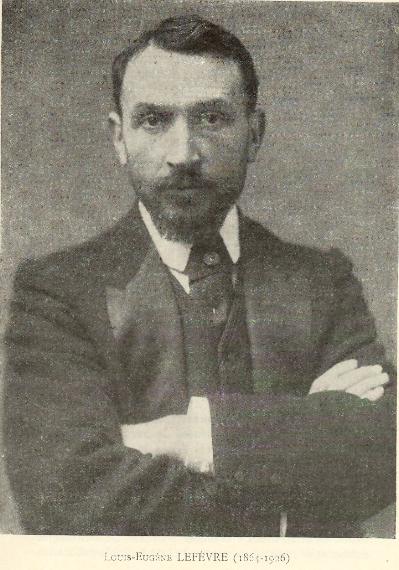 Sur Louis-Eugène Lefèvre
Sur Louis-Eugène Lefèvre