|
Parlement de Paris
Décision sur l’affaire Pasquette
Milet
29 juillet 1630
|
Préface
En 1630, ou peu de temps
auparavant, il arriva qu’un paroissien de Saint-Martin, de nuit, décapita
une dizaine d’arbres qu’avait
dans un pré une pauvre veuve, Pasquette Milet. La veuve requit et
obtint du bailli d’Étampes qu’il soit donné ordre au curé
de proclamer que toute personne qui connaîtrait le ou les coupables
et ne les dénoncerait pas serait passible d’excommunication.
Cependant le coupable pris de remord était
venu s’accuser en confession de son forfait, et il avait demandé
au curé de s’entremettre pour réparer le dégât
en son nom, sans le faire connaître. Le curé ne publia donc
pas la lettre
monitoire, par charité chrétienne,
en bon pasteur et pour tenter de concilier avant cela ses ouailles; aussi,
probablement, par scrupule de conscience, car il lui était impossible
de traiter en excommunié le coupable sans trahir le secret de la
confession.
Comme il faisait traîner les choses,
la veuve le cita devant le prévôt. Il fit alors connaître
l’offre de son pénitent, mais notre veuve refusa cet arrangement,
parce qu’elle voulait connaître ceux qu’elle appelait ses “ennemis
secrets”; elle exigea la publication de la lettre monitoire par le curé;
le prévôt, puis le bailli donnèrent raison au curé;
elle fit appel au tribunal de Chartres, qui cassa la décision des
autorités étampoises; le curé fit donc appel à
son tour. Au Parlement de Paris cependant, l’avocat général
Omer Talon, dont l’éloquence était célèbre autant
que la piété, soulignant l’importance de cette affaire qui
devait faire jurisprudence, demanda à la Cour de débouter le
curé de son appel et d’exiger la publication du monitoire.
Ainsi fut fait. Cette décision finale
fut motivée avant tout par des considérations d’intérêt
général; mais elle s’autorisait aussi d’une considération
tirée du droit canon lui-même, qui avait déjà
envisagé, depuis le XIIIe siècle, une situation de ce genre.
Nous ne connaissons pas pour l’instant la
suite de cette affaire des plus pittoresques, et instructives.
Bernard Gineste, novembre 2008
|

L’avocat général Omer Talon
(peint par Philippe de Champaigne en 1649)
|
|
XLVIII.
Jugé par arrêt rendu au parlement
de Paris, le 19. juillet 1630. qu’un curé ne peut refuser la publication
d’un monitoire (1), sous prétexte que
le coupable lui a donné charge en confession d’offrir des dommages
& intérêts.
Extrait des arrêts de ce parlement,
recueillis par maître Bardet (2), chapitre
116. du troisieme livre du premier tome, page 473. & suivantes.
|
(1) Dictionnaire de l’Académie (éd.
de 1831): “Monitoire. s. m. Lettres d’un Official de l’Évêque,
ou autre Prélat ayant juridiction, pour obliger par censures ecclésiastiques,
tous ceux qui ont quelques connaissance d’un crime ou de quelque autre
fait dont on cherche l’éclaircissement, de venir à révélation.
On a publié un monitoire dans toutes les paroisses.
Le juge a ordonné que l’Official décerneroit un monitoire.
Fulminer un monitoire. Jeter un monitoire. Ces deux mots ne signifient
que publier des lettres en forme de monitoire. On dit aussi, Des lettres
monitoires; et alors monitoire est adjectif.”
(2) Sur le recueil
de Pierre Bardet, voyez notre bibliographie. |
Pasquette Milet (3), pauvre veuve de la ville
d’Etampes, avoit un pré proche de ladite ville, dans lequel il y
avoit quantité d’arbres. Certaines personnes entrèrent nuitamment
dans ledit pré, & y coupèrent & abattirent douze arbres
par le pied, à cinq ou six pieds de terre (4). Ladite Milet rendit sa plainte au juge [c.1065] prévôt d’Etampes (5), qui lui permit d’informer, & d’obtenir lettres
monitoires (1) en forme de droit (6), pour avoir preuve & révélation
(7) de ce fait. En exécution, elle mit
lesdites lettres monitoires ès mains de maître Noël Baudry,
prêtre, curé de la paroisse de saint Martin d’Etampes (8), lequel après avoir long-temps différé
la publication desdites lettres monitoires, même y ayant été
condamné par sentence dudit juge, prévôt d’Etampes, vint
à révélation (9), &
déclara qu’il avoit oui en confession un certain quidam qui étoit
coupable de la coupe des arbres de ladite Milet, à laquelle il offroit
de satisfaire & payer les dépens, dommages & intérêts
résultans de la coupe desdits arbres, au dire de gens à ce
connoissans (10), au nom & acquit (11) de celui qu’il avoit oui en confession, qu’il
n’étoit point obligé de nommer; & requit qu’on n’eût
à passer outre (12) à la publication
des lettres monitoires. Sur quoi le prévôt d’Etampes ayant
égard aux offres dudit Baudry, le condamna aux dommages & intérêts
de ladite Milet, au dire de gens à ce connoissans, & le déchargea
de la publication & fulmination (13) desdites
lettres monitoires, sans dépens (14),
dont ladite Milet interjetta appel pardevant le bailli d’Etampes (15), qui confirma la sentence du prévôt,
& néanmoins enjoignit au curé d’admonester son pénitent
de ne plus récidiver & commettre tels actes. Ladite Milet derechef
interjetta appel pardevant les présidiaux de Chartres (16), lesquels infirmèrent les sentences des
prévôt & bailli de Chartres [Lisez:
d’Étampes], & icelles émendant & corrigeant,
sans avoir égard aux offres dudit Baudry, curé, le condamnèrent
à passer outre à (12) la publication
& fulmination des lettres monitoires obtenues par ladite Milet, &
condamnèrent ledit Baudry aux dépens, dont il interjetta appel,
pour lequel maître Germain (17) dit, que
la charité & le zèle fervent de l’appellant, qui comme
un bon pasteur s’efforce de maintenir tous ses paroissiens en union, amitié
& concorde, & d’étouffer & assoupir leurs dissensions
& querelles, lui ont causé ce procès, en quoi il est d’autant
plus louable, qu’il combat pour le seul zèle & affection d’un
véritable pasteur, & non pour remporter aucun profit pécuniaire
ni gain [c.1066] mercenaire; & tout au contraire
si l’intimée (18) ne conteste pas pour
son intérêt, ni pour aucun profit pécuniaire, puisqu’on
lui offre de payer ses dommages & intérêts justes &
raisonnables; mais elle conteste pour assouvir sa passion, & par une
seule vindicte (19), pour faire punir celui
qui a coupé ses arbres, en quoi elle ne peut de rien profiter, sinon
de contenter sa passion. Pœnæ non irrogatæ indignatio
solam duritiam continet, dit le jurisconsulte (20). Elle n’y est pas même recevable, puisque
la punition des crimes & la vindicte publique n’est point en la bouche
des particuliers, qui n’ont autre intérêt que le pécuniaire,
mais en celle de messieurs les gens du Roi (21),
qui seuls peuvent poursuivre l’intérêt public & la punition
des crimes, par mort ou autre peine afflictive aux coupables. Le crime dont
est question, est si léger, qu’on ne le peut pas véritablement
qualifier du nom de crime: il s’agit seulement de la coupe de quelques arbres
de mort bois (22) qui ne portoient aucun fruit.
Pour cela on veut obliger l’appellant à fulminer des lettres monitoires,
qui est le glaive & la censure de l’église, laquelle ne s’en
sert que pour des crimes atroces, importans & scandaleux, & non
pour des choses de si peu de valeur & de conséquence, la partie
étant même entiérement désintéressée.
L’appellant a eu la connoissance de ce prétendu crime par la confession
auriculaire (23) de celui qui en est coupable;
il ne lui est pas permis sous peine de sacrilege de le révéler,
ce que néanmoins l’intimée desire contre toute équité
& justice. Et conclut à ce que la sentence des présidiaux
de Chartres soit infirmée, & celle du bailli d’Etampes confirmée.
Maître Robert le jeune (24) dit pour
l’intimée (18), que l’appellant sous
le voile d’un zèle & d’une charité mal ordonnée,
s’efforce de couvrir un crime, & de lui procurer l’impunité, &
par une affection trop grande, se rend aucunement complice de ce crime, que
l’appellant qualifie si léger; mais tout au contraire il est grand
& plein de malice (25), de sévir même
sur les choses insensibles & inanimées pour assouvir sa passion
& sa rage. Les loix l’ont jugé tel, quand elles ont prescrit,
que celui qui en seroit convaincu, pût être condamné en
un bannissement ou autre peine semblable. [c.1067] Cela sert de réponse à ce que
l’appellant a dit, que l’intimée n’a autre intérêt que
le sien pécuniaire; mais sa cause regardant plus l’intérêt
public que le sien propre, elle en est d’autant plus favorable, elle a grand
intérêt de connoître & savoir qui sont ses ennemis
secrets qui peuvent attenter sur sa vie, desquels autrement elle ne peut se
garantir. Si elle avoit affaire à un juge ecclésiastique (26), qui eût voulu prendre connoissance (27) de la publication de ses lettres monitoires, &
des oppositions qui auroient pu y être formées, elle feroit déclarer
abusif tout ce qu’il auroit entrepris; à bien plus forte raison un
curé qui ne peut ni ne doit prendre aucune connoissance de cause
(28), & doit passer outre à la publication
& fulmination des lettres monitoires, sans s’informer d’autre chose.
D’alléguer qu’il a eu révélation de ce crime en confession
auriculaire, & qu’il n’est point obligé de nommer celui qui l’a
commis; on ne lui demande pas qu’il nomme ni indique son pénitent,
mais seulement qu’il fasse sa charge, en publiant les lettres monitoires,
sans qu’il soit obligé de venir à révélation,
en cela il ne peut se plaindre. Et conclut au bien jugé.
|
(3) Pasquette Milet. Non documentée
pour l’instant.
(4) C’est à
dire à une hauteur comprise entre un mètre et demi et deux
mètres. On notera que plus bas l’avocat général parlera
seulement de neuf arbres et non de douze.
(5) Le prévôt
d’Étampes était alors probablement Léon Laureau, cité
comme tel en 1627, plutôt qu’Accurse Cassegrain, cité en
1632 (Plisson, Rapsodie, vers 1680, cité par Marquis, Les
rues d’Étampes, 1881, p. 425).
(6) En forme de
droit. Avec les formes légales requises.
(7) Pour avoir preuve
et révélation. Selon Littré, “En terme d’officialité:
on publia des monitoires pour avoir révélation
de telle chose”.
(8) D’après
des notes inédites de Frédéric Gatineau, ce Noël
Baudry, aussi chanoine de Sainte-Croix d’Étampes, était depuis
au moins 1622 curé de saint-Martin, dont il avait été
précédemment vicaire; il mourut ou cessa ses fonctions vers
1637.
(9) Vint à
révélation. Se manifesta.
(10) Gens à
ce connoissans. Experts.
(11) Au nom & acquit.
Selon le Dictionnaire de l’Académie, édition de 1765, “acquit”
signifie “quittance, décharge”, et “on dit, Payer une chose à
l’acquit d’un autre, pour dire, La payer à la décharge d’un
autre.” Il faut donc comprendre “pour le compte de”.
(12) Passer outre
à quelque chose, comme on le voit par ce passage, ne veut pas
du tout dire négliger quelque chose, comme le croient certains,
mais bien au contraire l’entreprendre.
(13) Ces deux termes
sont en fait synonymes.
(14) Sans savoir à
payer les frais de procédure.
(15) Le bailli d’Étampes
était alors “Pierre du Bois, chevalier, seigneur de La Fayette (…)
conseiller du roy, gentilhomme de sa chambre, bailly et gouverneur d’Estampes”
(Plisson, Rapsodie, vers 1680, cité par Marquis, Les rues
d’Étampes, 1881, p. 424). Nous avons déjà mis en
ligne l’une de ses décision en date du 3 juillet 1629, pour le remplacement
du principal du collège, Walfard (cliquez ici).
(16) Les présidiaux
étaient des tribunaux créés en 1151 par Henri II dans
chaque bailliage ou sénéchaussée. Il apparaît
ici que l’on pouvait faire appel du jugement donné par un bailli au
présidial d’un bailliage voisin.
(17) Maître Germain
défend les intérêt de Noël Baudry à Chartres,
puis à Paris.
(18) De nos jours encore
on appelle l’intimé celui qui est poursuivi par son adversaire dans
une juridiction d’appel.
(19) Par une seule
vindicte. Seulement par vengeance.
(20) Citation des Digestes
de Justinien, dont le texte latin édité Mommsen & Krueger
a été mis en ligne par l’Université de Grenoble (cliquez ici). Traduction de cet aphorisme: “L’indignation
devant le fait qu’une peine n’ait pas été prononcée
n’est inspirée que par la dureté”.
(21) Les gens du
roi. Les officiers royaux, c’est-à-dire publics.
(22) Mort bois.
Me Germain est ici de mauvaise foi. Selon le Traité du voisinage
de Fournel et Tardif (Paris, Videcoq, 1834, p.529):
«Quant au mort-bois (qu’il ne faut pas
confondre avec le bois mort), on entend par là certaines espèces
de bois de petite essence, moins précieuses que les autres, et qui
ne paraissent propres qu’au chauffage, faute d’une destination plus utile.
L’indication de ces espèces a fait, pendant long-temps, la matière
de contestations; mais elles ont été fixées irrévocablement
par l’article 5 du titre 23 de l’ordonnance du mois d’août 1669, aux
NEUF suivantes, qui sont, 1re. saule; 2e. morsault; 3e. épines;
4e. puisne; 5e. sureau; 6e. aulnes; 7e. genêts; 8e genièvres;
9e. ronces. C’est donc à ces neuf espèces qu’il faut rigoureusement
réduire le mort-bois, sans aucune extension. Quelques usagers ont
voulu appliquer la qualité de mort-bois au charme, tremble, bouleau,
érable, comme étant des arbres ne portant fruits. Mais ce
système [p.530] a
toujours été rejeté; et la table de marbre de Dijon
ayant rendu deux arrêts, les 6 et 10 juillet 1748, qui mettaient le
charme dans la classe des morts-bois, ils furent cassés par un arrêt
du conseil d’état du 10 septembre suivant, comme étant en contravention
aux dispositions limitatives de l’article 5 du titre 23 de l’ordonnance du
mois d’août 1669.» Et les auteurs poursuivent en note: «La
distinction d’arbres ne portant fruits est vicieuse; I.° Parce que la
plupart des morts-bois portent de véritables fruits, tel que le genévrier,
le sureau, le genêt, la ronce; 2.° En ce qu’il n’y a pas d’arbre
ni de végétal qui, à proprement parler, n’ait son
fruit et sa graine par lesquels il se multiplie; 3.° Si la stérilité
, prise dans le sens ordinaire de la privation de fruits, caractérisait
les morts-bois, il ne resterait donc aux propriétaires les forêts
que les chênes, les châtaigniers et les hêtres; tout
le reste serait livré au pillage. C’est ce que les ordonnances ont
voulu prévenir en reduisant le mort-bois à neuf espèces.»
(23) Dans le christianisme
primitif n’avait cours que la confession publique par les pénitents
de leurs péchés les plus scandaleux, tout d’abord en préalable
au baptême, puis, plus tard, à titre exceptionnel et non
renouvelable. C’est au cours du moyen âge seulement que s’introduisit
progressivement l’usage de confesser régulièrement ses fautes
en tête à tête, à l’oreille pour ainsi
dire d’un prêtre, afin d’en recevoir régulièrement
l’absolution sacramentelle.
(24) Maître Robert
le jeune défend les intérêts de Pasquette Milet à
Chartres, puis à Paris.
(25) Malice
ne signifie encore que “perversité”, au XVIIIe siècle.
(26) Un juge ecclésiastique.
La juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique ont des
compétences distinctes, la seconde s’intéressant aux affaires
qui relèvent du droit canon interne à l’Église, quoique
dans la société profondément chrétienne de
l’Ancien Régime surgissent parfois entre elles des conflits de compétence.
Ainsi l’ordre donné à un curé de publier un monitoire,
qui fait appel à la conscience des fidèles et les menace
de sanctions ecclésiastiques relève-t-elle de la compétence
des autorités civiles lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit commun.
(27) La connaissance
en termes de procédure est le droit de connaître et de juger,
et, en d’autres termes, la compétence ou le ressort.
(28) Qui ne doit se
mêler d’aucune procédure.
|
Monsieur l’avocat général Talon (29)
dit, que la cause est nouvelle, toute publique (30)
& très-importante; c’est un nouvel artifice de ceux qui ont autrefois
soutenu qu’ils n’étoient point obligés à l’exécution
des mandemens de justice, & qui veulent renouveller le même langage,
si la cour n’y donne ordre. L’appellant, comme curé de saint Martin
d’Etampes, a été chargé des lettres monitoires pour
les publier & fulminer: il veut s’en décharger sous prétexte
qu’il offre de lui payer ses dépens, dommages & intérêts;
ce qui n’est pas raisonnable, parce que la cause va plus loin que les dommages
& intérêts de l’intimée: elle regarde tout le public
qui s’y trouve blessé. Si cela est toléré, c’est le
vrai moyen à l’avenir de mettre toute sorte de crimes, où
il n’y aura eu personne de morte, à couvert & dans l’impunité,
par de semblables déclarations, d’avoir oui le coupable en confession,
& offres de dommages & intérêts de sa part, ou en
son lieu & place. La confession est un regret d’avoir offensé
Dieu, d’avoir commis [c.1068] un crime, c’est
une satisfaction envers Dieu; mais non point envers les hommes, auxquels
Dieu commande qu’on satisfasse pareillement, autrement la satisfaction qu’on
lui a faite, est nulle. La confession n’empêche point la recherche
& la poursuite d’un crime, autrement il seroit facile de le couvrir,
ou par une véritable, ou par une simulée confession; ce qui
seroit d’une trop périlleuse conséquence. D’obliger un confesseur
à révéler le secret d’une confession, ce seroit un sacrilege;
mais qu’un confesseur, personne publique, sous prétexte d’avoir oui
une personne en confession, se puisse exempter de son ministere & de
sa charge publique, ou à tout le moins empêcher qu’un autre
ne la fasse & exerce, comme les présidiaux de Chartres ont ordonné,
que l’appellant publieroit ou feroit publier les lettres monitoires, il
n’y a aucune apparence (31). Si un official
(32) avoit entrepris la moindre connoissance
touchant des lettres monitoires, la cour déclareroit abusif tout
ce qu’il feroit: donc à plus forte raison un curé, qui n’a
qu’un simple ministere sans jurisdiction quelconque; & ainsi il y a
lieu de confirmer la sentence; toutefois, s’il plaît à la cour
de décharger l’appellant de la condamnation des dépens, puisqu’il
n’y a pas procédé par malice.
|
(29) L’avocat général Talon. Omer Talon
(vers 1595-1652), avocat général au Parlement de Paris, père
de Denis Talon (1626-1698), lui aussi avocat général, puis
président à mortier. Ses Mémoires ont connu deux
éditions (1732, 1827). Les Plaidoyers et Discours d’Omer et Denis
Talon ont été aussi édités en 1821.
(30) C’est-à-dire
qu’elle soulève une question d’intérêt général,
et nécessite à ce titre son intervention.

L’avocat général Omer Talon
(peint par Philippe de Champaigne en 1649)
(31) Aucune raison
valable.
(32) Un official
est un juge ecclésiastique délégué par l’évêque
pour exercer sa juridiction contentieuse.
|
LA COUR de grâce (33) mit
l’appellation au néant, ordonna que ce dont étoit appel, sortiroit
son plein & entier effet (34), & condamna
l’appellant aux dépens de la cause d’appel. Le lundi vingt-neuf
juillet mil six cent trente. Monsieur le président le JAY (35) prononçant.
***
Du Fresne
(36) rapporte le même arrêt dans
le chapitre 79. du second livre de son recueil, avec quelques circonstances
que Bardet (2) n’a pas rapportées, lesquelles
peuvent être remarquées, on le cite dans l’imprimé comme
du 29. juin, c’est une faute de l’imprimeur ou du copiste, il est du 29.
juillet, voici ce qu’il en écrit.
|
(33) “La Cour de grâce mit…”, et plus
loin: “la Cour mit de grâce…” Selon G. Cayrou (Le français
classique. Lexique de la langue du XVIIe siècle, Paris, Didier,
1924, p. 445), l’expression “de sa grâce” signifie “de son propre
gré, sans y être prié”. La Cour a été plus
loin que les réquisitions de l’avocat général.
(34) Sortir son
effet. Usage transitif rare du verbe sortir, non documenté par
les dictionnaires que j’ai pu consulter.
(35) Nicolas le Jay
(1573-1640), président de la Grande Chambre du Parlement de Paris
(1613-1630), premier président au Parlement (1630-1636), garde des
Sceaux (1636-1640).
(36) Jean Du Fresne
est l’auteur d’un Journal des principales audiences du Parlement,
tenu de 1623 à 1661, qui a connu plusieurs rééditions,
augmentations et continuations jusqu’en 1757. Voyez notre bibliographie.
|
Le lundi 19. juin 1630. jugé en confirmant la sentence des présidiaux
de Chartres, qui avoient infirmé celle du prévôt,
du bailli d’Etampes, qu’un curé, à qui une monition, à
la [c.1069] d’une veuve, est adressée,
pour la publier & fulminer, ne peut refuser d’en continuer les publications
& fulminations, sous prétexte que le coupable du crime s’est
venu confesser à lui, & l’a prié d’offrir en son nom tous
les dommages & intérêts, ce qu’il avoit fait, conformément
aux conclusions de monsieur l’avocat général Talon (29), encore que le crime pour la révélation
duquel la monition avoit été obtenue, ne fut que pour raison
de neuf arbres coupés en un pré, à quatre ou cinq pieds
de hauteur, & que pour raison de ce crime, le curé eût
offert à la partie, sur le mandement de son pénitent, ses dommages
& intérêts.
L’arrêt
est fondé sur ce qu’il n’est loisible à un curé, ou
autre ecclésiastique, d’éteindre ou supprimer la preuve
d’un crime qui va à la discipline publique, sous prétexte
de confession, & de quelque satisfaction offerte; que ce seroit une
ouverture pour étouffer & empêcher la preuve de tous les
crimes. La décision en est formelle au chapitre 2. de officio judicis
ordinarii (37), qui dit expressément,
potest excommunicare auctorem damni, licet etiam ei confessus
sit sed tamen non nominatim, quia non ut judex scit, sed ut Deus (38), plaidans Germain le Jeune (17) pour le curé appellant, & Robert
pour la veuve (24). Est à remarquer
que la cour mit de grâce (33) l’appellation
au néant, & ordonna que ce dont étoit appelle sortiroit
son effet (34), l’appellant, qui étoit
le curé, condamné aux dépens de l’appel. |
(37) Le De officio judicis ordinarii (“De l’office
de juge ordinaire”) est une section des Décrétales
de Grégoire IX rédigées par le dominicain Raymond de
Peñafort (mort en 1275), recueil de référence en matière
de droit canon. Il est fait référence ici au chapitre II du
titre XXXI du livre premier, à la page 397 de l’édition de
1582, dont le texte a été mis en ligne en mode image par l’université
de Californie (cliquez ici). En voici le texte exact: “Si sacerdos
sciat pro certo aliquem esse reum alicuius criminis: vel si confessus fuerit,
& emendare noluerit: nisi judiciario ordine quis probare possit: non
debet eum arguere nominatim, sed indeterminate: sicut dixit Christus: Unus
vestrum me traditurus est. Sed si ille cui damnum illatum est, petierit justitiam,
potest excommunicare auctorem damni, liceat etiam ei confessus sit: sed
tamen non nominatim potest eum removere à communione, liceat sciat
eum esse reum: quia non ut judex scit sed ut Deus: sed debet eum admonere,
ne se ingerat: quia nec Christus Judam à communione removit.”
Traduction (B.G., 2008): “Si un prêtre apprend avec certitude que
quelqu’un est coupable d’un crime, ou s’il s’est confessé et ne veut
pas donner satisfaction tant que quelqu’un n’aura pu le prouver d’une manière
judiciaire, il ne doit pas en parler d’une manière nominative mais
seulement indéterminée, de même que le Christ a dit:
L’un de vous me trahira. Mais si celui à qui le dommage a été
porté demande justice, il peut excommunier l’auteur de ce dommage
bien qu’il se soit confessé à lui; cependant il ne peut pas
l’exclure nominativement de la communion bien qu’il sache qu’il est coupable,
parce qu’il le sait non pas en temps que juge, mais du point de vue de Dieu;
mais il devra l’exhorter à ne pas s’y introduire. En effet même
le Christ n’a pas exclu Judas de la communion.”
(38) Traduction: “Il
peut (ce prêtre) excommunier l’auteur d’un dommage, même s’il
le lui a confessé; mais non pas nominativement, car il sait ce qu’il
sait non pas en temps que juge, mais du point de vue de Dieu” (B.G.,
2008). Ceci répond au scrupule du curé de Saint-Martin, qui
ne pourrait traiter son ouaille en excommunié sans trahir le secret
de la confession.
|
|
|
BIBLIOGRAPHIE
PROVISOIRE
1. Éditions de cet arrêt précis
Cet arrêt a d’abord
été édité dans le recueil d’arrêts du
Parlement de Paris donné par Pierre Bardet (en 1632, réédité
en 1773), puis dans celui de Du Fresne (qui a connu au moins six éditions
de 1646 à 1757) et enfin dans celui de Le Genty, qui combine ces
deux sources dans son propre recueil relatif aux affaires
du clergé de France (paru d'abord en 1673
puis trois fois réédité, voire remanié, jusqu'en
1769).
Nous donnons ici donc le texte de la toute dernière
édition de cet arrêt, au tome VII de la quatrième et
dernière édition du dernier de ces trois recueils.
1a) Pierre BARDET (1591-1685) [premier auteur],
Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement de Paris, puis bâtonnier
en 1728) [éd.], Recueil d’arrests du Parlement de Paris, pris
des Mémoires de feu Me Pierre Bardet, avec les notes et dissertations
de Me Claude Berroyer [2 volumes in-f° (40 cm); t.1: XXXVI+619 p.;
t.2: XVI+628+LXX p.], Paris, A. Besoigne, 1632-1642, tome I (1632), 3e livre,
chapitre 116, pages 473- ?.
1b) Réédition: Recueil…
Nouvelle édition revue et augmentée, par M. C.-N. Lalaure
[2 tomes en 1 volume in-f° (XIV+431 p.; 467 p.)], Avignon, P.-J. Roberty,
1773.
2a) Jean DU FRESNE, Journal des principales
audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à présent,
avec les arrests intervenus en icelles, recueilli par Me Jean Du Fresne
[in-4°], Paris, H. Le Gras, 1646, second livre, chapitre 79.
2b) Réédition.
2c) Réédition: Journal…
troisième édition, Paris, G. Alliot, 1652.
2d) Réédition: Journal…
jusques en 1657, Veuve Gervais Alliot, et Gilles Alliot, son fils,
1665.
2d) Réédition: Journal…
Nouvelle édition, revue. Depuis l’année 1622 jusqu’en 1661
[in-f° (40 cm); XXVIII+951 p.; tome 1; index], Paris, Rollin fils,
1733.
2e) Réédition: Journal…
Depuis l’année 1622 jusqu’en 1660 [in-f°], Paris, David,
1754.
2f) Réédition: Journal…
Depuis l’année 1622 jusqu’en 1660 [in-f°], Paris, Compagnie
des Libraires associés (& Bordelet), 1757.
3a) Jean LE GENTIL, Recueil
des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé
de France, augmenté d’un grand nombre de pièces et mis en
nouvel ordre. Le tout divisé en neuf parties, par Jean Le Gentil,
chanoine et vidame de l’église de Reims,... suivant l’ordre qui lui
en a été donné par les délibérations des
dernières assemblés générales du clergé
[6 volumes in-f°], Paris, A. Vitré, 1673, tome ?, pp. ?-?.
3b) Réédition: Paris, F. Léonard,
1675, tome ?, pp. ?-?.
3c) Réédition: Jean LE GENTIL
[premier auteur], Pierre LE MERRE père (avocat au Parlement) &
Pierre LE MERRE fils [continuateurs], Recueil des actes, titres et mémoires
concernant les affaires du clergé de France, augmenté d’un
grand nombre de pièces et d’observations sur la discipline présente
de l’Église, et mis en nouvel ordre suivant la délibération
de l’assemblée générale du clergé du 29 août
1705; le tout divisé en 9 parties, par Jean Le Gentil. Le même,
augmenté d’un grand nombre de pièces et d’observations sur
la discipline présente de l’Eglise. Tome
Septieme. Suite de la quatrieme partie qui est de la Jurisdiction ecclésiastique
volontaire, gracieuse et contentieuse, civile et criminelle [XVI+1628
colonnes], Paris, Vve F. Muquet, vers 1730, colonnes 1064-1069.
3d) Id., Paris,
Guillaume Deprez & Avignon, Jacques Farrigan, 1769, colonnes 1064-1069.
3e) Dont une réédition
numérique de cette dernière édition mise en ligne par
Google, http://books.google.fr/books?id=zmQOAAAAQAAJ&pg=PRA7-PA1064,M1#PRA7-PA1064,M1,
en ligne en 2008.
3f) Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris:
Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de
Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html,
2008.
2. Éditions du recueil de Bardet
Pierre BARDET
(1591-1685) [premier auteur], Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement
de Paris, puis bâtonnier en 1728) [éd.], [2 volumes in-f°
(40 cm); t.1: XXXVI+619 p.; t.2: XVI+628+LXX p.], Paris, A. BesoigRecueil
d’arrests du Parlement de Paris, pris des Mémoires de feu Me Pierre
Bardet, avec les notes et dissertations de Me Claude Berroyerne, 1632-1642.
Pierre BARDET (1591-1685) [premier auteur],
Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement de Paris, puis bâtonnier
en 1728) [1er éd.], Claude-Nicolas LALAURE [2e éd. & continuateur],
Recueil d’arrêts du Parlement de Paris, pris des mémoires
de feu M. Pierre Bardet, avec les notes et dissertations de M. Claude Berroyer.
Nouvelle édition revue et augmentée, par M. C.-N. Lalaure
[2 tomes en 1 volume in-f° (XIV+431 p.; 467 p.)], Avignon, P.-J. Roberty,
1773.
3. Éditions du recueil de Du Fresne
Ce recueil
constitué progressivement avec des tomes publiés d’abord par
des éditeurs différents, et qui ne sera réellement
publié comme un tout qu’en 1754, a connu plusieurs états, dont
le relevé qui suit, constitué à partir de nombreuses
notices éparses de la BNF, n’est sûrement pas exhaustif.
Jean DU FRESNE, Journal des
principales audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à
présent, avec les arrests intervenus en icelles, recueilli par Me
Jean Du Fresne [in-4°], Paris, H. Le Gras, 1646.
Jean DU FRESNE, Journal des principales
audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à présent,
avec les arrests intervenus en icelles, revu... en cette troisième
édition [in-f°; VIII+682 p. & table], Paris, G. Alliot,
1652.
Jean DU FRESNE, Journal des principales
audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques en 1657, avec
les arrests intervenus en icelles, revu, corrigé et encore augmenté
en cette dernière édition de plusieurs arrests placez selon
l’ordre de leur temps [in-f°], Paris, Veuve Gervais Alliot, et Gilles
Alliot, son fils, 1665.
François JAMET DE LA GUESSIÈRE,
Journal des principales audiences du Parlement depuis l’année
1657 jusqu’en 1667 [in-f°], Paris, Denys Thierry, 1667.
François JAMET DE LA GUESSIÈRE,
Journal des principales audiences du Parlement, depuis l’année
1667 jusques en 1678, avec les arrests intervenus en icelles [in-f°],
Paris, Denys Thierry, 1678.
François JAMET DE LA GUESSIÈRE,
Journal des principales audiences du Parlement, tome 4, contenant
quelques Arrests & reglemens notables qui avoient esté omis des
années 1676 & 1677 dans les tomes précédens; et
depuis 1677 à 1685 [in-f°], Paris, Nicolas Le Gras, 1685.
Jean DU FRESNE, Journal des principales
audiences du Parlement. Nouvelle édition, revue. Depuis l’année
1622 jusqu’en 1661 [in-f° (40 cm); XXVIII+951 p.; tome 1; index],
Paris, Rollin fils, 1733.
François JAMET DE LA GUESSIÈRE,
Journal des principales audiences du Parlement... Nouvelle édition.
Tome II. Depuis l’année 1660 jusqu’en 1674 [in-f°], Paris,
Paris, Rollin fils, 1733.
François JAMET DE LA GUESSIÈRE,
Journal des principales audiences du Parlement. 3, Par François
Jamet de La Guessière,... Depuis l’année 1674 jusqu’en 1685
[in-f° (40 cm); XVIII+1080 p.], F. Le Breton père, 1733.
Nicolas NUPIED, Journal des principales
audiences du Parlement... [tome V], Paris, 1707.
Nicolas NUPIED, Journal des principales
audiences du Parlement... [2 volumes in-f°; tomes IV-V], Paris,
1733-1736.
Jean DU FRESNE (tome 1), François
JAMET DE LA GUESSIÈRE (tomes 2-4), Nicolas NUPIED (tomes 5-6) et
Michel DU CHEMIN (tome 7), Journal des principales audiences du parlement,
avec les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions
et règlemens [7 volumes in-f°: t.1: 1622-1660; t.2: 1660-1674;
t.3: 1674-1685; t.4: 1685-1700; t.5: 1700-1710; t.6: 1711-1717; t.7 (“Supplément
au Journal des principales audiences du Parlement, depuis 1623 jusqu’à
1722 inclusivement”): 1718-1722], Paris, David, 1754.
Jean DU FRESNE (tome 1), François
JAMET DE LA GUESSIÈRE (tomes 2-4), Nicolas NUPIED (tomes 5-6) et
Michel DU CHEMIN (tome 7), Journal des principales audiences du parlement,
avec les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions
et règlemens [7 volumes in-f°: t.1: 1622-1660; t.2: 1660-1674;
t.3: 1674-1685; t.4: 1685-1700; t.5: 1700-1710; t.6: 1711-1717; t.7: 1718-1722],
Paris, Compagnie des Libraires associés (& Bordelet), 1757.
4.
Éditions du recueil de Le Gentil
Jean LE GENTIL,
Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires
du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces
et mis en nouvel ordre. Le tout divisé en neuf parties, par Jean
Le Gentil, chanoine et vidame de l’église de Reims,... suivant l’ordre
qui lui en a été donné par les délibérations
des dernières assemblés générales du clergé
[6 volumes in-f°], Paris, A. Vitré, 1673.
Réédition: Paris, F. Léonard,
1675.
Jean LE GENTIL [premier auteur], Pierre LE
MERRE père (avocat au Parlement) & Pierre LE MERRE fils [continuateurs],
Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires
du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces
et d’observations sur la discipline présente de l’Église,
et mis en nouvel ordre suivant la délibération de l’assemblée
générale du clergé du 29 août 1705; le tout divisé
en 9 parties, par Jean Le Gentil. Le même, augmenté d’un grand
nombre de pièces et d’observations sur la discipline présente
de l’Eglise [13 volumes in-f°; t.1: “De la
Foi catholique et de la doctrine de l’Église”; t.2: “Des Ministres
de l’Église”; t.3: “Des Cures et des curés, et de leurs vicaires
et des autres ecclésiastiques employés dans les paroisses”;
t.4: “Des Ministres de l’Église qui sont réguliers”; t.5: “Du
Culte divin”; t.6: “De la Juridiction ecclésiastique”; t.7: “Suite
de la quatrième partie qui est de la juridiction ecclésiastique
volontaire, gracieuse et contentieuse, civile et criminelle”; t.8: “Contenant
ce qui concerne les Assemblées du clergé; les différents
départements; les receveurs et les bureaux des décimes; les
droits et fonctions des agents généraux du clergé; et
les délibérations pour la conservation de ses archives”; t.9:
“Recueil des contrats passés par le clergé avec nos rois,
au sujet des impositions sur le clergé, et ses receveurs généraux,
pour en faire le recouvrement”; t.10: “Dans lequel on traite: 1° des
qualités requises dans les ecclésiastiques pour être pourvus
des bénéfices, ce qui a donné lieu d’entrer dans le
détail des gradués et de leurs droits; 2° des droits dont
le pape est en possession dans la collation des bénéfices
de France, tant de ceux dont il jouit dans tout le royaume que des usages
particuliers de la province de Bretagne et de celles de la légation
d’Avignon; 3° des droits des évêques de France, suivant
les maximes et la jurisprudence de notre siècle, dans la collation,
union et autres dispositions des bénéfices de leurs diocèses;
t.11: “Dans lequel on traite des droits des rois de France dans la disposition
des bénéfices ecclésiastiques de leurs États,
suivant le Concordat passé entre le pape Léon X et le roi François
premier; de leur droit de régale, de son origine, son étendue,
ses fondements et usage en France; de leur droit de nommer à une
prébende, tant pour leur joyeux avénement à la couronne
qu’après qu’ils ont reçu le serment de fidélité
des évêques; de l’indult qui leur a été accordé
en faveur des chanceliers de France et des officiers du parlement de Paris;
et des autres droits, titres et indults particuliers en exécution
desquels ils disposent des bénéfices ecclésiastiques
de leurs États”; t.12: “Dans lequel on traite: 1° des collateurs
et des patrons particuliers des titres ecclésiastiques; des droits
utiles et honorifiques des patrons et fondateurs, de leurs charges et devoirs,
etc.; 2° des qualités requises pour être pourvu des titres
ecclésiastiques, suivant les saints décrets et les ordonnances
du royaume; 3° des provisions des titres ecclésiastiques, obtenues
soit du pape, ou de ses légats, soit des collateurs ordinaires; 4°
des élections et bénéfices électifs; 5°
des règles et formalités requises en ce qui regarde l’exécution
des titres ecclésiastiques; 6° des procédures et instructions
des procès sur le possessoire des bénéfices” (un volume
d’observations manuscrites est conservé à la BNF); t.13: “Contenant
les cahiers présentés, et les remontrances et harangues faites
aux rois et aux reines par le clergé de France , tant aux États
généraux qu’aux Assemblées générales
et particulières du clergé; ensemble plusieurs édits,
déclarations et arrêts donnés en conséquence
des cahiers et remontrances du clergé”],
Paris, Vve F. Muquet, 1716-1750 & Paris, P. Simon, 1740.
Réédition: Recueil des
actes, titres et mémoires, etc. [13 volumes in-4°], Paris,
G. Desprez, 1768-1771, tome 7 (1769).
5. Sur la paroisse Saint-Martin
d’Étampes
Bernard GINESTE [éd.], «Léon
Guibourgé: L’église
Saint-Martin d’Étampes (1957)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-guibourge1957etampes601eglisesaintmartin.html, 2004.
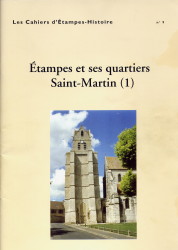 Jacques GÉLIS [dir.], Étampes et des quartiers. Saint-Martin (1) [56
p.; 47 documents figurés dont 1 photographies couleur], Étampes, Association Étampes-Histoire
[«Les Cahiers d’Étampes-Histoire» 9], 2008 [ISSN 1291-7791; 12 € en 2008].
Jacques GÉLIS [dir.], Étampes et des quartiers. Saint-Martin (1) [56
p.; 47 documents figurés dont 1 photographies couleur], Étampes, Association Étampes-Histoire
[«Les Cahiers d’Étampes-Histoire» 9], 2008 [ISSN 1291-7791; 12 € en 2008].
Et spécialement:
Claude ROBINOT, «Saint-Martin
d’Étampes, géohistoire d’un quartier» [3 photographies],
pp. 2-5.
Jacques GÉLIS, «Saint Martin,
un saint populaire», pp. 6-8 [1 photographie].
Jean-Pierre DURAND, «L’église Saint-Martin:
une histoire mouvementée» [16 photographies], pp. 9-21.
Michel MARTIN, «La population
de Saint-Martin des origines à la Révolution» [4 photographies
dont 2 de plans, 2 graphiques, 14 tableaux], pp. 22-39.
Bernard GINESTE
[éd.], «Paroisse de Saint-Martin d’Étampes: Registre
des baptêmes, mariages et sépultures (1705)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-18-stmartin1705registreparoissial.html,
2008.
Bernard GINESTE
[éd.], «Religieuses de Maubuisson: Fief, rente et dîmes
sis à Étampes (vers 1705)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-18-maubuisson1705fiefetdimes.html,
2008.
Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris:
Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de
Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html,
2008.
Autres affaires étampoises
traités par le Parlement de Paris
Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE [éd.],
«Parlement de Paris: Règlement
entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt
(1624)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1624reglement.html, 2012.
Le XVIIe siècle étampois
COLLECTIF [éd.], «Le dix-septième siècle
étampois», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-17esiecle.html, depuis 2012.
Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|

