L’ABEILLE D’ÉTAMPES
(15 mars 1913), pp. 1-2.
|
LES TEMPS PRÉHISTORIQUES
dans la région d’Étampes
|
La présence, aux environs d’Etampes, de silex taillés par
la main de l’homme, indiquant d’une manière certaine l’existence
de civilisations préhistoriques dans cette région, a été
reconnue par M. Maxime Legrand, dès 1875.
Nous allons passer en revue, dans un rapide
résumé des périodes préhistoriques, les gisements
de nos environs, qui attestent la présence de l’homme depuis les
temps les plus anciens de son existence.
Mais, tout d’abord, il nous faut dire quelques
mots de la méthode employée pour classer ces différentes
époques et pour établir leurs âges respectifs.
On sait que les géologues ont divisé
l’immense espace de temps écoulé depuis les temps primitifs
du globe jusqu’à l’époque actuelle, en ères primaire,
secondaire, tertiaire et quaternaire. Ces divisions reposent sur l’étude
des terrains superposés au cours des âges, et dont la date
relative est donnée précisément par leur ordre de
superposition. D’une manière générale, un terrain
est d’autant plus ancien qu’il est plus profondément situé
dans l’épaisseur du sol, et la couche géologique qui le
surmonte est, lorsqu’il n’y a pas eu dislocation, à la période
qui lui a immédiatement succédé. L’étude des
fossiles, ou restes conservés dans le sol, des animaux et des plantes
qui ont vécu pendant ces périodes, complète cette
donnée et nous permet de nous faire une idée de l’apparence
qu’offrait notre monde dans ces temps si anciens.
Bien qu’un peu arbitraires, car il n’y a
pas de divisions tranchées dans la nature, et ces ères ont
passé de l’une à l’autre d’une manière insensible,
ces divisions sont commodes et permettent de fixer les idées.
|
|
C’est des premiers vestiges de la présence de l’homme à la
surface de la terre, que l’on fait dater le début de l’ère
quaternaire, la seule dont nous ayons à nous occuper ici.
Cette époque, nommée Chelléenne,
du nom de Chelles (Seine-et-Marne) où elle a été bien
étudiée, correspondait à un climat plus chaud que le
nôtre. Dans les alluvions de la Seine, à Chelles et en d’autres
localités, on a retrouvé des restes fossilisés de figuiers,
de lauriers, d’arbres de Judée, végétaux qui ne poussent
plus actuellement à l’état sauvage sous notre climat. Les animaux
que l’on rencontre à cette époque sont: l’Éléphant
antique, le Rhinocéros de Merck, le grand Hippopotame, de grands félins,
le Felix Spelæa, le lion, le tigre et le Machairodus, dont la mâchoire
était armée de dents formidables. Outre ces animaux, disparus
aujourd’hui ou émigrés, il y avait aussi des chevaux sauvages,
des cerfs, des bœufs, etc…
L’homme de cette époque taillait
dans des blocs de silex, ou d’autres roches, lorsque le silex était
rare, de grossiers instruments, à la fois armes et outils, en forme
d’amande. Débités à grands éclats, que l’on
a nommé coups-de-poing, parce [p.2]
que l’on a supposé que l’homme s’en servait
en les tenant directement à la main, forme tout ce que nous connaissons
de l’outillage humain de cet âge.
De cet homme, nous n’avons actuellement
qu’un seul débris. C’est une mâchoire inférieure,
découverte en 1907, près du village de Mauër, non
loin d’Heidelberg, en Allemagne, par le Dr Schætensack. Cette mandibule
est extrêmement curieuse par ses caractères anatomiques:
absence de la saillie du menton, très grande largeur de la branche
montante, extrême puissance de toute la pièce, jointe à
une dentition qui est véritablement humaine.
On trouve des coups-de-poing sur les plateaux
des environs d’Étampes, à la surface du sol, mélangés
à des industries humaines d’âges postérieurs. Le
Musée de notre ville en possède trois et notre collègue
et ami G. Courty en a trouvé un, en 1911, dans les graviers anciens
déposés par la Juine dans la vallée de Morigny.
|
|
La période Acheuléenne
(de Saint-Acheul dans la Somme), qui fait suite à la période
chelléenne, forme la transition avec une période plus froide,
dont nous allons nous occuper. Cet acheuléen est caractérisé
par un coup-de-poing mieux taillé et à retouches plus fines
que l’outil chelléen; on trouve aussi des disques, éclats
circulaires du silex, taillés à grands coups, qui devaient
servir d’armes de jet.
|
|
Nous arrivons maintenant à l’époque
Moustérienne, qui donne son nom de la grotte du Moustier
(Dordogne). Les conditions climatériques ont changé; une
période, plus froide et extraordinairement pluvieuse, a remplacé
le climat méditerranéen de l’âge chelléen. Les
cours d’eau s’étendent bien au-delà de leurs limites actuelles.
L’emplacement où sera bâti Paris est complètement immergé;
du fleuve immense que forme la Seine, émergent seulement la colline
de Montmartre et celle du Mont-Valérien. La Juine, aujourd’hui si
paisible roule tumultueusement dans toute la largeur de la vallée
et dépose ses graviers jusqu’au pied des coteaux. Les espèces
animales, adaptées à un climat chaud émigrent vers
le Sud; elles sont remplacées par des espèces mieux adaptées
au froid: le Mammouth, éléphant pourvu d’une abondante toison,
le Rhinocéros à fourrures, l’Ours des cavernes, qui atteignent
la taille d’un bœuf… etc. Certaines espèces ont cependant persisté;
ce sont celles qui supportent facilement des variations assez considérables
de température: le cheval, le cerf, le bison, etc.
L’homme d’alors vit encore sur les plateaux;
mais il commence à rechercher l’abri que lui offrent les grottes
naturelles creusées dans les parois rocheuses. Dans ces grottes,
il accumule les débris provenant de sa nourriture, ses outils et ses
armes. Ce mélange d’os d’animaux, brisés pour en extraire la
moëlle, et de silex taillés, forme dans certaines cavernes un
remplissage que l’on a vu atteindre jusqu’à trente mètres d’épaisseur.
On peut juger par là de la prodigieuse durée des temps moustériens.
L’outillage est restreint; à part
quelques survivances de forme du coup-de-poing primitif, que l’on trouve
à la base du moustérien, il ne comprend que deux types: le
racloir et la pointe, simples éclats de silex retouchés sur
une seule face. C’est de cette époque que date le début de
l’utilisation de l’os, qui deviendra plus tard une matière première
d’industrie très importante pour l’homme primitif. L’homme moustérien
commence à être bien connu aujourd’hui, gâce aux découvertes
faites à Néanderthal, en Allemagne; à Spy, en Belgique;
à La Chapelle-aux-Saints, dans la Corrèze, en 1908; à
La Quina, dans la Charente, en 1911, etc. Le type de cet homme est remarquablement
homogène: de taille plutôt petite, avec une tête énorme,
très allongée d’avant en arrière, il possédait
des orbites très développées, formant un bourrelet
saillant au-dessus des yeux; sa musculature était extrêmement
puissante.
Rare aux environs d’Étampes, l’industrie
moustérienne y est cependant représentée par quelques
trouvailles isolées, soit à la surface des eaux, soit dans
les éboulis des pentes des vallées, où les pièces
ont été entraînées du plateau supérieur
par le ravinement intense dû aux incessantes pluies moustériennes.
Il y a donc dans notre région quelques
traces de cette époque, bien que nous ne puissions y rencontrer
d’importants dépôts comme ceux que l’on trouve dans les grottes,
qui n’existent pas chez nous, à cause de la constitution géologique
de notre sol.
|
|
Avec l’époque Solutréenne,
de Solutré (S.et-L.) nous arrivons à un perfectionnement de
la taille du silex, qui n’a jamais été atteint depuis. Les
pointes à crans, les pointes lancéolées, dites en feuille
de laurier et en feuille de saule, présentent une finesse de retouche
et une perfection de détails qui dénotent une extraordinaire
habileté de la part de l’homme préhistorique dans l’art
de tailler une matière aussi dure et aussi cassante que le silex.
Cette industrie solutréenne, qui
comprend également des instruments en os, est assez peu abondante
partout; quelques trouvailles isolées en ont été
faites en Seine-et-Oise; nous n’en connaissons pas aux environs d’Étampes.
Il est probable que la durée de cette période préhistorique
a été infiniment moins longue que celle de la période
moustérienne.
|
|
Puis vient l’âge de la Madeleine,
ou Magdalénien, qui tire son
nom de la grotte de la Madeleine, dans la Dordogne. Les conditions climatériques
se sont encore une fois modifiées. Il fait plus froid et plus sec
qu’au moustérien. Les grands glaciers, qui couvraient nos montagnes,
et qui ont laissé des traces de leur extension pendant les âges
antérieurs, bien au-delà de leurs limites actuelles, commencent
à se retirer. Ces glaciers, favorisés par la grande humidité
et le froid de l’âge moustérien, couvraient, en effet, des
étendues considérables. Celui des Alpes, atteignait l’emplacement
actuel de Lyon, et celui des Pyrénées, l’emplacement actuel
de Toulouse.
L’homme du magdalénien recherche
les cavernes; il possède un outillage en silex de formes extrêmement
variées et propre à de multiples usages: grattoirs, burins,
scies, perçoirs, petites lames retouchées, etc… Il a porté
l’industrie de l’os à un très haut degré de perfection,
taillant dans celui-ci et dans les bois de rennes et de cerfs, des pointes
de sagaies, des harpons, des aiguilles, etc… Grâce au burin de
silex, qui lui permet de travailler l’os, il utilise les loisirs que
lui procure le long hiver magdalénien, pour copier, par la sculpture
et la gravure, les figures des animaux et des plantes qui l’environnent.
C’est à cet humble chasseur de rennes, voisin comme type de l’esquimau
de nos jours, qu’il faut faire remonter l’origine de l’art. La vérité
d’observation, l’exactitude des détails, la vie intense qui se
dégage de ces œuvres si anciennes, donnent à cet art magdalénien
une justesse d’expression et une beauté qui n’ont pas été
dépassées.
Très rares dans tout le bassin de
Paris, à cause de l’absence des grottes, l’industrie magdalénienne
ne renferme, dans cette région, qu’un gisement important en plein
sol: celui du Beauregard, près de Nemours (Seine-et-Marne). Jamais
elle n’avait été signalée aux environs d’Étampes;
les fouilles, que j’ai pratiquées en 1912 sur le plateau de Fontaine-Liveau,
près d’Étréchy, permettent de combler cette lacune.
J’ai, en effet, recueilli sur ce point, au milieu d’une industrie d’un
âge postérieur, quelques pièces, dont un burin, qui
sont incontestablement magdaléniennes. Malheureusement, dans nos
sables siliceux, la matière osseuse ne s’est pas conservée,
et les silex taillés sont les seuls témoins qui nous restent
de la civilisation magdalénienne de notre région. Ils suffisent,
néanmoins, pour pouvoir affirmer que les magdaléniens ont
habité ce plateau, surplombant le plateau de la Juine.
J’ai recueilli également, à
Fontaine-Liveau, un silex appartenant à l’époque tardenoisienne,
période postérieure au magdalénien, mal connue encore
et caractérisée par de petits silex à formes géométriques.
Négligeant les phases intermédiaires
qui ne sont pas représentées dans notre région,
nous arrivons maintenant à l’époque néolithique,
mot qui signifie nouvelle pierre, par opposition à l’époque
paléolithique ou ancienne pierre, que l’on donne à tous
les âges antérieurs. C’est à dessein que nous avons
négligé de parler de l’époque aurignacienne, dont
l’âge relatif donne encore lieu à de vives discussions.
|
|
Avec l’époque néolithique
finit l’ère quaternaire des géologues; nous entrons dans la
période actuelle, bien que nous soyions
[sic] séparés du néolithique par plusieurs
milliers d’années.
Un profond changement s’est opéré
dans le climat; il est plus doux et plus humide qu’au magdalénien.
Les espèces animales de climat froid, répandues chez nous
depuis le moustérien, émigrent vers le Nord et sont remplacées
par la plupart des espèces que nous connaissons aujourd’hui. Le
renne, si abondant autrefois que l’on a donné le nom d’âge
du renne aux époques allant du moustérien à la fin
du magdalénien, cède la place au cerf. La civilisation humaine
s’est profondément transformée. Jusqu’alors exclusivement
chasseur et pêcheur, l’homme possède maintenant des végétaux
cultivés et des animaux domestiques. Il a inventé la poterie,
et s’il utilise encore la pierre taillée, il a imaginé aussi
de la polir, en usant régulièrement sa surface par le frottement
sur une roche de grès. Les grottes ne servent plus d’habitations,
mais souvent de sépultures; les néolithiques ensevelissent
aussi leurs morts dans des dolmens, monuments élevés en pierres
brutes, souvent de dimensions colossales, que l’on croyait autrefois, par
une interprétation erronée, autels druidiques. Ils dressent
des menhirs dont la signification est encore très obscure, gravent
les rochers de figurations conventionnelles, qui constituent l’origine
lointaine de l’écriture, mais ils ont perdu l’art si remarquable
des magdaléniens.
L’homme néolithique nous est bien
connu; il ne diffère de nous que par des détails anatomiques
très secondaires; plusieurs races sont déjà mélangées.
L’industrie néolithique et les monuments
de cet âge sont très communs aux environs d’Étampes;
citons seulement: le dolmen de Janville, le menhir de Pierrefitte, celui
de Milly, la grotte sépulcrale de Buno-Bonnevaux, les polissoirs
de Villemartin, de la Briche, du bois de La Guigneraye, etc…
Quant aux silex et aux haches polies, les
stations où on les trouve sont innombrables. La collection que
M. Dujardin a léguée au musée de notre ville, et qui
provient en majeure partie du plateau du Temple, au-dessus de Valnay, nous
montre la plupart des types de l’industrie néolithique de notre région.
M. M. Legrand a bien voulu nous signaler qu’il avait rencontré des
silex néolithiques aux points suivants: Champdoux, Tourot, Mondésir,
Nonserve, Guinette, Brières, Lhumery, Ormoy, Saclas, Les Émondants,
La Briche, Rimoron, Saint-Yon, etc.
A Fontaine-Liveau j’ai trouvé également
du néolitique, associé au magdalénien et au tardenoisien,
ce qui prouve une habitation successive de l’homme en ce point.
A partir de l’âge de la pierre polie,
les progrès de la civilisation humaine deviennent plus rapides.
L’homme découvre les métaux, le bronze d’abord, probablement
importé chez nous d’Orient. Une trouvaille, remontant à
cette époque, a été faite, il y a plusieurs années,
à Boutigny.
|
|
Puis, ils forgent le fer, matière précieuse d’abord, employée
au premier âge du fer ou pallstattien, pour orner les armes et outils
de bronze, avant de constituer la matière principale de l’industrie
métallurgique.
|
|
Au deuxième âge du fer,
époque marnienne
ou gauloise, nous arrivons à
la fin destemps protohistoriques, c’est-à-dire de ceux qui ont immédiatement
précédé l’histoire.
De ces âges du fer datent la découverte,
faite en 1876 près d’Auvers, de tombes contenant des corps ornés
d’anneaux de bronze, et celle de Congerville, en 1912, signalée
par M. M. Legrand. Nous n’avons cependant que peu de découvertes
de cette époque dans notre région.
|
|
Enfin, en l’an 50 avant notre ère,
la Gaule est conquise par les Romains et entre dans l’histoire. César
a donné dans ses Commentaires le récit de cette conquête,
et des renseignements, qui sont précieux pour nous, sur l’état
dans l’état [sic] dans
lequel vivaient nos ancêtres, à son arrivée dans leur
pays. On sait que, malgré une résistance acharnée,
les Gaulois, divisés en un grand nombre de petits peuples, durent
plier sous le poids des armes romaines. Le sort malheureux de Vercingétorix,
traîné en captivité, et égorgé, après
le triomphe de Jules-César, malgré l’héroïsme de
sa défense d’Alésia, est dans toutes les mémoires comme
épisode de notre histoire nationale.
Les Romains, dont la clémence envers
les chefs vaincus n’était pas la qualité dominante, étaient,
par contre, d’admirables colonisateurs; sous leur administration, la
Gaule, devenue province de l’Empire, vit se développer une brillante
civilisation, dont les témoins sont encore abondants autour d’Étampes.
A Saint-Yon, on voyait encore, il y a peu
d’années, les restes d’une voie romaine; une autre de ces routes,
près de laquelle on a trouvé une borne milliaire aujourd’hui
conservée au Musée d’Orléans, passait à Saclas,
village dont l’origine remonte peut-être au Salioclita gallo-romain,
indiqué dans l’itinéraire romain d’Antonin. A Mérouville,
à Villeconin, etc., les trouvailles romaines ont été
nombreuses et l’on sait qu’à Souzy-la-Briche, il existait un ou
peut-être plusieurs édifices, à coup sûr très
importants, ornés de belles mosaïques et de marbres précieux.
|
|
Arrivés au terme de ce trop rapide
exposé de l’histoire de l’homme primitif, il aurait
été intéressant de pouvoir fixer, aux périodes
que nous avons passées en revue, une durée précise.
Malheureusement, il est impossible, avant la période historique,
d’apprécier, en termes d’années, l’espace de temps de périodes
préhistoriques; cependant d’une manière générale,
se basant sur l’étude des phénomènes glaciaires dûs [sic] à ces grandes oscillations
de températures, dont la cause nous échappe encore, et sur
la durée de la formation des dépôts alluvionnaires, on
peut dire que le moustérien a eu une durée prodigieusement
longue, occupant presque la moitié des temps préhistoriques
et qui ne peut être évaluée que par centaines de siècles,
succédant à une période chelléenne un peu moins
longue. Le solutréen et le magdalénien réunis ont duré
moins longtemps; le néolithique, comme nous l’avons vu, n’est plus
qu’à quelques milliers d’années de nous. Et le progrès
des civilisations s’accentue rapidement ensuite.
Cette chronologie, toute relative, ne s’applique
pas, d’ailleurs, à tous les pays; favorisés par un climat
plus doux, les hommes du littoral méditerranéen ont prononcé
plus rapidement que nous l’évolution de leur civilisation. L’Égypte
et l’Asie antérieure possédaient déjà une
histoire nationale, alors que nous étions encore à l’âge
de la pierre polie, tout comme certains primitifs de nos jours utilisent
encore la hache de pierre, à côté de nos engins modernes
très perfectionnés.
En résumé, nous avons vu l’immense
progrès accompli par l’homme, depuis l’époque lointaine
où la race de Mauër errait dans la forêt primitive,
n’ayant pour se défendre des fauves formidables qui l’entouraient,
qu’un grossier silex, jusqu’à la brillante civilisation que nous
révèle l’occupation romaine de notre pays. Ce perfectionnement
lent, interrompus par de longues stagnations, nécessitant du cruelles
expériences [sic], de
pénibles adaptations aux variations climatériques, témoignent
du labeur obstiné et patient de l’homme primitif; il indique la
constance de son effort pour triompher des causes multiples de destruction
qui le menaçaient et de sa victoire finale sur la nature.
Les phases diverses de cette évolution
nous sont rendues sensibles par les silex que l’on trouve, nous l’avons
vu, dans notre région, et leur présence aux environs d’Étampes,
à presque toutes les époques des temps préhistoriques,
doit être un encouragement pour les chercheurs que séduisent
l’incomparable majesté et la haute portée philosophique
de ces études.
R. DE SAINT-PÉRIER,
Docteur en médecine.
|
|
|
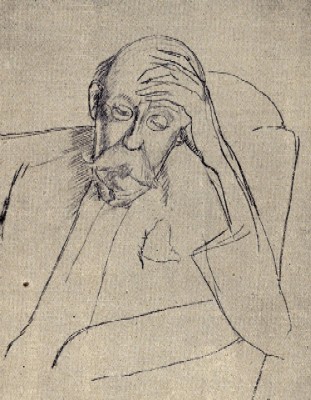 Nous donnonc ici un article de vulgarisation publié en 1913 par
le comte de Saint-Périer à l’intention du public étampois,
dans l’Abeille d’Étampes, qui est en même temps un
récapitulatif des trouvailles alors effectuées dans la région.
Il est bien certain que de nouvelles trouvailles ont depuis nettement
amélioré notre connaissance de la préhistoire étampoise.
Mais les grandes lignes dégagées par cet article restent valables.
Nous donnonc ici un article de vulgarisation publié en 1913 par
le comte de Saint-Périer à l’intention du public étampois,
dans l’Abeille d’Étampes, qui est en même temps un
récapitulatif des trouvailles alors effectuées dans la région.
Il est bien certain que de nouvelles trouvailles ont depuis nettement
amélioré notre connaissance de la préhistoire étampoise.
Mais les grandes lignes dégagées par cet article restent valables.