|
Qui est l’auteur de ce récit?
La comparaison
de ce texte avec les récits publiés par le journal local l’Abeille
d’Étampes laisse apparaître des parallèles textuels
très nets qui permettent de supposer que Charles Béranger
était le véritable nom de l’un des contributeurs anonymes de
l’Abeille à cette époque. Ce récit présente
aussi des parallèles nets avec celui de Léon Marquis. Nous
versons donc cette pièce au dossier, afin que les historiens d’Étampes
s’efforcent de débrouiller l’origine et la fiabilité de chacun
de ces récits, tous assez circonstanciés, bien que l’histoire événementielle
ne soit plus très à la mode.
Qui est Charles
Béranger? C’est un fils de bonne famille, de très bonne famille,
âgé de 27 ans en 1870. Son grand-père maternel est Aimé
Stanislas Darblay, dit Darblay le Jeune, richissime négociant en
grains, héritier d’une dynastie connue à Étampes depuis
le début du XVIIe siècle, député de Seine-et-Oise
et censeur de la Banque de France. Quant à son père, Alphonse
Béranger, il succèdera à Darblay comme censeur de la
même Banque de France, ce qui situe le personnage.
La famille connue
de Charles Béranger
La famille
Darblay est en effet attestée à Étampes depuis le début
du XVIIe siècle, et Virgine Pauline descend en droite ligne, à
la huitième génération du premier Darblay d’Étampes
connu:
Martin Darblay
(1615-1685), marchand au moins mort à Étampes en 1685, où
naissent et meurent tous ses premiers descendants:
Rodolphe
(1643-1694) est hôtelier et marchand de chevaux.
Jacques
(1668-1738) est hôtelier à l’enseigne Au Duc de Bourgogne.
Rodolphe
(1690-1766) est hôtelier à l’enseigne Aux Trois Marchands.
Jacques
(1727-1798) est aubergiste à l’enseigne Au Lion d’argent.
 Simon Rodolphe (1760-1839), qui mourra à
Saint-Germain-lès-Corbeil, est aubergiste à l’enseigne Au
Dauphin, meunier aux moulins de Vaux et de Chagrenon, Maître
de la Poste à chevaux d’Étréchy, Maire d’Auvers-Saint-Georges.
Simon Rodolphe (1760-1839), qui mourra à
Saint-Germain-lès-Corbeil, est aubergiste à l’enseigne Au
Dauphin, meunier aux moulins de Vaux et de Chagrenon, Maître
de la Poste à chevaux d’Étréchy, Maire d’Auvers-Saint-Georges.
Aimé
Stanislas, dit Darblay le Jeune (1794-1878), père de Virginie Pauline
et grand-père maternel de Charles Béranger, né à
Auvers-Saint-Georges épouse à Étampes Pauline Mainfroy,
de Morigny-Champigny, et meurt en son château de Saint-Germain-lès-Corbeil. Il est d’abord Maître
de la Poste à chevaux d’Étréchy, fonction dont il sera
déchu pour cause de bonapartisme sous la Restauration, mais surtout
négociant en grain et farines, et fabricant de papiers, possesseur
de la papeterie d’Essonnes depuis 1867, membre du Conseil d’Escompte de la
Banque de France puis Censeur de la Banque de France de 1854 à sa mort,
ainsi que du Crédit foncier, membre
de la Chambre de Commerce de Paris et président du comité agricole
de Seine-et-Oise. Élu député sous la Monarchie de Juillet,
il sera aussi sous l’Empire nommé maire de Saint-Germain-lès-Corbeil
et député gouvernemental de Seine-et-Oise de 1852 à
1870.
Sa fille
Virgine Pauline (1823-1889), née à Étampes et morte
au château de Tigery, a épousé à Corbeil en 1841
Alphonse Mathurin Béranger (1813-1884), né à Paris et
mort à Tigery, négociant en grains et farines, qui sera Censeur
de la Banque de France à la suite de son beau-père.
Virginie
Darblay donnera à Alphonse Béranger trois enfants: Charles,
qui nous intéresse, né le 5 mai 1843 à Corbeil; Jenny,
née le 9 septembre 1846 à Corbeil qui épousera en 1867
Alfred Louis Cibiel, député de l’Aveyron né à
Rouen en 1840; et Louise Cécile, sans alliance, qui habitera au domicile
de ses parents.
Données sur
Charles Béranger lui-même
Nous n’avons
guère de données pour l’instant (février 2007) sur
Charles Béranger lui-même Né à Corbeil en 1843,
aîné de trois enfants d’une famille des plus fortunées,
petit-fils d’un Censeur de la Banque de France et Député gouvernemental,
fils d’un futur Censeur de la Banque de France, il est à Étampes,
âgé de 27 ans, pendant la Débâcle, lorsque la première
unité de l’armée prussienne entre dans Étampes, le
20 septembre 1870.
Le 27 mai 1875,
il épousera à Paris Antoinette Amélie Myèvre,
née elle-même le 9 janvier 1854 à Paris. Antoinette
Myèvre lui donnera une fille, Marie Antoinette Louise Pauline, née
le 4 mai 1876 à Paris.
Nous savons
que vers 1870, Charles Béranger se tique d’écrire. Il semble
qu’on lui doive toute une série
de contributions à l’Abeille d’Étampes, sous un même
pseudonyme: la question reste à étudier. Notre source en la
matière est donc surtout, et même, pour l’instant, seulement le cahier dont Jean-Luc
Stéfanini nous a révélé l’existence par trois
courriels en date des 10 et 20 mars 2005.
Le cahier de Charles Béranger
Ce cahier,
qui a été retrouvé par Jean-Luc Stéfanini à
Saint-Maur avec un ensemble de documents familiaux appartenant à
une grandes-tantes aujourd’hui décédée, était à Agde
en 2005.
C’est
un cahier de 20 cm sur 15, avec une couverture rouge cartonnée, comportant,
sur une cinquantaine de pages, un ensemble de plusieurs textes. Ils sont
signés «Ch. BERANGER», et, sur la dernière page, on
lit les mots «FIN, AUTEUR: BERANGER». Voici les titres de ces
textes: 1) La nuit de Noël; 2) Lettre d’un jeune conscrit à son
père; 3) La voix de l’aquilon; 4) La première nuit après
la rentrée; 5) La promenade du jeudi; 6) Épisodes de la guerre
Afrique (poésie); 7) Une page de l’histoire de France (poésie).
8) Le récit
de l’arrivée des Prussiens n’a pas de titre et se termine abruptement
en bas de page sur les mots «déjà à».
Selon Jean-Luc
Stéfanini, à qui nous devons cette description, «le
style de l’ensemble parait homogène». Ajoutons que l’écriture
à la plume en est soignée et que le texte présente
épisodiquement des fautes d’orthographe. Il est possible que nous
soyons en présence d’une copie posthume de textes soigneusement
recueillis par une descendante de l’auteur d’après des manuscrits
épars et de dates différentes.
Sur le récit
de Béranger
J’ai identifié dans
l’Abeille d’Étampes, ainsi que j’y ai fait déjà
allusion, un récit des mêmes événements par un
contributeur anonyme qui présente de tels parallèles textuels
qu’on peut penser qu’il ne s’agit que d’une autre version du texte par le
même auteur, à qui l’on doit plusieurs autres articles ous
le même pseudonyme. Je n’ai pas eu le temps pour l’heure d’approfondir
ces premières recherches, que peut-être quelqu’un d’autre pourra
reprendre.
Notre récit présente aussi, comme nous l’avons signalé,
des parallèles textuels très nets avec le récit que
fait Léon Marquis des mêmes événements, dans
son fameux ouvrage Les rues d’Étampes et ses monuments, aux
pages 39-45. Il importerait donc de débrouiller la généalogies
de ces emprunts. Je n’ai pas le temps pour ma part de m’atteler à
cette tâche, ni à court ni à moyen terme, et il faut
espérer que quelqu’un d’autre s’y attellera, car cette tâche
est indispensable pour reconstituer d’une manière solide les fils complet
des événements: pas d’histoire sérieuse sans critique
des sources.
Je ne me permettrai
ici qu’une seule observation: l’intérêt de ce témoignage
est de souligner à quel point le patriotisme était une chose
peu partagée en 1870, comme le constate avec indignation un jeune
homme extrêmement fortuné, qui paraît pour sa part redouter
avant tout d’éventuelles
réquisitions. Le gros de la population, pour sa part, ne semble pas
craindre l’occupation prussienne plus que le régime dans lequel elle
vit, étroitement contrôlée et exploitée quétait à Agde
en 2005, elle est par le régime ploutocratique
du Second Empire. Bientôt, l’Éducation Nationale et une campagne
de propagande sans précédent vont y mettre bon ordre, et tout
sera près pour le carnage terrifiant de la Grande Guerre.
B.G., janvier 2007
|
|
[Transcription du récit]
Jusqu’au
milieu de Septembre, notre ville n’entendit pas le bruit, même lointain,
des armées; la capitulation de Sedan avait concentré dans Paris
toute la défense probable dde la France, et toutes les forces militaires
du pays s’étaient rassemblées dans la Capitale sur laquelle
se dirigeaient les différents corps de l’armée allemande. [p.2]
Le dix-sept
Septembre, nous étions complètement coupés de Paris,
et l’armée bavaroise, qui avait traversé la Seine à
Corbeil, marchait vers la Capitale par la route d’Orléans et les autres
routes du midi; mais Étampes était tout à fait en dehors
de son action immédiate.
Le lundi dix-neuf, dès
l’aurore, pour la première fois, nous entendîmes distinctement
le canon, dans la direction de Paris; les coups se suivaient sourds et précipités,
et avaient dans tous les cœurs un pénible retentissement; c’était
le jour des vendanges, et la population d’Étampes, répandue
sur les côteaux [sic] des environs, écoutait,
frémissante, ce bruit lointain.
Il faut bien
dire que, dès le soir, les récits les plus exagérés
nous arrivaient; ce n’était cependant pas une victoire pour nos armes,
mais enfin les Prussiens apprirent, par cet engagement, qu’ils ne pouvaient
pas espérer [p.3] de prendre Paris aussi
promptement qu’ils se l’étaient imaginé d’abord.
C’étaient [sic] le lendemain que nous devions voir les premiers
Allemands.
Ils occupaient
déjà, Montlhéry et Arpajon; on nous les signalait à
Étréchy, où quelques habitants de la ville, plus curieux
que les autres, s’empressèrent d’aller, et jugèrent même
à propos de leur payer à boire; les dragons acceptèrent,
mais, au courant de leur métier, empoignèrent quelques-uns
des curieux pour leur servir d’otages.
La postérité
croira peut-être qu’effrayée par les récits qui précédaient
l’armée allemande, notre population s’était enfuie ou renfermée
dans les maisons; il en fut autrement et, dès quatres [sic] heures de l’après-midi plus de cinq
cents personnes, parties d’Etampes pour voir les Prussiens encombraient
la route de Paris; femmes, enfants, oisifs de toute espèce; nous nous
rappelons [p.4] même que plusieurs, négligeant
les notions les plus élémentaires du patriotisme, s’oublièrent
juqu’à faire fête aux ennemis de la France.
Cependant
les dragons, suivis de quelques fantassins en charrette, avançaient
avec leur prudence bien connue. En face du bois de Brunehaut, ils tirèrent
quelques coup de fusils en l’air, probablement comme signal pour ceux des
leurs qui suivaient la voie ferrée et ils arrivèrent ainsi
à Etampes.
Les fantassins
restèrent à l’entrée de la ville, et les cavaliers,
l’arme au poing, se tenaient à l’entrée de la cour, les autres
y pénétrèrent avec leur chef. Ils prétendaient
faire désarmer la ville, à un moment, un conflit sembla imminent;
la population rassemblée en masse sur la [p.5]
place, frémissait; M. le Maire, irrité
de leurs outrecuidantes prétentions, avait saisi leur chef au collet,
celui-ci avait pâli et faisait apprêter les armes à ses
soldats!…
L’attitude
énergique de M. Brunard en imposa si bien à l’ennemi, qu’il
se vit obligé de se contenter d’un logement pour la nuit et de vivres
pour le soir seulement. Les huit fantassins eurent bientôt rejoint
les cavaliers, et tous passèrent la nuit à la gendarmerie, qu’ils
quittèrent dès quatre heures et demie du matin, sans tambour
ni trompette, en annonçant la visite d’un corps de trois mille hommes
marchant vers Orléans.
Le reste
de la semaine se passa sans encombre; on eut bientôt la visite de quatre
autres Prussiens, venus du côté de Pithiviers et se rendant
à Arpajon, l’un était à cheval, les autres en voiture,
ils appartenaient à la division de cavalerie
[p.6] du prince Albert, dont ils annonçaient l’arrivée,
mais ils n’exigèrent rien.
Un peu plus
tard, le vingt-trois on prit un vivandier de l’armée allemande, fourvoyé
dans nos contrées.
Il était
monté dans un de ces chariots à quatre roues, que nous voyions
apparaître pour la première fois, mais avec lesquels nous avons
fait, depuis, plus ample connaissance que nous n’aurions voulu; on confisqua
ses marchandises et son maigre attelage, et lui-même fut envoyé
à Chartres sous bonne escorte, pour être mis à la disposition
du Gouvernement.
Samedi vingt-quatre
Septembre, à midi, un détachement assez important arrivait
à Etampes, il venait du côté de Paris, par la grande route,
et se composaient d’une soixantaine de dragons, il traînait derrière
lui un chariot chargé de quelques sacs d’avoine réquisitionnés [p.7] en route, et pensait obtenir davantage à
Etampes; mais devant le refus de la municipalité, le commandant, ne
se trouvant probablement en force, se décida à rammener [sic] ses hommes par où ils étaient
venus.
A six heures,
arrivaient encore douze cavaliers ennemis; ceux-là, parvenus aux Quatre
Coins, enfilèrent la route de La Ferté, Tandis que neuf autres,
entrés par la rue Saint-Jacques, galopaient jusqu’au Haut-Pavé
et se retiraient ensuite. Un boulanger de la ville, croyant voir des troupes
françaises, ouvrit sa porte et leur cria: vive la France! Ils le
menacèrent de leurs pistolets et continuèrent leur chemin.
Tous ces
petits détachements provenaient d’un corps de cavalerie plus considérable
qui bivouaqua la nuit, sur la route de Paris à quelque distance d’Étampes,
[p.8] et poussa le lendemain matin,
dimanche vingt-cinq, une reconnaissance jusqu’à l’église Sant-Martin,
mais toujours sans rien prendre. Cette fois on compta qurante et [sic] cavaliers
Le même
jour, sur les une heure de l’après-midi, ont [sic] vit apparaître à l’Hôtel-de-Ville
d’Etampes, conduits par un voiturier de Pithiviers, cinq soldats de la garde
royale bavaroise; d’eux [sic] d’entre eux,
accusés de désertion ou de pillage, étaient conduits
par les autres à Arpajon, devant le conseil de guerre, c’était
au moins ce que disait le sous-officier qui conduisait le détachement;
la chose semblait un peu suspecte, mais l’examen de leur commission fit voir
qu’ils ne trompaient pas, et on se décida à les faire conduire
à destination.
Peu de jours
après nous apprîmes que deux soldats bavarois avaient été [p.9] fusillés à Arpajon, et tout
porte à croire que c’étaient les mêmes que nous avions
vus à Etampes.
Nous voici
arrivés au vingt-cinq Septembre, la ville n’est pas encore occupée
par les troupes allemandes, elle n’a pas subi encore aucune réquisition,
mais celà [sic] ne peut tarder longtemps,
car les vivres sont rares autour de Paris, et l’ennemi bien près de
nous au Nord nous déborde depuis longtemps à gauche et à
droite, il occupe Pithiviers et ses éclaireurs parcourent déjà
la Beauce dans tous les sens.
Devant l’abandon
d’Etampes par les troupes françaises, qui ne dépassaient pas
beaucoup Orléans, il était impossible, surtout dans une ville
commandée de toutes parts par des hauteurs, de tenter une sérieuse
résistance; nous l’avons dit d’ailleurs l’armée allemande nous
débordait déjà [interruption du
récit]
Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|
|
Source: Courriels de Jean-Luc
Stéfanini en date des 10 et 20 mars 2005.
|
|
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Édition
Jean-Luc STEFANINI & Bernard GINESTE [éd.], «Charles
Béranger: Arrivée des Prussiens à Étampes
(récit, 1870)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-beranger1870cahier.html, 2007.
Sur
Aimé Darblay grand-père de Charles Béranger
E. C. & de M. (journalistes), «Darblay»,
in Biographie des 750 représentants à l’Assemblée
législative élus le 13 mai 1849, par deux journalistes
[in-32 (15 cm); 256 p.], Paris, Pagnerre, 1849 [dont une réédition
numérique en mode texte par la BNF, 1995, mise en ligne sur son site
Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24257v,
en ligne en 2007], p. 218 [dont la saisie qui suit].
«DARBLAY,
élu à l’Assemblée législative le huitième
par 42,090 voix. Ancien député, il était, sous la dynastie
déchue, un des partisans du ministère Guizot-Duchâtel.
Cependant il s’est abstenu dans la question de l’indemnité Pritchard,
et dans les derniers temps il était classé parmi les conservateurs
progressifs. Très riche propriétaire, négociant en grains.
Il est président du comice agricole de Seine-et-Oise.»
Jacques LONGUET, Une
famille d’industriels au XIXème siècle: les Darblay [brochure
regroupant quelques documents d’archives intéressant l’histoire du
patronat et de la condition ouvrière], Évry, CDDP de l’Essonne
[«A l’école des archives»], 1998.
COLLECTIF D’INTERNAUTES, «Aimé Darblay»,
in Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Aym%C3%A9-Stanislas_Darblay,
en ligne en 2007.
COLLECTIF, «Le
moulin Brunard (compilation)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cee-moulinbrunard.html,
depuis 2010.
Données
généalogiques
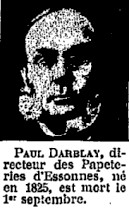 SECTION GÉNÉALOGIQUE
DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies
Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,
en ligne en 2007.
SECTION GÉNÉALOGIQUE
DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies
Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,
en ligne en 2007.
[L’auteur de cette page allègue comme
sources particulières: 1) Archives Départementales de l’Essonne,
(2E 48/2: Minutier); 2) J.-M.. Desormeaux, «Les de La Chaise»;
3) «Les Gros» du journal Le Crapouillot; 4) notes personnelles
de MM. Jean-François Arnou; notes personnelles de Guy Debargue].
SECTION GÉNÉALOGIQUE DE L’ASSOCIATION
ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies Béranger»,
in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/beranger.htm,
en ligne en 2007.
[L’auteur de cette page allègue comme
source particulière: Archives de la Banque de France (1251199628/134:
Comptes-courants fermés, dossier Darblay et Béranger)]
AUTEUR NON IDENTIFIÉ, «Les Familles
dans l’ascendance de Guillaume Hellouin de Ménibus», page web
en ligne en 2005 qui ne l’est plus en 2007 [données généalogiques
sur Charles Béranger].
Sur
la guerre de 1870 dans le pays étampois
(merci de nous adresser des références
bibliographiques,
notamment les références des articles de Henry de La Bigne
dans l’Abeille d’Étampes, si quelqu’un les a sous la main.)
Henri de LA BIGNE,
différents articles dans l’Abeille d’Étampes.
Léon MARQUIS, Les
rues d’Étampes et ses monuments, Histoire - Archéologie - Chronique
- Géographie - Biographie et Bibliographie, avec des documents inédits,
plans, cartes et figures pouvant servir de suppléments et d’éclaircissement
aux Antiquités de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile
Fleureau [in-8°; 438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun],
Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions en
fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de
la Tour Gile, 1996], spécialement pp. 39-45 [récit assez détaillé].
Claude ROBINOT, «1870-1871: L’année
terrible vue d’Étampes», in ASSOCIATION ÉTAMPES-HISTOIRE,
Le pays d’Étampes au XIXe siècle [288 p.], Éditions
Amattéis, Le Mée-sur-Seine, 1991, pp. 107-127.
Anne-Marie SERVATIUS et Bernard GINESTE [éd.],
«Gustave Fautras: De la Loire à l’Oder, chapitres 5 et 6
(1899)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-fautras-delaloirealoder.html,
2003.
Bernard GINESTE, «Cimetière
Notre-Dame ancien d’Etampes: tombe de soldats allemands (1870)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-1870tombedesoldatsallemands.html,
2004.
Bernard GINESTE [éd.],
«Victor Hugo: Incident en gare d’Étampes (Carnet intime,
13 février 1871)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-19-hugo1871etampes.html,
2004.
Bernard GINESTE, «Cimetière Notre-Dame ancien d’Etampes: tombe de soldats
allemands (1870)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-1870tombedesoldatsallemands.html,
2004.
Jean-Luc STEFANINI & Bernard GINESTE [éd.], «Charles
Béranger: Arrivée des Prussiens à Étampes
(récit, 1870)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-beranger1870cahier.html, 2007.
Toute correction, critique ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|
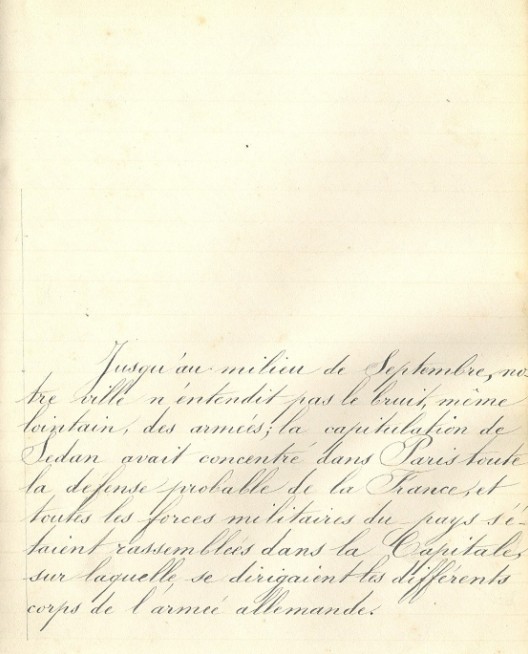
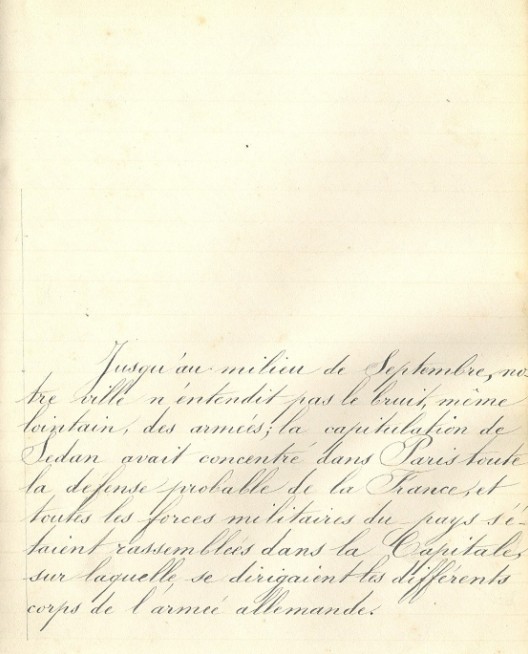
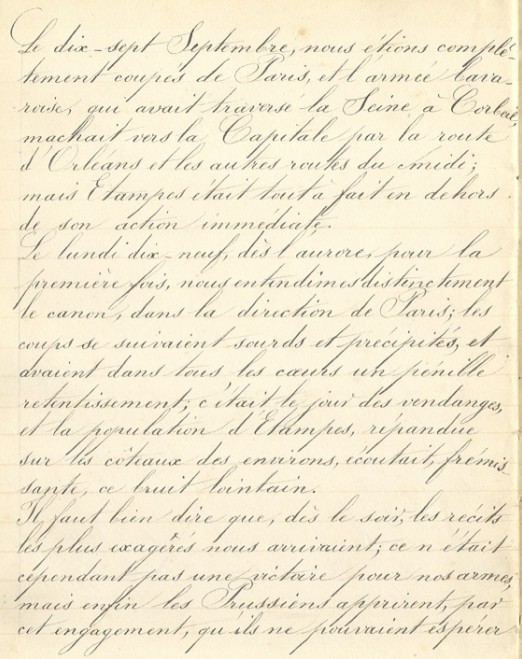
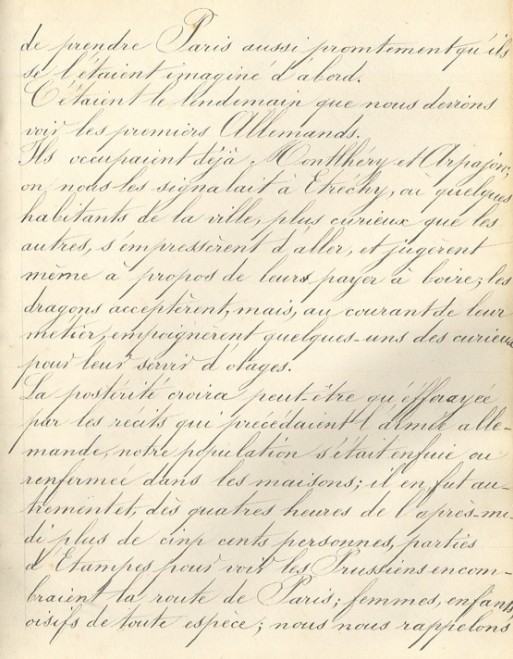
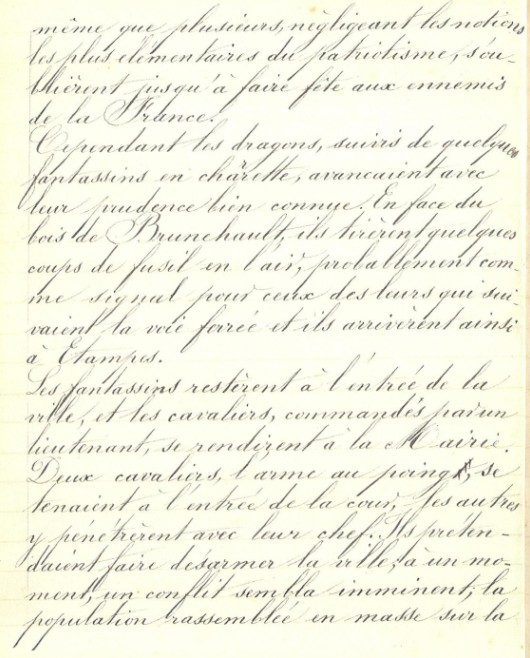
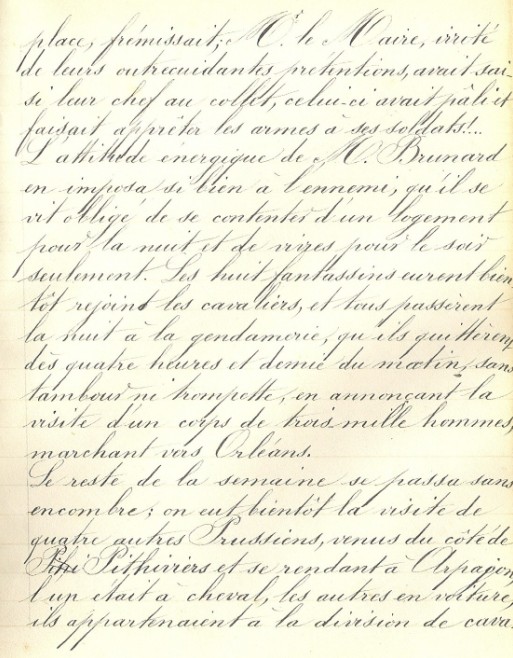
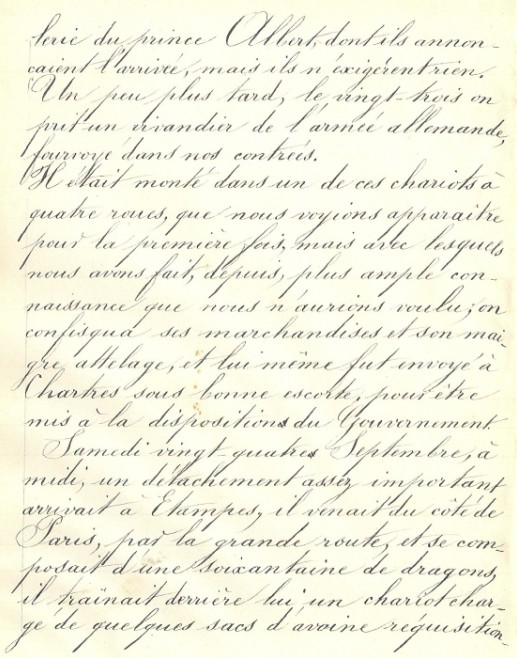
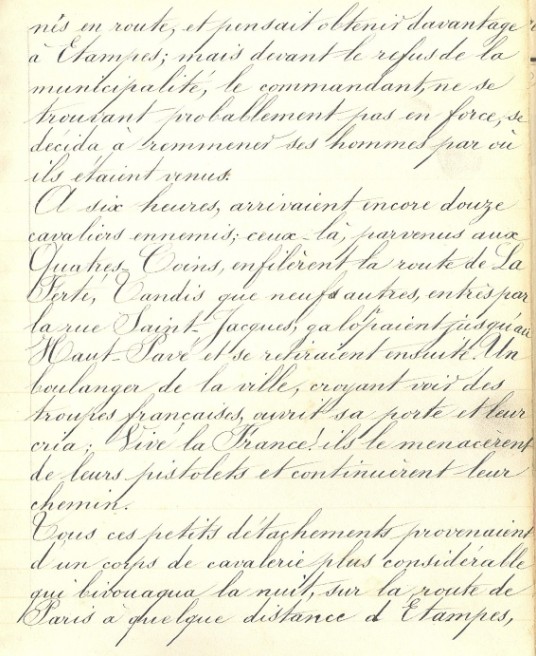
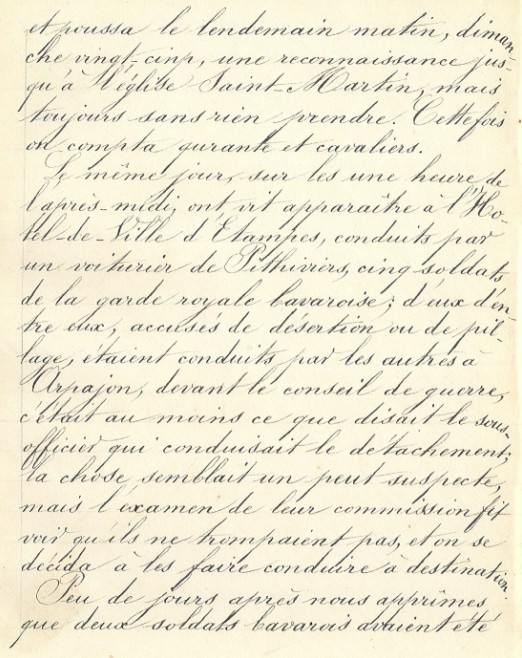
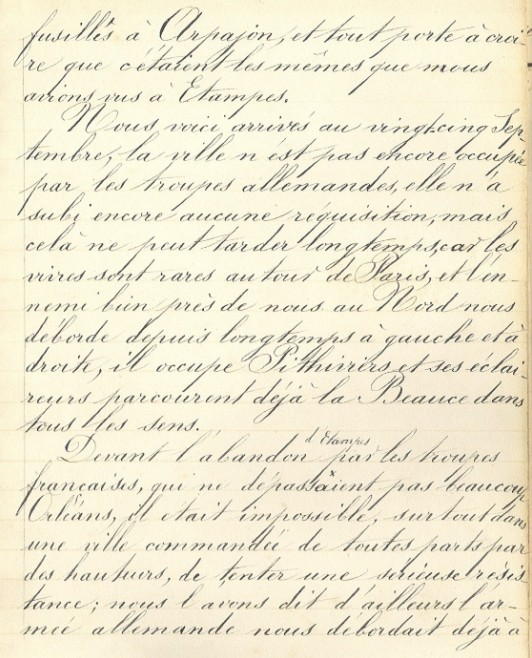
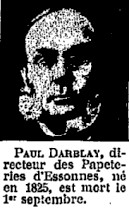 SECTION GÉNÉALOGIQUE
DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies
Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,
en ligne en 2007.
SECTION GÉNÉALOGIQUE
DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies
Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,
en ligne en 2007.