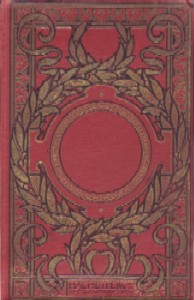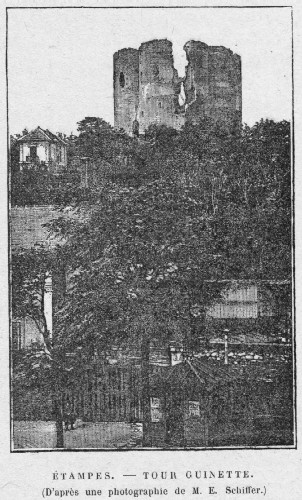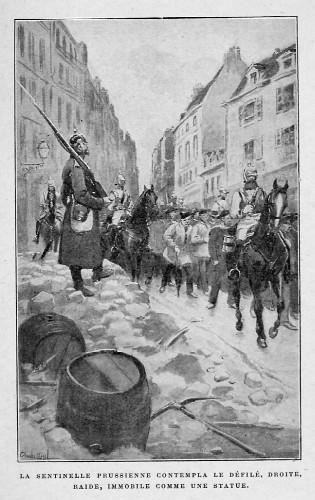|
|
V.
DE TOURY A ÉTAMPES
[pp.
35-38]
Au milieu de la confusion de leurs idées,
les prisonniers de Bricy se figuraient pourtant qu’on les délivrerait
au matin. Mais les premiers rayons de l’aube naissante ne tardèrent
pas à faire s’évanouir ce vacillant espoir.
Le curé de l’endroit vint les visiter
avant le départ et voulut bien, sur leur prière, intercéder
pour eux auprès du commandant de place; la démarche, hasardeuse,
fut sans succès: le chef prussien se refusait à les recevoir
et à les entendre.
Il n’y avait donc plus à s’y méprendre:
on les considérait comme des prisonniers de guerre, et on les emmenait
en captivité pour leur faire expier un crime imaginaire.
La course recommença, et cette nouvelle
étape ne devait être malheureusement que la répétition
de la première.
On défila d’abord entre une double
haie de Prussiens échelonnés du portail de l’église
à la route. Chaque prisonnier reçut pour la journée
une légère ration de pain, et l’on quitta Toury dans l’ordre
de marche adopté, sous les cris assourdissants des conducteurs
et sous leur farouche surveillance.
Les brutalités de la veille se renouvelèrent
dès les premiers pas. A Toury même, un vieillard de soixante-huit
ans, Penot Louis, qui cherchait à se réfugier dans une maison, [p.36] fut frappé,
ensanglanté, à moitié assommé, et ne put qu’à
grand’peine rejoindre la colonne.
A Angerville se produisit un incident des
plus émouvants. Parmi les prisonniers se trouvait un jeune homme
de cette ville, enlevé sans motif plausible, sur le seuil de sa
porte, le dimanche précédent, 9 octobre. Sa femme l’ayant
aperçu dans le cortège au moment du passage, s’élança
vers lui avec un bébé dans les bras, franchit le double rang
des Prussiens de l’escorte, et vint se jeter à son cou en s’écriant:
«Embrasse ton enfant…. Ils ne t’emmèneront pas, les barbares!
Je te défendrai contre eux tous…. Tu resteras avec moi, ou je te suivrai…»
Pendant une courte minute, on les vit mêler leurs pleurs et couvrir
de baisers le blond chérubin.
Mais il était dit qu’un tableau aussi
touchant ne pourrait attendrir les soldats d’outre-Rhin: avec une violence
qu’un français ne connaît pas, ils séparèrent
cette jeune épouse de son infortuné mari et la poussèrent
hors des rangs. Elle suivit la colonne, courant affolée, s’arrachant
les cheveux, bravant même les coups de sabre d’un cavalier impatienté
de la scène. «Reste, criait le prisonnier avec angoisse,
reste, je t’en supplie….Je reviendrai bientôt…». Il lui tint
parole: le soir, à Étampes, il put tromper la surveillance
des gardiens et s’échapper de leurs mains.
Ce fut à Angerville aussi que les prisonniers
commencèrent à recueillir les élans de sympathie
de tous les cœurs français. Epuisés par des réquisitions
incessantes, ruinés par l’occupation prussienne, les habitants des
villes, comme ceux des moindres hameaux, trouvaient encore le moyen de
secourir leurs frères malheureux, de les encourager, d’atténuer
leurs souffrances en leur jetant d’une fenêtre ou par une porte entr’ouverte
un morceau de pain ou un fruit qui était accepté avec reconnaissance.
Partout à travers la France, en Champagne comme en Alsace, se manifesta
la même charité patriotique.
Les soldats français n’avaient guère
à se louer des procédés de l’ennemi; ils étaient
cependant moins exposés aux violences prussiennes que les prisonniers
civils. Les gardiens [p.37] n’avaient
point à user de ménagements envers des paysans qu’ils considéraient
comme des francs-tireurs et des bandits; leur mot d’ordre était
de les traiter avec le plus de dureté possible, et ils observaient
strictement la consigne.
La faim, la soif, la fatigue et les coups
avaient rendu méconnaissables d’ailleurs la plupart des gens de
Bricy, et lorsqu’un clairon, de ses sons criards et stridents, annonçait
une halte, ils s’affaissaient à terre, muets et désespérés,
n’ayant plus même la force de se plaindre.
De distance en distance, on avait rencontré
au cours de cette étape des détachements de Bavarois conduisant
vers Orléans des chariots d’approvisionnements. On devait voir
plus tard, par les immenses convois qui obstruaient les chemins et se
croisaient en tous sens sur les routes des départements de l’Est,
que le service de l’intendance allemande ne chômait pas et que l’ennemi
ne se privait guère de rançonner les populations.
A quelques kilomètres d’Étampes
paissait, près de la route, un nombreux troupeau de vaches réquisitionnées
dans le pays et gardées par des soldats hessois qui fumaient leurs
longues pipes d’un air mélancolique, songeant peut-être aux
pâturages verdoyants de la vallée du Rhin. [p.38]
Les prisonniers entrèrent à Étampes sur quatre rangs;
leur mine pitoyable y provoqua des sentiments divers: les femmes pleuraient,
les hommes s’indignaient, l’ennemi comme toujours menaçait et injuriait.
Sur la porte de chaque maison était griffonnée à la
craie une inscription allemande indiquant le logements des soldats et des
chefs, et sur chaque seuil se tenaient des Prussiens de haute stature, cachant
mal sous leur barbe blonde un visage farouche et un regard endurci.
On fit pénétrer les prisonniers,
à l’extrémité nord de la ville, dans le jardin entouré
de murs d’un établissement industriel, où leur fut faite
une distribution de pain.
La crainte d’être fusillés, entretenue
dans leur esprit par des gardiens bavarois qui ne leur épargnaient
ni cyniques railleries ni gestes comminatoires, obsédait encore
à ce moment quelques vieillards. L’un d’eux même, Eugène
Gigou, — dont nous raconterons plus tard la triste fin, — semblait avoir
perdu la raison; à tout instant, il quittait le rang pour débiter
des propos incohérents, et chaque fois y était ramené
avec la crosse ou la baïonnette.
L’obscurité enveloppait déjà
l’intérieur de l’établissement où les prisonniers
allaient être enfermés. Cette seconde étape de quarante
kilomètres parcourus aussi misérablement avait mis le comble
à leurs fatigues, et lorsque, au quatrième étage, ils
purent s’étendre sur la paille dont était recouvert le plancher,
la plupart s’endormirent d’un sommeil accablant, hanté de lugubres
cauchemars. Plusieurs cependant veillaient et songeaient à fuir:
prenant les allures de commerçants de la ville, de visiteurs charitables,
ils passèrent sans être inquiétés devant les
sentinelles prussiennes et recouvrèrent ainsi la liberté.
|
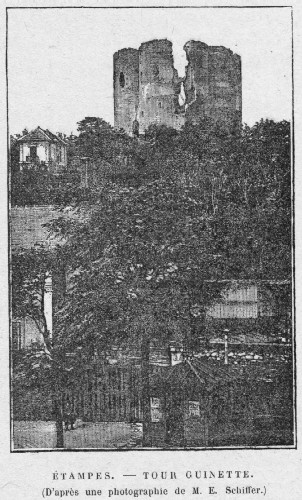
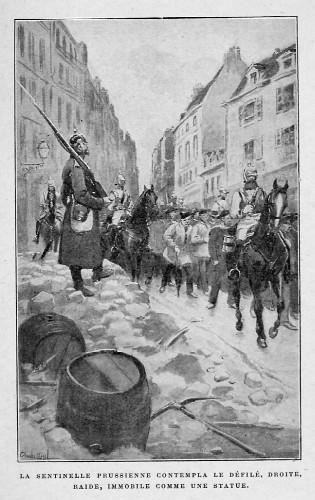
|
|
VI. D’ÉTAMPES A CORBEIL
[pp.
41-44]
Les prisonniers civils se revirent le
lendemain un peu moins accablés physiquement, mais tout aussi désolés.
Harcelés par les conducteurs, poussés par les baïonnettes,
marchant et courant sans répit, chaque jour en effet les éloignait
du village de Bricy, et longtemps encore ils devaient ignorer la fin de
cette triste odyssée.
Dès le matin, deux médecins
les vinrent visiter et délivrèrent des entrées d’hôpital
aux plus âgés et aux plus maltraités: Hoyau François
(soixante-dix ans), Cachin Louis (soixante-dix sept ans) et Labbé,
dont j’ai déjà parlé.
Des fenêtres de l’établissement
occupé, on apercevait la ville entière d’Étampes, au
pied du plateau qui la domine. La voie de chemin de fer était déserte,
aucun train ne la sillonnait, aucune locomotive n’y faisait entendre son
souffle bruyant; les rues, où vaguaient des troupiers allemands,
ne présentaient ni l’animation du réveil ni le mouvement des
affaires matinales; un morne silence planait sur toutes les maisons grises
de la petite cité; des corbeaux seuls croassaient au sommet de la
vieille tour Guinette.
Les prisonniers ne reçurent aucun aliment
ce matin-là, et ils auraient jeûné si la charité
des habitants ne leur fût venue en aide.
A la sortie d’Étampes,
un jeune officier bavarois, au visage imberbe, à la physionomie intelligente,
fut surpris de voir [p.42]
des paysans à la suite des soldats prisonniers
et s’informa du motif de leur arrestation. Il parut indigné d’apprendre
qu’aucune cause avouable ne l’expliquait. Mais que pouvait-il contre l’ordre
venu de haut, du général von Wittich lui-même, de chasser
comme un troupeau ces pauvres gens vers les frontières de Prusse?
L’étape fut marquée de nouveau
par de pénibles incidents et vit se renouveler les scènes
de brutalité des jours précédents.
On avait, en quittant Étampes, laissé
la route de Paris pour suivre celle de Corbeil. Les prisonniers civils
ne le regrettèrent pas, car jusqu’ici la crainte d’être occupés
aux travaux du siège avait persisté en leur esprit. Ils
se rappelaient, en effet, que les Prussiens avaient usé déjà
de ce procédé devant Strasbourg, et il n’en coûtait
certes guère à un ennemi aussi peu scrupuleux de rééditer
sous les forts de la capitale cette violation des lois de la guerre.
A mesure que l’on avançait, l’occupation
du pays par les troupes allemandes s’accentuait de plus en plus: la voie
creusée, défoncée en maints endroits, accusait qu’une
lourde artillerie, de pesants caissons l’avaient sillonnée fréquemment;
des fers de chevaux, épars ça et là, indiquaient qu’un
cavalerie nombreuse l’avait aussi parcourue. De loin en loin, sur la lisière
d’un bois ou au milieu d’une plaine, apparaissaient les restes d’un camp
abandonné; dans le fossé du chemin, le cadavre d’un cheval
à moitié dévoré ou les roues brisées
d’un chariot.
A quelque distance d’Étampes, le cortège
se croisa avec un détachement bavarois. On a souvent répété
que les soldats allemands, d’un tempérament apathique et rêveur,
témoignaient dans cette guerre, où ils étaient forcément
engagés, d’un sentiment d’humanité, qui faisait complètement
défaut aux Prussiens du Brandebourg. Le fait fut plus d’une fois
constaté. Mais la Bavière, en France, avait à cœur
d’imiter son alliée et de marcher sur ses traces: les soldats de
Munich, à part quelques exceptions, ne le cédaient en rien,
pour la rapacité et la cruauté, aux soldats de Berlin. [p.43]
A Boissy-le-Cutté, charmant village
entouré de collines, où l’on descend par une route percée
dans la forêt et bordée de roches granitiques, les habitants,
accourus vers les prisonniers avec du pain et de l’eau, se virent chassés
par les Prussiens qui s’emparèrent des aliments, répandirent
le liquide et brisèrent les vases.
La faim et la soif cependant se faisaient
vivement sentir. On s’était hasardé à arracher des
navets dans un champ qui longeait la route, mais toujours devant soi s’étaient
dressées les impitoyables baïonnettes ennemies.
A la Ferté-Alais, deux ou trois prisonniers
civils purent se dérober au joug de leurs tyrans, grâce au
concours de personnes vraiment françaises qui, pour faciliter leur
évasion, ne craignirent point de s’exposer à la fureur du
vainqueur.
Non loin de là, près d’une fontaine
où l’on avait fait halte, les habitants d’un village voisin s’étaient
approchés, eux aussi, désireux d’offrir aux prisonniers
quelques provisions. Mais, comme ceux de Boissy-le-Cutté, ils n’eurent
pas cette consolation et furent obligés de fuir, à travers
champs, sous les coups de sabre des cavaliers prussiens. Une jeune fille
seule brava les menaces tudesques et ne s’éloigna qu’après
avoir donné aux français tout le pain qui emplissait son
tablier.
En cet endroit, un lièvre imprudent,
dérangé du gîte et troublé dans le songe par
un chien qui le suivait de près, vint donner tête baissée
dans un groupe de soldats français qui facilement le saisirent.
Déjà nos troupiers se demandaient quel parti ils allaient
en tirer, lorsque les Prussiens, intervenant, s’emparèrent avec
autorité du délicat gibier. C’était le droit du plus
fort, mais était-ce le meilleur? Dans les moindres faits de cette
guerre se retrouve, ponctuellement suivi, le précepte de M.
de Bismarck: « La force prime le droit».
Plus loin, à Fontenay-le-Vicomte, les
femmes plus que les hommes encore manifestèrent leur indignation
de voir emmener en captivité des vieillards en blouse,courbés
et affaissés, le visage tuméfié, les pieds ensanglantés. [p.44]
Il était cinq heures lorsqu’on aperçut
les premières maisons de Corbeil. Les pavés de la route,
enlevés de place en place, avaient été entassés
en prévision de la défense; l’idée de la résistance
avait dû être abandonnée, mais au moins ne s’était-on
pas borné ici à de simples déclamations.
A l’entrée de la rue principale, juchée
sur un tas de pierres, une sentinelle prussienne lança son «Wer
da!» réglementaire quand apparut la tête du cortège;
puis, d’un mouvement automatique ayant replacé l’arme sur l’épaule,
elle contempla le défilé, droite, raide, immobile comme
une statue.
La faiblesse chez quelques prisonniers était
si grande alors qu’un meunier de Bricy, Martin, père de huit enfants,
tomba sans connaissance et se fendit la tête sur le pavé
de la rue; transporté à l’hospice, il put revenir au village
après la guérison de sa blessure.
Des rations de pain furent enfin distribuées
à la porte de l’église Saint-Spire, qui allait servir de
refuge. Mais, comme à Toury, les places étaient occupées
déjà par les soldats quand les civils entrèrent,
et ce ne fut qu’à grand’peine que ceux-ci purent s’asseoir sur les
marches de l’autel.
La nuit fut longue et le sommeil ne vint guère.
La position, du reste, n’était pas tenable; à chaque instant
il fallait se lever, s’étirer ou faire quelques pas pour reposer
ses membres de la dureté du carreau. Quand le jour, impatiemment
désiré, pénétra sous la voûte, les soldats
plièrent leurs couvertures, secouèrent leurs capotes, et tous
les prisonniers, délogés de l’église, défilèrent
encore une fois entre deux rangs de soldats bavarois au regard moqueur et
à l’air insultant.
|
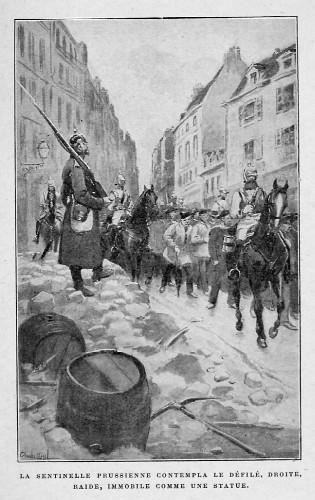
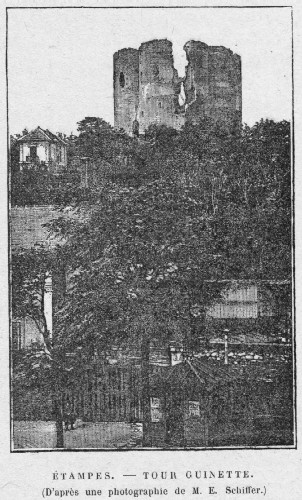
|
|
|
BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Gustave FAUTRAS, Guerre de 1870-1871. Cinq mois de captivité.
Récits d’un prisonnier civil en Prusse [in-18 ou in-16; in-16,
XIII+192 p.], Orléans, Séjourné, 1873.
Gustave FAUTRAS, De la Loire à l’Oder. Récits de captivité
d’un prisonnier civil en 1870-1871 [édition remaniée de
l’ouvrage précédent; in-8°; VIII+191 p.; figures] Paris,
Hachette & Cie [«Bibliothèque des écoles et des
familles»], 1899. 2e édition, 1900. 3e édition,
1904. 4e édition, 1907. 5e édition, ?. 6e édition:
De la Loire à l’Oder. Récits de captivité d’un
prisonnier civil en 1870-1871, par Gustave Fautras, inspecteur de l’enseignement
primaire, officier de ll’instruction publique. Ouvrage illustré de
40 gravures. Couronné par l’Académie des Sciences Morales et
Politiques. 6e édition 1914 .
Anne-Marie SERVATIUS et Bernard GINESTE [éd.],
«Gustave Fautras: De la Loire à l’Oder,
chapitres 5 et 6 (1899)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-fautras-delaloirealoder.html,
2003.
Autres
ouvrages de Fautras
Henri PROVOST & Gustave FAUTRAS, Aux enfants de la France,
chants de l’école et de la famille, à une et à deux
voix [grand in-8°; 240 p.; planches; musique], Paris, Ch. Delagrave,
1899.
Gustave FAUTRAS, Autour d’un champ de bataille
(Coulmiers) [in-8°; 191 p.; figures], Paris, Hachette [«Bibliothèque
des écoles et des familles»], 1901.
4e édition en 1914.
Gustave FAUTRAS, A travers l’année
tragique [in-8°; 190 p.; figures], Paris, Hachette [«Bibliothèque
des écoles et des familles»], 1903. 2e édition en
1906. 3e édition en 1911 [l’exemplaire de la
BNF a un envoi autographe de l’auteur à Maurice Barrès].
Gustave FAUTRAS, Souvenirs et impressions
de 1870-1871: le 3e Bataillon de la garde mobile de Seine-et-Oise pendant
le siège de Paris [in-8°; 154 p.; figures; carte],
Paris, Hachette, 1906.
Gustave FAUTRAS, Gretha, épisode
de la guerre de 1870. Avec lettre-préface de M. Frédéric
Masson (1847-1923) [in-16 (19 cm); XV+312 p.], Paris, Hachette.
1915. Réédition 1916 [l’exemplaire de la
BNF a un envoi autographe de l’auteur à Maurice Barrès].
Gustave FAUTRAS, La Dictée au certificat
d’études [in-8°; 128 p.], Paris, A. Hatier, 1932.
Gustave FAUTRAS, Pontoise et ses environs
[in-16; 96 p.; figures], Pontoise, L’Écho pontoisien, 1931.
Gustave FAUTRAS, 120 dictées données
au certificat d’études [in-16 (19,5 cm sur 12,5], Paris, A. Hatier,
1951
.
Autres sources
Le Corpus Étampois mettra ultérieurement
en ligne d’autres sources locales sur les événements de
la guerre de 1870 dans le pays étampois.
|
 Ces Récits de
captivité d’un prisonnier civil en 1870-1871 rédigés
par un inspecteur de l’enseignement primaire, furent cinq fois réédités
de 1899 à 1914 par Hachette dans sa collection «Bibliothèque
des écoles et des familles». Cet ouvrage
couronné par l’Académie des sciences morales et politiques
est l’un de ces livres qui ont inculqué au peuple de France la haine
d’un ennemi désormais héréditaire, le Boche. Il raconte
d’une manière extrêmement détaillée les exactions
subirent un groupe de prisonniers civils arrachés arbitrairement à
leur petit village de Bricy, à 16 km au nord-ouest d’Orléans,
et déportés en Prusse contre toutes les lois de la guerre.
Ces Récits de
captivité d’un prisonnier civil en 1870-1871 rédigés
par un inspecteur de l’enseignement primaire, furent cinq fois réédités
de 1899 à 1914 par Hachette dans sa collection «Bibliothèque
des écoles et des familles». Cet ouvrage
couronné par l’Académie des sciences morales et politiques
est l’un de ces livres qui ont inculqué au peuple de France la haine
d’un ennemi désormais héréditaire, le Boche. Il raconte
d’une manière extrêmement détaillée les exactions
subirent un groupe de prisonniers civils arrachés arbitrairement à
leur petit village de Bricy, à 16 km au nord-ouest d’Orléans,
et déportés en Prusse contre toutes les lois de la guerre.