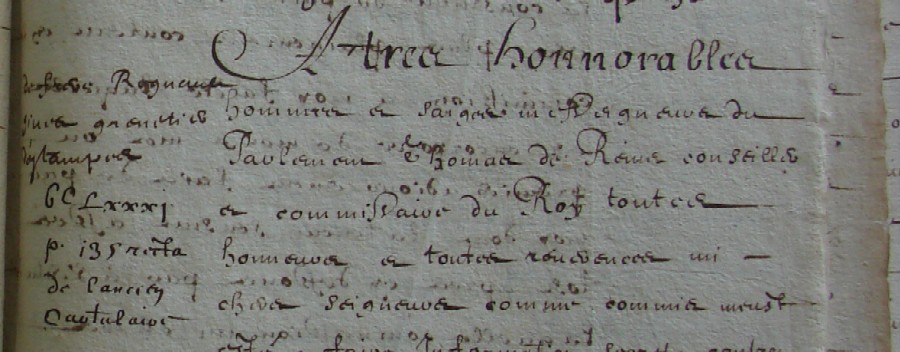|
INTRODUCTION
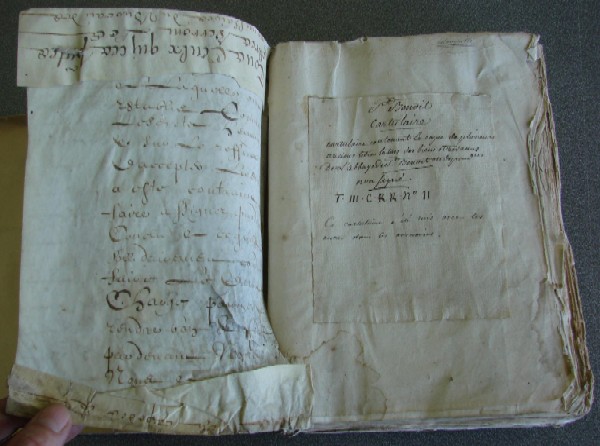 Le Moyen Age étampois est
encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici
que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation
reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire
du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à
fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs
renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes
au début du XIVe siècle.
Le Moyen Age étampois est
encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici
que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation
reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire
du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à
fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs
renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes
au début du XIVe siècle.
Ce rapport, en date du 24 juillet
1323, avait été copié sur l’original au début
du XVe siècle par un moine de Saint-Benoist-sur-Loire, dans
un cartulaire qui a lui-même disparu entre 1790 et 1848.
Heureusement un autre moine, au
XVIIe siècle avait recopié de nombreuses pièces
de ce premier cartulaire, dont celle-ci et deux autres relatives à
la même affaire, dans un nouveau cartulaire, qui fut transféré
à Bourges à la fin du XVIIIe siècle; grâce
à quoi il échappa tant aux bouleversements de la Révolution
qu’au bombardement allemand qui détruisit
en 1940 la presque totalité des anciennes archives départementales
du Loiret.
C’est de ce cartulaire de Bourges, jusqu’à
présent négligé, et insuffisamment utilisé
par les éditeurs du Cartulaire de Saint-Benoît-sur-Loire,
que nous tirons donc, pour commencer, ce document des plus pittoresques.
Merci à toute personne qui aurait la gentillesse
de nous suggérer quelque amélioration que ce soit à
cette première édition.
Nous commençons par résumer notre affaire dans l’ordre chronologique,
avant de donner le texte original en regard avec une
traduction en français moderne. En effet ce dossier ne
respecte pas rigoureusement l’ordre chronologique. Thomas de Reims
y a fondu, d’une manière parfois peu claire, différents
courriers et rapports qui se sont agglutinés les uns aux autres
au long de la procédure, les uns en moyen-français (pour
les courriers de Thomas lui-même, du prévôt de Janville
et de ses deux sergents), et les autres en latin (pour ceux du roi).
Nous y joignons plusieurs annexes, notamment ce qu’ont écrit Honoré
Frégier et Viollet-le-Duc, le premier sur l’Histoire de l’administration de la police de Paris
de 1182 à 1350, le deuxième sur la prison de l’Officialité de Sens.
B.G., septembre 2007
|
Au début du printemps 1323, fin mars
ou début avril, l’écuyer Rivet du Plessis, le clerc
Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et un certain Martin
de Vierville, valet du même chevalier, tendent un guet-apens
à un moine de Saint-Benoît-sur-Loire, le blessent mortellement,
lui arrachent les yeux et tentent de lui arracher la langue.
La scène se passe près
de Garancières-en-Beauce, alors que ce moine, nommé
Regnault Givet, se rendait du Plessis-Saint-Benoist à Sainville,
deux villages qui sont des possessions de son monastère. Lui-même
était grenetier d’Étampes, c’est-à-dire officier
du grenier des moines. Ce grenier se trouvait sans doute en la paroisse
Saint-Pierre d’Étampes, une autre de leurs possessions.
Les autres détail du crime ne
sont pas connus. Son mobile est vraisemblablement à chercher
dans un contentieux relatif à un arriéré de redevances
féodales, qui de fait sera réglé deux ans plus
tard, par un acte que nous éditerons plus tard. Tant Rivet du
Plessis que Guy d’Authon sont des nobliaux, vassaux sur leurs terres
du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire.
|
|

Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter) |
Le 12 avril, à la nouvelle de cette atrocité, le roi Charles
IV adresse un ordre de mission à son conseiller Thomas de
Reims: il doit faire enquête et arrêter tous les suspects,
en premier lieu Rivet du Plessis, Guyot d’Authon et un certain Lision.
Au cas où il pourrait s’en
emparer, il devra les transférer à la prison du Châtelet
de Paris. En effet le crime qu’il ont commis relève directement
de la justice du roi parce que le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire
est sous sa protection spéciale. Au cas contraire, Thomas de
Reims est chargé d’entamer à leur encontre une procédure
de bannissement, avec cette consigne précise: il doit prendre
garde à respecter le droit coutumier local.
Notre commissaire se rend donc
à Étampes, où il séjourne apparemment
en un hôtel qui arbore l’enseigne de la Fontaine Tristan. Malgré
tous ses efforts, il ne parvient pas à mettre les mains sur
les suspects. Son enquête le persuade cependant que les coupables
sont bien Rivet du Plessis et Guyot d’Authon. Lision n’est en fait que
le surnom du dit Guyot. Il a identifié cependant un troisième
complice, Martin de Vierville, valet de Guy d’Authon.
|
Son enquête le persuade également de ce que certains
faits sont également à reprocher à Guy d’Authon
lui-même, quoiqu’il reste perplexe sur la manière de
les qualifier au pénal. Nous n’en saurons pas plus sur ce point,
qui ne paraît pas avoir eu de suites.
N’ayant pu s’emparer des
coupables, Thomas les convoque à Étampes pour le mercredi 4 mai, en vain. Il s’interroge alors
sur la procédure à suivre pour prononcer le bannissement
des coupables et la confiscation de leurs biens d’une manière
qui soit conforme au droit coutumier local.
En l’occurrence, le cas est litigieux.
Authon-la-Plaine (en partie) et le Plessis-Saint-Benoist, comme du
reste le prieuré de Saint-Pierre d’Étampes, forment
une enclave indépendante dans le bailliage d’Étampes.
C’est une châtellenie qui relève, depuis que Philippe
le Bel en a ainsi décidé en 1296, de la prévôté
de Janville-en-Beauce et donc du bailliage d’Orléans.
|

Authon-la-Plaine en 2006 (© Michel De Pooter)
|
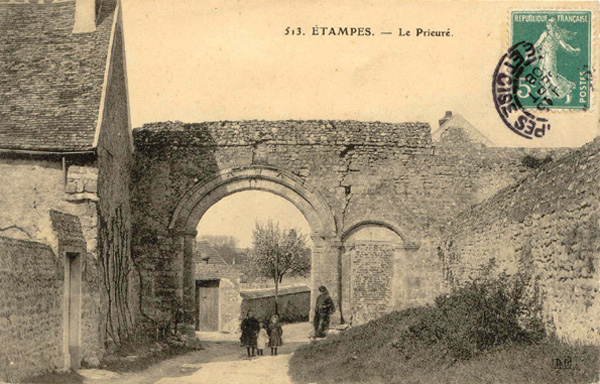
Restes du Prieuré Saint-Pierre d’Étampes en
1908
|
A
Janville il faut laisser passer un an entre la première convocation
et le bannissement. A Étampes il suffit de trois convocations
successives à des intervalles de temps laissés à
l’appréciation du bailli. Thomas décide de suivre la
procédure en usage à Paris. On les convoquera trois fois
à des intervalles de quinze jours, en y ajoutant largement une
quarantaine de jours.
Ce même jeudi de l’Ascension,
5 mai, il informe de sa
décision le prévôt de Janville, Guillaume de La
Touche. Ce prévôt a sous ses ordres, à cette date,
au moins trois sergents: Robin Thureau, Jean Lebarbier et Berthelot
Aignean. Ce dernier n’apparaît qu’une fois, comme crieur public
au marché de Janville, qui tombe le samedi. Les deux premiers en
revanche se déplacent à travers la prévôté
de Janville. |
Le
samedi qui suit, 7 mai, Guillaume de
La Touche répercute par écrit les ordres de Thomas de Reims
à ses sergents Robin et Jean.
Dès le lendemain, dimanche 8 mai, ces derniers sont
à Authon, où ils se présentent à la maison
de Rivet au Plessis, puis à celle du chevalier Guy d’Authon,
à son hôtel d’Hérouville. Le lendemain, lundi 9 mai, ils se rendent à Vierville.
Le but est de notifier aux trois suspects qu’ils sont convoqués
par le commissaire du roi à Janville pour le dimanche 22 mai.
Naturellement nos sergents
ne trouvent pas les intéressés chez eux. Ils trouvent
cependant à Hérouville «la mère du dit
Guyot», et, au Plessis, des «gens qui règlent en
son nom les affaires du dit Rivet». A Vierville on leur indique
que Martin n’a pas de résidence au pays. La veille du jour dit, samedi 21,
nos deux sergents font leur rapport par écrit sans doute sur
la demande de Thomas. |

Vierville en 2006 (© Michel De Pooter)
|
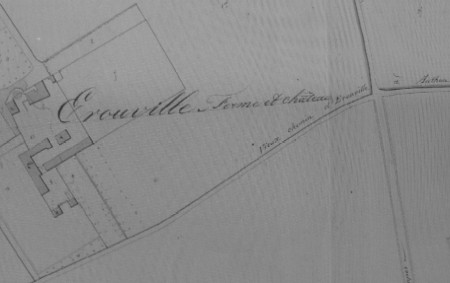
Hérouville et chemin d’Authon sur le cadastre napoléonien
|
Dimanche 22 mai, journée de la deuxième
convocation, personne ne se présente, et Thomas de Reims adresse
un nouvel ordre de mission aux deux sergents.
Ils se rendent à nouveau,
dès le lendemain, lundi 23 mai,
au Plessis, et à Hérouville, puis à Vierville,
comme l’atteste une lettre de Guillaume de La Touche à Thomas
de Reims en date du samedi 28:
on ne les a pas trouvés davantage, on a informé les anciens
voisins de Martin de Vierville, et les habitants des maisons de Rivet
et de Guyot, qu’ils étaient à nouveau convoqués
à Janville pour le dimanche 12 juin. De plus le prévôt
fait proclamer cette convocation au marché de Janville, samedi 28
(et probablement aussi tous les samedis suivants).
Entre-temps le premier rapport
de Thomas de Reims au Parlement de Paris a été soigneusement
examiné et réponse lui est faite le mercredi 1er juin. On ne paraît
pas lui avoir répondu sur la question de la culpabilité
du chevalier Guy. En revanche on approuve la procédure qu’il a
suivie.
|
Le 12 juin, jour
fixé pour la deuxième convocation en règle à
Janville, Thomas de Reims y vient à nouveau, sans que personne
se présente. Il les convoque alors à la fois pour le
jeudi 16 juin à Étampes, précisément à
l’hôtel de la Fontaine Tristan, où apparemment aura lieu
une audience publique d’enquête sur le fond, et pour le dimanche
3 juillet à Janville, sous peine de mettre en branle la procédure
de bannissement.
On notera au passage que cette mention
d’un hôtel étampois est peut-être la plus ancienne
qui nous soit parvenue.
Le lendemain 13 juin, Thomas se rend en personne aux trois
lieux en question notifier solennellement cette double convocation.
A Hérouville il voit la mère de Guyot, femme du chevalier
Guy d’Authon. A Authon même il renouvelle la convocation devant
l’église paroissiale. Au Plessis il voit plusieurs personne
de la maison de Rivet. Enfin il donne ordre au prévôt de
Janville et à ses sergents de renouveler cette convocation au marché
de Janville, samedi 18 juin à
venir. |

Tristan et Iseult à la Fontaine
(ivoire du XIVe siècle)
(Le roi Marc les surveille, mais Iseult
voit son reflet)
|

Tribunal ecclésiastique (3e quart du XIIIe siècle)
|
Au
jour dit de la troisième convocation solennelle à Janville,
dimanche 3 juillet, un certain
Jean Legrand de Janville, qui se dit cousin de Rivet autant que
de Guyot, fait état d’une lettre de l’official de Sens.
Il apparaît que Guyot, fils du chevalier
Guy d’Authon, est clerc. Il a usé de cette qualité
pour esquiver la juridiction royale. Et plutôt que se rendre à
l’évêque de Chartres, qui peut-être l’aurait livré
au roi, il s’est constitué prisonnier au tribunal ecclésiastique
archidiocésain de Sens. Cette juridiction est alors en plein
essor, comme celle du roi dans le domaine de la justice laïque,
et rentre fréquemment en concurrence avec elle.
L’official de Sens va jusqu’à oser
convoquer devant lui le commissaire du roi. Jean Legrand demande au
curé de Janville de lui notifier officiellement cette convocation.
Thomas de Reims menaçant le même ecclésiastique
de mesures de rétorsion, la convocation n’est pas notifiée. |
Pendant
la même audience du 3 juillet,
le dit Jean Legrand de Janville avec un nobliau d’Authon, «Jean
de La Gravelle et plusieurs autres qui se disaient cousins des dits
Rivet et Guyot» présentent à Thomas de Reims une
étrange lettre du roi en laquelle le roi en personne lui ordonne
de respecter la coutume du pays.
Ils allèguent de plus que
Rivet du Plessis est en Italie. Le fondé de pouvoir du l’abbé
de Saint-Benoît-sur-Loire se récrie que tout le monde
sait qu’il est encore au pays.
Notre commissaire ne se démonte
pas et rappelle qu’on n’est qu’à la troisième convocation:
il ne prononcera pas de bannissement avant le 24 juillet.
|

Sceau de Charles IV le Bel
|
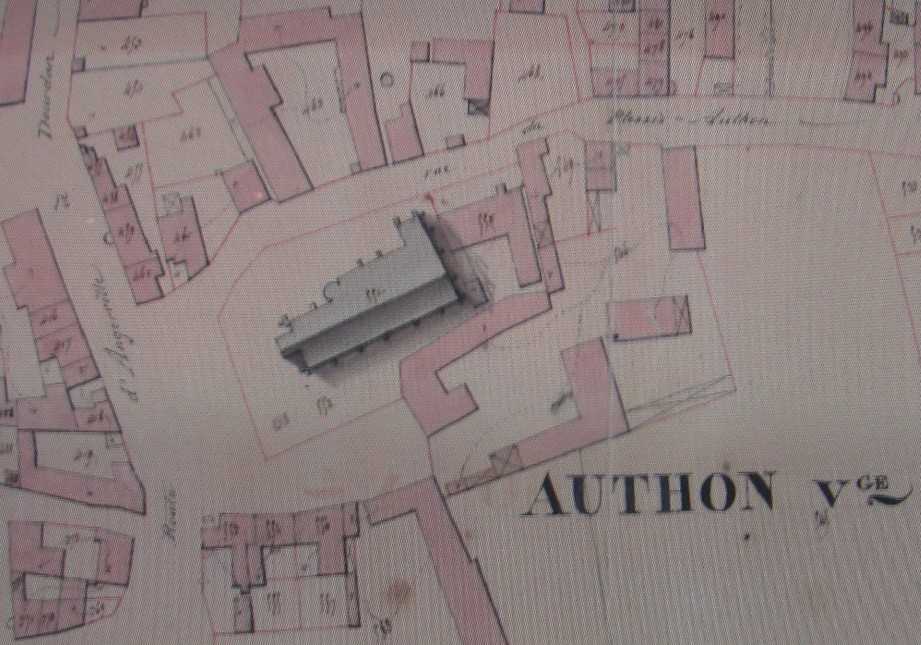
Eglise d’Authon sur la cadastre napoléonien
|
Probablement
ce même 3 juillet, il fait parvenir
un rapport au Parlement de Paris s’inquiétant de cette étrange
lettre du roi qui lui a été communiquée par ceux
qu’il est chargé de poursuivre.
Le lendemain lundi 4 juillet il se rend à nouveau
personnellement au Plessis, puis à Authon et à Hérouville.
Au Plessis, il voit de «bonnes gens» dans l’hôtel de
Rivet et «plusieurs aultres de ladicte ville». A Authon,
il fait à nouveau sa convocation pour le 24 juillet «au
lieu le plus public de la dite ville, devant l’église et devant
les Lépreux (devant les meisyaux)». Au manoir d’Hérouville,
même chose, «en la présence de la mère du dit
Guyot, des domestiques, de son grand-père et de plusieurs autres».
Dès le mercredi 6 juillet, apparemment, le Parlement
répond avec impatience (sous la forme d’une lettre du roi)
à son rapport du 3 juillet: le commissaire ne doit pas
tenir compte de quelque nouvelle lettre que ce soit. Cependant, comme
il ne recevra cette troisième commission que le dimanche 24
juillet, pendant la séance finale de cette procédure,
on doit se demander si cette date du 6 juillet donné par notre
seul manuscrit, qui est une copie de copie), ne serait pas une erreur
pour, par exemple, le 16: sexta (VI°) die pour undecima
(XI°) die.
|
Le 24 juillet enfin,
après avoir reçu en plein tribunal la réponse
du roi et l’avoir fait lire, malgré les protestations de «Jean
Legrand de Janville et Jean de La Gravelle», Thomas de Reims,
donne satisfaction au fondé de pouvoir de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
en constatant à nouveau le défaut des accusés,
et il procède à leur bannissement du royaume de France.
Il commande au prévôt de Janville de le faire «publier
et crier au dit pays, au lieu où on avait et a coutume de faire
ce genre de choses».
La procédure criminelle
proprement dite est terminée. Le Cartulaire de Bourges nous
a conservé cependant deux autres pièces postérieures
relatives à cette affaire, qui en constatent le règlement
au civil, par la constitution d’une rente au profit du monastère
de Saint-Benoît-sur-Loire. La deuxième de ces pièces
date du 11 juin 1324 et peut être consultée en cliquant ici. La
troisième date du 8 mai 1327 et peut être
consultée en cliquant ici.
|

Sceau de Charles IV le Bel
|
|
Thomas de Reims, commissaire de Charles
IV
Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist
procédure criminelle, du 12
avril au 24 juillet 1323
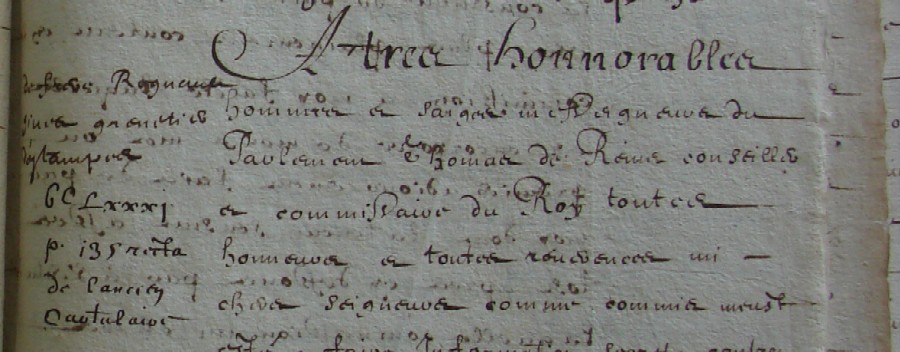
Texte du Cartulaire
de Bourges (XVIIe siècle)
|
Traduction proposée
par Bernard Gineste (2007) |
[en marge:] de frere Regnault / givet grenetier
/ d’estampes / GC lxxxi / p. 135 recto
|
|
(f°210r°) (10) A tres honnorables / hommes et sargens messeigneurs
du / Parlement Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy
/ honneurs et toutes reverences mi (15) chers seigneurs comme commis
meust / esté a faire information secrete contre / Rivet du
Plesseis Guiot dauton dict / Lision et leurs complices sur le / crevement
des yeux frere Regnaut (20) givet moine de S. Benoist et / gretenier [lisez: grenetier] d’estampes
en laquelle / commission on me mandoit que en aus [lisez: cas] (f°210v°)
que je [trouvois
(rayé)] trouverois / coupables doudict faict je les
/ prisse et enportasse ou chastellet / a Paris et arrestasse et saisisse
(5) leurs biens et ou cas ou je ne / trouverois les personnes de
ces / maufacteurs que je les appellasse / a ban et procedasse en icelluy
gardéé / coustume du pais si comme il (10) est plus plainement
contenu en la / commission a moy faicte laquelle / est encorporéé
de mot a mot ou / premier adiournement faict de par / moy dont la teneur
sensuit asses (15) tost apres cy dessous par la vertu de / laquelle
commission mi chers / seigneurs je fis l’information / qui mandéé
mestoit a faire laquelle / je envoyay pardevers vous avec (20) un procés
faict contre monsieur / Guy dauton chevalier pere doudict / Guyot
qui coulpables estoit trouvés (f°211r°) en aucunes
choses par la vertu de / ladicte information pour avoir / vostre advis
de la qualité de / la coulpe dudict chevalier et (5) trouvay par
icelle information / lesdicts Rivet Guiot et un aultre / que l’on appelle
Martin de / Vierville estre coulpables dudict / faict pourquoy je fis mon
povoir (10) de eux prendre si peu les eusse / avoir peu mais les cautelles
/ manieres et engins que je scos / et pos lesquels je ne pos avoir / nullement
et pour ce ne les (15) mein je pas ou chastellet comme / commis m’estoit
pour laquelle / chose je fis [saisir (rayé)] saisir les / biens des dessusdicts
et proceday / [blanc de 2 ou 3 mots]
au ban contre eux en (20) la forme et maniere qui sensuit / quar je
manday a guillaume (f°211r°) De la touche prevost d’yenville
/ et a Robin Tureau et a / Jean Lebarbier que il adiournassent / pardevant
moy les dessusdicts en (5) la forme et maniere que [blanc d’1 ou 2 mots] / ou dict adiournement
la teneur dudict / adiournement sensuit
|
[Rapport
de Thomas de Reims
aux membres du Parlement]
Aux très honorables
hommes et sergents messieurs du Parlement, Thomas de Reims, conseiller
et commissaire du roi, honneurs et toutes révérences.
Chers messieurs, il m’avait été
donné mission de faire secrètement enquête sur
Rivet du Plessis, Guyot d’Authon surnommé Lision et leurs complices
relativement au crèvement des yeux du frère Regnault
Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes.
Dans cette commission on m’ordonnait,
au cas où je trouverais les coupables du dit forfait, de
les arrêter et de les emmener au Châtelet à Paris
et de faire arrêt et saisie de leurs biens; et au cas où
je ne trouverais pas les personnes de ces malfaiteurs, de les convoquer
à ban et d’y procéder en respectant la coutume du pays,
comme il est précisé plus au long dans l’ordre de mission
qui m’a été adressé, lequel est cité intégralement
dans la première convocation faite sous mon autorité,
dont le contenu sera bientôt reproduit ci-dessous.
En vertu de cet ordre de mission
j’ai fait l’enquête qu’on m’avait confiée et je vous
l’ai envoyée avec un procès verbal relatif au chevalier
monsieur Guy d’Authon, père du dit Guyot, qui s’avérait
coupable de certaines choses comme il ressortait de cette enquête,
pour avoir votre avis sur la qualification à donner aux faits
reprochés au dit chevalier.
Et j’ai trouvé par
cette enquête que les dits River et Guyot, ainsi qu’un autre
que l’on appelle Martin de Vierville étaient coupables du
dit forfait. C’est pourquoi j’ai fait mon possible pour les arrêter
et j’aurais bien pu les avoir si avaient réussi tous les stratagèmes,
procédés et ruses que j’ai pu imaginer. Je n’ai pu
les avoir et c’est pourquoi je ne les ai pas mis au Châtelet
comme mission m’en avait été donnée.
Pour cette raison j’ai fait saisir
les biens des susdits et j’ai procédé au ban contre
eux en la forme et manière qui s’ensuit, car j’ai mandé
à Guillaume de La Touche, prévôt de Janville,
à Robin Thureau et à Jean Lebarbier qu’ils convoquent
devant moi les susdits en la forme et manière [qui se trouve]
dans la dite convocation. Voici le texte de la dite convocation.
|
Guillaume / de la la Touche prevost
d’yenville a / Robin Tureau et a Jean Lebarbier (10) sergents Notre
Seigneur le Roy / en la Prevosté dyenville et ou / ressort
d icelle a cil ou a ceux / d’eux a [sic]
qui ces lettres verront / Nous avons receü
les lettres de (15) honnorable homme et saige maistre / Thomas de
Rems [Thomas de
Rems] conseillier du / Roy au prevost d’yenville
Salut / Nous avons receü les lettres / dudict Seigneur contenant
la forme (20) qui s’ensuit
|
[Le
prévôt de Janville à ses sergents]
Guillaume de La Touche, prévôt de Janville, à
Robin Thureau et à Jean Lebarbier sergent de notre seigneur
le roi en la prévôté de Janville, à celui
ou à ceux qui consulteront cet acte.
Nous avons la lettre de honorable
homme et sage maître Thomas de Reims.
[Thomas
au prévôt de Janville]
[Thomas de Reims], conseiller
du roi, au prévôt de Janville, salut. Nous avons reçu
la lettre du dit Seigneur présentant le texte que voici.
|
 Carolus Dei
gratia / francorum et Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro
(f°212r°) Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem
et dilectionem ad / nostrum nuper pervenit auditum / fama publica
referente quod (5) Petrus Rives et Guiotus dauton / filius guidonis
dauton militis / et quidam vocatus Lisius domicellus / et nonnulli
alii eorum complices / in hac parte religiosum virum (10) fratrem
Renaudum gives monachum / monasterii sancti Benedicti supra / Ligerim
ac grenetarium de Stampis / euntem de quadam domo dicti / monasterii
vocata de plesseyo apud (15) Sainville [sic]
pensatis insidiis / invaserunt proditionaliter prope
/ villam de garenciriis ipsumque / monachum letaliter vulnerarunt /
et ambos oc[
Carolus Dei
gratia / francorum et Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro
(f°212r°) Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem
et dilectionem ad / nostrum nuper pervenit auditum / fama publica
referente quod (5) Petrus Rives et Guiotus dauton / filius guidonis
dauton militis / et quidam vocatus Lisius domicellus / et nonnulli
alii eorum complices / in hac parte religiosum virum (10) fratrem
Renaudum gives monachum / monasterii sancti Benedicti supra / Ligerim
ac grenetarium de Stampis / euntem de quadam domo dicti / monasterii
vocata de plesseyo apud (15) Sainville [sic]
pensatis insidiis / invaserunt proditionaliter prope
/ villam de garenciriis ipsumque / monachum letaliter vulnerarunt /
et ambos oc[c(rayé)]ulos a capite (20) eiusdem monachi extraxerunt
/ linguam suam ab ore ipsius (f°212r°) extrahere et amputare satagentes
/ religiosis viris abbato et conventu / dicti monasterii sancti Benedicti
et / dicto monacho una cum familia gentibus (5) rebus et bonis in nostra
existentibus / gardia speciali gardiam nostram / frandendo prædictam
quo circa nos de / vestris fidelitate et industria / plenarie confidentes
ac tanta maleficia (10) impunita remanere nolentes mandamus / et
committimus vobis quatenus / ad partes illas vos personaliter / confidenter
de et super præmissis / et ea tangentibus et dependentibus (15)
ab eisdem eorumque circumstantiis / universis vos secrete celeriter
et / diligenter informantes omnes / illos quos per informationem / ipsam
vel per famam publicam (20) aut vehementem præsumptionem
/ suspectos reperieritis de præmissis / ubicumque extra loca sacra
/ reperti fuerint capiatis seu / capi faciatis bona ipsorum (f°213r°)
quocumque et ubicumque existentia ad / manum nostram ponentes et tenentes
/ absque liberationi seu recredentia de / ipsis facienda nisi de nostra
process[er]it (5) voluntate personasque
dictorum / malefactorum in castelletum nostrum / parisiense captas sub
fida custodia et / oonquid [Lisez: quicquid]
indè feceritis et inveniretis / curiæ nostræ sub
vestro fideliter (10) inclusum sigillo quantocius transmittatur / si
vero dicti malefactores deprehendi / nequiverint ipsos ad jura nostra
super / his vocari facientes <ni
si venirint ipsos [lecture alternative et fautive
de la ligne précédente par un copiste intermédiaire
qui a oublié de la rayer]> / ad bannum secundum patriæ
(15) consuetudinem procedatur [man]damus /
autem omnibus et singulis / baillivis propositis servientibus / et
aliis justiciariis et subditis / nostris præsentibus in mandatis
(20) ut [vobis (rayé)] vobis in præmissis et ea /
tangentibus pareant efficaciter / et intendant ac præstant vim (f°213v°)
consilium auxilium favorem opem et / operam efficaces datum Parisiis
/ die duodecima aprilis anno domini / millesimo trecentesimo vigesimo
tertio
|
[Première
commission royale à Thomas de Reims]
Charles par la grâce
de Dieu roi des Francs et de Navarre, à son affectionné
et féal maître Thomas de Reims, notre conseiller,
salut et affection.
Il est récemment parvenu
à nos oreilles de par la rumeur publique, que Pierre Rivet
et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, ainsi qu’un certain
jeune homme dénommé Lisius et quelques autres complices
de cette action ont prémédité une embuscade
contre le frère Renaud Givet, moine du monastère de
Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes, qui se rendait
d’une certaine demeure du dit monastère, appelée le
Plessis, à Sainville, qu’ils l’ont attaqué traîtreusement
près du village appelé Garancières, qu’ils ont
blessé mortellement le dit moine, qu’ils lui ont arraché
les deux yeux de la tête, s’efforçant d’arracher et d’amputer
la langue de la bouche du susdit, et ceci alors que les religieux
hommes l’abbé et le couvent du dit monastère de
Saint-Benoît, ainsi que le dit moine, comme d’ailleurs leurs
serfs, leurs gens, leurs possessions et leurs biens se trouvent sous
notre spéciale protection, en infraction de la dite protection
spéciale.
Ainsi donc, pleinement
confiant dans votre fidélité et votre zèle,
et refusant que de si grands méfaits restent impunis, nous vous
donnons mandat et mission de faire vous-même dans ces régions,
personnellement et confidentiellement, une enquête secrète,
rapide et diligente à propos et au sujet des faits susdits,
de leurs tenants et de leurs aboutissants.
Tous ceux que par suite
de votre enquête, ou par la rumeur publique, ou bien par
forte présomption, vous trouverez suspects des faits susdits,
où qu’on les trouve, exception faite des lieux consacrés,
arrêtez-les ou faites saisir leurs biens, n’importe où
qu’ils se trouvent, les mettant et les gardant à notre disposition
sans leur faire bénéficier de libération même
sous caution qui ne procèderait pas de notre décision.
[Envoyez] les personnes
des dits malfaiteurs à notre Châtelet de Paris, une
fois capturées, sous bonne garde.
Que tout ce que vous ferez
et découvrirez soit transmis à notre tribunal fidèlement,
sous pli scellé.
Mais si les dits malfaiteur
ne peuvent être arrêtés, les faisant convoquer
devant notre autorité, qu’on procède au ban selon
la coutume du pays.
Et nous [or]donnons à
tous et à chacun de nos baillis, prévôts, sergents
et autres officiers de justice et sujets, par nos présentes
ordonnances, qu’ils vous obéissent efficacement dans le cadre
de cette affaire et de ce qui y touche, et qu’ils y fasse montre et
preuve de force, conseil, assistance, faveur, ressources et soins efficaces.
Donné à Paris
le 12 avril de l’an du Seigneur
1323.
|
(5) Par la vertu desquelles lettres
nous / te faisons assavoir que nous nous / sommes enformez en la
maniere que / commis nous estoit et avons faict / nostre plain pouvoir
d’avoir les corps (10) Rivet du plesseis et de guyot / fils de monsieur
Guy dauton chevalier / et si trouvé les eussions nous les
/ eussions amenez ou chastellet a Paris / ainsy comme commis nous
estoit et (15) les avons fait appeler pardevant / Nous a estampes a ce
mercredy / darrenierement passé qui fut veille / de l’ascension
a aller avant sur ce / que commis nous est sur peine (20) d’estre bannis
a laquelle journée / il ne sont venus ne comparus / pourquoy
nous les avons mis en / deffault et pour ce quil nous est
[en marge:] forme de / bannissement
/ p.135 verso / de lancien / Cartulaire
|
|
(f°214r°) commis que nous
aillons avant / a eux bannir des que trouvez ne / les pouvions
selon la coustume / du pais et on nous ait donné à (5)
entendre que par ladicte coustume / il les faust appeler par trois
/ quinzaines et la quarentaine / d’abondant pour ce est il que par
/ la vertu du pooir a nous commis (10) nous te commetons et mandons
/ que lesdicts Guyot et Rivet en la / ville d auton et en leurs hostiex
et / ailleurs ou il a esté accoustumé / d’estre appellé
en tel cas pour venir (15) au ban fay appeler par lesdictes / quinzaines
que pardevant nous se / comparent a yenville ou lieu ou tu / as accoustumé
a tenir tes plais / ou quel nous entendons a estre (20) aux fins desdictes
quinzaines / ou aux jours que l’en leur (f°214r°) assignera
pour parfaire ce que / commis nous est et se il avenoit / que lesdicts
Guiot et Rivet / le temps durant se repressentassent (5) pardevant toy
nous te mandons / que leurs corps tu arrestes et / amene ou fay amener
sur sauve / garde a Paris et ce que faict en / aras et les jours ausquels
tu (10) les appelleras nous referis sous / ton scel sens nul delay item
par / ces presentes lettres te donnons / en mandement que tu en la forme
/ [et] maniere que commis t’avons contre (15)
les dessusdicts va avant contre Martin / de Vierville vallet dudict monsieur
/ Guy et nous en referi comme dessus est / dict donné sous nostre
scel le jeudy / jour de l’ascension l’an mil trois cents (20) vingt trois
|
[Thomas
au prévôt de Janville, suite]
En vertu de cette lettre nous
te faisons savoir que nous avons enquêté de la manière
qui nous était demandée et que nous avons fait tout
ce que nous avons pu pour mettre la main sur Rivet du Plessis et Guyot,
fils du chevalier monsieur Guy d’Authon. Et si nous les avions trouvés,
nous les aurions amenés au Châtelet à Paris, comme
nous en avions mission.
Et nous les avons fait convoquer
devant nous à Étampes pour ce mercredi dernier [4 mai] veille de l’Ascension [5 mai], pour
avancer sur le dossier qui nous a été confié,
sous peine d’être bannis. A cette séance il ne sont pas
venus ni ne se sont présentés. C’est pourquoi nous les
avons mis en défaut.
Et quant à la mission
qui nous a été donnée d’entreprendre de les
bannir à partir du moment où nous ne pourrions les
trouver, selon la coutume du pays: on nous a fait remarquer que selon
la dite coutume, il faut les convoquer à trois reprises à
quinze jours d’intervalle, avec un surplus de quarante jours.
C’est pourquoi, en vertu du
pouvoir qui nous a été conféré, nous
te donnons pour mandat et mission de faire convoquer les dits Guyot
et Rivet dans la ville d’Authon, dans leurs hôtels et en tout
lieu où on a coutume de procéder à des
convocations dans ces cas-là aux dits intervalles de quinze jours,
[leur précisant] de se présenter à Janville au
lieu où tu as coutume de tenir tes audiences, auquel nous
avons l’intention de nous trouver aux termes des dits intervalles de
quinze jours, ou aux jours qu’on leur assignera, pour accomplir la mission
qui nous a été confiée.
Et s’il advenait que les dits
Guyot et Rivet, avec le temps, se présentent à toi,
nous t’ordonnons de les arrêter et de les amener ou de les
faire amener sous bonne garde à Paris.
Et ce que tu en auras fait,
ainsi que les jours auxquels tu les convoqueras, fais-nous le
savoir sous pli scellé sans aucun retard.
De plus, par la présente
lettre, nous te donnons ordre de commencer une procédure,
en la forme et manière que nous t’avons enjointe contre les
susdits, à l’encontre de Martin de Vierville, valet du susdit
monsieur Guy, et de nous en tenir informé comme dit ci-dessus.
Donné sous notre sceau
le jeudi jour de l’Ascension [5 mai] de l’an 1323.
|
par la vertu desquelles / lettres cydessus
transcriptes nous / vous mandons et commettons que vous (f°215r°)
ensemble ou l’un de vous aillez audict / lieu d’auton et adiournez
ledict Guyot, / ledict Rivet et Martin de Vierville / aux hostiers
ou ils demeurent et la ou (5) vous les pourez trouver ou il a esté
/ accoustumé d’appeler en tel cas pour / estre et venir pardevant
ledict maistre / Thomas pour respondre au faict le Roy / sur le cas
que l’an leur mest sur contenu (10) ou mandement de nostre seigneur
le Roy et / dessus [espace de 1 ou 2 mots]
au dimanche jour de / la Trinité prochain venant a yenville
/ de ce faire nous vous donnons / pooir mandons et commandons a tous
(15) a qui il appartient et peut appartenir / que a vous en ce faisent
obeissent / diligemment et ce faites si / diligemment que par
vous ni ait / defaut ce que faict en avez nous referirez (20) ou raportez
de boiche dedans trois / jours Donné soubs nostre scel l’an /
mil trois cents vingt trois le samedy (f°215v°) avant la sainct
Nicolas en may
|
[Le
prévôt de Janville à ses sergents, suite]
En vertu de la lettre ci-dessus
transcrite, nous vous donnons mandat et mission que vous deux ou
l’un de vous deux ailliez au dit lieu d’Authon et convoquiez le dit
Guyot, le dit Rivet, et Martin de Vierville, aux hôtels où
il résident et où vous pourrez les trouver, là où
on a pris l’habitude de faire des convocations en pareil cas, [leur demandant]
de se trouver et de venir devant le tribunal de maître Thomas pour
répondre à l’action du roi relativement à l’affaire
qu’on leur impute, ci-dessus rapportée par l’ordonnance de notre
seigneur le roi et ci-dessus [transcrite], le dimanche de la Trinité
prochain [22 mai] à Janville.
De faire cela nous vous
donnons pouvoir. Nous mandons et commandons à tous ceux
à qui cela revient ou peut revenir que dans cette affaire
qu’ils vous obéissent lorsque vous le ferez. Et faites-le
si diligemment qu’il n’y manque rien de votre fait. Vous nous rendrez
compte de ce que vous avez fait ou nous le rapporterez de vive
voix avant trois jours.
Donné sous notre sceau
l’an 1323 le samedi [7 mai] avant
la Saint-Nicolas-en-Mai [lundi 9 mai].
|
par / la vertu duquel Robin Turreau
et / Jean Lebarbier sergens dyenville / me referirent et raporterent
de boiche (5) que ils avoient adiournez les dessus / nommez aux
lieux contenus ou dict / adiournement au dimenche jour de la / Trinité
en la forme et maniere que / mandé leur estoit si comme il
est plus (10) plenement contenu en la rescription dont la / teneur
s’ensuit
|
[Rapport
de Thomas au Parlement, suite]
En vertu de quoi Robin Thureau
et Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rendirent compte et
me rapportèrent de vive voix qu’ils avaient convoqué
les personnes sus-nommées aux lieux portés par la dite
convocation, le dimanche de la Trinité, en la forme
et manière qui leur avait été ordonnée,
comme il est porté plus au long dans le rapport dont voici
le texte.
|
A honnorable et saige / leur chier
seigneur et maistre maistre / Thomas de Rems conseiller le Roy
nostre / Seigneur Robin Thureau et Jean Lebarbier (15) sergens
d’yenville honneur et reverence / avec obeissence en tous vos commandemens
/ chiers sires savoir vous faisons que / le dimanche après
l’ascension darrenierement / passé nous fusmes au plesseis en
(20) lostel dudict Rivet, lequel nous ni / trouvasmes pas et aussy
celi jour (f°216r°) fusmes a heronville en la paroche / d’auton
en l’ostel du pere dudict Guiot / lequel nous ne trouvasmes pas et
/ aussy en lendemain feusmes a (5) Vierville pour adiourner ledict
Martin / de Vierville lequel nous ne trouvasmes / pas ni ne ne tient
nulle residence et / adiournasmes les dessus dicts Rivet / Guiot ausdicts
lieux a estre pardevant (10) vous au dimanche jour de la Trinité
/ prochain a yenville en la forme et en / la maniere que il est contenu
en nostre / commission parmy laquelle ceste / rescription est annexéé
Et pour ce que (15) Nous ne trouvasmes pas lesdicts / Guiot et Rivet
nous fismes a savoir à la / maire dudict Guiot aux gens qui /
s’entremettent des besognes dudict Rivet / que ils estoient adiournez
en la maniere (20) dessusdicte Donné soubs nos sceaux / le samedy
après Penthecouste l’an mil (f°216v°) trois cents vingt
trois
|
[Rapport
des sergents de Janville à Thomas de Reims]
A honorable et sage leur sieur
et maître Thomas de Reims, conseiller de notre seigneur le
roi, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, honneur
et révérence avec obéissance à tous vos
ordres.
Cher monsieur, nous vous faisons
savoir que le dimanche après l’Ascension dernier, nous avons
été au Plessis à l’hôtel du dit Rivet,
que nous n’avons pas trouvé;
et aussi que ce même
jour nous avons été à Hérouville, dans
la paroisse d’Authon, à l’hôtel du père du dit
Guyot, que nous n’avons pas trouvé;
et aussi que le lendemain nous avons
été à Vierville pour convoquer de dit Martin
de Vierville, que nous n’avons pas trouvé, et qui n’y a pas
sa résidence;
et que nous avons convoqué
les susdits Rivet et Guyot aux dits lieu pour se présenter
à vous le dimanche de la Trinité [22 mai] qui
vient à Janville, en la forme et manière qui est portée
par notre ordre de mission, auquel ce rapport est mis en annexe.
Et comme nous n’avons pas
trouvé les dits Guyot et Rivet, nous avons fait savoir
à la mère du dit Guyot et aux gens qui règlent
en son nom les affaires du dit Rivet qu’ils étaient convoqués
de la manière susdite.
Donné sous nos sceaux
le samedi [21
mai] après Pentecôte [dimanche 15 mai] l’an 1323.
|
Auquel dimanche / jour de la Trinité
je me transportay / a yenville au lieu ou le prevost de / ladicte
ville a accoustumé a tenir ses (5) plais et moy estant en
jugement fis / appeler par les dessusdicts sergens et / citer par
six fois les dessus dicts Rivet / guiot et Martin scavoir moy se il
estoient / audict lieu, lesquels attendus (10) souffisemment jusques
a heure de midy / et de plus ne vindrent ne envoyerent / pour quoy
je les repute pour contumax / et les mis en deffaut et les manday /
a adiourner a une aultre journéé audict (15) lieu en la
forme et maniere qui sensuit /
|
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]
Ce dimanche-là jour de la Trinité [22 mai],
je me suis transporté à Janville au lieu où
le prévôt de la dite ville a coutume de tenir ses audiences,
et moi, étant en jugement, je fis appeler par les susdits
sergents et citer par six fois les susdits Rivet, Guyot et Martin
pour me rendre compte s’ils étaient au dit lieu.
On les a suffisamment attendus
jusqu’à l’heure de midi et davantage et ils ne sont pas venu
ni n’ont envoyé personne. C’est pourquoi je les ai tenus
pour contumaces et les ai mis en défaut, et j’ai donné
ordre de les convoquer à une autre audience au dit lieu en la
forme et manière que voici.
|
Thomas de Rhems conseiller le
Roy / nostre Seigneur Au Prevost d’yenville / a Robin Turreau et a
Jean Lebarbier / sergens dudict nostre seigneur le Roy (20) en la Prevosté
d’yenville et ou ressort / d’icelle salut comme par la vertu du
pooir / a nous commis vous ayez adiourné (f°217r°)
ou faict adiourner pardevant nous a ce / dimanche jour de la Trinité
a / yenville Rivet du plesseis Guiot / dauton escuyers ledict Guiot
fil de (5) monsieur Guy dauton chevalier et / Martin de Vierville vallet
dudict / chevallier si comme nous le / veons estre plus plenement contenu
/ en la rescription et mandement parmy (10) lesquelles ces presentes
lettres sont / annexéés Et nous soions audict / jour dudict
dimenche venus en nostre / propre personne audict lieu pour faire / ceque
a nous appartenoit laquelle chose (15) nous avons faict en la maniere
qui / ensuit quar nous estant en jugement fismes / par les dessusdicts
Robin et Jean Lebarbier / sergens d’yenville par six fois les dessusdicts
/ Rivet Guion dauton et Martin de (20) vierville crier et appeler que
si il estoient / audict lieu ne ame pour eux qu’il de / comparussent pardevant
nous et les / attendismes jusques a heure de midy et (f°217v°)
plus et pour ce que eux ne ame pour / eux ne se comparurent nous les
mismes / en deffault pour ce est il que derrechief / vous mandons et
commettons et a (5) chacun de vous que vous adiournez les / dessus
dicts Rivet Guyot dauton et / Martin de Vierville en parfaisant ce que
/ mandé vous a esté en la maniere / qu’autresfois commandé
le vous (10) avons en faisant autreci lesdicts / adiournemens en lieux
publiques / et marchez et ce que vous en ferez / et les journees que
vous leurs / assignerez pour les aultres (15) quinzaines pour a finir
nous referirez / Donné a yenville soubs nostre scel l’an / mil
trois cents vingt trois le dimenche / jour de la Trinité
|
[Thomas
de Reims aux prévôt et sergents de Janville]
Thomas de Reims, conseiller
de notre seigneur le roi, au prévôt de Janville et à
Robin Thureau et à Jean Lebarbier sergent de notre dit seigneur
le roi en la prévôté de Janville et dans son ressort,
salut.
En vertu du pouvoir qui nous
a été conféré, vous avez convoqué
ou fait convoquer, pour qu’ils se présentent devant nous ce
dimanche jour de la Trinité à Janville, River du Plessis,
Guyot d’Authon fils du chevalier monsieur Guy d’Authon, et Martin de
Vierville, valet du dit chevalier, comme nous le voyons porté
plus au long dans le rapport et l’ordre de mission auxquels la présente
lettre est annexée.
Et nous sommes, le dit jour
dimanche [22
mai], venu en personne au dit lieu pour faire
ce qu’il nous revenait de faire, et que nous avons fait de la manière
précisée ci-après: étant en jugement,
nous avons fait, par les susdits Robin et Jean Lebarbier, crier et
appeler les susdits Rivet, Guyot d’Authon et Martin de Vierville pour
qu’au cas où ils se trouvaient au dit lieu ou bien quelque personne
en leur nom, ils comparaissent devant nous; et nous les avons attendu jusqu’à
l’heure de midi et davantage. Et vu que ni eux-mêmes ni qui que
ce soit en leur nom n’ont comparu, nous les avons mis en défaut.
C’est pourquoi, à nouveau,
nous donnons mandat et mission, à vous et à chacun
de vous, de convoquer les susdits Rivet, Guyot et Martin de Vierville
en faisant bien ce qui vous a été ordonné de
la manière dont nous vous l’avions commandé précédemment,
en opérant aussi les dites convocations dans les lieux publics
et les marché.
Et ce que vous en ferez, ainsi
que les audiences que vous leur assignerez pour les autres intervalles
de quinze jours jusqu’à la fin, vous nous en rendrez compte.
Donné à Janville
sous notre sceau l’an 1323 le dimanche
jour de la Trinité [22 mai].
|
par la vertu duquel / adiournement
Robin Turreau et Jean (20) Lebarbier sergens d’yenville me / raporterent
de boiche et me referirent (f°218r°) les dessusdicts estre
adiournez au lieu / et en maniere que commis leur estoit / aux trois
sepmaines de la trinité / dessusdicte en la forme et maniere
(5) que plus pleinement est contenu en la / rescription dont la teneur
sensuit /
|
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]
En vertu de cette convocation,
Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rapportèrent
de vive voix et me rendirent compte que les susdits étaient
convoqués au lieu et de la manière qui leur avait été
ordonnés, trois semaines après la susdite Trinité
[trois semaines après
le dimanche 22 mai, c’est-à-dire le dimanche 12 juin],
en la forme et manière qui est portée plus au long
dans le rapport dont voici le texte.
|
A honnorable homme et saige
leur / chier seigneur et maistre maistre / Thomas de Rems conseiller
le Roy (10) notre Seigneur Guillaume de la touche / Prevost dyenville
Robin Tureau et Jean / Lebarbier sergens de ladicte Prevosté
/ salut et obeissance a vos commandemens / nous dessusdicts sergens savoir
(15) vous faisons que en accomplissant / vostre mandement avons adiourné
le / lundi lendemain de la Trinité desté / Rivet du
plesseis en son hostel du / plesseis lequel nous ne trouvasmes (20)
mie Item celi [jour] Guiot
dauton en l’ostel / du pere dudict Guiot a heronville et ne / le trouvasmes
mie Item celi jour / nous fusmes a vierville pour / adiourner Martin
de vierville (f°218v°) liquels na point de residence ou pais
/ si comme l’an nous dist et feismes / a savoir aux gens d’icelle ville
voisins / doudict Martin quant il y demoroit (5) et aux devantdicts lieux
desdicts / Rivet et guyon que les dessusdicts / Rivet Guiot et Martin adiournions
/ pardevant vous comme dessus est dict / a yenville ou l’en a accoustumé
a (10) tenir les plais aux trois semaines / de la Trinité dessusdictes
en la / forme et maniere que il est / contenu en vos commissions par[mi] / lesquelles ceste rescription est (15) annexéé
item Nous Prevost [dessusdict (rayé)] / dessus dict avons faict appeler
les / devant dictes personnes en plein marché / a yenville
le samedy après la feste / Dieu darrenierement passée
par (20) Berthelot Aignean sergent a yenville / a ce estably a estre
pardevant vous au / jour et lieux dessusdicts et selon la / forme
desdictes commissions si comme (f°219r°) ledict sergent nous
a raporté et ce / nous vous certifions soubs nos / sceaux donné
à yenville le samedy / après la feste Dieu l’an mil trois
(5) cents vingt et trois
|
[Rapport
des prévôt et sergents de Janville à Thomas]
A honorable homme et sage leur
cher seigneur et maître maître Thomas de Reims, conseiller
de notre seigneur le roi, Guillaume de La Touche, prévôt
de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de la dite
prévôté, salut et obéissance à tous
vos ordres.
Nous, les susdits sergents,
vous faisons savoir qu’en exécution de vos ordres nous avons
convoqué le lundi [23 mai] lendemain de la
Trinité d’été [22 mai], Rivet du Plessis
à son hôtel du Plessis, que nous n’avons pas trouvé.
Et aussi ce même jour Guyot d’Authon à l’hôtel du père
du dit Guyot à Hérouville, et nous ne l’avons pas trouvé.
Et aussi ce même jour nous avons été à Vierville
pour convoquer Martin de Vierville, qui n’a pas sa résidence au pays
à ce qu’on nous a dit.
Et nous avons fait savoir
aux gens de cette ville voisins du dit Martin quand il y demeurait,
et aux susdits lieux [de résidence] des dits Rivet et Guyot,
que nous convoquions devant vous les susdits Rivet et Guyot, comme
dit plus haut, à Janville, où l’on a coutume de tenir
les audiences, trois semaines après la susdite Trinité,
en la forme et manière qui est portée par vos ordres
de mission auxquels on a annexé ce rapport.
En outre nous, le susdit prévôt,
avons fait convoquer les susdites personnes en plein marché
à Janville le samedi [28 mai] après la Fête-Dieu
dernière [jeudi 26 mai], par Berthelot
Aignan, sergent à Janville préposé à
cette tâche, [leur précisant] de comparaître devant
vous au jour [12
juin] et lieux susdits et de la manière
prescrite par vos ordres ainsi que nous l’a rapporté le dit sergent,
et nous vous le certifions sous notre sceau.
Donné à Janville
le samedi [28
mai] après la Fête-Dieu [jeudi 26 mai] l’an 1323.
|
pendent lequel / adiournement
vous mi chiers / Seigneurs veistes ladicte information / mesmement* quant a ce dont mention / estoit faicte en
icelle que je allasse (10) avant a eux bannir gardéés
les / coustumes du pais lesqueles je / vous raportay estre divisees
/ consideré les chastelleries diverses /
[en marge:] chastelleries / p. 136 verso / de lancien / cartulaire
|
|
et estoit contenu autressi la maniere
(15) commant je avois alé avant contre / les dessusdicts
quar avant que on / puist bannir un homme en la chastellerie / d’yenville
il convient qu’il y ait un / an [espace de trois
mots environ] le premier (20) appel et le ban
et en la chastellerie / d’Estampes ny faut que trois / appeaux, par
trois assises par telles (f°219v°) intervalles de temps comme
il / plaist au baillif dudict lieu / et je avoie commancie a aller
avant / par trois quinzaine et la quarentaine (5) dabondant selon ce
qu’on a accoustmé / a faire en parlement et en la / prevosté
de Paris selon cequil est / plus plenement contenu en ladicte / information,
laquelle double raportéé (10) a vous mi chiers seigneurs
ou / parlement comment je debvois aller / avant me consillastes et
me mandastes / que selon la coustume que emprise / avoit [Lisez: avois] allasse avant et men envoiastes
(15) les lettres du Roy contenant la forme / qui sensuit
|
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(résumé d’un précédent rapport)]
Dans
l’intervalle précédant la dite audience [c’est-à-dire avant le 3 juillet], chers messieurs, vous avez eu sous les yeux la dite instruction,
surtout en ce qu’elle précisait que j’entreprenais contre
eux une procédure de bannissement en respectant les usages
du pays.
Je vous ai rapporté
que ces usages étaient en désaccord si l’on prenait
en compte les différentes châtellenies.
Et il était aussi porté
la manière dont je devais mener la procédure
contre les susdits: car, avant que l’on puisse bannir un homme, dans
la châtellenie de Janville, il convient qu’il y ait un an [entre]
la première convocation et le ban, alors que dans la châtellenie
d’Étampes, il ne faut que trois convocations effectuées
lors de trois audiences à des intervalles de temps fixés
à son gré par le bailli du dit lieu.
Et que j’avais commencé
à mettre en œuvre la procédure des trois quinzaines
de jours suivies d’un surplus de quarante, selon ce que se fait habituellement
au Parlement et dans la prévôté de Paris, comme
il est porté plus au long dans la dite instruction.
Je vous avais envoyé
cette instruction en double exemplaire, chers messieurs en Parlement,
[vous demandant] comment je devais procéder. Vous m’avez
conseillé et ordonné de procéder selon la
coutume que j’avais commencer d’observer, et vous m’avez envoyé
la lettre du roi portant le texte que voici.
|
 Carolus Dei gratia
/ francorum [
Carolus Dei gratia
/ francorum [Rex(rayé)] [et(rayé à tort)] Navarræ / Rex dilecto
et fideli magistro Thomæ de / Remis consiliario nostro salutem et dilectionem
(20) cum super eo quod ad nostrum pervenerat auditum / fama publica referente
quod Petrus Rives / Guiotus de Auton filius Guidonis de / auton militis cum
pluribus suis complicibus (f°220r°) in hac parte religiosum virum
fratrem / Renaudum Gives monachum monasterii / sancti Benedicti supra ligerim
ac grenetarium / de Stampis euntem de quadam domo dicti (5) monasterii vocata
de Plesseyo apud / Sainville pensatis insidiis invaserant / prodicionaliter
prope villam de Garenciriis / ipsumque monachum lathaliter / vulneraverant
et ambos oculos a capite (10) eiusdem monachi extraxerant linguam / suam
ab ore ipsius extrahere ei / amputare satagentes abbate et conventu / dicti
monasterii sancti Benedicti et / dicto monacho una cum familia (15)
gentibus rebus et bonis in nostra / existentibus gardia speciali gardiam
nostram / frangendo prædictam per nostras alias / litteras vobis committendo
mandasse / dicantur quatenus de et super / præmissis et ea tangentibus
et / depedentibus ab eisdem eorumque (f°220v°) circunstantibus universis
vos secreto / celeriter et diligenter informaretis visa / informatione per
vos de mandato nostro / super hiis facta ex causa vobis mandamus (5) iterato
tenore præsentium committentes / quatenus vestrum evocandi super præmissis
/ inquiratis seu inquiri faciatis cum qua / poteritis diligentia veritatem
et inquestam / ipsam sub nostro fideliter inclusam sigillo (10) curiæ
nostræ iudicandi et malefactores / super præmissis per dictam
inquestam / culpabiles repertos si eos reperire poteritis / extra tamen sacra
et religiosa loca in / castelletum nostrum parisiensi sub fida et (15) secura
custodia transmittatis si vero per / vos reperiri non potuerint malefactores
/ prædicti ad bannum contra ipsos prout / prætextu aliarum litterarum
nostrarum / vobis super præmissis directarum procedere (20) incepistis
per vos seu alium procedatis / ab omnibus iusticiariis et subditiis / nostris
vobis in præmissis et ea / tangentibus pareri volumus et mandamus /
Datum parisiis die prima junii anno (f°221r°) Domini millesimo trecentesimo
vicesimo / tertio
|
[Deuxième
commission royale à Thomas de Reims]
Charles par la grâce
de Dieu roi des Francs et de Navarre à son affectionné
et féal maître Thomas de Reims notre conseiller, salut
et affection.
Il est récemment parvenu
à nos oreilles de par la rumeur publique, que Pierre Rivet
et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, avec plusieurs
complices dans cette action, avaient prémédité
une embuscade contre le frère Renaud Givet, moine du monastère
de Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes, qui
se rendait d’une certaine demeure du dit monastère appelée
le Plessis à Sainville, qu’ils l’avaient attaqué traîtreusement
près du village appelé Garancières, qu’ils avaient
blessé mortellement le dit moine, qu’ils lui avaient arraché
les deux yeux de la tête, s’efforçant d’arracher et d’amputer
sa langue de la bouche du susdit; et ceci alors que les religieux hommes
l’abbé et le couvent du dit monastère de Saint-Benoît,
ainsi que le dit moine, comme d’ailleurs leurs serfs, leurs gens, leurs
possessions et leurs biens se trouvent sous notre spéciale protection.
Ils ont enfreint la dite protection spéciale.
On dit que, sous le
couvert d’une autre lettre de nous, ils vous ont écrit
en vous ordonnant de faire enquête secrète, rapide
et diligente à propos et au sujet des faits susdits,
de leurs tenants et de leurs aboutissants.
Nous avons examiné
le rapport de l’enquête que nous vous avions confiée
sur les faits susdits, et par suite nous vous ordonnons en vous le
répétant par la présente que vous recherchiez
et fassiez rechercher avec toute la diligence que vous pourrez la
vérité vestrum evocandi [tour non élucidé] sur les faits susdits
et que [vous envoyiez] fidèlement ladite enquête sous
pli scellé à notre tribunal.
Ceux qui doivent être
jugés, et les malfaiteurs trouvés coupables par
la dite enquête, si vous pouvez les trouver, hormis cependant
des lieux sacrés et religieux, faites-les transférer
sous bonne et sûre garde à notre Châtelet à
Paris.
Mais si les susdits
malfaiteurs ne peuvent être trouvés de vous, dans
la mesure où vous avez commencé de procéder
au ban contre eux sous le couvert de l’autre lettre de nous
qui vous a été adressée sur cette affaire,
procédez-y soit vous-même ou déléguez
quelqu’un d’autre pour le faire. Nous
ordonnons et commandons à trous nos officiers de justice et
sujets que dans cette affaire et dans tout ce qui y touche ils vous
obéissent.
Donné à Paris
le 1er juin de l’an du Seigneur
1323.
|
pourquoy je me transportay le
/ dimanche après les trois semaines de / ladicte Trinité
qui fut le dimanche après (5) la feste sainct Barnabé
apostre au / lieu ou ledict Prevost dyenville a / accoustumé
a tenir ses plais et mis / lesdicts Rivet Guiot et Martin en / deffault
appellez et attendus souffisemment (10) et les adiourne au dimanche
apres la / feste sainct Pierre et sainct Pol lors / prochain venant sur
peine de bannissement / et fis adiourner en la forme et maniere / qui
sensuit
|
[Rapport
de Thomas au Parlement, suite]
C’est pourquoi je me suis transporté
le dimanche [12 juin] suivant les trois
semaines de la dite Trinité [dimanche 22 mai], c’est-à-dire
le dimanche [12] suivant la fête de Saint-Barnabé-apôtre
[samedi 11 juin], au lieu où le dit Prévôt de Janville a coutume
de tenir ses audiences, et j’ai mis les dits Rivet, Guyot et Martin
en défaut après les avoir appelés et attendus suffisamment.
Je les ai convoqués pour
le dimanche [3 juillet] après la
fête de Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin] sous peine de bannissement, et je les ai fait convoquer en
la forme et manière que voici.
|
 a honnorables
hommes et (15) saiges mes tres chiers seigneurs du / Parlement
Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy nostre seigneur
/ toutes honneurs et obeissances mi / chiers seigneurs savoir vous fais
(20) que par la vertu des commissions / dudict seigneur et de la rescription
/ du Prevost dyenville Robin Turreau et (f°221r°) Jean Lebarbier
sergens de ladicte / Prevosté par la vertu de laquelle / Il m’appert
estre adiournez pardevant / moy a yenville Rivet du plesseis / Guiot
de auton fils de monsieur (5) Guy de Auton chevalier et Martin de / vierville
vallet dudict Monsieur Guy au / dimanche après la feste sainct
Barnabé / apostre en la forme et maniere que (10) commis l’avoie
et mandé ausdicts / Prevost et sergens par lesquelles ces / presentes
sont annexéés ledict / dimenche me transporte a ladicte
/ ville dyenville au lieu ou li prevost (15) a accoustumé a
tenir ses plais et / illeques fis appeler par ledict Jean / Lebarbier
lesdicts Rivet Guiot et / Martin une fois seconde et tierce / se il
estoients audict lieu ne ame pour (20) eux que il se comparussent pardevant
/ moy lequel attendu [sic]
jusques a heure de / midy et plus et criez seconde fois par
(f°222r°) trois fois si comme dessus est dict / par ledict sergent
ne veindrent ne / envoyerent pourquoy l’heure de midy / passéé
je les mis pour contumax (5) et les mis en deffault et est assavoir
/ que en ce mesme lieu par la vertu de la / darreniere commission a
moy faicte par / laquelle le Roys mes sires me mande / que je enquiere
la verité je adiourne (10) lesdicts Rivet Guiot et Martin pardevant
/ moy au jeudy après ensuyvant a / Estampes en l’ostel de la fontaine
tritan / a aller avant en la besoigne que / commise m’estoit selon ce que
raison (15) dourroit o inthimation veinssent ou non / je yroie avant en
ladicte besoigne et / tenroie le plait pour entaine [Lisez: eutaine
(huitaine)] ein sy comme / raison
dourroit et adournay autressy / les dessus nommez que il se comparussent
(20) pardevant moy audict lieu d’yenville / dedans le dymenche apres
la sainct / Pierre et sainct Paul prochain venant (f°222v°)
sur peine de bannissement pour aller avant / en ladicte besoigne qui
commise m’estoit / par la vertu de la premiere et seconde / commission
si comme raison dourroit (5) o intimation que si a ladicte journéé
/ ne venoient je iroie avant a eux bannir / item savoir vous fais que
le lundy / après ladicte sainct Barnabé je me / transportay
en la maison monsieur Guy (10) dAuton a heronville et illeques adiourné
/ en la presence de la maire dudict Guyot / et de plusieurs aultres lesdicts
Rivet / Guyot et Martin pardevant moy comme / dessus est dict as dix [Lisez: aus dicts] jours dudict (15) jeudy et dimenche
et de la autressi me / transportay a Auton de laquelle / paroche les
dessus nommez sont tenu et / devant lEglise de ladicte ville en lieu
/ plus public presens plusieurs de (20) ladicte ville adiourné
les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en la / forme et maniere jours
et lieux (f°223r°) que dessus est dict pardevant moy / item de
la me transporté au Plesseis / sainct Benoist en l’ostel dudict
/ Rivet et illec presens plusieurs fis (5) les dessus nommez tels et semblables
/ adiournemens pardevant moy comme / dessus est dict et commanday par
la / vertu du pooir a moy commis aux / dessus dicts Prevost et sergens
que (10) ce samedy prochain venant qui est jours / de marché a
yenville adiournassent / ou feissent adiourner les dessus nommez / au
dimanche après ladicte sainct Pierre / et sainct Pol pardevant
moy a yenville (15) comme dessus est dict lequel / adiournement raporta
estre faict / ledict Robin Turreau en la forme et / maniere que commis
li avoit item / mi chiers seigneurs le dymenche après (20) la
sainct Pierre et sainct Pol me / transportay audict lieu d’yenville
a honnorables
hommes et (15) saiges mes tres chiers seigneurs du / Parlement
Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy nostre seigneur
/ toutes honneurs et obeissances mi / chiers seigneurs savoir vous fais
(20) que par la vertu des commissions / dudict seigneur et de la rescription
/ du Prevost dyenville Robin Turreau et (f°221r°) Jean Lebarbier
sergens de ladicte / Prevosté par la vertu de laquelle / Il m’appert
estre adiournez pardevant / moy a yenville Rivet du plesseis / Guiot
de auton fils de monsieur (5) Guy de Auton chevalier et Martin de / vierville
vallet dudict Monsieur Guy au / dimanche après la feste sainct
Barnabé / apostre en la forme et maniere que (10) commis l’avoie
et mandé ausdicts / Prevost et sergens par lesquelles ces / presentes
sont annexéés ledict / dimenche me transporte a ladicte
/ ville dyenville au lieu ou li prevost (15) a accoustumé a
tenir ses plais et / illeques fis appeler par ledict Jean / Lebarbier
lesdicts Rivet Guiot et / Martin une fois seconde et tierce / se il
estoients audict lieu ne ame pour (20) eux que il se comparussent pardevant
/ moy lequel attendu [sic]
jusques a heure de / midy et plus et criez seconde fois par
(f°222r°) trois fois si comme dessus est dict / par ledict sergent
ne veindrent ne / envoyerent pourquoy l’heure de midy / passéé
je les mis pour contumax (5) et les mis en deffault et est assavoir
/ que en ce mesme lieu par la vertu de la / darreniere commission a
moy faicte par / laquelle le Roys mes sires me mande / que je enquiere
la verité je adiourne (10) lesdicts Rivet Guiot et Martin pardevant
/ moy au jeudy après ensuyvant a / Estampes en l’ostel de la fontaine
tritan / a aller avant en la besoigne que / commise m’estoit selon ce que
raison (15) dourroit o inthimation veinssent ou non / je yroie avant en
ladicte besoigne et / tenroie le plait pour entaine [Lisez: eutaine
(huitaine)] ein sy comme / raison
dourroit et adournay autressy / les dessus nommez que il se comparussent
(20) pardevant moy audict lieu d’yenville / dedans le dymenche apres
la sainct / Pierre et sainct Paul prochain venant (f°222v°)
sur peine de bannissement pour aller avant / en ladicte besoigne qui
commise m’estoit / par la vertu de la premiere et seconde / commission
si comme raison dourroit (5) o intimation que si a ladicte journéé
/ ne venoient je iroie avant a eux bannir / item savoir vous fais que
le lundy / après ladicte sainct Barnabé je me / transportay
en la maison monsieur Guy (10) dAuton a heronville et illeques adiourné
/ en la presence de la maire dudict Guyot / et de plusieurs aultres lesdicts
Rivet / Guyot et Martin pardevant moy comme / dessus est dict as dix [Lisez: aus dicts] jours dudict (15) jeudy et dimenche
et de la autressi me / transportay a Auton de laquelle / paroche les
dessus nommez sont tenu et / devant lEglise de ladicte ville en lieu
/ plus public presens plusieurs de (20) ladicte ville adiourné
les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en la / forme et maniere jours
et lieux (f°223r°) que dessus est dict pardevant moy / item de
la me transporté au Plesseis / sainct Benoist en l’ostel dudict
/ Rivet et illec presens plusieurs fis (5) les dessus nommez tels et semblables
/ adiournemens pardevant moy comme / dessus est dict et commanday par
la / vertu du pooir a moy commis aux / dessus dicts Prevost et sergens
que (10) ce samedy prochain venant qui est jours / de marché a
yenville adiournassent / ou feissent adiourner les dessus nommez / au
dimanche après ladicte sainct Pierre / et sainct Pol pardevant
moy a yenville (15) comme dessus est dict lequel / adiournement raporta
estre faict / ledict Robin Turreau en la forme et / maniere que commis
li avoit item / mi chiers seigneurs le dymenche après (20) la
sainct Pierre et sainct Pol me / transportay audict lieu d’yenville
|
[Rapport
de Thomas au Parlement, suite
(reprise d’un rapport précédent)]
A honorables et sages hommes
chers messieurs du Parlement, Thomas de Reims, conseiller et commissaire
de notre seigneur le roi, tous honneurs et toutes obéissances.
Chers messieurs, je vous fais
savoir qu’en vertu des ordres du dit seigneur [le roi] et du rapport
du prévôt de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier,
sergents de la dire prévôté, par lequel je constate
que sont convoqués en ma présence à Janville
Rivet du Plessis, Guyot d’Authon fils du chevalier monsieur Guy d’Authon,
et Martin de Vierville valet du dit monsieur Guy, le dimanche
[12 juin] après la fête de Saint-Barnabé-apôtre
[samedi 11], en la forme et manière que je avais ordonnée aux
dits prévôt et sergents [dans une lettre] à
laquelle celle-ci est annexée,
le dit dimanche [12 juin],
je me suis transporté à la dite ville de Janville
au lieu où le prévôt a coutume de tenir ses audiences;
et là j’ai fait appeler par le dit Jean Lebarbier les dits
Rivet, Guyot et Martin, une première fois, une deuxième,
puis une troisième, [leur faisant dire], s’ils étaient
au dit lieu, eux ou quelqu’un qui les représente, qu’ils comparaissent
devant moi.
Après qu’on les
a attendus jusqu’à l’heure de midi et avoir et appelés
par cri une seconde fois par trois fois, comme dit ci-dessus, par
le dit sergent, ils ne vinrent pas ni n’envoyèrent personne.
C’est pourquoi, l’heure de midi étant passée, je les
ai portés contumaces et je les ai mis en défaut.
 Et il faut savoir qu’en ce même lieu, en vertu de la dernière
commission qui m’a été adressée, par laquelle
le roi m’ordonne de rechercher la vérité, j’ai convoqué
pour le jeudi [16 juin] suivant les dits
Rivet, Guyot et Martin à Étampes en l’hôtel
de la Fontaine-Tristan, pour entreprendre la tâche qui m’était
confiée comme la raison l’exigera, avec cet avertissement:
qu’ils se rendent ou non à cette assignation, j’entreprendrai
la dite tâche et je tiendrai audience dans huit jours comme
l’exigeait la raison.
Et il faut savoir qu’en ce même lieu, en vertu de la dernière
commission qui m’a été adressée, par laquelle
le roi m’ordonne de rechercher la vérité, j’ai convoqué
pour le jeudi [16 juin] suivant les dits
Rivet, Guyot et Martin à Étampes en l’hôtel
de la Fontaine-Tristan, pour entreprendre la tâche qui m’était
confiée comme la raison l’exigera, avec cet avertissement:
qu’ils se rendent ou non à cette assignation, j’entreprendrai
la dite tâche et je tiendrai audience dans huit jours comme
l’exigeait la raison.
Et j’ai convoqué
aussi les susdits [leur demandant] de comparaître devant
moi au dit lieu de Janville avant le dimanche [3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin], sous peine de bannissement, pour procéder à
la tâche qui m’était confiée, en vertu du premier
et du deuxième ordres de mission, comme l’exigerait la raison,
avec cet avertissement que s’ils ne se rendaient pas à la dite
audience, j’entreprendrai de les bannir.
En outre je vous fais savoir
que le lundi [13 juin] après ladite
Saint-Barnabé [samedi 11 juin], je me suis
transporté à la maison de monsieur Guy d’Authon à Hérouville
et là j’ai convoqué en présence de la mère du
dit Guyot et de plusieurs autres les dits Rivet, Guyot et Martin pour qu’ils
se présentent à moi, comme déjà dit ci-dessus,
aux dits jours du dit jeudi [16 juin] et du dit dimanche
[3 juillet].
Et de là je me suis
aussi transporté à Authon, paroisse dont relèvent
les susnommés, et devant l’église de la dite ville, dans
un lieu plus public, en présence de plusieurs personnes de
ladite ville j’ai convoqué les susdits Rivet, Guyot et Martin
de la même manière et en précisant les mêmes
jours et lieux qu’il vient d’être dit, pour qu’ils se présentent
devant moi.
En outre, de là je
me suis transporté au Plessis-Saint-Benoist à l’hôtel
du dit Rivet et là en présence de plusieurs personnes
j’ait fait les convocations susmentionnées à l’identique
pour qu’ils se présentent devant moi comme déjà
dit.
Et en vertu du pouvoir qui
m’en a été conféré j’ai donné
ordre aux susdits prévôt et sergents que le samedi
[18 juin] qui vient qui est jour de marché à Janville,
ils convoquent ou fassent convoquer les susnommés pour qu’ils se
présentent devant moi le dimanche [3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul [mercredi 29 juin] à Janville, comme déjà dit. Le dit Robin
Thureau m’a rapporté que cette convocation avait été
faite de la manière qui le lui avait été ordonnée.
En outre, chers messieurs,
le dimanche [3 juillet] après la
Saint-Pierre-et-Saint-Paul [mercredi 29 juin], je me suis
transporté au dit lieu de Janville.
|
et (f°223v°) avant que je allasse
en jugement vint / Jehans Legrand dyenville qui cousins / et amis
se disoit du dict Rivet et Guiot / et appella avec luy le curé
dyenville (5) lequel curé me
monstra unes lettres / qui scellees estoient si comme il / apparoist
de premiere face du scel de la / cour l’official de sens esquelles
entre / les aultres choses estoit contenu que (10) Guiot fils de monsieur
Guy dauton / chevallier s’estoit rendu comme clerc en / la prison lofficial
de sens et pour ce / que je Thomas dessusdict les / fesoie appeler
comme commissaires (15) dudict seigneur sus le faict dont on / les poursuit
me mandoit adiourner / comme commissaire devant lofficial de / sens
a une certaine journéé après ceste / magdelaine
et en requist ledict (20) Jehans ledict curé que il majournast
/ auquel curé je respondy que par la / vertu du mandement adiourner
ne me (f°224r°) devoit et ou cas ou il le feroit / je faisoie protestation
de mes interests / despens et domaiges demander contre / eux en lieu et
en temps en disent (5) que je nestoie leur subget en nulle / maniere quar
je estoie demorant / a Paris hors de la jurisdiction / ordinaire dudict
official ne navoi / faict contrame [Lisez:
contraire] ne delict en leur (10) jurisdiction ordinaire ne ne
se / ventoient en leurs lettres parquoy / nulle jurisdiction peussent exerciter
/ en moy et quant li curez est oy ceste / response si se doubta et respondy
(15) que il ne feroit mie l’adiournement /
item
celle mesme journéé en jugement / moy present firent
lire ledicts / Jehans [Lisez: Jehan et] Jehan
De la gravelle / escuiers comme amis charnels (20) dudict Guion
la lettre dudict / official et me requirent que (f°224v°) je
n’allasse avant au ban contre / ledict Guiot quar il estoit clerc /
et rendus comme clerc en la / prison dudict official comme dict
(5) est et je leurs respondi que / quant je verroie ledict Guiot ne
/ ame qui se vosist fondez pour li je / savoie bien que je avoie a faire
/ mes pour chose quil deissent je ne (10) lairoie que je ne le meisse
en / deffaut mesmement que le dict / guiot subget et de la jurisdiction
[de (rayé)] / ordinaire lEvesque de chartres
/ et y avoit esté faict le delict (15) pourquoy il sembloit
que ce fut / barat fuite et chose afaitie
|
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(Convocation non notifiée de l’official de Sens)]
Et, avant que je ne procède
au jugement, s’est présenté Jean Legrand de Janville,
qui se disait cousin et ami du dit Rivet et de Guyot et il a appelé
à le rejoindre le curé de Janville.
Ce curé m’a montré
une lettre qui était scellée, à ce qu’il semble
en première apparence, du sceau du tribunal de l’official
de Sens.
Dans cette lettre, entre autres
choses, il était porté que Guyot, fils du chevalier
monsieur Guy d’Authon, s’était porté prisonnier en
tant que clerc, à la prison de l’official de Sens.
Et, parce que moi, le
susdit Thomas, je les faisais convoquer, en tant que commissaire
du susdit seigneur [le roi] relativement au méfait pour lesquels
ils sont poursuivis, [cette lettre] ordonnait de me convoquer en tant
que commissaire devant l’official de Sens à une certaine audience
après la Sainte-Marie-Madeleine.
Et Jean a demandé au
curé de le faire, c’est-à-dire de me convoquer. J’ai
répondu en disant au curé qu’en vertu de l’ordonnance
royale il ne devait pas me convoquer et qu’au cas où il ferait,
je prévenais solennellement que je requerrais contre eux
remboursement des intérêts, des dépens et des
dommages, en lieu et en temps, alléguant que je n’étais
leur sujet en aucune façon. En effet je me trouvais résider
à Paris, hors de la juridiction ordinaire du dit official,
je ne leur avais fait tort ni aucun délit dans leur juridiction
ordinaire, et ils ne s’appuyaient dans leur lettre sur aucune raison
par laquelle ils puissent exercer sur moi quelque juridiction.
Et quand le curé a entendu
cette réponse, il a hésité, et a répondu
qu’il ne notifierait pas cette convocation.
De plus, lors de cette même audience, en ma présence,
le dit Jean et Jean de La Gravelle, tous deux écuyers, en temps
qu’amis intimes du dit Guyon, ont fait lire la lettre du dit official
et m’ont requis de ne pas entreprendre le ban contre le dit Guyot, en
temps que clerc se trouvant dans la prison de l’official de Sens, comme
il a été dit.
Et je leur ai répondu
que quand je verrais le dit Guyot ou quelqu’un qui accepte d’avoir
procuration de lui, je savais bien ce que j’aurais à faire,
mais quoi qu’ils disent, je n’aurais de cesse de le mettre en défaut,
vu surtout que le dit Guyot [était] de sujet et soumis à
la juridiction de l’évêque de Chartres et que c’est là
qu’avait été commis le délit. En raison de quoi
il semblait que c’était là fourberie, échappatoire
et faux-semblant.
|
et vuil / mi chiers seigneurs que vous / saichiez que
celle mesme journéé / moy estant en jugement Jehan
(20) Legrand d’yenville Jehans de la / gravelle et plusieurs aultres
(f°225r°) qui cousins se disoient dudict / Rivet et Guiot me
presenterent / unes lettres du Roy en laquelle / le Roy mesme me mandoit
que (5) gardéé la coustume du pais joute / la commission
à moy faicte je allasse / avant en ceste besoigne et me offrirent
/ a faire tantost foy des dictes coustumes / lesquelles ils allegoient
estre (10) telles comme est faict mention / en ladicte information
auxquels je / respondi que ladicte information
volentiers / je recevoie et quanque bailler me / voldroient aucques desquelles
choses (15) bailler et enformer furent defaillant /
|
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(Production surprenante d’une lettre du roi)]
Et je veux, chers messieurs,
que vous sachiez que lors de cette même audience, alors que
j’étais en jugement, Jean Legrand de Janville, Jean de La
Gravelle et plusieurs autres qui se disaient cousins des dits Rivet
et Guyot, m’ont présenté une lettre du roi en laquelle
le roi lui-même m’ordonnait qu’une fois respectée la coutume
du pays selon mon ordre de mission j’entreprenne la tâche
qui m’avait été confiée.
Et ils m’ont proposé
de se porter garants sur le champ des dites coutumes. Il alléguaient
que ces coutumes étaient celles qui sont mentionnées
dans la dite enquête.
Je leur
ai répondu que je recevrais volontiers la dite enquête
et tout ce qu’ils voudraient me communiquer. Mais ils n’ont pas
été en mesure de me communiquer ni de m’informer de
si peu que ce soit,
|
fors tant qu’il me requirent que
/ je meisse en mon procés que ledict / Rivet estoit oultre
montains et / que riens ne savoit de ces (20) appeaux ne savoir ni
le pooit / pour quoy necessaire li estoit que (f°225v°) gardast
la coustume le procureur de / l’abbé de sainct Benoist disent
que / ledict Rivet estoit ou pais et ne / sen estoit encores bougez
lesquelles (5) choses oyes je respondi a ceux qui / amis des dessusdicts
se disoient / que je me garderoie bien de / mesprendre et n’estoit encores
/ mie la journéé par la vertu de (10) laquelle je pooie
bannir les / dessusdicts Rivet Guiot et / Martin quar ores premiere / estoit
ce la tierce journéé que / il estoient appellez ne ne (15)
veoie mie si comme il me sembloit / que il deissent choses par la
/ vertu desquelles je deusse cesser / de bailler deffault ou contumace /
contre les dessusdicts Rivet Guiot (20) et Martin pourquoy l’eure de midy
/ venue les fis appeler une fois / seconde et tierce en jugement (f°226r°)
lesquels ne se comparurent pas / pardevant moy ne aultres qui / pooir
eussent d’iceux aultres que / dessus est dict pour eux (5) attendus souffisemment
et criez / comme dict est je les reputay / pour contumax et les mis en
/ deffault et adiournay les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en (10)
jugement que il se comparussent / pardevant moy a yenville sur / peine
d’estre bannis du royaume / de France et a aller avant en / le besoigne
qui commise m’estoit (15) au dimanche aprés la Magdaleine / o
intimation veinssent ou non une / fois pour toutes je yroie avant au /
ban et commanday a Robin Turreau / sergent d’yenville que il par li ou
par (20) aultres adiournast les dessusdicts (f°226v°) en plein
marché audict jour et / lieu a faire ceque dessus est / dict
o l’inthimation dont parlé est / en ladiournement de dessus et
vous (5) faict assavoir mi chiers seigneurs / que a lendemain en ma propre
/ personne je me transportay au / plesseis sainct Benoist en la maison
/ dudict Rivet et illeques en la (10) presence de bonnes gens qui / demeurent
ou dict hostel et de plusieurs / aultres de ladicte ville adiournay /
au dimenche après la magdeleine / audict lieu les dicts Rivet
Guiot et (15) martin en la forme maniere et / l’intimation que dessus est
dicte / item ce jour mesme je me transporte / a auton paroche dont les
dessus / dicts estoient quant ils firent (20) ledict faict ou lieu plus
publicque (f°227r°) de ladicte ville devant lEglise / et devant
les meisyaux et illec / adiournay les dessus dicts Rivet / Guiot et martin
en la forme maniere (5) et o l’intimation que dessus est / dicte, item
ce mesme jour allay / a heronville maison dudict monsieur / Guy dauton
et illec en la presence / de la maire dudict Guiot de la gent (10) de laieus
et de plusieurs / aultres adiournay les dessusdicts / as dix jours [Lisez: dict jour] et lieu en la / forme maniere
et o l’inthimation / dessus dictes a laquelle journéé (15)
dudict dimanche après la / Magdeleine je me transportay / a yenville
et moy estant en / jugement ou lieu ou le dessus (f°227v°) dict
Prevost a accoustumé a tenir / ses plais me furent presentees /
unes Lettres du Roy mon sieur / contenant la forme qui s’ensuit /
|
[Rapport
de Thomas au Parlement, suite]
sinon de demander que je porte dans mon
procès-verbal que le dit Rivet était en Italie et
qu’il ne savait ni ne pouvait rien savoir de ces convocations. C’est
pourquoi il était nécessaire de respecter la coutume.
Le fondé de pouvoir
de l’abbé de Saint-Benoît disait que le dit Rivet était
au pays et ne s’en était pas encore éloigné.
En entendant cela, j’ai
répondu à ceux qui se disaient amis des susdits que
je me garderais bien d’aller contre la loi et qu’on n’était
pas encore à l’audience où j’aurais le pouvoir de bannir
les susdits Rivet, Guyot et Martin. En effet c’était alors
la troisième où ils étaient convoqués,
et je ne voyais pas, à ce qu’il me semblait, qu’ils disent des
choses en vertu desquelles je doive m’abstenir d’imputer défaut
et contumace aux susdits Rivet, Guyot et Martin.
C’est pourquoi, l’heure de
midi étant arrivée, je les ai fait appeler une fois,
deux, puis trois en jugement, mais ils n’ont pas comparu pas devant
moi ni personne qui ait procuration d’eux autre que ceux qui
viennent d’être mentionnés.
Après les avoir
attendus suffisamment et avoir fait crier après eux comme
on l’a dit, je les ai tenus pour contumaces et les ai mis en défaut.
Et j’ai convoqué le
susdits Rivet, Guyot et Martin en jugement, leur demandant de comparaître
devant moi à Janville sous peine d’être bannis du
royaume de France, de poursuivre la tâche qui m’était
confiée, le dimanche [24 juillet] après
la Sainte-Marie-Madeleine [vendredi 22] avec cet avertissement:
qu’ils viennent ou non, une fois pour toutes je procèderais
au ban.
Et j’ai ordonné à
Robin Thureau sergent de Janville que lui-même ou d’autres
convoquent les susdits en plein marché pour le dit jour
[dimanche 24 juillet] et au dit lieu pour faire ce qu’on vient de dire, avec l’avertissement
dont on vient de parler.
Et je vous fais savoir, cher
messieurs, que le lendemain [lundi 4 juillet] je me
suis transporté personnellement au Plessis-Saint-Benoist à
la maison du dit Rivet et que là en présence de braves
gens qui demeurent au dit hôtel, et de plusieurs autres de la dite
ville j’ai convoqué pour le dimanche [dimanche 24 juillet] après la Sainte-Marie-Madeleine [22 juillet] au dit lieu les dits River, Guyot et Martin de la manière
et avec l’avertissement susdits.
En outre, le même jour
[lundi 4 juillet], je me suis transporté à Authon, paroisse dont les
susdits relevaient lorsqu’ils ont commis les dits faits au lieu le plus public
de la dite ville, devant l’église et devant les Lépreux et
là j’ai convoqué les susdits Rivet, Guyot et Martin de la manière
et avec l’avertissement susdits.
En outre le même jour [lundi 4 juillet], je suis allé à Hérouville à la maison
du dit monsieur Guy d’Authon et là, en la présence
de la mère du dit Guyot, des domestiques, de son grand-père
et de plusieurs autres, j’ai convoqué les susdits aux dits jour
[24 juillet] et lieu, de la manière et avec l’avertissement susdits.
Lors de cette audience du dit
dimanche [24 juillet] après la Sainte-Marie-Madeleine [vendredi 22 juillet], je me suis transporté à Janville et alors que j’étais
en jugement au lieu où le susdit prévôt a coutume de
tenir ses audiences, il m’a été présenté une
lettre de mon seigneur le roi portant le texte suivant.
|
 (5) Carolus
Dei gratia / francorum et Navarræ / Rex Dilecto et fideli
magistro / Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem et
dilectionem cum (10) visa in curia nostra parisiensi / informatione
facta super erutione / oculorum fratris Renaudi Gives / monachi monasterii
sancti Benedicti / supra ligerim et grenetarii de (15) Stampis et
aliis maleficiis et / delictis in ipsius monachi personam / perpetratis
quæ quidem maleficia / Petrus Rives et Guiotus de auton / filius
Guidonis de Auton militis (20) commisisse dicuntur consideratoque (f°228r°)
quod dictum monasterium ipsiusque / monachi in nostra sunt gardia /
speciali quod per factum huiusmodi / in nostri contemptum violata extitit
(5) et effracta quodque ipsius / violationis cognitio et punitio ad
/ dictam curiam nostram cum ad eam / recurritur spectat in solidum consideratisque
/ dicti maleficii enormitatibus et aliis (10) quæ certa prædicta
consideranda erant / ipsa curia nostra tam viva voce quam / per litteras
vobis commiserit / inquirere vestrum evocandum super / prædictis
et inquestam eidem curiæ (15) remitere et alio in hoc facto / procedere
juxta traditam tam verbo quam / litteriis vobis formam et post hoc ex
/ parte dictorum Petri et Guioti exhibita / fuerint vobis litteræ
nostræ tacito de (20) præmisso obtentæ que commissioni
vobis / in hac parte ut dictum est factæ (f°228v°) derogare
videntur, iterato vobis / committimus et mandamus quatenus / dictis nonobstantibus
[l (lettre rayée?)] litteris aut / aliis tacito
de ordinatione curiæ nostræ / prædictæ obtentis
vel obtinendis in dicto / negotio juxta traditam verbo et litteris
/ vobis formam procedatis tam celeriter / quam in vestri defectum non
sit ad nos / ulterius propter hoc recurrendum (10) datum Parisiis sexta
die julii anno / Domini millesimo trecentesimo / vicesimo tertio
(5) Carolus
Dei gratia / francorum et Navarræ / Rex Dilecto et fideli
magistro / Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem et
dilectionem cum (10) visa in curia nostra parisiensi / informatione
facta super erutione / oculorum fratris Renaudi Gives / monachi monasterii
sancti Benedicti / supra ligerim et grenetarii de (15) Stampis et
aliis maleficiis et / delictis in ipsius monachi personam / perpetratis
quæ quidem maleficia / Petrus Rives et Guiotus de auton / filius
Guidonis de Auton militis (20) commisisse dicuntur consideratoque (f°228r°)
quod dictum monasterium ipsiusque / monachi in nostra sunt gardia /
speciali quod per factum huiusmodi / in nostri contemptum violata extitit
(5) et effracta quodque ipsius / violationis cognitio et punitio ad
/ dictam curiam nostram cum ad eam / recurritur spectat in solidum consideratisque
/ dicti maleficii enormitatibus et aliis (10) quæ certa prædicta
consideranda erant / ipsa curia nostra tam viva voce quam / per litteras
vobis commiserit / inquirere vestrum evocandum super / prædictis
et inquestam eidem curiæ (15) remitere et alio in hoc facto / procedere
juxta traditam tam verbo quam / litteriis vobis formam et post hoc ex
/ parte dictorum Petri et Guioti exhibita / fuerint vobis litteræ
nostræ tacito de (20) præmisso obtentæ que commissioni
vobis / in hac parte ut dictum est factæ (f°228v°) derogare
videntur, iterato vobis / committimus et mandamus quatenus / dictis nonobstantibus
[l (lettre rayée?)] litteris aut / aliis tacito
de ordinatione curiæ nostræ / prædictæ obtentis
vel obtinendis in dicto / negotio juxta traditam verbo et litteris
/ vobis formam procedatis tam celeriter / quam in vestri defectum non
sit ad nos / ulterius propter hoc recurrendum (10) datum Parisiis sexta
die julii anno / Domini millesimo trecentesimo / vicesimo tertio
|
[Troisième
commission royale à Thomas de Reims]
Charles par la grâce
de Dieu roi des Francs et de Navarre, à son affectionné
et féal maître Thomas de Reims notre conseiller, salut
et affection.
Dans notre tribunal
de Paris a été examiné l’enquête qui
a été opérée sur l’arrachement des
yeux de frère Regnault Givet, moine du monastère de
Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes et sur d’autres
méfaits et délits perpétrés à
l’encontre de la personne du dit moine.
On dit que ces méfaits
ont été commis par Pierre Rivet et Guyot d’Authon,
fils du chevalier Guy d’Authon.
Étant considéré
que le dit monastère du dit moine est sous notre protection
spéciale, par un tel fait cette garde se trouve violée
et enfreinte en mépris de notre autorité, et que le
jugement et la sanction de la dite violation relève de notre
dit tribunal, vu que cela lui revient et le regarde du tout au
tout;
étant considéré
également les énormités du dit méfait,
et certains autres points déjà mentionnés qui
étaient à prendre en considération,
notre susdit tribunal
vous a donné mission tant de vive voix que par ordre écrit
d’enquêter vestrum evocandum [locution non
élucidée] sur les susdits faits, et de renvoyer votre
enquête au dit tribunal, et, une fois faite cette deuxième
chose, d’entamer une procédure sous la forme qui vous a été
communiquée tant de vive voix que par écrit.
Et après cela, il vous
a été exhibé de la part des dits Pierre et
Guyot une lettre de nous, obtenue secrètement au sujet de
ce qui précède, qui paraît abroger l’ordre de mission
qui vous été donné sur ce point, à ce qu’il
a été dit.
A nouveau donc nous vous donnons
ordre et mission, sans tenir compte de lettres ou d’autres documents
déjà obtenus ou obtenus à l’avenir secrètement
de l’administration de notre susdit tribunal, d’observer dans cette
affaire la procédure qui vous a été communiquée
de vive voix et par écrit, et de procéder avec tant
de célérité que cela ne tourne pas à une
faute de votre part à notre égard si vous revenez encore
vers nous sur ce point.
Donné à Paris
le 6 juillet de l’an du Seigneur
1323.
|
lesquelles je fis / lire de mot
a mot en jugement / et lors me requirent Jean (15) legrant d’yenville
et Jehan de / gravelle qui cousins se disoient / desdicts Rivet
et Guiot ce que / autrefois de par eux a esté dict / dessus
pour les dessus dicts (20) Rivet et Guiot ausquels fut / faicte la response
que autrefois (f°229r°) avoit esté faicte et dis a eux
/ oultre que considerer la teneur de / la lettre qui presentéé
m’estoit je / estoie tenus a aller avant a bannir (5) les dessus
dicts et me requeroit o / grant instance le procureur desdicts /
Religieux que je li octriasse / deffaut et que je les bannisse / Pourquoy
tout veü et consideré ce que (10) dessus est dict eu conseil
et avis / sur tout l’eure de donner deffault / passée les dessus
dicts Rivet / guiot et Martin appellez par / Robin Tureau sergent dyenville
(15) une fois seconde et tierce pourceque / il ne se comparurent ne aultres
/ qui mandement eust d’eux aultre / que dessus est dict je les mis en
/ deffault et considere la coustume (f°229v°) du Parlement et
de Paris et / considere aultressi que ledits / fais estoit fais de
garde enfreinte / et briséé de quoy la connoissance
(5) appartient a Roy et non a aultre / considere autressi ceque encharchie
/ m’estoit de mes seigneurs du / Parlement et ce que mandé m’estoit
/ reputé les dessusdicts Rivet Guiot (10) et Martin pour bannis
et illec en / jugement les banni du Royaume / de france et commanday
au prevost / d’yenville qui illeques estoit presens / que il feist les
dessusdicts Rivet (15) Guiot et Martin publier et crier / oudict pais
au lieu ou on avoit / et a accoustumé a faire tels / choses pour
bannis du Royaume / de france Donné soubs mon scel (20) lan et
le jour dessusdicts Donné (f°230r°) soubs mon scel lan et
le jour / dessusdicts
|
[Rapport
de Thomas au Parlement, suite et fin]
J’ai fait lire cette lettre
intégralement en jugement.
Et alors Jean Legrand de Janville
et Jean de La Gravelle, qui se disaient cousins des dits Rivet et
Guyot m’ont demandé la même chose que la fois précédente,
qui a été mentionné ci-dessus, en faveur des
dits Rivet et Guyot.
Il leur a été
fait la même réponse qui leur avait été
faite la fois précédente, et je leur ai dit en outre
que compte tenu de la teneur de la lettre qui m’était présentée,
j’étais tenu de procéder au bannissement des susdits.
Et le fondé de pouvoir
des susdits religieux me requérait avec une grande insistance
que je constate en sa faveur leur défaut et que je les bannisse.
C’est pourquoi, tout considéré,
et vu ce qui a été dit ci-dessus, après avoir
pris conseil et avis sur tout, quand l’heure de constater le défaut
a été dépassée, après que les
susdits Rivet, Guyot et Martin ont été appelés,
une fois, deux, puis trois, puisqu’ils n’ont pas comparu ni eux ni
d’autres personnes qui aient un mandat de leur part autres que ceux
que ceux qui viennent d’être mentionnés, je les ai mis
en défaut.
Et considéré
aussi la tâche dont j’étais chargé par messieurs
du Parlement et ce qui m’était ordonné, j’ai déclaré
les susdits Rivet, Guyot et Martin bannis du royaume de France, et
j’ai ordonné au prévôt de Janville qui était
présent là, de faire publier et crier au dit pays, au
lieu où on avait et a coutume de faire ce genre de choses, que
les susdits Rivet, Guyot et Martin étaient bannis du royaume de
France.
Donné sous mon sceau
l’an et le jour susdits [24 juillet 1323].
|
collonata [Lisez:
collata] cu. or. / qd. ha. [cum originali,
quod habemus]
|
Collationné avec l’original,
qui est en notre possession. [Mention
de l’auteur du Cartulaire original, perdu].
|
FIN DU TEXTE.
Nous éditerons
d’autres documents sur la même affaire ultérieurement.
|

Authon-la-Plaine, Le Plessis-Saint-Benoist, Hérouville,
Sainville et Vierville sur la carte de Cassini de 1756
|
ANNEXE 1
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute
information disponible sur chacun des personnages considérés.
Berthelot Aignean
|
Sergent
à Janville.
|
Charles IV
|
En
latin Carolus. Roi de France de 1322 à
1328.
|
Guillaume de La Touche
|
Prévôt
de Janville cité en avril-juillet 1323.
|
Guy d’Authon
|
En
latin Guido. Chevalier possessioné à
Hérouville.
|
Guyot d’Authon
|
En
latin Guiotus. Fils du chevalier Guy d’Authon,
et clerc.
|
Jean de La Gravelle
|
Nobliau
possessioné à Authon (le fief de Gravelle est encore
mentioné en 1515 comme localisé à Authon)
|
Jean Lebarbier
|
Sergent
à Janville.
|
Jean Legrand de Janville
|
Nobliau
possessioné à Janville.
|
Lision
|
En latin
Lisius. Surnom de Guy d’Authon, compris au départ
par erreur comme le nom de l’un de ses complices.
|
Martin de Vierville
|
Valet
de Guy d’Authon.
|
Pierre Delaunoy
|
Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
en 1324 (C’est seulement l’acte suivant qui le mentionnera par son
nom propre).
|
Pierre Rivet du Plessis
|
Nobliau possessioné
au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la paroisse d’Authon (C’est
la pièce suivante qui nous apprend que Rivet est le patronyme
de ce personnage, dont le prénom est Pierre).
|
Regnault Givet
|
Moine de
Saint-Benoît-sur-Loire, grenetier d’Étampes
|
[Robert de Joigny]
|
Évêque
de Chartres de 1316-1326 (mentionné seulement de par son titre) |
Robin Thureau
|
Variantes
graphiques: Tureau, Turreau, Thureau.
Sergent de Janville.
|
Thomas de Reims
|
En
latin Thomas de Remis. En français Thomas
de Rems. Membre du Parlement de Paris, commissaire du roi. Sur la carrière ultérieure
de Thomas de Reims, nous ne savons pour l’heure qu’une chose: en avril
1328, il sera nommé à nouveau commissaire du roi, en
compagnie de Pierre de Prouville, dans le cadre d’une affaire de monnaies
en Périgord [Archives Nationales, Registre JJ 65A (1327-1328),
n°82 (f°64)].
Jules VIARD & Aline
VALLÉE, Registres du Trésor des chartes. Tome
3. Règne de Philippe VI de Valois. Première partie, JJ 65A
à JJ69. Inventaire analytique, par J. Viard, revu par A. Vallée
[in-4°; XXIV+416 p.], Paris, Imprimerie nationale, 1978.
(Référence repérée
grâce à la page: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Registres_JJ_part01.htm,
en ligne en 2007).
|
Anonyme 1
|
Mère
de Guyot d’Authon, vivante en 1323.
|
Anonyme 2
|
Grand-père
(sans doute paternel) de Guyot, vivant en 1323.
|
Anonyme 3
|
Curé
de Janville en 1323
|
Anonyme 4
|
Official
de Sens en 1323
|
Anonyme 5
|
Fondé
de pouvoir de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en 1323
|
Anonymes 6
|
Cousins
ou prétendus cousins de Rivet et Guyot cités en 1323
|
|
ANNEXE 2
ÉLÉMENTS DE LEXIQUE
Je donne ici sans volonté
d’exhaustivité le sens curieux de certains mots, dont certains
ne sont pas portés par le Lexique de l’Ancien français
de Godefroy, ou seulement avec un sens qui ne satisfait pas le contexte.
En bref, je donne ici naïvement ce que j’ignorais et que peut-être
d’autres que moi seront intéressés de savoir.
asses tost
|
aussitôt
|
aucques, auques
|
un peu, quelque
peu
|
aultressi, autressi
|
aussi
|
boiche
|
bouche
|
chastellerie
|
châtellenie
|
chastellet
|
Châtelet
(en latin Castelletum). On appelait châtelets,
au Moyen Âge, de petits châteaux établis à
la tête d’un pont, au passage d’un gué, à cheval
sur une route en dehors d’une ville ou à l’entrée d’un
défilé. Il en existait deux à Paris, au bout des
deux pont desservant l’île de la Cité, le grand Châtelet,
au nord (rive droite) et le petit (rive gauche). Le Châtelet de Paris,
ainsi divisé en deux parties, et devenu inutile après la
construction de la forteresse de Philippe Auguste, fut affecté
à la prévôté de Paris en charge de la police
et de la justice criminelle. Il comprenant prisons et salles de torture.
La prison du Grand-Châtelet, démolie seulement entre 1802
et 1810, s’élevait à l’emplacement actuel du théâtre
du Châtelet.
|
heronville
|
Hérouville (Erainville sur la carte de Cassini)
|
illec, illecques
|
là
|
inthimation, intimation
|
avertissement
|
mesmement
|
surtout
|
o
|
avec (selon Littré c’est une altération
du roman ob, od ou ab, lui même
provenant du latin apud, qui avait pris en basse
latinité le sens “avec”). Conservé
dans notre texte seulement dans l’expression o int(h)imation.
|
ou
|
au (contraction
de en le, tandis que au n’est au départ
que la contraction de à le)
|
quanque
|
tout ce que (latin quantum quod; graphies
attestées par Godefroy: )
|
|
ANNEXE 3
Alfred Gandhilon
ANALYSE SOMMAIRE
Inventaire sommaire des
archives départementales antérieures du Cher, série
G, 1931
F°° 210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller
et commissaire du roi, condamnant au bannissement Rivet du Plessis,
Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville
[sic, en fait: Vierville (B.G.)],
valet de Guy d’Authon, accusés d’avoir crevé les yeux de
frère Regnaut Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier
d’Étampes (1323). Cette sentence est précédée
d’une longue procédure où sont rapportées plusieurs
[trois (B.G.)] lettres du roi.—
F°230. Accord passé, sous le sceau de Jean de Longueau
[N.B.: le cartulaire porte erronément:
Longneau (B.G.)], prévôt d’Orléans,
entre les religieux de Saint-Benoît, d’une part, Guy d’Authon,
chevalier, et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)], écuyer, agissant pour le comte de Pierre Rivet, du
Plessis, écuyer, d’autres part, au sujet d’arrérages
de rentes réclamés par les religieux à Pierre Rivet.
Au nom de leur mandataire, Guy d’Authon et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)] s’engagent
à payer aux religieux une rente annuelle de 40 livres tournois
(1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).— F°237. Par-devant
Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau de la prévôté
de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre Rivet, écuyer du Plessis,
en payement d’une rente annuelle de 32 livres parisis, due par lui à
l’abbaye de Saint-Benoît pour certains «accors d’amendes
et malefaçons», abandonne aux religieux divers biens qu’il
tenait d’eux en foi et hommage au terroir du Plessis (1327, le samedi
après la Saint-Jacques) [sic, lisez en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe
(B.G.)].
|
Inventaire sommaire des archives
départementales antérieures à 1790. Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I.
Archevêché de Bourges. 1re partie, colonne 343.
|
ANNEXE 4
Honoré Antoine Frégier
TOPOGRAPHIE DE PARIS ET AUTORITÉS PRÉPOSÉES
A SA POLICE (1182-1350)
Histoire de l’administration de la police de Paris,
1860
Nous donnons
ici ce chapitre en entier, pour qu’on puisse se faire une idée
générale de l’origine et de la nature des institutions
parisiennes que nous voyons à l’œuvre
en 1323. Frégier y explique notamment la naissance de la Prévôté,
du Châtelet, du Parlement et des commissaires de police.
|
HISTOIRE DE L’ADMINISTRATION
ET DE LA POLICE DE PARIS
LIVRE PREMIER. 1182-1350.
TITRE PREMIER.
TOPOGRAPHIE DE PARIS ET AUTORITÉS PRÉPOSÉES
A SA POLICE.
CHAPITRE UNIQUE.
Topographie de Paris
— Sa situation primitive — Ses accroissements successifs. — Sa division
en trois grandes zones. — Sa troisième enceinte, sous Philippe—Auguste.
— Constitution municipale de cette ville à l’avénement
de ce prince. — Prévôt des marchands et prévôt
de Paris. — Premiers conflits de ces deux autorités. — Institution
du Châtelet. — Le prévôt de Paris chef du Châtelet.
— Décadence momentanée de la prévôté.
— CeIIe-ci est relevée par salut Louis. — Composition du Châtelet.
— Origine des commissaires de police. — Le prévôt de Paris,
magistrat de robe et d’épée. — Le guet, son organisation.
— Police de sûreté de Paris et de sa banlieue. — Le prévôt
de Paris chargé de la publication des lois. — Rapports du
prévôt et du Châtelet avec le parlement.
|
|
Paris s’est accru progressivement
depuis son origine. Cette ville fut d’abord enfermée dans un
espace très restreint qui était borné par les deux
bras de la Seine. Défendu tout à la fois par un mur d’enceinte
et par la rivière, cet espace reçut et conserva toujours
le nom de Cité. Les [p.2] avantages de la position géographique de celle-ci attirèrent
sur les bords du fleuve un grand nombre d’habitants qui en cultivèrent
le territoire ou qui y bâtirent leur demeure. Les habitations composant
le faubourg du nord devinrent bientôt une partie intégrante
de la ville et furent entourées d’une clôture particulière
qui forma la deuxième enceinte de Paris. La population se groupait
aussi du côté du midi, mais elle était plus clairsemée
sur ce point qui resta long temps à découvert. Paris
se trouva dès lors divisé en trois zones; la première,
située sur la rive droite, fut appelée le quartier d’outre
Grand-Pont (1), Elle était aussi connue sous le nom de la Ville, parce
qu’elle avait une plus grande étendue que le territoire de la
Cité, comme si l’on devinait déjà que la partie
la plus nombreuse des habitants de Paris dût, de nos jours, se
porter de préférence de ce côté, et réaliser
par des déplacements continuels l’espèce de prédiction
qui avait donné lieu à la désignation primitive de
ce quartier. La seconde zone, située sur la rive gauche, prit le
nom de quartier d’outre Petit-Pont (2), Elle fut connue depuis sous la désignation
d’Université, étant devenue le centre de l’enseignement
et le séjour des professeurs des écoles aussi bien que des
élèves. On l’appelle encore à présent le quartier
ou le pays latin. Enfin, la troisième zone, qui était, en
réalité, le berceau de la nouvelle ville, garda son ancien
nom et fut appelée le quartier de la Cité (3). Sous le règne
de Philippe-Auguste [1180-1223], les dehors
de Paris étant occupés, surtout du côté du
midi, ou par des communautés religieuses, ou par des habitations
particulières qui se multipliaient de plus en plus, ce prince
sentit le besoin d’assigner à cette ville une enceinte plus considérable
qui permît d’y réunir les dernières agglomérations
d’habitants qui s’étaient formées autour ou non loin de ses
murs. Les travaux [p.3] furent entrepris aux frais du domaine du roi et de la ville,
et leur exécution dura vingt ans. Cette enceinte fut la troisième.
Elle embrassa, comme la première, Paris dans toute son étendue.
Lorsqu’elle fut achevée, la ville comptait quatre quartiers, qu’il
ne faut pas confondre avec les trois zones dont il a été
parlé. A la fin du règne de saint Louis, le nombre de ces
quartiers fut augmenté de quatre autres. La topographie de Paris
n’éprouva dès lors aucun changement jusqu’à l’époque
où Charles V monta sur le trône [1364] (1).
|
(1)
Ce grand pont est aujourd’hui le pont au Change. II était
formé par une porte fortifiée.
(2) Ce
petit pont est celui de l’Hôtel-Dieu. II était aussi
fermé par une porte.
(3) Delamare,
Traité de la police, t. 1, p. 81-93.
(1) Delamare,
t. I, p. 107.
|
A l’avénement de Philippe-Auguste
[1180], la France venait d’entrer dans une phase nouvelle de
civilisation. Les communes étaient émancipées
ou tendaient vers leur affranchissement. La royauté n’était
plus un titre éphémère; elle s’efforçait
d’acquérir une existence propre, indépendante, et de fonder
sa prédominance sur toutes les classes de la société.
La langue française commençait à se former;
enfin, il s’opérait dans les entrailles de la société
un travail de rénovation qui devait appeler à de meilleures
destinées les classes du peuple soumises aux charges les plus
pénibles et créer une bourgeoisie assez puissante pour
siéger plus tard, sous le nom de tiers état, dans les
assemblées solennelles de la nation, à côté
du clergé et de l’élite de la noblesse, et pour se mettre
un jour en possession de la direction des affaires publiques, après
des luttes incessantes et acharnées contre les forces privilégiées
et dominantes de la société.
|
|
|
A l’époque où éclata le mouvement communal, Paris
jouissait déjà des franchises et des garanties qu’ambitionnaient
les autres villes de France de ces franchises se perdait dans les
temps les plus reculés (2) L’administration communale était
partagée entre des officiers municipaux élus par la
bourgeoisie et le prévôt de Paris, officier du roi. [p.4] |
(2)
Dissertation de Leroi sur l’origine de l’Hôtel de ViIle, dans
l’Histoire de Paris, par Felibien et Lobineau, t. I, p. 70.
|
Les magistrats de la cité ne reçurent le titre de prévôt
des marchands et d’échevins que sous le règne de saint
Louis. Auparavant, ils n’étaient désignés par
aucune appellation honorifique, ou, si cette appellation existait,
les anciens monuments n’en ont conservé aucune trace (1). La ville de Paris,
capitale du royaume et résidence de nos rois, avait eu le bonheur
de se soustraire aux plus grands abus de la féodalité et
à la sujétion commune. Elle était régie alors
par des coutumes qui en faisaient une ville d’exception.
|
(1)
Histoire de Paris, par Felibien et Lobineau,
t. I, p. 32.
|
Les attributions de l’autorité municipale et du prévôt
n’étant pas suffisamment limitées, il s’éleva
des conflits fréquents entre ces deux autorités. Le prévôt
des marchands et les échevins revendiquaient le droit de connaître
des excès et des délits commis sur la rivière
dont ils avaient la surveillance, pour assurer et faciliter le commerce.
ils prétendaient que cette prérogative, résultant
du fait de la marchandise de l’eau, pouvait d’autant
moins leur être contestée qu’ils en étaient en
possession par eux-mêmes, ou par leurs devanciers, de temps immémorial,
et que la notoriété de cette possession était
établie par un signe non équivoque, tel que le poteau
planté sur la place de Grève, auquel était attaché
un carcan avec les armes de la ville de Paris. Le même droit de
juridiction contentieuse était réclamé par eux à
l’égard des autres attributions administratives qui leur avaient
été conférées.
Le prévôt de Paris
combattait ces prétentions en disant que, comme chef du Châtelet,
il représentait la personne du roi en ce qui concerne la justice,
et qu’à ce titre il était seul compétent pour
statuer sur les délits et les crimes qui se commettaient dans
l’étendue de sa juridiction. Il taxait d’entreprise contre son
autorité l’établissement du poteau invoqué par
l’échevinage comme marque de sa justice, et il ajoutait que
cet appareil n’avait été conservé que par pure
tolérance. Le parlement, saisi à plusieurs reprises de
ces [p.5]
différends, avait prononcé, après des discussions
solennelles, eu faveur du prévôt de Paris (1). Toutefois, malgré
les arrêts du parlement, le prévôt des marchands
ne laissa pas de connaître des contraventions et délits
commis sur la rivière, et le droit de juridiction dont il se prévalait
lui fut conservé non seulement par le fait de la possession,
mais encore par les ordonnances et les règlements.
|
(1)
Delamare, Traité de la Police, t. 1, p. 187 et suivantes.
|
L’institution du Châtelet comme tribunal remonte à une
haute antiquité. Il formait originairement la cour féodale
(lu comte de Paris. C’est en 1032 que ce tribunal fut présidé
pour la première fois par un magistrat revêtu de la qualité
de Prévôt. Il paraît que jusqu’à la minorité
de saint Louis, les personnes appelées à l’exercice
de cette magistrature, à Paris, étaient considérables
tant par leur naissance que par leurs lumières. Toutes les autres
prévôtés du royaume étaient données
à ferme. Pendant la régence de la reine Blanche, mère
de ce roi [1226-1234], les troubles excités par l’ambition des barons ayant accru
les charges de l’État, le conseil du prince, pour y subvenir, crut
devoir affermer la prévôté de Paris. Cet office devint
dès lors la proie d’hommes cupides et sans capacité. Des
enchérisseurs n’ayant pas assez de fortune pour soumissionner en
leur nom la ferme (le la justice prévôtale, s’associaient
entre eux et tous prenaient la qualité de prévôt
de Paris, dont ils exerçaient collectivement les fonctions. On vit,
dans deux adjudications successives, deux marchands s’asseoir de la
sorte, tour à tour, sur le siège de la première
juridiction ordinaire du royaume (2).
|
(2)
Ibid., p. 119 et 120. Brussel, De l’origine
et de l’usage des fiefs, t. I, p.42.
|
Cet état de choses donna lieu aux plus graves désordres.
Le prévôt de Paris n’était pas seulement chargé
de rendre la justice; il était gouverneur de la ville et investi
du commandement des gens de guerre de la vicomté. Il était
en outre juge des différends qui intéressaient le domaine
du [p.6] roi; en un mot, il avait hérité sous ces divers
rapports des attributions des anciens comtés. Toutefois, quel
secours pouvait-on attendre d’un traitant, comme gouverneur de la cité,
dans les temps de troubles alors si fréquents? Quelle confiance
méritait un juge obligé d’opter entre les devoirs (le
sa charge et les suggestions de son intérêt comme fer mier,
dans les cas où le fisc était appelé à profiter
de la condamnation? S’il était à craindre qu’un tel juge
ne cédât trop facilement au désir d’accroître
la perception des amendes qui faisaient partie des produits de sa ferme,
n’avait-on pas lieu d’appréhender, à plus forte raison,
que la perspective d’une riche confiscation ne fit taire en lui le cri
de la conscience et que, dans le doute, un accusé ne fût
déclaré coupable par le prévôt pour satisfaire
l’infinie cupidité du fermier? Enfin, si l’espoir du gain devait
multiplier les poursuites du juge dans certains cas, la misère des
vagabonds et de la plupart des malfaiteurs ne devait-elle pas refroidir
le zèle de ce même juge et le porter à laisser la
société sans défense, afin de ne pas entreprendre
des procès dont les frais eussent été supportés
en pure perte par les fonds de la ferme?
Toutes ces appréhensions ne
furent que trop justifiées par l’expérience. Les garanties
individuelles furent méconnues par le défenseur officiel
de la cité jusque-là que les citoyens honnêtes désespérant
d’obtenir bonne justice sur le domaine du roi, se retiraient sur le
territoire des hauts justiciers ecclésiastiques. On sait, en
effet, que Paris était alors soumis, suivant la hiérarchie
féodale, à deux justices distinctes la justice du roi qui
s’exerçait sur les habitants du domaine royal, et les justices
particulières qui appartenaient aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques
exerçant le droit de souveraineté dans la circonscription
de leur territoire. Au retour de sa première croisade [1252], saint
Louis mit fin à tous ces abus, en abolissant la vénalité
de l’office de prévôt de Paris; il remit cet office à
un homme renommé par sa probité, son savoir et son énergie,
et lui assigna un [p.7] traitement considérable. Joinville, dans sa naïve
et touchante chronique, nous a conservé, le nom de cet austère
magistrat qui s’appelait Étienne Boileau. l ce moment, on vit,
renaître la confiance et la sécurité. Les malfaiteurs
furent recherchés et punis sévèrement. La justice
fut rendue avec impartialité et sans acception de personnes,
et il ne resta nul vestige des prévarications et des abus qui
avaient excité la clameur publique (1).
|
(1)
Vie de saint Louis, par .Joinville, avec notes
de Ducange, p. 123.
|
La réforme introduite dans la prévôté de
Paris rendit au Châtelet son ancienne considération. Saint
Louis, suivant l’usage antique de ses prédécesseurs,
vint siéger quelquefois dans le sein du tribunal, à côté
du magistrat intègre qu’il avait revêtu de sa confiance.
Le roi, par cette dé marche, avait pour but d’encourager les
prévôts des autres parties de la France en honorant le
caractère de celui qui représentait son autorité
à Paris, car le chef du Châtelet n’était que le
garde de la prévôté, comme pour attester que la
présidence suprême de cette juridiction appartenait au
roi, témoignage confirmé d’ailleurs parle dais qui surmontait
le siége principal, comme étant. la place du monarque (2). Une des bases les plus
solides de la réforme dont nous venons de parler, fut la séparation
de la recette du domaine royal de la prévôté de Paris.
Par cette mesure, les attributions du prévôt se trouvèrent
réduites au gouvernement, à la police et à la justice
de la capitale. Ces fonctions réunies entourèrent la prévôté
d’un grand éclat et furent ambition nées dans la suite par
les seigneurs du plus haut rang. Nos rois les rehaussèrent encore
en y joignant celle de chambellan, afin de donner aux prévôts
de Paris un accès plus facile auprès de leur personne. Les
abus étaient alors si difficiles à déraciner que, pendant
près de deux siècles, il fut impossible, malgré
les essais tentés par Charles V [1364-1380], de faire participer
les provinces aux bienfaits du nouveau régime
[p.8] établi Paris. L’anomalie des magistrats fermiers
y subsista pendant tout ce temps. Ce n’est que sous Charles VII [1422-1461] qu’elle disparut (1).
|
(2)
Delamare, t. I, p, 115-120.
(1)
Delamare t. I, p. 122-123.
|
Delamare et Brussel, écrivains non moins judicieux que savants,
rapportent au règne de Philippe-Auguste [1180-1223] les notions les plus anciennes et les plus exactes qu’on
ait pu recueillir sur la prévôté de Paris. Le
second de ces écrivains établit, d’après des preuves
certaines, que sous ce règne le prévôt était
assisté de six prud’hommes (2), lesquels formaient auprès de
lui un conseil; c’est dans les mains du prévôt seul que résidait
le pouvoir juridictionnel. Quoique ce magistrat ne jugeât point
selon le droit, puisqu’à cette époque il n’existait pas
de règles écrites, mais seulement des usages et des coutumes,
sa juridiction n’en était pas moins un véritable tribunal.
La première ordonnance connue qui dispose sur les officiers du Châtelet,
est celle de novembre 1302 rendue par Philippe le Bel [1285-1314], et pourtant cette ordonnance n’a point le caractère
d’un règlement général et organique; elle ne
contient que des dispositions de détail et d’un intérêt
secondaire. La seule de ces dispositions qui ait quelque importance
est celle qui défend au prévôt d’avoir un lieutenant
attitré, et qui ne l’autorise à se faire remplacer, en
cas de nécessité absolue, que par un prud’homme (3). Indépendamment
des assesseurs du prévôt, il y avait, dans la composition
du tribunal, des auditeurs, des enquêteurs et des examinateurs
qui concouraient à l’instruction des procès, en recevant
les dépositions des témoins, en procédant à
des enquêtes et à d’autres écritures. Les enquêteurs
et les examinateurs agissaient ou comme délégués
spécialement par le prévôt pour une affaire déterminée,
ou comme officiers de police; dans le premier cas, ils procédaient
juridiquement, comme rapporteurs de l’affaire qui [p.8] leur avait été
confiée, et dans le second, en vertu de leur titre même
d’examinateurs ou plutôt de commissaires de police (1).
|
(2)
Brussel, De l’usage des fiefs, t. I, p. 424.
(3)
Ordonnances des rois de France, t. I, p. 352.
(1)
Delamare t. I, p. 210.
|
Les registres du Châtelet, qui sont sans contredit les plus
anciens documents judiciaires du royaume, constatent que dès
1321, il existait auprès de cette juridiction un parquet composé
d’un procureur du roi et de substituts. Ces officiers étaient
déjà connus et désignés sous le nom de gens
du roi (2).
|
(2)
Ibid., p. 201.
|
Philippe de Valois [1328-1350], en modifiant l’organisation du Châtelet, ôta aux
commissaires examinateurs le droit de siéger parmi les juges
de ce tribunal, et les chargea exclusivement de l’instruction des affaires.
Huit conseillers furent créés pour assister le prévôt,
en remplacement des anciens prud’hommes (3); leur nombre fut ensuite
augmenté.
|
(3)
Ordonnances des rois de France, 1327, t.II,
p. 1 et suiv.
|
Les examinateurs ou commissaires de police exerçaient chacun
leur surveillance dans le quartier qui leur avait été
assigné. Bien que l’utilité publique eût pu les
astreindre à y demeurer, il est constant qu’en général
ils résidaient dans d’autres quartiers, et qu’ils ne paraissaient
dans celui dont ils étaient les gardiens, que pour l’inspecter
par des tournées plus ou moins assidues.
Afin d’assurer le service de
sa juridiction, le prévôt disposait d’une compagnie
d’ordonnance de cent maîtres et de deux compagnies de sergents,
dénomination qui était alors purement militaire. L’une
de ces compagnies était composée de trente-cinq hommes
à cheval, et l’autre de soixante-dix hommes à pied. L’effectif
de chacune de ces compagnies fut successivement augmenté. Les
sergents à pied portaient des bâtons fleurdelisés,
d’où ils furent appelés sergents à verge. Ils
étaient chargés de la garde de la ville et des faubourgs,
et de veiller à l’exécution des règlements de
police. [p.10] Les sergents à cheval étaient préposés
à la surveillance des environs de la capitale (1).
|
(1)
Delamare, 1. 1, p. 249.
|
Chaque commissaire de police avait sous ses ordres un certain nombre
de sergents à pied. Il pouvait aussi requérir l’assistance
des chefs du guet bourgeois (2).
|
(2)
Ibid., p. 225.
|
Le prévôt de Paris, comme les comtes, les baillis et
les sénéchaux, était magistrat de robe et d’épée.
Il présidait en robe le tribunal et portait l’épée
en tête des troupes dont il avait le commandement. Son costume
et ses attributs dans les grandes cérémonies témoignaient
de sa double autorité. Il était vêtu d’une robe
de brocard d’or fourrée d’hermine, et monté sur un cheval
richement caparaçonné. Deux pages le précédaient
portant au bout d’une lance, le premier, son casque, le second, ses gantelets
(3).
|
(3)
lbid,, p. 249.
|
Quoique la juridiction du prévôt fût bornée,
ainsi que nous l’avons dit, par plusieurs justices seigneuriales, cependant
celles-ci ne pouvaient connaître de certains crimes. Nos rois
en avaient délégué la répression à
leur magistrat ordinaire, c’est-à-dire au prévôt.
Ils lui avaient attribué, en outre, la connaissance pleine et entière
des faits de police, la prévention, en première instance,
dans toutes les autres matières, et le droit de statuer en cas
d’appel: sur les sentences rendues par les hauts justiciers ou leurs officiers
(4).
|
(4)
Ibid., p. 156.
|
Le guet est une institution municipale dont l’origine remonte aux
premiers temps de la monarchie. Pendant le moyen âge, le guet
de Paris était composé, partie des bourgeois de la cité,
qui en formaient le plus grand nombre, et partie de vingt sergents
à cheval, et de vingt-six sergents. à pied soldés
par le roi. Les corporations des marchands et des artisans fournissaient
alternativement, pour le service du guet, un certain nombre d’hommes
fixé par le prévôt de Paris. Ces hommes montaient
la garde à tour de rôle, de [p.11] trois semaines en trois semaines,
aux quartiers qui leur étaient assignés, et formaient ce
qu’on appelait le guet assis ou le grand guet. Ce corps était
divisé en dizaines, quarantaines, et cinquantaines d’hommes.
Ces sections ou compagnies étaient commandées par des
officiers de ville appelés dizeniers, quaranteniers ou cinquanteniers,
lesquels étaient nommés par le prévôt des
marchands, et relevaient de lui. Les dizeniers devaient recenser fréquemment
les habitants des maisons comprises dans leur section, sous l’autorité
des quaranteniers et des cinquanteniers. Ils déposaient ensuite
leurs listes chez les commissaires de police de leurs quartiers, ou au
greffe du Châtelet. Les quaranteniers représentaient la milice
bourgeoise auprès de l’autorité prévôtale
ou municipale, toutes les fois qu’il était nécessaire de
faire parvenir des ordres ou des instructions à cette milice.
|
|
Le guet royal, était mobile, c’est-à-dire destiné
à faire des rondes (1). Deux commis, nommés clercs du guet, faisaient l’office
de sergents-majors; ils tenaient les contrôles de la garde
bourgeoise, et envoyaient chaque jour des ordres de service aux gens
de métier dont le tour de garde était arrivé.
Ceux-ci devaient se rendre, à l’heure du couvre-feu, c’est-à-dire
entre sept et huit heures du soir l’été, et de six à
sept heures l’hiver, sur la place du Châtelet, ou se faire remplacer.
Là, ils étaient répartis, par les clercs du guet,
entre les divers postes desservis par les bourgeois. Chaque poste était
gardé par six hommes armés. Les principaux de ces postes
étaient le Châtelet, la cour du Palais, l’église
de la Madeleine, en la Cité, la fontaine des Innocents, les piliers
de la Grève et la porte Baudoyer. Il y avait des corps-de-garde
aux carrefours et sur d’autres points qu’on avait jugé utile
de protéger.
|
(1)
Delamare, t. I, p. 256.
|
Le service du guet commençait avec la nuit et finissait
entre quatre et cinq heures du matin. Le rassemblement et [p.12] la retraite (le la
garde avaient lieu au son du cor. Les sergents composant le guet royal concouraient
au service de sûreté avec les bourgeois. Ils avaient pour commandant
un officier appelé chevalier du guet. Celui-ci, ou son lieutenant,
se rendait avec sa troupe au même lieu de rassemblement que les bourgeois;
et pendant que ceux-ci montaient la garde à leur poste, les premiers
parcouraient les rues et les faubourgs de Paris, et visitaient les corps-de-garde
des gens de métier pour s’assurer de leur présence, et pour
s’informer des événements de la nuit. Ils signalaient au prévôt
de Paris les bourgeois et les artisans qui s’étaient absentés
sans cause légitime. Ce magistrat était juge des infractions
portées à la discipline, et des cas d’exemption et de dispense.
Le chevalier du guet pouvait, en l’absence du prévôt, régler
la composition et l’ordre du service. II était, au surplus, préposé,
comme gardien de la ville, au maintien de la discipline de la section
bourgeoise aussi bien que de la section militaire du guet qu’il commandait
sous l’autorité du prévôt (1).
|
(1)
Ordonnances des rois de France, 1363, t. III,
p. 668.
|
Presque tous les corps de métier cherchaient à se soustraire
au service du guet, et un certain nombre y était parvenu en
se prévalant de ses rapports industriels avec I’Église,
avec les chevaliers et même avec les riches hommes. Les
barilliers, le croirait-on? avaient été dispensés
de ce service parce qu’ils étaient en possession de l’insigne
honneur de confectionner les barils destinés à conserver
les liqueurs et les vins fins de la noblesse et de la haute bourgeoisie.
Les prud’hommes jurés des divers métiers jouissaient de cette
exemption à cause de leur qualité. Quoique le guet fût
une dette du séjour et de l’établissement, et quoiqu’il
dût être obligatoire pour tous les citoyens, il ne pesait
en réalité que sur les commerçants et les artisans.
Ceux-ci avaient toutefois la faculté de se faire exempter lorsqu’ils
étaient parvenus à I’âge de soixante ans ou qu’ils
pouvaient alléguer [p.13] quelque infirmité.
Les juifs étaient exclus du service du guet, ainsi que ceux dont
la profession était de nature à inspirer le dégoût
ou accusait la bassesse soit de leur rang, soit. de leur caractère
(1).
|
(1)
Registres des métiers, p. 425 et suiv.
|
Le Prévôt devait veiller au maintien de la tranquillité
publique, non seulement à Paris, mais dans toute l’étendue
de sa juridiction.
|
|
Ce magistrat était aussi chargé de l’arrestation des
personnes qui avaient commis un délit. Elle était opérée
par ses officiers, et l’exécution des jugements et arrêts
lui appartenait (2), ainsi que la publication des actes de l’autorité ayant
un intérêt général. Cette publication
s’opérait à son de trompe, par voie de proclamation
ou de cri, suivant le mot du temps, et en outre par voie d’affiche.
L’officier préposé aux publications s’appelait juré
crieur. Les procès-verbaux de ces publications étaient
inscrit sur les registres du Châtelet que l’on nommait bannières
(3).
|
(2)
Delamare, t. 1, p. 26.
(3) Ibid.,
p. 282.
|
Le Châtelet relevait de la cour du roi ou du parlement. Ce tribunal
suprême a pris naissance sous saint Louis. Il était composé
originairement de prélats, de chevaliers, et des douze pairs
de France, et formait le conseil du roi. C’est dans son sein que se
discutaient les matières d’État, ainsi que les questions
qui intéressaient le domaine, les droits du roi, et l’administration
publique. C’est de lui que sont sortis le parlement proprement dit,
la chambre des comptes, la cour des aides, le conseil des parties et
le grand conseil. Comme cour judiciaire ou parlement, il connaissait
des appels des juridictions seigneuriales, qui n’étaient point
du ressort des baillis et des sénéchaux, et des sentences
de ceux-ci comme justice royale; il exerçait, en outre, un droit
de censure sur les décisions des cours d’Église (4). [p.14]
|
(4)
Larocheflavin, Parlements de France, p. 22.
|
Au treizième siècle, le nombre des membres du parlement
n’était pas déterminé d’une manière fixe
(1). Dans
le commencement du siècle suivant, les juges du parlement étaient
appelés maîtres, et celui qui les présidait souverain
du parlement. La présidence appartenait alors à l’un
des prélats qui faisaient partie de ce corps illustre, ou au plus
ancien des maîtres. Les fonctions de greffier étaient remplies
par des officiers désignés sous le nom de notaires. Plus
tard, le premier de ces titres a prévalu (2).
|
(1)
Beugnot, Olim, t. II, p. 13.
(2)
Larocheflavin, p. 45 et 46. Ordonnances des rois de France,
17 novembre 1318, t. 1, p. 6.
|
Tant que le parlement fut mobile, c’est-à-dire qu’il suivit
le roi dans ses différentes résidences, les membres dont
il se composait, formés en assemblée, prirent le nom de
chambre du parlement. Sous Philippe le Bel, le conseil du roi fut divisé
en deux sections principales. La première reçut le nom
de conseil privé, et connut des matières d’État;
la seconde prit le nom de parlement, et fut chargée de statuer
sur les affaires judiciaires. Le parlement étant devenu sédentaire,
son institution fut régularisée et agrandie; on créa
vingt-six conseillers, tant clercs que laïques. Les légistes
furent substitués peu à peu aux prélats et aux
barons. Le chancelier Nogaret faisait l’office de garde-des-sceaux,
pendant le règne de Philippe le Bel, et fut le premier magistrat
étranger au parlement, qui le présida comme chef de la
justice de France. II partageait cet honneur avec les prélats
(3).
|
(3)
Larocheflavin, Parlements de France, p. 22 et 46, Ordonnances
des rois de Fronce, 23 mars 1302, t. I, p. 366.
|
Comme les affaires se multipliaient de plus en plus, on les distribua
en deux catégories celles qui devaient être jugées
sur plaidoiries contradictoires, et celles dont l’instruction devait
avoir lieu par écrit. On établit pour celles-ci une chambre
dite des enquêtes, dont les membres furent [p.15] chargés,
les uns de rapporter et les autres de juger les affaires (1).
|
(1)
Larocheflavin, Parlements de France, p. 22.
|
Les procès susceptibles de plaidoirie furent attribués
à la chambre primitive du parlement, qui prit dès lors
le nom de grand’chambre. Ce nom lui fut donné, tant à cause
de l’importance des affaires remises à son jugement, qu’en raison
du haut rang des personnages qui y siégeaient, selon les occasions,
tels que princes, pairs, prélats, ducs, comtes, barons, les
officiers de la couronne, le chancelier et autres (2).
|
(2)
Ibid., p. 23.
|
La chambre des enquêtes était présidée
par un évêque, et la grand’chambre par le chancelier, ou
en son absence par un prélat. Philippe le Long créa une
seconde chambre des enquêtes, ainsi qu’une chambre des requêtes.
L’élément laïque commença, sous ce prince,
à prédominer dans le parlement, et les prélats
cessèrent bientôt d’en faire partie (3).
|
(3)
Ibid. p. 22. Ordonnances des rois de France,
3 décembre 1310, t. I p. 702.
|
Le parlement ne fut dirigé par des présidents attachés
à chaque chambre, que vers le milieu du quatorzième
siècle.
Philippe de Valois [1328-1350] en créa trois ( 4).Le parlement procédait, en
assemblée générale des chambres, à la
vérification des édits, à la réception
des présidents et conseillers, au jugement des procès
criminels poursuivis contre l’un de ses membres, à celui des
mercuriales dont ceux-ci pouvaient être l’objet, à la confection
des règlements qui touchaient, soit à l’ordre judiciaire,
soit à l’ordre administratif (5).
|
(4)
Ibid., p. 46.
(5) Ibid.,
p. 40.
|
| Dans les actes publics, on ne
découvre les premières traces du ministère du
procureur général, qu’à la fin du quatorzième
siècle (1396). Cette circonstance est d’autant plus remarquable,
que le roi était représenté par un procureur attaché
à la juridiction du Châtelet dès 1321, et que cet
[p.16]
office était
même connu en 1302. Du reste, il est d’autant plus difficile d’asseoir
une opinion arrêtée sur l’origine de ces deux fonctions, qu’elles
ont été introduites par l’usage avant d’avoir été
sanctionnées par la loi (1). |
(1)
Larocheflavin, Parlements de France, p. 96. Ordonnances
des rois de France, 23 mars 1302, t. I, p. 360.
|
Pendant la vacance du siége
du prévôt, cet officier était remplacé par
le procureur général du parlement. Celui-ci n’était
appelé à ces fonctions qu’à Paris, et par exception.
Le roi étant le chef suprême de la juridiction du Châtelet,
et le prévôt n’étant en réalité que
son lieutenant ou son délégué, cette délégation
ne pouvait être remise, lors de la vacance du siége prévôtal,
qu’à un membre du parlement représentant aussi le prince
dans ses fonctions. C’est ainsi que le procureur général
fut appelé à l’office du prêvôt, quoique son
autorité fût plus élevée que la sienne (2).
|
(2)
Delamare, t. I, p. 115
|
L’autorité du parlement
ne s’étendait pas seulement sur le Châtelet, comme juridiction
inférieure, mais sur le prévôt chargé de
la police de Paris. Cette cour connaissait par appel des affaires contentieuses
de police, que le Châtelet avait jugées en première
instance, et elle réglementait, en se conformant aux édits
du roi, les matières de pure administration qui composaient les
attributions du prévôt. Ce dernier publiait les arrêts
de règlement émanés à cet égard du
parlement, et en assurait l’exécution par ses ordonnances.
|
|
Dans les cérémonies
publiques, son rang était marqué après celui des
membres du parlement (3).
L’administration générale
du royaume, en ce qui concerne la police, était placée
sous l’autorité supérieure du chancelier; c’est lui qui
présidait à la rédaction des ordonnances du roi sur
cette matière.
|
(3)
Ibid.
|
|
ANNEXE 5
Eugène Viollet-le-Duc
LA PRISON DE L’OFFICIALITÉ
DE SENS
Dictionnaire raisonné,
1856
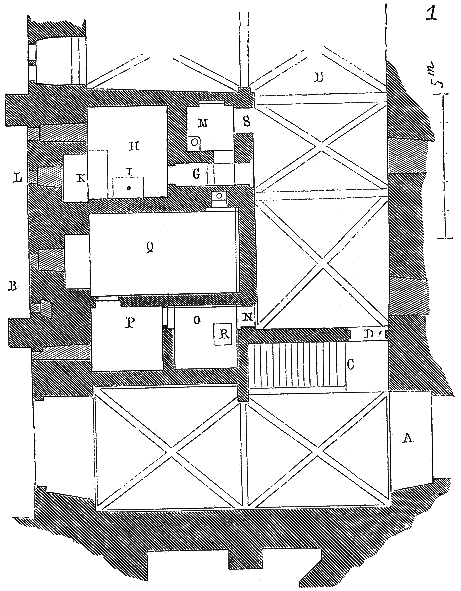 Les prisons
qui sont groupées dans le voisinage d’une salle de justice
sont celles qui présentent évidemment le plus d’intérêt
et dont la destination ne peut être mise en doute.
Les prisons
qui sont groupées dans le voisinage d’une salle de justice
sont celles qui présentent évidemment le plus d’intérêt
et dont la destination ne peut être mise en doute.
Or, il existe encore dans l’officialité
de Sens une prison complète à côté de
la salle où l’on jugeait les accusés. Cette salle est
située à rez-de-chaussée sous la grand’salle
synodale; elle est voûtée sur une rangée de colonnes
formant épine. Les prisons occupent un quart environ de l’espace,
et sont prises à l’extrémité d’une des deux nefs.
Nous en donnons (fig. 1) le plan.
L’entrée du palais archiépiscopal est en A,
la cour en B. L’escalier C conduit à la
grand’salle au premier étage. Par le guichet D, on
pénètre dans l’officialité E. Le
guichet G donne entrée dans une prison H voûtée
en berceau. En I est une dalle percée d’un orifice communiquant
à une fosse d’aisances; scellée au mur est une barre de
fer, à 0m,60 de hauteur environ, destinée à passer
la chaîne qui retenait le prisonnier assis. Une hotte de pierre
K empêche le patient de voir le ciel par la fenêtre
L, très-relevée au-dessus du sol, et ne lui
laisse qu’un jour reflété.
Mais cette prison présente
une particularité curieuse: au-dessus du guichet G,
fort bas, est un petit escalier qui conduit à une cellule
placée au-dessus du cabinet M, et qui est mise,
par une fenêtre, en communication avec la prison H.
Ainsi pouvait-on placer là, soit un surveillant, soit une personne
recueillant les moindres paroles du prisonnier. De la place occupée
par celui-ci, il était impossible de voir la fenêtre de
la cellule, à cause de la hotte qui abat le jour extérieur.
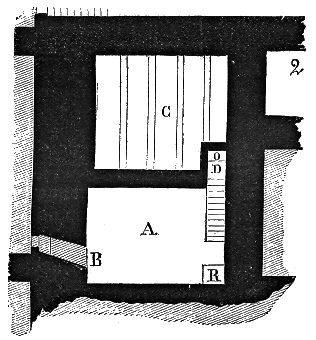 Un second
guichet N donne entrée dans trois cellules
O, P, Q; cette dernière
assez spacieuse et munie d’un siège d’aisances. La cellule
O ne paraît pas avoir été destinée
à enfermer un prisonnier; elle ne reçoit pas de jour
de l’extérieur, mais son pavé est percé d’une
trappe R donnant dans un vade in pace, ou un paradis,
comme on disait alors. En M, est un cabinet
d’aisances qui donnait directement dans la salle de l’officialité
par une porte S.
Un second
guichet N donne entrée dans trois cellules
O, P, Q; cette dernière
assez spacieuse et munie d’un siège d’aisances. La cellule
O ne paraît pas avoir été destinée
à enfermer un prisonnier; elle ne reçoit pas de jour
de l’extérieur, mais son pavé est percé d’une
trappe R donnant dans un vade in pace, ou un paradis,
comme on disait alors. En M, est un cabinet
d’aisances qui donnait directement dans la salle de l’officialité
par une porte S.
Si nous soulevons la trappe R,
nous descendons, au moyen d’une échelle ou d’une corde, dans
le cachot A (fig. 2), prenant de l’air, sinon du jour,
par une sorte de cheminée B. La fosse d’aisances
des prisons étant en C, au niveau du cachot, le prisonnier
avait un siège d’aisances relevé de plusieurs marches
en D. Nous avons encore trouvé dans ce paradis un lambris
de bois placé dans l’angle près de la cheminée
de ventilation B, pour préserver le prisonnier
de l’humidité des murs. Dans la crainte que le malheureux jeté
dans ce cul de basse-fosse ne cherchât à s’évader
en perçant les murs de la fosse, le plus épais, celui
qui donne le long de l’escalier descendant aux caves de l’officialité,
est bardé extérieurement de larges bandes de fer posées
en écharpe et retenant ainsi unies toutes les pierres.
Si ce cachot ne présente
que peu de traces du séjour des humains, il n’en est pas
ainsi pour les cellules du rez-de-chaussée, qui sont, surtout
celle H, littéralement couvertes de gravures et
de sculptures grossières datant des XIIIe, XIVe et XVe siècles.
On y voit un crucifiement, un tournoi, des inscriptions, des noms,
gravés sur l’enduit de plâtre; car ces divisions et murs
intérieurs sont en moellons enduits d’une épaisse couche
de plâtre.
Nous n’avons trouvé nulle
part un ensemble aussi complet de cachots et prisons n’ayant subi
aucune modification depuis l’époque de leur établissement.
Ces prisons ont été
bâties en même temps que l’officialité de Sens,
et datent par conséquent du milieu du XIIIe siècle.
Toutes les voûtes, celle du vade in pace comprise,
sont en berceau et construites en moellons. Seule la voûte de
la fosse d’aisances est composée d’arcs de pierre parallèles,
avec intervalles en moellons posés sur les extrados de ces
arcs.
Source: Réédition
numérique en mode texte par Wikipédia du Dictionnaire
de Viollet-le-Duc.
|
ANNEXE 6
Béroul:
Tristan et Iseult
ÉPISODE FAMEUX DE LA
FONTAINE
Notre
document nous apprend qu’il existait en 1323 à Étampes
un hôtel de la Fontaine Tristan
(la copie porte par corruption Tritan).
C’était évidemment de son enseigne que cet établissement
avait reçu son nom, lquelle enseigne illustrait une scène
alors mythique.
On donne ici le texte qui est considéré
comme la source la plus classique du roman de Tristan et Iseult, celui
de Béroul (qui est fragmentaire). Dans cet épisode, des
jaloux, à savoir un certain nain et trois barons, ont averti
le roi Marc que sa femme Iseult le trompait avec Tristan. Sur le
conseil du nain, Marc se cache dans un arbre pour surprendre les deus
amants. Mais Iseult voit son reflet dans la fontaine, et les deux
amants simulent une froideur qui induit à nouveau Marc en erreur.
On donne aussi photographie d’un cul-de-lampe
du palais de Jacques Coeur à Bourges représentant la
même scène que l’ivoire conservé au Louvre.

[lacune] Li rois qui sus en l’arbre estoit / Out l’asenblee bien
veüe / Et la raison tote entendue. / De la pitié qu’au cor
li prist, / Qu’il ne plorast ne se tenist / Por nul avoir: mout a grant
duel. / Mot het le nain de Tintaguel./
"Las, fait li rois, or ai veü /
Que li nains m’a trop deceü. / En cest arbre me fist monter. /
Il ne me pout plus ahonter. / De mon nevo me fist entendre / Mençonge
por qoi ferai pendre. / Por ce me fist metre en aïr, / De ma mollier
faire haïr. / Je l’en crus, et si fis que fous. / Li gerredons
l’en sera sous. / Se je le puis as poinz tenir, / Par feu ferai son cors
fenir. / Par moi avra plus dure fin / Que ne fist faire Costentin / A
Segoçon, qu’il escolla / Qant o sa feme le trova. / Il l’avoit
coroné a Rome / Et la servoient maint preudomme. / Il la tint
chiere et honora. / En lié mesfist, puis en plora."
 Tristran
s’en est pieça alez. / Li rois de l’arbre est devalez. / En
son cuer dit or croit sa feme / Et mescroit les barons du reigne
/ Que li faisoient chose acroire / Qu’il set bien que ce n’est pas
voire / Et qu’il a prové a mençonge. / Or ne laira qu’au
nain ne donge / O s’espee si sa merite: / Par lui n’iert mais traïson
dite. / Ne jamais jor ne mescroira/ Tristran d’Iseut, ainz lor laira
/ La chambre tot a lor voloir.
Tristran
s’en est pieça alez. / Li rois de l’arbre est devalez. / En
son cuer dit or croit sa feme / Et mescroit les barons du reigne
/ Que li faisoient chose acroire / Qu’il set bien que ce n’est pas
voire / Et qu’il a prové a mençonge. / Or ne laira qu’au
nain ne donge / O s’espee si sa merite: / Par lui n’iert mais traïson
dite. / Ne jamais jor ne mescroira/ Tristran d’Iseut, ainz lor laira
/ La chambre tot a lor voloir.
"Or puis je bien enfin savoir: / Se
feüst voir, ceste asenblee / Ne feüst pas issi finee. /
S’il s’amasent de fol’ amor, / Ci avoient asez leisor: / Bien les veïsse
entrebaisier. /
Ges ai oï si gramoier, / Or sai je bien n’en ont corage.
/ Por qoi cro je si fort outrage? / Ce poise moi, si m’en repent.
/ Mot est fous qui croit tote gent.
[...] Ele respont: "Bele
magistre, / Bien doi estre pensive et tristre. / Brengain, ne vos
vel pas mentir: / Ne sai qui hui nos vout traïr, / Mais li rois
Marc estoit en l’arbre / Ou li perrons estoit de marbre. / Je vi son
ombre a la fontaine. / Dex me fist parler primeraine. [...]
Source: Wikipédia.
|
Source du texte du rapport de Thomas de Reims ici édité:
le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007.
|


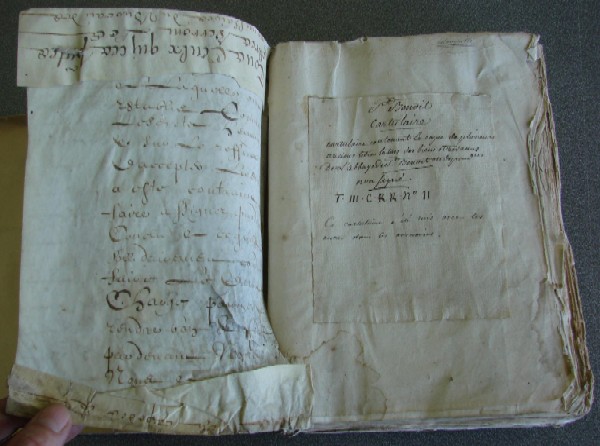 Le Moyen Age étampois est
encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici
que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation
reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire
du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à
fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs
renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes
au début du XIVe siècle.
Le Moyen Age étampois est
encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici
que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation
reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire
du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à
fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs
renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes
au début du XIVe siècle. 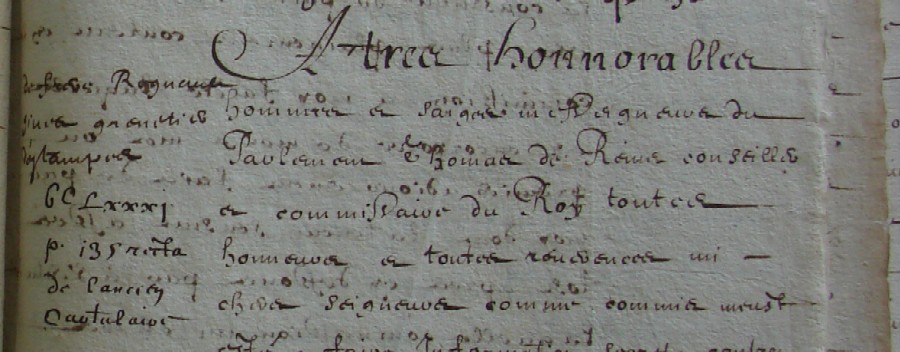

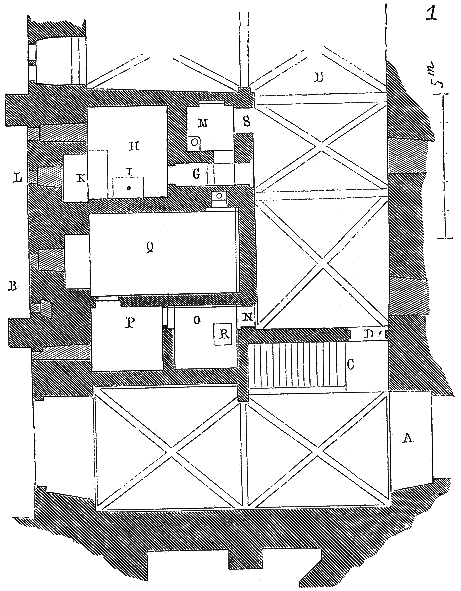 Les prisons
qui sont groupées dans le voisinage d’une salle de justice
sont celles qui présentent évidemment le plus d’intérêt
et dont la destination ne peut être mise en doute.
Les prisons
qui sont groupées dans le voisinage d’une salle de justice
sont celles qui présentent évidemment le plus d’intérêt
et dont la destination ne peut être mise en doute. 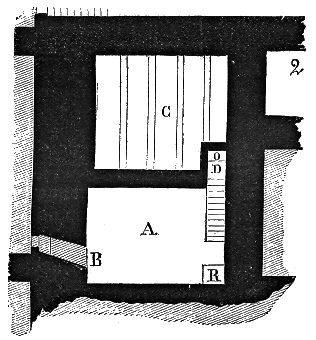 Un second
guichet N donne entrée dans trois cellules
O, P, Q; cette dernière
assez spacieuse et munie d’un siège d’aisances. La cellule
O ne paraît pas avoir été destinée
à enfermer un prisonnier; elle ne reçoit pas de jour
de l’extérieur, mais son pavé est percé d’une
trappe R donnant dans un vade in pace, ou un paradis,
comme on disait alors. En M, est un cabinet
d’aisances qui donnait directement dans la salle de l’officialité
par une porte S.
Un second
guichet N donne entrée dans trois cellules
O, P, Q; cette dernière
assez spacieuse et munie d’un siège d’aisances. La cellule
O ne paraît pas avoir été destinée
à enfermer un prisonnier; elle ne reçoit pas de jour
de l’extérieur, mais son pavé est percé d’une
trappe R donnant dans un vade in pace, ou un paradis,
comme on disait alors. En M, est un cabinet
d’aisances qui donnait directement dans la salle de l’officialité
par une porte S. 
 Tristran
s’en est pieça alez. / Li rois de l’arbre est devalez. / En
son cuer dit or croit sa feme / Et mescroit les barons du reigne
/ Que li faisoient chose acroire / Qu’il set bien que ce n’est pas
voire / Et qu’il a prové a mençonge. / Or ne laira qu’au
nain ne donge / O s’espee si sa merite: / Par lui n’iert mais traïson
dite. / Ne jamais jor ne mescroira/ Tristran d’Iseut, ainz lor laira
/ La chambre tot a lor voloir.
Tristran
s’en est pieça alez. / Li rois de l’arbre est devalez. / En
son cuer dit or croit sa feme / Et mescroit les barons du reigne
/ Que li faisoient chose acroire / Qu’il set bien que ce n’est pas
voire / Et qu’il a prové a mençonge. / Or ne laira qu’au
nain ne donge / O s’espee si sa merite: / Par lui n’iert mais traïson
dite. / Ne jamais jor ne mescroira/ Tristran d’Iseut, ainz lor laira
/ La chambre tot a lor voloir.