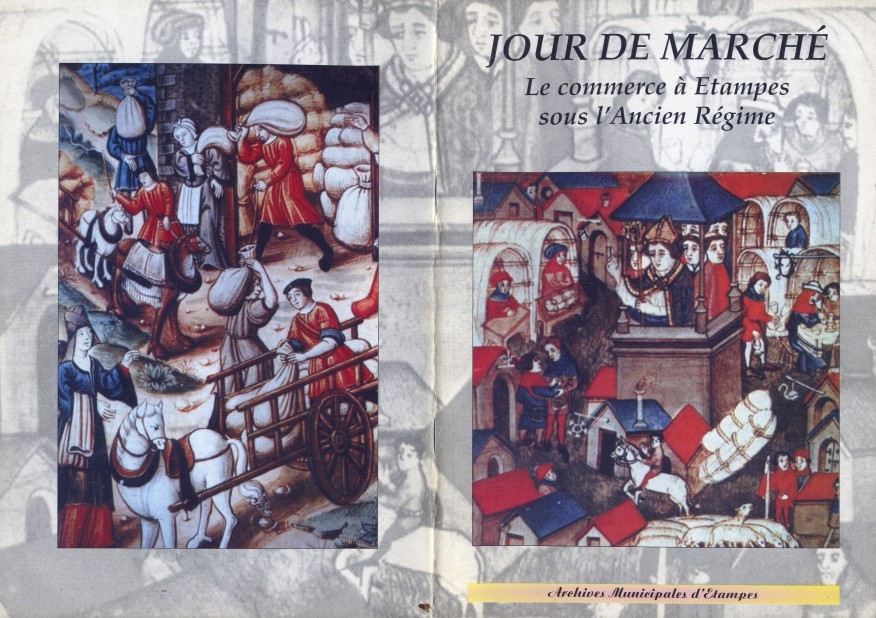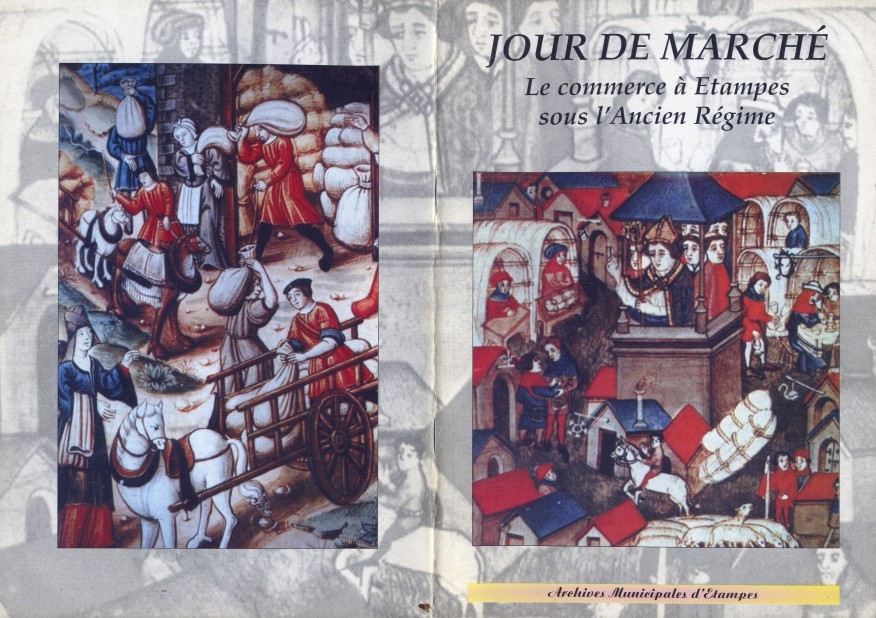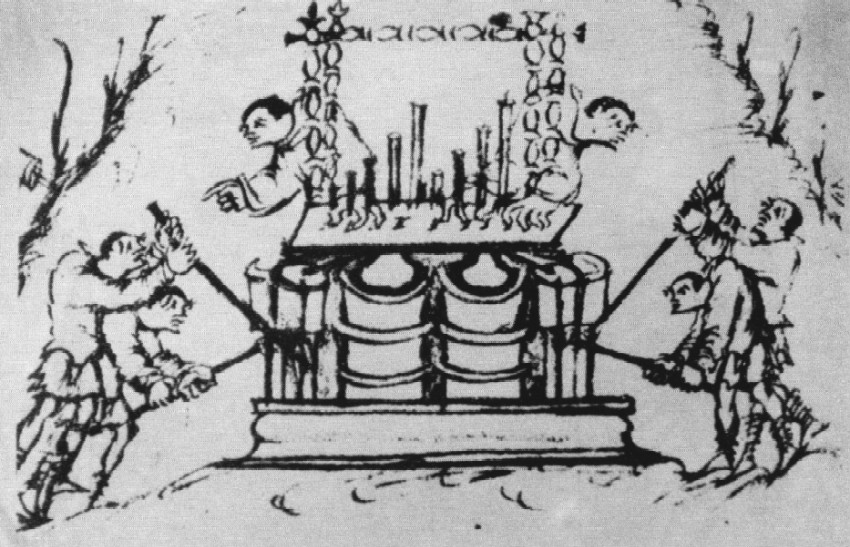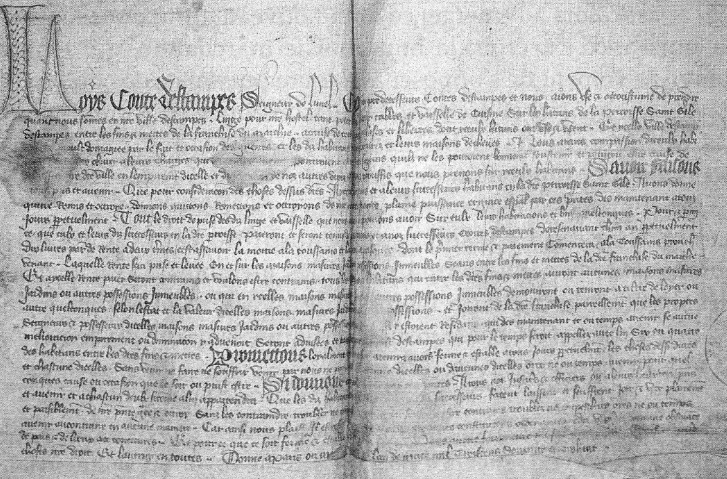|
Archives Municipales d’Étampes
JOUR DE MARCHÉ
Le commerce à Etampes sous l’Ancien Régime
par
Clément Wingler
directeur des Archives municipales
A.M.E.
4, rue Sainte-Croix 91150 ETAMPES
|
|
SOMMAIRE.
AVANT-PROPOS (p.3). — ÉTAMPES AUX XIe ET XIIe SIÈCLES: VILLÉGIATURE
ROYALE ET NÉGOCE.— Le commerce sous les premiers
rois Capétiens (p. 5). — La fondation du marché Saint-Cilles (1123)
(p. 7). — LE COMMERCE SOUS LOUIS VII: L’ÂGE D’OR DU XIIe SIÈCLE.
— La charte royale de 1137: une monnaie stable (p. 10).
— La fondation de la foire Saint-Michel (1147) (p.11).
— Corporations ou métiers: la charte royale
de 1179 (p.12). —Vin et draps (p. 14). — DE L’ESSOR À LA CRISE: XIIIe
- XIVe - XVe S. — Les nouvelles paroisses (p.17).
— La
grande boucherie de Philippe Auguste (p.17). —Le désastre
de la Guerre de Cent Ans (p.18). — Renouveau et rivalités
après la paix de 1478 (p.19). —
LE COMMERCE SOUS LA RENAISSANCE: LE DERNIER AGE
D’OR (XVIe S.). — Coutume et commerce (p.22).
— Le Port (1490-1676) (p.24).
— LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME: LE COMMERCE
AUX XVIIe ET XVIIIe s. — Le déplacement de la foire Saint-Michel
(1774) (p.27). — Le marché Notre-Dame (p.28).
— Bouchers de la campagne et bouchers de la ville (p.29).
— La construction d’une nouvelle boucherie
et l’agrandissement du marché Notre-Dame (p.32). — Commerce et ordre public: l’ordonnance de 1779 (p.33)
— NOTES (p.37
[ici en marge du texte]).
|
|
AVANT-PROPOS
Celui qui s’intéresse à l’histoire économique et commerciale
d’Etampes sous l’Ancien Régime, cherchera en vain l’ouvrage susceptible
de lui en présenter une synthèse.
Seules quelques études partielles,
mais souvent de valeur, écrites par des érudits locaux à
la charnière de ce siècle et du précédent, lui
permettront de lever un coin du voile.
Pourtant, comment parvenir à comprendre
le passé de cette ville, sans prendre conscience que parmi les facteurs
divers qui ont concouru à façonner son identité urbaine
jusqu’à la Révolution, voire au-delà, l’élément
commercial a joué un rôle prépondérant dès
le Moyen-Age, jusqu’à donner naissance à tout un quartier:
celui de la place Saint-Gilles. C’est à l’agriculture et au commerce
que la ville doit ses deux âges d’or du XIIème siècle
et de la Renaissance. A la première période correspond la diffusion
d’une monnaie royale frappée à Etampes et la fondation d’importants
centres d’échanges qui existent encore de nos jours: le marché
Saint-Gilles et la foire Saint-Michel; à la seconde époque
se rattache le souvenir du Port, d’où partaient des bateaux chargés
de blé destinés à approvisionner la capitale.
Le présent livret n’entend pas combler
la lacune précitée: il ne contient pas un historique du commerce
à Etampes. Son ambition est moindre: il se propose de décrire
et de replacer dans le contexte de l’époque, quelques uns des principaux
dossiers et documents conservés dans les services publics d’archives.
Le lecteur constatera que certaines périodes,
notamment le Moyen- Age, ou certains aspects de la question, par exemple
le commerce de la boucherie, ont bénéficié d’un traitement
privilégié. Il ne s’agit pas là d’une démarche
arbitraire, mais du résultat de l’existence ou de la disponibilité,
dans le premier cas, de pièces de première importance, et,
dans le second cas, de sources particulièrement abondantes. La période
moderne n’a été traitée que très superficiellement,
faute de temps. Elle fera l’objet d’une étude qui paraîtra
ultérieurement.
À ÉTAMPES,
avril 1997
Clément WINGLER [p.4]
|
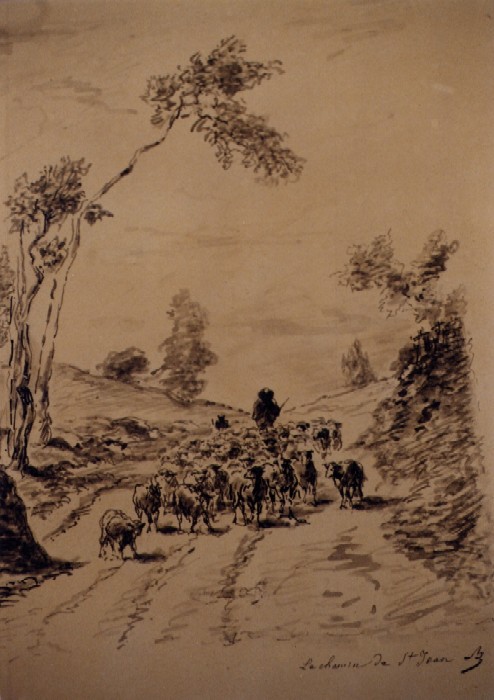
Illustration: Troupeau de
moutons sur le chemin Saint-Jean, allant à la plaine de Guinette.
Par Narcisse Berchère, s.d., Musée d’Étampes).
[p.5]
|
|
|
ETAMPES AUX Xe ET XIe SIÈCLES:
VILLÉGIATURE ROYALE ET NÉGOCE
Faute de sources manuscrites antérieures au Xlème siecle,
il apparaît illusoire de chercher à savoir quelle a pu être
la vie économique et commerciale de la première ville d’Etampes
détruite en 911 par les envahisseurs normands.
Seule nous est connue la situation géographique
favorable qui est celle de la cité depuis la période gallo
romaine, au cœur d’un terroir riche, arrosé de rivières, propice
à la culture des céréales et de la vigne, en bordure
de l’importante voie qui traverse la région du nord au sud, reliant
Paris â Orléans.
|
|
LE
COMMERCE SOUS LES PREMIERS ROIS CAPÉTIENS
A partir de 987, Etampes connaît le
gouvernement direct des premiers rois Capétiens qui font de la ville
leur lieu de résidence favori. Robert II le Pieux (roi de 996 à
1031) fonde les églises Saint-Basile et Notre-Dame, et la reine Constance
fait ériger un Palais du Séjour aux jardins semble-t-il magnifiques,
arrosés par la Louette et la Chalouette détournées
de leur cours naturel.
La maîtrise de l’eau en tant que force
motrice permet de développer des industries nouvelles, d’établir
des moulins destinés à recevoir les grains et à permettre
notamment le tissage des draps. Leur existence est avérée
par un diplôme (1) de Henri 1er.
Vignes et blés constituent les principales
ressources de la ville. Les greniers et celliers royaux font partie intégrante
de l’ensemble de bâtiments que constitue le Palais du Séjour.
Selon dom Basile Fleureau (2), “le palais
(est) composé de plusieurs corps d’Hôtel sous lesquels il y
(a) caves et au dessus greniers qui servent à retirer vins et blés
que l’on recueille dans les vignes et sur les terres du roi, avec ceux
qui proviennent de ses moulins et autres rentes et droits qui lui (appartiennent).”
Au Xlème siècle la ville se
compose de deux entités distinctes éloignées de plus
d’un kilomètre: Stampae veteres (Etampes-les-Vieilles), la ville
primitive et ouverte qui se confond aujourd’hui avec le noyau ancien du
quartier Saint-Martin, et Stampae castrum ou Stampae novae (Etampes le Châtel),
ville nouvelle sans doute protégée par des fortifications,
édifiée de par la volonté royale à l’ombre du
Palais du Séjour et des églises Notre-Dame et Saint-Basile
(3). [p.6]
Afin de favoriser la prospérité
de leur ville préférée, les premiers rois Capétiens
s’efforcent tout au long du XIème siècle, de rapprocher ces
deux entités urbaines, d’établir une continuité territoriale
entre elles. Le facteur commercial est le moyen privilégié
et déterminant retenu pour y parvenir. Trois documents de première
importance en font foi.
Datés de 1046, 1085 et 1123, ils montrent
une progression régulière dans la mise en œuvre de la politique
royale, même s’il faut se garder de voir dans chacun de ces actes
de gouvernement, la mise en application par étapes d’une politique
dûment planifiée sur le long terme. Néanmoins, le but
premier poursuivi rapprocher les deux entités pour garantir l’essor
d’Etampes et l’épanouissement du domaine royal, est toujours perceptible,
et les moyens employés pour y parvenir incitations économiques,
commerciales et fiscales, toujours identifiables.
Outre le développement de la ville,
un objectif second des rois de France apparaît peut être vers
la même époque, même s’il n’est pas encore clairement
exprimé. Né de l’observation de la nature et de l’extension
géographique des échanges favorisés par la mise en
œuvre de cette politique propice au commerce, il vise à transformer
Etampes, cité directement administrée et donc contrôlée
par le pouvoir Capétien, en un entrepôt vaste et sûr
pour l’approvisionnement de Paris.
Le premier des trois documents qui porte témoignage
de la politique royale est une confirmation de 1046 (4), dans laquelle Henri
1er cède plusieurs terres et droits aux chanoines qu’il vient d’installer
à Notre- Dame. Ceux-ci obtiennent entre autres, la dîme des
cultures royales au dessus d’Etampes-les-Vieilles, des terres non encore
défrichées dans l’espace qui sépare les deux entités
urbaines, un moulin, et un arpent et demi de vignes sous le Castrum. Les
bénéficiaires reçoivent également l’assurance
qu’ils seront préservés de tous actes de violence et abus de
pouvoir des officiers royaux ou des seigneurs des environs. Le roi veut ainsi
“encourager
les défrichements, favoriser la production agricole, par la suite et
pour cela, attirer snr ses domaines hôtes, colliberts, serfs, en les
rassemblant sous la protection et la bienveillance ecclésiastique,
en les entourant des garanties que la paix offre au travail” (5).
Dans le même esprit, Philippe 1er donne
en 1085 à la Maison-Dieu d’Etampes-les-Vieilles, une terre d’un
arpent située près d’un pont sur la Louette, et affranchit
les hôtes qui y sont installés, du paiement de toute imposition
ou taille due aux officiers royaux. Ces derniers ne pourront par ailleurs
exercer aucune brutalité à leur encontre. Le roi ajoute que
les hôtes qui le souhaitent, auront la possibilité de “venir
acheter ou vendre à son marché” et que dans ce cas, “on
ne leur demandera rien de plus que la légitime coutume du marché”,
c’est-à-dire aucune taxe supérieure à la somme fixée
par la coutume pour l’achat et la vente de denrées. En outre, “ils
ne seront pas obligés de faire crédit” (6). [p.7]
La volonté royale de provoquer par
des avantages fiscaux, l’installation de nouveaux habitants sur le no man’s
land qui s’étend entre les deux entités urbaines, est tout
à fait discernable.
Au-delà de son intérêt
premier, cette charte démontre l’existence d’un marché à
Etampes vers la fin du XIème siècle. En quel endroit se trouve-t-il?
Compte tenu du fait que les hôtes nouvellement établis “viendront”
au marché, on peut émettre l’hypothèse qu’il se tient
à l’intérieur de l’enceinte fortifiée d’Etampes-le-Châtel,
où la sécurité des marchands et des acheteurs peut
être garantie (7).
|
(1) “Molendinum nostrum in suburbio”.
On peut en partie identifier ces moulins comme étant ceux de Bierville
et de Saclas, de Notre-Dame, Branleux, et peut-être de Chauffour,
in: Cartulaire général de Paris, n°163:
diplôme de Henri Ier de 1046/LASTEYRIE. - Paris, 1906. p. 187 [légère
erreur de référence].
(2) Les Antiquitez de la ville et du duché
d’Estampes / dom Basile FLEUREAU. - Paris, 1683. p.26.
(3) Voir op. cit. (1), p.23.
(4) Voir op. cit. (2), p.23 et suiv.
(5) Les Institutions royales au pays d’Etampes
/ PauI DUPIEUX. - Versailles, 1931. p.7.
(6) Recueil des actes de Philippe Ier n°CXIV
/ Maurice PROU. – Paris, 1896. p.287.
(7) Dom Basile FLEUREAU, op. cit. (2), p.95.
Essais sur Étampes: t.II / Maxime de MONTROND. - Paris, 1836,
p.210.
|
LA
FONDATION DU MARCHÉ SAINT-GILLES (1123)
Une nouvelle étape est franchie en
1123 avec la naissance d’un marché neuf entre Stampae veteres et
le castrum. La charte de Louis VI qui l’institue, est d’une valeur capitale
pour l’histoire d’Etampes. Elle marque en fait la création de par
l’autorité royale, d’une ville nouvelle à vocation commerciale
au lieu-dit Saint-Gilles, intermédiaire entre les deux ensembles
urbains plus anciens. Le détail de cette charte est bien connu.
Une copie de 1594 en est conservée aux Archives communales (8).
Pour attirer des hôtes à Saint-Gilles
et animer le marché, Louis VI n’octroie pas uniquement des privilèges
commerciaux aux nouveaux habitants, du type de ceux habituellement donnés
aux marchands forains, mais des droits plus étendus comparables à
ceux consentis aux villes de franchise ou villes neuves.
Non seulement les marchands “qui amèneront
des provisions, blé, vin ou autres denrées, ou qui s’en retourneront”,
auront la garantie perpétuelle de sauf-conduit (“il ne pourra
leur être pris aucune chose sauf en cas de malversation au marché
même”), mais encore ceux qui choisiront de s’établir à
Saint-Gilles bénéficieront d’avantages d’une durée
tout d’abord limitée à dix ans par la charte de 1123, puis
rendus de fait et pour partie continuels, par des confirmations ultérieures
(9).
Les avantages qui leur sont accordés
sont d’ordre financier, commercial, judiciaire et militaire. Les nouveaux
habitants bénéficient d’une “masura” (maison avec terrain) protégée
contre les contestations d’un tiers, et sont exemptés de toute taille
(impôt direct au profit du pou voir royal). Ils ne doivent payer
le droit de minage (imposition royale sur le mesurage des grains) que le
jeudi, jour du marché. Le droit de marché est lui-même
abaissé de 60 sols à 5 sols 4 deniers. Les hôtes sont
également exemptés de la chevauchée et du service
d’ost, des expéditions et assemblées de gens d’armes, en
d’autres termes, du service militaire. En matière judiciaire, ils
obtiennent le privilège de ne pas relever de la compétence
du prévôt, mais sont justiciables du roi seul. Ils n’ont pas
à payer d’amende pour une citation en justice mal fondée,
peuvent refuser de prêter un serment quelconque sans avoir à
le racheter, et les amendes qui pourraient leur être appliquées
pour forfaits, se verraient réduites de 7 sols et demi à 16
deniers. [p.8]
“Le quartier Saint-Gilles est donc un territoire
de franchise soumis un régime particulier” (10).
Ses hôtes sont néanmoins soumis
à une obligation non négligeable fournir au roi lors de ses
séjours, tout le linge et les ustensiles de table et de cuisine qu’il
estimera nécessaire à sa cour. En revanche, contrairement
à l’usage en vigueur dans la plupart des grandes villes, le droit royal
d’hébergement gratuit qui est exigible aux habitants trois fois l’an,
est sans objet à Etampes, dans la mesure où le souverain y
dis pose de son propre palais.
L’utilisation fréquente du Palais du
Séjour est attestée par l’existence de nombreux actes officiels
dressés à Etampes. Louis VII y réside pendant au moins
dix longues périodes entre 1106 et 1131 (11), confirmant le rôle
de la cité comme lieu de villégiature royale. Mais Etampes
n’a pas uniquement la fonction d’un site de plaisance capétienne.
Sa situation géographique en fait une place commerciale de premier
ordre pour fournir à Paris les grains et le vin nécessaires
à sa subsistance, et une base militaire dans la lutte que mène
Louis VI contre les grands féodaux du domaine royal, notamment les
seigneurs du Puiset et de Montlhéry, qui tentent de s’affranchir
de l’autorité de la couronne. [p.9] |
(8) Inventaire analytique des
titres concernant la franchise du marché Saint-Gilles de 1123 à
1633, s.d. (XVIII s.), Archives municipales d’Etampes, cote AA8. Dom
ELEUREAU, op. cit. (2), donne le texte de la charte en latin, p.95
et 96. Une transcription de la charte en Français moderne est également
disponible: Actes constitutifs de la ville d’Etampes XIle-XVIe s.
Clément WINGLER. - Etampes: A.M.E., 1992, 19 p.
(9) Confirmation d’Henri III en mars 1575, puis
par sentences du bailliage en août 1576 et en juillet 1612.
(10) Une ville-marché au XIle s. Etampes
/ Maurice PROU. - Paris, 1926, p.2. Arch. Dép.
de l’Essonne, cote Gbr 2286.
(11) En 1106, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1119,
1121, 1123, 1131. Les autres années de présence, probables,
ne sont pas connues.
|
|
|
|
LE COMMERCE SOUS LOUIS VII: L’ÂGE D’OR DUXIIe s.

Le Changeur
|

Denier royal frappé à Étampes vers 1200
(Musée national de la Monnaie, Paris) [p.10]
|
Pendant son long règne (1137 à 1180), Louis VII effectue de
nombreux séjours à Etampes s vingt-deux sont connus pour la
période 1142-1179. Poursuivant la politique de son père, il
montre un intérêt certain pour le développement économique
et commercial de la ville, qu’il encourage par plusieurs actes officiels,
particulière ment la charte de 1137 sur la monnaie, celle de 1147
qui institue la foire Saint-Michel, et celle de 1179 sur le commerce et
les métiers.
|
|
LA CHARTE
ROYALE DE 1137:
UNE MONNAIRE D’ÉTAMPES STABLE
Selon Léon Marquis (12), le droit de
battre monnaie semble avoir été mis en pratique à
Etampes dès l’époque mérovingienne, soit avant même
que la ville ne devienne une cité directement administrée par
le pouvoir royal. L’auteur des “Rues d’Étampes” évoque
l’existence d’un triens mérovingien en or fin, frappé au Vlème
ou au VIlème siècle, portant la mention “DRUCTOMARUS STAMPAS
FITURC”. Un autre triens, marqué de l’inscription “STAMBIS
GRATIA DEI REX” aurait lui aussi été produit par un atelier
étampois, peut-être sous le règne de Charles-le-Simple
(893-922).
Bien plus, à en croire Louis-Eugène
Lefebvre (13), la présence d’un atelier de frappe monétaire
pourrait expliquer l’origine étymologique du nom de la ville, “stampa”
étant le nom germanique d’“atelier”, et “stampfen”,
l’expression consacrée dans la même langue, pour désigner
le fait de battre monnaie.
La frappe de deniers d’argent sous les premiers
Capétiens est certaine. Plusieurs pièces du XIIème
siècle provenant de l’atelier royal d’Etampes sont exposées
au Musée national de la monnaie à Paris.
Dans ses “Antiquités d’Estampes”
parues en 1683, dom Basile Fleureau décrit des pièces produites
sous Louis VI et Louis VII “sur quelqu’unes desquelles est le portrait
du roy avec ces paroles au tour en lettres gotiques (sic), Lodovicus Rex
Francorum; et sur le revers, une montagne avec un château dessus et
ces paroles Castello Stempis” (14).
Au XIIème siècle, le droit de
battre monnaie n’est plus un privilège royal. Ainsi que le souligne
Jean Favier (15), “il est usurpé par des ateliers seigneuriaux
(laïcs ou ecclésiastiques) avec toutes les conséquences
d’une dissolution du pouvoir public, et notamment la multiplication d’espèces
[p.11] à bas titre qui font disparaître les monnaies jugées
les meilleures sur le marché.” De plus, la croissance de la masse
de métal d’argent disponible pour la confection de pièces
est insuffisante pour répondre aux besoins financiers nés du
développement des échanges. “Les ressources procurées
par l’exploitation des gisements argentifères vont déclinant”, ce qui provoque une pénurie
de métal, source d’inflation, et accentue la dégradation
des pièces en circulation, dont la qualité de métal
précieux est rognée. Les bonnes pièces sont désormais
thésaurisées, “la mauvaise monnaie chasse
la bonne”.
Afin de garantir le prestige et la qualité
de la monnaie royale frappée à l’atelier d’Etampes, et par
voie de conséquence, l’intégrité des transactions commerciales
et financières dont la ville est le théâtre, Louis VII
décide dès son accession au trône en 1137, de donner
une charte aux bourgeois de la cité, dans laquelle il leur promet,
sa vie durant, de ne pas altérer la monnaie “dont ils usaient et
qui avoit cours parmy eux, tant en son poids qu’en sa valeur; à condition
qu’ils luy païeroient tous les trois ans cent livres de la mesme monnaie.
Si, sur les plaintes qui luy en seraient faites, il se trouvait qu’elle
eût été altérée, il punirait selon (l’avis
des dits bourgeois) tout falsificateur qui aurait commis le crime”.
(16)
|
(12) Les rues d’Etampes et ses monuments
/ Léon MARQUIS. - Etampes, 1881. p.60.
(13) Etampes et ses monuments aux XIe XIIe siècles
/ L.-E. LEFEBVRE. - Paris, 1907, p.47 et suiv.
(14) FLEUREAU, op. cit. (2), p.102-103.
(15) Dictionnaire de la France médiévale
/ Jean FAVIER. Paris, 1993, p. 65 et suiv.
(16) Dom Basile FLEUREAU, op. cit., p.102-103.
|
LA FONDATION
DE LA FOIRE SAINT-MICHEL
Par rapport au marché qui se tient
habituellement chaque semaine et qui n’intéresse que le public de
la ville et de ses environs, la foire connaît généralement
une périodicité annuelle et rayonne sur une clientèle
et une aire d’approvisionnement plus vastes.
Les grandes foires des XIIème et XIIIème
siècles sont tout autant des lieux de rencontres et d’échanges
des produits de commerce national, voire international, que des places financières
de premier ordre.
Sous Louis VI, la plus importante foire de
la région est celle de Morigny. Annuelle, elle dure huit jours, depuis
le samedi après l’Ascension, jusqu’à la veille de la Pentecôte.
Les religieux de l’abbaye de Morigny, qui jouissent de la faveur du roi,
y perçoivent de nombreux droits, péage, minage (droit prélevé
sur les grains vendus)..., et exercent la haute justice.
En mai 1147, la ville d’Etampes obtient à son tour le privilège
royal d’organiser une foire annuelle.
Louis VII, qui vient de répondre favorablement
à l’appel à la Croisade lancé par le pape Eugène
III et Bernard de Clairvaux, “se mettoit en équipage…, … enrôlait
des soldats, et assembla à Etampes son parlement”. (17) Sensible
au sort des lépreux soignés dans la cité par la maladrerie
Saint-Lazare établie sur la route de Paris, il lui accorde plusieurs
privilèges s des terres à Boissy, le droit de prendre deux
muids (mesures) de blé dans son grenier et dix muids de vin dans sa
cave tous les ans au jour de la Saint-Rémy (15 janvier), et surtout,
le droit de foire le jour de la Saint-Michel (29 septembre). [p.12]
Cette foire se tiendra chaque année
dans les “Sablons” (terrains sablonneux) au lieu-dit Saint-Michel,
depuis la veille de la dite fête, à soleil couchant, jusqu’à
la fin de la semaine suivante.
“C’est pour l‘administrateur de la léproserie,
rattachée à l‘ordre hospitalier de Saint-Lazare-de-Jérusalem,
une occasion de se substituer de plein droit aux officiers royaux dans la
perception (de tous les droits de marché qui pouvaient appartenir
au roi). Tous les revenus de la foire sont adjugés au plus offrant,
à charge de payer le fermage dans les huit jours du contrat de bail.
Les enchères sont préalablement annoncées dans les églises,
au prône dominical. Elles ont lieu en présence et sous la
direction des officiers du bailliage, qui ont en dernier ressort le choix
de l’adjudicataire” (18).
Pendant les huit jours que dure la foire,
la maladrerie jouit par ailleurs de l’exercice de toute justice, moyenne
et basse, en titre de prévôté, à l’exception
de la haute justice, que le roi réserve à ses officiers. Tous
ceux qui viennent à la foire bénéficient en outre “tant
en venant qu’en retournant, sauve-garde, sans qu’ils puissent être
arrêtés pour crimes” (19).
La richesse de la maladrerie augmente rapidement
au XIIème siècle, par les dons de nombreux seigneurs et bourgeois
qui suivent l’exemple du roi de France.
A la fin du siècle, elle entre en possession
d’un moulin à Etampes-les-Vieilles, de vignes, de terres labourables
à Mérobert et Bouville. Après le roi, le plus illustre
bienfaiteur de la maladrerie est Thibault, comte de Blois, qui fait livrer
chaque année aux lépreux d’Etampes, dix muids de son vin de
Chartres (charte de 1183).
|
(17) Op. cit. (16), p.105-l06.
(18) Op. cit. (5), p.141. [p.38]
(19) Op. cit. (5), p. 454. Voir également
Compte des recettes et dépenses de la maladrerie:
1552- 1556 / Charles FORTEAU, in: Annales du Gâtinais,
1903. p.25; et: Archives Nationales: Compte de la maladrerie, cote
R4 941, fol.48.
|
CORPORATIONS
OU MÉTIERS:
LA CHARTE ROYALE DE 1179
Après avoir pris des mesures en faveur
de la stabilité monétaire (charte de 1137) et du grand commerce
forain (1147), Louis VII montre sa volonté d’encourager l’artisanat
et les industries locales. En fait foi l’importante charte donnée
aux bourgeois de la ville en 1179.
Ce règlement de police de 29 articles
édicté, selon l’aveu même du roi, pour faire cesser
les abus provoqués par la négligence de ses officiers pendant
son règne, est de première valeur pour l’historien. Il permet
en effet de connaître quelques uns des métiers alors pratiqués
à Etampes, et d’approcher le statut personnel et professionnel de
plusieurs catégories de population (20).
Au XIIème siècle, la majeure
partie des habitants d’Etampes sont des hommes libres qui disposent à
ce titre de libertés civiles, commerciales et industrielles. Bien
qu’en régression constante, le servage subsiste sur certaines parties
du domaine royal.
Dans son article 1, la charte de 1179 affranchit
de cette servitude, des paysans établis sur une portion du terroir
de la ville appelé “Octave”, lieu-dit aujourd’hui impossible à
situer. En contrepartie, les anciens serfs doivent payer au roi les droits
seigneuriaux dûs par tout roturier travaillant la terre. [p.13]
Un tel affranchissement collectif est pratique
courante, “le seigneur n‘ayant aucun intérêt à décourager
ses serfs dans le contexte économique des grands défrichements,
préférant réduire ses exigences pour ne pas multiplier
les tentatives de déguerpissement” (21), alors que de nombreux bras sont nécessaires pour
faire reculer la forêt et exploiter les terres ainsi gagnées.
“Les incapacités du serf se réduisent donc
avec le temps, se muant souvent en autant de taxes...” Précisons que “le serf du
XIIème siècle n’a rien d’un esclave: il a droit à une
famille et il jouit de ses biens, mais ne peut quitter sa terre, qu’on ne
peut en revanche lui enlever sans cause valable. Cependant, il ne peut disposer
à sa guise de ses biens, dont le seigneur, ici le roi, est seul héritier” (21).
Quant aux hommes libres, la charte de 1179
accorde des privilèges à plusieurs catégories d’artisans
regroupés en corporations, également appelées “métiers”.
A Etampes comme dans la plupart des villes
de France, s’organisent au XIIème siècle des communautés
d’artisans ayant une même activité, aux fins de défendre
les intérêts du groupe et de garantir à chaque membre
la protection et la solidarité de ses confrères.
Dans ses articles 2 à 4, la charte
protège la vente directe du producteur local au consommateur, en
interdisant aux épiciers-grossistes (“régrattiers”) de revendre du pain, du vin et du
poisson frais.
Les abus des officiers royaux sont réprimés:
le prévôt (ici, collecteur des revenus domaniaux) se voit interdire
d’exiger des marchands, une commission en poisson d’eau douce ou salée.
Ainsi que le précise l’article 16 “s’il en veut, d’en acheter
comme les autres.”
De nombreux droits perçus en nature
ou en espèces par le roi, sont réduits: pour l’étalonnage
des mesures de vin, le prévôt ne pourra plus percevoir qu’un
septier (six ou huit pintes) de vin rouge (art.14). Le droit de pressurage
est limité à un demi septier de vin (art.18), la redevance
de chaque cierger (fabriquant de cierges), est réglée à
dix livres de cire par an (art.20), celle d’un vendeur d’arcs, à
un arc par an (art.21). Celui qui vend des fruits jusqu’à la valeur
de quatre deniers, est exempté du droit de place, (art.22), de même
que ceux qui vendent du lin ou du chanvre au marché (art.26).
D’autres chartes de franchises ou de privilèges
complètent celle de 1179 elles concernent la corporation des bouchers
qui obtient en 1155 l’annulation d’un abus par lequel les officiers du roi
ne payaient que les deux tiers du prix courant, la communauté des
tessiers (tisserands, 1204), celle des chaussetiers (1280), et la corporation
des tanneurs (1298).
Outre leur intérêt propre, ces
chartes permettent de mieux appréhender l’importance de certaines
activités artisanales et industrielles production viticole, métiers
du textile et des peaux, meuniers, boucherie et boulangerie. [p.14]
|
(20) L’original est conservé
aux Archives Nat. [Il a en fait été
retrouvé récemment par Frédéric Gatineau aux
Archives Départementales de l’Essonne (B.G., 2007)]: cartulaire
de Notre-Dame d’Etampes, cote F°58V°. Reproduction en latin et
commentaire chez Dom Basile FLEUREAU, op. cit. (2), p.113-119. Traduction
chez GUIZOT: Histoire de la civilisation française, t.IV,
p.3
(21) Jean FAVIER, op. cit. (15), p.879.
|
Le commerce du vin d’Etampes, essentiellement
destiné à une consommation locale, semble avoir été
florissant au XIIème siècle.
La libre vente du vin est autorisée
depuis 1137, sauf en temps de ban royal, lorsque le roi vend sa propre production
(22). Ses greniers et celliers se trouvent dans les bâtiments rattachés
au Palais du Séjour. Les comptes de Philippe Auguste, conservés
aux Archives Nationales, laissent apparaître la dépense liée
à l’achat de vin d’Etampes par le roi et sa cour (23).
Particulièrement attentif au sort des
vignerons, Charles VII leur accorde à plusieurs reprises des privilèges.
Ainsi que le rapporte par exemple B. Fleureau (24), “en vue du soulagement
de l’âme
de son père (Charles VII) décide l’exemption de payer un
septier de vin au prévôt, et autant à son lieutenant
et à ses serviteurs, qu’ils avaient coutume de prendre de chaque
bourgeois qui vendait son à vin à pot.”
L’industrie drapière et la tannerie
sont de même largement représentées, surtout au faubourg
Saint-Pierre où un faisceau de petite rivières fournit l’eau
nécessaire.
Philippe Auguste passe en 1204 un contrat
avec les tisserands en drap ou en toile. Ils sont désormais exemptés
de toutes coutumes, tailles et autres levées, même au moment
de leur entrée dans le métier, mais ils demeurent assujettis
au droit d’étalonnage et au service militaire (25).
A en croire Fleureau, le but du roi, “sachant
que la Beauce est plus propre que d’autres provinces à la nourriture
des bêtes à laine (est) de donner la commodité aux
habitants d’Étampes de faire un grand commerce de draperies”.
Dans ce contrat de 1204 apparaissent pour
la première fois des prud’hommes (“probi ministeriales”)
au nombre de quatre, élus parmi leurs pairs au sein de la corporation,
pour la représenter et rendre la justice dans les affaires concernant
le métier. [p.15]
|
(22) Basile FLEUREAU,
op. cit. (2), p. 26 et 103.
(23) En 1189, “de X modus vini pro expensa auberti
qui ivit vendere blados Stampis XXV s.”, In: les Institutions monarchiques,
t.1 et t.2 / LUCHAIRE, Paris, 1900. p. 95-96 et p.136-137
(24) En 1137. Voir B. FLEUREAU, op. cit.,
p.103.
(25) Op. cit. (24), p.132.
|

La vigne: Coupe des grappes et Pressoir (gravures du XIIIe siècle,
BNF)
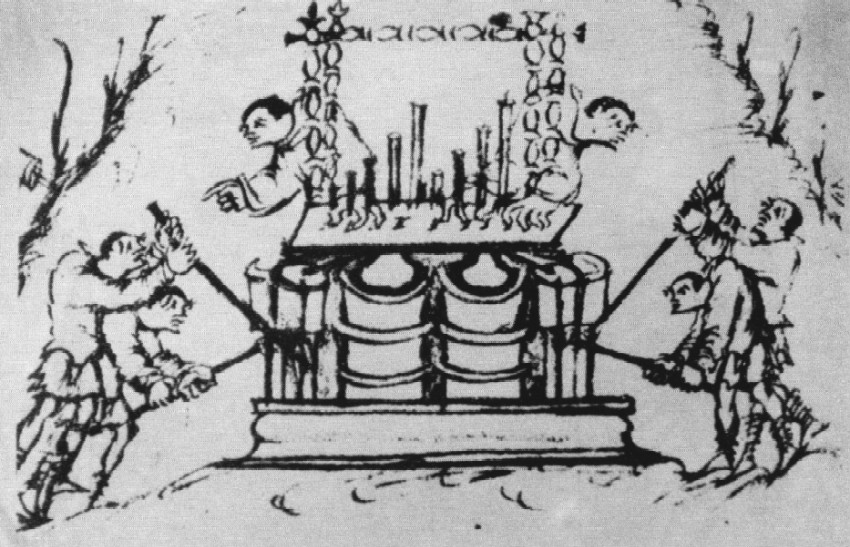
[p.16]
|

La misère. Miniature attribuée à Jean Bourdichon
(vers 1490).
(Bibliothèque de l’École des Beaux-Arts, Paris)
[p.17]
|

Éventaire de marché devant l’Hôtel dit d’Anne de
Pisseleu. Par Narcisse Berchère, s.d. (Collection: Musée
d’Étampes) [p.22] |
DE L’ESSOR À LA
CRISE: XIIIe-XIVe s. - XVe s.
Le développement économique et commercial de la ville entraîne
un accroissement de la population et l’urbanisation de terres jusqu’alors
non ou peu habitées.
|
|
Cet essor rend nécessaire au XIlIème
siècle, la création de nouvelles paroisses. Jusqu’alors, Etampes
en comptait trois: Saint-Martin (Etampes-les-Vieilles), Notre-Dame et Saint-Pierre
(Etampes-le-Châtel). Au début de 1227, Saint-Basile devient
la quatrième paroisse et, en 1250, le quartier Saint-Gilles né
de la fondation du marché quelques cent vingt ans plus tôt,
peut recenser suffisamment d’habitants pour être érigé
à son tour en paroisse.
La nouvelle paroisse Saint-Basile compte deux
églises, celle qui porte son nom, et la collégiale Sainte-Croix
aujourd’hui disparue. Cette dernière a été construite
dès 1183 sur l’emplacement d’une importante synagogue laissée
à l’abandon suite au départ des Juifs l’année précédente.
La présence d’une importante communauté juive au XIIème
siècle, qui a sans doute contribué au développement
des transactions commerciales et financières, est attestée
par la charte donnée par Louis VII en 1179 (26).
|
(26) Elle mentionne des “juifs royaux”
et un “prévôt des Juifs”. Réf., voir note (20).
|
LA
GRANDE BOUCHERIE DE PHILIPPE AUGUSTE
S’inspirant de la codification en vigueur
à Paris, Philippe Auguste réglemente et réorganise
en 1186 le commerce de la boucherie à Etampes. Le texte du diplôme
royal est malheureusement mal connu. Nous savons qu’avant cette date, une
boucherie était établie dans chaque quartier de la ville:
Saint-Martin, Saint-Gilles, Saint-Pierre et Notre-Dame,
Celle de Notre-Dame, sans doute la plus importante,
appartenait à un certain Hugues Nascard, et comportait plusieurs
étaux confiés à des tenanciers différents.
Au moment de sa réforme, Philippe Auguste
rachète à Nascard sa boucherie au prix de cent sols parisis
de rente perpétuelle (27), et fait construire de nouvelles halles,
approximativement situées à l’emplacement de l’actuelle place
de l’Ancienne Comédie. L’aspect de l’édifice n’est pas connu,
mais la présence, au-dessus des étaux, d’un local faisant
office de salle des plaids (tribunal civil) est certaine. [p.18]
L’accès au métier de boucher,
et son exercice, sont sévèrement réglementés.
Nul ne peut tuer un animal ou débiter
de la viande s’il ne fait pas partie de la corporation. Pour y entrer, il
faut acquitter un droit et avoir été examiné par les
maîtres jurés du métier. Ces derniers inspectent également
toute viande mise en vente. Est formellement interdit l’achat de bêtes
à des lépreux, ou encore à des médecins chirurgiens
(“barbiers”), dont l’état physique ou la profession impliquent
un contact avec le sang humain.
|
(27) Dom Basile FLEUREAU, op.
cit., p.134. Voir La grande boucherie de Ph. Auguste et l’Hôtel
Saint-Yon à Etampes: XIle et XVe s. / L.-E. LEFEBVRE, Paris,
1909.
|
LE DÉSASTRE
DE LA GUERRE DE CENT ANS
Après avoir connu un XIIIème
siècle prospère, le territoire d’Etampes se voit confronté
à une longue période d’épreuves: la guerre de cent
ans.
Il faut attendre le retour de la paix en 1478
pour que la vie économique puisse renaître, et la ville se
repeupler. Pendant ces années où pillages et ravages frappent
la cité à plusieurs reprises, Etampes demeure fidèle
au roi de France, même si celui-ci n’y réside plus, et en a
confié l’administration directe à des apanagistes (28).
De 1307 à 1400, la châtellenie
d’Etampes, érigée en comté à partir de 1327,
est distraite du domaine royal et confiée à la maison d’Evreux,
avant de connaître entre 1400 et 1478, plusieurs décennies
d’incertitudes liées à la lutte franco-anglaise et aux contestations
entre Armagnacs et Bourguignons.
De 1357 à 1360, et à nouveau
en 1367, les troupes anglaises conduites par le Prince de Galles ravagent
la région, pillent les églises, désorganisent la vie
économique et commerciale.
Le marché Saint-Gilles, non défendable,
est transféré en 1360 dans la partie fortifiée de la
ville, soit dans la paroisse Saint-Basile, au-dessous du château,
et devant la collégiale Notre-Dame, elle-même fortifiée
et environnée de fossés depuis 1353 (29).
Ému par la détresse des quelques
habitants qui demeurent encore à Saint-Gilles, totalement ruinés
par les Anglais, le comte apanagiste Louis II d’Évreux décide,
moyennant redevance (30), de renoncer à son droit de prélever
sur ces habitants, le linge et la vaisselle nécessaires à
sa maison. Ainsi qu’il le reconnaît, sa générosité
n’est pas désintéressée les riverains de l’ancien marché
Saint-Gilles “ne (pouvant) (tout) bonnement (pas) soutenir (ces charges),
(ce) qui pourrait estre cause qu’ils délaissent la ville, (diminuant
ainsi) les autres droits et rentes et proffits (qu‘il) prenait sur (eux)”.
L’original de cette charte de juillet 1378 est conservé aux Archives
municipales d’Etampes (31). [p.19]
|
(28) Voir DUPIEUX, op. cit.
(5), p.13 et suiv.
(29) Voir FLEUREAU, op. cit., p.97 et suiv.
(30) Le paiement annuel d’une rente de 10 livres
parisis, payable à terme, une moitié à la Toussaint
et l’autre à Pâques.
(31) A.M.E., cote AA5. Transcription in: Actes
constitutifs de la ville d’Etampes: XIIe-XIVe s. / Clément WINGLER.
- Etampes, 1992.
|
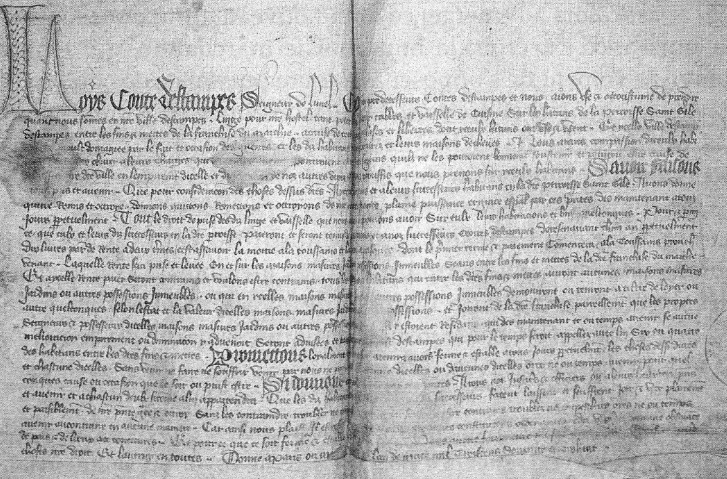 Charte de Louis II d’Évreux,
comte d’Étampes, juillet 1378 (Archives municipales d’Étampes)
Charte de Louis II d’Évreux,
comte d’Étampes, juillet 1378 (Archives municipales d’Étampes)
RENOUVEAU
ET VITALITÉ APRÈS LA PAIX DE 1478
Au retour de la paix en 1478, comme l’expose
Paul DUPIEUX dans son ouvrage consacré aux institutions d’Étampes,
“les habitants du quartier Saint-Gilles veulent, comme par
le passé, avoir l’avantage exclusif de tenir le marché. A
cette prérogative sont attachés trop de privilèges,
pour qu’ils puissent consentir à l’abandonner. Le roi leur accorde
satisfaction le 8 juin 1478. Le 20 mars 1479, un arrêt du parleinent
(32) défend aux habitants des quartiers Notre-Dame et Saint-Basile,
de vendre ou d’acheter du vin, du blé, des draps, des cuirs, du bétail
pendant la semaine, sauf le jeudi sur la place Saint-Gilles. Aucune réunion
commerciale ne doit plus avoir lieu à l’avenir le samedi près
de Notre-Dame. Les défenses ne sont pas respectées. Des procès
s’engagent entre les habitants des quartiers rivaux. La concurrence économique
bat son plein. Il s’agit d’une véritable opposition entre des privilèges
anciens, sacrés, immuables, et l’extension du négoce, qui
répond à un accroissement de la consommation parisienne. La
rivière d’Étampes vient en effet d’être rendue navigable
et des bateaux chargés de vivres quittent la ville (pour la capitale).
Or le quartier Notre-Dame est plus proche du port que celui de Saint-Gilles...
Quand et comment se terminèrent les procès Nous n’avons pu l’apprendre... Mais nous savons
qu’à la date de 1534, il y a au moins deux marchés par semaine
à Etampes, le jeudi sur la place Saint-Gilles et le samedi près
de Notre-Dame” (33).
[p.20]
|
(32) Archives Nationales: Registres
du Parlement, Apr. din, X1a8318, fol.518 r° et v°.
(33) DUPIEUX, op. cit. (5), p.139 à
141.
|
 Seigneur percevant les taxes
Seigneur percevant les taxes (Miniature du XVe siècle
– BNF)
|
|
LE COMMERCE
SOUS LA RENAISSANCE:
LE DERNIER ÂGE D’OR (XVIe s.)
De la paix qui clôt la Guerre de Cent ans (1478) aux premiers ravages
des guerres de religion (1562), Etampes et son commerce connaissent leur
dernier âge d’or.
|
|
C’est dans le contexte de ce relèvement
économique et démographique, que la “Coutume des bailliage
et prévosté d’Étampes” est “rédigée
et accordée par les gens des Trois Etats desdits lieux au mois de
septembre 1556”
(34). Au XVIème siècle, la “Coutume” est un droit particulier
ou municipal établi par l’usage, souvent vieux de plusieurs siècles,
qui a acquis force de loi depuis qu’il a été rédigé
par écrit.
Sont notamment décrits et codifiés
par matières, les usages qui régissent une partie de la vie
économique et commerciale de la ville et de la campagne voisine.
Deux versions imprimées de la Coutume d’Etampes, datant des XVIe et
XVIIe siècles, sont accessibles aux Archives communales (34).
|
(34)
Publié par: Coustumes générales
et particulières du royaume, t.1 / Charles DU MOULIN. - Paris, 1581. Arch. mun. d’Et., cote FAG 1. — Nouvelle édition commentée par: Coustumes du bailliage et prévosté du
duché d’Estampes / Marc-Antoine LAMY. - Paris, 1720. Arch. mun. d’Et., cote FLP 33.
|
En matière de foires et marchés,
est rappelée la règle de sauf-conduit dont bénéficient
les marchands (chap.13, art.CLXV) “n’est loisible à aucune personne,
faire procéder par voie de saisie et exécution réelle,
sur les denrées et marchandises amenées en la ville d’Estampes
et autres villes et villages desdits bailliage et prévosté,
es quels y a foire ou marché publicq pour estre vendues, sur les
chevaux, bestes de somme et charrois, marchandises et denrées et sur
le chemin pour y aller et retourner (sic)”. Ce sauf-conduit s’applique
également au produit de la vente, “aux deniers provenant des marchandises
vendues et achetées”. Destiné primitivement à protéger
les marchands contre les brigandages et les exactions, ce privilège
n’est pas sans présenter des travers: un particulier qui souhaite
recouvrer son dû en faisant saisir les biens d’un marchand endetté,
n’est en droit de formuler sa requête qu’en dehors des périodes
de foires et marchés. Le cas s’est — semble-t-il — présenté
à plusieurs reprises (34).
|
|
|
ÉLEVAGE ET BOUCHERIE
Concernant l’élevage (chap.15, art.CLXXXV
et CLXXXVI), la coutume précise qu’il “n’est loisible à
personne demeurant à Etampes, de tenir bestes à laine, porcs,
oyes et cannes, à peine de confiscation desdistes bestes, et d’amende
arbitraire. Peuvent néanmoins les bouchers, pour la fourniture de
[p.23] la dite ville, tenir en icelle les dites bêtes à
laine pour huit jours seulement, et sont tenus iceux bouchers, tuer leurs
bêtes sur la rivière et non en leurs maisons”.
L’élevage est donc prohibé à
l’intérieur de la ville, sans doute pour des raisons d’hygiène.
Cette disposition n’est pas propre à Etampes. Ainsi que le précise
M. A. LAMY (35), on la retrouve dans la plupart des autres villes royales.
Cette prohibition ne s’étend pas aux faubourgs, où sont nourris
les animaux destinés à l’approvisionnement du centre urbain.
Dans la pratique, il semble que l’interdiction ait été peu
respectée. Encore au début du XVIIIème siècle,
“on voit journellement à Etampes, ces sortes d‘animaux
dans les rues impunément, et sans que les juges de police y mettent
ordre; cependant il serait d’une très bonne police de tenir la main
à l’exécution parce que la ville en serait plus nette et l’air
plus pur” (36).
Contrairement aux autres habitants, les bouchers
peuvent donc conserver des bêtes à laine pendant huit jours,
et les conduire aux champs, mais ils ne sont pas autorisés à
les tuer dans leur maison, “à cause de l’infection que le sang
qui s’amasserait et croupirait, causerait”, alors que “sur la rivière”,
où l’abattage est autorisé, “l’eau l’emporte”.
Le droit de pâture ne s’applique pas
aux porcs “car ces animaux sont pernicieux aux herbages”, et aux
chèvres “car elles sont venimeuses” (37). Les charcutiers des faubourgs
sont tenus de garder les porcs dans leurs maisons, “ces animaux étant
très sales et gâtant en fouillant la terre avec leur museau,
tous les lieux où ils s‘arrêtent”.
La Coutume nous renseigne très précisément
sur les dispositions qui réglementent le droit de pâture. La
libre pâture sur les prés d’autrui est autorisée entre
le 15 mars et le 1er octobre. Du 1er octobre au 15 mars, elle n’est permise
que si le pré n’est pas clos. Bien entendu, aucun bétail ne
peut être amené dans les bois, et sur les terres plantées
de vignes et d’arbres fruitiers (art.CLXXXVIII). Le droit de pâture
est limité à la paroisse. Il ne peut s’étendre aux
“paroisses contigües et joignantes de clocher à
autre”. Des gardiens de pâturages, également appelés
“messiers”, sont nommés par les habitants de la paroisse où
ils sont établis.
|
(35) Op. cit. (34), p.455.
(36) Op. cit. (35), p.456.
(37) Op. cit. (35), p.454.
|
|
GIBIER ET PIGEONS
Ainsi que le rappelle la Coutume (chap.15,
art.CLXXXIII), le droit de chasse est féodal et ne peut être
exercé par un roturier. De même, la possession d’un grand colombier
à pied “avec boulins, jusqu’à rez-de-chaussée”,
n’est permise qu’au seigneur d’un fief noble (art.LXXXIX), “fondé
par écrit”. Par contre, tout le monde peut avoir un “colombier
sur pilliers ou sur quelque bâtiment”. [p.24]
Enfin, “il n’est pas permis de transformer
(une terre) en garenne sans concession du roi, car (les garennes) nuisent
beaucoup aux laboureurs, la grande quantité de lapins qui s’y trouvoit
mangeant les grains”.
|
|
|
CUIRS ET DRAPS
“Si le moyen-âge n’ignore ni le tissage de la toile, ni
le travail du cuir des bovins ou des peaux de mouton et de chèvre,
c’est cependant à partir du XIVème siècle que ces industries
trouvent leur pleine expansion. Toutes deux se concrétisent par
une longue macération des produits de base: lin et chanvre d’une
part, peaux d’autre part. A l’utilisation dynamique de l’eau par les moulins
s’ajoute l’usage des eaux stagnantes des rotoirs à plantes textiles,
des tanneries et mégisseries… le marais péri-urbain sert à
la fois à la défense d’Étampes et à l’essor
des plantes textiles. Parallèlement, l’industrie du cuir répond
à une forte demande. Des tanneries jalonnent les rivières.”
Claudine BILLOT,
Atlas historique des villes de France: Étampes. - Paris, CNRS, 989.
Les tanneurs ne sont pas oubliés par
la coutume de 1556. Elle précise qu’ils ne peuvent jeter “leurs
plains (38) dans la rivière pendant le jour, seulement pendant
la nuit afin que l’usage de l’eau ne soit pas empêché (ou
pollué)”,
(art.CLXXXVI).
|
(38) Bouillie de cuir et de chaux
qu’on fait peler dans l’eau. [p.39] in: Dictionnaire de Trévoux,
Paris, 1762, t.3. A.M.E., cote V7 –316C.
|
 Transport de blé sur la Seine (BNF)
Transport de blé sur la Seine (BNF)
|
LE PORT (1490-1676)
C’est à la demande des échevins
et du prévôt des marchands de Paris que Charles VIII permet
en 1490 à Jean de Foix, comte d’Etampes depuis 1478, d’octroyer aux
habitants de la ville le droit de port.
Son aménagement et la transformation
de la rivière d’Etampes en canal doivent permettre le transport
vers la capitale par la Juine, l’Essonne et la Seine, des blés de
la Beauce dont Etampes est le principal entrepôt et centre de distribution.
Jusqu’alors le transport des céréales indispensables à
l’approvisionnement de Paris se fait pour l’essentiel par des routes peu
sûres et en mauvais état.
Aux difficultés matérielles
pour l’établissement du port (percement d’un canal, détournement
de cours d’eau, constitution d’un réservoir) (39), s’ajoute un contentieux
juridique. En 1490 existe déjà un port à Etampes petit
port privé appartenant à l’ordre de Saint Jacques de l’Épée,
situé derrière l’hôpital de leur commanderie, soit hors
les murs de la ville, à l’emplacement des anciens abattoirs actuels.
Le Commandeur de l’Ordre s’oppose aux lettres patentes de Jean de Foix
qui, en donnant au nouveau port l’exclusivité du trafic, signifie
à court terme la disparition de celui de l’hôpital. Le Parlement
rend un arrêt en 1527 aux termes duquel les deux ports peuvent coexister.
[p.25]
L’étendue du nouveau port est précisée:
depuis les fossés de la ville jusqu’à une ruelle descendant
du faubourg Évezard à la rivière, soit approximativement
l’espace actuellement compris entre la rue Van Loo et la sente des Capucines.
Son activité est certaine: chaque jour
une vingtaine de bateaux, chacun pouvant emporter entre 16 et 17 tonnes
de marchandises, arrivent au port ou le quittent.
Le trafic décline à partir du
milieu du XVIIème siècle. L’amélioration des routes
permet désormais un transport plus rapide et économique des
marchandises que les canaux et rivières. De plus, la guerre civile
de 1652 empêche d’assurer les travaux d’entretien nécessaires
à une bonne navigation. Enfin, la rupture des écluses de
la rivière en 1676 arrête tout trafic et le port est abandonné.
[p.26]
|
(39) Voir: Le Port d’Etampes:
1490-1676 / Clément WINGLER. – Etampes: Arch. Mun., 1996, 35.
|
|
Artisanat et commerce: L’atelier de vente
d’un dentellière
au XVIIIe siècle. (Bibliothèque des Arts décoratifs)
|
Un colporteur au XVIe siècle
(Bibliothèque de l’Arsenal)
|
|
|
LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME:
LE COMMERCE
AUX XVIIe ET XVIII s.
L‘histoire du commerce à Etampes sous les règnes de Louis
XIV, Louis XV et Louis XVI, reste à ecrire. Essayons d’en dresser
un rapide et très partiel tableau à partir des documents conservés
aux Archives municipales.
Le relèvement
économique de la ville semble certain sous Louis XIII, avant d’être
brutalement interrompu par la reprise de la guerre civile pendant la minorité
de Louis XIV.
La Fronde laisse derrière elle une ville
martyre, ravagee par le siège qu’elle subit en 1652 et les épidémies
de peste (1631, 1632). “Pendant de nombreuses années, Etampes
offre le spectacle d’une ville désolée, aux maisons sans toits,
sans fenêtres, percées de tous les côtés. Dans les
brèches de la grande enceinte, les mendiants et les pauvres viennent
s‘abriter. Les rues sont désertes: la population a tellement diminué
que deux échevin y suffisent maintenant à diriger ses affaires.
Pour comble de malheur, les récoltes de 1661 et 1662 ayant été
mauvaises, la famine fait son apparition... Des troupes passent sans cesse,...
réquisitionnent les fourrages, le blé, la viande” (40).
Au XVIIIème siècle, Etampes
retrouve un rôle de grand marché céréalier d’approvisionnement
de la capitale, sans atteindre l’importance qu’il a pu avoir au Moyen-Age
et sous la Renaissance.
La population diminue tout au long du siècle.
Si les cinq paroisses totalisent 1622 feux (cellules familiales de base)
en 1740, ceux-ci ne sont plus qu’au nombre de 982 en 1762. Ce n’est qu’à
la veille de la Révolution que la ville retrouve 2000 teux (environ
9000 habitants), c’est-à-dire la même puissance démographique
qu’au début du XVIIème siècle.
|
(40) Ma petite patrie: histoire
de la région d’Etampes / C. CANCE et Louis MOREAU. – Etampes,
1945, p.86 et suiv.
|
|
LE DÉPLACEMENT
DE LA FOIRE SAINT-MICHEL (1774)
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la foire
Saint-Michel demeure le grand rendez-vous commercial de l’année.
Si elle se tient toujours dans les sablons du lieu-dit Saint-Michel, hors
les fortifications de la ville, les droits qui lui sont rattachés
ne sont plus perçus par la maladrerie Saint-Lazare à partir
de 1699, date où celle-ci disparaît, mais par l’Hôtel-Dieu.
qui en a hérités.
L’emplacement qui est celui de la foire, éloigné
du centre ville, est malcommode et suscite des contestations qui finissent
par l’emporter en 1774. Le 28 juillet, un grand nombre d’habitants présentent
un [p.28] mémoire aux membres du conseil municipal (41). Ils exposent
que “la foire ... est éloignée de la ville d’un quart de
lieue (soit 1,5 km), que le terrain est tout sable mouvant qui dans les
temps de sécheresse endommage considérablement les marchandises
exposées en vente, ainsi que les pluies qui sont assez communes
en cette saison, qu’il n’y a d’ailleurs comme abri qu’une seule maison,
ce qui occasionne la défection de la plupart des personnes qui viennent
à la foire pour y acheter ce qui leur est nécessaire ...,
que si son emplacement était à proximité de la ville,
cela éviterait des frais de transport et de dépouillement
de marchandises et denrées qui sont exposées en vente, qu’il
serait (donc) avantageux à tous les marchands, que cette foire soit
transférée et placée dans les allées du port
(comblé au siècle précédent). L’agrément
des lieux, leur forme régulière, ... la proximité de
la ville, y attireraient un peuple nombreux, et par conséquent une
vente et une consommation beaucoup plus considérables dans les différentes
branches du commerce.”
Le plaidoyer convainc le conseil municipal
qui décide le jour même, à l’unanimité, de transférer
la foire sur les allées du port. Le bureau de l’Hôtel-Dieu,
qui reste en possession de ses droits, ne peut que se ranger à cette
décision, en estimant que les “sablons sont effectivement peu propices
à l’usage d’une foire, le long de la grande route (de Paris), à
un endroit très resserré qui donne souvent lieu à des
accidents, alors que la place du port ne peut être qu’utile et agréable” (42).
Les délibérations du conseil
municipal et du bureau de l’Hôtel-Dieu sont homologuées par
une sentence du bailliage donnée le 12 août 1774.
|
(41) Registre des délibérations
du conseil municipal, 28 juillet 1774, p.54.
A.M.E., cote 1 D 6.
(42) Extrait des registres du greffe des délibérations
du bureau de l’Hôtel-Dieu, in Reg. des délibérations
du conseil municipal. op. cit. (41), p.55.
|
Au contraire de la foire annuelle de Saint-Michel
qui permet aux habitants de découvrir entre-autre des produits artisanaux
et manufacturés, les marchés hebdomadaires n’exposent à
la vente, pour l’essentiel, que des produits de l’agriculture et de l’élevage,
des denrées comestibles. Ainsi, la place Saint-Gilles voit volontiers
converger les céréaliers et les éleveurs, qui confirment
son rôle de marché de gros, alors que la place Notre-Dame
reçoit le principal marché local de produits alimentaires
de détail.
Dès la fin du XVIIème siècle,
le marché Notre-Dame apparaît trop exiguë. “Il est
tellement petit et serré proche de l’église que les marchands
de poissons et autres denrées sont obligés d’exposer en vente
leurs denrées jusque sur les degrés de l’église, ce
qui est très indécent à la porte d’un lieu Saint” (43). “La volaille doit être
placée dans la rue des Oisons (aujourd’hui rue Paul Hugo) et les rues
adjacentes qui sont très étroites, ce qui gène le passage.
Un cavalier ne peut y passer!” (44). [p.29]
L’engorgement de la place et des rues avoisinantes
est d’autant plus grand que la plupart des marchands ne sont pas originaires
de la ville mais souvent de bourgs distants de 15 à 40 km, ce qui
les conduit à se rendre à Etampes et à transporter bétail
et marchandises à dos de cheval ou à l’aide de chariots.
Plusieurs procès-verbaux dressés
par l’administration du bailliage entre 1764 et 1767 (45) nous permettent
de mieux connaître ces marchands et d’appréhender la physionomie
commerciale de la place Notre-Dame vers le milieu du XVIIIème siècle.
A l’exception de quelques produits textiles
d’usage courant (bas, chemises...) et de rares objets de verre et de quincaillerie,
ne sont proposés à la vente que des produits de l’élevage
et de l’agriculture: volailles diverses, œufs, beurre, fromage, fruits et
légumes; pour ces derniers, essentiellement des navets et des légumes
secs: pois, fèves et lentilles.
Aucun Etampois ne figure parmi les marchands
de denrées comestibles: ce sont donc des personnes étrangères
à la ville qui alimentent son principal marché en victuailles
diverses. Rappelons néanmoins que le commerce des aliments de base:
pain et viande de boucherie, demeure le privilège des boulangers
et bouchers établis dans la cité, même s’il est parfois
battu en brèche.
Bon nombre des marchands qui se rendent à
Etampes chaque semaine ou de manière plus saisonnière pour
y écouler leurs produits, ne tirent en général de cette
activité commerçante qu’un revenu d’appoint, quelques fois
non négligeable, qui leur permet de compléter les ressources
issues de leur labeur habituel, presque toujours le travail de la terre et
la culture de la vigne.
Sur 24 éventaires recensés en
moyenne en 1764 (45), 13 sont tenus par des vignerons ou leurs épouses,
6 par des laboureurs, 2 par des manouvriers. Le nombre particulièrement
élevé de vignerons, qui se présentent pour l’occasion
sous la qualité de marchands de fruits mais aussi de volailles et
de légumes, témoigne par ailleurs de la persistance de petits
vignobles dans plusieurs terroirs de la région, ainsi à Bouville,
Lendreville, Boissy-sous-Saint-Yon, Sermaises, Courances ou Dourdan.
|
(43) Requête des habitants
au duc de Vendôme et dEtampes, 1698. A.M.E., cote AA 173.
(44) Requête du maire au prince de Conti,
seigneur du duché d’Etampes, 1737.
A.M.E., cote AA 173.
(45) Procès-verbal du 15 septembre
1764. cote AA 57.
|
BOUCHERS
DE LA CAMPAGNE
ET BOUCHERS DE LA VILLE
Au cours de la première moitié
du XVIIIème siècle, le commerce de la boucherie s’accommode
de moins en moins des pesantes coutumes qui parfois depuis le moyen-âge,
réglementent son activité et, par voie de conséquence,
l’approvisionnement en viande de la population. [p.30]
Les artisans membres de la corporation des
bouchers sont les premiers à ne plus respecter les principales dispositions
codifiées par la coutume de 1556. Par commodité, la plupart
d’entre-eux débitent et vendent la viande depuis leurs maisons, ce
qui est interdit, et n’exposent leur marchandise à la vente que pendant
quelques heures par jour, alors que la coutume leur prescrit de le faire
du soleil levant au soleil couchant (46)
En 1739, la corporation des bouchers d’Etampes
ne compte plus que six membres. Leur nombre ne permet pas de répondre
de manière satisfaisante aux besoins de la population urbaine et
des habitants de la campagne environnante qui doublent chaque semaine la
consommation de viande par leurs achats aux marchés de la ville. Afin
de pouvoir satisfaire cette demande, les six bouchers acceptent que leur
privilège de vendre la viande à Etampes soit étendu
aux bouchers de la campagne. Ainsi est remis en question le monopole jadis
institué par Philippe Auguste. “Les bouchers de la campagne pourront
apporter, vendre et débiter de la viande à la grande boucherie
tous les jours de la semaine, sans aucune obligation de visite (de contrôle
par un boucher de la corporation d’Etampes)” (47).
Vers la même époque, d’autres
corporations doivent également accepter la concurrence de marchands
extérieurs à la ville. Les jours de marché, des merciers,
épiciers, toilliers, fripiers et même boulangers, vendent librement
leurs marchandises à Etampes, semble-t-il sans soulever de protestations
chez les commerçants établis dans la cité. Les autres
jours de la semaine, les marchands extérieurs à la ville peuvent
offrir leurs produits à la vente, sous réserve d’obtenir la
permission des maîtres-jurés des corporations locales correspondantes,
et de payer un droit de cinq deniers.
L’attitude conciliante des bouchers d’Etampes
s’avère cependant de courte durée: environ dix-sept ans après
l’institution du libre commerce de la viande, ils cherchent à recouvrer
leur ancien monopole. La concurrence des bouchers de la campagne, qui se
sont souvent installés depuis peu dans les faubourgs et les hameaux
proches de la ville, se fait durement sentir. Ils parviennent à vendre
leur viande à des prix inférieurs des deux tiers à
ceux pratiqués par les bouchers de la ville; en revanche, la qualité
de leur marchandise est incontestablement moins bonne.
Alors qu’une majorité de notables se
prononcent pour les bouchers de la corporation, les habitants les moins
fortunés, mais aussi bon nombre de représentants de la petite
et moyenne bourgeoisie, prennent parti pour ceux de la campagne. Le débat
devient public, comme en témoignent plusieurs pétitions en
faveur des bouchers de la campagne, signées par plus d’une centaine
d’Etampois. [p.31]
Parmi les noms relevés sur les listes
de pétitionnaires d’avril 1759, notons ceux des curés de Saint-Gilles
et Saint-Martin, des syndics des paroisses Notre-Dame et Saint-Pierre, d’un
conseiller et avocat du roi, d’un nombre très important d’artisans(48),
de plusieurs aubergistes et épiciers.
Ces pétitions sont intéressantes
de par les arguments qu’elles font valoir. On peut y déceler l’influence
des idées défendues par les physiocrates, notamment la conception
du “laisser-faire, laisser passer“, de “la libre circulation des
marchandises”, de “la liberté du commerce”. La notion
du “bien-être de tons, surtout du petit peuple” est également
mise en avant: “(les signataires) espèrent une decision de justice
qui maintiendra l’ordre et l’intérêt public, … et qui sera
une barrière à l’ambition des bouchers d’Etampes qui, en
fixant le prix de leur viande au-dessus de celui des bouchers de la campagne,
priverait le bas peuple de cet aliment”.
Un incident sérieux se produit en mai
1759. Les bouchers d’Etampes interdisent verbalement à leurs collègues
des environs, de vendre leur marchandise dans la ville. Ceux-ci refusent
d’obtempérer et continuent à approvisionner les marchés
de la cité. En représailles, le 12 mai, la corporation d’Etampes
confisque la viande que Claude Chaumedru, boucher de Méréville,
vend sur le marché Notre-Dame, et porte l’affaire devant la justice
royale, en arguant de son droit de monopole qui lui avait été
confirmé par la coutume en 1556.
La justice donne raison à la corporation
(49) en rappelant que “défense est faite à toutes personnes
autres que les dits maîtres, de vendre et d’exposer en vente aucune
chair de boucherie, à peine de confiscation et de 300 livres d’amende”,
conformément aux principes de la coutume, mais le procureur du roi
en profite pour signifier aux bouchers de la corporation, qu’ils doivent
eux aussi se conformer à la coutume. Et de leur remémorer
qu’ils “ne pourront vendre et débiter ailleurs, qu’en
la boucherie sise au petit marché Notre-Dame, ou telle autre qui leur
sera établie par la suite, (et non dans leurs maisons), avec obligation
de garnir chaque jour depuis soleil levé jusqu’à soleil couchant,
sauf le vendredi et le dimanche, les étaux des chairs coupées
en morceaux, nettes et non corrompues, devant être visitées
et vendues à des prix raisonnables”. Le lieutenant général
de police Jacques Picart, reçoit pour mission d’y veiller.
Bien entendu, les bouchers de la campagne
ne restent pas inactifs, et interjettent appel de la sentence de justice,
au motif qu’elle porterait “atteinte au privilège des foires et
marchés”. Ils sont soutenus par nombre d’habitants qui “sont
sous l’espérance qu’on taxerait les viandes à différents
prix suivant la différence de sa (sic) valeur et que la partie du
peuple la moins riche aurait les bas morceaux à un prix bien inférieur
aux bons.” [p.32]
Le conflit s’éternise, la décision
de justice n’est guère appliquée, et les bouchers de la campagne
continuent à approvisionner les marchés de la ville.
Notons qu’à la même époque,
des conflits similaires pour le maintien ou l’abolition des privilèges
commerciaux hérités du Moyen-Age, ont lieu dans beaucoup de
villes, par exemple à Paris où les boulangers veulent interdire
les ventes de leurs homologues des faubourgs et de la campagne sur les
marchés intra-muros de la capitale.
|
(46) Voir le dossier d’établissement
d’une nouvelle boucherie, Arch mun. d’Etampes, cote AA 172.
(47) Mémoire de Claude CHAUMEDRU,
marchand boucher à Méréville, et de Jean PERCHEREAU,
marchand boucher à Chalo-Saint-Mars, 1760. A.M.E cote AA 173.
(48) Pétitions des habitants d’Etampes
en faveur des bouchers de la campagne, 1760, A.M.E., cote AA 171 et 172.
(49) Décision du procureur du Roi,
en date du 6 avril 1759. Arch, mun. d’Et., cote AA 171.
|
LA
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE BOUCHERIE ET L’AGRANDISSEMENT DU MARCHÉ
Une fois de plus, le conflit entre bouchers
de la ville et bouchers de la campagne, met en évidence l’exiguïté
de la place du marché Notre- Dame, incitant la municipalité
en 1760, à se saisir à nouveau de la question du déplacement
de la grande boucherie de Philippe Auguste, de manière à dégager
un espace propice à l’agrandissement du marché.
Une première tentative pour obtenir
la reconstruction de la boucherie en un autre lieu, avait été
faite dès 1698, sous la forme d’une requête des habitants au
duc de Vendôme et d’Etampes. Elle était restée sans
suite faute d’accord sur le financement de l’opération (50). Une
seconde tentative avait connu le même sort en 1737,
Une nouvelle requête est donc présentée
au duc d’Orléans et d’Etampes en 1760. Hochereau, maire de la ville,
obtient le 22 septembre 1761, l’autorisation de démolir l’ancienne
boucherie qui apparaît “six fois trop grande”, et de construire
un nouveau bâtiment plus petit, rue du Puits de la Chaîne,
en utilisant les matériaux de l’ancien. Les neuf maîtres-bouchers
de la corporation donnent leur accord à l’opération, et
acceptent de payer au duc d’Orléans, une rente annuelle de 90 livres
pour une hypothèque levée sur l’ancienne boucherie, et pour
le maintien de leur privilège exclusif d’utilisation des 14 étaux
de la nouvelle boucherie. La reconstruction est financée par la
ville. Un conseiller du roi et échevin, J. B. Delisle, et un greffier
du grenier à sel et marchand meunier, Pierre Guettard, cèdent
le 8 décembre de la même année, la maison où
sera établie la nouvelle boucherie. Le nouvel établissement,
qui aura coûté 1786 livres et 8 sols, est officiellement ouvert
au public le 3 septembre 1762 (51).
|
(50) Dossier sur la reconstruction
de la grande boucherie, A.M.E., cote AA 173.
(51) Op. cit. (50), cote AA 174 à
AA 177.
|
|
LES MARCHANDS ET LE BOURREAU:
LE DROIT DE HAVAGE
Depuis la fin du Moyen-Age, le bourreau ou
“exécuteur des sentences criminelles du bailliage
d’Etampes” (52),
jouit d’un privilège destiné à compléter sa
rémunération: le droit de havage, qui consiste à perce
voir un impôt en nature ou en argent sur toutes les denrées
vendues sur le marché. [p.33]
Si ce droit est aboli à Paris en 1721,
il perdure à Etampes tout au long des XVIIème et XVIIIème
siècles, au grand dam des marchands qui y sont assujettis. Si on
ne peut trouver trace dans les Archives, de contestations sérieuses
au XVIIème siècle, le conflit éclate en 1760, quand
le bourreau Desmorets double subitement le montant de la taxe perçue.
Il s’ensuit une baisse de la fréquentation du marché par ceux
qui l’approvisionnent, marchands et laboureurs, qui préfèrent
désormais vendre leurs produits en d’autres lieux. Des habitants s’en
émeuvent et en appellent au duc d’Orléans, seigneur de la
ville. Le conseil municipal dans sa séance du 19 février 1764,
dénonce avec quelque exagération les “prétentions
exhorbitantes de l’exécuteur des sentences criminelles, qui menacent
de ruiner totalement le commerce.”
Un huissier est dépêché
sur le marché pour dresser des procès-verbaux constatant
et détaillant la perception du droit de havage. Plusieurs de ces
procès-verbaux sont conservés aux Archives municipales (53).
Ils nous apprennent que lors de la tenue du marché sur la place Notre-Dame,
“la mère, l’épouse et la domestique de l’exécuteur
des sentences, lèvent en son nom, des droits sur l’ensemble des
marchands de beurre, œufs, fromages, volailles, navets, fruits et autres
légumes”. Le payement se fait en argent, et aucun justificatif
n’est demandé: “prononcer le nom du bourreau suffit”. Le marchandage
est possible: Michel Dru, manouvrier à Roinville, obtient de ne payer
que deux sols pour les trente dindes qu’il propose à la vente, au
lieu des trois sols initialement exigés. “Après
avoir été payée, la domestique marque les vêtements
du marchand ou la serviette enveloppant les marchandises, avec un peu d’ocre.”
Ce jour-là, vingt-quatre marchands s’acquittent du règlement
de la redevance.
Contrairement aux espérances des édiles municipales,
la justice du bailliage donne raison au bourreau sur le fond et sur la
forme. En juillet 1764, elle reconnaît la validité du droit
de havage et des tarifs pratiqués et condamne pour “surveillance
abusive”, l’huissier diligenté par le maire. Sollicité
en appel par la municipalité, le Parlement de Paris rend un arrêt
définitif le 17 juillet 1766: le droit de havage de l’exécuteur
des sentences est confirmé mais restreint à la perception
d’une taxe “de six deniers par sac de blé, orge, avoine, plein
ou non, et de trois deniers par sac de menus grains, pois, fèves,
lentilles”. Les autres denrées ne sont plus assujetties à
ce droit.
|
(52) Nous reprenons ici la démonstration
et les propos de Charles FORTEAU, in: Le dernier exécuteur des
sentences criminelles d’Etampes et le droit de havage. - Etampes, 1904.
A.M.E., cote FLM 115.
(53) Procès-verbaux des 11 juillet
et 15 septembre 1764. A.M.E., cote AA 57.
|
|
Le marché devant la Collégiale
Notre-Dame.
Par Narcisse Berchère, s.d. (Musée d’Étampes)
|
Usage des nouvelles mesures. Gravure
de Labrousse,
d’après J.P. Delion (BNF)
|
COMMERCE
ET ORDRE PUBLIC:
L’ORDONNANCE DE 1779
Les Archives municipales conservent une ordonnance
de police datée du 10 juillet 1779 (54), qui rappelle et précise
les textes en vigueur relatifs à la police des foires et des marchés,
Ils concernent aussi bien les commerçants de la ville, que les marchands
forains et le public. [p.34] [p.35]
Les articles XII à XXII cherchent à
prévenir les troubles à l’ordre public qui pourraient être
causés par l’abus d’alcool, les jeux et certains us et coutumes du
compagnonnage.
“Les artisans et gens de métier
n‘ont pas le droit de s‘attrouper et de porter des cannes et des bâtons.
Les cabarets n’ont pas le droit de recevoir plus de quatre compagnons à
la fois, et d’accepter les pratiques du prétendu devoir. Les maîtres
(des métiers) ne doivent que prendre des compagnons qui justifient
du lieu de naissance, et doivent tenir un registre.”
“Il est interdit aux marchands, colporteurs
et artisans, de donner à jouer dans les foires et sur les marchés”.
Sont prohibés “les jeux de cartes, de dés, la blanque, le
tourniquet… et tous les jeux de hasard et de loterie” (art. XXII).
“Les hôtelliers, cabaretiers, taverniers,
limonadiers, vendeurs de bière, d’eau de vie et de liqueurs en détail,
n’ont pas le droit d’ouvrir leurs boutiques après huit heures du
soir, de la Toussaint à Pâques soit pendant le Carême,
et après dix heures du soir, le reste de l’année” (art.XX).
Les articles XXV et XXXI s’intéressent
au recel: “il est interdit aux marchands, artisans d’acheter des hardes,
des meubles, de la vaisselle, des bijoux, des livres, du plomb, et d’autres
choses, aux enfants et domestiques, sauf s’il y a consentement du père
ou de la mère, du maître ou de la maîtresse…”
En matière de denrées alimentaires,
il est rappelé que leur vente par des commerçants extérieurs
à la ville, ne peut se faire par colportage à domicile: “les
personnes de la campagne doivent vendre leurs provisions sur les marchés
(où elles sont contrôlées et taxées) et non
par porte à porte. Les acheteurs sont punis” (art.XXXI).
Enfin, à une époque où
la valeur des poids et des mesures n’est pas unifiée et varie d’une
ville à l’autre, il apparaît important de prémunir l’acheteur
contre l’altération ou la contrefaçon des mesures utilisées
par les marchands. Leur confection est de ce fait sévèrement
réglementée.
Chaque boulanger doit avoir un moule estampillé
à son nom, ou portant un signe distinctif, et est tenu de mettre
son empreinte sur chaque pain exposé à la vente.
En mars 1783 (55), un arrêt du Parlement
de Paris impose la création de nouvelles mesures de grains en métal,
suite à une requête des maîtres de postes aux chevaux,
des directeurs de carrosses et de messageries, des marchands de grains,
laboureurs et hôteliers.
Les nouvelles mesures doivent être en
cuivre rouge, aux armes de la police, et marquées par le receveur.
Toute transaction en grains doit être calculée par des mesureurs
agréés. A cette occasion, un droit dit de minage doit être
acquitté. Les anciennes mesures sont “rompues et brisées”.
[p.36] |
(54) A.M.E., cote AA 273.
(55) Arrêt du Parlement de Paris du
8 mars 1783, A.M.E., cote AA 273. [p.40]
|
|
| Crédits de l'édition originale: “Document édité par les Archives
municipales d’Etampes, en coopération avec la Direction de la Communication
de la Ville d’Etampes. Textes: C. Wingler. Crédit photo: C. Fougereux.
Saisie: D. Krys. Conception, impression: Imprimerie municipale d’Etampes.
1ère édition. Mai 1997” [p.3 de couverture].
|
| Source: La plaquette originale de
1997 et une partie des illustrations originales, ressaisies par B.G en 2007. |