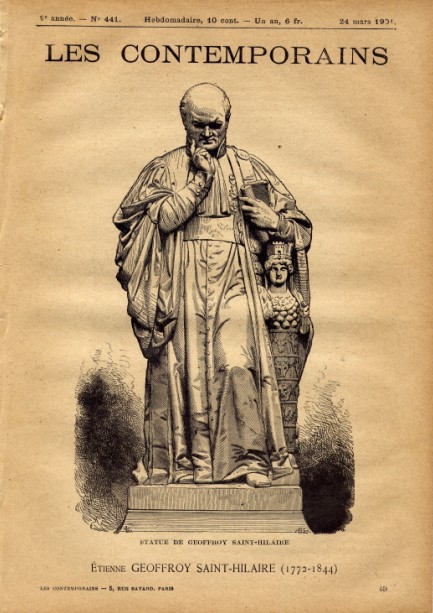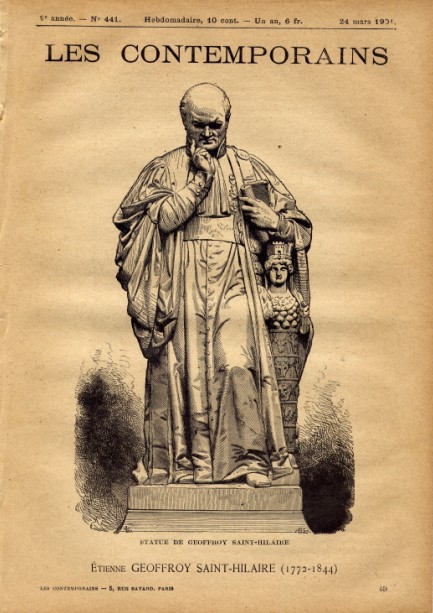| Les Contemporains [9e année] n°441 (24 mars 1901) |
Étienne
Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844)
|
9e année. N°441.
|
Hebdomadaire, 10
cent. — Un an, 6 fr.
|
24 mars 1901.
|
LES CONTEMPORAINS
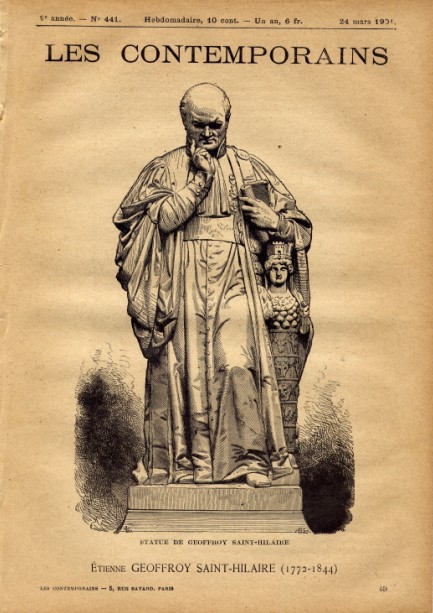
STATUE DE GEOFFROY
SAINT-HILAIRE
ÉTIENNE
GEOFFROY SAINT-HILAIRE (1772-1844)
LES CONTEMPORAINS — 5, RUE BAYARD, PARIS
|
Jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, la zoologie n’était
guère sortie de la ligne tracée par le deux naturalistes antiques
Aristote et Pline. En dépit des efforts tentés par quelques
esprits indépendants pour substituer l’expérience à
l’érudition, le respect était général pour la
parole du maître; et la paresse humaine, trouvant plus commode d’étudier
des livres dans le silence du cabinet que de chercher à surprendre
les secrets de la nature, se plaisait à figer indéfiniment la
science des animaux en une immobilité déjà plusieurs
fois séculaire. Entraînés cependant par l’exemple de Linné,
quatre savants, quatre Français, ont, presque sous nos yeux, assumé
la tâche de rompre avec une tradition surannée, stagnante, et
d’entrer franchement dans la voie de l’observation.
|
|
C’est grâce à cette convergence de leurs travaux vers un but
unique que les noms de Buffon, de Daubenton, de Cuvier (1) et de Geoffroy
Saint-Hilaire se trouveront associés, aux yeux de la postérité,
en un faisceau indissoluble. Et, particularité remarquable, naturalistes
ont, en quelque sorte, ouvert l’un à l’autre le chemin qu’ils devaient
suivre, pour leur gloire et pour le profit de la science à laquelle
ils se sont consacrés avec tant de dévouement. Buffon, ayant
besoin d’un collaborateur, prit Daubenton; celui-ci adopta pour disciple
Geoffroy, dont il fit bientôt, presque de vive force, son collègue;
et à son tour Geoffroy fournit à Cuvier, qui vivait ignoré
dans un village de la Normandie, les moyens de sortir de son obscurité.
|
(1)
Cuvier, voir Contemporains, n°4.
|
Celui de ces savants qui a donné la plus fortc impulsion à
la zoologie expérimentale et concrète est, sans contredit, Cuvier,
dont l’esprit rigide et froid, n’accordant aucune part à l’imagination,
n’admettait rien en dehors de phénomènes et des formes. Or,
à côté du domaine des faits, un autre, non moins vaste,
s’étend le champ des idées, et c’est celui-là que Geoffroy
Saint-Hilaire entreprit de défricher. Ses premiers travaux furent
communs avec ceux du collaborateur qu’il s’était lui-même choisi;
mais bientôt, rebuté par l’aridité de ce labeur exclusivement
analytique, il ne tarda pas à s’engager dans une route différente.
Les deux amis devinrent rapidement deux adversaires, profondément
séparés par les opinions scientifiques; ils ne s’en acquirent
pas moins, chacun dans sa voie, une gloire égale.
|
|
|
I.
FAMILLE — AU COLLÈGE DE NAVARRE — PREMIERS TRAVAUX
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire est né
à Etampes, le 13 avril 1772; sa famille, fort honorable, mais peu
fortunée, était venue de Troyes dans cette ville vers la première
moitié du XVIIIe siècle. Il avait de qui tenir; le nom qu’il
portait était déjà célèbre dans la science,
et peut-être l’atavisme eût-il suffit seul à décider
sa vocation. Mais il eut en outre le bonheur de trouver, au seuil même
de la vie, les conseils sûrs et éclairés de son aïeule
paternelle, qui l’initia de bonne heure aux sentiments les plus élevés,
les plus nobles, les plus généreux.
L’excellente femme avait coutume d’occuper les
loisirs des longues veillées à raconter à ses petits-enfants,
réunis autour d’elle, des histoires de son temps. 1)ans ces causeries,
revenait souvent le récit de l’heureuse fortune de deux Geoffroy,
qui s’étaient illustrés au siècle précédent,
l’un, Étienne-François, comme professeur au Jardin des plantes
et au Collège de France, l’antre, Claude-Joseph, par ses travaux de
chimie pharmaceutique et de botanique.
Séduit par ces exemples, le jeune Etienne sentit peu à
peu s’éveiller en lui le désir de la gloire, et un jour il
se prit à demander: «Mais, moi aussi, je veux devenir célèbre;
que faut-il faire pour cela? — Il faut, répondit la grand-mère,
le vouloir fortement. Je les ai bien connus, car ils étaient de notre
famille. Tu portes le même nom qu’eux; fais ce qu’ils ont fait.»
Et, afin qu’il pût encore s’inspirer d’autres modèles, l’enfant [p.3] reçut en présent
un exemplaire de la Vie des hommes illustres, de Plutarque.
|
|
Tandis qu’Etienne rêvait à sa future renommée, son père,
Jean-Gérard Geoffroy, alors magistrat à hampes, lui annonça
qu’une bourse lui était accordée au Collège de Navarre
et qu’on allait l’y placer. Le chemin de la gloire, que peut-être il
avait espéré plus riant, apparut à l’écolier
tristement hérissé de thèmes et de versions rébarbatifs,
et ses succès scolaires furent de médiocre valeur. La physique
seule avait le don de captiver son attention.
Dès que les premières études
du jeune homme furent achevées, le choix d’une carrière préoccupa
sa famille. Son père eût vivement désiré lui voir
embrasser l’état ecclésiastique, et, pour l’y décider,
il lui fit offrir un canonicat et un bénéfice. Mais Etienne
refusa, et, sous l’influence du penchant qui l’entraînait vers les
sciences, il demanda l’autorisation de rester à Paris, pour suivre
les cours du Collège de France et du Jardin des plantes. La permission
lui fut donnée, à la condition qu’en dehors de ses travaux scientifiques
il étudierait la jurisprudence. Il prit son diplôme de bachelier
en droit vers la fin de 1790, mais il s’abstint de persévérer
dans cette voie.
Restait la médecine. La profession elle-même
ne séduisait pas le jeune homme; cependant, il accepta de s’orienter
vers cette science, parce qu’elle n’est pas isolée, et que des liens
très étroits la rattachent à la physique, à la
chimie, à la biologie, les quelles constituaient l’objet de ses préférences.
Il était préparé déjà à suivre
les cours du haut enseignement par l’étude qu’il avait faite de la
physique expérimentale, au Collège de France, sous la direction
de Buisson.
Il vint prendre place parmi les pensionnaires
libres du Collège du Cardinal Lemoine, dont les professeurs appartenaient
à l’Eglise. C’était là qu’enseignaient Lhomond et Haüy
(1).
|
(1)
Haüy, Voir Contemporains, n°224.
|
Lhomond divisait son temps en deux parts, consacrées, l’une à
l’éducation de l’enfance, l’autre à l’étude des plantes;
Haüy, qui vénérait cet homme excellent à l’égal
d’un père, avait appris pour lui plaire la botanique, et de là
était insensiblement passé à la minéralogie.
Tous deux faisaient fréquemment de longues excursions pour recueillir
les échantillons nécessaires leurs études scientifiques.
Sans autre pensée que celle de se rapprocher
autant que possible de deux hommes célèbres, pour avoir la
satisfaction de pénétrer, si peu que ce fût, dans leur
vie, Geoffroy suivait souvent, de loin, leurs paisibles promenades. Un jour,
l’occasion se présente fortuitement de les aborder; on l’interroge,
et il laisse percer dans ses réponses une admiration si naïve,
si sincère, que les deux savants, touchés de cet hommage, devinant
la vocation latente en cet esprit enthousiaste, admettent désormais
le jeune homme à leurs entretiens.
Pas n’est besoin de dépeindre sa joie
ni l’ardeur nouvelle avec laquelle il se consacra à la science, guidé
par des maîtres aussi habiles. Sous la direction d’Haüy, il ne
tarda pas à se passionner pour la minéralogie.
Or, en ce moment, Daubenton faisait au Collège
de France un cours sur cette science;. Geoffroy se comptait au nombre de
ses auditeurs assidus. Après chacune de ses leçons, le professeur
avait coutume de poser quelques questions à ses élèves.
Un jour, il interroge Geoffroy sur la cristallographie, et voilà que
le disciple entre dans des développements et des considérations
qui étonnent le maître: «Jeune homme, lui dit celui-ci
avec une bienveillante bonhomie, vous en savez plus que moi! — Je ne suis,
répond Geoffroy, que l’écho de M. Haüy.» Cette parole,
hommage de reconnaissance très grand dans sa simplicité, valut
à Geoffroy la sympathie de Daubenton, qui, après avoir commencé
par lui confier la détermination de quelques échantillons,
devait, un peu plus tard, lui fournir les moyens d’entrer dans une carrière
où la gloire l’attendait. [p.4]
Mais cette vie d’études qui convenait
si bien à son ardente curiosité de la vérité
scientifique devait, auparavant, subir une interruption, causée par
la rapide précipitation des événements politiques. L’orage
révolutionnaire commençait à gronder, et le jeune homme
avait au cœur trop de générosité pour se résigner
à le contempler du rivage, sans tenter le salut de ceux qui allaient
sombrer dans la tourmente.
|
L’abbe René-Just Haüy

Charles-François
Lhomond
|
|
II.
LES JOURNÉE DE SEPTEMBRE — ADMIRABLE DEVOUEMENT DE GEOFFROY SAINT-HILAIRE
Désignés à la persécution
par leur caractère de prêtres, tous les professeurs du Collège
du Cardinal Lemoine furent arrêtés le 13 août 1792 et
enfermés dans l’église de Saint-Firmin, transformée en
prison.
La nouvelle de cette arrestation ayant été
portée à Geoffroy, il en ressentit une peine très vive,
car il avait conservé la. plus grande affection pour ses anciens maîtres.
En particulier, l’incarcération d’Haüy le frappa douloureusement,
et, sans perdre un instant, il mit tout en œuvre pour sauver l’excellent
homme. Il court chez Daubenton, et, tandis que celui-ci tente d’intéresser
ses amis à la cause du professeur, il multiplie les démarches
auprès des autres membres de l’Académie des sciences; il obtient
qu’Haüy, qui, à cette époque, en faisait déjà
partie, sera réclamé au nom de ce Corps.
Le résultat souhaité couronne
enfin tant d’efforts. Le lendemain, à 10 heures du soir, un ordre
d’élargissement est signé. Geoffroy se fait ouvrir les portes
de la prison, pénètre jusqu’auprès d’Haüy, et
veut l’entraîner. Mais il se heurte à une invincible opposition,
dont les motifs doivent faire reporter sur la grandeur d’âme du maître
une partie de l’admiration qui s’attache à l’acte courageux du disciple.
«Ces grands hommes, disait Fontenelle,
sont des enfants.» A la plus grande pénétration de l’esprit,
Haüy joignait la plus grande simplicité du cœur. Oublieux des
dangers que courait sa propre existence, sa seule souffrance, en ces cruelles
conjonctures, était d’avoir vu ses chères collections profanées
par la main brutale des agents qui avaient opéré des perquisitions
dans sa cellule avant de l’arrêter.
Il avait demandé et obtenu que ses échantillons
minéralogiques fussent transportés dans sa prison, et là,
plein de sérénité au milieu des clameurs de mort, il
s’occupait à y rétablir cet ordre savant dont il n’avait encore
consigné les règles nulle part, et dont il eût emporté
le secret sur l’échafaud.
Surpris par Geoffroy au cours de celte besogne,
Haüy n’accorde qu’une attention secondaire à la nouvelle que
la liberté lui est rendue. Il se refuse à quitter sa prison
tant qu’il n’aura pas remis en ordre ses matériaux, que d’ailleurs
on ne saurait transporter à cette heure avancée. De plus, le
lendemain étant la fête de l’Assomption de la Sainte Vierge,
il déclare qu’il ne sortira point sans avoir entendu la messe.
Ainsi fut fait, et, dans la matinée du
15 août, Haüy, ayant assisté au Saint Sacrifice, alla
retrouver sa petite cellule.
Au Collège Lemoine, il rencontra Lhomond,
qui venait d’être sauvé, lui aussi, par la reconnaissance d’un
ancien élève, Tallien. Mais les autres professeurs ne devaient
pas revoir leurs cellules on était à la veille des horribles
massacres de Septembre.
Geoffroy, cependant, ne demeurait pas inactif,
et, ne pouvant rien obtenir des Pouvoirs publics, il imagina un plan d’évasion
qui devait permettre aux captifs d’échapper à la mort. Le 2
septembre, sous le déguisement d’un commissaire des prisons, il put
pénétrer dans l’église Saint-Firmin, où ils
étaient détenus, et qui était voisine de son habitation.
Là, il fait part à ses anciens
maîtres des moyens qu’il a préparés pour assurer leur
fuite; mais il rencontre une résistance que ses prières ne
peuvent vaincre. En ces temps de troubles et de carnage, les âmes vertueuses
luttaient entre elles de générosité le sang des victimes,
comme une rosée [p.5] féconde,
faisait éclore partout les fleurs expiatoires du dévouement
et du sacrifice.
Tous les professeurs du Collège se refusent
à tenter l’évasion qui leur est proposée, et l’un d’eux,
l’abbé de Kéranran, fait à Geoffroy cette belle réponse:
«Non, nous ne pouvons quitter nos frères, car notre délivrance
n’aurait d’autre résultat que de rendre leur perte plus certaine!»
Désolé par ce refus sublime, mais
non découragé cependant, espérant toujours qu’un revirement
se fera dans l’âme des prisonniers ou que des circonstances imprévues
aplaniront les difficultés, Geoffroy se retire. Il attend la nuit,
et, dès que la rue est devenue silencieuse et obscure, il se rend
avec une échelle à Saint-Firmin, à un angle de mur qu’il
a le matin même, afin de tout prévoir, indiqué à
l’abbé de Kéranran et à ses compagnons.
De longues heures se passent, et, sur la crête
du mur, personne n’apparaît. Enfin, presque au matin, un prêtre
se montre, et il est bientôt hors de la fatale enceinte. D’autres lui
succèdent, et sont aussi délivré; l’un d’eux, en enjambant
le mur avec trop de précipitation, tombe sur le sol et se blesse
au pied. Geoffroy le prend sur ses bras, le porte dans un chantier voisin,
puis il revient au poste qu’il s’est assigné, et continue son courageux
sauvetage.
Douze prêtres avaient été
ainsi arrachés à une mort trop certaine, lorsqu’un coup de
fusil fut tiré du jardin sur Geoffrov, qui, tout entier à sou
œuvre de dévouement, ne s’apercevait pas que le soleil venait de
se lever.
La balle se perdit dans ses vêtements;
mais, à la fois désespéré et heureux, il dut
descendre de son échelle et rentrer chez lui.
Aucun de ses anciens maîtres n’avait tenté
de s’échapper; au rendez-vous convenu entre le libérateur et
les prisonniers, suivant l’expression d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui
nous a transmis le souvenir de l’admirable dévouement de son père,
le libérateur seul était venu. Tous furent massacrés
dans les sanglantes journées de Septembre.
|

Joseph Lakanal
|
III. AU JARDIN DES PLANTES — PROFESSEUR A VINGT ET UN
ANS
Épuisé par d’aussi violentes secousses,
Geoffroy se retira dans sa famille, à Etampes; il y tomba malade.
Durant son absence, les amis qu’il avait laissés à Paris trouvaient,
au milieu des angoisses de cette période cruelle, une consolation
dans son souvenir, et s’occupaient à assurer sa carrière.
Haüy lui écrivait: «Dès
votre lettre reçue, j’en ai fait part à M. Lhomond. Nous n’avions
jamais été si gais depuis que vous n’êtes plus avec nous.»
Et, en même temps, il le recommandait de tout son pouvoir à
Daubenton: «Aimez, adoptez mon jeune libérateur!» Daubenton,
qui avait vu Geoffroy à l’œuvre, ne demandait qu’à aplanir
pour lui les obstacles du début; à sa sympathie venait d’ailleurs
s’ajouter ce désir presque instinctif qu’éprouvent les vieillards
de se survivre en la personne de ceux qui continueront la tâche dont
ils ont assumé les premiers labeurs.
Effrayé des excès de la Terreur,
et craignant d’être compromis par une situation qui le mettait en vue,
Lacépède venait de donner sa démission du poste de
garde du cabinet de zoologie qu’il occupait au Jardin des plantes. Daubenton
demanda et obtint la place pour Geoffroy.
A peine installé, celui-ci, fidèle
à ce besoin de dévouement qui lui avait fait braver la mort
dans les journées de Septembre, ouvrit son logement aux proscrits
de tous les partis. Ce logement, qui communiquait avec les catacombes, et
offrait ainsi une retraite sûre, servit d’asile, entre autres, à
Roucher, l’auteur des Mois. Mais le poète ne devait pas, cependant,
éviter l’échafaud: soit ennui, soit crainte de compromettre
son hôte, il quitta son abri, et fut presque immédiatement
arrêté. Quelques jours avant le 9 thermidor, il prit place sur
la funèbre charrette, en compagnie du fils de Buffon et d’André
Chénier.
Créé par Louis XIII, accru par
Louis XIV, illustré par les travaux de Buffon, le Jardin des plantes
était devenu le centre de l’histoire
[p.6] naturelle moderne; depuis lors, ce rôle ne lui
a jamais été contesté. En 1790, des améliorations
considérables furent introduites dans l’organisation de l’établissement,
sur les plans que Daubenton vint présenter à l’Assemblée
constituante, et où il développait simplement les idées
du grand naturaliste dont il était le continuateur.
Deux ans plus tard, Bernardin de Saint Pierre,
homme doux et pacifique, nommé, malgré le contraste de son
caractère avec la férocité sanglante de cette époque,
intcndant du Jardin des plantes, réclama la création d’une ménagerie.
Il rappelait que Buffon avait longtemps désiré celle de Versailles,
et il ajoutait, en parlant de l’illustre savant, cet argument: «Ses
remarques les plus utiles lui ont été inspirées par
les animaux qu’il avait lui-mêmc étudiés, et ses tableaux
les mieux coloriés sont ceux qui les ont eus pour modèles:
car les pensées de la nature portent avec elles leur expression.»
Au mois de juin 1793, le Jardin des plantes
reçut, par un décret de la Convention, le nom, de forme antique,
de Muséum d’histoire naturelle. On y étendit l’enseignement
à toutes les branches des sciences biologiques, et le nombre des
chaires fut porté de trois à douze. Parmi les chaires nouvelles,
deux étaient réservées à la zoologie; l’une
fut donnée à Lamarck, et Daubenton proposa Geoffroy pour l’autre,
que l’on voulait attribuer à Pallas.
Geoffroy avait à peine vingt et un ans,
et on hésitait à lui confier le poste de professeur; mais Daubenton
se porta garant de l’avenir, en se basant sur la passion du travail qui
dévorait le jeune homme. Celui-ci, de son côté, éprouvait
quelque scrupules à assumer pareille tâche. Son protecteur
le rassura: «Je prends sur moi la responsabilité de votre inexpérience;
j’ai sur vous l’autorité d’un père: osez entreprendre d’enseigner
la zoologie, et qu’un jour on puisse dire que vous en avez fait une science
française!»
Jusque-là exclusivement minéralogiste,
Geoffroy connaissait à peine les premiers principes de la science
qu’on le chargeait de professer. Il se trouva d’abord dans le plus grand embarras,
qu’il n’hésitait pas d’ailleurs, à avouer: «Tenu de tout
créer, j’ai acquis les éléments de l’histoire naturelle
en rangeant et en classant les collections qui étaient confiées
à mes soins.»
Cependant, il n’en monta pas moins résolument
dans sa chaire, et commença un cours sur l’histoire des oiseaux et
des mammifères. Sa première leçon débuta par
un exorde dans le goût de l’époque: «Citoyens, dit-il,
pendant que nos frères d’armes vont cimenter de leur sang les bases
de notre république, nous, dans le silence de l’étude, nous
allons conquérir de nouvelles connaissances afin d’ajouter un rayon
de plus à la gloire nationale.»
Les collections dont disposait le jeune professeur
corroborer ses enseignements par des exemples pratiques ne se composaient
que de débris misérables. La seule ménagerie qui eût
jusque-là existé en France était celle de Versailles.
Il eût été fort simple de la transférer au Jardin
des plantes; mais, dans les journées qui suivirent le 10 août,
le peuple, égarant sa colère sur tout ce qui se rattachait
à la royauté, massacra presque tous les animaux qui composaient
cette ménagerie.
La plupart des quadrupèdes et des oiseaux
furent immolés, et leurs restes servis en un repas civique: la gent
populaire épargna toutefois, les estimant sans doute trop coriaces,
un rhinocéros et quelques lions. Désireux de les soustraire
au sort de leurs compagnons, Bernardin de Saint-Pierre vint plaider la cause
des pauvres bêtes à la barre de la Convention nationale; son
discours, pitoyable et pathétique, avait pour épigraphe: Miseris
succurrere disco. Plus heureux que tant d’autres, qui perdirent leurs
clients sans toujours se sauver eux-mèmcs, il gagna son procès,
et les débris de la ménagerie royale s’en vinrent former le
noyau de la collection du Muséum.
Celle-ci devait bientôt s’accroître
de quelques ménageries ambulantes que la police, dans l’intérêt
de la sûreté et de la salubrité [p.7] publiques, avait fait saisir.
Un matin, on vient annoncer à Geoffroy Saint-Hilaire, à qui
ces trésors étaient destinés, que des visiteurs peu
accommodants attendent à sa porte: un léopard, un ours blanc,
une panthère, plusieurs mandrills. Le Muséum n’a pas de local
pour abriter de pareils hôtes; Geoffroy les accepte cependant; il les
fait entrer dans l’établissement et attacher sous ses fenêtres.
Puis il court avertir ses confrères, et ceux-ci, peu rassurés
d’un tel voisinage, se hâtent d’aviser aux moyens d’enfermer solidement
ces richesses aussi précieuses que formidables.
C’est vers cette époque que l’abbé
Tessier, ayant rencontré Cuvier au fond de la Normandie et fait ainsi
«la meilleure de ses découvertes». écrivait à
Jussieu et à Geoffroy pour les prier d’ouvrir la carrière scientifique
à «ce nouveau Delambre». Il avait joint à ses
lettres quelques mémoires de son protégé; Geoffroy,
ayant lu les manuscrits, fut pris d’enthousiasme, et, sous l’empire d’une
inspiration généreuse, il écrivit immédiatement
à Cuvier: «Venez jouer parmi nous le rôle d’un Linné,
d’un autre législateur de l’histoire naturelle.»
Puis, comme Cuvier était sans ressources,
il s’occupa à lui chercher un poste qui pût lui permettre de
vivre à Paris. Il lui offrit de partager son logement, lui ouvrit
ses collections, et pendant plusieurs années, les travaux des deux
jeunes savants furent communs. Plus tard, séparés par leurs
opinions scientifiques, ils ne perdirent pas le souvenir de leur première
et confiante amitié, et ils aimaient à rappeler le temps heureux
«où ils ne déjeunaient jamais sans avoir fait une découverte».
Ici se place un trait qui, mieux que tout discours,
fait l’éloge de la délicate générosité
de Geoffroy.
Daubenton, Lacépède, Lamarck,
avaient fait à Cuvier un accueil sympathique; au contraire, Haüy
fit entrevoir à Geoffroy qu’en associant un étranger à
ses travaux il se préparait un rival qui peut- être l’éclipserait
et le dominerait. «Mais cet excellent jeune homme, nous dit Cuvier
lui-même, après avoir porté huit jours dans son sein le
trouble que ce conseil y avait fait naître, me le confia avec abandon,
et m’assura que sa conduite avec moi ne changerait pas.»
Ajoutons qu’Haüy n’en fut pas moins, dans
une large mesure, bon prophète.
|
|
IV. EXPÉDITION D’ÉGYPTE (1798-1802)
Cependant, l’apaisement des passions politiques
commençait à se faire, et aux jours de terreur avaient succédé
des jours de gloire. On savait qu’une grande expédition se préparait,
et qu’elle serait militaire et scientifique, mais son but demeurait secret.
Seul, Berthollct, chargé de choisir pour l’accompagner les savants
les plus résolus et les plus éclairés, était
dans la confidence.
Cuvier fut pressenti; mais, peu soucieux sans
doute d’affronter des dangers dont il s’était déjà
soigneusement garanti pendant la Révolution, en se retranchant derrière
sa qualité d’étranger, il déclina la proposition, et
demanda que Savigny fut pris en sa place. Il avait à Paris assez de
matériaux pour réaliser les travaux qui devaient le conduire
à la gloire; et, voyant déjà la fortune lui sourire,
il préférait l’attendre tranquillement dans son lit, laissant
aux autres le souci de courir après elle.
|
|
L’année 1798 venait de commencer. Les travaux de Geoffroy le portaient,
lui aussi, rapidement vers l’Institut, lorsque Berthollet vint lui dire:
«Venez avec Monge et moi; nous serons vos compagnons; Bonaparte sera
notre général (1).» Où allait-on? Il était
impossible de le révéler; mais, dans ce mystère même,
le jeune savant vit un attrait de plus, et la perspective d’une vie nouvelle,
de trouvailles fortuites et de périls inconnus, le séduisit.
Il se laissa embarquer: son étoile le conduisait en Egypte.
|
(1)
Napoléon Bonaparte, voir les Contemporains n°176-183.
|
Partie de Toulon le 19 mai, l’expédition parvint à Alexandrie
dans les premiers jours [p.8] de
juillet. A peine a-t-il touché la terre égyptienne, si fameuse
par son antique civilisation, que Geoffroy, emporté par l’enthousiasme
scientifique, veut tout voir, tout explorer. Il conduit ses fouilles partout:
dans le sol, dans les tombeaux, dans les ruines. Il descend dans les catacombes,
où dorment depuis de longs siècles des restes momifiés,
comme si leurs lointains contemporains les avaient accumulés là
pour éclairer la science moderne.
|
|
Fait curieux: il recueille des crocodiles, des ibis entièrement conservés,
des squelettes de bœufs, d’ichneumons; ces animaux, morts il y a trois mille
ans, sont absolument semblables à ceux qui représentent aujourd’hui
les mêmes espèces; et cependant, il se fera, quelques années
plus tard, le champion convaincu de l’hypothèse de la transmutation
des formes vivantes.
Voltaire avait dit d’Hérodote: «Ce
père de l’Histoire qui nous a fait tant de contes.» Geoffroy
semble avoir pris à tâche de justifier de cette calomnie, du
moins sur les points qui sont de son domaine, le plus ancien des observateurs.
Il établit, par exemple, que, conformément aux assertions de
l’historien grec, le crocodile est réellement, de tous les animaux,
celui qui, proportionnellement, naît le plus petit et devient le plus
grand, puisque, sorti d’un œuf qui mesure à peine 17 lignes, il atteint,
dans toute sa taille, jusqu’à 17 coudées; que sa mâchoire
supérieure et son crâne, soudés ensemble, se meuvent
sur l’inférieure; qu’un petit oiseau, une espèce de pluvier,
pénètre dans sa gueule, dévore les parasites qui s’y
logent, sans que l’énorme reptile songe à lui faire le moindre
mal; qu’enfin sa langue est courte et sans usage.
Dès son arrivée, Geoffroy s’était
attaché tout particulièrement à l’étude des poissons
du Nil et, parmi ces poissons, celui qu’il désirait surtout observer
était le silure électrique, ou malaptérure, que les
Arabes nomment tonnerre, par un ingénieux rapprochement de
ses décharges électriques et des effets de la foudre, Il ne
put s’en procurer qu’au mois d’avril 1801, alors que les événements
qui suivirent le départ de Bonaparte avaient déjà forcé
les savants français à s’enfermer dans Alexandrie.
C’est donc au milieu des périls d’un
siège, tandis que les boulets sifflaient autour de lui, que, nouvel
Archimède, il s’attaqua aux problèmes ardus qui le préoccupaient.
Moins heureux, cependant, il ne put pas s’écrier: Eurêka;
le lien secret qui unit au principe de la vie la production d’électricité
chez le malaptérure ne fut pas révélé à
ses méditations; et ce mystère, que les savants de nos jours
n’ont guère éclairci, demeura pour lui aussi impossible à
soulever que le voile d’lsis.
Il était tout enlier à ses travaux,
quand on vint lui annoncer qu’un article de la capitulation du 31 août
1081 abandonnait aux Anglais les richesses scientifiques recueillies par
les Français. Pris d’indignation, il tenta de faire annuler cet article.
Mais le général Hutchinson déclara qu’il exigerait la
stricte exécution des clauses de la capitulation, et Hamilton vint
de sa part annoncer à Geoffroy et à ses collègues que
toute démarche nouvelle serait inutile.
Alors, emporté par une inspiration énergique,
Geoffroy s’écria: «Eh bien, non, nous n’obéirons pas!
Votre armée n’entre que dans deux jours dans la place; d’ici là
le sacrifice sera consommé, et nous aurons nous-mêmes brûlé
nos richesses! Vous ferez ensuite de nous ce qu’il vous plaira!»
Les rôles étaient renversés:
c’était aux vaincus à menacer. Hamilton, pâle, silencieux,
semblait frappé de stupeur. «Nous le ferons, continua Geoffroy;
c’est à la célébrité que vous visez: comptez
sur les souvenirs de l’histoire! Allez dire à votre général
qu’il sera un autre Omar, et qu’il aura, lui aussi, brûlé une
bibliothèque dans Alexandrie!»
L’énergie de celte résolution
eut raison de l’insistance des Anglais. L’article 16 de la capitulation
fut annulé; et Geoffroy put rentrer en France, dans les derniers
jours de janvier 1802, chargé, comme autrefois Tournefort à
son retour de Grèce, des dépouilles de l’Orient.
|
|
V. MEMBRE DE L’INSTITUT — MISSION EN PORTUGAL
Ayant repris ses fonctions au Muséum,
Geoffroy se remit avec ardeur à ses recherches d’anatomie comparée,
qu’il ne devait plus guère interrompre. Il en fit connaître les
premiers résultats en 1807.
Cette même année, une place étant
de venue vacante à l’Académie des Sciences, il s’y porta candidat,
et fit, pour obtenir leurs suffrages, les visites requises aux membres de
la docte Assemblée. Ses biographes rapportent, à cette occasion,
une assez bizarre anecdote.
Il venait de remettre à Lagrange quelques
unes de ses mémoires et se disposait à prendre congé,
lorsque le célèbre géomètre lui dit:
«Approchez, jeune homme; que pensez vous
de votre concurrent?»
La question était embarrassante; Geoffroy
balbutia:
«Mais… je ne puis répondre; il
ne m’appartient pas de formuler une appréciation.
— Sans doute; mais ce que je demande peut être
dit même par vous. Je sais que c’est un très habile entomologiste.
Mais est-ce un Réaumur ou un Fabricius?
— C’est un Fabricius.
— Sachez, jeune homme, que j’estime plus quelques
pages comme celles que vous avez lues dernièrement à l’Académie
que beaucoup de volumes la manière de Fabricius.»
Réaumur s’était attaché
surtout à étudier les mœurs des insectes; Fabricius, au contraire,
décrivait leurs caractères et s’efforçait de classifier
leurs nombreuses espèces; l’un et l’autre ont donc rendu, à
des points de vue différends de grands services à la science.
L’opinion de Lagrange, toute personnelle, ne prouvait rien, par suite, contre
Fabricius.
Geoffroy n’en recueillit pas moins le bénéfice,
et, comme d’autres suffrages lui furent donnés, il fut nommé
membre de l’Institut le 14 septembre 1807. Cuvier lui offrit ses félicitations,
ajoutant: «Je suis d’autant plus heureux que je me reprochais d’occuper
une place qui vous était due…»
En mars 1808, Geoffroy fut chargé par
l’Empereur d’une mission scientifique en Portugal, que les armes françaises,
sous les ordres de Junot, occupaient depuis le mois de septembre de l’année
précédente. Cette mission avait surtout pour but de rapporter,
en vue d’enrichir nos collections, les objets précieux du Brésil
qui figuraient au musée de Lisbonne.
Accompagné de Delalande, son aide et
son secrétaire, le savant traverse, au milieu des plus grands périls,
l’Espagne soulevée contre l’invasion française. Aux environs
de Merida, il rencontre une dame dont la voiture avait versé sur la
route, et qui s’était légèrement blessée; il
lui prodigue ses soins, l’oblige à monter dans sa propre voiture, et
l’accompagne à pied, jusqu’à la ville. Là, il est arrêté,
retenu prisonnier pendant quelques jours, et enfin remis en liberté,
ainsi que Delalande, sur les instances de la dame qu’il avait secourue.
Désireux de ne pas dépouiller
les musées étrangers, et de ne rien acquérir que par
voie d’échange, il avait emporté de Paris plusieurs caisses
d’échantillons qui figuraient en double dans nos collections. Arrivé
à Lisbonne, il est accueilli avec joie par Junot, qu’il connaissait
pour avoir fait avec lui la campagne d’Egypte, et il est immédiatement
investi de pleins pouvoirs pour l’accomplissement de sa mission.
Loin d’abuser de sa puissance, cependant, il
s’attache à observer les plus grands égards envers le peuple
vaincu.
Il commence par réintégrer dans
sa chaire le professeur Brotero, botaniste distingué de l’Université
de Coimbra; il rappelle Verdier, exilé politique, membre de l’Académie
des sciences de Lisbonne et membre correspondant de l’institut de France,
et lui permet ainsi de revoir sa famille; il accorde la plus efficace protection
aux savants et aux littérateurs.
Il prend dans le musée de Lisbonne des
minéraux, des plantes, des animaux brésiliens: mais, en retour,
il classe suivant [p.10] les
principes scientifiques les échantillons qu’il laisse, et qui étaient
jusque-là en désordre; de plus, il enrichit les collections
du Portugal des nombreux spécimens qu’il a apportés de Paris.
Ce désintéressement, qu’on ne
saurait trop admirer, fut l’argument qu’il invoqua contre les Anglais pour
conserver ses acquisitions, lorsqu’ils en réclamèrent la remise
après la convention de Cintra.
C’était la deuxième fois qu’il
s’opposait victorieusement aux exigences de ce peuple, larron historique
dont le rôle a toujours été de s’approprier les conquêtes
réalisées
par les autres au prix de leurs peines, de leurs travaux, de leurs sacrifices
et de leur sang.
Geoffroy rapporta ses collections en France;
elles étaient si légitimement notre propriété
que, un peu plus tard, quand les nations nous reprirent les richesses que
nous leur avions enlevées au nom des lois de la guerre, le ministre
du Portugal déclara que son pays n’avait rien à réclamer.
La Faculté des sciences de Paris venait
d’être créée; en 1808, par décret impérial.
En 1809, Geoffroy y fut nommé professeur de zoologie et d’anatomie
comparée.
Par une délicatesse qui met une fois
de plus en relief la générosité de son caractère,
il ne voulut occuper son nouveau poste qu’après l’avoir offert à
Lamarck; celui-ci, fier dans sa pauvreté, refusa, les larmes aux yeux.
En possession d’une chaire qui lui donnait une
grande autorité dans le monde savant, entouré d’un auditoire
sympathique et enthousiaste, Geoffroy put désormais développer
librement les idées dont il avait seulement jusque-là indiqué
le germe.
Nous allons exposer ces idées en aussi
peu de mots que possible, et tracer rapidement les grandes lignes du débat
qu’il dut soutenir, pour les défendre, avec Cuvier. Ce dessein comporte
peut-être quelque aridité; nous nous en excusons à l’avance,
mais nous ne saurions nous y soustraire, si nous voulons faire le portrait
intégral de Geoffroy Saint-Hilaire.
|
|
VI. DOCTRINE SCIENTIFIQUE
Dès le début de sa carrière,
alors qu’il était astreint par les devoirs de son enseignement à
ne se préoccuper que des différences qui séparent les
animaux, Geoffroy Saint-Hilaire fut, au contraire en quelque sorte exclusivement
frappé de leurs ressemblances. A mesure que ses investigations embrassaient
une portion plus étendue de la série zoologique, il constatait
entre les divers types des rapports étroits les reliant les uns aux
autres; partout il retrouvait une structure et des organes analogues, modifiés
seulement dans leur aspect suivant le groupe envisagé. De là
à admettre que tous les êtres sont construits sur un plan primordial
que le Créateur a suivi constamment dans ses lignes essentielles,
en variant à l’infini les détails d’exécution, il n’y
avait qu’un pas; et ce pas fut vite franchi.
A vrai dire, cette idée de l’unité
de composition n’était pas absolument nouvelle dans la science. Aristote
l’avait entrevue. En 1555, Pierre Belon faisait un rapprochement entre le
squelette de l’homme et celui de l’oiseau. Newton s’en préoccupe en
deux passages de l’Optique: «Cette uniformité que l’on
voit dans les corps des animaux»; et ailleurs: «Toutes les Parties
sont semblablement disposées chez presque tous les animaux.»
Buffon, dans l’article sur l’Ane, avait écrit «En créant
les animaux, l’Être suprême n’a voulu employer qu’une idée,
et la varier en même temps de toutes les manières.» Et,
dans le Discours sur les Singes. il insiste sur cette pensée:
«Ce plan, toujours le même, toujours suivi de l’homme aux singes,
du singe aux quadrupèdes, des quadrupèdes aux cétacés,
aux oiseaux, aux poissons, aux reptiles…..»
Après Buffon, Camper et Vicq-d’Azyr entrevirent
aussi l’unité de plan. Mais il était réservé
à Geoffroy Saint-Hilaire de bâtir, sur ce principe, une science
neuve, originale, à laquelle nul avant lui n’avait songé, l’anatomie
philosophique. A l’inverse [p.11] de
Cuvier, qui ose à peine dégager des faits leurs conséquences
générales les plus évidentes, lui, dominé par
ses vues théoriques, part de l’idée pour chercher dans les
faits un appui et un argument.
Tous les êtres vivants, réalisés
suivant une conception unique, munis des mêmes organes, accomplissant
les mêmes fonctions, sans autres modifications que celles qui résultent
d’un équilibre avec leur genre de vie spécial, voilà
la proposition générale à laquelle l’ont conduit ses
premiers travaux. Sa carrière scientifique tout entière aura
pour but la démonstration expérimentale de ce principe. Aussi
toutes ses recherches d’anatomie sont-elles des recherches d’analogie.
A peine a-t-il entrepris cette tâche qu’une
difficulté se présente. L’étude comparée du crâne
chez le crocodile et chez le quadrupède lui montre que cette partie
du squelette comprend, pour le premier, plus de vingt os, et dix au plus
pour le second. Voilà l’unité de composition en déroute!
Mais un trait de génie vient lui permettre de prouver qu’il ne s’est
point trompé: il prend le crâne d’un mammifère avant
sa naissance, et il reconnaît, bien séparés, les mêmes
os que chez le crocodile, os dont le nombre se trouve réduit chez
le quadrupède adulte, parce que plusieurs se soudent entre eux à
mesure que l’individu avance en âge.
Dégagée de tout élément
accessoire, la doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire peut se résumer
ainsi: Tous les animaux ont été créés sur un type
uniforme, renfermant en principe tous les organes et toutes les fonctions
réalisés dans la série zoologique. Les différences
qui séparent leurs diverses espèces tiennent uniquement au degré
de développement de chaque organe, et, par suite, de chaque fonction.
Telle partie se trouve ici pleinement différenciée, ailleurs
seulement indiquée. La nature ne forme jamais de nouveaux organes
en vue de nouvelles fonctions à remplir; féconde en modifications,
elle les produit exclusivement en atrophiant ou en développant les
organes, suivant le degré d’utilité que leur assigne le genre
de vie de l’animal.
Convaincu que l’organe n’est point créé
en vue de la fonction, Geoffroy était absolument opposé à
la théorie philosophique des causes finales: «Je ne connais
point, disait-il, d’animal qui doive jouer un rôle dans la nature.»
Et il ajoutait «Chaque être est sorti des mains du Créateur
avec ses propres conditions: il peut selon qu’il lui est attribué
de pouvoir; mais c’est une erreur de croire que les organes aient été
formés en vue de fonctions à remplir.»
De telle manière que cet esprit éminent,
à qui ses études avaient montré dans la création
un ordre impeccable et digne d’admiration, arrivait, en poussant à
l’extrême les conséquences de ses principes, à la conclusion
absurde que le hasard seul maintient l’harmonie universelle. Si, par exemple,
le jeune oiseau, à un moment toujours le même, s’échappe
de son nid et se soutient dans les airs, c’est que, grâce à
un avantage constant, mais purement fortuit, il possède des ailes;
mais nulle providence ne l’a doué intentionnellement de ces membres.
C’est presque du pur atomisme; et Lucrèee,
après Epicure, n’avait guère parlé autrement, lorsqu’il
proclamait, en vers, cette matérialiste assertion: Rien n’a été
formé dans notre corps avec une destination définie; tout organe
engendre sa fonction par le fait seul qu’il existe:
Nil ideo quoniam natum est in
corpore ut uti
Possemus, sed quod natum est, id procreat
usum.
En réalité,
cependant, quand Geoffroy se laissait entraîner à de pareilles
conclusions, l’expression dépassait sa pensée, et le désir
de rester strictement confiné dans l’examen du fait matériel
et de sa résultante nécessaire le jetait hors de ses propres
convictions.
S’il fallait donner une preuve de cette révolte
de ses idées intimes contre la thèse qu’il croyait devoir soutenir
par sincérité scientifique, on pourrait invoquer le fait qu’il
a défendu, avant et avec Lamarck, la théorie de la filiation
indéfinie des espèces par voie de transmutation. Or, dans
cette [p.12] théorie, à
laquelle Darwin devait donner tant de célébrité, et
qui a provoqué depuis lors de si ardentes polémiques, la part
faite au hasard est extrêmement réduite. Ni la lutte pour la
vie, ni la sélection naturelle, ni les tendances intimes des êtres
à la variation, ni l’influence du milieu, ne relèvent du hasard;
et ce sont là précisément les grandes causes invoquées
par Lamarck et Darwin pour expliquer l’évolution des formes vivantes.
Les transformistes vous diront que si l’oiseau
a des ailes, c’est parce que l’ancêtre non ailé d’où
il est issu a senti peu à peu naître en lui l’aptitude au vol,
et que ses membres supérieurs se sont progressivement modifiés
pour lui permettre de réaliser cette aptitude; mais jamais ils ne
s’aviseront de dire que l’oiseau a reçu des ailes par hasard, et que
s’il vole, c’est pour s’être aperçu un beau jour qu’il était
muni d’organes lui permettant d’entreprendre la conquête de l’air.
Voilà donc Geoffroy Saint-Hilaire pris
en flagrant délit d’inconséquence: d’un côté,
il repousse la théorie finaliste, l’estimant contraire aux conséquences
logiques des faits qu’il observe; de l’autre, il soutient l’unité
de composition du règne animal et la transmutation des formes vivantes
les unes dans les autres, et il admet par suite des lois organisatrices définies,
positives, étrangères à toute intervention fortuite.
Cette inconséquence d’ailleurs n’est pas à son désavantage,
puisque c’est par amour de la vérité qu’il s’efforçait
de se mentir à lui-même.
|
|
|
VII.
GEOFFROY ET CUVIER
Une grave et longue maladie qui l’atteignit
en 1812, les désastres cruels qui frappèrent la France en
1813, interrompirent les travaux scientifiques de Geoffroy Saint-Hilaire.
En 1815, d’autres devoirs, d’ordre politique, le tinrent encore éloigné
de la science: il fut nommé représentant par les électeurs
d’Etampes, et fit partie de la Chambre des Cent-Jours. La seconde Restauration
vint lui rendre sa liberté et lui permettre de reprendre ses études.
C’est en 1818 qu’il publia le grand ouvrage
où sont exposées les vues qu’il caressait depuis 1795, et
qu’il avait, à différentes reprises, indiquées dans
ses cours. Le titre complet du livre était celui-ci: Philosophie
anatomique. Des organes respiratoires sous le rapport de la détermination
et de l’identité de leurs pièces osseuses.
Sous ce titre étaient réunis quatre
Mémoires, précédés d’un Discours préliminaire,
où se trouvent développés la loi de l’unité de
composition et les principes secondaires qui se greffent sur cette hase.
L’auteur y annonçait en ces termes le but de son œuvre: «La prévision
à laquelle nous porte cette vérité, c’est-à-dire
le pressentiment que nous trouverons toujours, dans chaque famille, tous
les matériaux organiques que nous aurons aperçus dans une autre,
est ce que j’ai embrassé dans le cours de mon ouvrage sous la dénomination
de Théorie des analogues.»
Dans cette première phase de la lutte
qu’il allait soutenir contre les idées de Cuvier, Geoffroy n’appliquait
encore sou principe qu’aux seuls animaux à vertèbres, et, ainsi
limitée, sa théorie était inattaquable. Cuvier lui-même
n’eût pu la contester, puisqu’il avait déjà réuni
tous ces animaux en un groupe unique.
Deux ans plus tard, Geoffroy voulut étendre
l’unité de structure aux articulés, c’est-à-dire aux
animaux qui, comme les insectes, les vers, sont constitués par des
séries d’anneaux placés bout à bout. Mais quels rapports
établir entre les vertébrés et ces êtres dégradés,
qui n’ont plus de vertèbres ni même d’os?
Plus d’os! C’est vrai si l’on s’en tient au
sens strict du moi; mais Geoffroy montre qu’ils ont des parties dures, qui
donnent attache aux muscles, enferment les viscères, constituent
un véritable squelette extérieur. Plus de vertèbres!
Mais cette division de leur corps en segments n’est-elle pas une image frappante
de la colonne vertébrale, partagée en noyaux superposés
dont chacun envoie des nerfs dans une région spéciale de l’organisme? [p.13]
Cependant Cuvier, qui avait reconnu dans le
règne animal quatre plans primordiaux, nettement séparés,
parallèles et ne se rejoignant en aucun point, commençait
à éprouver quelque secrète impatience de voir ce bel
ordre de sa classification menacé par les progrès d’une théorie
nouvelle, dont l’ingéniosité et la hardiesse avaient réuni
de nombreuses sympathies.
Le voile qui couvrait encore son mécontentement
se déchira lorsque, vers le commencement 1830, Geoffroy vint présenter
à l’Académie et soutenir devant la savante Assemblée
un mémoire de deux jeunes anatomistes, Laurencet et Meyraux, qui,
allant plus vite, sinon plus loin que le maître, étendaient aux
mollusques l’unité de composition.
La mesure était pleine, et ne devait pas tarder
à déborder. Le mémoire ayant été lu en
séance, Geoffroy fut, naturellement, chargé de faire le rapport,
et, huit jours après, le 15 février 1830, il en donna lecture
devant l’Académie. Il louait les auteurs d’avoir cherché à
démêler les transitions qui unissent les mollusques céphalopodes
aux vertébrés, et d’avoir ainsi contribué à combler
l’un des hiatus infranchissables qui partageaient les animaux en quatre
groupes sans souche commune. Et, tout en reconnaissant la sagacité
qui avait présidé à l’établissement de la classification
jusque-là adoptée, il laissait clairement entendre qu’une lumière
nouvelle devait remplacer cette doctrine désormais injustifiable
et surannée.
Devant cette attaque directe, Cuvier ne put
se contenir. Séance tenante, il répondit par improvisation
qui respirait le plus vif mécontentement; quelques jours plus tard,
il publiait un mémoire, riche en documents, où il s’attachait
à réfuter les assertions de Geoffroy. Dans ce mémoire,
il ne se bornait pas d’ailleurs à affirmer l’hiatus qu’il avait signalé
entre les mollusques et les vertébrés, mais il attaquait dans
son ensemble la Théorie des analogues.
Après avoir demandé à son
adversaire de définir exactement ce qu’il faut entendre par l’unité
de composition organique, Cuvier ajoutait: «Ne voulez-vous parler que
de simples ressemblances entre les animaux? Alors, vous dites une chose vraie
dans certaines limites, mais aussi vieille que la zoologie elle-même;
car, pour trouver l’origine de ce principe, il faudrait remonter jusqu’à
Aristote. Direz-vous que votre principe est unique, primordial et universel,
qu’il domine tous les autres faits? C’est là ce qu’on ne saurait admettre;
car, loin d’être unique et dominant, votre principe est subordonné
à un autre principe bien plus élevé et bien plus fécond.»
Or, cette loi générale plus féconde,
savez- vous comment Cuvier la définit lui-même? «Ce principe,
dit-il, c’est celui des conditions mêmes d’existence, de la convenance
des parties et de leur coordination pour le rôle que l’animal est appelé
à jouer dans la nature.»
Eriger en principe un simple concours de conditions
très diverses, mettre ces conditions au-dessus d’une loi organisatrice
simple et constamment respectée, c’était donner gain de cause
à l’adversaire. Sans différer, Geoffroy improvisa une réponse
qui lui assurait la victoire sur le point principal de sa théorie.
Cependant, si les quatre plans de Cuvier perdaient
du terrain aux yeux des savants comme du public, et tendaient à s’effacer
devant le plan unique de Geoffroy, le novateur emportait moins de suffrages
à l’égard des théories qu’il croyait pouvoir dégager,
comme des corollaires nécessaires, de sa loi primordiale. Les causes
finales et l’invariabilité des espèces, qu’il attaquait ardemment,
furent non moins habilement défendues par Cuvier, et celui-ci, en
réalité, demeura vainqueur sur deux des trois questions capitales
controversées dans ce mémorable débat.
La lutte se prolongea pendant plusieurs séances
de l’Académie, et, légèrement ironique, Geoffroy ne
put s’empêcher de féliciter l’Assemblée de donner accès
enfin à des discussions dignes de la préoccuper, au lieu
de se borner à enregistrer de menus faits, de valeur insignifiante,
germes non [p.14] viables de
prétendues découvertes tombées dès le lendemain
dans l’oubli.
Le tempérament différent des deux
champions se manifestait par le ton spécial que chacun donnait à
sa polémique. Cuvier, plus froid et plus calme, mesuré dans
ses paroles, discutait les faits pied à pied, méthodiquement;
au contraire, Geoffroy s’abandonnait aux envolées soudaines et entraînantes,
aux idées originales et hardies; une conviction passionnée
se faisait jour dans ses répliques, qu’il colorait des plus brûlantes
images.
Tandis que Cuvier déclarait n’être
point de ceux qui, «au lieu de s’en tenir aux faits positifs, et de
se servir du langage simple et des mots propres, emploient des métaphores
et des figures de rhétorique; qui croient se tirer d’embarras par
un trope [sic] ou par une antonomase»,
son adversaire montrait que les purs classificateurs qui glorifiaient Linné
pour abaisser Buffon n’avaient été suivis par l’opinion publique:
«Cris impuissants! Vaines protestations! Les éditions de l’Histoire
naturelle ne s’en succèdèrent pas moins coup sur coup,
comme autant de monuments élevés à la gloire de ce
grand homme: tant il est vrai que, pour exprimer de grandes choses et pour
vivre dans la mémoire des hommes, il faut que l’âme s’élance,
qu’elle imprègne la pensée d’imagination, d’idéal et
de poésie!»
Le débat ne tarda pas à franchir
les portes de l’Académie, et à émouvoir l’opinion non
seulement en France, mais dans tous les pays où il se trouvait des
penseurs pour méditer sur de pareils sujets. On eût pu se croire
revenu au temps antique des luttes philosophiques, qui passionnaient le monde.
Les savants prirent parti: ceux que touchait davantage le progrès
sévère et lent, mais précis, des sciences, se rangèrent
du côté de Cuvier; les esprits hardis se tournèrent vers
Geoffroy.
|
|
Du fond de l’Allemagne, le vieux poète Goethe (1), qui avait, lui
aussi, pressenti, mais avec moins de clarté, l’unité de composition
organique, applaudissait aux idées nouvelles. En 1830, il écrivait,
pour affirmer cette sympathie, les Dernières pages de Goethe,
expliquant à l’Allemagne les sujets de philosophie naturelle controversés
au sein le l’Académie des sciences de Paris.
|
(1) Gœthe, voir Contemporains,
n°415.
|
Eckermann raconte comment, au mois de juillet de cette année, féconde
en péripéties politiques, le poète, le rencontrant fortuitement,
lui dit:
«Vous connaissez les dernières
nouvelles de France; que pensez-vous de ce grand événement?
Le volcan a fait éruption; il est tout en flammes.
— C’est une terrible histoire, répondit
Eckermann; et, au point où en sont les choses, on doit s’attendre
à l’expulsion de la famille royale.»
Et Gœthe de s’écrier:
«Il s’agit bien de trône et, de
dynastie, il s’agit bien de révolution politique! Je vous parle de
la séance de l’Académie des Sciences de Paris: c’est là
qu’est le fait important, et la véritable révolution, celle
de l’esprit humain.»
|
|
|
VIII.
DERNIÈRES ANNÉES
La vie de Geoffroy Saint-Hilaire, autant que
nous pouvons l’apprécier d’après les détails que l’histoire
nous a transmis, semble avoir gravité autour de deux mobiles principaux,
que l’on trouve à la base de tous ses actes: l’homme obéissait
constamment à une générosité qui le poussait
à se faite le défenseur des opprimés, des faibles, des
persécutés; le savant, épris de gloire, demandait toutes
les émotions de sa vie à sa foi scientifique, qu’il jugeait
infaillible et qui ne s’est point démentie un seul instant.
Nous l’avons vu sauver des prisonniers sous
la Terreur, offrir un abri aux proscrits, favoriser les débuts de
Cuvier, dans lequel il pouvait cependant entrevoir un rival, tenir tête
énergiquement aux prétentions des Anglais en Egypte, respecter
en Portugal les droits du vaincu, offrir à Lamarck la chaire qui
lui était donnée à lui-même.
|
|
La révolution de Juillet, qu’il approuvait
[p.15] d’ailleurs, lui fournit une occasion nouvelle de se
dévouer. Dès les premiers symptômes de l’orage, l’archevêque
de Paris, Mgr de Quélen (1), voyant ses jours menacés, s’était
retiré à l’hospice de la Pitié. Geoffroy, dont l’habitation
était voisine, instruit des dangers que courait le prélat,
vint le chercher, et l’obligea doucement à le suivre dans son logement
du Jardin des plantes. Comme un de ses amis lui faisait remarquer que son
actc d’humanité pouvait entraîncr pour lui des conséquences
cruelles, il répondit en souriant: «Passez-moi encore celui-ci,
je suis coutumier du fait.» Son repentir, on le voit, n’était
pas très sincère.
|
(1) Mgr de Quélen, voir Contemporains, n°270.
|
Mgr de Quélen quitta son asile le 14 août, quand l’ordre fut
rétabli. Geoffroy avait quelques raisons de ne pas oublier cette date;
c’était le 14. août aussi qu’il avait obtenu la liberté
d’Haüy.
Son admiration ardente pour les sciences, qu’il
jugeait sans bornes et seules dignes des préoccupations des hommes,
le soutenait dans la réalisation de ses travaux, auxquels il demandait
d’ailleurs une réputation dont il avait soif; il aimait la gloire,
et ne s’en taisait point.
La gloire répondit à son appel;
elle vint, accompagnée de toutes les satisfactions qu’il souhaitait.
L’Empereur l’avait décoré de sa main lors même de la
création de l’Ordre de la Légion d’honneur. Toutes les Académies
le comptèrent dans leur sein. Des savants étrangers entreprirent
le voyage, on pourrait presque dire le pèlerinage de Paris, uniquement
pour le voir. Les disciples accouraient de toutes les contrées se
presser autour de sa chaire.
Sou seul délassement, au milieu de ses
occupation, était de s’abandonner aux joies de la famille, aux douces
affections qui l’entouraient. De ce côté, nulle ombre ne troublait
son bonheur. Il avait épousé Mlle Brière de Mondétour,
fille d’un receveur général des économats sous Louis
XVI; elle lui avait donné une fille, consolation de ses vieux jours,
et un fils, Isidore, qui devait par la suite, non sans succès, continuer
les travaux de son père.
Dès l’enfance de ce fils, il avait reconnu
en lui, avec bonheur, un esprit élevé, auquel il pourrait plus
tard confier le soin de développer ses doctrines, et de conserver
la gloire qui s’attachait à son nom. «Jugez, disait-il un jour
à un ami, si je suis heureux: voici les plus chers trésors de
mon fils.» Et ce disant, il ouvrait une armoire où l’enfant avait
religieusement réuni tous les écrits publiés sur les
travaux de son père.
Cependant les années s’écoulaient,
et un peu d’amertume devait se mêler à cette existence jusque-là
presque exempte de nuages.
Après la mort de Cuvier, survenue en
1832, Geoffroy voulut continuer les travaux de ce savant sur les êtres
fossiles et les révolutions du globe. Mais il fut aussitôt
accusé de vouloir attenter à la gloire du grand homme, et
il dut renoncer à persévérer dans son dessein. Ce qu’il
ne qu’il ne fit pas d’ailleurs sans quelque révolte: «Le mieux,
je le sens, dit-il, serait d’avoir le courage ou la sagesse de ne tenir aucun
compte de ces obstacles. Oui, peut-être, mais il s’agissait ici d’une
gloire française, du premier Zoologiste de notre âge!»
Et, mélancoliquement, il ajoutait: «C’est
à la postérité, si elle daigne s’occuper des luttes
de cet âge, de faire leur part à mes adversaires et à
moi: j’ai le corps inclinant vers la tombe; je n’attendrai point longtemps.»
Un plus grand chagrin lui était réservé.
La direction de la ménagerie qu’il avait créée lui fut
ôtée et donnée à Frédéric Cuvier,
frère du grand naturaliste, que celui-ci avait appelé auprès
de lui. Toutefois, Frédéric ne jouit pas longtemps de la faveur
qu’on lui faisait; il mourut six mois après avoir pris possession
de sa place, et l’administration du Muséum se hâta de rétablir
Geoffroy Saint-Hilaire dans un poste qu’il avait si dignement occupé
de 1794 à 1828.
Les années de Geoffroy ont été
abrégées par le travail incessant de sa pensée, consumées
pour ainsi dire par le feu de son [p.16] imagination
toujours active. Il n’avait pas assez des jours pour se livrer à
son labeur; sa passion pour la science et son désir de gloire le tenaient
éveillé jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Il avait fait construire et placer près de son lit une armoire dans
laquelle, mystérieusement, étaient enfermés une lampe,
du papier, des plumes; à l’insu de sa famille, alors que chacun se
livrait au sommeil, il ouvrait son armoire, prenait ses cahiers, et, assis
sur son lit, il méditait, il imaginait, il écrivait.
Ces travaux spéculatifs, qui, ne portant
point sur une base purement matérielle, exigeaient une constante tension
de l’esprit, en même temps qu’ils fatiguaient les yeux, précipitèrent
rapidement la cécité dont il était menacé. Il
devint complètement aveugle.
Le spectacle de la nature qu’il avait tant contemplé,
tant admiré, tant étudié, déroba pour toujours
à son regard, et, comme Milton, il put amèrement s’écrier:
Mes yeux cherchent en vain les
fleurs fraîches écloses;
Mes printemps sont sans grâce et
mes étés sans roses;
Tout est vague, confus, couvert d’un voile
épais,
Et, pour moi, le grand livre est fermé
pour jamais.
Mais sa douleur
trouva la plus réconfortante consolation dans I’affection pieuse
des siens, qui le soutint au milieu de ces cruelles épreuves. Il
n’eut pas à demander, pour continuer ses travaux, le secours d’une
main étrangère; sa fille, nouvelle Antigone, ne voulut point
céder à d’autres le soin de guider ses pas, et d’écrire
sous sa dictée les dernières inspirations de son génie.
Le souvenir de ses études contribuait
aussi à maintenir la sérénité dans soit esprit:
«Je cherche en vain la lumière, disait-il parfois à ses
amis, et cependant le spectacle des êtres animés est toujours
devant mes yeux.»
Ses disciples se réunissaient encore
souvent autour de lui, avides de recueillir ses conseils et ses derniers
enseignements; dans cette intimité, son cœur se réchauffait,
et il ne pouvait taire son bonheur: «Que de joie, s’écriait-il,
vous apportez à votre vieux maître! Je suis aveugle, et cependant
je me sens heureux!»
Il s’éteignit doucement, le 14 juin 1844;
les angoisses de l’agonie lui furent épargnées. Jusqu’à
la fin, la vive lumière qui éclairait ses souvenirs brilla
dans son esprit; en un suprême adieu, il serra la main de sa fille,
et lui dit: «Sois-en sûre, nous nous reverrons!»
Cet homme célèbre mourut fidèle
à la foi de son enfance, dit l’abbé Baraud dans son ouvrage:
Chrétiens et hommes célèbres au XIXe
siècle.
Dès 1794, inaugurant, au Muséum
d’histoire naturelle l’enseignement de la zoologie, il fit un discours
tendant à prouver que l’homme ne doit être compris dans aucune
classe d’animaux.
A la fin d’un chapitre de sa Philosophie anatomique,
on lit ces belles paroles: «Arrivé sur cette limite, le physicien
disparaît, 1’homme religieux seul demeure, pour partager l’enthousiasme
du saint prophète et pour s’écrier avec lui: Cœli enarrant
gloriam Dei…. Laudemus Dominum.»
|
|
|
BIBLIOGRAPHIE
SARRUT, Biographie d’Étienne Geoffroy
Saint Hilaire, Paris, 1839. — DE MERSEMAN, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire,
Bruges, 1844. — ISIDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Vie, travaux et doctrine
scientifiques d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Paris, 1847. —
PARISET, Histoire des membres de l’Académie royale de médecine,
Paris, 1850. — JOLY, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Paris,
1856. — FLOURENS, Eloges historiques lus dans les séances de l’Académie
des sciences, Paris, 1856. — FRÉDÉRIC DUBOIS, Eloge
de Geoffroy Saint-Hilaire, in Mémoires de l’Académie
impériale de médecine, Paris, 1859. — DUCROTAY DE BLAINVILLE,
Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, Paris, 1890. — Abbé
BARAUD, Chrétiens et hommes célèbres au XIXe siècle.
— MICHAUD, Biographie universelle. — Nouvelle biographie générale
(Didot). — Revue indépendante, Analyse des travaux d’Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire, par le Dr PUCHERAN (août-septembre 1845).
|
|
Imprimerie P. FERON-VRAY, 3 et 5,
rue Bayard, Paris, VIIIe. — Le gérant: E. PETITHENRY.
|