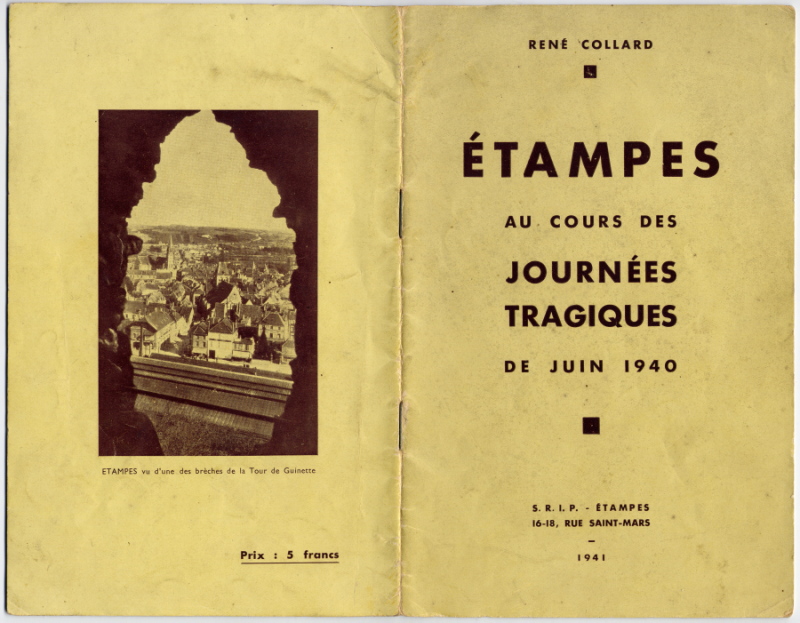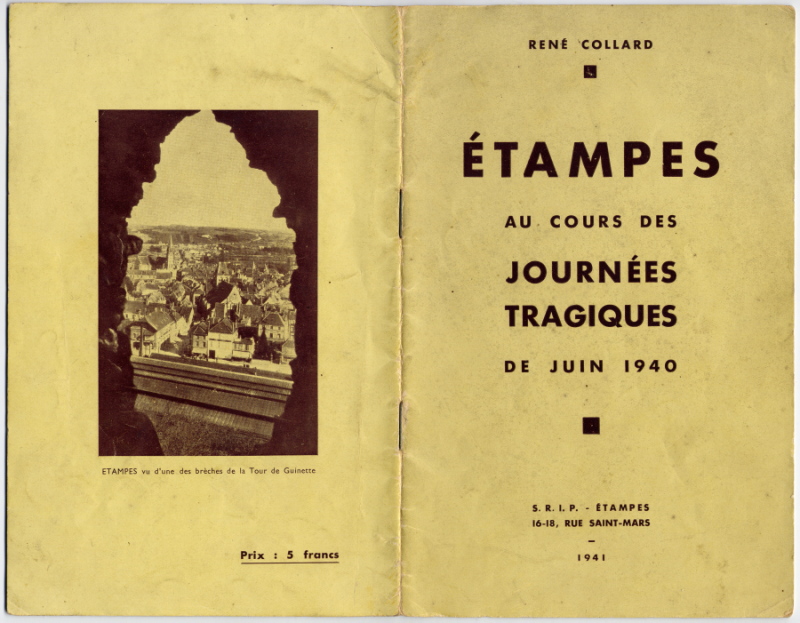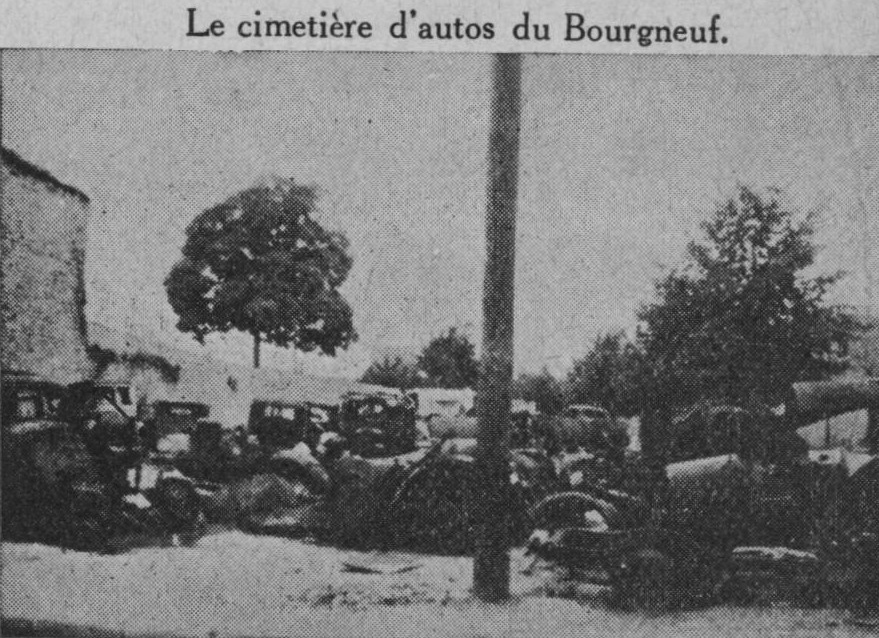Remarque:
Dans cette édition, on marque en vert
ce qui était dans l’édition de 1941
et qui a été soit supprimé ou corrigé dans la
suivante, et on marque en bleu ce qui
n’existe que dans l’édition de 1944.
[(1941:) Ce qu’on va lire n’est qu’un résumé succint
des principaux événements qui se déroulèrent
dans notre ville au cours de la mi-juin 1940. Cette date restera dans
les annales tant nationales que locales comme la plus effroyable catastrophe
et la plus honteuse débâcle qu’ait jamais enregistrées
l’armée, le peuple et la France tout entière.]
[(1944:)
Voilà une date qui marquera dans les annales
nationales et locales comme la plus effroyable catastrophe et la plus
honteuse débâcle qu’aient enregistrées l’armée
et le peuple de France.]
Dès la fin du mois de mai, il faut
bien reconnaître qu’à l’optimisme béat engendré
par les nouvelles tendancieuses répandues dans le pays, aussi bien
par la grande presse que par les agences officielles d’information, nouvelles
qui consistaient à qualifier de «drôle de guerre»
les hostilités ouvertes depuis septembre 1939, succédait
maintenant une inquiétude chaque jour accrue.
|
On savait qu’en Norvège nous avions dû évacuer la
côte, un moment occupée. On apprenait, depuis, que la Hollande,
le Luxembourg et la Belgique n’avaient opposé qu’une inutile défense
à l’avance massive des armées du Reich et que ces trois
pays étaient envahis, comme l’avaient été quelques
mois plus tôt la Pologne et le Danemark. L’évacuation de Dunkerque,
malgré l’héroïsme dont certains de nos soldats avaient
fait preuve au cours d’un repli formidable et tragique, ne pouvait être
considéré comme un succès. Le changement du Haut Commandement,
passant des mains du général Gamelin en celles du général
Weygand dans un moment aussi grave, ne pouvait davantage laisser d’illusions
aux esprits réfléchis, qui envisageaient froidement la situation
et qui savaient dans quels abîmes de facilité, de paresse
et de désordre avait sombré le pays au cours des trois dernières
années.
|

Enfin, les interminables files de réfugiés belges, ardennais,
picards, alsaciens et lorrains dévalant sur nos routes; puis, au
début de juin, celles de l’Oise, de l’Aisne, de la Champagne et de
tant d’autres départements du Nord et de l’Est, ne pouvaient plus
laisser beaucoup d’espoir sur un arrêt possible de l’invasion.
Mais que fut-ce lorsqu’on
apprit que les armées allemandes [p.6]
s’étaient emparées [sic] de Calais, de Boulogne, d’Arras,
d’Amiens, que la majeure partie de la côte de la Manche n’était
plus sous le contrôle français et que la Basse-seine était
coupée dans le département de l’Eure, à peu de distance
de Seine-et-Oise!
On voyait, par
ailleurs, les grandes banques, les grandes administrations, les grandes
maisons de commerce évacuer leurs archives, leurs fonds et même
leur personnel; on voyait passer d’énormes camions transportant à
l’arrière du matériel provenant des principales usines de
la banlieue de Paris. On parlait de la bataille sur la Somme d’abord, puis
sur l’Oise, sur la Seine ensuite et, incessamment, sur la Loire.
|
Il paraissait donc logique que la population non absolument indispensable,
ceux qui n’étaient ni des élus, ni des requis, et qui eussent
même pu être une entrave aux opérations militaires
et au ravitaillement, envisageassent des mesures de repliement. Les bombardements
par avions s’annonçaient formidables. Dans des villes où
s’opérait le retrait, des combats avaient eu lieu; il n’était
pas rare de voir des soldats français transformer certaines maisons
en fortins. Comment s’étonner, après cela, que des hommes
et des femmes chargés de famille s’efforçassent d’aller mettre
les leurs et eux-mêmes à l’abri, ou, du moins, à ce
qu’ils croyaient être un abri?
Un bombardement
aérien avait eu lieu déjà à l’aérodrome
d’Étampes et dans la région le lundi 3 juin, faisant une dizaine
de morts, dont un civil: M. Paulin Coudière, débitant, installé
à Mondésir. Un autre avait eu lieu dans la nuit du 7 au 8
juin sur notre ville même, atteignant et détériorant
les immeubles occupés par les familles Ritter, Guigner, Baudet et
Dallier.
|

Enfin, les interminables files de réfugiés belges, ardennais,
picards, alsaciens et lorrains dévalant sur nos routes; puis, au
début de juin, celles de l’Oise, de l’Aisne, de la Champagne et de
tant d’autres départements du Nord et de l’Est, ne pouvaient plus
laisser beaucoup d’espoir sur un arrêt possible de l’invasion.
Mais que fut-ce lorsqu’on
apprit que les armées allemandes [p.6]
s’étaient emparées [sic] de Calais, de Boulogne, d’Arras,
d’Amiens, que la majeure partie de la côte de la Manche n’était
plus sous le contrôle français et que la Basse-seine était
coupée dans le département de l’Eure, à peu de distance
de Seine-et-Oise!
On voyait, par ailleurs,
les grandes banques, les grandes administrations, les grandes maisons de
commerce évacuer leurs archives, leurs fonds et même leur
personnel; on voyait passer d’énormes camions transportant à
l’arrière du matériel provenant des principales usines de
la banlieue de Paris. On parlait de la bataille sur la Somme d’abord, puis
sur l’Oise, sur la Seine ensuite et, incessamment, sur la Loire.
|
Il paraissait donc logique que la population non absolument indispensable,
ceux qui n’étaient ni des élus, ni des requis, et qui eussent
même pu être une entrave aux opérations militaires
et au ravitaillement, envisageassent des mesures de repliement. Les bombardements
par avions s’annonçaient formidables. Dans des villes où
s’opérait le retrait, des combats avaient eu lieu; il n’était
pas rare de voir des soldats français transformer certaines maisons
en fortins. Comment s’étonner, après cela, que des hommes
et des femmes chargés de famille s’efforçassent d’aller mettre
les leurs et eux-mêmes à l’abri, ou, du moins, à ce
qu’ils croyaient être un abri?
Un bombardement aérien
avait eu lieu déjà à l’aérodrome d’Étampes
et dans la région le lundi 3 juin, faisant une dizaine de morts,
dont un civil: M. Paulin Coudière, débitant, installé
à Mondésir. Un autre avait eu lieu dans la nuit du 7 au 8
juin sur notre ville même, atteignant et détériorant
les immeubles occupés par les familles Ritter, Guigner, Baudet et
Dallier.
|

Mais voici que le mardi 11 juin, au matin, nos concitoyens découvrirent
en s’éveillant un épais nuage de fumée couvrant toute
la région, à la manière d’un brouillard intense.
Les uns disaient qu’il était destiné à masquer les
opérations des troupes françaises; d’autres prétendaient
qu’il provenait des Allemands, lesquels s’en servaient pour faciliter
leur avance. En réalité, il s’agissait de dépôts
de carburant de la région parisienne qui avaient été
incendiés volontairement [(Addition de 1944:) par les patriotes].
Les nouvelles des quelques rares journaux
quotidiens qui nous parvenaient maintenant, de même que celles de
la radio, n’étaient plus du tout rassurantes. La propagande gouvernementale [p.7] baissait le ton, en même
temps que les dirigeants chargés de l’orchestrer filaient dans
le Midi en auto, en train, ou en bateau, par les voies les plus rapides.
Le public faisait queue dans les gares, aux guichets des billets, et un
nombre incalculable d’autos, plus ou moins surchargées de gens et
de colis, commençaient, à Étampes, à travers
les rues Saint-Jacques, Saint-Martin et de la République, leur interminable,
leur hallucinant défilé.
Les 12 et 13 juin, l’exode se précipitait.
On annonçait que bientôt les trains allaient être supprimés.
Le cortège des réfugiés sur nos voies principales
était si considérable qu’il était impossible de traverser
la chaussée.
|
A l’ancienne Malterie, carrefour des Religieuses, certains de nos dévoués
concitoyens, aidés par des membres de la Croix-Rouge, s’étaient
dépensés sans compter depuis quinze jours, recevant, hébergeant
et canalisant les malheureux cultivateurs réfugiés des régions
envahies accompagnés de leur famille, leurs charrettes, leurs chevaux
et, certains même, d’une partie de leur bétail. A la gare,
d’autres bonnes âmes locales se tenaient depuis des semaines, jour
et nuit, sur les quais, ravitaillant les évacués et les troupes.
D’autre part, l’Institution Jeanne-d’Arc était, depuis le début
de la guerre, transformée en hôpital militaire par les soins
des Dames Françaises, sous l’impulsion particulière de Mme
Paul Duclos, entourée de personnalités civiles et religieuses.
Au Collège, devenu lui-même
un hôpital militaire depuis septembre 1939, on se préoccupait
d’évacuer les malades qui s’y trouvaient en traitement.
|
12 JUIN

Le mercredi 12 juin, l’atmosphère devint dramatique. Un affolement,
une stupeur collective s’emparèrent de la population.
A Étampes,
tous les services publics, toutes les administrations étaient encore
à leur place. Seuls certains commerçants, craignant le pire,
avaient quitté la ville. L’affluence des réfugiés
rue de la République, rue Saint-Jacques et dans toutes les autres
rues parallèles ou perpendiculaires devenait alarmante. Des hommes,
des femmes, des bêtes, écrasés par la fatigue et la [p.8] chaleur accablante,
gisaient le long des trottoirs et des ruisseaux. Le square du Théâtre
n’était plus qu’un vaste dortoir où s’affaissaient des corps
épuisés. Dans l’épouvantable cortège qui continuait
de défiler, on remarquait les tableaux les plus dérisoires,
les plus invraisemblables. Des créatures, qui n’avaient plus d’êtres
humains que les yeux démesurément agrandis, allaient à
pied, traînant sur leurs dos ou à bout de bras de lourds colis
chargés de hardes. D’autres transportaient tout leur barda sur une
voiture d’enfant, l’homme tirant devant, la compagne poussant derrière.
On pouvait voir des femmes ayant enlevé leurs chaussures trop étroites
marcher sur leurs bas déchirés.
Ceux qui ont assisté à ce spectacle
comme nous le fîmes, avec notre curiosité professionnelle,
ne sont pas prêts de [sic] l’oublier. Une température torride, équatoriale,
se mêlant à l’angoisse, à la soif, à la faim,
à l’insomnie, faisait de la situation une page d’apocalypse agitée
par un vent de folie.
Le désarroi, dans la population d’Étampes,
était déjà si grand, que deux hommes appelés
de par leurs fonctions à avoir un certain ascendant sur leurs concitoyens:
MM. Maurice Dormann, sénateur, et Léon Liger, maire, décidèrent
de rédiger l’affiche suivante, qui fut placardée sur les
murs de la ville: |
|
AUX HABITANTS
D’ÉTAMPES,
Les bruits les plus pessimistes et les plus stupides
courent toute la ville.
On entend dire partout que la Municipalité
aurait annoncé l’évacuation prochaine de la population.
Rien n’est plus faux.
La Préfecture, qui a envisagé son repli,
si celui-ci est nécessaire, — et l’heure n’en est pas encore venue
— a même choisi Étampes comme lieu de stationnement.
Il est donc criminel d’affoler la population à
une heure où les graves événements que nous vivons
sont déjà assez durs à supporter.
Nos troupes héroïques tiennent toujours
et retardent la marche de l’ennemi qui s’essouffle.
La meilleure façon de leur rendre hommage
est de conserver son calme et son sang-froid.
Haut les cœurs, patience et espoir toujours!
|
Hélas! les événements,
peu après, devaient se charger de faire un sort à cette affiche… [p.9]
|

LE 13
JUIN
Le jeudi 13 juin, la panique était à son comble. On apprenait
que les Allemands étaient aux portes de Paris. Des militaires français
de tout grade passaient dans notre ville, mêlés aux civils,
les uns à pied, d’autres en vélo, certains en voiture avec
leur famille. Le capitaine Renoult, commandant la place d’Étampes,
était littéralement débordé et ses services
assiégés par des automobilistes imprudents qui s’étaient
enfuis sans emporter la quantité d’essence suffisante. Il n’était
plus possible désormais de trouver une seule goutte du précieux
liquide. Déjà, les autos abandonnées faute de carburant
s’alignaient au long des routes et des trottoirs.
Des foules innombrables se pressaient, se
bousculaient aux portes des épiceries, des boulangeries, des charcuteries
et des débits. Le 13 au soir, il était presque impossible
de se procurer un morceau de pain à Étampes, et l’on comprend
que beaucoup de nos concitoyens, craignant que leur famille ne manquât
du nécessaire, aient préféré, sans plaisir,
l’aventure des routes mitraillées.
[(1941:)
Pendant ce temps, nous préparions
le numéro de L’Abeille d’Etampes, portant la date du 15 juin
et devant paraître le vendredi comme d’habitude. Nous nous demandions,
à la vérité, ce qu’il adviendrait d’ici-là. Aussi,
dès la soirée du jeudi 13, apprenant que nos dépositaires
d’Etampes avaient fermé leurs portes, nous résolûmes
de vendre L’Abeille à la criée dans les rues.]
|
C’est au cours de ce même après-midi du jeudi 13 que le bruit
se répandit comme la foudre «que la Russie venait de déclarer
la guerre à l’Allemagne». [(1941:)
Ce bobard ne fût pas venu tout seul
à nos oreilles à ce moment qu’il eût fallu l’inventer,
tant les esprits étaient avides de «miracles»!] Les gens d’apparence
les plus sérieux, prenant leurs désirs pour des réalités,
vous abordaient sur la place de l’Hôtel-de-Ville avec des yeux d’illuminés,
en vous assurant «que le fait était officiel et qu’il allait
être diffusé par la T.S.F.»
On sait ce qu’il en advint…
Enfin, c’est ce fameux jeudi soir que la
foule put voir passer dans la rue de la Juiverie [1940:) (devenue
depuis rue de la Beauce)] un soldat français
et une infirmière que des gardes territoriaux emmenaient fièrement
à la gendarmerie, le fusil sur l’épaule. Il s’agissait,
disait-on, de deux parachutistes allemands déguisés, l’un
en militaire, l’autre [(1941:)
en infirmière-chienlit] [(1944:) en infirmière], qu’on avait découverts
au bord de la Juine. En réalité, il s’agissait bien d’un
pauvre soldat français et d’une véritable infirmière
française, laquelle dut exhiber [(1941:) ses charmes...] [1944:) devant témoins les attributs de son
sexe] à l’appui de ses affirmations
pour être crue et relâchée.
Ah! Cette hantise des parachutistes!... [p.10]
|
LE 14
JUIN

La nuit du jeudi au vendredi 14 passa, lourde de chaleur orageuse et d’anxiété
toujours accrue. Par instants, on entendait la D.C.A. tirer au loin contre
des avions invisibles.
L’attaque aérienne se faisait menaçante.
Déjà, dans l’après-midi du jeudi, un appareil allemand
était venu photographier différents points de la ville,
en ayant soin de les entourer au préalable d’un cercle de fumée
blanche.
Le bombardement
tant redouté eut lieu le vendredi matin, vers 10 heures, à
deux reprises différentes. Au cours du premier vol, les avions
lâchèrent des bombes et, à leur second passage, ils
mitraillèrent sauvagement. Les quartiers les plus atteints furent
ceux de Saint-Pierre et du Port. Une bombe tomba sous le pont de Dourdan,
une autre dans le square du Souvenir, mutilant les lions de pierre et le
fusil porté par le Poilu, et une troisième sur une voie du
dépôt de la gare, blessant M. Hutteau, mécanicien,
qui fut aussitôt transporté à l’hôpital d’Orléans,
ainsi que MM. Lorré, Richefou et Moreau, tous de la gare d’Étampes.
Des immmeubles sur le Port, rue Saint-Jacques, villa Fourgeau, place Notre-Dame,
rue de la République, rue Émile-Léauté et rue
de la Tannerie furent en tout ou partie démolis par d’autres engins.
Citons-en quelques-uns: rue de la Tannerie, nos 7, 8 et 10, immeubles Diamy,
Sugy et Boblet; rue de la République, n° 20, Hôtel du Duc
d’Orléans; place Notre-Dame, nos 9, 10 et 13, immeubles Théret,
Rollet et Lannoy; impasse aux Bois, immeubles Depin et Danthu; rue Émile-Leauté,
nos 10 et 12, immeubles Canet et Graullier; rue Saint-Jacques, nos 3, 4
et 6, immeubles veuve Leluc, veuve Baufort et Besnault; impasse Fourgeau,
immeubles Diard et Delassis; place du Jeu-de-Paume, Hôtel des Ventes;
promenade du Port, immeubles Hoyau, Menu, Beauvais, Barraud et le Casino;
boulevard Saint-Michel, nos 47, immeuble Ligerot; rue de la République
(quartie Saint-Pierre) nos 210, 212, 216, 218, 224, 226, 230, 237, 239,
243, 245, 247, 250 et 251, immeubles Garnier, Erulin, Marchaudon, Voilard,
Morin Maurice, carré, Corceret, Gatineau, Dulit, Christophe, Bouclet,
Jahan, Lemaire et Madeck; rue SAdi-Carnot, nos 4 et 6, immeubles Chaline
et Pinault; rue du sablon, nos 1 et 3, immeubles de Drouot et Prin; rue
des Remparts, immeuble Dalisson. L’immeuble de Mme Charles Lefort, situé
2 bis, rue Saint-Jacques, fut àç la fois bombardé et
incendié par un autocar arrêté devant la porte et dans
lequel des enfants furent brûlés vifs. Mme Lefort, qui se trouvait
dans sa cuisine, fut blessée, et Mme Gromelle, femme de l’huissier
en chef de la Préfecture de Versailles, réfugiée à
Étampes, qui se tenait à ses côtés, fut grièvement
atteinte, elle aussi, et mourut peu après.
[p.11]
|
Et des cadavres, en nombre considérable, hélas! jonchèrent
le sol. On évalue leur nombre à plusieurs centaines [(1941:) (400?)] [(1944:) (400), dont beaucoup
furent emportés peu après par leurs familles, ou leurs amis].
A Saint-Pierre et au Port, le spectacle était
infernal, dantesque. Il y avait là, au moment du bombardement,
un embouteillage indescriptible d’automobiles massées sur quatre
rangs, incapables ni d’avancer, ni de reculer. Les bombes, les éclats
tombèrent sur cette marée humaine comme des grêlons
sur un champ de blé. Des bras, des jambes, des pavés, des
carreaux, des portes volèrent en morceaux. Le sang coula, des hurlements
d’horreur et de douleur déchirèrent l’air et s’entendirent
des plus lointains quartiers de la ville.
Alors,
ce fut chez ceux qui avaient résolu de rester quand même à
Étampes un sauve-qui-peut général. Dieu merci, quelques-uns,
doués d’un certain sang-froid, demeurèrent sur place et
organisèrent les secours. Grâce au concours de braves citoyens,
comme MM. Darnault, menuisier, 204, rue de la République; Jouannin;
Doré (de la S.N.C.F.); Flamand (des P.T.T.); Pointeau, cultivateur;
Mme Gazonnois, fille de M. Christophe, garagiste, des blessés, dès
10 heures 15, purent être ramassés et portés avec des
moyens de fortune jusqu’à l’hôpital, où les docteurs
Grenet, Bardin, Guillery, l’abbé Guillet, aumônier; M. Rebiffé,
directeur-économe, les docteurs Lansac, Morin, aidés par
les religieuses infirmières et tout le personnel hospitalier, se
dévouèrent sans compter. On alla jusqu’à arracher
des portes pour s’en servir de civières. Malheureusement, le feu
ravageait les automobiles et les corps mutilés. Un camion militaire
chargé de cartouches avait sauté sous la mitraille. Les pompiers,
accourus, éteignirent les brasiers de leur mieux. Dans la foule des
morts on devait compter certains compatriotes: au Port, le jeune Roland
Fontaine, M. Joseph Cailleaux, dont on devait retrouver le corps le 13
juillet dans de mystérieuses conditions, à demi-décomposé,
dans une buanderie, 85, rue Saint-Jacques; M. Lignal, aiguilleur à
la S.N.C.F., et M. Henri Lyraud; à Saint-Pierre, M. Paturange et
Mme Houdinière, littéralement calcinés dans leur auto;
M. Mercher, tué devant chez lui, 210, rue de la République;
Mme Sellier, trouvée morte chez elle. D’autre part, il fallut déplorer
des blessés graves: Mme Gatineau, morte de ses mutilations; M. Carré,
assureur, 224, rue de la République, auquel après d’effroyables
peripéties [p.12] dont
on pourrait faire un livre, on coupa une jambe; M Erulin, demeuré
infirme depuis, et son fils, âgé de deux ans et demi, — lequel
devait mourir quelques semaines plus tard; M. Flamand fils, blessé
à sa fenêtre, 210, rue de la République, à qui
l’on dut enlever un œil par la suite; M. et Mme Billard, atteints tous
deux dans leur maison, 235 rue de la République; d’autres encore
dont les noms [(1941:) ne nous sont pas encore connus] [(1944:) nous sont demeurés
inconnus].
|


Signalons au passage la courageuse attitude de MM. Gilbert et Christen,
qui, les 14 et 15 juin, procédèrent à la recherche
et à l’enlèvement des corps sur le Port, rue Saint-Jacques
et avenue de Paris.
Étant donné l’encombrement
et le danger que pouvaient réserver des bombes à retardement;
étant donné également le manque d’aide, — le vide s’étant
presque instantanément fait dans les quartiers sinistrés,
— on ne put enterrer les cadavres le jour même. Ce n’est que le lundi
17, à la demande des autorités allemandes, que les fossoyeurs
courageux, à la tête desquels se trouvaient l’infatigable M.
Darnault — lequel devait jusqu’au 27 juillet assurer le service des inhumations
— et le chef fossoyeur Sergent, enfouirent les corps calcinés, déchiquetés
et jusqu’aux membres épars des malheureuses victimes. Sur chacune
d’elle on recueillit ce qu’on pouvait relever d’identité, on le consigna
sur un papier, que l’on introduisit dans une bouteille enterrée avec
le cadavre, ou fichée sur la terre qui le recouvrait.
|
On utilisa principalement les tranchées-abris du Bourgneuf et du
Port pour inhumer les morts. Rien que dans celles du Bourgneuf, on estime
que les débris humains rassemblés formaient un total de quarante-six
victimes, sans compter les corps entiers. D’une manière générale,
M. Darnault et ses aides enveloppaient les cadavres dans des loques précédemment
trempées dans de l’eau de Javel avant de les inhumer. Sage précaution,
étant donné leur état de putréfaction précipitée
par la chaleur caniculaire de cet inoubliable été.
L’après-midi du vendredi
qui suivit le bombardement, ce fut, dans notre ville, une fièvre
grandissante. La plupart des services départementaux: préfecture,
tribunaux, gendarmerie, police, hygiène, pompiers, etc…, se trouvaient
repliés à Étampes, en attendant de refaire un nouveau
bond en arrière. Le soir-même, en effet, tous avaient abandonné
la ville, las d’attendre des instructions qui ne venaient pas. [p.13] |

|
En ce qui concerne nos services communaux, le personnel de la mairie,
juché sur des camions chargés des précieuses archives,
quittait l’Hôtel de Ville à la tombée de la nuit, à
l’invitation du maire, M. Liger. Ce dernier, accompagné de son secrétaire
général, M. Lasserre, partait le lendemain matin à
la première heure. Tous, après avoir fourni, ainsi que tout
le personnel, un effort considérable pendant plusieurs semaines,
avaient ordre de reprendre contact avec le préfet et ses services
à Méréville. De là, ils s’en furent à
Crottes-en-Pithivrais, dans le Loiret. Mais, devant l’avance de l’ennemi,
ils n’y demeurèrent que quelques heures et se trouvèrent
dispersés par le flot de la retraite. |
Ajoutons que le vendredi soir, vers 22 heures, une femme d’une quarantaine
d’année, correctement vêtue, fut abattue d’un coup de revolver
au coin des rues Saint-Martin et de Chauffour par un inconnu. Elle ne
fut enlevée que le lendemain. Une balle [(1944:)
tirée par le meurtrier] vint même frapper notre concitoyen M. Gaston
Barat, au talon de sa chaussure gauche. Une autre femme fut assassinée
et violée près du Pont Saint-Jean. D’autres crimes furent
perpétrés dans différents quartiers de la ville et
des environs par des apaches et des sadiques échappés des
cabanons et des prisons. Les corps des victimes de ces forfaits se mêlèrent
[(1941:)
hélas] à ceux des bombardements [(1941:) ....]. |
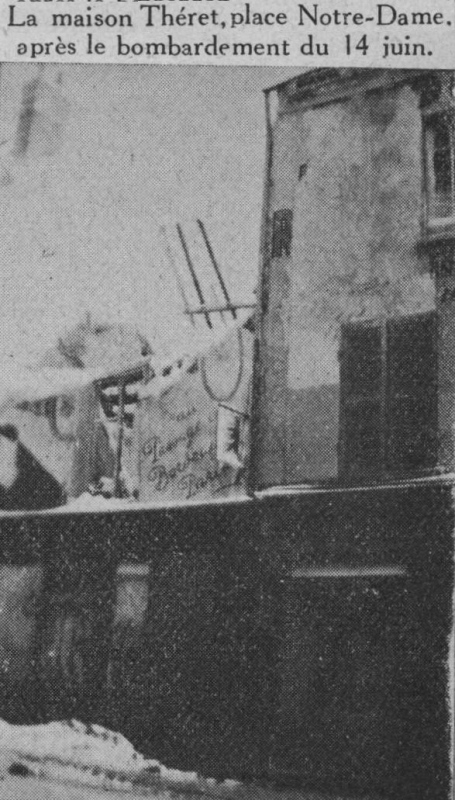
|
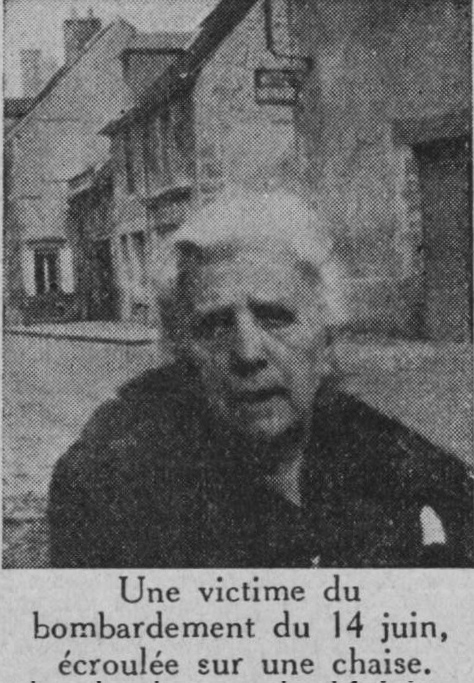
|

LE
15 JUIN
Nous avons dit que
la gendarmerie était partie le soir du 14 juin. Notons qu’il s’agissait
des services de Versailles; mais la brigade d’Étampes, elle, ne
partit que le lendemain matin, samedi, au tout dernier moment. Quant aux
magistrats et au personnel du Tribunal de notre ville, ils ne consentirent
à partir que trois jours après en avoir reçu l’invitation,
laquelle leur était parvenue dès le 12 juin.
Mentionnons aussi que le vendredi 14 juin, à
l’heure du bombardement, des torpilles tombètrent également
au Petit-Saint-Mars: une dans le jardin du garde barrière, une seconde
derrière le château et deux dans le Rougemont, sans causer aucun
mal: une cinquième enfin tomba dans le jardin de M. Paris, serrurier,
creusant seulement un vaste entonnoir.
On peut dire que le samedi matin, 15 juin, la population
d’Etampes était réduite à néant. Sur plus de
dix mille habitants, notre ville n’en comptait plus qu’un millier: municipalité
— MM. Pillas et Laffin exceptés — pompiers, police, postes, gendarmerie,
tout était parti, ne faisant qu’imiter les services supérieurs
de Paris et du département qui s’étaient repliés avant
eux.
C’est alors que le pillards qui, eux, remplissaient
la ville, s’en donnèrent «à cœur joie», quelque
répugnance qu’on ait à employer ce terme. En moins de temps
qu’il n’en faut pour le dire, des escarpes venus, on ne sait d’où,
s’abattirent sur des maisons, des boutiques évacuées de notre
cité et firent main basse sur tout ce qui pouvait avoir quelque valeur
ou seulement quelque utilité. Les cadavres eux-mêmes, demeurés
dans leurs voitures, ne furent point épargnés. Un razzia générale,
qui ne sera pas la moindre honte de cette guerre ignominieuse, fut opérée
dans la région, et si tous les magasins, tous les logements ne furent
pas mis à sac par des bandits à ce moment, c’est à quelques
courageux citoyens demeurés dans nos murs que nous le devons, à
MM. Lejeune, Pillas, Laffin, Delaveau, Daeschler, Darnault, Brochet, Menet,
Koffel, Flizot père, Doron, Péquet, Lajugie, Rebiffé,
MM. Les abbés Guibourgé, Ghys et Guillet; MM. Sergent, Arnaud,
Douard, Foix, Audran, Bercé, Mmes et Mlle Simonneau, Mmes Dallier,
Curtet (qui ferma son restaurant la dernière et qui le rouvrit la
première); Bourdon, M., Mme et Mlles Grosbois, M. et Mme Le Dréhan,
M. et Mme Léotard, M. et Mme Poirier, Mme et Mlle Bouyssier, M. et
Mme Hypolite, Mme Jumentié et Mme Mayeux (centenaire), M. et Mme Giraud
E., M. Pecquet, M. et MmeLeday, Mme Mandin, M. et Mme Pararaisse, M. Garin,
M. et Mme Fauvaque, famille Robillard, Mlle M. Ducoup, M. et Mme Suère,
M. et Mme Eugène Caillau, Mme et Mlle Malgras, Mme veuve Lameth, Mme
veuve Bidochon, Mlle Desforges,
|
M. et Mme
Bouvier, Mme veuve Rebèche, Mlle Léonache, Mlle Pinson, M.
et Mme Margry, M. et Mme Métais, Mme veuve Mercier, M. Jamet et sa
sœur Mlle Elise Jamet, M. Charles Laurent, M. et Mme Vallette, M. et Mme Lecornu,
M. Bongibault, M. Chansard, Mme veuve Chartrain, M. et Mme Crépu, M.
et Mme E. Thomas, M. Bézard, Mme Crinière, Mmmes Jousset, M.
et Mme Corpechot, Mme Chauvin, M. et Mme Mandard, M. et Mme Pelletier, M.
et Mme Arthur Chauvet, M. et Me Raymond Guérin, M. et Mme Joseph Guérin
(M. Joseph Guérin rendit les plus signalés services), Mme veuve
Rimmel et sa belle-fille Mme Rimmel (qui ne cessa et ne cesse encore de se
dévouer pour nos prisonniers); mmes Gigot,
Molon, Robin, Mlle Hanotel qui, avec sa connaissance parfairte de la langue
allemande fut une précieuse auxiliaire pour les services de la mairie ;
Mlle Sevestre et sa servante, M. Mandard, M. et Mme Picoulet, M. et Mme Brault,
M. et Mme Dufayet (qui tous se dévouèrent pour le ravitaillement
en lait, surtout pour les malades et les enfants), Mlle Simone Petit et sa
maman, très courageuses ; MM ; Doron, Roques et Chappart
(qui participèrent au ravitaillement en pain), M. et Mme Noquet, M.
et Mme Chevallier, M. et Mme Trudon, Mmmes veuves Jouanest et Dufresne, Mme
Tribaudeau, M. et Me Pelletier, M. et Mme Cagnat, M. et Mme A. Chauvet, M.
et Mme Eugène Paris, M. et Mme Daniel Pecquet, M. Mazure. M. Flammery,
employé aux eaux et resté à son poste, rétablit
la distribution d’eau eau bout de quelques jours avec sa roue hydraulique,
l’électricité faisant complètement défaut. Citons
encore M. et Mme E. Chauvet, Mme veuve Bruneau, M. et Mme Bervier, M. et
Mme Altier, Mlle Madeleine Pinson, M. et Mme Joannest, M. et Mme Emile Martorel,
M. et Mme Rousseau, maréchal-ferrant; M. et Mme Lameth, M. et Mme
Genet, cultivateur; M. et Mme Méry, M. et Mme Baudin Henri, M. et
Mme Vidal, M. et Mme Bourly et leur fille, M. et Mme Léon Guérin,
famille Sion, Mme veuve Dufresne, Mme veuve Daubignard, M. et Mme Léon
Paris, famille Donnadieu, M. et Mme Fournier, M. et Mme Jules Leblanc, Mme
Laurent, M. Raymond Pillias, M. et Mme André Douard, Mme veuve Chanon,
Mmes Roux et Gérard Roux, M. et Mme Fontès, Mlle Ghys, Mme
veuveBrosse, Mme Pinguenet, Mme veuve Boblet, Mme veuve Dardon, Mlle Chenu,
Mlle Charlotte Laurent, restée seule à l’Hôtel du Grand
Courrier,,, et combien d’autres dont nous n’avons pu recueillir les noms,
qui voudront bien nous en excuser, et qui ont bien mérité de
la reconnaissance de la population tout entière.
Le samedi matin, les trains ne
partaient plus, Des grappes humaines continuaient quand même de stationner
devant la gare et dans les rues avoisinantes, On annonça que les troupes
allemandes allaient être là dans la soirée, Beaucoup ne
voulaient pas y croire.
|
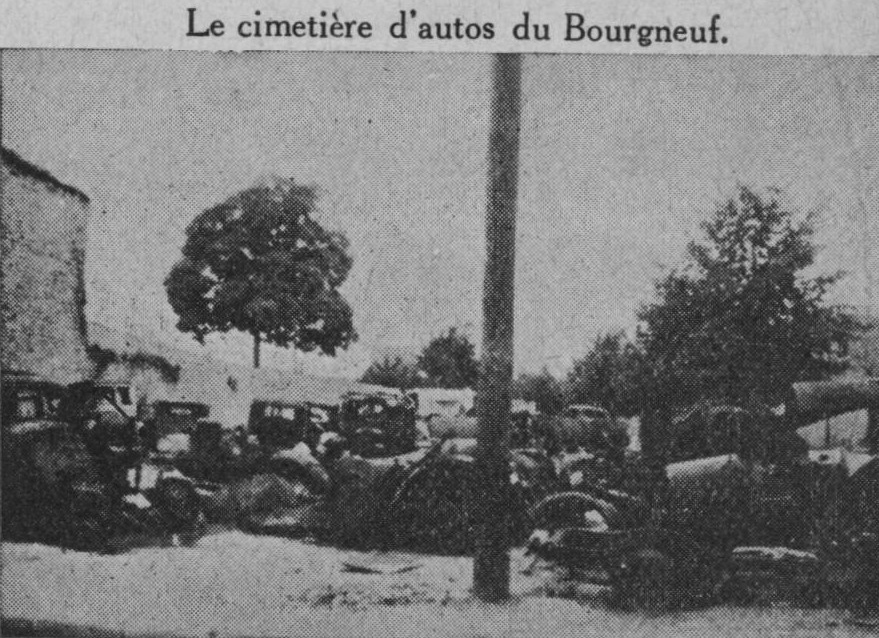
|
Et pourtant... Laissons, à cet endroit de notre récit, la parole
à M. Delaveau, notre estimé concitoyen de la rue Aristide-Briand,
qui joua un rôle important dans les minutes qui vont venir, et qui
voulut bien nous rapporter ce qui suit:
— A la fin de la matinée, je vais à
mon clos comme d’habitude, situé aux Jardins Ouvriers, et je me mets
en devoir de cueillir des fraises. A ce moment, deux soldats français
entrent et me demandent le route de Pithiviers. Je les renseigne et ils partent
en courant, traversant le Juineteau par le jardin Parisot. Peu après,
je lève la tête et j’aperçois le canon d’un fusils dans
l’ouverture de ma porte restée ouverte. Puis le fusils disparaît
pour faire place à une mitrailleuse. Ma foi, je me risque. Il y a
là un soldat allemand, mais comme in ne paraît pas agressif,
j’avance la tête dans le chemin et je m’aperçois que toutes
les portes et issues sont gardées par des sentinelles armées
de fusils ou de mitraillettes. Que faire ? Je me décide à
partir pour aller en reconnaissance... Et les Allemands me laissent passer.
Au coin de l’avenue Frédéric-Louis, je croise bien un petit
poste, mais plus rien jusque chez moi.
Ainsi, comme le confirme ce récit,
les troupes allemandes sont entrées dans Etampes sans coup férir.
Qui l’eût cru ? Paris, lui, avait été déclaré
entre temps « ville ouverte » et ses habitants, demeurés
sur place, savaient maintenant à quoi s’en tenir. Mais Etampes ?
Il eût suffi, pour [(1941:) déclancher] [(1944:)
déclencher] un combat local, d’un incident comme celui qui
éclata à la gare vers dix heures.
Tout le personnel de notre gare était à
son poste ce matin-là, n’ayant pas cessé d’être sur la
brèche jour et nuit depuis l’offensive du 10 mai, déployant
une activité, une sollicitude et un courage admirables. Or, à
l’arrivée d’un train, le bruit se propage tout à coup qu’il
y a, dans le convoi, des parachutistes ennemis. La chasse à l’homme
s’organise aussitôt et des coups de feu éclatent, blessant trois
personnes dans la foule. Deux voyageurs du fameux train sont arrêtés
et conduits au capitaine faisant fonctions de commissaire de gare. Au même
instant, des nouvelles arrivent: les Allemands ont dépassé Longjumeau
et s’avancent rapidement ? Vite, on prépare un train pour l’évacuation
des familles de cheminots et pour les réfugiés présents
sir les quais. Vers midi, un sous-chef de gare de Brétigny, venu au
pas de gymnastique par les voies, vient annoncer que les Allemands sont maintenant
à Etréchy, que le train dans lequel il se trouvait est bloqué
et que tous les voyageurs ont été faits prisonniers. On active
alors la mise en place du convoi d’évacuation; on fait embarquer les
femmes et les enfants, le personnel de la gare, lui, ayant reçu l’ordre
de rester à son poste pour continuer l’acheminement des trains.
|
Vers 13 heures, coup de tonnerre ! La nouvelle circule, brève:
les Allemands arrivent. Effectivement, quelques minutes passent, puis soudain,
des estafettes en side-car, revolver et mitraillettes au poing, apparaissent
place de la Gare, s’acheminant vers le boulevard Henri-IV et se rendent jusqu’à
la tête du train prêt à partir.
L’officier, commandant ce petit détachement,
descend et, revolver au poing, intime l’ordre aux mécaniciens de ne
pas avancer. Brusquement, des coups de feu éclatent, provenant du
train où se trouevnt d’autres cheminots (environ 200) mobilisés
à la 7e section des Chemins de fer de campagne, et arrivés
la veille au soir en gare d’Etampes. L’officier et deux soldats allemands
qui l’accompagnent sont abattus, La riposte ne se fait pas attendre: les mitraillettes
entrent en action. Des soldats allemands, au nombre d’une trentaine, déchargent
leurs fusils sur les deux côtés du trai: les uns postés
sur la Promenade et les autres dans les salles d’attente d’où ils
tirent à travers les vitres. Une mitrailleuse entre même en
action sur le Pont Saint-Jean. Tous les occupants du train descendent alors
en levant les mains et ils abandonnent le convoi.
Hélas, le triste bilan de cette échauffourée
apparaît dans sa cruelle réalité: six soldats de la 7e
section sont étendus sur le terrain, un agent de la voie est également
tué et un de l’exploitation grièvement blessé. D’autres
militaires sont blessés, eux aussi, et transportés à
l’hôpital.
Quelques minutes plus tard, les quais étaient
entièrement vidés; la foule s’étaient littéralement
volatilisée. Peu après, on enterra les victimes dans un terrain
situé derrière le silo de la Coopérative Agricole.
Maintenant les troupes allemandes défilent
sans interruption en direction d’Orléans, venant de La Ferté,
d’Étréchy et de Dourdan. Les premiers éléments
ont traversé la ville en motocyclettes et side-cars. Ce sont maintenant
des camions, [p.18] des tanks,
de la cavalerie. Sur la chaussée, ils font place nette en refoulant
sur les trottoirs et les rues latérales les autos des réfugiés
et celles de l’armée française en panne ou abandonnées.
Toute la journée se passe ainsi.
|
LE 16
JUIN
Le dimanche matin, 16 juin… Mais redonnons
la parole à M. Delaveau, qui va nous conter la suite:
— Vers neuf heures, ce matin-là,
Mme Dallier, l’épicière de la place de l’Hôtel-de-Ville,
m’appelle et m’informe que trois officiers allemands demandent à
voir le Maire d’Etampes. Comme il n’y en a plus, je me présente. L’un
d’eux me questionne: «Vous, M. le Maire?», — «Ya»,
lui dis-je sans hésiter, songeant à cette minute que de cette
réponse dépend peut-être le sort de notre ville. Il
m’invite à entrer. La mairie est dans un état pitoyable: des
réfugiés y sont couchés pêle-mêle sur des
hardes, entourés de leur barda, avec, pour la plupart, une bouteille
à portée de la main. Celui qui semble être l’officier
supérieur allemand me demande un plan de la ville: je me mets en quête
d’un de ces documents… sans résultats, lorsque l’un des officiers,
s’avançant vers le tiroir de la bibliothèque située dans
le cabinet du maire, en retire un tout naturellement. Jugez de ma stupéfaction…
et de ma confusion. Mais passons… Après un rapide examen du plan, on
m’invite à conduire ces messieurs à l’hôpital et à
l’usine des Laboratoires Dausse. Après quoi nous revenons sur la place
de l’Hôtel-de-Ville, où une auto nous attend. J’y monte en compagnie
des officiers, on me remet un plan où les établissements [p.19] qu’ils entendent visiter se
trouvent marqués d’un cercle rouge, et nous voilà
partis. Nous nous rendons ainsi tour à tour à la gare des
marchandises, aux abattoirs, à la ferme de Guinette, puis à
la gare des voyageurs qui est occupée par les motorisés. Sous
le hall de la gare des marchandises mes compagnons savaient qu’il y avait
du blé, ainsi que dans le silo. La ferme de Guinette était
complètement déserte; nous la visitâmes de fond en comble.
Après cela, nous nous rendîmes à Authon-la-Plaine, que
nous ne fîmes que traverser pour rentre à Étampes. Mes
fonctions de maire avaient duré tout juste trois heures.
|
Ajoutons que dès leur
arrivée à Saint-Pierre, les Allemands réunirent les
habitants de ce quartier qui s’y trouvaient encore et, après les
avoir accompagnés, les passèrent… à la fouille au coin
des rues Évezard et du Port, devant le magasin d’électricité
Pillas, où se trouvait un feldwebel. Toutes les poches furent visitées
et chaque fois qu’on y trouvait un couteau ou autre objet indésirable
il était jeté dans la bouche de caniveau dont on avait ôté
la plaque de fonte.
Nous ne terminerons pas
la relation de cette journée du dimanche 16 juin sans rapporter
le raid tragique de cet avion français qui, vers 10 heures 30, s’avisa
de vouloir bombarder un convoi allemand au-dessus de Saint-Martin. Pris
dans le tir de la D.C.A ennemie, qui était installée depuis
la veille au Petit-Saint-mars, les deux audacieux aviateurs, le sous-lieutenant
Roger Balbiano, du groupe 502 à Amiens, et le sous-officier Pierre
Bizet, du même groupe, né le 10 juin 1914, s’écrasèrent
au Rougement avec leur appareil. Ce sont encore nos braves amis Émile
Sergent et Georges Hennequin qui enterrèrent pieusement les deux
héroïques combattants au cimetière Saint-Pierre, où
l’on peut voir leurs tombes derrière la grande tranchée
collective où repose une partie des victimes du bombardement du
14 juin. [p.20]
|
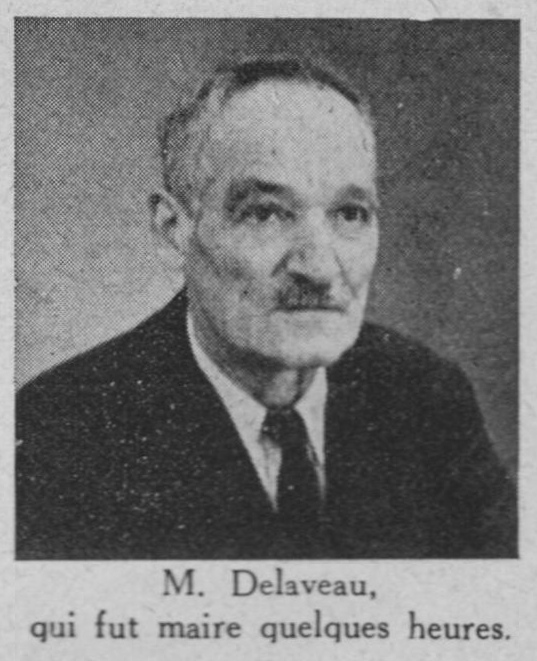
|

|
LE
17 JUIN
Le lundi 17 juin, nos concitoyens demeurés sur place commencèrent
à se ressaisir [(1941:) en constatant que les occupants ne répondaient pas
à la réputation de tortionnaires qu’on nous avait faite d’eux.
Le pillage lui-même allait diminuant.] [(1944:). Le pillage lui-même est en régression.]
M. Ulysse Pillas, revenu
à la Mairie, [(1941:)
commence à organiser] [(1944:). organise] certains services. Un appel est fait au concours des bonnes volontés.
C’est le brave Sergent, le fossoyeur, qui parcourt les quartiers de la
ville et qui sonne le ralliement au son du tambour. Les bons cœurs affluent
de toutes parts. Successivement, MM. Delaveau, Lajugie, Sergent, Arnaud,
Foix, Laffin, Pillas, Doron, Péquet, Audran, Darnault, Menet, Lejeune,
Péchenard, Hotermans, Brochet, Emile Rouleau [(1941:) (chauffeur)], Manceau, Flament, Berthaud, Didier, Pignard, Guitton, Descot
et Leroy ont offert ou offrent leurs services.
[(1941:)
M. Barthélémy Durand, propriétaire
du domaine de Valnay, n’a pas entendu cet appel pour venir se mettre spontanément
au service de la population et c’est lui qui organise le premier la fabrication
du pain.]
Ceux qui ont pris en main
la direction de la ville commencent d’abord par se soucier du précieux
aliment, qui fait défaut depuis trois jours, ainsi que l’eau, le
gaz, l’électricité. Des soldats allemands ont bien donné
de-ci, de-là, quelques biscuits, mais cela est nettement insuffisant
et ne peut durer. Quant à l’eau, puisqu’il n’y a pas le choix,
le mieux est de la puiser dans les brassets de la Juine et de la faire
bouillir ensuite pour pouvoir la consommer. |
Mais voici que les évacués commencent à rentrer,
ceux qui, étant donné l’embouteillage des routes, n’ont
pu aller loin et ont été rejoints par les troupes allemandes.
Tous demandent du pain et de l’essence pour pouvoir regagner leur domicile.
Une première boulangerie est donc ouverte, celle de M. Plé,
rue de la République, et, pour la délivrance du pain, MM.
Delaveau, Menet et Lajugie sont chargés de distribuer aux grilles
de la Mairie des petits bouts de papier de couleur portant le cachet municipal.
Ces bons représentent une ration de 500 gr. de pain pour le prix
de 1 fr. 50. Comme la quantité fabriquée est minime et que
les demandes sont grosses, il en résulte bien quelques protestations
vite réprimées.
Une première boucherie ouvre à son tour, celle de M. Legendre,
rue Paul-Doumer, à la grande satisfaction du public.
Déjà les services
de la Kommandantur occupent tout le rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville. Petit à petit, on installe ceux de la commune au premier
étage au premier étage, M. Brochet, agent d’assurances, assure
les fonctions de Secrétaire, tâche difficile pour commencer,
étant donné qu’il n’existe plus d’archives. M. Arnaud, employé
à la Grande-Vitesse de la gare, prend l’état-civil, ce qui,
pour les mêmes raisons, n’est pas plus commode. D’autre part, M.
Maurice Brochet, aiguilleur, 10, rue Sainte-Croix, rend les [p.21] plus signalés
services, lui aussi, en assumant les tâches les plus diverses. Comme
le Receveur municipal a été également replié
avec la caisse, les premiers fonds doivent être fournis par les
dévoués organisateurs des services eux-mêmes; mais
il est dit que toutes les bonnes volontés présentes sont
animées du plus haut esprit d’entr’aide et, malgré les difficultés
du moment, elles ne reculent devant aucun effort, ni aucun sacrifice. |
LES JOURS SUIVANTS
Nous avons dit que le lundi
17 le pillage était déjà en régression. Ce
résultat était dû à une habile mesure prise
en un temps record. Le matin de ce jour-là, notre [(1941:) sympathique]
concitoyen M. Daeschler, [(1941:) remplit les fonctions d’interprète avec une parfaite
obligeance] [(1944:) qui remplissait les fonctions
d’interprète], conduisit M. Pillas, maire par interim,
devant le général allemand qui faisait office de commandant
de Place et qui était logé à l’Hôtel du Nord,
devant la gare.
— Monsieur le Général, dit
M. Daeschler, il faut que cesse le pillage et, pour cela, il est nécessaire
que vous nous laissiez organiser la police.
— D’accord, répondit l’officier, mettez
des brassards aux hommes chargés de ce service; je vous laisse carte
blanche pour opérer. De même, faites ouvrir les magasins
actuellement fermés, de manière à ce que la population
puisse être ravitaillée.
C’est donc grâce à cette décision
que les actes de pillage commis par des réfugiés et certains
concitoyens égarés purent être jugulés et que
des magasins d’alimentation purent fonctionner.
|
Parmi les personnes qui n’avaient pas quitté notre ville et qui,
au cours de ces journées historiques, payèrent encore de leur
personne, il faut citer l’agent Crochot, dont la femme, malade, était
immobilisée sur son lit, et qui assura son service de police avec
une inlassable activité, en compagnie de M. Barrué, gendarme
retraité, chargé plus spécialement des écritures.
Citons aussi M. Paris, mécanicien, qui remit des voitures en état,
de manière à assurer le ravitaillement, ainsi que M. Naudin,
qui fabriqua le pain dans la boulangerie Plé, et M. Goguet, qui
prêta la main à l’état-civil. Nous nous en voudrions
de ne pas citer également M. Bongage, qui prit en main la trésorerie
de la ville; M. Genet, cultivateur à Saint-Martin, qui procéda
à l’enlèvement des victimes [p.22]
du bombardement; M. René Blanchet, qui
mena à bien les travaux dangereux de déblaiement des maisons
bombardées; M. Descroix, qui assura le ravitaillement en farine
avec son camion; M. Caillet, qui se chargea du transport du pain à
destination des réfugiés logés à l’Abattoir
(La répartition de ce pain fut menée à bien grâce
au concours de MM. Chevrier Alfred, Thibault (préposé à
l’octroi), Paris Raymond et Mme Daubignard jeune, qui faisait office de
caissière.] Enfin, signalons la belle conduite de M. Hennequin, qui,
en qualité d’aide fossoyeur, paya nuit et jour de sa personne, accomplissant
une besogne qu’il n’est point exagéré de qualifier de surhumaine
si l’on veut bien se rendre compte de l’état effroyable des pauvres
corps déchiquetés ou carbonisés. M. Guerry fit de même
pour les multiples chevaux et vaches crevées au long des rues et
des chemins, ainsi que M. Hédeville, qui, armé d’une pique
et d’une massue, abattait les chiens enragés.
|

|
La
relation des événements qui se déroulèrent
à la mi-juin 1940 à Étampes ne serait pas complète
si nous ne mentionnions pas la découverte éminemment historique
faite le 15 juin, sur le Port, d’un camion abandonné contenant un
trésor inestimable que peut s’enorgueillir à juste titre
de posséder [(1941:) le
plus grand musée de France] [(1944:) le
Musée des Invalides], à savoir: une collection
des reliques de l’empereur Napoléon, parmi lesquelles [(1941:) son petit
chapeau] [(1944:) son chapeau d’Eylau], sa redingote
prise à Marengo, son épée [(1941:) d’apparat]
[(1944:) son épée d’Austerlitz]d’Austerlitz
et ses décorations.
|
Tous
ces objets, soigneusement enfouis dans des caisses, avaient quitté
les Invalides, deux ou trois jours plus tôt, pour être transportés
en lieu sûr, lorsque le conducteur du camion, affolé sans
doute par le bombardement du 14, abandonna dans notre ville ses précieux
bagages et… disparut.
Ajoutons que, grâce
à l’initiative habile d’un médecin de l’hôpital, les
inestimables reliques purent être dissimulées jusqu’à
ce qu’on les entreposât provisoirement au Château de la Malmaison,
en attendant leur retour aux Invalides. [p.23]
|

[(1941:) LA VIE RECOMMENCE ]
[(1941:) Enfin la vie de réorganise peu à
peu. Quelques jours plus tard, la boulangerie Rousseau, rue Paul-Doumer,
ouvre elle-même ses portes; puis c’est le tour de la boulangerie Coutelier,
rue de la République. Et voilà que l’eau fait aussi sa réapparition,
apportant un mieux-être sensible.
Entre temps; M. Pierre Lejeune, qui avait offert son concours
dès le début, est désigné comme Commissaire-Maire
aux côtés de M. Pillas. Tout de suite, il donne la pleine mesure
de son autorité, de son tact et de ses capacités. Grâce
à sa connaissance de la langue allemande, il est en mesure de résoudre
bien des problèmes et bien des difficultés. Son rôle
apparaît chaque jour plus nécessaire. Il ne tarde pas à
s’imposer, encore qu’il ne fasse rien pour cela. Ses connaissances, son activité,
sa sollicitude, seules lui attirent la considération et la sympathie
générale. MM. Péchenard et Hotermans, qui pratiquent
également la langue allemande, le premier d’Ormoy-la-Rivière
et le second de Saint-Hilaire, assistent MM. Lejeune et Pillas dans leurs
fonctions et ne marchandent pas davantage leur activité et leur temps.
M. Daeschler se joint à eux; il devient bientôt, grâce
à sa connaissance parfaite de la langue allemande et à son
obligeance, le plus utile des auxiliaires.
Pendant ce temps, MM. Laffin, Doron et Daniel Pequet
se prodiguent à Saint-Martin et à la Mairie, s’occupant de
tout: boulangerie, nettoiement, garde, etc... M. Martignon, de son côté,
prend en mains, avec toute l’ardeur qu’on lui connaît, la direction
du ravitaillement à l’abattoir. M. Bercé, lui aussi, quoique
amputé d’une jambe, se met à la disposition de la commune;
c’est lui qui, actuellement encore, assure l’enlèvement des ordures
ménagères.
Pour permettre à tous ces hommes de bonne
volonté de ne pas perdre des minutes précieuses à faire
la queue devant les boulangeries, on décide de leur remettre leur
portion de pain en 11 h. à midi au Commissariat de police, aux mêmes
conditions qu’aux autres habitants; M. Delaveau, M. Emile (de Saint-Martin)
et M. Foix, employés à la S.N.C.F., sont désignés
pour assurer cette distribution.
Tous les matins, des équipes de volontaires
se groupent sur la place de l’Hôtel-de-Ville; elles sont réparties
dans les différents quartiers de la ville pour débarrasser
les rues des objets et détritus les plus hétéroclites
qui les encombrent: animaux crevés, autos, vélos délabrés,
valises vides, bouteilles cassées, casques, cartons, gravois, vêtements,
papiers, paille, etc., etc.. |
Enfin, un jour vint où l’argent commença à garnir la
caisse de la ville; aussitôt on décida que tous ces braves gens,
qui avaient accepté sans murmurer les plus ingrates besognes, recevraient,
en guise de salaire et en attendant mieux, 500 gr. de pain pour les adultes
et 250 gr. Pour leurs enfants au-dessous de 10 ans. Pourtant, lorsqu’on saura
que la ville avait la charge supplémentaire d’assurer l’approvisionnement
en pain du camp de prisonniers de Mondésir — soit 2.000 bouches — on aura
idée du labeur et des difficultés inouïes que cela représentait
à l’époque pour les bonnes volontés locales.
Les jours s’écoulèrent un à
un, bons et mauvais. L’argent rentrait chaque jour un peu plus, grâce
à d’opportunes perceptions. Le pain gratuit fut un beau matin supprimé
aux travailleurs auxquels on donna 10 fr, par jour, puis, plus tard, 20 fr,,
chiffre encore présentement en vigueur.
Et l’on sait le reste...
Les réfugiés rentrèrent de
plus en plus nombreux, si bien qu’aujourd’hui on peut dire, qu’à de
très rares exceptions près, les Etampois ont réintégré
leur chère cité et retrouvé leurs habitudes. Nous vivons
toujours sous le régime de l’occupation, certes; bien de nos concitoyens,
en rentrant ont trouvé leur immeuble réquisitionné;
mais qu’estice en comparaison de ce qu’ils appréhendaient en partant ?
Car enfin, c’est à cela qu’il ne faut pas
cesser de songer. Nous avons vécu des jours difficiles; d’autres suivront
encore... Et puis... et puis des heures meilleures reviendront pour peu que
nous sachions les attendre avec vaillance et les préparer avec foi.
Les dernières lignes de cette brochure,
après avoir formé le vœu que nos chers prisonniers reviennent
prendre au plus tôt leur place à leur foyer, seront pour nous
incliner avec respect et gratitude devant les noms de nos héroïques
concitoyens dont les noms, un jour prochain, viendront s’ajouter, sur la
pierre symbolique, à ceux qui ont versé leur sang pour la Patrie.
Avril 1941.]
|
[(1944:)
L’OCCUPATION ]
[(1944:) La vie se
réorganise petit à petit. L’occupant se fait tout d’abord
indulgent et doucereux. Il prodigue les roueries de sa race: insinuant
et bon enfant. Puis, peu à peu, la pointe de fer perce le gant de
velours…. Et il redevient ce qu’il n’a jamais cessé d’être:
orgueilleux, despote et encombrant.
Il
n’est guère de maison, dans notre ville, ne soient occupées
par l’ennemi. Chaque jour un nouvel immeuble est réquisitionné.
Un grand nombre de nos concitoyens, rentrant d’exode, trouvent leur logement
envahi et déjà transformé. Ils doivent se contenter
d’une simple pièce ailleurs. La plupart des notaires, médecins
et avoués de la commune doivent transférer leurs études
et cabinets dans des locaux de fortune.
Un jour, le général
d’armée Weissmann, chef des services allemands de l’air, décide
de s’installer au château de Brunehaut, à 1.200 mètres
de la ville. On peut dire que, dès ce moment, notre cité
est voué au plus tragique destin. Elle deviendra, en effet, avec
ses innombrables officiers, ses installations techniques et ses repaires
secrets, un objectif militaire ennemi de première importance que
l’aviation anglo-américaine assignera au jour dit à ses bombardiers.
Pourtant, au long des quatre années, deux mois et sept jours [p.24] qu’aura
duré l’occupation nazie, Etampes, malgré le nombre considérable
de ses occupants, n’aura eu à souffrir d’aucun incident grave.
En dehors de quelques accrochages passagers entre habitants et envahisseurs,
ou entre administration française et allemande, notre ville ne
connut jamais, Dieu merci, les répressions sanglantes, les otages,
les lourdes amendes de guerre qui frappèrent tant d’autres communes.
Notre cité le dut, tant à la calme dignité de sa
population, qu’à l’intelligente diplomatie de son maire, M. Lejeune,
et de son Conseil municipal, auxquels la plus élémentaire
justice commande de rendre hommage.]
|
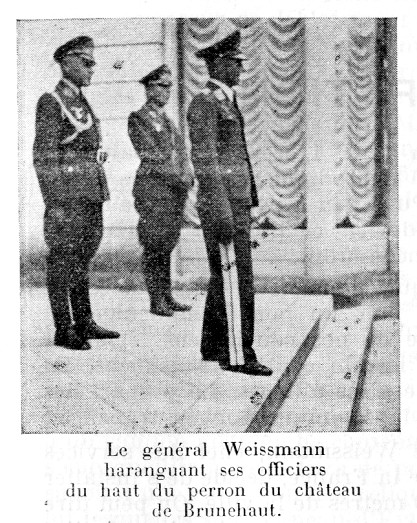 [Photo propre à la seconde édition.]
[Photo propre à la seconde édition.]
|
Sources:
Le brochure de Collard dans sa réédition de 1945, saisie
en 2004 par Bernard Gineste; scan des photographies de la 1ère édition
par François Jousset.
Saisie des variantes de l’édition de 1941 sur un exemplaire de la
collection d’Alain Desgranges.
|