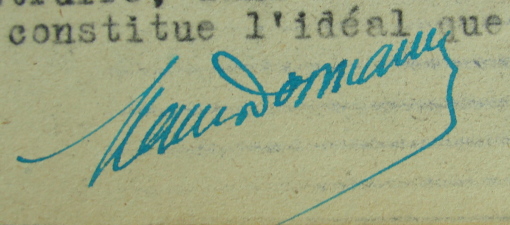|
On était
au mois de janvier 1871, triste et terrible époque, dont le souvenir
malheureux restera toujours inoubliable.
Paris était assiégé.
Chaque jour, de nouvelles
sorties avaient lieu, se traduisant soit par de simples escarmouches, soit
par de véritables combats entre les avant-postes des deux armées.
Chacune d’elles était plus meurtrière encore que la précédente
et la liste des morts et des blessés venait s’ajouter à celle
de la veille.
Succombant sans céder
sous le nombre, mais jamais découragés, les Français
gardaient l’espoir d’arriver enfin à repousser ces Allemands maudits
et sortir de l’enfer qui les enserrait.
A la tête d’un des
régiments les plus avancés de la garde nationale, se trouvait,
en qualité de commandant, Jean Romowski, né en Pologne d’une
mère française, qui, depuis quelques années, avait
quitté son pays d’origine pour venir à Paris, tirer parti
de son habileté de sculpteur.
Au moment où se
passent les faits dont nous parlons, les bataillons de la garde nationale
venaient de se former, composés de courageux citoyens, prêts
à verser la dernière goutte de leur sang pour la défense
du sol sacré de la patrie.
Jean Romowski avait été
d’une voix unanime, à ce moment, choisi par les habitants de son
quartier à titre de commandant, son courage, son sang-froid et l’énergie
dont il avait fait preuve, lui avaient valu cet honneur. Il avait d’abord
refusé, en invoquant sa qualité d’étranger, mais se
déclarant fier du choix de ses amis. Il était prêt, disait-il,
comme les autres à répandre son sang pour repousser l’envahisseur
de sa patrie adoptive, mais il était de son devoir de décliner
tout grade et de laisser le commandement à un plus digne.
L’insistance des siens
vint à bout de sa détermination.
Il se vit donc forcé
d’accepter, et ce fut un bien. Dans maintes occasions, le bataillon qu’il
commandait, dirigé avec une indomptable énergie, donna la
mesure de son dévouement, et il fut cité à l’ordre
du jour.
Une sortie devait avoir
lieu le lendemain du jour où se passe ce récit, et, au bivouac,
chacun brûlait de se trouver en contact avec les Prussiens et de leur
infliger une défaite honteuse.
Jean s’était retiré
dans un coin, l’air soucieux, rêveur, et la tête entre ses mains.
A quoi songeait-il? A sa famille peut-être, à sa vieille mère,
dont il était depuis quelque temps sans nouvelles, et aussi à
son jeune frère René, qu’il avait quitté depuis près
de dix ans, alors qu’il était encore enfant, ces êtres chers
qu’il ne reverrait peut-être jamais, une balle ennemie pouvait l’atteindre
le lendemain, il n’aurait pas la dernière consolation d’embrasser
ceux qu’il aimait! Qu’importé, après tout, le devoir est de
marcher: son honneur avant tout; ses hommes comptent sur lui, une défaillance
ne saurait l’arrêter.
Il se lève et ordonne
le repos. Au point du jour, il faudra recommencer l’attaque, chacun doit
être prêt. A ce commandement, les couvertures sont déployées
et quelques minutes après, [p.18] le
silence le plus profond s’étendait sur le bivouac.
Seul, Jean restait debout, les noires idées
de tout à l’heure l’assaillaient obstinément. La crainte lui
est étrangère, elle ne saurait avoir prise sur son énergie.
Il connaît le feu, que de fois l’a-t-il affronté, face à
face avec les lignes prussiennes? Que ses hommes se reposent, il fera seul
la veillée d’armes.
Le jour paraissait à
peine que le bataillon était mis en alarme par les cris des sentinelles.
Tout le monde est debout en un instant, on marche droit à l’ennemi.
Un régiment de uhlans barre le chemin, on ne peut s’y tromper, la
blancheur des uniformes se détache dans la pénombre.
Jean était au premier
rang, encourageant ses hommes de la voix, et leur donnant l’exemple.
La fumée de la première
décharge était à peine dissipée, que soudain
le chef s’arrête, il a pâli... En face de lui, dans les rangs
allemands, il vient de reconnaître son frère, son René
bien-aimé.
Est-ce possible, au milieu
des ennemis de la France! René! Traître aux siens, à
sa famille, à ses traditions! C’est de sa main qu’il périra!
Or, voici ce qui s’était
passé. Le jeune homme avait pris du service dans l’armée des
envahisseurs et conquis l’épaulette d’officier.
Le cœur serré par
la rage, Jean n’hésite plus, il arrache le fusil des mains de l’homme
qui se trouve à ses côtés, épaule met en joue
et fait feu.
Le petit nuage de fumée
produit par la détonation disparaissait à peine, que le corps
de l’officier allemand, la tête fracassée, s’affaissait sur
les côtés de la selle, retenu seulement par la courroie dont
nos ennemis avaient eu la précaution de munir leurs cavaliers dans
le but de permettre au cheval de rapporter au camp celui des leurs que les
balles avaient abattu.
Jean avait, dans un sublime
et héroïque désespoir, tué son propre frère,
ne laissant pas à une main étrangère le soin de cette
suprême action.
Deux larmes tracèrent
leur amer sillon sur ses joues encore plus pâles; le mouvement de
colère, sous l’impulsion duquel il avait agi, était passé,
il ne pensait déjà plus qu’à son devoir.
— En avant! mes enfants!
commandait-il d’une voix ferme.
A cet ordre, le bataillon
s’élançait, baïonnette au canon. Trois pas encore et
Jean tombait, frappé mortellement d’une balle en plein front, en
s’écriant:
— Merci, mon Dieu! Vive
la France!
Maurice DORMANN.
Septembre 1897.
|

Anciens combattants étampois de 1870
(cliché de Paul Royer, vers 1905)
|