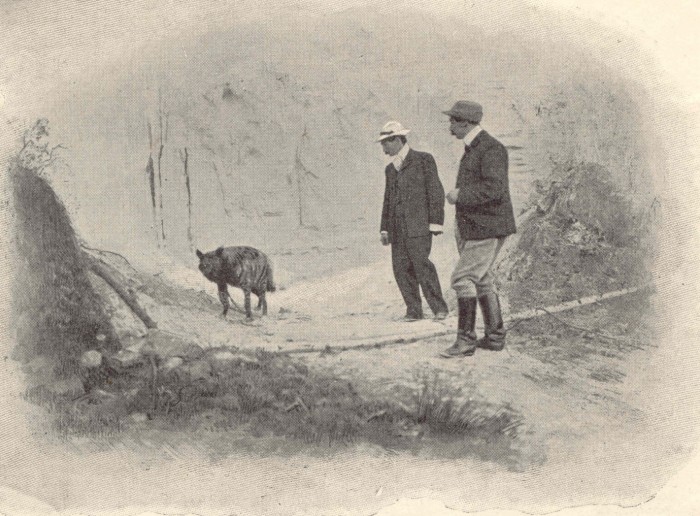|
Edmond Frank
LES AUXILIAIRES
MODERNES DE LA JUSTICE
25 août 1906
Les journalistes
|
Le gendarme
|
Le devin |
Une instruction judiciaire à
Etampes
L’affaire du curé de Châtenay, qui depuis un mois met les
reporters sur les dents et tient le public en haleine, fournit à
notre collaborateur Nozière, en son Courrier de Paris, le
sujet d’une spirituelle fantaisie satirique, où la fiction dépasse
à peine les bornes de la vraisemblance. En effet, au train dont vont
les choses, une réforme radicale du code d’instruction criminelle
et des procédés d’enquête judiciaire ne tardera pas
à s’imposer. Déjà, dans la pratique, les pionniers
de ce progrès avaient devancé le législateur; jamais
encore leur audace novatrice ne s’était affirmée de façon
aussi éclatante.
Brusquement, l’abbé
Delarue disparaît, le 24 juillet, à la grande surprise et
au vif émoi de ses paroissiens et de sa famille. Aussitôt,
la justice — en l’espèce le parquet d’Etampes — de mettre en mouvement
son appareil ordinaire, composé des deux éléments traditionnels:
la police et la gendarmerie. Mais, au même moment, un autre élément
intervient: le quatrième pouvoir, — la presse. Jadis, la presse
se contentait d’enregistrer les actes et les gestes de
dame Thémis et de ses auxiliaires réguliers; c’était
le vieux jeu; aujourd’hui, elle ne craint pas de leur faire concurrence,
de se substituer à eux, agissant pour son compte, de sa propre initiative
et avec ses propres moyens.
Donc, afin de chercher
la piste du prêtre disparu, on a vu des journaux détacher leurs
plus fins limiers, chargés de courir le pays à pied, en voiture,
en wagon, en auto, d’exercer leur flair et leur activité sous toutes
les formes. Celui-ci s’est fié à la seule sagacité d’un
maître reporter ubiquiste; celui-là, «ne reculant devant
aucun sacrifice», a recruté une équipe de trente trappeurs
pour battre la campagne, fouiller les bois, sonder les rivières, et
offert aux explorateurs bénévoles l’appât de 1.000 francs
de récompense; des rivaux ont engagé de véritables
matches à qui arriverait bon premier à, la découverte
de l’abbé, vivant ou mort. Car on flotte, anxieux, en pleine obscurité,
entre l’hypothèse romanesque de la fuite et l’hypothèse dramatique
de l’assassinat. Finalement, cette dernière semble prévaloir
à notre époque un fugitif garde malaisément l’incognito
sous les yeux d’Argus,
constamment en éveil, et, d’ailleurs, des témoignages dignes
de foi démentent les racontars désobligeants trop facilement
répandus touchant la conduite de l’honorable curé.
Cependant, malgré leur ténacité
proverbiale, leur fièvre d’émulation, le stimulant de l’amour-propre
professionnel, les limiers du reportage se fatiguent sans .résultats,
réduits à se poser quotidiennement cette cruelle énigme:
«Où est-il?» à suppléer par des efforts
d’imagination à l’insuffisance de leurs moyens pratiques et à
prédire, au petit bonheur, un problématique «coup de
théâtre».
Alors, une idée
surgit, dont une feuille hebdomadaire, le Pays parisien, revendique
la priorité. Pourquoi n’aurait-on pas recours à l’adjuvant
des sciences occultes? N’est-ce pas une excellente occasion d’en essayer
l’application? Justement, on a sous la main un mage hindou, originaire de
Ceylan, le «professeur» Devah. Sollicité, l’homme bronzé
accorde ses bons offices; il se rend à Etampes, opère sur place,
en présence des journalistes sceptiques et des badauds du cru ébahis,
se livrant à de bizarres simagrées, humant l’air, flairant
des traces présumées comme un chien de chasse, fouissant et
goûtant la terre comme un... chercheur de truffes. Il découvre
un mouton crevé et une bicyclette qui serait celle de l’abbé
Delarue. Bientôt (Paris, décidément, est une ville unique
au monde, où l’on peut se procurer de tout à volonté,
même des fakirs authentiques), apparaît un second mage non moins
hindou, le «professeur» Ramana; son système diffère
essentiellement de celui de son compatriote: astrologue, au lieu de se baisser
vers le sol, il interroge les astres, — et ne découvre rien du tout.
Il est ensuite question de Pickmann, fameux par son extraordinaire faculté
divinatoire.
Enfin, à
côté de ces seigneurs d’importance, l’affaire suscite une
légion de magiciens de moindre acabit: voyantes éveillées,
somnambules extralucides, cartomanciennes; bref, c’est un débordement
soudain d’hypnotisme, d’occultisme, de spiritisme, d’empirisme, tranchons
le mot, de charlatanisme, — phénomène qui ne laisse pas d’être
curieux au vingtième siècle, époque où l’on
professe volontiers le culte de la science positive.
Sans doute le journal le Matin a- t-il
voulu réagir contre cette tendance rétrograde en opposant au
surnaturel le naturel. A son tour, il a eu le mérite d’une innovation,
l’emploi de l’hyène, habile à déterrer les cadavres,
et il a requis le concours d’une sinistre pensionnaire du dompteur Pezon;
mais Carlos (tel est son nom) ne s’est pas montré à la hauteur
de sa tâche: dépaysé, le fauve africain, selon l’expression
populaire, n’a «rien voulu savoir», et cet animal qui ne «travaille»
que la nuit n’a pas réussi à faire la lumière sur
l’angoissant mystère de Châtenay.
|
L’Hindou
Devah ramassant de la terre pour la flairer,
sur la route d’Etampes à Chalo-Saint-Mars
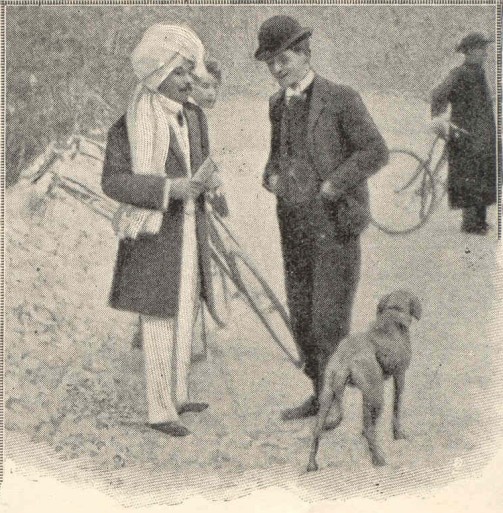 L’Hindou
Ramana
L’Hindou
Ramana
|
On continue donc de se perdre en conjectures, et des copieuses informations
publiées jusqu’à présent à ce sujet, nous ne
pouvons guère que tirer deux moralités. Premièrement,
c’est que, par une singulière antinomie, certains nouveaux procédés,
prétendus «scientifiques», sont, peut-être en
vertu du dicton: «Les extrêmes se touchent», empruntés
aux pratiques primitives des âges les plus reculés, et que,
en l’an de grâce 1906, aux champs, à la ville, dans le salon
de la comtesse et dans la boutique de Figaro, des
gens discutent encore sérieusement du merveilleux. Secondement, c’est
que le pouvoir judiciaire doit désormais s’accommoder de ses modernes
auxiliaires.
La presse en est le principal, et — veuillez
bien noter la gradation — après lui avoir apporté. d’abord
son concours direct, voilà qu’elle y joint celui des empiriques
et celui des bêtes. Est-ce un bien? Est-ce un mal? En tout cas, un
fait reste acquis : le gendarme n’est plus que le bras gauche de la.
justice; le journaliste en est devenu le bras droit.
EDMOND FRANK.
|
Les
journalistes
|
Le gendarme
|
Le devin
|
|
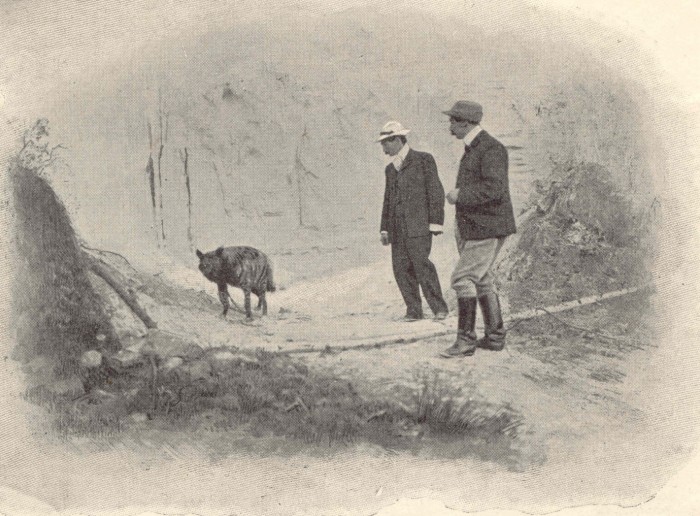
Le dompteur Pezon
et son hyène
L’Illustration n°3313
du 25 août 1906, page 120
|
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
Edmond FRANK, «Les nouveaux auxiliaires de la justice» [avec 4 illustrations], in L’Illustration
3313 (25 août 1906), p. 120.
Jean-Michel ROUSSEAU [éd.],
«Edmond Frank: Les nouveaux auxiliaires
de la justice (sur l’affaire du curé de Châtenay, Illustration
du 25 août 1906)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-edmondfrank19060825curedechatenay.html, 2007.
Sur cette affaire
Jean-Michel
DUHART, «Le curé de Chatenay a disparu», in C.L.C.
(Carte postales et Collection) 107 (janvier-février
1987), pp. ?-?.
Jean-Michel ROUSSEAU
& Bernard GINESTE [éd.],
«Pierre Royer (P.R): Route d’Étampes à Chalo-Saint-Mard
(à la recherche du curé de Chatenay, 1906)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cpa-es-royer1906chatenay.html, 2006.
Quelques publications
d’Edmond Frank
Edmond Franck (1846-1911), journaliste, correspondant
parlementaire, collabora au Bien public et au Journal des débats;
il fut rédacteur à L’Écho universel et secrétaire
de rédaction au Petit Parisien. Il a aussi publié quelques
romans et fut membre de la Société des gens de lettres.
|
Edmond
FRANK (journaliste et romancier, 1846-1911), Histoire de l’Assemblée nationale de 1871, depuis le
8 février 1871 jusqu’au 24 mai 1873 [in-18; 407 p.], Paris, A.
Le Chevalier, 1873.
Edmond FRANK, La Maison fermée.
3e édition [in-8; 324 p.], Paris, G. Robert, 1885.
Edmond FRANK, Le réveillon
du père Buirette [28 cm; 8 p.; illustrations], Paris, L’Illustration
[«Supplément au n°» 3016 (15 décembre 1900)],
1900.
Edmond FRANK, Le Crime de Clodomir
Busiquet, roman [in-16; 307 p.], Paris, A. Fontemoing [«Minerva»],
1905.
Edmond FRANK [éd.], Paul MARROT
(né en 1851) [auteur], Le Charme. Lazare (poésies posthumes).
Œuvres choisies [in-16; XVI+260 p.], Paris, A. Fontemoing [«Minerva»],
1908.
Toute critique, correction
ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|