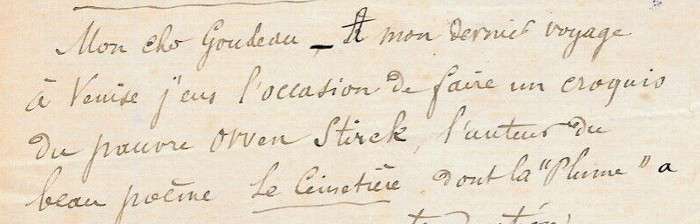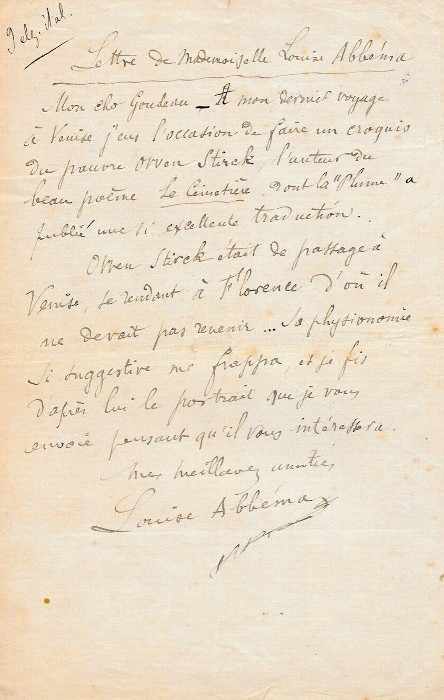|
ANNEXE
TROIS POÈMES D’OWEN STIRCK
ET LES NOTES SUR CE POÈTE DE SON TRADUCTEUR
1. — Le Cimetière
Nous y joignons à titre de curiosité une version anglaise
qu’en a composée et mise en ligne en 2006 Raymond E. André
III
Notre confrère Émile Goudeau nous communique le poème
suivant qui lui a été transmis par le traducteur. L’auteur,
un jeune poète anglais, Owen Stirck, mort récemment à
Florence d’une maladie de langueur, était un artiste dans le sens
le plus élevé de ce terme. Nous publierons plus tard les meilleures
pages inédites de cet exquis poète.
L. D. (Léon Deschamps)
|
Our colleague Émile Goudeau sent to us the following poem,
which was sent to him by the translator. The author, a young English poet,
Owen Stirck, deceased recently in Florence of an illness of languor (lingering
illness), was an artist in the most elevated sense of the term.
|
|
Le Cimetière
— Mon cœur ressemble à un cimetière.
Les morts y sont couchés si nombreux qu’il n’y
a plus de place.
— Les plantes sauvages croissent, superbes, sur la
corruption,
— Mon cœur ressemble à un cimetière.
Au milieu des touffes épaisses de la ciguë,
de la belladone, de la jusguiame, du datura aux calices malsains, d’anciennes
fleurs autrefois plantées, autrefois soignées, surgissent
pâles, délicates, tristes et belles,
— Les morts sont couchés si nombreux qu’il n’y
a plus de place.
L ’herbe vivace disjoignit les pierres, le temps effaça
les noms jadis gravés. Les croix funéraires, dans un geste
suprême, étendent lamentablement leurs bras noirs sans couronnes.
Elles seules indiquent le lieu où Ils reposent.
— Les plantes sauvages croissent, superbes, sur la
corruption.
Les grilles sont fermées, les clefs, désormais
inutiles, perdues; personne ne se souvient, personne ne songe à traverser
le cimetière abandonné, les murs roulent sur eux-mêmes,
s’effritent, s’entassent, et forment une ceinture de ruines.
— Mon cœur ressemble à un cimetière.
— Les morts sont couchés si nombreux qu’il n’y
a plus de place.
— Les plantes sauvages croissent, superbes, sur la
corruption.
Nul ne sait ceux qui dorment là. Nul ne connaît
leurs noms, moi excepté. Je sais où trouver leurs noms. Dans
les nuits sombres je les appelle tout bas, ils se dressent livides, au milieu
des touffes épaisses de la ciguë, de la belladone, de la jusquiame
et du datura aux calices malsains:
Ceux qui m’ont torturé.
Ceux qui m’ont trahi.
Ceux qui m’ont persécuté.
Ceux qui m’ont fait au cœur une blessure dont le sang
coule encore.
Les voilà, les voilà tels que je les
ai enterrés vivants, sous une pluie de cendre et de feu, dans l’amer
linceul de mes souvenirs.
Les grilles sont fermées.
Les clefs, inutiles, perdues.
D’anciennes fleurs autrefois plantées, autrefois
soignées, surgissent pâles, délicates, tristes, belles
et voilent le secret des noms.
— Les morts sont si nombreux qu’il n’y a plus de place.
Mon cœur ressemble à un cimetière abandonné.
Owen Stirck.
|
Cemetery
— My
heart seems a cemetery.
The dead therein lie so numerous that no empty place
remains.
— Spreading
weeds, and haughty, surmount this corruption.
— My
heart seems a cemetery.
Among dense tufts of hemlock, belladonna, henbane,
of datura with its deleterious calyxes, of ancient flowers planted in far-off
days, tended long ago, arising pale, delicate, sad and beautiful.
— The
dead therein lie so numerous that no empty place remains.
The tenacious grass dislocates the stones; time effaces
the bygone names engraven there. The funerary crosses, in a last gesture,
lamentably extend their truncated black arms. They alone mark the place
where each corse lies.
— Spreading
weeds, and haughty, surmount this corruption.
The iron gates are closed, the keys useless from now
on, lost; no one remembers them; no one dreams of crossing the abandoned
cemetery, the walls wend their ways, crumbling into dust, crowding together,
and forming an enclosure to this place of ruin.
— My
heart seems a cemetery.
— The
dead therein lie so numerous that no empty place remains.
— Spreading
weeds, and haughty, surmount this corruption.
No one knows those who sleep there. No one knows their
names, save myself. I know where to find their names. On somber nights
I invoke them in low voice; they arise pallid, among dense tufts of hemlock,
belladonna, henbane, of datura with its deleterious calyxes.
Those who have tortured me.
Those who have betrayed me.
Those who have persecuted me.
Those who have made upon my heart a wound from which
the blood still pours.
They are there, they are there just as I’d buried them
alive, under a rain of ash and of fire, in the bitter shroud of my memories.
The iron gates are closed, the keys useless, lost.
Of ancient flowers planted in far-off days, tended
long ago, arising pale, delicate, sad, beautiful and concealing the secret
of names.
— The
dead therein lie so numerous that no empty place remains.
My heart seems an abandoned cemetery.
Owen Stirck
(Translation: Raymond E. André III, 2006)
|
2. — Le Lac Noir
|
LE LAC NOIR
Sous les sapins livides semblables à des spectres,
entouré de pics aux profondes déchirures où nulle herbe
ne poussa,
de rochers monstrueux, de précipices béants, s’étend
le LAC NOIR aux eaux profondes.
Là depuis des Siècles et des Siècles
veille le Monstre des Sept Douleurs.
Sur les flots pesants, jamais repu, gueule ouverte,
il jette dans l’universelle désolation son cri d’appel.
Les désespérés tressaillent jusqu’aux
os. Dans la nuit qui les cerne de toutes parts, ils se lèvent à
sa voix cherchant à tâtons le chemin qui conduit vers Lui.
Vers le Monstre des SEPT DOULEURS.
Nul n’indique la route à suivre.
Ceux qui sont revenus perdirent le souvenir.
De lourdes ténèbres cachent le lieu
funeste.
Moi, j’ai marché dans la brume épaisse
des jours d’été,
Dans l’âpreté des nuits d’hiver,
Sous des cieux sans astres, j’ai marché afin
d’arriver jusqu’à Celui qui boit le sang des âmes, et leur
donne l’Oubli.
|
II
Je suis arrivé sous les sapins livides semblables
à des spectres,
Au bord du LAC NOIR où veille le MONSTRE des
SEPT DOULEURS.
Il a senti venir sa proie; ses yeux rouges ont brillé
de convoitise; j’ai mesuré la profondeur
de sa gueule béante, — abîme sombre, terrible, définitif
où allaient enfin, à jamais disparaître,
les Tortures de mon passé.
Avant de me séparer d’Elles j’ai voulu les revoir,
Une à une je les ai appelées,
Elles sont venues, etse sont dressées devant
moi, pâles, farouches, saignantes,
Je les ai reconnues.
O toi! qui la première creusas le moule strict
et profond de la douleur dans mon cœur vierge, toi, lâche trahison
de l’ami.
Toi! perfidie des lèvres adorées, mensonge
des tendres yeux bleus.
Toi, cruauté des miens.
Toi, hautaine indifférence de mes frères,
rires moqueurs qui glacèrent mon âme;
Ingratitude de ceux que j’aimais;
Outrages du monde méprisant; froideurs, injustices,
calomnies;
Brutalité des Forts,
Attaques sournoises des Faibles,
Ignominies humaines dont l’amer dégoût
a troublé mon cerveau,
Blessures empoisonnées, terrifiantes qui jamais
ne guérirez,
Plaies cruelles, qu’un regard fait saigner,
Souvenirs obsédants qui chassez le sommeil et
peuplez l’insomnie de fantômes,
Vous le savez maintenant,
Vous le savez! je n’ai qu’à me pencher vers
le Lac Noir.
Mes lèvres boiront ses eaux pesantes, et le
Monstre des Sept Douleurs, Celui qui veille depuis des
Siècles et des Siècles,
Vous arrachera de mon cœur,
Vous déchirera de ses dents aiguës,
Vous mettra en lambeaux, ô vous les féroces!
Ô vous les dévoratrices!
Il ne demeurera en moi aucun souvenir de vos morsures.
La paix sera sur mon âme.
Je serai pareil à Celui qui vient de naître
à la Vie.
|
|
III
Je les chassais devant moi, mes Tortures, comme un
troupeau de bêtes malfaisantes, les
flagellant de ma colère, ivre d’une sauvage joie,
Je les chassais jusqu’aux flots noirs, jusqu’au Monstre
qui veille sur ses eaux profondes
Et tout d’un coup, — dernier déchirement plus
âpre, que tous ceux, naguère connus — tressaillement de ma
chair arrachée — effondrement terrible de mon Moi,
Je les ai vues subitement disparaître mes Tortures
sous la dent du Monstre dans les flots noirs,
Tel était leur nombre, tel était leur
poids que les flots se sont élevés jusqu’aux sommets des pics
aux profondes déchirures, ils ont comblé les précipices.
Ils se sont joints aux nuages sombres qui toujours
pesaient sur eux,
Le ciel s’est abaissé,
et je n’ai eu devant mes yeux terrifiés qu’un
mur,
Un mur mouvant, sombre, liquide, où flottaient
ensanglantées, les épaves de mes douleurs,
noyées... mortes.
|
IV
Alors, j’ai marché dans la brume épaisse
des jours d’été,
Dans l’âpreté des nuits d’hiver cherchant
à reconnaître mon chemin.
J’en avais perdu le souvenir, et j’étais seul
dans une immensité morne.
J’ai voulu pleurer, mes yeux sont sans larmes.
Crier, ma voix n’a plus de son;
Appeler, j’ai oublié le nom de Celui qui aurait
pu me secourir.
J’ai regardé en moi. J’ai vu que mon cœur vide
était criblé de trous énormes : maison démolie,
rempart démantelé, ruines amoncelées; effrayante solitude
d’une Chose détruite.
Mon âme est sans prière,
Les mots n’ont plus de sens.
Épouvanté du vide, écrasé
par le néant, je ferme les yeux.
Qui donc me fera saigner le cœur?
Qui en fera se rouvrir les blessures de la Vie?
.......................................
Sur la terre glacée, sous un ciel sans astres,
le front caché, j’attends dans le Noir que l’éternelle Nuit
commence.
Owen Stick
|
3. — Amour
AMOUR
Mes lèvres sont vierges, vierge mon âme,
vierge mon corps. — J ’ai fui les hideuses matérialités de
l’amour; — j’ai reculé, éperdu, devant les caresses impures,
— les abandons honteux, l’accouplement
sinistre.
— Je descendrai chaste dans la froideur du tombeau
—
— Mes lèvres sont vierges, vierge mon âme,
vierge mon corps. —
— C’est vainement que j’ai cherché une âme.
— en tous lieux je l’ai cherchée — je n’ai vu que des filles aux
regards lascifs — aux bouches sensuelles, avides de l’étreinte des
mâles.
Elles tressaillent à leur approche comme des
cavales, — les flancs palpitants, la gorge en émoi.
— Leur front se couvre des rougeurs ardentes de
l’attente exaspérée.
— Je me suis détourné d’elles, j’ai
méprisé leur beauté, — j’ai bouché mes oreilles
pour ne point entendre leurs paroles — et fermé mon cœur pour qu’aucune
d’elles n’y entrât — et ne s’en rendit par surprise la maîtresse.
Une seule fois, — une seule, — mes lèvres se
sont posées, — sur le front pur d’une vierge pure, — enfant déjà
grave, silencieuse, — farouche aux hommes, et si pâle, si aérienne
— si venue d’en-haut qu’elle semblait née — d’un rayon de lumière
et des nuées transparentes, — qui montent le matin de la surface
des lacs endormis. —
Elle ne savait rien de la Vie, et n’en voulut rien
apprendre. — Toutes les tristesses accumulées de sa race — tous ses
dégoûts, ses révoltes, ses amertumes elle les avait pressentis,
— et les portait dans son âme endolorie — comme une expiation des crimes
du passé.— Son ineffable pureté rachetait victorieusement les
corruptions anciennes.
Elle quitta la terre subitement — Comme un ange rappelé
de son exil — sans les .noîtes agonies, et les répugnantes
destructions de la chair. — (Aucune misère humaine ne devait atteindre
sa beauté). — Toute vêtue de blanc, d’un blanc de vapeurs,
d’un blanc immaculé, — dans la paix solennelle d’un jour d’été,
— le sourire de l’extase sur les lèvres, elle tomba morte —
|
Sur son lit de vierge on l’étendit — semblable
à une statue de marbre — sculptée par un artiste divin —
Ses longs cheveux d’un
or si pâle, — encore simples et vivants flottaient autour d’elle —
mêlés à des fleurs défaillantes — Lys, jasmins,
et verveines propices à l’enchantement.
J’ai soulevé d’une main tremblante — les longues
boucles blondes d’ou émanaient des parfums subtils — je les ai portées
à mes lèvres — et j’ai scellé d’un mystique baiser
nos mystiques fiançailles. Mes yeux arides, pour la première
fois se sont remplis de larmes — larmes d’amour — larmes de douleur, larmes
de joie — j’ai chanté dans mon cœur le cantique de la délivrance
— la délivrance d’une créature humaine —
Fleur des albes puretés — âme de neige
nouvellement tombée — Cristal sans tâche des sources polaires
— intacts désormais — jamais souillés — jamais flétris
— éternellement vous garderez votre forme première.
Ô toi la seule vraiment
divine parmi les filles des hommes — Douce rêveuse d’étoiles,
où es-tu? toi la seule que j ’ai aimée — Si céleste!..,
que mon amer scepticisme se fondait devant la limpidité de tes yeux,
— et que je balbutiais en te voyant si candide, — les anciennes prières
aujourd’hui glacées sur mes lèvres..
Avant toi — rien — Après toi, ton souvenir
vivant. — Amour unique, amour définitif — Union étroite
des fluides magnétiques — flamme pure confondue dans une autre
flamme — s’élançant par un effort puissant hors du monde connu
— dans le mystérieux Au-Delà — vers les Eternelles Sérénités.
J’ai fui les hideuses matérialités,
—- j’ai reculé éperdu devant les caresses impures, — les abandons
honteux,
l’accouplement sinistre. —
— Pour te retrouver âme vivante et désenchaînée,
—
— Je descendrai chaste dans la froideur du tombeau
—
Et garderai vierge mon cœur, vierges mes lèvres,
— qui jamais n’ont baisé que l’or pâle de tes cheveux.
|
NOTES
sur le Poète anglais OWEN STIRCK
C’est à
Rome en 1886 que je connus Owen Stirck. Je le rencontrai d’abord fréquemment
soit, errant à la tombée du jour sous les grands ombrages de
la villa Borghèse, soit assis dans un des coins les moins fréquentés
du jardin Pamphile, soit au Colosséo, les soirs où éclairées
par la lune, les ruines apparaissent gigantesques et fantastiques. Je l’avais
remarqué, mais j’ignorais son nom. Une sympathie irrésistible
me poussait, moi très triste, très désespéré,
vers ce jeune homme toujours seul, cheminant avec lenteur comme absorbé
par une intense méditation. Un visage beau quoique d’une excessive
pâleur, et toute la personne infiniment distinguée. Mais ce
qui le rendait suggestif au dernier degré, c’était ses yeux
d’une ’couleur indécise, très grands sous des paupières
lourdes, et d’une profondeur de rêve si saisissante, si particulière,
qu’on avait à les entrevoir le frisson que vous donne une chose inconnue
et la subite impression d’abîmes mystérieux, d’où montaient
de très loin, des ombres et des lueurs changeantes. La première
fois qu’il fixa sur moi ses extraordinaires prunelles, je ne pus me défendre
d’une vive émotion, tandis qu’attiré par le magnétisme
qui venait d’elles je me rapprochai de lui. Ce fut sur la terrasse du Pincio;
nous nous trouvions seuls, l’heure de la promenade étant passée.
Un orage violent s’amoncelait sur les collines en face de nous; des nuées
rousses, violâtres, traversées par la lividité des éclairs,
se nouaient, se dénouaient, tout en montant rapidement sur Rome qu’elles
commençaient à couvrir de leurs grandes ombres mobiles. Spectacle
fort beau! Je le dis à haute voix. Owen Stirck se retourna, me regarda
longuement, et me répondit, — chose étrange — par la phrase
que justement j’attendais de lui. Depuis cette heure, depuis ce jour,
je devins son fidèle compagnon, son ami dévoué, le seul
qui soit resté près de lui, le seul qu’il ait voulu à
son chevet, durant les sombres périodes où il implorait la
Mort libératrice en objurgations passionnées, le seul dans
les mains duquel il ait remis ses manuscrits, en lui confiant le soin d’en
publier une partie.
Owen Stirck est né en Écosse au mois
de janvier 1862. Il avait dix ans quand après un drame de famille,
qu’il ne m’appartient pas de divulguer, sa mère quitta son pays et
vint avec son fils et ses deux filles s’établir en Italie, après
un bref séjour à Genève. Owen ressentit une lourde tristesse
de cette installation définitive dans un pays qui n’était
pas le sien. Il regrettait, sous le brûlant soleil de Rome, et de
Naples, les brumes de son Écosse, et, devant nos fleuves taris
par la sécheresse des étés trop chauds, les lacs clairs
et les brises froides de ses montagnes.
«Qui me rendra les brumes, les ouates floues
qui enveloppent les contours — où sont-elles les nuées légères
qui adoucissent les angles — atténuent les vigueurs cruelles— dissimulent
la léprosité des murs — et la hideur des formes laides? —
— Et aussi ces nuées, ces brouillards, ces brumes,
— voilant de leurs manteaux, ce que les vices et les crimes humains — ce
que les péchés ont d’abject, ce que les voluptés ont
d’horrible.
— Loin du soleil, dans les vapeurs flotteuses — qui
joignent le ciel à la terre — je me sentais vivre dans un rêve
à peine distinct; — tout à coup on a déchiré les
nuées, — la lumière s’est faite, — j’ai eu la vision nette de
l’existence humaine, — criminelle, basse, abjecte, et je l’ai prise en abomination.—»
Il écrivait encore.
«Je meurs du soleil qui devait me faire vivre.
— Au lieu des fantômes, pâles qui bercèrent mes premiers
ans, — le rude spectre solaire m’est apparu — il a tué mon corps
sous ses flèches acérées; — mon esprit sous son aveuglante
clarté. — Je suis un fils de Niobé. — L’Apollon maudit, —
me refuse la pénombre des cieux voilés, — des monts ennuagés
— des longs voiles que déchire à peine l’Aurore — Soit! Mais
plutôt que de voir sous la lumière crue s’étaler impudemment
l’humaine ignominie — je me plongerai volontairement dans la douce ténèbre
— dans la douce ténèbre de la miséricordieuse Mort
— pour y goûter à jamais la paix des sommeils introublés.»
|
L’impression
qu’avait laissée en son esprit déjà morbide l’évènement
qui sépara sa famille, ne fit que s’accroître avec le temps.
A dix-huit ans, Owen fuyait le monde et refusait d’assister aux fêtes
que donnait sa mère dans la villa qu’elle venait d’acquérir
à quelques milles de Florence. A cette époque encore il fut
frappé d’une grande douleur qui devait influencer sa brève existence
et lui donner cet amer dégoût de toutes choses qui est la caractéristique
de son talent. Quel spectacle frappa ses yeux purs? Quelle faute fut commise?
Quelle soudaine révélation des grossièretés de
la vie reçut-il? Je l’ignore. Toujours est-il qu’il quitta brusquement
sa mère et ses sœurs, et ne voulut jamais les revoir. Désormais
il vécut seul en proie à une misanthropie farouche, ne se
fixant nulle part; allant de Pise à Rome, de Rome à Venise,
de Venise à Naples, s’embarquant pour de lointains voyages. Son premier
désir en quittant sa famille fut de retourner e nÉcosse;
il écrivit à ce sujet à son père, son père
refusa de le recevoir; il se sentit banni par lui, en comprit sûrement
le motif, etcntinua plus désespérément encore sa vie
errante. Il y avait une nouvelle blessure dans son âme,au fond si tendrement
exaltée.
Aucune joie dans son existence — pas même celle
que les plus déshérités peuvent obtenir. Owen n’aima
jamais, car jamais il ne trouva la femme de son rêve ardent et mystique
: Ame vierge, dans un corps vierge, et si haute, si pure a’esprit, si détachée
de l’humanité, qu’elle eut accepté, comme seule étant
d’ailleurs possible, une union immatérielle. Je dois Je dire —
Owen avait pour les manifestations de l’amour une horreur profonde. C’était
s’assimiler aux bêtes, disait-il, et il trouvait pour les flétrir,
lui si chaste et si vague, des vers d’une altière cruauté, malheureusement
impossible à citer.
Si d’aventure dans nos courses nous rencontrions appuyés
l’un sur l’autre deux jeunes amoureux aux regards noyés, Owen Stirck
détournait la tête avec un dégoût qu’il ne cherchait
point à leur dissimuler. Un jour à Bagni di Lucca, ayant vu
au balcon de l’hôtel un homme baiser longuement une femme sur les
lèvres, puis attirer celle-ci dans une chambre, dont ils fermèrent
aussitôt les volets, Owen quitta l’appartement qu’il occupait au-dessus
d’eux, l’hôtel même et ne voulut plus y rentrer. Quand ses sœurs
se marièrent il refusa d’assister au mariage et partit pour le Tyrol
afin, disait-il, de chasser de son esprit, l’obscène et repoussante
image d’une nuit de noces; mais en revanche il envoya un chèque de
cent mille francs à chacune des jeunes épouses. L’argent n’existait
pas pour cet être si noble et si beau. Quiconque lui en demandait
en. recevait avec libéralité. Il est mort presque pauvre.
Depuis longtemps la fièvre ne le quittait guère,
mais il ne parlait jamais de sa maladie et ne consultait aucun médecin.
Il s’en allait rapidement, il le savait, il en était heureux. — «Je
vais enfin pouvoir dormir — me dit-il un soir — il était tourmenté
par de longues insomnies, — pour la première fois depuis des mois je
sens venir le sommeil; si je ne me réveillais pas... Addîo caro,
addio per sempre, là Mort me sera moins cruelle que la Vie.»
Je ne voulus pas le quitter et tint longtemps sa main dans les miennes.
Au jour naissant, il fit un mouvement, ouvrit les yeux et les fixa sur les
miens. Je vis dans ces yeux magiques la mort qui arrivait; je détournai
la tête pour cacher mes larmes, quand je le regardai de nouveau Owen
Stirck n’existait plus; son visage avait déjà repris sa mystérieuse
beauté et, sur ses lèvres fermées désormais, je
vis éclore le sourire immuable de l’éternelle paix.
Le traducteur des œuvres
d’Owen Stirck.
|
|