|
ANNEXE
LE PORTRAIT DE LA DUCHESSE JOSIANE PAR VICTOR HUGO
dans L’Homme qui rit (1869)
Quoi qu’il en
soit de notre hypothèse, il est intéressant de se reporter
au texte du Victor Hugo qui est à la source du Portrait de la Duchesse
Josiane qu’à donné Louise Abbéma en 1875.
LA DUCHESSE JOSIANE
I
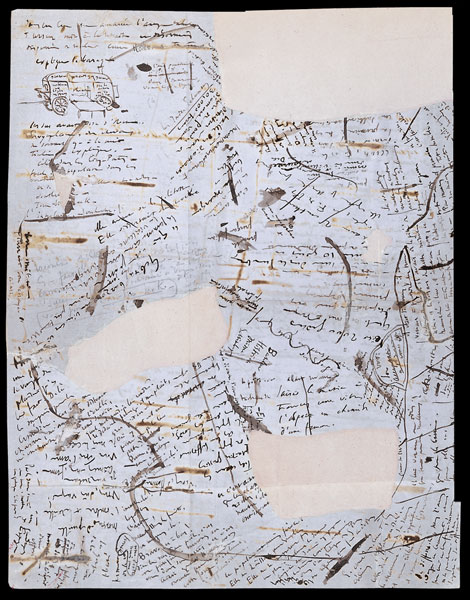 Vers 1705, bien que lady Josiane eût vingt-trois
ans et lord David quarante-quatre, le mariage n’avait pas encore eu lieu,
et cela par les meilleures raisons du monde. Se haïssaient-ils?
Vers 1705, bien que lady Josiane eût vingt-trois
ans et lord David quarante-quatre, le mariage n’avait pas encore eu lieu,
et cela par les meilleures raisons du monde. Se haïssaient-ils?
Loin de là. Mais ce qui ne peut vous échapper
n’inspire aucune hâte. Josiane voulait rester libre; David voulait rester
jeune.
N’avoir de lien que le plus tard possible, cela lui semblait
un prolongement du bel âge. Les jeunes hommes retardataires abondaient
dans ces époques galantes; on grisonnait dameret; la perruque était
complice, plus tard la poudre fut auxiliaire. A cinquante-cinq ans, lord
Charles Gerrard, baron Gerrard des Gerrards de Bromley, remplissait Londres
de ses bonnes fortunes.
La jolie et jeune duchesse de Buckingham, comtesse de
Coventry, faisait des folies d’amour pour les soixante-sept ans du beau Thomas
Bellasyse, vicomte Falcomberg. On citait les vers fameux de Corneille septuagénaire
à une femme de vingt ans: Marquise, si mon visage. Les femmes aussi
avaient des succès d’automne, témoin Ninon et Marion. Tels
étaient les modèles.
Josiane et David étaient en coquetterie avec une
nuance particulière. Ils ne s’aimaient pas, ils se plaisaient. Se côtoyer
leur suffisait. Pourquoi se dépêcher d’en finir? Les romans
d’alors poussaient les amoureux et les fiancés à ce genre de
stage qui était du plus bel air. Josiane, en outre, se sachant bâtarde,
se sentait princesse, et le prenait de haut avec les arrangements quelconques.
Elle avait du goût pour lord David. Lord David était beau, mais
c’était pardessus le marché.
Elle le trouvait élégant.
Être élégant, c’est tout. Caliban
élégant et magnifique distance Ariel pauvre. Lord David était
beau, tant mieux; l’écueil d’être beau, c’est d’être fade;
il ne l’était pas. Il pariait, boxait, s’endettait. Josiane faisait
grand cas de ses chevaux, de ses chiens, de ses perles au jeu, de ses maîtresses.
Lord David de son côté subissait la fascination de la duchesse
Josiane, fille sans tache et sans scrupule, altière, inaccessible et
hardie. Il lui adressait des sonnets que Josiane lisait quelquefois. Dans
ces sonnets, il affirmait que posséder Josiane, ce serait monter jusqu’aux
astres, ce qui ne l’empêchait pas de toujours remettre cette ascension
à l’an prochain. Il faisait antichambre à la porte du cœur de
Josiane, et cela leur convenait à tous les deux. A la cour on admirait
le suprême bon goût de cet ajournement. Lady Josiane disait: C’est
ennuyeux que je sois forcée d’épouser lord David, moi qui ne
demanderais pas mieux que d’être amoureuse de lui!
Josiane, c’était la chair. Rien de plus magnifique.
Elle était très grande, trop grande. Ses cheveux étaient
de cette nuance qu’on pourrait nommer le blond pourpre. Elle était
grasse, fraîche, robuste, vermeille, avec énormément d’audace
et d’esprit. Elle avait les yeux trop intelligibles. D’amant, point; de chasteté,
pas davantage. Elle se murait dans l’orgueil. Les hommes, fi donc! un dieu
tout au plus était digne d’elle; ou un monstre. Si la vertu consiste
dans l’escarpement, Josiane était toute la vertu possible, sans aucune
innocence. Elle n’avait pas d’aventures, par dédain; mais on ne l’eût
point fâchée de lui en supposer, pourvu qu’elles fussent étranges
et proportionnées à une personne faite comme elle. Elle tenait
peu à sa réputation et beaucoup à sa gloire. Sembler
facile et être impossible, voilà le chef-d’œuvre. Josiane se
sentait majesté et matière. C’était une beauté
encombrante.
Elle empiétait plus qu’elle ne charmait. Elle marchait
sur les cœurs. Elle était terrestre. On l’eut aussi étonnée
de lui montrer une âme dans sa poitrine que de lui faire voir des ailes
sur son dos. Elle dissertait sur Locke. Elle avait de la politesse. On la
soupçonnait de savoir l’arabe.
Être la chair et être la femme, c’est deux.
Où la femme est vulnérable, au côté pitié,
par exemple, qui devient si aisément amour, Josiane ne l’était
pas. Non qu’elle fût insensible.
L’antique comparaison de la chair avec le marbre est absolument
fausse. La beauté de la chair, c’est de n’être point marbre;
c’est de palpiter, c’est de trembler, c’est de rougir, c’est de saigner; c’est
d’avoir la fermeté sans avoir la dureté; c’est d’être
blanche sans être froide; c’est d’avoir ses tressaillements et ses
infirmités; c’est d’être la vie, et le marbre est la mort. La
chair, à un certain degré de beauté, a presque le droit
de nudité; elle se couvre d’éblouissement comme d’un voile;
qui eût vu Josiane nue n’aurait aperçu ce modelé qu’ travers
une dilatation lumineuse. Elle se fût montrée volontiers à
un satyre, ou à un eunuque. Elle avait l’aplomb mythologique.
Faire de sa nudité un supplice, éluder un
Tantale, l’eût amusée.
Le roi l’avait faite duchesse, et Jupiter néréide.
Double irradiation dont se composait la clarté étrange de cette
créature, A l’admirer on se sentait devenir païen et laquais.
Son origine, c’était la bâtardise et l’océan.
Elle semblait sortir d’une écume. A vau-l’eau avait été
le premier jet de sa destinée, mais dans le grand milieu royal. Elle
avait en elle de la vague, du hasard, de la seigneurie, et de la tempête.
Elle était lettrée et savante. Jamais une passion ne l’avait
approchée, et elle les avait sondées toutes. Elle avait le
dégoût des réalisations, et le goût aussi. Si elle
se fût poignardée, ce n’eût été, comme Lucrèce,
qu’après. Toutes les corruptions, à l’état visionnaire,
étaient dans cette vierge.
C’était une Astarté possible dans une Diane
réelle. Elle était, par insolence de haute naissance, provocante
et inabordable.
Pourtant elle pouvait trouver divertissant de s’arranger
elle-même une chute. Elle habitait une gloire dans un nimbe avec la
velléité d’en descendre, et peut-être avec la curiosité
d’en tomber. Elle était un peu lourde pour son nuage. Faillir plaît.
Le sans-gêne princier donne un privilège
d’essai, et une personne ducale s’amuse où une bourgeoise se perdrait.
Josiane était en tout, par la naissance, par la beauté, par
l’ironie, par la lumière, à peu près reine. Elle avait
eu un moment d’enthousiasme pour Louis de Boufflers qui cassait un fer cheval
entre ses doigts. Elle regrettait qu’Hercule fût mort.
Elle vivait dans on ne sait quelle attente d’un idéal
lascif et suprême.
Au moral, Josiane faisait penser au vers de l’épître
aux Pisons: Desinit in piscem.
Un beau torse de femme en hydre se termine.
C’était une noble poitrine, un sein splendide harmonieusement
soulevé par un cœur royal, un vivant et clair regard, une figure pure
et hautaine, et, qui sait? ayant sous l’eau, dans la transparence entrevue
et trouble, un prolongement ondoyant, surnaturel, peut-être draconien
et difforme. Vertu superbe achevée en vices dans la profondeur des
rêves.
II
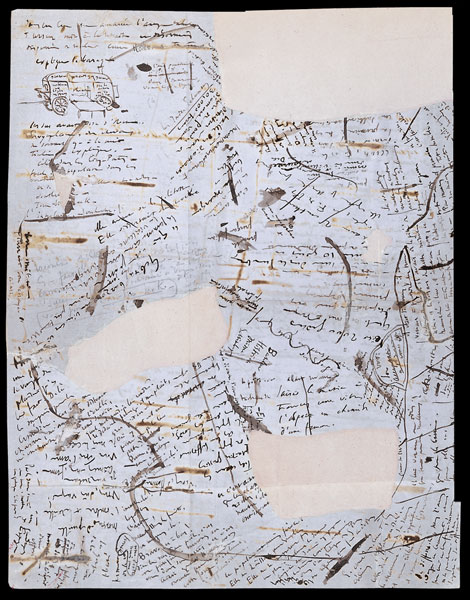 Avec cela, précieuse.
Avec cela, précieuse.
C’était la mode.
Qu’on se rappelle Élisabeth.
Elisabeth est un type qui, en Angleterre, a dominé
trois siècles, le seizième, le dix-septième et le dix-huitième.
Élisabeth est plus qu’une anglaise, c’est une anglicane. De là
le respect profond de l’église épiscopale pour cette reine;
respect ressenti par l’église catholique, qui la mélangeait
d’un peu d’excommunication. Dans la bouche de Sixte-Quint anathématisant
Elisabeth, la malédiction tourne au madrigal. Un gran cervello di
principessa, dit-il. Marie Stuart, moins occupée de la question église
et plus occupée de la question femme, était peu respectueuse
pour sa sœur Élisabeth et lui écrivait de reine reine et de
coquette à prude: «Votre esloignement du mariage provient de
ce que vous ne voulez perdre liberté de vous faire faire l’amour.»
Marie Stuart jouait de l’éventail et Elisabeth de la hache. Partie
inégale. Du reste toutes deux rivalisaient en littérature. Marie
Stuart faisait des vers français; Élisabeth traduisait Horace.
Elisabeth, laide, se décrétait belle, aimait les quatrains et
les acrostiches, se faisait présenter les clefs des villes par des
cupidons, pinçait la lèvre à l’italienne et roulait la
prunelle à l’espagnole, avait dans sa garde-robe trois mille habits
et toilettes, dont plusieurs costumes de Minerve et d’Amphitrite, estimait
les irlandais pour la largeur de leurs épaules, couvrait son vertugadin
de paillons et de passequilles, adorait les roses, jurait, sacrait, trépignait,
cognait du poing ses filles d’honneur, envoyait au diable Dudley, battait
le chancelier Burleigh, qui pleurait, la vieille bête, crachait sur
Mathew, colletait Hatton, souffletait Essex, montrait sa cuisse Bassompierre,
était vierge.
Ce qu’elle avait fait pour Bassompierre, la reine de Saba
l’avait fait pour Salomon [1]. Donc, c’était correct, l’écriture
sainte ayant créé le précédent. Ce qui est biblique
peut être anglican.
[1] Regina
Saba coram rege crura denudavit. Schicklardus In Proœmio Tarich. Jersici
F. 65.
Le précédent biblique va même jusqu’à
faire un enfant qui s’appelle Ebnehaquem ou Melilechet, c’est-à-dire
le Fils du Sage.
Pourquoi pas ces mœurs? Cynisme vaut bien hypocrisie.
Aujourd’hui l’Angleterre, qui a un Loyola appelé
Wesley, baisse un peu les yeux devant ce passé. Elle en est contrariée,
mais fière.
Dans ces mœurs-là, le goût du difforme existait,
particulièrement chez les femmes, et singulièrement chez les
belles. A quoi bon être belle, si l’on n’a pas un magot? Que sert d’être
reine, si l’on n’est pas tutoyée par un poussah?
Marie Stuart avait eu des «bontés»
pour un cron, Rizzio.
Marie-Thérèse d’Espagne avait été
«un peu familière» avec un nègre. D’où l’abbesse
noire. Dans les alcôves du grand siècle la bosse était
bien portée; témoin le maréchal de Luxembourg.
Et avant Luxembourg, Condé, «ce petit homme
tant joli».
Les belles elles-mêmes pouvaient, sans inconvénient,
être contrefaites. C’était accepté. Anne de Boleyn avait
un sein plus gros que l’autre, six doigts à une main, et une surdent.
La Vallière était bancale. Cela n’empêcha pas Henri VIII
d’être insensé et Louis XIV d’être éperdu.
Au moral, mêmes déviations. Presque pas de
femme dans les hauts rangs qui ne fût un cas tératologique. Agnès
contenait Mélusine.
On était femme le jour et goule la nuit. On allait
en grève baiser sur le pieu de fer des têtes fraîches coupées.
Marguerite de Valois, une aïeule des précieuses, avait porté
à sa ceinture sous cadenas, dans des boîtes de fer-blanc cousues
à son corps de jupe, tous les cœurs de ses amants morts. Henri IV
s’était caché sous ce vertugadin-là.
Au dix-huitième siècle la duchesse de Berry,
fille du régent, résuma toutes ces créatures dans un
type obscène et royal.
En outre les belles dames savaient le latin. C’était,
depuis le seizième siècle, une grâce féminine.
Jane Grey avait poussé l’élégance jusqu’à savoir
l’hébreu.
La duchesse Josiane latinisait. De plus, autre belle manière,
elle était catholique. En secret, disons-le, et plutôt comme
son oncle Charles II que comme son père Jacques II. Jacques, à
son catholicisme, avait perdu sa royauté, et Josiane ne voulait point
risquer sa pairie. C’est pourquoi, catholique dans l’intimité et entre
raffinés et raffinées, elle était protestante extérieure.
Pour la canaille.
Cette façon d’entendre la religion est agréable;
on jouit de tous les biens attachés à l’église officielle
épiscopale, et plus tard on meurt, comme Grotius, en odeur de catholicisme,
et l’on a la gloire que le père Petau dise une messe pour vous.
Quoique grasse et bien portante, Josiane était,
insistons-y, une précieuse parfaite.
Par moments, sa façon dormante et voluptueuse de
traîner la fin des phrases imitait les allongements de pattes d’une
tigresse marchant dans les jongles.
L’utilité d’être précieuse, c’est
que cela déclasse le genre humain. On ne lui fait plus l’honneur d’en
être.
Avant tout, mettre l’espèce humaine à distance,
voilà ce qui importe.
Quand on n’a pas l’olympe, on prend l’hôtel de Rambouillet.
Junon se résout en Araminte. Une prétention
de divinité non admise crée la mijaurée. A défaut
de coups de tonnerre, on a l’impertinence. Le temple se ratatine en boudoir.
Ne pouvant être déesse, on est idole.
Il y a en outre dans le précieux une certaine pédanterie
qui plaît aux femmes.
La coquette et le pédant sont deux voisins. Leur
adhérence est visible dans le fat.
Le subtil dérive du sensuel. La gourmandise affecte
la délicatesse. Une grimace dégoûtée sied à
la convoitise,
Et puis le côté faible de la femme se sent
gardé par toute cette casuistique de la galanterie qui tient lieu de
scrupules aux précieuses. C’est une circonvallation avec fossé.
Toute précieuse a un air de répugnance. Cela protège.
On consentira, mais on méprise. En attendant.
Josiane avait un for intérieur inquiétant.
Elle se sentait une telle pente à l’impudeur qu’elle était bégueule.
Les reculs de fierté en sens inverse de nos vices nous mènent
aux vices contraires. L’excès d’effort pour être chaste la faisait
prude.
Être trop sur la défensive, cela indique
un secret désir d’attaque. Qui est farouche n’est pas sévère.
Elle s’enfermait dans l’exception arrogante de son rang
et de sa naissance, tout en préméditant peut-être, nous
l’avons dit, quelque brusque sortie.
On était à l’aurore du dix-huitième
siècle. L’Angleterre ébauchait ce qui a été en
France la régence. Walpole et Dubois se tiennent. Marlborough se battait
contre son ex-roi Jacques II auquel il avait, disait-on, vendu sa sœur Churchill.
On voyait briller Bolingbroke et poindre Richelieu. La galanterie trouvait
commode une certaine mêlée des rangs; le plain-pied se faisait
par les vices. Il devait se faire plus tard par les idées.
L’encanaillement, prélude aristocratique, commençait
ce que la révolution devait achever. On n’était pas très
loin de Jélyotte publiquement assis en plein jour sur le lit de la
marquise d’Épinay. Il est vrai, car les mœurs se font écho,
que le seizième siècle avait vu le bonnet de nuit de Smeton
sur l’oreiller d’Anne de Boleyn.
Si femme signifie faute, comme je ne sais plus quel concile
l’a affirmé, jamais la femme n’a plus été femme qu’en
ces temps-là.
Jamais, couvrant sa fragilité de son charme, et
sa faiblesse de sa toute-puissance, elle ne s’est plus impérieusement
fait absoudre. Faire du fruit défendu le fruit permis, c’est la chute
d’Eve; mais faire du fruit permis le fruit défendu, c’est son triomphe.
Elle finit par là. Au dix-huitième siècle, la femme tire
le verrou sur le mari. Elle s’enferme dans l’éden avec Satan. Adam
est dehors.
III
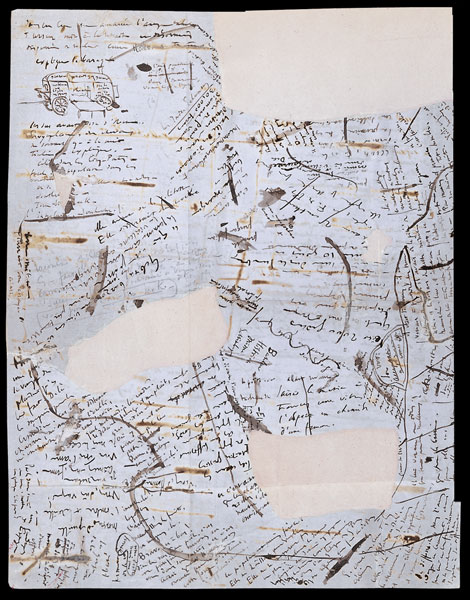 Tous les instincts de Josiane inclinaient plutôt à se
donner galamment qu’à se donner légalement. Se donner par galanterie
implique de la littérature, rappelle Ménalque et Amaryllis,
et est presque une action docte.
Tous les instincts de Josiane inclinaient plutôt à se
donner galamment qu’à se donner légalement. Se donner par galanterie
implique de la littérature, rappelle Ménalque et Amaryllis,
et est presque une action docte.
Mademoiselle de Scudéry, l’attrait de la laideur
pour la laideur mis à part, n’avait pas eu d’autre motif pour céder
à Pélisson.
La fille souveraine et la femme sujette, telles sont les
vieilles coutumes anglaises. Josiane différait le plus qu’elle pouvait
l’heure de cette sujétion. Qu’il fallût en venir au mariage
avec lord David, puisque le bon plaisir royal l’exigeait, c’était une
nécessité sans doute, mais quel dommage! Josiane agréait
et éconduisait lord David. Il y avait entre eux accord tacite pour
ne point conclure et pour ne point rompre. Ils s’éludaient.
Cette façon de s’aimer, avec un pas en avant et
deux pas en arrière, est exprimée par les danses du temps, le
menuet et la gavotte. Être des gens mariés, cela ne va pas à
l’air du visage, cela fane les rubans qu’on porte, cela vieillit. L’épousaille,
solution désolante de clarté. La livraison d’une femme par
un notaire, quelle platitude! La brutalité du mariage crée
des situations définitives, supprime la volonté, tue le choix,
a une syntaxe comme la grammaire, remplace l’inspiration par l’orthographe,
fait de l’amour une dictée, met en déroute le mystérieux
de la vie, inflige la transparence aux fonctions périodiques et fatales,
ôte du nuage l’aspect en chemise de la femme, donne des droits diminuants
pour qui les exerce comme pour qui les subit, dérange par un penchement
de balance tout d’un côté le charmant équilibre du sexe
robuste et du sexe puissant, de la force et de la beauté, et fait
ici un maître et là une servante, tandis que, hors du mariage,
il y a un esclave et une reine. Prosaïser le lit jusqu’à le rendre
décent, conçoit-on rien de plus grossier? Qu’il n’y ait plus
de mal du tout s’aimer, est-ce assez bête!
Lord David mûrissait. Quarante ans, c’est une heure
qui sonne.
Il ne s’en apercevait pas. Et de fait il avait toujours
l’air de ses trente ans. Il trouvait plus amusant de désirer Josiane
que de la posséder. Il en possédait d’autres; il avait des femmes.
Josiane, de son côté, avait des songes.
Les songes étaient pires.
La duchesse Josiane avait cette particularité,
moins rare du reste qu’on ne croit, qu’un de ses yeux était bleu et
l’autre noir. Ses prunelles étaient faites d’amour et de haine, de
bonheur et de malheur. Le jour et la nuit étaient mêlés
dans son regard.
Son ambition était ceci: se montrer capable de
l’impossible.
Un jour elle avait dit à Swift:
— Vous vous figurez, vous autres, que
votre mépris existe.
Vous autres, c’était le genre humain.
Elle était papiste à fleur de peau. Son
catholicisme ne dépassait point la quantité nécessaire
pour l’élégance. Ce serait du puséysme aujourd’hui. Elle
portait de grosses robes de velours, ou de satin, ou de moire, quelques-unes
amples de quinze et seize aunes, et des entoilages d’or et d’argent, et autour
de sa ceinture force nœuds de perles alternés avec des nœuds de pierreries.
Elle abusait des galons. Elle mettait parfois une veste de drap passementé
comme un bachelier. Elle allait cheval sur une selle d’homme, en dépit
de l’invention des selles de femme introduite en Angleterre au quatorzième
siècle par Anne, femme de Richard II. Elle se lavait le visage, les
bras, les épaules et la gorge avec du sucre candi délayé
dans du blanc d’œuf, à la mode castillane. Elle avait, après
qu’on avait spirituellement parlé auprès d’elle, un rire de
réflexion d’une grâce singulière.
Du reste, aucune méchanceté. Elle était
plutôt bonne.
D’après l’édition
numérique mise en ligne par le Gutemberg Project.
|









