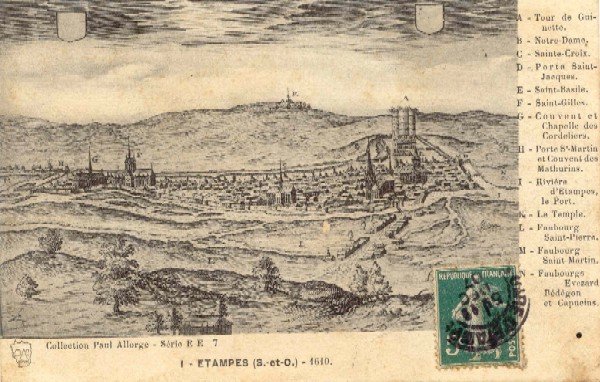Revue
de l’histoire
de Versailles
et de Seine-et-Oise
32e année (1930),
pp. 273-289.
|
La défense militaire d’Etampes au XVIe
siècle
|
La défense militaire d’Etampes au XVIe siècle
A voir les
choses d’un regard superficiel, la riante ville d’Etampes, dans sa parure
de peupliers, de tilleuls et de saules argentés, dominée par
des coteaux jadis recouverts de vignes, semblait née pour se développer
dans la quiétude et le bonheur au fond de sa vallée. Heureuse
et calme, elle ne le fut guère autrefois. La richesse du sol fit
toujours une proie du petit pays arrosé par la Louette, la Chalouette
et la Juine. Pillé par les Bourguignons au début du quinzième
siècle, il le fut au seizième par des aventuriers et des
mercenaires. Les auberges, qui s’échelonnaient le long de la route
de Saint-Jacques de Compostelle, n’hébergeaient pas seulement des
pèlerins. En octobre 1555, dans une période de paix, un édit
royal fortifia la police ou la maréchaussée étampoise,
éleva le nombre des archers, «attendu la frequence du passaige,
où se sont cy devant commis et commectent journellement plusieurs
assacinatz, meurtres et voileries, qu’il ne serait possible purger et nectoyer
sans plus grande force» (1).
On s’explique par là que la défensive
restait le principal souci des populations et des chefs eux-mêmes.
|
(1) P. just., n°XXIX ter. Ces pièces
justificatives sont publiées dans notre travail sur Les Institution
royales au pays d’Étampes de 1478 à 1598. Versailles, 1931,
in-8°.
|
I. LES FORTIFICATIONS
Des hordes de malfaiteurs réduisaient
vite à merci les habitants d’une localité, surtout durant
les guerres civiles. Aussi, dans toute bourgade, voulait-on construire des
remparts. L’incurie du bailli était telle qu’on ne tenait plus guère
compte de sa personne. On s’adressait au roi, Il appartenait aux officiers
du bailliage d’entériner [p.274] les
lettres obtenues. Dès avant 1556, Angerville était fermée
par des murs très épais; elle possédait une vingtaine
de tourelles munies de créneaux et de meurtrières; de larges
fossés interdisaient l’accès de la ville (2). En 1588, Henri III accordait aux habitants
de Boissy-le-Sec (3) la permission de se fortifier.
Autrement que serait-il advenu? Les contribuables n’auraient pu résister
aux pillages continus et n’auraient payé ni taille, ni aides, ni subsides.
Or le trésor, au seizième siècle, avait un impérieux
besoin d’argent.
|
(2) MENAULT, Hist. d’Angerville-la-Gate,
p. 86-88.— Cf. Coutume d’Etampes, dans Bourdat de Richebourg. t. III,
p. 115.
(3) Boissy-le-Sec (Seine-et-Oise), arr. et canton
d’Étampes.— Arch. Loiret, Fonds du duché d’Orléans,
A 1168, fol. 335, copie du dix-huitème siècle.
|
Est-ce avec
des arrières-pensées d’ordre financier que François
Ier, le 15 juillet 1536, envoya de Lyon aux habitants d’Etampes l’ordre
de réparer leurs murailles? Tout porte à croire qu’il y avait
à cela des motifs différents, Les armées de Charles-Quint
dévastaient la Provence et se disposaient à marcher vers Paris,
Le roi de France dans ses missives, avertissait d’abord les habitants d’Etampes
«du bon grant ordre et provision, disait-il, que nous avons donnée
en toutes les frontières, entrées et passages de nostre royaulme,
qui est telle que, quelques grans preparatifz qu’ayent pu dresser noz ennemys
pour execucion de leurs malignes et dampnées entreprises, ilz n’en
pevent rapporter que honte, vitupere et dommage». Mais il ne se contentait
pas d’avoir «en bon pasteur» pourvu les frontières.
Il désirait préserver l’intérieur de toute oppression,
et voir la paix régner entre ses bons et loyaux serviteurs (4). Si l’hypothèse était
permise en histoire, on imaginerait aisément les répercussions
de la guerre étrangère, la panique sur le territoire et les
brigandages favorisés par une situation anormale et troublée.
Au fond, que redoutait François Ier? Il était prudent; il craignait
pour Paris; et une armée venant du Sud aurait certainement passé
par la Beauce et par Etampes. Mais pourquoi oublierait-on que, depuis le
23 juin 1534, Anne de Pisseleu, la belle favorite chantée par le poète
Marot, était comtesse d’Etampes? Il était naturel, dès
lors, que François Ier se préoccupât de maintenir la
sécurité la plus entière à Etampes.
|
(4) P. Just., n°XXV.
|
La ville avait
été flanquée d’un château-fort au douzième
siècle [p. 275] et de
remparts au quatorzième. Mais elle avait subi de rudes assauts pendant
la guerre de Cent ans. De larges brèches furent alors ouvertes dans
ses murailles; sur toute une partie de l’enceinte il ne restait plus que
des soubassements, au début du quatorzième siècle. Le
tracé des fortifications suivait au nord le boulevard Henri-IV actuel
depuis la ruelle d’Enfer, du côté d’Orléans; il prolongeait
ce boulevard en direction de Paris jusqu’à la rue qui débouche
entre la rue du Château et la route actuelle de Dourdan. Il empruntait
cette rue qui descend obliquement à l’est, puis la rue des Remparts.
Au sud, il épousait le contour de la rivière d’Etampes, formée
par les eaux réunies de la Chalouette et de la Louette. A l’ouest,
il regagnait le boulevard Henri-IV, en passant par la rue du Filoir et
la ruelle d’Enfer. En temps normal, la ville comptait huit portes, munies
chacune de deux tours. C’étaient:
1° La porte Saint-Martin;
2° La porte Dorée, qui gardait l’ancienne route de Dourdan;
3° La porte du Châtel ou des Lions;
4° La porte Saint-Jacques, dont la construction ne remonte qu’à
l’année 1512 (5);
5° La porte Evrard, Evézard ou de la Couronne (porta Eurardi
dès le treizième siècle) (6);
6° La porte Saint-Pierre ou de Pluviers (7);
7° La porte Saint-Fiacre;
8° La porte Saint-Gilles (8).
|
(5) Fragments de la Rapsodie de Plisson,
dans Marquis, Les rues d’Etampes, p. 410. Id., ib., p. 73. Fleureau.
p. 199.
Quant à la porte Dorée, son épithète doit s’orthographier
ainsi et non d’orée, comme l’a démontré M. L. Eug. Lefèvre,
Nom contesté... Etampes, 1914.
(6) Porta Eurardi, l’expression se trouve dans
une charte de 1226 séparant les paroisses Notre-Dame et Saint-Basile.
— Fleureau, p. 104.
(7) Pluviers, ancien nom de Pithiviers, encore
employé à la fin du seizièmc siècle.
(8) Marquis. ib., p. 72-76, et plan de
la ville aux dix-septième et dix-huitième siècle, à
la fin du livre.
|
Cet appareil
défensif tombait en ruine vers le sud-est, lorsque survint l’ordre
de François Ier. Les habitants d’Etampes accueillirent les lettres
royaux, comme si elles avaient répondu à leur attente. Les
avaient-ils sollicitées par l’entremise d’Anne de Pisseleu? C’est possible.
Ce n’est pas certain. Ils s’assemblèrent à l’Hôtel de
Ville, sous la direction du conseil de bailliage, le 14 août 1536, le
jour même [p.276] où
Jean Jouvin, chevaucheur d’écurie, avait apporté les missives.
Là ils décidèrent de relever leurs fortifications,
d’employer à cette œuvre leurs deniers communs et, au cas où
ils ne suffiraient pas, de fournir le complément nécessaire
en s’imposant une taxe. Leur projet ne ressemblait en rien à une
innovation. Il fallait réparer les murailles, en se conformant à
l’ancien devis du quatorzième siècle. On commencerait à
la tourelle de la porte Evrard, qui se trouvait sur les fossés du
Port-Neuf; on suivrait de là le pourpris jusqu’à la porte
Saint-Fiacre. Tel serait l’ordre des travaux. On ménagerait de larges
boulevards pour séparer de l’enceinte les héritages privés,
pour permettre aux défenseurs éventuels de circuler et de
s’organiser. Ce n’était pas tout. Il importait de murer les portes
Dorée et Saint-Fiacre, les moins utiles au trafic et au commerce;
il convenait surtout de munir de ponts-levis les portes Evrard, Saint-Jacques,
Saint-Pierre et Saint-Martin, qui en étaient encore dépourvues.
Les bourgeois d’Etampes s’armeraient de «bastons de deffence»
(9).
|
(9) Arch. Etampes, procès-verbal d’une
délibération de l’assemblée de ville.
|
Ce plan rencontra l’approbation de la grande
majorité des habitants. Mais, pour le réaliser, il fallait
raser des maisons. Quelques particuliers, groupés autour de Martin
Auper, bourgeois d’Etampes. se prétendirent lésés
et réussirent à mettre dans leurs intérêts les
officiers royaux d’Etampes. De là des retards dans l’exécution
du projet, puis un mandement plus impératif de Français Ier,
en septembre 1536. Le maire et les échevins d’Etampes s’adressèrent
au gouverneur de l’Île de France, le cardinal du Bellay (10), et lui exposèrent leurs
difficultés, Celui-ci leur envoya des gens d’expérience, pour
les aider dans leur entreprise, et des gens de conseil, pour entendre les
opposants. Ensuite il leur enjoignit d’obéir au roi sans s’inquiéter
des conséquences.
|
(10) Jean du Bellay (1492-1560), frère
de Guillaume du Bellay, qui écrivit des Mémoires, et oncle de
Joachim du Bellay.
|
Cependant Martin Auper, soutenu par Jérôme
de Villette, avocat du roi, qui se voyait également lésé
dans ses biens, parvint, en présentant faussement l’affaire, à
obtenir de la Chancellerie des lettres qui lui donnaient raison. Datées
du onze octobre 1536, elles étaient adressantes au bailli d’Etampes
et ordonnaient la cessation des travaux, Martin Auper était riche.
La Chancellerie était vénale.
[p.277]
Les officiers royaux d’Etampes devenaient suspects:
les uns s’étaient laissés corrompre, les autres défendaient
leur patrimoine. Ils mettaient obstacle à la volonté de François
Ier le plus habilement du monde: ils plaçaient le roi en contradiction
avec lui-même. C’est dans de tels cas spéciaux qu’apparaît
l’utilité des gouverneurs. Le cardinal du Bellay rendit à
François Ier une vision plus nette de la réalité. Il
inspira des lettres patentes du 20 janvier 1537, par lesquelles les baillis
d’Orléans, de Montfort-l’Amaury (11) ou de Dourdan étaient proclamés
les seuls juges compétents du différend entre Martin Auper et
les échevins d’Etampes (12).
|
(11) Monfort-l’Amaury (Seine-et-Oise), arr. Rambouillet,
chef-lieu de canton.
(12) P. just. N°XXVI.
|
Le 8 avril 1537 (13), les agents municipaux de la ville
présentèrent ces lettres à Claude Bongars, lieutenant
général du bailli d’Orléans, qui séjournait à
Etampes dans l’hôtel du Cheval Bardé. C’est là que cet
officier connut du désaccord, Il décerna une commission aux
échevins d’Etampes qui firent ajourner par devers lui les parties
en cause. Il fut convenu que Martin Auper et ses voisins recevraient une
indemnité pour les dommages causés à leurs biens. De
part et d’autre on désignerait des experts qui auraient à s’entendre
sur la valeur des héritages menacés. L’estimation aurait lieu
en présence de Claude Bongars. Le lieutenant général
d’Orléans infligerait à quiconque voudrait contester sa juridiction
une amende extraordinaire de cent marcs d’or.
|
(13) Arch. d’Etampes: à cette date, Procès-verbal
du lieutenant général d’Orléans.
|
Alors seulement
on aurait pu envisager l’exécution des lettres royaux du 15 juillet
1536. Mais Martin Auper ne se tint pas pour vaincu. Il en appela au Parlement,
qui, le 3 juin 1541, rendit contre lui un arrêt analogue à la
sentence de Claude Bongars. — Auper, la veuve Hébert, Guillaume Lambert
et sa femme avaient jusque-là tenu en échec la municipalité
d’Etampes. Il semblait que désormais on pourrait aller de l’avant
et fortifier Etampes. Il n’en fut rien, car la ville n’était pas assez
riche pour indemniser les opposants. Ainsi les choses tramèrent en
longueur, si bien qu’en 1562, Etampes se trouva menacée par les protestants,
sans avoir rien fait pour se protéger. L’arrêt de 1541 était
suranné. A la demande des maire et échevins, le Parlement en
renouvela les conclusions, le 26 mai 1562.
[p. 278]
Mais le projet de 1536 fut reconnu insuffisant
par Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, lieutenant général
pour le roi à Etampes. Celui-ci, de concert avec le maréchal
de Brissac, établit un nouveau plan de défense; le 28 septembre
1562, le bailli et la municipalité reçurent du Parlement
l’ordre de s’y conformer. Dans toute cette procédure, on entrevoit
que la bonne volonté des Etampois s’était heurtée à
des obstacles, surtout de nature pécuniaire; mais elle n’avait pas
fait défaut, sauf chez quelques individus intéressés
(14).
|
(14) P. just., n°XXXI bis et ter.
|
|
II. LES ARBALETRIERS ET LES
ARQUEBUSIERS.
Les habitants d’Etampes, qui ressentaient comme
un besoin l’obligation de fortifier leur ville, désiraient aussi
d’eux-mêmes se livrer à des exercices mâles et guerriers,
de nature à les instruire dans le métier des armes. Ils s’accordaient
en cela avec une ordonnance du roi Charles V, rendue le 3 avril 1369 (15), qui défendait les jeux de
dés, de dames, de paume, de quilles, de palet, de billes, de «soules»
(16), sous peine de quarante sols parisis
d’amende, et recommandait le maniement de l’arc et de l’arbalète.
Mus, disaient- ils, par l’amour du bien public, ils supplièrent Henri
II de consentir quelques privilèges en faveur des jeunes gens d’Etampes
pour leur ôter l’occasion de fréquenter les tavernes, pour
les détourner de l’oisiveté et des plaisirs dangereux. Ils
obtinrent de lui la permission de s’adonner aux jeux de l’arbalète
et de l’arquebuse, par lettres données à Saint-Germain-en-Laye,
le 21 mai 1549 (17). On organisa chaque année,
au premier mai, un concours. Ce jour-là, sur une place publique d’Etampes,
deux «papegauts» étaient élevés et exposés
l’un aux coups des arbalétriers, l’autre aux coups des arquebusiers.
Les deux vainqueurs étaient ensuite proclamés solennellement
l’un roi des arbalétriers, l’autre roi des arquebusiers. Ils recevaient
de la [p.279] municipalité
chacun un mouton d’or (18) ou l’équivalent (19). Cette récompense n’était
pas la plus appréciée. Les gagnants étaient de plus,
par la faveur du roi Henri II, exemptés pour un an, à dater
du jour de la fête, de tous impôts, c’est-à-dire de la
taille, du huitième, du vingtième sur les vins «de leur
crû seulement», des gabelles et des subsides. Les lettres étaient
adressantes aux généraux des finances, aux conseillers sur
le fait de la justice des aides et au bailli d’Etampes. Elles furent enregistrées
et rendues exécutoires au conseil de bailliage, le 7 juin 1549. Leurs
dispositions restèrent toujours en vigueur par la suite. La franchise,
qui représentait pour le trésor un si léger sacrifice,
puisqu’elle s’appliquait à deux personnes seulement, et qui offrait
en retour l’avantage d’inspirer aux jeunes bourgeois d’Etampes le goût
des plaisirs virils et une salutaire émulation, fut confirmée
sans doute par les successeurs d’Henri Il. Il est certain qu’elle le fut
par Henri IV, en septembre 1602 (20).
|
(15) Isambert, t. V., p. 322 et 323. Ord. V, 172,
(16) Dans le Nord, on appelait «soule»
une boule de bois ou d’autre matière dure, qu’on poussait avec une
crosse. Cf. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue françoise,
t. VII, p. 511, col.
(17)
Publ. Fleureau, p. 232. — Mentions diverses: Max. Lcgrand, Etampes pittoresque,
1897, p. 190. — De Bigault de Fouchères, Tabl. hist. sur Etampes,
p. 33.
(18) «Sorte de monnaie qui portait d’un
côté l’image de Saint-Jean-Baptiste et de l’autre un mouton
avec sa toison...» (Godefroy, ouv. cité, t. V, p. 431,
col. 3).
(19) 40 sols tournois en 1560. Cf. Compte
municipal. p. just., n°XXXI.
(20) Fleureau, p. 234.
|
III LES GARNISONS
Si, en raison des profits qu’ils en retiraient
et en vue d’accroître leur sécurité, les habitants
d’Etampes acceptaient allègrement de manier les armes et de les
faire servir à leur défense, ils n’en avaient pas moins une
instinctive horreur des gens de guerre étrangers à leur ville
et au bailliage. Ils ne supportaient jamais en temps de paix des garnisons
dans leurs murs. Ils en avaient trop souffert jadis, pendant la domination
bourguignonne. A la fin du quinzième siècle, au début
du seizième, ils se souvenaient encore. Les officiers royaux s’entendaient
à l’occasion avec les échevins pour écarter non seulement
de la ville, mais aussi du bailliage, le retour le pareils maux. Le capitaine
d’Etampes, Roger de Béarn, qui était chevalier et bailli,
envoyait l’un de ses sous-ordres Girault de Saint-Avy, ancien prévôt,
au devant de six mille lansquenets qui voulaient établir leur garnison
à Etampes. Il agissait à la requête de la municipalité
et cela se passait au mois de mars 1514. Pendant que Girault de [p.180] Saint-Avy tenait les troupes
en respect avec ses hommes, aux environs de Moret (21) et de Milly (22), une action parallèle d’un
autre ordre fut décidé sur l’avis de l’assemblée réunie
des officiers bailliagers et des habitants. Les échevins demandèrent
au gouverneur d’Orléans, Lancelot du Lac (23) qui séjournait à Etampes,
des lettres missives. Puis deux d’entre eux allèrent les présenter
au capitaine des lansquenets, qu’ils rencontrèrent à Chastres-sous-Montlhéry
(24). Le gouverneur d’Orléans expliquait
probablement au chef de cette bande que ses gens ne trouveraient pas à
Etampes ce qui était nécessaire à leur entretien. De
pareils arguments n’auraient pas suffi à l’éloigner. Aux lettres
de Lancelot du Lac, on joignit six écus d’or. Sensible à ce
don, le capitaine fit rebrousser chemin à ses mercenaires (25), qui n’avaient pas encore atteint
les limites du bailliage d’Etampes.
|
(21) Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), arrondissement
de Fontainebleau, chef-lieu de canton.
(22) Milly (Seine-et-Oise), arrrondissement d’Etampes,
chef-lieu de canton.
(23) De la famille du Lac, maison de la Beauce,
d’où sont sortis les seigneurs d’Ouville, de Chamerolles, du Coudray
et de Montereau. Ouville (Loiret), arrondissement et canton de Chilleurs-aux-Bois.
— Coudray (Loiret), arrondissement de Pithiviers, canton de Malesherbes,
Montereau (Loiret), arrondissement de Gien, canton d’Ouzouer-sur-Loire. —
Sur la famille du Lac, consulter Lalanne, Dictionnaire historique,
p. 1070, col. 1.
(24) Aujourd’hui Arpajon (Seine-et-Oise), arrondissement
de Corbeil, chef-lieu de canton.
(25) Plisson, Rapsodie, éd. Forteau,
Annales du Gâtinais, 1909, p. 33.
|
La ville jouit
alors pendant une quarantaine d’années d’une tranquillité
relative. Malheureusement les troubles civils s’y manifestèrent dès
la première heure. Etampes connut les jours sombres d’autrefois,
lorsqu’elle fut contrainte, pour prévenir les vexations des huguenots,
à installer dans ses murailles des compagnies d’ordonnance, à
les loger, à les nourrir. Il fallut redoubler d’efforts pour éviter
les abus des gens de guerre; et d’autre part leur présence était
indispensable, en vue d’éviter les surprises possibles et pour réprimer
les brigandages de plus en plus fréquents. En 1560, deux compagnies
tenaient garnison à Etampes, celle du seigneur de La Fayette (26) et celle du seigneur de la Trémoille
(27). Elles possédaient [p.181] chacune un maréchal
des logis et un fourrier, qui veillaient de concert avec les sergents royaux
du bailliage, à assurer le ravitaillement des troupes, Les gens
de La Trémoille étaient logés à l’hôtel
du Barde, ceux de La Fayette à l’Ecu de France (28). La municipalité, pour ne pas
éveiller les mécontentements populaires, subvenait aux frais
de leur entretien, dans une certaine mesure. Elle payait les hôteliers,
sur le produit de son droit de barrage. D’ailleurs ces compagnies ne durent
pas rester fort longtemps à Etampes. Car les échevins ne paraissent
leur avoir consacré que des sommes dérisoires (29).
Cette épreuve n’était rien en
comparaison des souffrances qui assaillirent la ville d’Etampes pendant les
guerres de religion.
|
(26) Sans doute un descendant de Gilbert de La
Fayette (vers 1380 - 23 février 1462) qui fut maréchal de France
sous Charles VII.
(27) Louis III, premier duc de Thouare (1563),
fils de François de La Trémoille qui fut lieutenant général
de Poitou et de Saintonge. Il naquit en 1521, mourut devant Melle le 25 mars
1577. Lalanne, Dictionnaire historique, p. 1734, col. 1 et 2.
(28) Auberge de la rue Saint-Jacques. — Cf. Travers
(E.), Epitaphes d’hôteliers à Etampes, p. 19.
(29) P. just., n°XXXI.
|
IV. L’ORGANISATION DE LA DEFENSE
URBAINE PENDANT LES GUERRES DE RELIGION
Notre but n’est pas de raconter dans tous ses
détails cette douloureuse histoire, mais seulement de dégager
autant que possible les rapports du bailli d’Etampes et de la municipalité
avec les garnisons chargées de défendre la ville et les environs.
D’autres ont traité des événements eux-mêmes,
qui sont très connus et que Dom Fleureau a rapportés avec une
grande minutie (30).
A) Sous Charles
IX. — Après l’avènement du roi Charles IX, et pendant sa minorité,
deux factions à caractère religieux et politique, se disputèrent
le gouvernement de la France, celle des catholiques, avec les Guise à
sa tête, celle des protestants, conduits par le prince de Condé.
Grâce à l’influence des Guise, Catherine de Médicis
fut proclamée régente. Mais Antoine de Bourbon, roi de Navarre,
avait le commandement de l’armée. Il s’occupa à éviter
les désordres civils, puisqu’il était chargé de préserver
la tranquillité [p.282] publique.
Elle courait alors de graves dangers. Car les protestants, qui avaient réuni
des bandes allemandes, et les catholiques auraient voulu les uns et les
autres posséder Paris. Le prince de Condé, posté à
Orléans avec quatorze mille hommes, n’attendait qu’une occasion favorable
pour tenter la suprême aventure, et de jour en jour la ville d’Etampes
voyait grandir la menace.
|
(30) Antiquitez d’Estampes, pp. 236-242,
247-258. — Marquis, Les rues d’Etampes, p. 312-316.— La Bigne (Henri
de), Etampes: 1562, 1652, 1793. dans Abeille d’Etampes, 8 et
22 janvier, 19 et 26 février, 5 et 26 mars, 2, 9 et 30 avril 1871.—
Les auteurs précédents ont puisé leurs renseignements
dans les Mémoires des contemporains des guerres de religion.
|
En quoi avait
consisté l’organisation défensive de la ville?
Au mois d’avril 1562, elle vit successivement
arriver dans ses murs, pour la sauvegarder, une bande sous les ordres du
capitaine d’Eschaux, cinq compagnies sous le commandement du seigneur de Culan
(31), lieutenant
de Jean de Brosse, et enfin le seigneur de Monterud, commis au gouvernement
des duchés d’Orléans et d’Etampes. Il fallut ravitailler tous
ces gens de guerre. Le produit des octrois royaux, qui n’avaient pas été
augmentés à temps, n’y suffisait pas. Les habitants durent
avancer les «munitions», comme on disait alors pour désigner
les vivres et les autres choses nécessaires à l’existence (32).
|
(31) Cuise était alors le chef-lieu d’une
baronnie. — Colon (Cher), arrondissement de Saint-Amand-Mont-Rond, canton
de Châteaumeillant.
(32) Fleureau. p. 237.— Plisson, éd. Forteau,
ib., p. 62-63.
|
Ce fut un véritable
état de siège, selon l’expression moderne, la mise au service
de l’armée de toutes les ressources civiles. Le 15 avril 1562, le
maire et les échevins d’Etampes avaient reçu du Roi de Navarre
le pouvoir de réquisitionner chez les habitants des denrées,
pour nourrir les gens de guerre. Le remboursement aurait lieu, dès
qu’il serait possible. Le 13 mai 1562, Charles IX mandait au bailli d’Etampes
qu’il avait résolu dans son Conseil de mettre en campagne une puissante
armée, composée de gens de pied et de cheval, sous la direction
personnelle d’Antoine de Bourbon, son oncle. Elle passerait par où
l’on jugerait à propos, surtout aux environs d’Etampes. C’est pourquoi
il importait de constituer dans cette ville un magasin de farines et pour
cela de réquisitionner tous les blés chez les forains et les
particuliers, à charge d’en rembourser le prix au cours du jour. Il
fallait de plus en prohiber la vente et la sortie. En exécution de
ces lettres, Nicolas Petau, bailli d’Etampes, ordonna trois jours après
au premier sergent royal «sur ce requis» de signifier leur devoir
aux habitants. D’autres mandements royaux [p.283]
— ils semblent avoir afflué à Etampes
durant cette période — en joignaient de construire de fours, s’il
en était besoin, et fixaient le nombre et le poids des pains à
fournir (33).
|
(33) Plisson, éd. Forteau, ib. p. 63-65.
|
Le 14 juillet
1562, les échevins recevaient l’ordre royal de «faire dresser
étapes de pain, vin, chairs et avoine» sur le passage des douze
cents «chevaux pistoliers» du comte Christophe de Rogendorff
(34). Il convenait de ne rien ménager,
de présenter les vivres en abondance, afin d’éviter les défections,
les désordres dans la troupe et l’oppression du peuple (35).
|
(34) Roggendorf, en Rhénanie. Cf. Ritter,
Geographisch statistiches lexicon, II, 706. col. IV,
Roggendorf.
(35) Plisson, éd. Forteau, ib., p. 66.
|
En tout, pendant
la seule année 1562, la ville d’Etampes, littéralement épuisée,
avait livré à une soldatesque effrénée 60 muids
de blé, mesure de Paris, 6 muids d’avoine, mesure d’Etampes, 147 poinçons
de vin, 5643 pains de deux livres, 32908 pains de 15 onces (36), 50618 pains de 12 onces,
2780 livres en espèces sonnantes, 180 livres de lard, 30 pintes d’huile,
50 livres de chandelles, 344 fagots, 20 moules (37) de mois. Dans la fièvre,
la crainte, l’agitation, personne ne comptait plus ses biens, ni ne songeait
à sa propre subsistance. Les officiers royaux déployèrent
beaucoup d’activité, d’autant plus peut-être qu’ils redoutaient
à la fois les huguenots et les mercenaires étrangers. Seul
Claude Cassegrain, lieutenant général du bailliage, avait gagné
le camp des rebelles, Il fut condamné à être pendu, par
arrêt du Parlement du 21 novembre 1562 (38).
A quoi aboutirent
tant de sacrifices?
Les reîtres allemands de Condé,
qui avaient occupé Pithiviers le 11 novembre et avaient ainsi entraîné
le départ pour Corbeil de la garnison étampoise, s’emparèrent
facilement d’Etampes le 13 novembre. Ils purent à leur aise assouvir
leur folie de destruction, pendant six semaines. [p.284]
*
* *
|
(36) L’once, à Paris, valait la seizième
partie de la livre. — Le poinçon contenait habituellement les deux
tiers d’un muid.— Le muid d’Etampes était plus grand que le muid de
Paris d’un setier une mine.
(37) La moule était analogue à notre
stère.
(38) A «estre pendu et estranglé,
disait l’arrêt aujourd’hui perdu, à potences croisées,
qui seront mises et plantées en la place des Halles de cette ville
de Paris». (Mém. de Condé, t. IV, p. 94. Voir
aussi p. 122). — Cf. De Bigault de Fouchères, Tables historiques
sur Etampes, p. 49.
|
Le pays n’avait
pas eu le temps de se relever d’un tel désastre, lorsque, vers la
fin de septembre 1567, les troubles recommencèrent. Sous la direction
de Claude de la Mothe, seigneur de Bonnelles (39), huit corps de garde furent
créés pour défendre la ville et un pour tenir le château.
Une mesure analogue avait été prise en 1562. D’honorables bourgeois
furent élus pour encadrer les habitants ainsi groupés et armés.
Les fortifications furent relevées. On constitua d’importantes réserves
de vivres, de bois de fourrages, de poudres, de munitions de guerre. Des
ustensiles de ménage, lits, tables, châlits, linge, vaisselle,
tréteaux, escabelles, furent confisqués dans les maisons et
portés au château, pour servir aux gens de Claude de la Mothe.
Tout cela se fit sur l’initiative de la municipalité, qui avait même
proposé au roi, tant un homme de robe, comme Nicolas Petau, lui semblait
insuffisant, la nomination d’un nouveau capitaine. La résistance paraissait
assurée. Le seigneur de Bonnelles avait interdit de tirer des coups
d’arquebuse sans nécessité depuis six heures du soir jusqu’au
lendemain après la levée des corps de garde. Il soumit les
habitants à une rigoureuse discipline ils ne devaient exécuter
aucune ronde sans le commandement des chefs qui auraient le mot du guet.
Mais que pouvaient tant de précautions
contre des forces supérieures en nombre? Etampes se rendit une seconde
fois, le 17 octobre 1567, au comte de Montgoméry (40), qui venait de Janville
(41). Cette victoire ne fut pas de longue
durée pour le parti huguenot. L’armée royale rentra en possession
de la ville le 16 novembre (42). De nouvelles garnisons
très fortes y furent établies sous le commandement du capitaine
de Saint-Martin, des seigneurs de Tilladet et de Monluc (43).
|
(39) Bonnelles (Seine-et-Oise), arrondissement
de Rambouillet, canton de Dourdan.
(40) Gabriel, comte de Montgoméry, né
vers 1530, mort après condamnation le 26 juin 1574. Il avait blessé
mortellement Henri II par mégarde, le 30 juin 1559. — Lalanne, Dictionnaire
historique, p. 1307, col. 2.
(41) Janville (Eure-et-Loir), arrondissement de
Chartres, chef-lieu de canton.
(42) Fleureau, p. 240 et 241.
(43) Blaise de Monluc, maréchal de France,
né à Sainte-Gemme (Gers) en 1501, mort au château d’Estillac
(Agenais) en 1577. Il a écrit des Commentaires, éd.
de Ruble. 1852-72, 5 vol. in-8. Les trois personnages en question sont mentionnés
p. just. N°XXXV.
|
A quoi se réduisit
le rôle du bailli? Comme en 1562, il ravitailla les troupes. Il était,
comme nous dirions aujourd’hui, chargé du service de l’intendance.
On doit rendre à Nicolas Petau cette justice qu’il s’acquittait merveilleusement
de sa tâche. Grâce à lui, un peu grâce à
la fermeté qu’il sut déployer, aux sanctions qu’il prenait
contre les récalcitrants, bien des désordres, des actes d’indiscipline
militaire furent évités. Il exécutait d’ailleurs les
mandements du roi. Le 17 novembre 1567, Charles IX, comme si la Beauce lui
avait paru inépuisable en céréales, manifestait l’intention
d’amasser de nouveau les blés et les farines, dans toute l’étendue
du bailliage, pour les amener à Etampes. Les commissaires généraux
des vivres étaient en outre requis de faire rechercher les aliments
cachés dans la ville ou abandonnés par les ennemis dans la
rapidité de leur fuite. Deux bourgeois d’Etampes furent élus
en assemblée municipale pour recevoir les blés et pour les
conserver dans les greniers de l’hôtel du Mesnil-Girault (44). Ils rendirent à
la Chambre un compte particulier de leur recette et de leur dépense.
Les laboureurs et les fermiers de tous les villages du baillage d’Etampes
leur avaient amené le produit de leurs récoltes (45). Longtemps après
ils furent récompensés de cette obéissance aux ordres
du roi, ils furent payés entre 1573 et 1579 seulement. Ils avaient
eu aussi à transporter une partie de leurs grains à Orléans.
On évalua la somme totale due par la municipalité, dépositaire
des octrois royaux, à 8757 livres (46). Les guerres de religion
allaient coûter davantage au pays d’Etampes.
|
(44) A l’emplacement de ta place Dauphine actuelle.
(45) Plisson, Rapsodie, éd. Forteau,
Annales du Gâtinais, 1909 p. 68-69.
(46) P. just., n°XXXV.
|
B) Sous Henri
III et Henri IV.— Nous ne rappellerons pas l’anarchie profonde qui régna
en France après la mort de Charles IX, la constitution d’armées
particulières sous le commandement du duc d’Alençon, frère
du nouveau roi, et sous Jean Casimir Palatin, puis les prétentions
des Guise au trône. Henri III mit tout en œuvre pour conserver Etampes
sous son autorité. Le bailli de cette ville fut, à partir
de 1583, un écuyer. Michel de Veillard, qui se proclamait officiellement
capitaine et gouverneur. En fait il ne joua pas, dans la défense
du pays, un rôle plus positif que Nicolas [p.286] Petau. Ce dernier continuait à
exercer des fonctions de magistrature à Etampes. De bailli, il était
passé lieutenant particulier du bailli. Le roi comptait bien plus
sur les habitants d’Etampes eux-mêmes que sur ces officiers, dont
les pouvoirs tendaient à devenir exclusivement judiciaires. Au mois
de mars 1585, Philippe Hurault, comte de Cheverny (47), chancelier de France,
gouverneur d’Orléans et de la Beauce, avertit les bourgeois d’Etampes
d’avoir à se fortifier. La ville se ferma presque entièrement.
De ses huit portes, trois seulement, celles de Saint-Jacques, de Saint-Pierre
et de Saint Martin, furent maintenues. Les autres furent murées. La
porte Dorée et la porte Saint-Fiacre l’étaient déjà.
«Le château, nous dit le P. Fleureau, était gardé
jour et nuit par des habitants, qui étaient choisis chaque jour
par le maire et les échevins, sous le commandement du sieur de Blaville,
qui en était capitaine» (48). Nous acquérons
par ce texte la certitude que Michel de Veillard ne s’intitulait plus gouverneur
que par habitude et que c’était là un titre purement honorifique.
Cependant, le 27 avril 1585, Henri III interdisait expressément aux
bourgeois de laisser entrer une troupe, quelle qu’elle fût, dans leurs
murailles sans une permission signée de sa main.
|
(47) Cheveroy (Loir-et-Cher), arrondissement de
Blois, canton de Contres, — Philippe Hurault, né au château
de Cheveray le 25 mars 152, y mourut le 30 juillet 1599. Il fut conseiller
au Parlement de Paris, maître des requêtes de l’Hôtel du
Roi et chancelier du duc d’Anjou (Henri III qui, devenu roi, le nomma garde
des sceau (1578) et chancelier de Franco (1581). Disgrâcié en
1588, il fut rappelé par Henri 1V, qui le créa gouverneur de
Chartres. Il a laissé des Mémoires, parus en 1636 in-4°.
— Cf. Lalanne, Dictionnaire historique, p. 1010, col. 1 et 2.
(48) Fleureau, p. 247,
|
Quelque temps
après, un nouveau gouverneur de la ville fut désigné
par les habitants, sur la proposition du roi et du comte de Cheverny. On
voit par là que le même homme ne restait pas longtemps dans
cette charge. Se montrait-il au-dessous de sa tâche? Son insuffisance
était signalée à son supérieur immédiat,
le gouverneur d’Orléans. L’imminence du péril opérait
d’elle-même, pour ainsi dire, le discernement des valeurs. Le seigneur
de la Mothe-Bonnelles vint, comme en 1567, organiser la défense d’Etampes.
Une assemblée de ville, tenue le 10 mai en présence des officiers
royaux, décida de remettre au capitaine de la Mothe-Bonnelles le rôle
des dixaines, chargées de la police urbaine. Il en tirerait, pour [p.287] garder le château,
soixante hommes. Dix d’entre eux seraient installés en sentinelles
et remplacés par dix autres et ainsi de suite, six fois dans les vingt-quatre
heures de la journée. Ce pouvoir d’occuper militairement le château
appartenait de droit à la municipalité, en vertu de lettres
royaux, et elle en avait fait cession temporairement au seigneur de Bonnelles.
Grâce à la discipline de ses habitants et à la prudence
de son gouverneur, la ville put éviter un nouveau désastre
(49).
|
(49) Fleureau. p. 247-248.
|
Mais, en 1587,
des bandes allemandes et suisses, au service du parti huguenot, se jetèrent
dans les riches plaines de la Beauce. Elles menacèrent Etampes. —
Chalo-Saint-Mard et les environs immédiats de la ville étaient
livrés au pillage (50). Etampes reçut dans
ses murs l’armée royale du seigneur de Sainte-Marie et demeura saine
et sauve (51).
|
(50) Id. p. 252.
(51) Id., p. 250.
|
Le 19 août
1587, ses habitants entrèrent dans la Ligue, parti du duc de Guise.
Après l’assassinat de ce dernier ses partisans placèrent une
garnison dans Etampes. Elle était commandée par François
d’Isy, seigneur de la Montagne, qui fut bientôt remplacé par
le seigneur de Pussay. Le plus odieux fanatisme se donna libre cours. Le
seigneur de la Montagne fit emprisonner Nicolas Petau, le bailli, et ses
enfants, sous le prétexte fallacieux de mauvais catholicisme. Toute
la population d’Etampes, indignée, fit entendre la voix de sa réprobation.
Les suspects de conciliation avec le parti protestant, de tolérance,
dirait-on aujourd’hui, «de politique», disait-on alors, étaient
incarcérés sans pitié. Le prévôt, Jean
Audren, subit le même sort que Petau. Le Conseil du Roi envoya à
Etampes, pour remplacer Audren, Simon Delorme, avocat au Parlement. En
cette circonstance l’assemblée de ville manifesta sa pensée
avec courage et refusa de reconnaître le nouvel officier (52).
|
(52) Id., p. 255.
|
Nous serons
bref sur le dénouement. La ville d’Etampes ne pouvait pas opposer
de résistance aux attaques d’une armée nombreuse. Les forces
réunies du roi de France et du roi de Navarre s’emparèrent d’Etampes,
le 30 juin 1589, et la saccagèrent de
[p.288] fond en comble. Petau fut tué et,
nous déclare sans autre précision la Rapsodie, «M. le
prévost Jean Audren fut encore plus mal traité» (53). Remarquons en passant que Nicolas Péteau,
tiraillé par des factions adverses, victime de son esprit d’apaisement,
avait été, en 1587, incarcéré par les ligueurs
et fut, en 1589, mis à mort par les huguenots. Plus tard, l’armée
de la Ligue reprit de nouveau la ville, sous la direction d’Alexandre de
Castelnau. Enfin, le 4 novembre 1589, Henri IV revint, fit démolir
le château, laissant subsister les ruines actuelles de Guinette, démantela
Etampes et la préserva ainsi pour l’avenir de beaucoup de maux (54).
Nous avons eu l’impression que, de 1562 à
1589, en dépit de quelques accalmies, la petite ville d’Etampes
avait subi des violences sans nombre, et n’avait plus obéi à
ses officiers locaux accoutumés.
|
(53) Plisson. éd. Forteau, ib., p. 67.—
On comprendra toute l’horreur de cette affaire, si l’on se souvient que Petau
avait été incarcéré par les catholiques.
(54) Id., ib. n. 1.
|
|
CONCLUSION
Au début du seizième siècle,
les officiers du bailliage concentraient entre leurs mains les pouvoirs
locaux. Peu à peu ils virent leur échapper une partie de leur
autorité. Ils restaient des magistrats. Ils maniaient rarement l’épée.
Leur rôle militaire s’était affaibli.
Le bailli et capitaine d’Etampes relevait tantôt
du gouverneur de l’Île-de-France, tantôt du gouverneur d’Orléans,
dans la première moitié du seizième siècle.
Pendant les guerres de religion, il dépendit du gouverneur d’Orléans.
Il ne commanda pas les années chargées
de défendre son bailliage. D’autres, plus grands capitaines, assumèrent
cette lourde responsabilité. Pour lui, il se contentait de pourvoir
au ravitaillement des troupes.
A aucun moment son action ne fut séparée
de celle de la municipalité étampoise, qui avait le rôle
financier par excellence pendant les troubles civils.
Le service du guet, négligé comme
inutile en temps de paix, était assuré en temps de guerre
par les soins de l’échevinage, d’après un [p.289] rôle des dixaines,
qu’il avait établi au préalable. Le bailli surveillait seulement
les actes de la municipalité. Les pouvoirs de celle-ci ne se dissociaient
pas des siens à proprement parler. Bailli et échevinage collaboraient.
Les officiers directement royaux ne faisaient que transmettre à
l’assemblée de ville des ordres de l’autorité centrale et
presser leur accomplissement. Mais les agents municipaux n’étaient-ils
pas les exécuteurs dociles des volontés royales? Ils l’étaient
et le devinrent de plus en plus.
P. DUPIEUX.
|
|
Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|
|
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
1) Article original: Paul DUPIEUX, «La
Défense militaire d’Etampes au XVIe siècle» in Revue
de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise 32 (1930), pp. 273-289.
2) Extrait: Paul
DUPIEUX, La Défense militaire d’Etampes au XVIe siècle
[in-4°; 19 p.; e xtrait de la Revue de l’histoire de Versailles et de
Seine-et-Oise (octobre-décembre 1930)], Versailles, J.-M. Mercier,
1930 [apparemment imprimé seulement en 1932].
3) Publication numérique
en mode image par la BNF sur son site Gallica, in «Revue de l’histoire de Versailles
et de Seine-et-Oise 32 (1930)», http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-67123,
pp. 273-289, en ligne en 2005.
4) Présente publication
numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Paul
Dupieux: La Défense militaire d’Etampes au XVIe siècle
(1930)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-dupieux1930defense.html,
2005.
Autres ouvrages
de Dupieux sur Étampes
Paul DUPIEUX, Les Institutions royales au
pays d’Etampes (Comté puis Duché: 1478-1598), par Paul Dupieux,
architecte-adjoint de la Seine. Ouvrage couronné par l’Institut
[in-8°; XIX+288 p.; gravure; carte], Versailles, Mercier [«Bibliothèque
d’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, publiée sous les auspices
de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise
(Académie de Versailles)»], 1931.
Paul DUPIEUX, Lettres royaux inédites
concernant Etampes (1456-1573) [gr. in-8°; 47 p.; extrait du Bulletin
philologique et historique (1930-1931)], Paris, Imprimerie nationale,
1933.
Autres publications
de Dupieux
Nous donnons ici la bibliographie
des autres ouvrages de Paul Dupieux conservés par la BNF. Il est juste
en effet que le Corpus Étampois lui rende cet hommage, puisqu’il
a beaucoup donné à Étampes, pendant la première
partie de sa carrière d’historien; avant que sa carrière d’archiviste
ne l’éloigne de notre région.
Paul DUPIEUX & M. le Comte de JANSSENS, Le Gentilica Claudius dans
quelques noms de lieux de l’Ouest, Clion, Cloué, Cloyes, etc.
[in-8° ; 19 p.; extrait du Bulletin de la Société des
antiquaires de l’Ouest (2e trimestre 1931)], Poitiers, Société
française d’imprimerie, 1931.
Paul DUPIEUX, Les Brondes, manufactures
de cotonnades et de liqueurs, 1762-1800 [in-8°; paginé 59-104
; extrait des Mémoires lus au Congrès des sociétés
savantes de Toulouse IV (1933)], 1933.
Paul DUPIEUX, Les Attributions de la juridiction
consulaire de Paris (1563-1792). L’arbitrage entre associés, commerçants,
patrons et ouvriers au XVIIIe siècle [gr. in-8°; 35 p.;
extrait de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes (1934)],
Paris & Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1935.
Paul DUPIEUX, L’Industrie textile en Champagne
troyenne de 1784 à 1789 [in-8°; 27 p. ; extrait de la Nouvelle
Revue de Champagne et de Brie (juillet 1935)], Châlons-sur-Marne,
A. Robat, 1935.
Paul DUPIEUX, Troyes et la foire de Beaucaire,
courants commerciaux sous la Révolution et l’Empire [in-8°;
17 p.; extrait de la Nouvelle Revue de Champagne et de Brie (avril
1936)], Châlons-sur-Marne, A. Robat, 1936.
Gustave-B. DUHEM [auteur principal], Paul DUPIEUX
[auteur de la préface et des tables], Département de l’Aube.
Ville de Chaource. Inventaire sommaire des archives communales antérieures
à 1790, rédigé par G. Duhem [in-8°; 44 p.],
Troyes, J.-L. Paton, 1936.
Gustave-B. DUHEM, Paul DUPIEUX & J. BLANC
[collaborateur], Répertoire numérique de la série
Y: établissements de répression (Archives départementales
de l’Aube) [32 cm; 12 p.], Troyes, Archives départementales de
l’Aube, 1936.
[MONTLUCON]
- DUPIEUX (Paul).
Paul DUPIEUX
(1904-1980) & Jules BLANC, Archives départementales de l’Aube,
antérieures à 1792. Répertoire numérique de la
sous-série II C, fonds de l’enregistrement et de la conservation des
hypothèques [Texte imprimé], dressé par Paul Dupieux,...
avec la collaboration de Jules Blanc,... [in-f° (30 cm sur 24,5), V+53
p.], Troyes, Imprimerie troyenne, 1938.
Paul DUPIEUX [rédacteur] & Louis
ALFONSI [collaborateur], Répertoire numérique de la série
V: Cultes [32 cm; III+39 p.] Troyes, Archives départementales
de l’ Aube, 1938.
Paul DUPIEUX (Archiviste en chef de l’Allier), Département de
l’Allier. Ville de Montluçon. Inventaire sommaire des archives communales
antérieures à 1790. Tome premier, séries AA, BB et CC
[in-f° (33 cm sur 25); 48 p.], Moulins, Crépin-Leblond, 1944.
[Les pièces inventoriées ici sont conservées aux Archives
départementales de l’Allier, elles concernent les actes relatifs
aux privilèges de la ville (AA), les délibérations du
Conseil municipal (BB), et les finances communales (CC). L’ensemble est précédé
d’une très introcduction historique sur la sitation de Montluçon,
par Paul Dupieux].
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE MOULIN
DU CENT-CINQUANTENAIRE DE LA RÉVOLUTION [éd.] & Paul
DUPIEUX [préfacier], Études sur la Révolution française
dans l’Allier. 1re série. 1939-1945 [in-4° (25 cm sur 16,5);
212 p.], Moulins, Imprimerie du Progrès, 1945.
Paul DUPIEUX, Marcel MOREAU [auteur] &
Louis VÉREL [préfacier], Histoire du Bourbonnais pour
la jeunesse. Dessins de Mlle Yvonne Diverneresse. Préface de M.
Vérel [in-16 (19,5 cm sur 14); 200 p.; figures; portraits;
carte],Moulins, Crépin-Leblond, 1945.
Paul DUPIEUX [auteur] & Augustin BERNARD
(1867-1947) [préfacier], La province de Bourbonnais. Préface
par Augustin Bernard,... Aquarelles hors-texte en couleurs et sépias
de Pierre Poncet. Légendes de A. Collot. Frontispice de Ranson
[in-f° (38,5 cm sur 28,5; 282 p.; figures; planches], Moulins, Crépin-Leblond,
1946. Dont une réédition: La province de Bourbonnais [21 cm;
261 p.], Paris, Barré & Dayez [«Nouvelle revue d’histoire»
17], 1991 [ISBN 2-902484-11-9: 100 FF].
Paul DUPIEUX, Les Artistes à la cour
ducale des Bourbons: les Maîtres de Moulins [in-8° (23 cm
sur 14,5); 55 p.], Moulins, Crépin-Leblond [«Curiosités
bourbonnaises» 39], 1946.
Joseph (François-Joseph) VIPLE, Camille
GAGNON, Paul DUPIEUX & Marcel GÉNERMONT, Visages du Bourbonnais
[in-8°; 200 p. ; figures; planches en noir et blanc et couleur; portraits,
fac-similés; cartes en couleur], Paris, Éditions des Horizons
de France [«Provinciales»], 1947.
Paul DUPIEUX, Les Traces germaniques dans
la toponymie bourbonnaise [in-4°; paginé 277-288; extrait
de Onomastica 3-4 (septembre-décembre 1947)], Lyon &
Paris, I.A.C., 1947.
Paul DUPIEUX, Les noms de souterrains et
d’industries en Bourbonnais [24 cm; notes bibliographiques], Moulins,
A. Pottier [«Les noms de lieux et de peuples du Bourbonnais, témoins
historiques» 1], 1947-19..
Alexandre
VIDIER [premier éditeur en 1911], Léon LEGRAND & Paul
DUPIEUX [continuateurs], G. DUPONT-FERRIER [préfacier], Comptes
du domaine de la ville de Paris, publiés par les soins du Service
des travaux historiques de la ville de Paris [2 volumes in-f° (32
cm); t.1 (1424-1457; texte édité et annoté par Alexandre
Vidier,... Léon Le Grand,... Paul Dupieux,... ; introduction de G.
Dupont-Ferrier,...): XXXII+1056 p.; t. 2 (1457-1489, texte édité
et annoté par Jacques Monicat): LII p.+698 col.+II p.; figures; fac-similés],
Paris, Imprimerie nationale [«Histoire générale de Paris»],
1948-1958.
Paul DUPIEUX, Les Traces germaniques dans
la toponymie bourbonnaise [in-8°; pagine 19-38; carte; extrait
du Bulletin de la Section de Géographie du Comité des Travaux
historiques et scientifiques (1946, 1947 & 1948)], Paris, Imprimerie
nationale, 1953 [L’exemplaire de la BNF porte des notes et corrections
manuscrites de l’auteur].
Paul DUPIEUX & Antoine LACROIX, Le Napoléon
ou les Drames de la monnaie française depuis deux mille ans
[24 cm; 462+XXXIX p.; illustrations; bibliographie pp. 417-433; index],
Paris, Debresse, 1973.
Paul DUPIEUX, Peuples et princes en Bourbonnais
[26 cm; 421 p.; illustrations; bibliographie pp. 409-414], Moulins, Ipomée,
1980 [ISBN 2-86485-010-9; 340 FF].
Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|