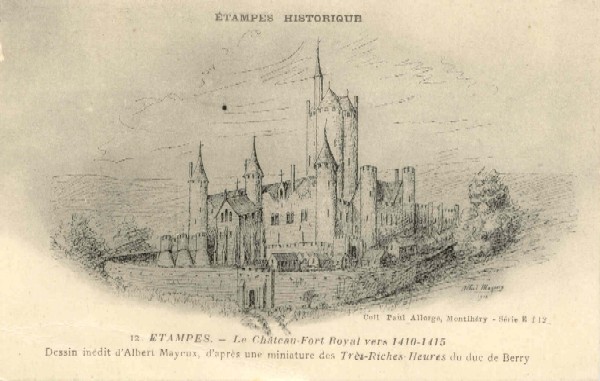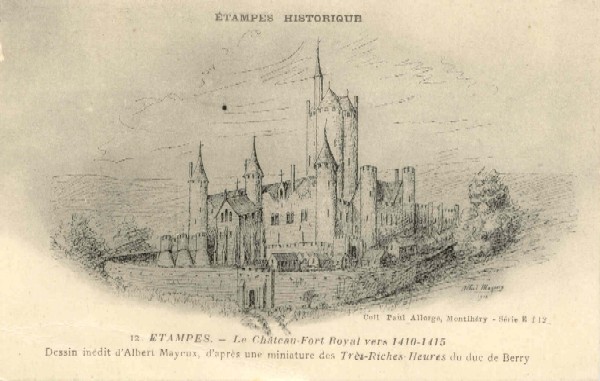|
LES SEIGNEURS
D’ÉTAMPES
CHRONOLOGIE DES BARONS, COMTES ET DUCS D’ÉTAMPES
par Léon Marquis
Membre de plusieurs sociétés historiques et
archéologiques
Étampes
L. Humbert-Droz, imprimeur-éditeur
1901
Dans une réunion archéologique qui eut lieu à Étampes
en 1900, un de nos Confrères nous demandait s’il n’y avait pas eu
d’autres duchesses de cette ancienne seigneurie que celle connue indifféremment
sous les noms de duchesse d’Étampes ou Anne de Pisseleu? Nous répondîmes
qu’il y en avait d’autres, eu effet, notamment Diane de Poitiers, Gabrielle
d’Estrées, etc., et que la liste de tous les seigneurs serait trop
longue à donner de mémoire, car certains ont été
dépossédés de la seigneurie et en ont été
pourvus de nouveau, de telle sorte qu’elle a changé de mains plus
de cinquante fois, de l’année 1240 à l’année 1789.
Les seigneurs d’Étampes étaient
les plus grands dignitaires: rois et reines, princes et princesses, hauts
et puissants [p.2] seigneurs issus des rois de France, mais qui, quelquefois, ne
craignaient pas de les combattre à1’occasion.
Les listes et les documents donnés par
dom Fleureau, historien d’Étampes, sont assez complets, maïs
ils s’arrêtent au milieu du XVIIe siècle: Le P. Anselme et l’Art
de vérifier les dates (par un Religieux bénédictin)
donnent aussi une bonne Chronologie, mais elle s’arrête à
l’année 1712 et dit à tort que le duché d’Étampes
passa alors au Domaine de la Couronne. En effet, les Essais historiques
sur Étampes, par de Montrond, auquel nous aurons recours, donnent
une suite des seigneurs depuis l’origine jusqu’à l’extinction de
la seigneurie en 1789.
D’après ces différents ouvrages,
les dictionnaires Moréri, d’Expilly et la Chenaye-des-Bois, et des
documents puisés aux meilleures sources, nous avons établi
une Chronologie de cette seigneurie avec une notice abrégée
sur chacun des seigneurs qui en étaient titulaires.
Dès le VIe siècle, Gontran, roi
de Bourgogne et d’Orléans, possédait les villes de Châteaudun,
Chartres, Vendôme et Étampes; qui tirent ensuite partie du
domaine des rois de France (1).
|

Léon Marquis
(1) Fleureau, Antiq.
d’Étampes, 1683, in-4°, p. 12.
|
Au IXe siècle, d’après les Annales de Saint-Bertin,
par l’abbé Dehaisne, le comté d’Étampes fut donné
au roi Charles-le-Chauve.
D’après la Chronique de Morigny,
il y avait au XIe siècle, sous le règne de Philippe Ier,
un nommé Marc, qui était vicomte d’Étampes, et dont
la fille épousa Gui, fils de Hugues Ier, dit le Grand, seigneur
du Puiset. Gui, par ce mariage, devint vicomte d’Étampes: cette
dignité était
donc déjà héréditaire (2). [p.3]
|
(2)
Fleureau, p. 588, L’art de vérifier les dates, 1786,
in-fol., tome II p. 666.
|
Le vicomte Gui était Grand Chambrier de France, c’est-à-dire
un des plus grands officiers de la couronne (1).
On l’appelait indifféremment Gui de
Méréville, ou Gui du Puiset. Il était le frère
ou le cousin de Bernard d’Étampes, qui prit part à la première
croisade en 1096 et mérita, par sa bravoure, d’être fait seigneur
propriétaire d’une ville d’Arabie nommée Adraon. (Castrum
Bernardi de Stampis) (2).
En l’année 1113, Gui est l’un des treize
témoins d’une donation par laquelle le roi Louis le Gros accorde
à l’église Notre-Dame d’Étampes le droit d’avoir un
âne qui desserve son moulin. (Charte de Louis III datée d’Étampes,
dans le chapitre N.-D., août 1113, publiée par Fleureau, p.
348 et citée par Luchaire, Annales de Louis VI, n°161).
Guy a été l’un des premiers bienfaiteurs
de l’abbaye de Morigny qui avait été bâtie dans un
fief appartenant à Hugues, son père. (Fleureau, pp. 568 et
suiv.)
Lors des dissensions entre les moines de Morigny
et les chanoines de Saint-Martin d’Étampes, le vicomte Gui est souvent
cité. C’est ainsi qu’en 1142, il souscrit à une charte par
laquelle Louis VI confirme aux moines la possession de l’église Saint-Martin,
que son père leur avait donnée. (Charte de Louis VI, donnée
au Palais d’Étampes en août 1112, publiée par Fleureau,
p. 479 et citée par [p.4] Luchaire, n° 144). Vers 1118, Gui, au nom de l’abbé
de Morigny, va trouver le roi à Châteaufort et réussit
à faire trancher le différend avec les chanoines de Saint-Martin
qui ne voulaient pas reconnaître la suprématie de l’Abbaye.
Le roi donne l’ordre de reconnaître la légitimité des
prétentions de l’abbé sur l’église Saint-Martin. (Épisode
de la Chronique de Morigny, cité par Fleureau p. 482 et par
Luchaire, n°402.)
|
(1)
Achille Luchaire, Annales de la vie de Louis VI le Gros, 1800, in-8.
Plusieurs actes cités dans cet ouvrage indiquent le vicomte Gui,
chambrier, comme témoin.
D’après Moréri (Dict. hist.),
le Grand Chambrier était distingué du Grand Chambellan. Un
des plus considérables droits de sa charge, était d’avoir
juridiction sur tous les marchands et artisans du royaume, de donner des
lettres de maîtrise et de leur faire observer les ordonnances. Il
tenait sa juridiction à Charonne et à Picpus, au bout du faubourg
Saint-Antoine, et ses jugements étaient portés en appel au
Grand Conseil.
(2) Fleureau, pp.
568 à 572. Moréri, Dict. hist., art. ADRAON.
|
Selon certains historiens, dom Morin (1), le président Hénaut (2), Sainte-Marthe, du Breuil
et autres, un comte d’Étampes existait vers la même époque
et était le mari d’Eustache ou Eustachie, fille du roi Philippe
Ier. Mais, c’est une erreur manifeste, selon le Cartulaire de Notre-Dame
d’Yerres. D’après ce document, Eustachie de Corbeil, fille de
Frédéric de Châtillon et fondatrice de
l’abbaye d’Yerres, avait épousé en secondes noces le
seigneur Jean d’Étampes, de qui elle eut plusieurs enfants (3).
Ce Jean d’Étampes avait un frère,
Guillaume d’Étampes, qui devint prieur de la même abbaye (4).
La seigneurie d’Étampes, connue vaguement
dans ses origines: vicomté selon les uns et comté selon les
autres, ne commença réellement à former une seigneurie
qu’à partir du règne de Saint-Louis.
|
(1) Histoire du Gâtinais, 1630, in-4°.
(2) Abrég.
chron. de l’histoire de France.
(3) Alliot, Cartulaire
de N.-D. d’Yerres. 1899, in-8, p. 2.
(4) Id.,
p. 14.
|
|
ANNÉE 1240
1. La
seigneurie était alors une baronnie: elle fut donnée par le
roi Louis IX, en 1240, à la reine Blanche, sa mère, pour la
dédommager d’une partie de son douaire [p.5]qu’elle avait cédé
à Robert, son fils, en le mariant en 1237 à Mathilde de Brabant.
(Lettres patentes de Saint-Louis, datées de Paris, 1240. — Fleureau,
p. 131.)
On sait que cette reine fut déclarée
régente du royaume après la mort de son mari, le roi Louis
VIII, ainsi que pendant le voyage d’outre-mer du roi Saint Louis, et qu’elle
fonda l’abbaye du Lis près Melun et plusieurs autres monastères.
(Moréri art. BLANCHE.) On lui attribue aussi la fondation du couvent
des Cordeliers d’Étampes. (De Montrond, Essai hist., tome
I, p. 478.)
Saint-Louis a été l’un des bienfaiteurs
de l’église Notre-Dame d’Étampes, car il y fonda deux chapellenies
royales en 1254 et 1255. (Fleureau, pp. 340 â 344.)
|
|
|
ANNÉE 1252
2. A la mort de la reine Blanche, le 30 novembre 1252, la seigneurie
rentra dans le domaine de la couronne, mais elle en fut détachée
quelques années après. (Fleureau, p. 435.)
|
|
|
ANNÉE 1272
3. Elle
composa alors une partie du douaire de Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis.
(Fleureau, p. 435.)
Cette reine, pour favoriser les bouchers
d’Étampes, leur donna à bail, en 1274, les bancs et les étaux
qu’ils occupaient dans le Petit Marché, moyennant une rente de 72
livres parisis. (Lettres de Marguerite, données à Passy en
3274 et citées par Fleureau, p. 136.)
Tous les historiens vantent la beauté
et les vertus de cette princesse qui suivit son mari dans ses voyages d’outre-mer.
Elle avait fondé des hôpitaux et des maisons
[p.6]
religieuses à Château-Thierry et à Paris. (Moréri,
art. MARGUERITE.)
|
|
|
ANNÉE 1295
4. A la mort de Marguerite de Provence, le 20 décembre 1295,
la seigneurie revient à son fils, le roi Philippe le Hardi, c’est-à-dire
à la couronne. (Fleureau, p. 443.)
|
|
|
ANNÉE 1307
5. Le roi Philippe le Bel la céda, en avril 4307, à
son frère Louis Ier, comte d’Évreux, ainsi que les prévôtés
et châtellenies d’Évreux, Aubiguy, Gien, la Ferté-Alais
et Meulan, pour lui tenir lieu d’une pension de quinze mille livres qui
lui avait été assignée par le testament de Philippe
le Hardi. (Lettres patentes de Philippe IV d’avril 1307, publiées
par Fleureau, pp. 143 et 144.)
Louis Ier avait épousé en l’an
1300 Marguerite d’Artois, dame de Brie-Comte-Robert.
Au mois d’août 1411, il assigna sur
la prévôté d’Étampes trente sols tournois de
rente que la comtesse d’Étampes, son épouse, avait légués
au chapitre Notre-Dame d’Étampes et à la même époque,
le roi Philippe IV amortit cette même rente. (Lettres de Louis Ier
datée de Paris, août 1311) et de Philippe IV datée de
Saint-Ouen, août 1311) [sic] (1). [p.7]
|
(1) Alliot, Cartulaire cité, p. 57.
|
|
ANNÉE 1319
6. A
la mort de Louis d’Évreux, le 19mai 1319, Charles d’Évreux,
son second fils, eut pour partage tes domaines de Gien, Étampes et
quelques autres. Ce fut en l’honneur de Charles d’Évreux que la
baronnie d’Étampes fut érigée en comté, au mois
de septembre 1327, par le roi Charles le Bel, son cousin. (Lettres patentes
de Charles IV, de septembre 1327, publiées par Fleureau, p. 151.)
Charles d’Évreux périt dans
une bataille le 24 août 1336 et laissa quatre enfants. Il fut aussi
l’un des bienfaiteurs de l’église Notre-Dame d’Étampes. (Fleureau,
p. 452.)
Par son testament, le comte Charles assigna
sur la prévôté d’Étampes dix livres tournois de
rente pour la célébration annuelle de quatre services solennels
à l’église Notre-Dame. Les exécutrices testamentaires
sont: sa veuve, la reine Jeanne et Marguerite, comtesse de Boulogne, ses
sœurs. Les clauses du testament sont approuvées par Jeanne d’Évreux,
reine de France, et par Philippe de Melun, évêque de Châlons.
(Lettres de Philippe données à Étampes le 10 février
1336 et de la reine Jeanne datées de Château-Thierry, 11 juin
1337 (1).
|
(1) Alliot, Cart. cité, pp. 58 et 63.
|
Marie d’Espagne, comtesse d’Alençon et d’Étampes, dame de
Lunel, veuve de Charles d’Évreux, fut une grande bienfaitrice de
l’abbaye de Morigny, car elle fonda des messes pour le repos de son âme
et de celle de son mari. Pour la dotation de ces fondations, elle donna
quarante livres tournois de rente et autres biens qui devront être
employés à la pitance des moines, notamment «à
chacun d’eux trois œufs à souper par chacun [p.8] jour, depuis la sainte
Croix en septembre, jusques à Pâques, par chacun an, perpétuellement...»
(Lettres patentes de Marie d’Espagne, datées de Dourdan, 22 septembre
1352, publiées par Fleureau, pp. 158 à 155.)
Elle mourut le 13 novembre 1379.
Cette princesse portait dans ses armes,
que nous donnons ci-après, un quartier des armes de Castille, comme
celles de Blanche de Castille, qui paraissent avoir donné naissance
aux armes d’Étampes: Au château d’or, sommé de trois
tours de même, avec trois créneaux maçonnés de
sable, la porte et les fenêtres d’azur. (Fleureau, p. 155. — Léon
Marquis, Les Rues d’Étampes, p. 61.)
|
|
|
ANNÉE 1336
7. Louis
d’Évreux, deuxième du nom, l’un des quatre enfants de Charles
d’Évreux et son fils aîné, était encore en bas
âge à la mort de son père quand il hérita du comté
d’Étampes. (Fleureau, p. 456.)
Ayant été fait prisonnier en
1358 à la bataille de Poitiers, il fut un de ceux que le prince de
Galles admit à la table du roi captif le soir de la fatale journée.
En 1358, les hommes d’armes du comte Louis,
qui étaient en garnison dans le château d’Étampes,
étaient sans cesse en guerre avec les habitants qui s’étaient
fortifiés dans leur église Notre-Dame, sous les ordres de
Baudouin de Blesay, capitaine de la ville. Le 16 janvier 1358, les compagnies
anglaises de la Beauce profitèrent de ces divisions pour emporter
d’assaut le «fort de l’église Notre-Dame et piller Étampes».
(Histoire de du Guesclin.)
Le comte d’Étampes fut fait prisonnier
par les Anglais, car en 1360 il s’engage à leur payer à titre
de rançon mille moutons d’or et leur donne en gage son chapeau
[p.9] d’or
du prix de deux cents moutons. (Chroniques de Froissart.)
Louis II d’Évreux avait légué
en 1368 à l’église Notre-Dame d’Étampes des biens
considérables pour des fondations charitables, notamment une messe
qui se chantait autrefois tous les jours dans cette église, «devant
soleil levant» et appelée «la messe du Comte»
Il avait fondé aussi plusieurs services anniversaires à célébrer
pour lui au même lieu, après sa mort.
Ces donations eurent lieu en considération
des pertes et des dommages subis par le chapitre et les chanoines durant
les guerres qui ont duré si longtemps dans toute la France. (Lettres
du comte Louis II datées de Paris, juin 1368; du «Chastel»
d’Étampes, août 1373; et de Paris, juillet 1378, publiées
par Fleureau, pp. 344 à 325.)
En 1368, il confirma après deux siècles
et demi la concession de Louis le Gros accordant au chapitre Notre-Dame
l’autorisation d’aller avec un âne quérir des grains dans toute
la châtellenie d’Étampes. (Lettres de Louis II datées
de Paris, 2 juin 1368). (1).
|
(1)
Alliot, Cartulaire cité, p. 122.
|
En septembre 1384, il amortit les cens qui lui étaient dus sur les
biens légués par deux bourgeois d’Étampes à
la même église. (Lettres du même, datées du châtel
d’Étampes, 25 septembre 1384) (2).
Ces libéralités furent suivies
de lettres d’amortissement que le comte d’Étampes obtint du roi
Charles VI, en 1392, pour affermir les diverses fondations. (Fleureau,
pp. 326 à 331.) [p.10]
|
(2) Id.,
pp. 39 à 48.
|
|
ANNÉE 1381
8. Louis II d’Évreux se voyant sans enfants de Jeanne de
Brienne ou d’Eu, sa femme, qui mourut le 6 mai 1400, fit donation entre vifs,
le 9 novembre 1381, du comté d’Étampes et des seigneuries de
Gien, Dourdan et Aubigny-sur-Nierre, à Louis de France, duc d’Anjou
et de Touraine, second fils du roi Jean et son ami d’enfance. (Lettres du
comte Louis II, du 9 novembre 1381, publiées par Fleureau, pp. 159
à 162.)
Louis de France est un des personnages les
plus considérables qui ont possédé le comté.
Après la mort du roi Charles V en 1380, il devint régent
du royaume pendant la minorité de Charles VI, son neveu. Ayant été
adopté pour fils, la même année, par la reine Jeanne
de Sicile, il devint en 1382 roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem.
Il ne jouit pas longtemps de la libéralité
de son ami, car il mourut avant lui le 20 septembre 1384, près de
Bari, en Italie, où il fut, dit-on, empoisonné. (Fleureau,
pp. 163, 164. — Moréri, Dict. hist., Art. ANJOU et LOUIS.)
Louis de France avait épousé,
le 9 juillet 1360, Marie de Châtillon, dite de Blois, fille de Charles
de Blois, duc de Bretagne, laquelle mourut le 12 novembre 1404.
|
|
|
ANNÉE 1384
9. Louis de France, duc d’Anjou, eut deux fils qui héritèrent
des titres et biens de leur père.
L’ainé, Louis, deuxième du nom,
né en 1377, fut couronné roi de Naples et de Sicile en 1389;
il était roi d’Aragon et de Jérusalem, duc d’Anjou, comte de
Provence et du Maine. [p.11]
Louis II d’Anjou avait épousé,
le 2 décembre 1400, Yolande d’Aragon, fille de Jean Ier, roi d’Aragon,
laquelle mourut le 14 novembre 1442.
Le second, Charles, devint duc d’Anjou et de
Calabre, prince de Tarente, comte du Maine, d’Étampes et de Gien
et eut les châtellenies de Dourdan et d’Aubigny. Il mourut sans alliance
le 19 mai 1404. (Fleureau, p. 106. — Moréri, art. ANJOU.)
|
|
|
ANNÉE 1385
10. Peu
de temps après, Marie de Châtillon,veuve de Louis Ier d’Anjou,
reine de Jérusalem et de Sicile, tant en son nom que comme tutrice
de ses enfants mineurs Louis et Charles, transporta à leur oncle
Jean de France, duc de Berry, comte de Poitou, d’Auvergne et de Boulogne,
fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, les comtés d’Étampes
et de Gien et les autres seigneuries de Louis II d’Évreux.
Ce don eut lieu à titre de compensation,
pour tenir compte au duc de Berry de la principauté de Tarente que
leur père lui avait accordée pour l’attacher à ses
intérêts, mais que, depuis la mort de celui-ci, ou voulait
conserver à l’un d’eux.
Une transaction qui eut lieu à cet effet
entre eux et le duc de Berry fut agréée et confirmée
par le roi Charles VI an mois d’août 1385. (Lettres patentes du roi
Charles VI, datées de son camp en Flandre, 1er août 4385,
publiées par Fleureau, p. 166 et 168.)
Rappelons que ce comte d’Étampes fut
parrain en 1401, (il y a juste cinq siècles), de la cloche «Marie
la grosse» ou bourdon de Notre-Dame d’Étampes. Il avait épousé:
1° en juin 1360 Jeanne d’Armagnac, morte en mars 1387; [p.12] 2° en mai 1389 Jeanne II comtesse d’Auvergne
et de Bologne, morte vers 1424.
|
|
|
ANNÉE 1387
11. Jean, duc de Berry, fit semblable donation des mêmes domaines
le 28 janvier 1387 à son frère Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne, comte de Flandre et d’Artois, gouverneur de Normandie et de
Picardie, quatrième fils du roi Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg.
Par testament daté de 1401, il étendit à Jean, comte
de Nevers, fils aîné de Philippe le Hardi, la donation qu’il
avait faite en faveur de ce dernier. (Lettres de Jean de France, datées
de Paris, 28 janvier 1387, publiées par Fleureau. p. 168. — Art
de vérifier les dates.)
Comme son frère Louis d’Anjou, il fut
aussi régent du royaume pendant la maladie du roi Charles VI.
Philippe avait épousé en juin
1369, Marguerite, comtesse de Flandres et d’Artois, veuve de Philippe Ier,
dit de Rouvres, duc de Bourgogne, morte le 20 mars 1404.
On sait que la magnificence des ducs de Bourgogne,
surpassait celle des rois de France leurs cousins. Philippe le Hardi, fils
de roi, avait osé préparer une invasion en Angleterre; et
sa maison était composée d’une véritable armée
d’officiers et serviteurs: environ douze cents chanceliers, secrétaires,
aumôniers, cuisiniers, chambellans, pannetiers, veneurs, chirurgiens,
barbiers et valets de toutes sortes (1). [p.13]
|
(1)
État des officiers de Philippe le hardi, dans la Revue nobiliaire
de 1865.
|
|
ANNÉE 1404
12. Philippe le Hardi étant mort le 27 avril 1404, le comté
d’Étampes passa à son fils aîné Jean sans Peur,
duc de Bourgogne,comte de Flandre et d’Artois, qui ne devait cependant
en prendre possession qu’après la mort de Jean, duc de Berry. Celui-ci
changea bientôt de dispositions et révoqua la donation après
l’assassinat du duc d’Orléans, frère unique du roi, en novembre
1407, par des meurtriers aux ordres du duc de Bourgogne, son cousin.
Le fils aîné du duc d’Orléans
ne pouvant obtenir contre le meurtrier de son père la justice qu’il
désirait, prit les armes contre lui, ainsi que d’autres seigneurs.
D’où, l’origine de la fameuse ligue entre les Armagnacs et les Bourguignons.
En 1414, le chevalier de Bosredon, qui commandait
dans le château d’Étampes pour le duc de Berry, du parti des
Armagnacs, se vit obligé, comme on sait, de capituler après
quelques jours de siège, devant les forces réunies du Dauphin
Louis et du duc de Bourgogne. (Fleureau, pp. 173 et 175.)
Jean sans Peur avait épousé
en avril 1385, Marguerite de Bavière, morte en janvier 1423. Le luxe
de ce prince n’était pas moins grand que celui de son père.
Ainsi, à Soissons, en 1409, au mariage de son frère Philippe
de Bourgogne, comte de Nevers, avec Isabelle de Coucy, il fit faire pour lui
et les principaux seigneurs de Bourgogne, seize robes écarlates dont
les manches et les chaperons étaient couverts de lozanges d’or. La
même année, au mariage de son autre frère Antoine, duc
de Brabant, avec Élisabeth de Luxembourg, fille unique du marquis de
Moravie et nièce du roi de Bohême, les réjouissances
[p.14] furent magnifiques et on y vit toute la puissante et nombreuse
famille de Bourgogne, avec quantité de princes et de grands seigneurs
(1).
|
(1) De Barante, Hist. des ducs de Bourgogne.
|
En 1408, le duc de Berry qui était redevenu seigneurs d’Étampes,
fit enfermer dans le châtel de cette ville, une fillette nommée
Gillette la Mercière, âgée de huit ans, qu’il voulait
faire marier à un peintre travaillant pour lui. Il fallut l’intervention
du roi et du Parlement de Paris pour délivrer la jeune prisonnière
et la rendre à ses parents (2).
|
(2) Douët d’Arcq, Choix de pièces
sur le règne de Charles VI. Tome 1, p. 313.
|
Le même seigneur, Jean de Berry, possédait un livre d’heures
ayant appartenu au duc d’Aumale et qui se trouve toujours au château
de Chantilly. Ce livre, d’un prix inestimable, contient de superbes miniatures
dont l’une, notamment, représente le château d’Étampes
au XVe siècle.
|
|
|
ANNÉE 1412
13. Le 22 janvier 1412, par suite de la reddition du château
d’Étampes au profit du dauphin Louis de France, duc de Guyenne et
gendre de Jean sans Peur, puisqu’il avait épousé Marguerite,
sa fille aînée, le comté d’Étampes fut confisqué
par le roi Charles VI et réuni au domaine de la couronne.
Guillaume d’Arbouville, chevalier et gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, en fut fait gouverneur. (Lettres patentes
de Charles VI, datées de Paris, 22 janvier 1412, publiées
par Fleureau, p. 176.)
Par une commission du dauphin Louis de France,
datée de son camp devant Étampes du 16 avril 1412, Etienne
[p.15] Chartier (1) fut nommé receveur du comté d’Étampes,
ainsi que des châtellenies de Dourdan; la Ferté-Alais et dépendances,
confisquées par le roi pour cause de rébellion. (Lettres
du dauphin, datées d’Étampes, 46 avril 1412, publiées
par Fleureau, p. 476.)
|
(1) On sait que la plupart des familles de ce
nom font partie de la lignée de Chalo-saint-Mard.
|
|
ANNÉE 1417
14. Le duc Jean de Berry étant mort le 45 juin 1416, le duc
de Bourgogne Jean sans Peur, en profita pour s’emparer du comté
d’Étampes et de ses annexes, eu vertu de la donation de 1401, mais
il fut obligé d’employer la voie des armes.
En octobre 1447, tandis qu’il s’emparait de
Montlhéry, Dourdan et autres villes, ses officiers prenaient Étampes,
Auneau, Rochefort et Gallardon. (Fleureau, p. 478.)
D’après les Itinéraires des
ducs de Bourgogne, il est lui-même à Étampes les
26, 27 et 29 octobre.
|
|
|
ANNÉE 1419
15. Jean sans Peur ayant été assassiné à
Montereau le 10 septembre 1419 par les gens du Dauphin, son fils aîné
Philippe III, dit le Bon, duc de Bourgogne, de Brabant, de Luxembourg cl
de Limbourg, comte de Flandre, d’Artois, de Hollande, de Zélande,
etc., lui succéda au comté d’Étampes. C’est lui qui
institua l’ordre de la Toison d’Or. Il mourut en 1467. Philippe le Bon avait
épousé: 1° en juin 1409, Michelle de France, fille du
[p.16] roi Charles VI, morte sans enfants le 8 juillet 1422; 2°
en novembre 1424, Bonne d’Artois, veuve de Philippe de Bourgogne, comte de
Nevers, et par suite sa tante, laquelle mourut sans postérité
en 1425; 3° en janvier 1429, Isabelle de Portugal, fille de Jean Ier,
roi de Portugal, laquelle mourut en décembre 1471 et eut trois enfants
dont deux fils morts en bas-âge et Charles dit le Téméraire,
duc de Bourgogne. (Fleureau, pp. 178 et 179. — Moréri, art. BOURGOGNE.)
Philippe le Bon montra un luxe encore plus
grand que ses prédécesseurs. Le nombre de ses officiers de
cuisine fut presque doublé. (Etat des officiers déjà
cité.) Il fit frapper des monnaies à son effigie (1). En 1424, au mariage
de sa sœur Marguerite, duchesse de Guyenne, avec Artus III de Bretagne,
les fêtes durèrent plus d’un mois (2).
|
(1) Hennin. Mon. de l’hist. de France.
(2) De Barante,
Hist. des ducs de Bourgogne. |
Dans le célèbre banquet ou festival que le même duc
donna à Lille en février 1453, à l’occasion d’un projet
de voyage en Terre Sainte, chacun de services était composé
de quarante-huit plats qui descendaient du plafond au moyen de chariots
peints en or et en argent. II y avait des pièces montées,
représentant les châteaux du duc, différents personnages,
des animaux... On y prononça des vœux en l’honneur du duc de Bourgogne,
du comte de Charolais et du comte d’Étampes, qui était alors
Jean de Nevers (3).
|
(3) Chron. de Mathieu d’Escouchy, par
de Beaucourt. — Mém. d’Olivier de la Marche, par d’Arbaumont.
|
|
ANNÉE 1421
16. Par acte du 8 mai 1421, le Dauphin Charles disposa du comté
d’Étampes en faveur de Richard de Bretagne, [p.17] quatrième
fils de Jean V, duc de Bretagne, pour le récompenser de ses bons
services dans la guerre contre les Anglais, car avec Jean VI, duc de Bretagne,
son frère, il l’avait aidé à retirer Marie d’Anjou,
sa femme, de la main de ceux-ci qui la tenaient prisonnière à
Paris.
Devenu roi sous le nom de Charles VII, il confirma
cette donation en octobre 1425 et y ajouta même le comté de
Mantes. Richard avait épousé Marguerite d’Orléans,
comtesse de Vertus, morte en avril 1466. (Fleureau, p. 181. — Art de
vérifier les dates.) |
|
|
ANNÉE 1425
17. Philippe le Bon empêcha l’effet de cette donation par la
force des armés et conserva la jouissance du comté.(Art
de vérifier les dates.)
Artus III (ou Arthur), duc de Bretagne, appelé
plus souvent le comte de Richemont, est indiqué aussi comme comte
d’Étampes par certains auteurs (Moréri, Dict. hist.
et Anselme, Hist. général). Est-ce par suite de sa parenté
avec deux seigneurs d’Étampes? Il était en effet le gendre
de Philippe le Bon et le frère de Richard de Bretagne.
On sait que le duc Artus se signala dans plusieurs
batailles contre les Anglais, notamment à celle de Patay en
Beauce, en 1429.11 mourut en décembre 1458 sans enfants de ses trois
femmes: Marguerite de Bourgogne, Jeanne d’Albret et Catherine de Luxembourg.
(Moréri, art. BRETAGNE).
|
|
|
ANNÉE 1434
18. Philippe le Bon céda ce comté, en 1434, avec le
comté d’Auxerre, à Jean de Bourgogne, dit Jean de Nevers,
comte de Nevers, de Rethel et d’Eu, son cousin germain, pour [p.18] lui tenir lieu d’une
rente de cinq mille livres qu’il lui avait promise en compensation des
droits que Jean prétendait avoir sur les duchés de Brabant,
Limbourg, etc. (Fleureau, p. 178.)
Jean de Nevers avait épousé 1°
En novembre 1435, Jacqueline d’Ailli, fille de Raoul d’Ailli, seigneur
de Péquigny; 2° le 30 août 1475, Paule de Brosse, dite
de Bretagne, fille de Jean de Brosse, deuxième du nom, comte de Penthièvre,
et de Nicolle de Blois, et 3° en 1480, Françoise d’Albret, morte
sans enfants, en mars 1521.
Jean de Nevers se signala dans les guerres
contre les Anglais sous les ordres du duc de Bourgogne. (Chron. de Monstrelet.)
Jean de Brosse, quatrième du nom, qui
fut plus tard comte d’Étampes, et dont il sera question ci-après,
est son arrière petit-fils. (Moréri, art. BOURGOGNE et BROSSE.)
|
|
|
ANNÉE 1435
19. Le 25 septembre 1435, suivant un article du traité d’Arras,
entre le roi Charles VI et le duc Philippe le Bon, il fut convenu que le
comté d’Étampes serait mis sous séquestre pendant un
an entre les mains de Charles Ier, duc de Bourbon et d’Auvergne (1).
|
(1)
Ce traité a été publié dans les Mémoires
d’Olivier de la Marche.
|
Richard de Bretagne, qui était présent au traité et
député pour le roi, ne parait pas y avoir fait opposition.
Jean de Nevers y était également et représentait le
duc de Bourgogne. (Fleureau, pp. 179 et 180.) [p.19]
|
|
|
ANNÉE 1436
20. Au mois de janvier 1436, Jean de Nevers était redevenu
comte d’Étampes ainsi qu’il résulte de lettres de cette date
scellées de son sceau, et du vivant même de Richard de Bretagne,
qui mourut le 3 juin 1438.
Quant à Jean de Nevers, il mourut le
25 septembre 1491. (Fleureau, p. 180.)
|
|
|
ANNÉE 1422
21. Quelques années après la mort de Richard de Bretagne,
sa veuve, Marguerite d’Orléans, en qualité de tutrice de
François Il, duc de Bretagne, leur fils, obtint du roi Charles VII,
en juin 1442, la confirmation du don fait à son mari. Mais il y eut
deux oppositions: 1° de la part de Philippe le Bon, défenseur
des droits de Jean de Nevers; 2° de la part du Procureur général
du Parlement, lequel soutenait que la seigneurie avait été
donnée en apanage à Louis d’Évreux, fils du roi Philippe
le Hardi, et la postérité de ce prince étant éteinte,
elle devait être réunie au domaine de la couronne. A la suite
de cette seconde opposition, le comté d’Étampes fut saisi
par le procureur général, et ses revenus administrés
par les commissaires du Parlement. Tantôt, c’était le roi qui
en jouissait, tantôt le duc de Bourgogne et tantôt d’autres.
(Lettres patentes de juin 1442, du roi Charles VII, citées par Fleureau,
pp. 181 et 182.)
François II, qui est quelquefois qualifié
de comte d’Étampes, avait épousé: 1° en 1455,
Marguerite, fille de François 1er duc de Bretagne, sa cousine, morte
en septembre [p.20] 1469; 2° en 1471, Marguerite, fille de Gaston IV comte de
Foix, morte en 1487, dont il eut Anne de Bretagne qui devint reine de France
et comtesse d’Étampes (Moréri, art. BRETAGNE).
|
|
|
ANNÉE 1478
22. Un procès qui dura plus de trente ans résulta de
ce différend. Il fut jugé définitivement par un arrêt
du Parlement de Paris du 18 mars 1478 qui réunit de nouveau le comté
d’Étampes à la couronne. (Arrêt du Parlement publié
par Fleureau, p. 181.)
|
|
23. La même année au mois d’avril, le roi Louis XI
disposa de la seigneurie d’Étampes en faveur de Jean de Foix, vicomte
de Narbonne, et de ses enfants. (Lettres pat. de Louis XI datées d’Arras,
avril 1478, publiées par Fleureau, pp 191 à 198.)
Il était fils de Gaston IV, comte de
Foix et d’Éléonore d’Aragon, reine de Navarre, d’où
sont issus les rois de Navarre, et allié des rois de Castille, de Naples
et de Sicile.
Le roi Charles VII l’avait armé chevalier
au siège de Tartas en 1442. Il était très considéré
par ce roi et par ses successeurs Charles VII et Louis XII, qu’il accompagnait
souvent dans leurs voyages. (Fleureau, p. 190).
Il avait épousé Marie d’Orléans,
fille de Charles, duc d’Orléans et sœur du roi Louis XII, dont il
eut Gaston V de Foix, et Germaine de Foix, mariée en 1505 à
Ferdinand V, dit le Catholique,
roi d’Aragon, Castille, Naples, etc. (Moréri, Art. FOIX,
ARAGON).
Jean de Foix, qui s’intitulait, dans ses actes
«Roi de Navarre, seigneur de Béarn,comte de Bigorre et d’Étampes»,
étant arrivé à Étampes le 5 novembre 1500, il
y mourut quelques jours après et fut inhumé dans un caveau
du chœur de l’église Notre-Dame-du-Fort. Sa femme repose
[p.21] au même
lieu. (Fleureau, p. 198.) Du reste, Jean de Foix s’était réservé
la dignité d’abbé de Notre-Dame. (Alliot, Cartulaire cité,
pp. 145 et 147; Fleureau, p. 352.)
C’est au comte Jean de Foix que l’on doit l’amélioration
du port d’Étampes en 1490. (Lettres de Jean de Foix, datées
de Tours, 28 juillet 1490, publiées par Fleureau, p. 193.)
|
|
|
ANNÉE 1500
24. Gaston V de Foix, duc de Nemours, fils de Jean de Foix et neveu
du roi Louis XII hérita du comté d’Étampes, à
la mort de son père, étant âgé de onze ans.
Il fit son entrée solennelle à
Étampes en 1506 (1).
|
(1) Fleureau donne, p. 499, des détails intéressants
sur cette cérémonie.
|
Ayant échangé en 1507, avec le roi de France, la vicomté
de Narbonne contre le duché de Nemours, il ne fut plus appelé
que duc de Nemours.
Nommé gouverneur de Milan en 1511,
lors de la guerre d’Italie, puis commandant général des armées
françaises, il fut l’un des plus grands capitaines dont s’honore
la France; il s’illustra par sa valeur et sa magnificence; il gagna plusieurs
batailles, notamment celle de Ravenne. Il fut tué au siège
de cette dernière ville le 11 avril 1519, âgé de 23 ans
seulement, et inhumé à Milan. (Fleureau, p. 199. — Moréri, art. GASTON.)
|
|
|
ANNÉE 1512
25. A la mort de Gaston de Foix, le comté
d’Étampes revint de nouveau à la couronne. (Lettres patentes
du roi Louis XII, données à Blois en septembre 1512 et publiées
par Fleureau, p. 206.) [p.22]
|
|
|
ANNÉE 1513
26. En mai 1513, la reine Anne de Bretagne fut gratifiée de
la seigneurie d’Étampes par le roi Louis XII son époux, avec
pouvoir d’en disposer en faveur d’un de leurs enfants à son choix.
(Lettres patentes du roi, datées de Blois, mai 1513 et publiées
par Fleureau, p. 207.)
Elle accorda, dès l’année 1513,
aux religieuses de Maubuisson, près Pontoise, trois muids de froment
à prendre sûr le droit des dîmes des grains et vins d’Étampes.
(Lettres de la reine Anne, datées d’Étampes, août 1513,
citées par Fleureau, p. 218.) Ces dons furent confirmés en
1514, par François, comte d’Angoulême. (Lettres datées
de Paris, 25 décembre 1544, citées par Fleureau, p. 218.)
La reine Aune ne jouit pas longtemps du comté
d’Étampes car elle mourut Blois le 9 janvier 4514. Comme son corps
fut ramené à Saint-Denis, il y eut une longue suite de funérailles
dans toutes les villes où passa le funèbre cortège.
C’est le 28 janvier qu’il traversa la ville
d’Étampes, D’après le Récit des Funérailles,
publié par Merlet et de Gombert (1), un grand nombre d’officiers vinrent
au devant du corps à une lieue en dehors la ville, ainsi que des chanoines,
Cordeliers, etc...
|
(1) Paris, Aubry, 1858, pp. 62 à 65.
|
En outre des princes et princesses du sang et autres en grand deuil, on
voyait:
400 torches aux armes de la défunte,
50 aux armes de la ville de Blois,
300 aux armes de la ville d’Étampes,
200 aux armes de Chalo-Saint-Mard. [p.23]
Le lendemain samedi 29 janvier, il y eut des
funérailles pompeuses à l’église Notre-Dame, toute tendue
de noir, avec de grands écussons aux armes de la princesse.
|
|
|
ANNÉE 1514
27. A la mort d’Anne de Bretagne, le 9 janvier 1514, le comté
d’Étampes, en vertu des Lettres patentes de 1513, revint par héritage
à sa fille aînée Claude de France. (Lettres patentes
de Louis XII, datée de Blois, mai 1513, et publiées par Fleureau,
p. 207.)
Ayant épousé le 18 mai 1514,
François, comte d’Angoulême, plus tard héritier de la
couronne sous le nom de François Ier, le roi Louis XII, en considération
de ces noces, accorda aux habitants d’Étampes le droit de nommer un
maire et des échevins, avec tous les droits de commune. (Lettres patentes
de Louis XII, données à Saint-Germain-en-Laye en mai 1514,
publiées par Fleureau, p. 213.)
|
|
|
ANNÉE 1516
28. Le roi François Ier donna le comté d’Étampes,
en l’année 1546, pour en jouir sa vie durant, à Artus de
Gouffier, duc de Roannais, comte de Caravas, seigneur de Boisi, d’Oiron,
de Maulevrier, de Boutervilliers, etc., grand maître de France, pour
le récompenser de ses services.
Il était déjà gouverneur
d’Étampes et avait accompagné autrefois les rois Charles VIII
et Louis XII dans leurs voyages. Il avait épousé en 1499, Hélène
de Hangest, dame de Magni.
Ancien gouverneur de François Ier pendant
sa jeunesse, ce roi le combla d’honneurs et le nomma ambassadeur en Allemagne,
mais il ne jouit pas longtemps de toutes [p.24] ces faveurs, car
il mourut le 10 mars 1518. (Fleureau, pp. 215 et 217. — Moréri,
Art. GOUFFIER. — Anselme,
Histoire généalogique de la maison de France.)
|
|
|
ANNÉE 1548
29. A la mort de Gouffier, la reine Claude de France rentra en possession
du comté d’Étampes; c’est ce qui résulte d’un acte
du 17 août 1519 par lequel elle donne aux religieuses de Maubuisson,
trois muids de blé de rente, pour la fondation,d’un «salve regina»,
à chanter tous les jours après matines. Cette fondation pieuse
est la confirmation de dons faits précédemment par la reine
Anne, sa mère, en 1513 et en 1514. (Lettres de Claude, datées
de Fontainebleau, 17 août 1519, publiées par Fleureau, p.
207.)
La reine Claude, qui avait, dit-on, introduit
en France la prune de ce nom, était un peu boiteuse, mais en échange
ornée de toutes sortes de vertus. Elle mourut le 20 juillet 1524.
|
|
|
ANNÉE 1524
30. A la mort de la reine Claude de France, le comté d’Étampes
fit retour à la couronne. (Fleureau, p. 285.)
|
|
|
ANNÉE 1526
31. Le 13 avril 1526, le roi François Ier fit don du
comté, mais pour en jouir pendant sa vie seulement, à Jean
de la Barre, vicomte de Bridiers, seigneur et baron de Verets, de Jouy-en-Josas,
de Villemartin, etc., capitaine du Plessis-les-Tours, bailli et capitaine
de Rouen, bailli [p.25] de Paris, premier gentilhomme de la Chambre, chambellan et maître
de la garde-robe du roi.
Cette faveur lui fut accordée en récompense
du dévouement et des importants services qu’il rendit au roi à
la bataille de Pavie et durant sa détention en Espagne. (Lettres
patentes du roi François Ier, datées de Mont-de-Marsan, 13
avril 1526, publiées par Fleureau, p. 221.)
L’histoire nous a conservé peu de documents
sur ce personnage; comme il était seigneur de Villemartin près
d’Étampes, c’est sans doute à lui qu’on doit l’origine du
château de la Barre; dont les ruines existent encore près de
Morigny. Il devint gouverneur et garde de la Prévôté
de Paris le 11 juin 1526 et jouit de cette charge jusqu’à sa mort
arrivée en 1538, d’après son épitaphe rapportée
par l’historien d’Étampes. (Fleureau, p. 223.)
|
|
|
ANNÉE 1533
32. A la mort de Jean de la Barre, le comté fit de nouveau
retour à la couronne. (Fleureau, p. 224.)
|
|
|
ANNÉE 1534
33. Le
roi François Ier ayant été séduit par la beauté
d’Anne de Pisseleu, fille du seigneur de Heilly, et voulant la favoriser,
ainsi que son mari Jean de Brosse, quatrième du nom, comte de Penthièvre
(appelé aussi Jean de Blois ou Jean de Bretagne), il leur fit don,
en juin 1534, leur vie durant, du comté d’Étampes, «avec
le revenu du grenier à sel établi dans cette ville».
(Lettres patentes du roi François Ier données à Chantilly
le 23 juin 1534, et publiées par Fleureau, p. 224.)
Jean de Brosse, grâce à ce mariage,
fut remis en possession [p.26] du comté de Penthièvre et des autres seigneuries
qu’il avait perdues. II fut nommé gouverneur du Bourbonnais, puis
gouverneur de Bretagne, et de pauvre qu’il était, il devint riche
et puissant.
François Ier ne s’en tint pas
là: il érigea en 1536 le comté d’Étampes en
duché en faveur des deux époux: «Considérant
qu’il est de grande étendue, de bon et gros revenu, réputé
une des plus notables maisons du royaume, dont dépendent plusieurs
beaux fiefs, vassaux..., sujets, places et seigneuries, et voulant élever
le dit comté au plus haut titre et degré....» (Lettres
patentes de François Ier données à Paris en janvier
1436 et publiées par Fleureau, p. 227.)
Le don du duché fut confirmé
aux deux époux par Français Ier en 1543 (Acte de ce roi cité
par Fleureau, p, 229) et par le roi Henri II en 1547. (Lettres de Henri
II datées de Fontainebleau 14 septembre 1547 et publiées par
Fleureau, p. 280.)
On connaît la maison que François
Ier fit bâtir à Étampes pour loger sa favorite. Ce
logis est bien du style de l’époque, et sa façade porte encore
les signes indéniables de sa royale origine.
On trouve dans une lettre de l’époque
cette description curieuse du costume habituel de la duchesse: «Une
robe de drap d’or frisé, fourré d’hermines mouchetées;
une cotte de toile d’or incarnat égorgelée et dorée
avec force pierreries» (1).
|
(1) Génin, Lettres de Marguerite d’Angoulême.
1841, in-8, p. 117.
|
|
ANNÉE 1553
34. A cause des intelligences d’Anne de Pisseleu (appellée
[p.27] souvent la Duchesse d’Étampes ou Madame d’Étampes)
avec, les ennemis de l’Etat, le duché d’Étampes lui fut repris
en 1553 par le roi Henri II. Elle se retira dans l’une de ses terres où
elle mourut dans l’oubli et le mépris de tout le monde.
Le roi Henri II donna le duché
en 1553 à Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, sa favorite,
qui était veuve depuis 1531 de Louis de Brezé, grand sénéchal
de Normandie. Elle en eut deux filles, dont l’une fut mariée à
Claude de Lorraine, duc d’Aumale. (Fleureau, p. 231.)
On croit que Diane, avant d’être la favorite
de Henri II, avait accordé ses faveurs à François
Ier, mais cela n’a pas été prouvé. il est certain
qu’elle avait su conquérir les bonnes grâces du père
avant d’avoir eu celles du fils et qu’elle contribua beaucoup à
faire exiler sa rivale Madame d’Étampes, avec laquelle elle soutint
de longs procès.
Tout le monde connaît la maison de cette
ville, où elle séjournait quand elle allait chevaucher sur
le pavé d’Orléans. On y voit, parmi de fines sculptures attribuées
à Jean Goujon, les chiffres entrelacés de Diane et de Henri.
(De Montrond, t. II, p. 73. — Brantôme. — Ann. du Gâtinais,
1889, p. 293.)
|
|
|
ANNÉE 1559
35. Ainsi que la duchesse Anne de Pisseleu, la duchesse Diane de
Poitiers tomba aussi en disgrâce, par suite des intrigues des Guise
et de Catherine de Médicis, femme du roi Henri Il, qui la fit chasser
de la cour. A la suite de l’édit der évocation des dons et
aliénations du domaine, fait par le roi François Il en août
1559, le duché d’Étampes rentra dans le domaine royal, ainsi
que le château de Chenonceaux et des bijoux de grand prix qu’elle avait
reçus du roi. Diane mourut en avril 1566. (Fleureau, p. 231. — Moréri,
art. Diane de POITIERS.) [p.28]
|
|
|
ANNÉE 1562
36. Au mois d’avril 1562 le roi François II rendit le duché
d’Étampes à Jean de Brosse, pour en jouir seulement pendant
deux ans, et au mois de juin de l’année suivante, il lui en continua
la jouissance pour le reste de sa vie, en reconnaissance des bons services
qu’il avait rendus à l’Etat, car ce seigneur ne s’était jamais
séparé de son roi pendant les plus grands troubles. (Lettres
patentes du roi Charles IX. données à Vincennes le 22 juin
1563, vérifiées à la Chambre des comptes le 28 avril
suivant, et publiées par Fleureau, p. 231.)
Jean de Brosse mourut en janvier 1564 et les
hahitants d’Étampes lui firent des honneurs funèbres avec
service solennel à l’église Notre-Dame. (Fleureau, p. 232.)
Anne de Pisseleu, sa femme, lui survécut
douze ans, car elle mourut eu 1576.
|
|
|
ANNÉE 1564
37. A la mort de Jean de Brosse, le duché d’Étampes
fit de nouveau retour à la couronne. (Fleureau, p. 234.)
|
|
|
ANNÉE 1576
38. Par
suite du traité de paix conclu en avril 1576 entre le roi Henri III
et les Huguenots, le duché d’Étampes fut donné, pour
en jouir sa vie durant, à Jean Casimir, comte Palatin du Rhin, qui
était l’allié du prince de Condé et était venu
sous les murs d’Étampes et d’Orléans en janvier 1568. (Lettres
patentes de Henri III datées de Paris, [p.29]
18 mai 1576, et publiées par Fleureau, p. 243.) Ces lettres ajoutent
que Jean Casimir pourra «avoir sa retraite et demeurer en nos château
et maison haute et basse du dit Étampes». Les maisons dont
il est ici question sont probablement celles des duchesses Anne de Pisseleu
et Diane de Poitiers.
On promit en outre à Jean Casimir des
gages élevés comme colonel de 4000 reîtres pour le
service du roi de France et le paiement de onze millions de livres pour
la solde de ses troupes. Les paiements n’ayant pu être faits en temps
voulu, le nouveau duc renonça au duché dès l’année
1577. (Acte de renonciation du 8 mars 1577, cité par Fleureau, p.
245.)
Jean Casimir administra ensuite l’Électorat
durant la minorité de Frédéric IV, son neveu, et il
mourut en 1592. (Moréri, art. BAVIÈRE.)
|
|
|
ANNÉE 1577
39. Par suite de la renonciation du comte Jean Casimir, le duché
d’Étampes revint de nouveau au roi en 1547 [sic (1577)]. (Fleureau,
p. 245.)
|
|
|
ANNÉE 1579
40. Le roi Henri III ayant emprunté en 1578 à Catherine
de Lorraine, duchesse de Montpensier, la somme de cent mille livres pour
subvenir aux frais de la guerre, il lui donna, par engagement, suivant acte
devant les notaires du Châtelet du 9 décembre 1578, et lettres
patentes de janvier 1579, le duché d’Étampes et le comté
de Senlis. (Lettres patentes de Heuri III, datées de Paris, 17 janvier
1579, et publiées par Fleureau, p. 245.) [p.30]
Catherine de Lorraine, qui était fille
du célèbre homme d’Etat, François de Lorraine, duc de
Guise et d’Aumale, avait épousé Louis de Bourbon, duc de Montpensier,
et mourut le 6 mai 1596. (Moréri, art. LORRAINE.)
|
|
|
ANNÉE 1582
41. Le même roi Henri III retira le duché d’Étampes
des mains de la duchesse de Montpensier le 18 juillet 1582, pour le donner
avec les comtés de Clermont et de Senlis, à sa sœur Marguerite
de Valois, reine de Navarre, comme supplément de ce qu’il lui avait
promis en dot par son contrat de mariage avec Henri de Bourbon, roi de
Navarre, et depuis roi de France sons le nom de Henri IV. (Lettres patentes
de Henri III, datées de Fontainebleau, 8 juillet 1582, et publiées
par Fleureau, p. 261.)
|
|
|
ANNÉE 1598
42. Marguerite de Valois, reine de France et de Navarre, donna à
son tour le duché, en 1598, à Gabrielle d’Estrées,
duchesse de Beaufort et marquise de Monceaux, suivant actes devant les notaires
d’Usson, du 11 novembre 1598 et devant les notaires du Châtelet du
15 janvier 1599. (Actes publiés par Fleureau, p. 261.) On sait que
Gabrielle était la favorite du roi Henri IV et que celui-ci fut même
sur le point de l’épouser.
|
|
|
ANNÉE 1599
43. A la mort de Gabrielle d’Estrées, en 1599, César,
duc de Vendôme et de Mercœur, son fils naturel légitimé
de Henri IV hérita du duché d’Étampes, ayant été
rendu [p.31] par son père capable de
recevoir toutes sortes de dons. (Lettres patentes de Henri IV, datées
de Paris, janvier 1595, et citées par Fleureau, p. 266.)
César était en outre duc de Beaufort
et de Penthièvre, seigneur d’Anet, grand-maître et surintendant
général de la navigation et du commerce. Il avait reçu
du roi le duché de Vendôme en 1598. Ayant épousé
en 1609, Françoise de Lorraine, duchesse de Mercœur, fille de Philippe
de Lorraine, celui-ci lui céda le gouvernement de Bretagne.
Après avoir été comblé
de faveurs par Henri IV et par Louis XIII son successeur, il tomba en disgrâce,
mais il y fut rappelé sous Louis XIV; ce qui fait qu’il conserva
le duché d’Étampes jusqu’en 1651, c’est-à-dire pendant
plus d’un demi-siècle. Il mourut en 1665. (Moréri, art. CÉSAR.)
|
|
|
ANNÉE 1651
|
|
44. Le 4 février 1651 (1), le duché d’Étampes fut
donné par César de Vendôme à Louis, duc de Vendôme,
de Bourbon et de Mercœur, son fils aîné, suivant une clause
du contrat de mariage de celui-ci avec Laure-Victoire Mancini, nièce
du cardinal Mazarin. (Fleureau, p. 166. — Moréri, art. MANCINI.
— La Chenaye, Dict. de la Nobl., art. MANCINI.)
Il était en outre pair de France, chevalier
des ordres du roi, prince de Martigues et gouverneur de Provence. Il suivit
le roi Louis XII dans son voyage en Savoie et fit les campagnes de Hollande,
de Flandre et d’italie de 1630 à 1656. Il fut, enfin, nommé
par le roi Louis XIV vice-roi de Catalogne, en l’année 1650. Ayant
ensuite embrassé [p.32] l’état ecclésiastique, il fut fait cardinal par
le pape Alexandre VII en 1667.
Il mourut à Aix-en-Provence le 6 août
1669. (Moréri, art. LOUIS.)
|
(1) Et non le 20 mai 1654, comme l’indique Fleureau
d’après un titre du Greffe d’Étampes, pp. 266 et 286; cette
erreur a été reproduite par de Montrond (Essais hist.),
tome II, pp. 130 et 217.
|
|
ANNÉE 1669
45. A la mort du cardinal Louis de Vendôme, Étampes
passa à son fils aîné Louis-Joseph de Vendôme,
duc de Mercœur, prince de Martigues, grand sénéchal et gouverneur
de Provence, général des galères, chevalier des ordres
du roi et de la Toison d’or.
Après s’être distingué
dans les campagnes de Louis XIV en Hollande, de 1672 à 1692, il
devint généralissime des armées d’Espagne et d’Italie,
vice-roi de Catalogne.
Il remporta une victoire complète en
1705 sur le prince Eugène de Savoie, près de Cassano, et une
autre en 1706 sur les Impériaux à Calcinato. Enfin, en décembre
1710, il fut vainqueur des Alliés à la célèbre
bataille de Villaviciosa, en Espagne, et assura à jamais la couronne
d’Espagne sur la tête du petit-fils de Louis XIV.
On rapporte qu’après la bataille, le roi d’Espagne
n’ayant pas de lit pour se reposer, Vendôme lui dit: «Je vais
vous faire donner le plus beau lit sur lequel jamais souverain ait couché:»
Et il fit étendre en guise de matelas, les étendards et. les
drapeaux pris sur les ennemis. C’est cette belle page qui est représentée
sur une belle gravure en couleurs, signée Le Cœur, 1787.
Il mourut à Vinaros, comblé d’honneurs,
le 11 juin 1712, âgé de cinquante-huit ans, et fut enterré
à l’Escurial dans le tombeau des infants d’Espagne. (Moréri,
art. LOUIS-JOSEPH.)
A l’occasion de la victoire remportée
à Cassano (ltalie) par leur duc et protecteur, les Étampois
firent en décembre [p.33] 1705, de grandes réjouissances dans tonte la ville. En
septembre 1712, à l’occasion de sa mort, il y eut un service funèbre
à l’église Notre-Dame. (Léon Marquis, Les Rues
d’Étampes, p. 22.)
|
|
|
ANNÉE 1712
46. Louis-Joseph de Vendôme étant mort sans postérité,
sa veuve, Marie-Anne de Bourbon, hérita du duché d’Étampes.
Il l’avait épousée en 1710 âgé de 55 ans.
Marie-Anne, qu’on appelait quelquefois Mademoiselle
de Montmorency, était petite-fille du grand Condé. Elle mourut
le 44 avril 1748, âgée de 40 ans. (Moréri, art. BOURBON
et FRANCE. — De Montrond, Essais hist., tome II, p. 484.)
|
|
|
ANNÉE 1718
47. A la mort de Marie-Anne de Bourbon, le duché vint en la
possession de sa mère Anne de Bavière, seconde fille de Édouard
de Bavière, prince palatin du Rhin et veuve de Henri-Jules de Bourbon.
Cette princesse mourut le 28 février 1723, âgée de
74 ans. (Moréri, art. BAVIÈRE et BOURBON; de Montrond, tome
II, p. 133.)
|
|
|
ANNÉE 1723
48. Louise-Élisabeth de Bourbon, petite-fille de la précédente
et de Henri-Jules de Bourbon, hérita du duché d’Étampes.
Son père Louis de Bourbon, prince du sang, pair et grand-maître
de France, gouverneur de Bourgogne et de Bresse, était mort dès
l’année 1740.
Mariée le 9 juillet 1743 à Louis-Armand
de Bourbon, [p.34] prince de Conti, gouverneur du Poitou, lieutenant-général
des armées du roi, elle porta le duché d’Étampes dans
cette autre branche de la maison de Bourbon. (Moréri, art. BOURBON. — De Montrond, t. II, p. 181.)
|
|
|
ANNÉE 1743
49. Le duché passa par alliance dans la maison d’Orléans
le 17 décembre 1743; lors du mariage de Louise-Henriette de Bourbon-Conti,
dite Mademoiselle de Conti, et fille de Louise-Élisabeth avec Louis-Philippe
d’Orléans, duc de Chartres, petit-fils du régent Philippe
d’Orléans. (La Chenaye, Dict. de la Nobl., art. BOURBON. —
De Montrond, Essais hist., t. II. 131.)
|
|
|
ANNÉE 1759
50. Après la mort de la princesse Louise-Henriette, son mari
lui succéda à la seigneurie d’Étampes, car les sentences
du bailliage, en 1770, sont rendues au nom de Louis-Philippe d’Orléans,
comme tuteur de son fils Louis, Philippe-Joseph d’Orléans, duc de
Chartres. (De Montrond, tome II, p. 132.)
|
|
|
ANNÉE 1779
51. Le 28 juin 1779, par suite du partage de la succession de la
princesse de Conti entre la duchesse de Bourbon et Louis-Philippe-Joseph
d’Orléans, son frère, les domaines d’Étampes et de la
Ferté-Alais échurent à ce prince pour la somme de 480.000
livres et il en jouit jusqu’à la Révolution de 1789. C’est
lui qui fit construire les galeries du [p.35]
Palais-Royal et qui devint membre de la Convention sous le nom de Philippe-Égalité.
Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, dernier duc d’Étampes et
père de Louis-Philippe, roi des Français, avait été
gouverneur de Poitou et lieutenant-général des armées
navales. II avait épousé le 31 avril 1769, Louise-Marie-Adélaïde
de Bourbon-Penthièvre et il mourut le 6 novembre 1793. (De Montrond,
t. II, p. 132.)
|
|
ÉTAMPES, IMPRIMERIE HUMBERT-DROZ, RUE SAINT-MARS
|