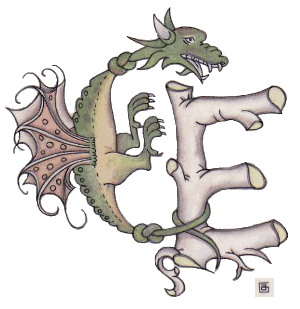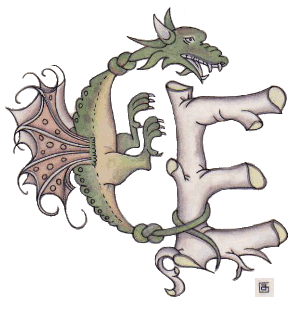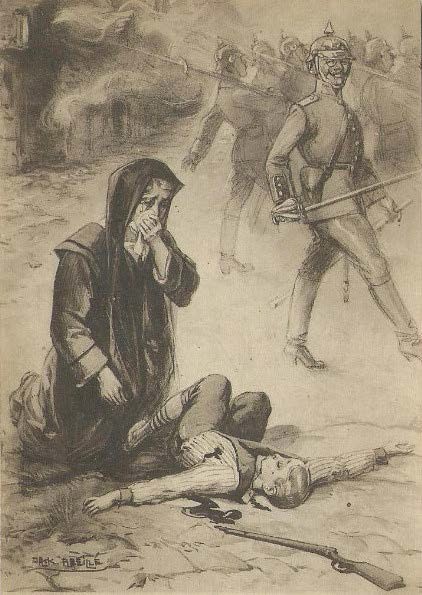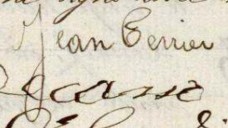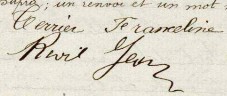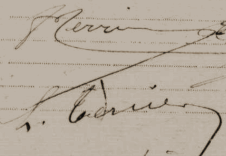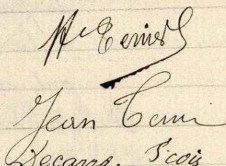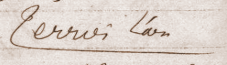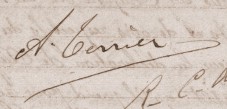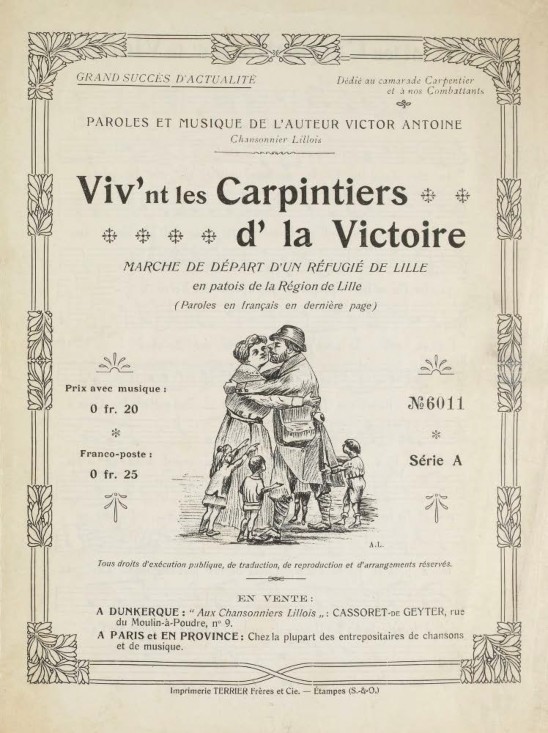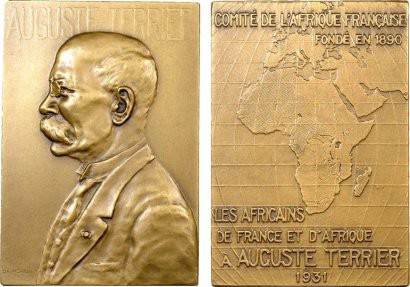|
BHASE n°30
(juillet 2016)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de
ce numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase030w.pdf
|
|
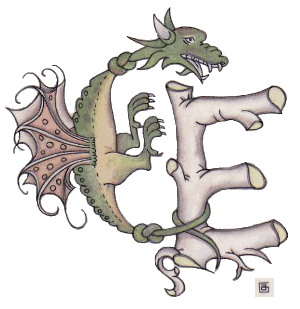
|
Nouvelles
et contes
de
l’arrière, 1914-1916
|
Préface
|
3-7
|
|
I
.
|
Le
Noël de Marthe
|
13-30
|
|
II.
|
Poupée
de Noël
|
32-43
|
|
III.
|
L’espion
|
44-57
|
|
IV
|
Le
Châtiment
|
58-90
|
|
V
|
Le
pardon de Francine
|
92-115
|
|
VI
|
Grand’Mère
|
116-145
|
Terrier-Frères
Une histoire
étampoise, 1884-1934 (49 documents)
147-217

Nouvelles
et contes
de
l'Arrière 1914·1916
par Léon Terrier + Terriers Frères, une histoire étampoise
BHASE
n°30 juillet 2016
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE
n°30
Bulletin
historique et archéologique du Sud-Essonne
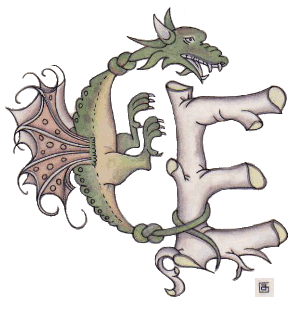
publié par
le Corpus Étampois
juillet
2016
COMITÉ
DE LECTURE
Bernard
Gineste Bernard Métivier Bernard Minet
† Bernard
Paillasson
Préface
Ce
numéro du BHASE est constitué de deux parties bien différentes. Leur point
commun ? C’est la famille nombreuse des Terrier, qui a joué un rôle de premier
plan dans l’histoire culturelle du pays étampois, pendant tout le premier
tiers du XXe siècle.
En 1914,
quelques mois avant la Guerre, trois des six frères Terrier, venus d’Annecy,
prennent le contrôle autant de l’imprimerie que de la rédaction de L’Abeille
d’Étampes. Déjà bien connus des Étampois à cette date pour leurs contributions
à cet hebdomadaire local, ils y jouent dès lors les premiers rôles à un moment
crucial de l’histoire de France.
Jean
Terrier dirige l’imprimerie. Entre autres publications patriotiques, il édite
alors en 1916 un recueil de Nouvelles et Contes de l’Arrière, composé
par son propre fils Léon Louis, qui dans la suite collaborera aussi à L’Abeille.
*
La première
partie de ce BHASE est la réédition de ce beau recueil aujourd’hui totalement
introuvable, et dont j’ai dû aller photographier, page par page, un exemplaire
rarissime à la Bibliothèque nationale de France. Bernard Métivier en a ensuite
patiemment ressaisi le texte, manuellement.
On
y trouvera cinq courts récits de guerre, suivi d’une comédie en un acte, dont
le sujet est aussi la vie pendant la guerre, de 1914 à 1916, du point de
vue de ceux qui sont restés à l’Arrière tandis que le père, ou le mari, ou
l’amant, ou le fils encourent tous les dangers des champs de bataille.
Ce sont,
successivement : « Le Noël de Marthe », « Poupée de Noël », « L’Espion »,
« Le Châtiment », « Le pardon de Francine » et enfin « Grand’Mère, comédie
un un acte ».
Toutes
les situations pathétiques que crée la guerre sont considérées, s’il est possible
; tous nos héros sont patriotes et loyaux, du moins pour ceux qui sont français
; car on ne voit guère ici dans le camp ennemi que violence cruelle et trahison
infâme.
Mon mari
est-il mort ? Ou bien captif ? Mon père est-il mort ? Et comme je voudrais
que ma mère cesse de souffrir de cette cruelle incertitude ?
Et si
mon mari est mort, que me restera-t-il de lui ? Et que dire à notre fils qui
voudrait que le père Noël lui donne une sœur ?
Et moi
qui suis sur le Front, que dois-je penser, et que puis-je espérer d’une fiancée
dont je découvre que le frère n’est qu’un ignoble espion à la solde de l’ennemi
? Ne faut-il pourtant pas le faire fusiller sans fléchir ?
Quant
à moi qui suis une fille-mère abandonnée par un autre espion, que dois-je
faire, et que va devenir mon enfant ? Et que se passera-t-il si les hasards
de la guerre et de l’invasion nous mettent à nouveau face à face ?
Pourtant
la guerre peut réunir peut-être aussi ce qu’avait dissous un mode de vie autrefois
insouciant et frivole. L’amour peut-il renaître entre une infirmière et le
mutilé de guerre qui l’avait autrefois trahie ?
Enfin,
imaginons une mère dont le fils unique est noblement mort au combat. Imaginons
ensuite que se présente à elle une jeune femme exilée par l’invasion, et qu’il
s’agit d’héberger. N’est-ce pas un devoir patriotique ? Oui, mais s’il s’agit
d’une fille-mère ? Ne serait-ce pas encourager l’immoralité ?
*
Dans
la deuxième partie de BHASE n°30 on trouvera un deuxième recueil, cette fois-ci
documentaire. Nous y réunissons cinquante pièces relatives à la pittoresque
famille de notre auteur et de son éditeur, Léon-Louis et Jean Terrier. Étampois
de fraîche date, ils ont joué un rôle important dans l’histoire de la Grande
Guerre au pays d’Étampes et pendant les vingt années qui suivirent. Voici
en quelques mots l’histoire de cette copieuse fratrie d’immigrés savoyards
Comme un
vol de gerfauts hors du charnier natal, les six fils d’un
maître charpentier d’Annecy, Denis Terrier, laissèrent la montagneuse Savoie,
qui pour Paris, qui pour Quimperlé, qui pour Étampes. Tous furent publicistes,
journalistes, ou imprimeurs. Et voici ce que nous avons exhumé de la poussière
des archives.
-
Louis, l’aîné (1858-1897), avait ouvert la
voie. De Paris, il faisait rayonner avec d’autres la bonne parole républicaine
avec le Journal des Débats, autant sur Étampes, où il collabora au
journal local L’Abeille dès 1884, que sur Quimperlé, où il
dirigeait
son propre journal, L’Union agricole et maritime. Mais il mourut jeune.
-
Jean (1860-1926) resta d’abord à Annecy où
il fut imprimeur ; mais sur le tard, en 1914, il vint prendre en main l’imprimerie
d’Étampes, qu’il dirigea pendant toute la guerre et, au-delà, jusqu’à sa mort.
Avec lui vint d’Annecy à Étampes son fils Louis Léon, à qui nous devons le
recueil de Nouvelles et contes de l’Arrière ici réédité pour la première
fois depuis 1916, et qui sera ensuite rédacteur de L’Abeille, ne
mourant pour sa part qu’en 1968, à Paris.
-
François (1864-1897) est le seul des six fils
de Denis Terrier qui ne paraisse pas avoir séjourné à Étampes : il mourut
à Quimperlé où il était parti, comme journaliste, aider son frère aîné, bien
jeune encore pour mourir, et à peine marié.
-
Léon (1869-1937) vint prendre dès 1897 la
relève de Louis à Étampes, où il fut d’abord comptable de l’imprimerie de
L’Abeille, alors tenue par Ollivier Lecesne. Il se maria à une
Étampoise en 1899 et succéda en 1914 à son patron à la direction de l’hebdomadaire
local, jusqu’à la fin de 1934. Il mourut trois ans plus tard d’un accident
de voiture.
-
Henri (1871-1921) fit sa carrière de journaliste
à Paris, sur les traces de ses aînés, notamment au Journal des débats.
Mais c’est chez ses frères d’Étampes qu’il s’en vint mourir, au terme d’une
longue maladie, en 1921.
-
Enfin Auguste (1873-1932) fut la gloire de
la famille. Il voua en effet, et non sans succès, toute sa vie et ses talents
de publiciste à la cause patriotique de l’Empire colonial d’Afrique. Il avait
épousé en 1901 une des filles de l’imprimeur étampois Ollivier Lecesne, et
séjourna d’ailleurs un temps chez lui rue
Saint-Jacques,
vers 1912, avant de s’installer à Paris, d’où il était plus aisé de se consacrer
à la grande tâche qu’il s’était fixé.
Bonne lecture.
Bernard Gineste
LEON TERRIER
NOUVELLES
ET CONTES DE L’ARRIÈRE
1914-1916
ÉTAMPES
IMPRIMERIE TERRIER FRERES & Cie
1916
Il
a été tiré de ce volume cinquante exemplaires numérotés N°
Je
dédie ces Nouvelles et Contes de l’Arrière, qui me
furent inspirés par des scènes touchantes vécues autour de moi, à mon père
dont les conseils avertis me facilitèrent la mise à jour de ce premier et
timide essai.
L. T.

Le
Noël de Marthe
À Mme Marthe B…, en souvenir du
cher disparu à D...
Par trois
fois déjà, Marthe a essuyé la buée qui, inlassablement, recouvre les vitres
de la fenêtre close. Son regard triste, anxieux, va de la vieille horloge
de bronze qui orne la cheminée où pétille joyeusement un grand feu de bois,
au coin de la rue qui passe sous la fenêtre du rez-de-chaussée de la petite
villa qu’elle habite, dans la banlieue d’Annecy.
Parfois
sa pensée s’arrête au joli spectacle qu’offre la neige qui tombe abondamment
par cette froide matinée de veille de Noël : les flocons capricieux s’abattent,
tout à coup, drus et serrés, comme s’ils avaient hâte de se reposer de leur
céleste voyage, sur le tapis moelleux qui s’étale sur les pavés, sur les trottoirs
; puis, dans une bourrasque du vent qui s’élève, les flocons blancs tourbillonnent,
dansent, voltigent, s’abaissent et remontent vers le ciel, comme s’ils voulaient
éviter, à leur virginité, le contact de la terre.
D’un
regard rêveur, elle suit les quelques rares habitants de la cité savoisienne,
engourdie sous son manteau glacé, qui se risquent au dehors, malgré la rigueur
du froid et l’avalanche de
neige
: quelques femmes seulement, d’ailleurs |6 chaudement emmitouflées dans
leurs manteaux et leurs fourrures, ne montrant, de leurs visages, que le bout
d’un nez rougi et des yeux pensifs et tristes. Quelques-unes, en passant près
de la fenêtre où Marthe reste rêveuse, s’arrêtent, sourient mélancoliquement
et lui demandent :
— Toujours
pas de nouvelles ?
Un simple
geste de négation leur sert de réponse tandis que le regard déchirant des
beaux yeux, pleins de larmes semble les questionner à son tour. Et, pour fuir
cette vision de tristesse, elles se hâtent vers leur demeure, en baissant
la tête sous la rafale glacée.
Tout
à coup, Marthe voit déboucher au coin de l’avenue, celui qu’elle attend :
le père Dalignon, cachant dans les plis de son manteau sa grosse boîte noire
vernie de facteur, apparaît. Et le cœur de Marthe bat follement dans sa poitrine
!
Oh !
qu’il est donc long à venir ce vieillard, portant avec lui les lettres si
impatiemment attendues par les vieilles mamans, par les jeunes épouses qui
y trouveront les mots d’espoir, les mots d’amour dont le pauvre logis, triste
et désert maintenant, sera, pour une minute, tout illuminé.
Il s’arrête
à quelques portes ; il sonne et attend qu’on vienne lui ouvrir, ne refusant
pas, à l’occasion, le bon verre de vin chaud qui lui donne des forces nouvelles.
Marthe,
anxieuse, espère l’instant où il passera devant la fenêtre, s’arrêtera, glissera
par la petite fente aménagée au- dessous, la lettre si impatiemment attendue.
Il
vient ! Le cœur de Marthe s’affole dans sa poitrine ! Elle suit ses mouvements
des yeux pendant qu’il cherche dans sa boîte... Il va s’arrêter ; il va sortir
la lettre !... Mais non ! il n’y a encore rien pour elle aujourd’hui !...
il lui jette un long regard, hoche la tête tristement et continue silencieusement
sa tournée.
|7
Marthe
se rassied, le cœur brisé et sanglote ! Petit Jean, qui joue à ses pieds,
avec un chemin de fer à mécanique, lève sa petite frimousse, toute barbouillée
de chocolat, abandonne son jouet et cherche à grimper sur les genoux de sa
mère.
-
Dis, petite mère, pourquoi pleures-tu toujours,
maintenant ?
Ses
grands yeux bleus inquiets se fixent sur le visage de la jeune femme ; il
essaye, en les tirant de toutes ses forces, d’enlever les mains qui cachent
le cruel désespoir.
Et,
Marthe, les yeux rougis, cède enfin au caprice de l’enfant, l’embrasse éperdument
et l’étreint sur sa poitrine haletante.
-
Petite mère ne m’aime donc plus, dit câlinement
Jean, dressé sur ses genoux et jouant avec les frisettes éparpillées des beaux
cheveux bruns dont les bandeaux soyeux couvrent le front haut et blanc de
la jeune femme.
-
Mais si ! lui dit-elle en essayant de sourire
et en l’embrassant à nouveau. Seulement petite mère a beaucoup, beaucoup de
chagrin et elle ne peut plus jouer avec son petit Jean.
-
Pourquoi ! pourquoi petite mère a-t-elle tant
de chagrin, tous les jours ? reprend l’enfant dont le visage rieur prend une
expression de sérieuse gravité.
-
Parce que, depuis longtemps, père n’écrit
plus à maman, qu’elle ne sait plus où il est, ce qui lui cause beaucoup de
tourments.
Jean,
que cette réponse si souvent répétée depuis un mois, ne satisfait plus, s’entête
à questionner, tout en caressant la jolie tête brûlante qu’il enlace de ses
bras potelés.
Marthe
le regarde ! Oh ! comme il ressemble à Georges ! comme elle retrouve bien
le regard franc des grands yeux limpides, un peu cernés ; le front haut, se
plissant légèrement, entre les sourcils épais et noirs, lorsqu’il réfléchissait
; |8 le
nez, droit et fort, au-dessus des lèvres rieuses, qui donnait à ce visage
sévère une expression de bonté et d’amour, lorsqu’elles
souriaient.
Pauvre
petit Jean ! N’aura-t-il, de ce père bien- aimé, qu’une lointaine vision de
tendresse, qu’un vague souvenir de caresses et de baisers ! Le reverra-t-il
ce père qui l’aimait tant ! ce père qui, depuis la naissance de ce cher petit
être, semblait avoir deux cœurs pour pouvoir tant aimer et ce fruit charmant
de leur amour, et sa petite Marthe jolie qu’il adorait plus ardemment encore
qu’autrefois ? Hélas ! N’était-ce pas folie que d’espérer encore ?
Depuis
quarante jours exactement, elle n’a plus reçu des nouvelles de son mari, parti
au feu vers le milieu d’août. Elle a écrit partout : au dépôt du corps, au
ministère de la Guerre, à la Croix-Rouge de Genève. Les réponses imprimées
lui sont
parvenues,
sans atténuer son chagrin. Toutes les mêmes, dans leur cruelle brièveté :
« Pas de
nouvelles, donc tout va bien. »
Non !
c’est impossible ! Si Georges vivait, il ne laisserait pas sa Marthe adorée
dans une telle anxiété. Au début de la guerre, il lui écrivait à peu près
chaque jour des lettres pleines d’amour et d’espérance. Et ces mots si tendres,
si confiants, lui avaient donné le courage de supporter la cruelle épreuve.
Puis, sans que rien ne fasse prévoir ce long silence, elle n’a plus eu de
nouvelles. Pas la moindre petite carte, pas le plus petit baiser envoyé, comme
il faisait parfois, du fond de la tranchée, par un camarade qu’on relevait
de garde. Mais elle a lu sur les journaux, qu’à la date où la correspondance
avait brusquement été interrompue, de violents combats s’étaient livrés en
Belgique, à l’endroit où Georges se battait.
Et elle
ne veut plus croire aux consolations de ses amies qui lui citent telles |9 jeunes femmes de la ville dont les maris, signalés comme
morts, sont prisonniers dans quelque camp lointain de l’Allemagne.
Désespérée
par ce trop long silence, déprimée par les nuits de veille, par les visions
atroces qui la font parfois s’éveiller, brisée de fièvre, inondée de sueur,
croyant entendre, dans le murmure du-vent, la voix de Georges qui, mourant,
l’appelle à son secours, elle n’a plus aucune volonté pour réagir et s’abandonne
ainsi, de longues heures, près de la fenêtre, à son affreux chagrin.
Un instant,
distraite par le bavardage de l’enfant qu’elle contemple, elle paraît oublier
; mais à un souvenir trop précis
qui
s’éveille en son cœur, elle se reprend à désespérer et à sangloter.
Jean
comprend qu’il fatigue petite mère ; il l’embrasse affectueusement sur ses
yeux inondés de larmes, se laisse glisser à terre et se rassied à ses pieds,
mais ne reprend pas son jouet.
A son
tour, il réfléchit et cherche à rassembler, dans sa petite tête, toutes les
pensées confuses qui s’y croisent, par suite de ce qu’il constate lui-même
ou de ce qu’il entend dire autour de lui par les grandes personnes qui viennent
rendre visite à sa maman…
Voilà
trop longtemps, aussi, que les jours se suivent, uniformément tristes ! Cependant,
il se souvient qu’il a été très heureux autrefois, au temps où il faisait
tous les jours du soleil, où l’on s’en allait promener avec petite mère tous
les après- midis sur le bord du lac bleu, où on jouait aux petits tas de sable
avec Louis et Jacqueline, sous l’œil attentif des mamans assises, sur leurs
pliants, le long de la promenade ombragée ; il se souvient qu’après
avoir goûté, il guettait l’arrivée de son père qui venait à la sortie de
son bureau, les chercher à la promenade : il courait à sa rencontre,
se jetait dans |10 .ses
jambes,
se laissait saisir par les bras vigoureux qui l’élevaient très haut, vers
les branches des platanes dont il arrachait quelques feuilles vertes, et le
redescendaient vers le grave visage qui l’embrassait tendrement.
Oh !
oui qu’il était heureux à cette époque : petite mère ne pleurait jamais, jamais
; au contraire, bien des fois, elle riait de si bon cœur que Jean s’arrêtait
de jouer, la regardait, curieux et moqueur, et riait, à son tour, d’une telle
gaîté. Il n’y avait pas très longtemps même, un beau soir, qu’il faisait
clair de lune,
dans
le petit jardinet, qu’embaumaient des corbeilles de roses, petite mère avait
chanté une romance, très belle, et qui avait ravi les tantes et les oncles,
invités à fêter l’anniversaire de la naissance de l’enfant Qu’elle était heureuse,
maman Marthe, lorsqu’elle avait présenté son petit Jean, ce délicieux bambin
de quatre ans, mignon à croquer dans ses petites culottes courtes, son maillot
collant, son béret marin ! Que de cadeaux il avait reçus ! Le joli chemin
de fer qui traînait à ses pieds lui avait été donné par son père qui en l’embrassant
tendrement l’avait appelé : « Mon petit homme. »
C’était
peu de temps après que les beaux jours s’étaient enfuis. Il y eut beaucoup
de bruit dans la petite ville, toutes les cloches sonnèrent à la fois, faisant
un gros bourdonnement sinistre ; des soldats couraient dans les rues et jouaient
très fort de leurs clairons. Le soir, petit père riait en disant qu’il allait
tuer beaucoup de Prussiens avec son fusil ; mais il entendit, lorsqu’il fut
couché dans son lit blanc, plus tôt que d’habitude, maman Marthe qui sanglotait
sur l’épaule de son père dont la voix était grave.
Et depuis
qu’il était parti, après les avoir embrassés bien fort, il n’y avait plus
de gaîté autour de lui comme autrefois. Cependant, les premiers temps, petite
mère avait continué à |11 l’embrasser, à jouer avec lui. Le matin, elle se levait
de très bonne heure, et, jolie comme les anges des images, toute blanche dans
sa longue chemise, ses pieds nus, elle courait dans la salle à manger,
ouvrait la petite boîte, prenait la lettre
quotidienne
et, souriante, heureuse, la lisait à haute voix, couchée dans son grand lit
où il venait à son tour, se blottir calmement pour écouter ce qu’écrivait
son père.
Mais
depuis de longs jours, ces bonnes matinées paresseuses sont finies ! Petite
mère, levée de bonne heure, ne revient plus
près
de lui que pour faire sa toilette ; et, toute la journée, elle reste pensive
à la fenêtre, où il vient jouer à ses pieds, pendant qu’elle pleure ou prie
silencieusement.
Il croit
bien comprendre le pourquoi de ce brusque changement ! Il n’y a plus jamais
de lettres dans la petite boîte.
Mais pourquoi
donc petit père n’écrit-il plus ?
Jamais,
à son jeune cerveau, l’idée de la mort ne s’est présentée, car on évite de
parler de la sinistre chose devant lui. Et il entrevoit la guerre comme un
jeu, où l’on fait semblant de tomber sur l’herbe, pour se lever quand on est
las de jouer, comme il le fait sur la vaste pelouse du Pâquier avec ses petits
amis.
Vaguement,
il pressent un mystère. Mais lequel ? Parfois il a pensé que c’était le monsieur
à casquette galonnée qui gardait toutes les lettres pour lui dans sa boîte
noire. Mais petite mère n’eut certainement-pas continué à lui causer. Lui
faudrait-il alors croire que son père, comme celui de son petit ami Pierre,
a eu les bras coupés par les méchants prussiens ? Il ne sait trop que penser.
Mais ce qui lui paraît absolument certain c’est que sa mère aura du chagrin
tant qu’elle ne recevra pas une lettre.
Comment
faire ! Il a cherché longtemps sans |12 rien trouver, le pauvre chérubin,
lorsqu’à l’approche de la fête de Noël une idée a germé dans sa petite tête.
Chaque
soir, sa prière finie, Marthe lui fait nouer ses petits doigts et face à l’image
de Jésus, suspendue au-dessus de son lit, elle lui dit :
—
Demande à petit Noël ce qui te fera grand plaisir. Aux enfants très sages,
il apporte, dans leurs souliers, ce qu’ils désirent.
Et lui,
il demande une boîte de soldats semblables à son père, pour faire la guerre
!
Marthe
lui affirme qu’ainsi il en trouvera certainement une dans ses souliers.
Pourquoi
donc ne s’adresserait-elle pas aussi à lui pour avoir des nouvelles de petit
père puisqu’il ne refuse rien aux personnes sages !
Il a
hésité à le lui dire jusqu’à ce jour ; mais ce matin, veille d’une si belle
fête, la vue du grand chagrin de sa mère lui est particulièrement pénible
et le décide à exposer son enfantine idée...
Jean
tire doucement Marthe de ses tristes pensées, sa jolie figure rose prend une
expression grave ; son petit doigt vient se placer au coin de sa bouche, comme
un point d’interrogation.
-
Petite mère, pourquoi ne demandes-tu pas à
père Noël de t’apporter des nouvelles de papa dans tes souliers, ce soir ?
À
cette question si drôlement exprimée Marthe sourit tristement. Et prenant
la tête blonde dans ses mains :
-
Père Noël n’écoute que les prières des petits
enfants, lui dit-elle ; il n’écoute pas celles des grandes personnes, parce
qu’elles ne savent pas s’adresser si gentiment à lui.
Alors
Jean reste rêveur et ne dit plus rien. Mais Marthe vient tout à coup de se
rappeler que c’est ce soir la fête divine des enfants ; Jean, |13 comme
tous les autres petits de la ville, aura sa joyeuse surprise, si ardemment
désirée...
La nuit
venue, lorsqu’il va se coucher, Jean range près de la haute cheminée ses bottines
et Marthe doit céder au caprice de l’enfant qui la supplie de mettre ses
petits souliers, à boucles dorées, près des siens.
Puis
lorsqu’il se trouve seul dans la chambrette, Marthe ayant prétexté un peu
de travail pour attendre qu’il soit endormi et s’étant retirée dans la salle
à manger, Jean se dresse sur son lit, écarte les rideaux blancs et, à genoux
devant l’Enfant Jésus, il refait sa prière.
— Petit
Jésus, lui dit-il, en tendant ses bras vers lui, ne m’envoie ni soldats, ni
friandises ; mais si j’ai été bien sage, si tu veux me faire grand plaisir,
apporte dans les souliers de maman, des nouvelles de petit père et je t’aimerais
de tout mon cœur pour le bonheur que tu nous auras donné.
Et il
lui semble voir sous l’éclat radieux d’un rayon de lune qui s’est glissé à
travers les volets clos jusqu’à la divine Image, Jésus qui lui sourit tendrement.
Puis,
vite, il se glisse dans son lit, et, pour obéir à petite mère, il s’endort
profondément.
Quelques
instants après, Marthe, écartant les rideaux, voit le visage calme de l’enfant
endormi, souriant dans une divine extase et elle pense qu’en son rêve, Jean
voit père Noël qui se glisse vers les petits souliers et y dépose cadeaux
et friandises.
Bientôt,
en effet, chaque petit soulier est empli d’oranges, de papillotes dorées,
de boules de chocolat et sur les tiges qui se tiennent très fermes, des mains
blanches déposent une grande boîte de carton rouge, ornée d’un drapeau tricolore.
Marthe
regarde l’échafaudage gracieux devant |14 lequel demain matin, l’enfant
exprimera sa joie et sa confiance en la bonté de l’Enfant-Dieu.
Tristement
ses yeux fixent ses petits souliers à elle, qui reposent vides à côté de ceux
de l’enfant, sa pensée fait un retour en arrière et elle songe au gentil Noël
qui y déposa, l’an dernier, le joli cœur, en or, orné de perles, qui se cache
sur sa poitrine ! Elle pense à la joie qu’elle éprouva en trouvant ce charmant
souvenir, lorsqu’elle vint chercher pour Bébé les surprises de Noël et quels
remerciements émus, quels tendres baisers elle donna à Georges, qui enlaçait
sa petite Marthe coquette.
Hélas !
pourquoi donc le bonheur était-il à jamais banni de ce petit nid d’amour où
ces êtres avaient vécu si tendrement unis...
Marthe,
dans le grand lit où elle ne peut se réchauffer, pleure silencieusement tandis
que dans la nuit, maintenant claire, sous un ciel limpide où luit une lune
argentée et de radieuses étoiles, la terre, couverte de son blanc manteau,
offre au Seigneur, dont c’est la Fête solennelle, les carillons de ses cloches
sonores, les prières ardentes des femmes et des enfants, prosternés sous la
voûte des chapelles, et, tout là- bas, dans les plaines sanglantes du Nord,
les râles des mourants, les clameurs des héros, le tonnerre des canons, toutes
ces voix terrestres demandant à Noël, la Paix éternelle et radieuse qu’il
avait promis aux hommes de bonne volonté...
Le
jour se glisse à travers les volets et la blancheur de son éclat annonce la
chute joyeuse des légers flocons blancs. Marthe, éveillée, entend le son de
la cloche qui appelle les fidèles à la première messe de Notre-Dame.
Jean
dort profondément ; il ne s’éveillera pas avant qu’elle ne soit de retour.
Vite, |15 elle saute hors du lit, s’habille chaudement, regarde
l’enfant endormi, ses petits poings crispés enfoncés dans ses yeux. Rassurée
par ce sommeil qui lui paraît si profond, elle sort de sa demeure et, fermant
doucement la porte de la villa, elle se dirige vers l’église.
Mais
le bruit de la porte se fermant, si léger qu’il soit, réveille Jean qui se
dresse sur son lit, effarouché.
Ecartant
les rideaux, il regarde le lit de sa mère, n’aperçoit pas la figure chérie
et s’effraye du silence. Un instant, il pleure pensant ainsi attirer son attention.
Mais non
! personne ne vient ! Il est donc seul !
Ou bien
petite mère, près de la fenêtre, guette-t-elle déjà, plongée dans ses tristes
réflexions, la venue du facteur ?
Il regarde
autour de lui, en se frottant les yeux ; il aperçoit l’Enfant Jésus dont le
doux regard semble lui sourire et il se rappelle brusquement sa prière de
la veille.
Alors
avec des précautions infinies, il se glisse hors du lit, roule sur le parquet,
embarrassant ses petits pieds blancs dans sa trop longue chemise, mais la
peau moelleuse qui lui sert de descente de lit amortit la chute et il se relève
tout souriant.
Doucement,
il se dirige vers la porte de la salle à manger, l’entr’ouvre et regarde vers
la fenêtre. Personne ! Alors il s’enhardit, ouvre toute grande la porte et
se précipite vers la cheminée.
Oh !
bonheur ! que petit Jésus est gentil ! À ses yeux émerveillés apparaissent,
lorsqu’il soulève le carton de la grande boite rouge, des rangées de petits
soldats, cavaliers, fantassins, artilleurs même avec leurs canons,
tout reluisants d’éclat, prêts à défiler orgueilleusement sur la table de
la salle à manger où il les fera manœuvrer. Des souliers retournés s’échappent
|16 des
friandises dorées, argentées, dégageant un délicieux parfum de vanille et
de chocolat.
— Petit
Noël, merci, du fond du cœur !
Mais
brusquement son radieux sourire contemplatif s’efface. Une pensée grave traverse
sa petite tête.
N’a-t-il
pas hier soir demandé autre chose à père Noël ?
Maintenant
il n’ose se retourner de peur d’apercevoir les souliers de petite mère ! S’il
n’y avait rien ! Si père Noël avait oublié la lettre de petit père ! Mon
Dieu ! lui qui était si content, lui faudra-t-il voir sa maman sangloter tristement
au lieu de jouer avec lui ?
Très
ému, il se retourne enfin, s’approche des chaussures, les regarde et tristement
baisse la tête.
Oh ! petit
Noël ! pourquoi n’avoir pas exaucé sa prière ?
Que lui
importe jouets et friandises puisque maman pleurera ! Toute sa joie s’est
éteinte ; ses jolis yeux, si rieurs,
lorsqu’il
contemplait les petits soldats de plomb, s’emplissent de larmes et, sans bouger,
cachant sa tête dans sesbras nus, il se met à sangloter longuement…
Tout à coup,
contre les vitres couvertes de buée, deux petits coups secs sont frappés.
Jean se
retourne, regarde et pousse un grand cri.
Là, dans
la rue, quelqu’un lui fait signe. Mais, ce quelqu’un, qui est-ce ?
Serait-il
possible, mon Dieu ! Mais oui, c’est bien lui ! Oh ! il le reconnaît bien,
avec sa grande barbe blanche, son tendre sourire, son grand manteau couvert
de neige, le capuchon blanc qui lui couvre le visage, la grosse canne sur
laquelle il s’appuie pour venir du ciel et ne pas glisser dans la neige. Oui,
c’est lui, c’est le Père Noël ! C’est ce tendre vieillard qui aime |17 tant les enfants sages et qui apporte à Jean la lettre
qui rendra le bonheur à sa mère !
Oh !
qu’il est beau ! Sous son manteau, qu’il secoue pour faire tomber les flocons
blancs, il a une belle tunique bleue, avec des boutons brillants, des galons
argentés, une étoile sur la poitrine, suspendue à un ruban rouge !
Jean
émerveillé le contemple ; puis il court à la fenêtre, grimpe sur la chaise
et, réunissant toutes ses petites forces, soulève l’espagnolette de la fenêtre
qu’il ouvre doucement.
Et voilà
que le père Noël lui parle ; s’il osait bouger, il se mettrait à genoux, mais
l’émotion le paralyse ; il prend la lettre que le vieillard lui tend, il
promet de la remettre à sa mère et d’excuser le commissionnaire qui ne peut
attendre son retour,
car
il part sur « le front », il tend sa joue au baiser du vieillard... Et le
brave commandant du dépôt de chasseurs qui, arrivé au bout de la rue, s’est
retourné, aperçoit l’enfant immobile, qui lui sourit, extasié...
Jean
descend de la chaise et n’ayant pas la force de refermer la fenêtre, la pousse
simplement et glisse la chaise contre les battants.
Il court
vers les souliers qui attendent toujours devant la cheminée ; son cœur bat
à se rompre dans sa poitrine. Quelle surprise pour petite mère ! Pourvu qu’elle
ne le surprenne pas ! Vite, il remet tout en ordre, glisse la lettre dans
la boucle dorée du joli soulier Louis XV et s’enfuit vers son lit dans lequel
il se cache, après avoir fait des efforts inouïs pour l’escalader. Il a froid,
il tremble sous les chaudes couvertures, mais il est si heureux qu’il n’en
souffre pas. Son petit cœur, ivre de joie, laisse déborder sa reconnaissance
et, joignant ses petites mains sous l’édredon de plumes, il remercie le Père
Noël qui a si bien récompensé petite mère et Jean de leur
sagesse.
|18
Lorsqu’il
entend la porte s’ouvrir, il ferme ses yeux, cache sa petite frimousse sous
les draps blancs et Marthe qui s’avance doucement, sur la pointe des pieds,
croit qu’il dort encore profondément.
Elle
dépose sur ce visage aimé un long, long baiser sous la douceur duquel Jean
s’éveille, sourit à sa mère dont il voit les jolis yeux rougis.
— Elle a pleuré, pense-t-il, mais grâce à ma prière, elle ne pleurera
plus.
Il
se laisse saisir par les bras qui l’emportent vers la haute cheminée, glisse
son bras nu autour de la jolie tête pâlie et s’extasie devant les magnifiques
cadeaux que père Noël a mis dans ses souliers.
Elle,
heureuse de la joie de l’enfant, chasse un instant, les tristes pensées qui
l’assaillent et, à genoux, devant lui, étale les friandises.
Puis,
doucement, elle lui chante la vieille chanson qu’elle avait apprise, jadis,
quand elle était petite fille, dans les bras de Sa mère.
Et cette
voix mélancolique qui cherche à tinter gaiement, dans le silence de la chambrette,
ravit l’enfant qui contemple sa mère dévotement.
Petit
Noël, avec mystère,
Ce soir,
des cieux, descend vers nous, Gentils enfants, que pour vous plaire, Ses mains
soient pleines de joujoux. Hier, les paupières mi-closes,
Vous lui
faisiez un doux appel, Rêvant déjà de douces choses, Soyez heureux ! Voici
Noël !
Et lorsque
la voix mélodieuse se tait, expirant dans un sanglot, un silence mélancolique
règne un instant dans la chambre. Mais voilà que Jean s’écrie :
Petite
mère, petite mère ! Noël ne vient |19 pas que pour les enfants.
Regarde dans tes souliers, il y a quelque chose de blanc.
Marthe
se détourne machinalement, pensant qu’une friandise s’est glissée dans son
soulier.
Mais
elle pâlit brusquement, saisit la chaussure, en retire la lettre.
Mon Dieu
! mais... mais non, elle ne rêve pas, cette écriture fine et déliée, elle
la reconnaît, c’est celle de Georges, de son mari bien-aimé.
Elle
chancelle sous l’émotion, cherche un appui et se laisse glisser sur un fauteuil,
cherchant à comprimer les battements de son cœur.
Jean,
les yeux brillants de plaisir, la regarde ; elle déchire l’enveloppe, saisit
le billet qu’elle renferme, le lit rapidement, une première fois, et, mêlant
ses rires et ses sanglots, folle de bonheur, elle saisit Jean, l’assied sur
ses genoux et lui conte, par phrases hachées, interrompues par les baisers
qu’elle lui donne, ce que petit père a écrit, l’espérance qu’il leur envoie
pour la fête de Noël.
Dans
un sanglant combat sur les rives de l’Yser, il fut blessé grièvement, après
avoir, par son courage, mérité sur le champ de bataille, les galons de sergent
; ses camarades ayant dû se retirer momentanément et l’ayant cru mort, il
resta évanoui sur le terrain et ne reprit connaissance que dans une ambulance
où, prisonnier, il reçut les premiers soins. Puis les ennemis battus avaient
dû reculer et il avait été envoyé dans un hôpital lointain de Belgique et
à l’heure actuelle, à peu près guéri de ses blessures, il était interné comme
prisonnier dans un camp de Bavière. Un jeune docteur français qui allait,
par suite d’un échange, rentrer en France, lui avait promis de remettre ce
mot au commandant de son dépôt et il espérait fermement que les
ardents
baisers qu’il leur envoyait à tous les deux, les consoleraient de
leurs cruelles angoisses. Il n’y aurait plus qu’à
|20 attendre avec confiance en la victoire finale,
la cessation des hostilités.
Marthe
pleure, mais ce sont des larmes de joie qui inondent son visage et Jean qui
comprend qu’il a retrouvé sa petite mère d’autrefois, la petite maman qui
joue, chante et l’embrasse souvent, lui murmure doucement à l’oreille : —
Puisque Père Noël n’écoute pas les prières des grandes personnes, hier soir,
je l’ai gentiment prié de t’apporter une lettre de papa, tu vois que j’ai
dû être bien sage pour qu’il m’ait ainsi récompensé.
... Le
vent a chassé les nuages qui fuient en déroute dans le ciel bleu pâle ; un
gai soleil d’hiver inonde de ses rayons frileux les plaines et les monts,
couverts de leurs manteaux d’argent ; les cloches de bronze emportent dans
les ondes sonores de leur chant, le cri d’espérance des femmes et des enfants
de France...
Annecy, le 25 décembre 1914. |21

Poupée
de Noël
À Madame
René V… en souvenir du héros tombé à Altkirch en août 1914.
Devant
la haute cheminée où pétille un feu clair, Marie, la vieille bonne, aligne
les petits souliers de Pierrot.
Pour
la voir, l’enfant s’est soulevé légèrement sur sa couchette blanche et Lucette
Morange qui suit, anxieuse, les moindres mouvements de son fils, croit voir
dans ses yeux profondément cernés, passer un éclair de joie. Un peu d’espoir
se glisse en son cœur ; elle approche ses lèvres du visage du petit malade
et, en l’embrassant doucement, lui dit :
-
Noël descendra ce soir dans la cheminée et
mon Pierrot trouvera de bien jolies choses dans ses souliers à son réveil
!
L’enfant
reste un instant pensif, puis, sans cesser de fixer la haute cheminée, il
demande :
-
Est-ce que Noël pourrait m’apporter quelque
chose de très gros ?
Et
Lucette qui pense au superbe cheval à mécanique que doit apporter le Bon Vieillard
au manteau de neige, s’empresse de répondre affirmativement. Alors Pierrot
câlinement lui glisse ses petits bras autour du cou et lui murmure à l’oreille,
entre deux baisers :
-
Eh bien, maman Lucette, tu attendras Noël
et tu lui diras qu’il me donne une petite sœur, comme celle que l’on m’avait
promise. Tu veux |22 bien, n’est-ce pas, mère chérie,
autrement je mourrai de chagrin et tu resteras seule, seule...
Lucette
comprend trop bien, par ces mots, que son espoir était vain : l’obsédante
pensée, au contraire, semble s’être plus profondément que jamais enracinée
dans la petite tête fiévreuse, puisque l’idée de mort vient d’y surgir, en
cas d’impossibilité. Et sa déception est si grande qu’elle ne peut contenir
ses sanglots.
Alors
Pierrot comprend que son désir n’est encore pas réalisable et se laisse retomber
sur sa couchette, en geignant faiblement.
*
*
*
Sur ce
foyer jadis si heureux, la Guerre a passé, semant la mort, détruisant à jamais
le bonheur qui y régnait. Le père, Louis Morange, le délicat et célèbre poète,
était mort en Alsace, tué par les balles prussiennes, en entraînant sa compagnie
à l’assaut, et, du choc douloureux que Lucette ressentait lorsqu’on lui annonça
l’irrémédiable perte, une couche prématurée résultait qui coûtait la vie
à la fillette si impatiemment attendue.
Lucette
n’avait supporté la double épreuve qu’à la pensée du cher petit être qu’elle
devrait doublement aimer désormais.
Et brusquement,
Pierrot était tombé malade à son tour. Il refusait toute nourriture, ne voulait
pas dormir et restait des heures entières, abîmé dans une étrange prostration.
Ses joues fraîches et fermes s’étaient creusées ; son teint était devenu blême
; ses yeux avaient perdu leur expression de gaîté et d’intelligence malicieuse
et du délicieux bambin au corps rondelet et musclé dont Lucette était si
fière, il n’était bientôt plus resté qu’un chétif petit être pâle, pleurant
du matin au soir.
Le docteur
avait hésité tout d’abord à se prononcer, |23 ne parvenant pas à discerner très nettement les causes
de cet étrange affaiblissement. Puis lorsqu’il eut entendu à plusieurs reprises
Pierrot réclamer avec un entêtement enfantin son
« papa
dont il aimait tant les caresses» et « la sœurette qu’on lui avait
promise pour partager ses jeux », il comprit que l’enfant dont la sensibilité
précoce avait été mise en éveil par les voiles de crêpe et les larmes de sa
mère se consumait d’un très violent chagrin. Il n’avait pu conseiller comme
remède que la distraction continue afin de faire diversion à l’obsédante
pensée.
Lucette
avait tout essayé : jouets somptueux, délicates friandises, promenades à la
campagne. Rien n’avait servi ! Et le docteur inquiet n’avait pu cacher qu’une
issue fatale était à redouter si une rapide diversion ne se produisait pas...
Lucette
vient de voir s’écrouler son dernier espoir et, envahie d’une extrême lassitude,
elle s’abandonne à son chagrin. À quoi bon lutter contre l’inexorable Destinée
! Elle sera vaincue ! Que n’est-elle donc morte avec le cher petit ange qui
n’avait pas pu vivre !
Et
elle reste là, près du petit lit blanc, incapable de réagir contre la douleur
qui l’étreint.
Le léger
contact d’une main sur son épaule la fait tressauter et se retourner. C’est
Marie, la vieille bonne, qui s’est permis d’interrompre le cours de ses sombres
pensées. Elle fut sa maman nourricière et, en cette qualité, s’est vue, à
plusieurs reprises, honorée de la confiance de sa chère petite maîtresse.
Elle a assisté à la scène douloureuse et une idée lui est venue, qu’elle veut
soumettre à la jeune femme :
— Lucette,
lui dit-elle gravement, il y a dans les bazars de grosses poupées qui ouvrent
les yeux, parlent, s’agitent comme de vraies |24 fillettes. Essayez ce subterfuge. Je connais l’âme des
petits enfants ; il suffit parfois de choses bien simples pour satisfaire
des désirs qui paraissaient des plus irréalisables. Essayez celui- ci... »
Lucette
ne réfléchit que l’espace d’une minute. Elle veut s’accrocher au moindre espoir.
Elle tentera tout pour procurer à son Pierrot un instant de bonheur. Rapidement
elle s’habille, et, après avoir embrassé l’enfant sur son front brûlant de
fièvre, elle descend en toute hâte...
Au-dehors,
la nuit est sombre, glaciale. Quoique ce soit nuit de Réveillon, nulle animation
ne se manifeste dans les rues ou sur les boulevards : peu de lumières, peu
d’autos, pas de couples joyeux. Paris lui aussi est en deuil.
Lucette
marche très vite, sans but bien déterminé ; elle se rend compte rapidement
qu’à cette heure tardive, le hasard seul peut la servir dans sa recherche
d’un bazar encore ouvert. Infatigable, s’abandonnant à ses sombres pensées,
elle n’en continue pas moins sa course à travers les rues qui s’assombrissent
de plus en plus à mesure que la nuit s’avance.
Tout
à coup, tranchant sur l’obscurité presque générale du boulevard, la façade
d’un théâtre, légèrement illuminée, attire son attention. Elle s’arrête,
regarde à droite, à gauche, paraissant stupéfaite de se trouver à cet
endroit du boulevard où elle n’eut jamais songé à venir de sang-froid acheter
une poupée... Qu’est-elle venue faire jusque-là ? A-t-elle subi à ce point
l’influence de ses pensées pour revenir inconsciemment vers ce théâtre où,
quelques années auparavant, par un soir de Noël, un beau soir de plaisirs
et de fête, sa vie s’était décidée.
Des souvenirs
jaillissent en foule à son cerveau enfiévré !
Nettement
elle revoit cette loge discrètement éclairée, emplie de l’étrange parfum qui
monte |25 des coulisses, où son fiancé, enivré par le succès triomphal
de son premier chef-d’œuvre était venu lui dire les suprêmes paroles d’amour
qui devaient les unir éternellement.
A ces
heures d’un inoubliable bonheur, d’autres avaient suivi, toujours aussi belles
! Et près de ce théâtre où elle avait orgueilleusement partagé le triomphe
du génie de son poète, c’est toute sa jeunesse heureuse qui s’évoque à ses
yeux.
Est-il
vraiment possible que ce bonheur soit mort à jamais ! Qu’elle ne verra plus
l’être tant aimé ! Que de tous les beaux projets qu’ils firent en cette nuit
de Noël qui vit leurs fiançailles, plus rien ne subsistera que deux petites
tombes froides d’enfants et une croix de bois dans quelque lointaine plaine
d’Alsace....
Et Lucette
tristement sanglote, sans se soucier des quelques passants qui se retournent
pour voir cette grande jeune femme vêtue de crêpe, pleurant devant ce théâtre
où l’on rit…
Lucette
est brusquement rappelée à la réalité par la vue d’un singulier tableau :
près de la porte d’entrée du théâtre, une vieille marchande d’oranges est
assise et, près d’elle, sautille une fillette qui semble avoir bien froid,
sous les oripeaux qui la couvrent.
Prise
de pitié, elle s’approche de l’enfant qui machinalement est venue se placer
dans les rayons lumineux d’un des globes électriques.
Et Lucette
se sent saisie d’un brusque frisson : elle passe sa main gantée sur ses yeux
comme pour en chasser une vision inopportune...
Rêve-t-elle
? Mais non. Ces yeux clairs, ces cheveux bruns légèrement bouclés sur les
tempes, cette bouche mignonne, elle les reconnaît ! Traits pour traits, cette
petite ressemble à s’y méprendre à son mari lorsqu’il était enfant. |26 Ne lui disait-elle pas souvent, lorsqu’ils s’amusaient
à feuilleter le vieil album de photographies de la famille, qu’il ressemblait
à une fillette !
Un brusque
soupçon lui traverse l’esprit.
Cette
extraordinaire ressemblance de la fillette avec son mari devant ce théâtre
où il était un des auteurs le plus en vogue, lui semble vraiment étrange !
Et voilà que la petite voyant cette belle dame qui l’examine, s’approche d’elle
et se met à chanter doucement, en se balançant, les deux mains à la hauteur
des hanches :
Je revois
la petite allée
Où j’eus
mon premier rendez-vous. Je retrouve sous la feuillée...
Le
couplet de la romance reste inachevé.
Pâle comme
une morte, Lucette vient de saisir l’enfant par le bras, et d’une voix rauque,
lui demande :
-
Petite, dis-moi…. qui t’a appris cette chanson
?
La
fillette effrayée balbutie :
-
Mais... c’est Monsieur Louis, mon grand ami
qui est mort à la guerre !
II semble
à Lucette qu’elle va s’évanouir.
Serait-il
possible que cette enfant fut le fruit d’une liaison coupable !
D’un
brusque effort de volonté, elle rassemble ses idées. Elle veut savoir à tout
prix, dût-elle en mourir. Cette vieille marchande d’oranges lui dira peut-être
la vérité.
D’un mouvement
nerveux, elle pousse la fillette devant la vieille femme et lui demande :
-
Madame, cette petite m’intéresse. Qui est-
elle ?
La marchande
interpellée regarde d’abord soupçonneusement la belle dame ; elle hésite
un instant, puis se décide à répondre :
-
C’te p’tite est orpheline. D’abord son papa
|27 était pas légitime, il avait un autre foyer, vous comprenez.
Oh ! il était
bon pour
elle, il l’aimait bien et ne la laissait manquer de rien. Lui en apportait-il
de bonnes choses quand il venait la voir. Hélas ! il a été tué en Alsace,
comme tant d’autres ! Quant à la maman, c’était une actrice, une bonne fille,
mais trop belle ; ça l’a perdue ! Le bon monsieur a dû la laisser tant
elle était frivole. Elle en a eu bien du chagrin et s’est lancée dans la
grande vie. La guerre est venue ; en peu de temps, elle a eu
dispersé
l’argent que le père de la petite lui avait remis ; c’t hiver passé, elle
a pris froid en revenant de je ne sais où. Et elle est morte en me confiant
la p’tiote. J’suis pas riche, alors si elle veut manger... »
Lucette
n’écoute plus la vieille femme qui lui énumère toutes les difficultés de la
vie et profère de sanglantes menaces contre Guillaume et sa tribu de bandits.
Elle est prise d’un brusque vertige, ses yeux se voilent, il lui semble qu’elle
va mourir...
Elle
n’avait donc pas encore épuisé toute la coupe de la souffrance humaine ? Faut-il
donc qu’aux malheurs irréparables qui l’ont frappée en ce qu’elle avait de
plus cher, vienne s’ajouter l’écroulement de ses illusions ?
Elle
ne pourra même plus, lorsqu’elle sera seule à souffrir, songer au Passé, sans
que l’image d’une rivale détestée ne vînt ternir l’apaisant souvenir des
beaux jours de bonheur ! Elle n’a qu’une issue pour en finir avec la souffrance
: mourir.
Elle
va fuir. D’un brusque mouvement, elle repousse la fillette qui câlinement
s’était glissée contre elle. Sous le choc, la pauvrette glisse et tombe sur
l’asphalte luisant, en poussant un cri de douleur.
Mais,
dans un élan spontané, Lucette, épouvantée par ce qu’elle vient de faire,
se précipite |28 vers l’enfant et la relève.
Un sentiment d’infinie, pitié s’éveille en son cœur. Est-elle coupable, la
petite orpheline ? N’est-elle pas plutôt une autre malheureuse victime du
cruel Destin ! Que va- t-elle devenir ? N’est-ce pas, après l’Assistance publique,
la rue qui l’attend, avec toutes ses tentations, ses embûches ? Et qui sait,
le ruisseau peut-être ! Oh ! Singulière ironie ! La fille du poète
Louis
Morange devenant une de ces tristes dévoyées dont il avait dit, en vers sublimes,
l’effroyable existence !
Un sursaut
d’orgueil s’ajoute à sa pitié. Non, elle ne l’abandonnera pas. L’innocente
créature trouvera en elle la protectrice dévouée qui continuera l’œuvre du
père, mort au champ d’honneur. Il est mort pour sauver la France, c’est-à-
dire sa femme, son enfant, sa demeure ; sa fin héroïque a racheté ce qu’il
y eut de mauvais dans sa conduite et Lucette songe qu’elle ne doit pas mourir,
que son rôle à elle, femme de France, est d’aider à réparer les malheurs que
les fautes du passé ont accumulés sur la patrie meurtrie.
Que fera-t-elle
pour cette enfant ? La mettra-t-elle en pension ou fera-t-elle un don généreux
à la vieille femme ? Pendant qu’elle réfléchit, la fillette dont elle avait
gardé la petite main glacée dans la sienne, s’est à nouveau blottie contre
ses chaudes fourrures et, enhardie tout à coup, lui saisit la main, la porte
sans rancune à sa bouche et dans un bon sourire qui illumine son clair regard
d’enfant, elle murmure :
— Madame,
emmène-moi chez toi et je te distrairai. Si tu as un bébé, je le bercerai
en chantant.
Ces mots
viennent de rappeler Lucette à la réalité. Et son Pierrot qu’elle oubliait
! Et la grosse poupée dont elle voulait charmer son réveil ! Il est près de
minuit et il serait fou de continuer ses recherches. |29
Une idée
jaillit tout à coup dans son cerveau. Pierrot veut une sœurette ! Ne tient-elle
pas par la main celle qui lui rapporterait la santé et la joie ?... Non...
c’est impossible !... La fille de sa rivale chez elle... N’est-ce pas un
sacrifice par trop surhumain ?
Et cependant,
si son Pierrot allait mourir...
Elle
se décide d’un seul coup. Elle ne réfléchira plus à rien !
À la
vieille marchande d’oranges, elle jette quelques billets bleus en lui criant
son nom, puis hélant un taxi qui passe, y pousse la fillette et s’affale à
ses côtés sur la banquette de velours, le corps brisé, la tête en feu...
Un jour
gris filtre à travers les persiennes closes de la chambre de Pierrot. C’est
Noël ! Devant la haute cheminée où flambe une grosse bûche, les souliers s’alignent
pleins de friandises dorées, de jouets magnifiques.
Et cependant
dans cette chambre bien tiède, où devrait régner le bonheur, on n’entend que
le bruit étouffé des sanglots d’une femme.
Près
du petit lit blanc où Pierrot repose, le docteur, appelé en hâte par Lucette
qui a trouvé en rentrant son petit en proie à une violente crise de fièvre,
est assis, anxieux, attendant le réveil de l’enfant. Près de lui une fillette
se tient pensive, un peu émotionnée par la tristesse qui règne autour d’elle.
Parfois, elle regarde timidement Lucette et ses jolis yeux s’emplissent d’une expression de reconnaissance infinie.
Le timbre
de la vieille horloge tinte lentement huit coups. Le son argentin éveille
l’enfant qui frotte ses yeux de ses petits poings amaigris. Il cherche à se
dresser sur son lit, appelle faiblement sa mère qui accourt. Un instant ils
restent unis par le baiser matinal. Puis |30 Pierrot, se souvenant de son désir de la veille, demande
:
-
Mère chérie, as-tu vu Noël ? M’a-t-il apporté
petite sœur ?
Pour
toute réponse, Lucette s’écarte du petit lit blanc. Et Pierrot extasié voit
s’avancer vers lui la jolie sœurette de son rêve. Et voilà que pour accroître
le charme, la petite sœurette lui dit d’une voix très douce :
-
Noël m’envoie à toi, ami Pierrot, pour te
parler de papa.
Alors
le bonheur de Pierrot est trop grand et il laisse retomber sa tête sur l’oreiller.
Lucette
pousse un cri de détresse. Mais le docteur s’est déjà penché sur le petit,
a écouté les battements de son cœur et lorsqu’il se relève, il appelle la
fillette, la pousse doucement vers Lucette, en disant à la jeune femme pâle
d’émotion :
-
Généreuse amie, Poupée de Noël a sauvé votre
enfant. Embrassez-la !...
25
décembre 1915. |31

L’Espion
À la mémoire
de mon ami René E…, des tirailleurs algériens, mort au champ d’honneur.
Sorti
de Saint-Cyr, l’un des premiers de sa promotion, le jeune lieutenant René
d’Egronne venait d’être nommé capitaine, à la suite d’un raid audacieux qu’il
avait accompli au sud de Merrakech1.
Pour
fêter cette nomination bien méritée, il avait réuni au mess ses camarades
de régiment et quelques amis qu’il avait connus au Cercle où se réunissait
la colonie européenne de Casablanca, la plupart de jeunes commerçants nouvellement
installés dans cette ville et parmi ceux-ci un Alsacien, M. Fritz Muller,
venu quelque six mois auparavant installer, au quartier des Roches-Noires,
une grande usine de machines agricoles. Ce garçon affable s’était lié rapidement
avec les jeunes officiers et les divers membres du cercle ; il sablait largement
le champagne autour de lui et organisait, dans sa coquette villa des Charmilles,
située à l’une des portes de la ville, des
1 Marrakech.
réceptions
très suivies, qu’agrémentait, tout particulièrement, la présence de sa sœur,
la belle Marguerite Muller, dont les dix-huit printemps, les yeux bleus candides,
les lèvres roses et fraîches, la chevelure blonde, opulente, délicatement
ondulée, les formes idéales finement moulées dans un |32 tailleur noir qui lui seyait à merveille, faisaient rêver
tous les officiers de la garnison.
Mais,
elle, ne se départissant jamais de son attitude de reine indifférente, semblait
ignorer les simples mortels qui soupiraient à ses pieds, et ne sortait jamais
qu’en compagnie de son frère pour qui elle paraissait éprouver une vive affection.
On en
était au dessert, le champagne pétillait dans les coupes ; une franche gaîté
rayonnait autour de la table. Chaque officier avait conté sa petite aventure
amoureuse et tous approuvèrent lorsque le lieutenant Manier parla d’aller
terminer la fête chez la belle Edja, où les plus jolies aimées aux petits
pieds nus, aux bras souples ornés de bracelets d’or, à la peau dorée par
le soleil africain, avaient promis de danser en l’honneur du brillant capitaine,
sur la haute terrasse de l’antique palais, dormant au clair de lune, dans
la nuit bleue.
Mais
René d’Egronne, le favori de la belle Edja elle-même, refusa et pour satisfaire
la curiosité excitée par ce refus, il dit à ses convives :
— Je
vous ai réunis non seulement pour fêter mon avancement, mais aussi, mes amis,
pour terminer dignement ma vie de garçon ; je vous annonce donc officiellement
que je commence ma cour, dès ce soir, auprès de Mlle Marguerite Muller, ma fiancée.
Tous
les yeux se fixèrent sur Fritz Muller qui acquiesça d’un léger signe de tête.
Et en
effet, à dater de ce soir-là, le nouveau capitaine fréquenta assidûment la
villa des Charmilles, ou le plus gracieux accueil lui était réservé par la
jeune Alsacienne qui semblait ardemment éprise de son galant fiancé.
René
d’Egronne eût été parfaitement heureux s’il n’eut éprouvé un léger froissement
d’amour-propre en constatant combien était grande l’influence qu’exerçait
Fritz Muller sur |33 le caractère affectueux de
sa jeune sœur. Une légère déception
vint
même passagèrement troubler le charme grisant dans lequel se déroulait leur
printanière idylle : il fut un instant question qu’il devait changer de garnison
et, enchanté d’un avancement qu’il espérait plus rapide, il voulut presser
les formalités à remplir pour son mariage ; Marguerite s’y opposa, douce mais
énergique, refusant de quitter son frère dont le commerce était de plus en
plus prospère et fit céder le capitaine dont elle chassa la fâcheuse impression
par une affection chaque jour plus tendre.
Le mariage
avait été fixé aux premiers jours de juillet ; mais il fut brusquement reculé
de quelques jours par suite du départ inopiné de Fritz Muller qu’une importante
affaire appelait à Paris.
Les deux
jeunes gens se consolèrent de ce fâcheux contretemps car ils avaient la faculté
de se voir chaque soir et René éprouvait un réel plaisir à passer ses soirées
auprès de sa gracieuse fiancée qui s’amusait à broder les mille futilités
charmantes de son trousseau de future épouse.
Mais
le bonheur fut de courte durée. L’orage éclata tout à coup et René, certain
soir radieux qu’ils allaient enlacés à travers les allées parfumées du jardin
exotique, annonça tristement à sa fiancée que la guerre était déclarée entre
la France et l’Allemagne et qu’il allait partir à la gloire... ou la mort.
Un ardent
baiser dans lequel ils mirent toute leur âme fut le serment qui lia leur vie
éternellement et c’est les yeux pleins de larmes qu’ils se séparèrent.
Le capitaine
d’Egronne était chargé de la défense de Saint- Prixe, petit village accroché
au |34 flanc des coteaux verdoyants de la Marne ; il avait reçu
l’ordre d’y tenir ou d’y mourir. Il avait installé sa compagnie dans un creux
du terrain boisé, un peu au-devant du village qui dormait à sa gauche et
dont il n’apercevait que le vieux clocher, couvert d’ardoises brillantes sur
quoi se jouaient les rayons ardents d’un gai
soleil
de septembre. Très bien dissimulés, les tirailleurs attendaient patiemment
la ruée des troupes allemandes qui étaient signalées ; René, assis sur une
motte de terre, relisait pour la troisième fois, l’épître amoureuse que lui
avait adressée sa fiancée.
— Que
peut-elle faire à cette heure matinale ? murmura-t-il, cherchant à revivre
par la pensée, les moindres gestes de celle qu’il aimait ardemment.
Son regard
se fixa machinalement sur l’horloge du vieux clocher et constata qu’elle
était arrêtée, les deux aiguilles l’une sur l’autre, marquant trois heures
et quart.
Il tirait
sa montre lorsque son ordonnance, Paul Risquet, un engagé volontaire,
gavroche parisien qu’une peccadille
jeunesse
avait envoyé aux Batt’ d’Aff’ d’où il était sorti pour s’engager aux tirailleurs,
lui dit, respectueusement familier envers ce jeune chef qu’il aimait :
-
Mon capitaine, j’ comprends rien à cette sacrée
patracle ! Lorsque nous sommes arrivés, elle marquait huit heures et demie
; d’un seul coup elle marque trois heures et quart ! C’est c’pendant pas
une horloge pneumatique comme à Pantruche ?
-
Tu as dû te tromper, lui dit le capitaine
en riant. Tu avais trop dormi cette nuit et tes yeux étaient encore brouillés.
L’ordonnance
hocha la tête et allait répondre lorsqu’un obus éclata au-dessus d’eux et
tua net trois tirailleurs.
-
Tiens, murmura le capitaine, je ne pensais
|35 pas avoir à supporter un feu d’artillerie. Comment diable,
ont-ils pu nous repérer ?
Curieux,
son regard interrogea le ciel ; pas le moindre
«
taube » à l’horizon.
Et cependant,
les obus continuaient à pleuvoir, rendant la position intenable. René chercha
à quel endroit il pourrait dissimuler à nouveau sa compagnie que le feu de
l’ennemi décimait ; il aperçut sur la droite du village, un petit bois assez
épais, qui commandait également la route qu’il lui fallait défendre.
Il donna
l’ordre de s’y porter discrètement ; les hommes s’y glissèrent, en passant
derrière les maisons silencieuses du village qui semblait mort ; partout les
volets étaient clos, les portes fermées Les habitants effrayés avaient fui
devant l’invasion des barbares ; pour plus de sûreté, René d’Egronne
envoya
un sergent et quelques hommes reconnaître le village ; ils revinrent, n’ayant
trouvé qu’une vieille femme, agonisant sur son lit de douleur et, dans l’église,
le prêtre de la paroisse, prosterné devant l’autel.
Le petit
bois fut occupé et comme par enchantement, le feu de l’artillerie ennemie
cessa soudain.
René devint
soucieux en constatant cet étrange phénomène.
-
Que signifie cela ? murmura-t-il songeur.
Le bombardement s’achève dès que nous abandonnons la place ; serions-nous
vraiment signalés ?
La
réponse ne se fit pas attendre ; un obus, puis deux, puis trois passèrent
sur leurs têtes et le bombardement au bois commença.
-
Y a pas à douter, mon capitaine, murmura l’ordonnance
qui se tenait à ses côtés. Quelqu’un nous observe ! Faut découvrir l’oiseau.
Et son
regard perçant fouilla l’horizon à son tour. Brusquement, il tressaillit en
fixant l’horloge de l’église ; elle marquait maintenant neuf heures moins
un quart et les deux aiguilles |36 dirigeaient nettement leurs
pointes dans la direction du petit bois qu’ils occupaient.
Il ne
dit rien à son capitaine, un peu vexé de l’ironique répartie que celui-ci
avait faite à sa précédente remarque ; mais il posa son fusil, fouilla dans
son sac et en sortit un poignard marocain qu’il avait ramassé sur un champ
de bataille, dans l’Oued, le glissa dans sa large ceinture, fourra
une
grosse corde et un mouchoir dans ses vastes poches et, en rampant, se dirigea
vers l’église.
René
d’Egronne, jugeant la nouvelle position intenable, résolut de se retrancher
dans le village même, prêt à soutenir un siège en règle dans chaque maison,
transformée en forteresse.
Lorsqu’il
eut réparti ses hommes à leurs divers postes de combat, il vint avec une de
ses sections, prendre position près de l’église. Ils approchaient de la petite
porte du presbytère lorsque, tout à coup, aux yeux stupéfaits des soldats,
Paul Risquet apparut, portant sur ses épaules, le corps ligoté et bâillonné
du prêtre que le sergent avait aperçu, quelques instants auparavant, prosterné
devant l’autel.
Goguenard,
l’ancien Batt’ d’Alf déposa le corps aux pieds du capitaine, joignit les talons,
salua et dit en riant :
— V’là
l’oiseau que nous cherchions, mon capitaine. Du haut du clocher où il était
perché, il suivait des yeux nos mouvements. Et lorsque nous étions bien installés,
à l’abri des marmites boches, il descendait à l’horloge donner un coup de
pouce aux aiguilles qui indiquaient notre nouvelle position. Regardez l’horloge
: il est six heures et demie, j’en parie. J’ai vu, blotti dans l’ombre, le
vilain moineau accomplir son louche travail. Un prêtre, ça doit prier ou
se battre (j’en connais plusieurs qui ont bravement cassé leur pipe),
mais ça ne
s’amuse
pas à remonter les horloges. J’aurais bien voulu |37
l’empêcher
d’accomplir une troisième fois sa triste besogne ; mais il me paraissait rudement
costaud ! Heureusement, Bibi s’est rappelé certains tours qu’il avait appris
aux Batt’ d’Aff’ et profitant de l’attention que ce sale Boche mettait à
tourner les aiguilles, je l’ai eu vivement ficelé et bâillonné. Le voici
!
Et,
comme déjà un obus éclatait sur le village, l’ordonnance recommanda aux camarades
de ne pas bouger et disparut à nouveau dans le petit escalier tortueux qui
menait au clocher. Arrivé près de l’horloge, il fit, à son tour, manœuvrer
les aiguilles et le bombardement délaissant docilement le village, s’acharna
à nouveau sur le petit bois abandonné.
L’homme
jetait des regards de haine à ceux qui ironiquement le contemplaient. René
qui éprouvait un écœurement très vif pour ceux qui faisaient de l’espionnage
une arme de guerre, arme traîtresse et lâche, ne jeta qu’un rapide coup d’œil
au personnage étendu à ses pieds, cachant un visage tout embroussaillé de
barbe rouge dans ses mains larges et énormes.
— Portez-le
près d’un mur. Inutile de juger le coupable pris sur le fait. Préparez le
peloton d’exécution.
Au son
de cette voix brève qui dictait l’ordre de mort, l’homme tressaillit et ses
yeux jetèrent une étrange lueur lorsqu’ils fixèrent le jeune chef.
À ce
moment précis, un cycliste arrivait, apportant un ordre du colonel ; René
dut s’absenter immédiatement, vu la gravité de la situation, jugeant utile
d’aller à son tour prévenir le capitaine de la batterie d’artillerie qui le
soutenait.
Le lieutenant,
commandant en son absence, s’apprêtait à faire procéder lui-même à l’exécution,
lorsque l’espion que l’on avait adossé contre le mur de l’église, s’adressa
à lui dans un français très correct :
— Monsieur,
lui dit-il, je fais appel à la générosité proverbiale de votre cœur de Français
; je laisse dans un lointain pays une femme que j’aimais tendrement. Accordez-moi
la faveur de lui adresser quelques mots d’adieu avant de mourir et, en échange,
je
donnerai à votre chef, dès qu’il sera de retour, des indications précises
dont il appréciera la haute importance.
Indécis
au premier abord, le jeune lieutenant, généreux autant que chevaleresque envers
un ennemi sans défense, jugea qu’il n’y avait aucun danger à accorder cette
suprême faveur.
Gardé
à vue par quatre robustes tirailleurs, l’homme, à qui on avait rendu l’usage
de ses bras, griffonna rapidement quelques mots et les tendit au lieutenant.
Par mesure de prudence, celui-ci y jeta un simple coup d’œil ; il n’y lut
d’ailleurs qu’une défense absolue, impérieuse, de se marier désormais, succédant
à quelques simples mots affectueux.
— Quelque
amant bien jaloux, murmura-t-il, en haussant les épaules, et il rendit le
petit carré de papier à l’homme qui le relut, y griffonna machinalement deux
mots dans un coin, et, l’ayant glissé dans une enveloppe, y inscrivit une
adresse dont le lieutenant galamment négligea de prendre connaissance.
Il poussa
même la complaisance jusqu’à la faire porter immédiatement à l’arrière par
un des tirailleurs blessés qu’on évacuait.
Lorsque
René revint, l’esprit absorbé par de graves préoccupations, il s’étonna que
l’exécution n’eût pas été accomplie ; mais le lieutenant s’excusa, en expliquant
les divers motifs qui l’avait poussé à attendre son retour.
René
s’approcha du mur auquel s’appuyait l’homme ; les tirailleurs l’entouraient,
jouant avec les postiches et les lunettes dont il s’était |39 volontairement dépouillé. Il se retourna brusquement
en entendant la voix du capitaine.
René
poussa un cri d’angoisse :
-
Fritz Muller !
Le
cri s’étouffa dans sa gorge ; il chancela, crut défaillir, tant il eut brusquement
la vision nette du drame qui allait décider de sa vie.
Le
faux Alsacien le regardait fixement.
-
Eh bien, oui ! dit-il, tu me reconnais, René
! Je regrette le hasard qui nous met face à face, dans une si cruelle situation
; mais que veux-tu, la guerre a de ces sinistres caprices ! Oh ! ne prend
pas cet air méprisant. Je sais que vous autres, Français, vous répudiez ce
moyen de combattre l’adversaire. Cependant, combien il nous fut utile pour
parvenir au point où nous en sommes aujourd’hui. Nous ignorons chez nous ce
qu’est cette sottise que vous dénommez la loyauté. À la guerre, mon cher,
tout est bon pour écraser l’ennemi. Et c’est dans l’espoir de voir nos armées
entrer dans votre orgueilleux Paris que j’ai tenté, durant ton absence, de
me soustraire à la mort que tu avais ordonnée.
En disant
ces mots, il regardait cyniquement l’officier qui paraissait atterré.
Impassibles,
les tirailleurs suivaient la scène qui se déroulait sous leurs yeux.
Ironique,
l’espion continuait :
— Je
n’avais pas le choix des moyens. Mais puisque la destinée m’avait mis entre
les mains d’un ami, presque d’un frère, c’est de son cœur, de son amour que
je décidais de me servir pour sauver ma vie. J’ai sollicité et obtenu du lieutenant,
dont la galanterie et la délicatesse sont au-dessus des plus
grandes
louanges, l’autorisation d’écrire une lettre qui, le hasard aidant, est déjà
très loin à l’arrière maintenant et ne tardera pas à parvenir à une personne
que nous connaissons bien tous les deux...
René
releva brusquement la tête et fixa l’espion ; il vit la lueur mauvaise qui
luisait dans les yeux fourbes de l’homme ; il eut l’intuition qu’il venait,
par une nouvelle fourberie, de briser sa vie à jamais ; et cependant il arrêta
le brusque mouvement du lieutenant qui venait de comprendre comment l’odieux
espion s’était joué de lui.
Fritz
termina froidement :
— Marguerite
ignore ce que je suis devenu. Me croyant mort à l’ennemi, elle n’aurait pas
hésité, la guerre terminée, à s’unir à celui qu’elle aime ardemment. Mais
qu’elle sache ma mort infâme ! Qu’entre elle et toi se dresse mon cadavre
! Et jamais elle ne sera tienne ! Je lui ai donc écrit que j’allais mourir
et je lui fais promettre, si je ne reviens pas, de ne jamais épouser le capitaine
René d’Egronne. À toi de choisir entre ma mort et ton bonheur.
René
sentit, à la haine qui emplissait son cœur, s’ajouter un profond dégoût. Une
minute seulement, il réfléchit. La vie de cet homme était entre ses mains,
car il savait qu’aucun de ses soldats, de ses « chers enfants noirs », ne
contesteraient la légitimité de la sentence qu’il allait prononcer : la mort,
comme espion ou la prison, comme suspect ; dans leurs yeux, il lut l’acquiescement
absolu à la mesure de clémence qui, si elle les privait d’une juste vengeance,
sauverait peut-être le bonheur de leur chef aimé. S’il le tuait, la mort de
cet homme brisait à jamais sa vie ; il ne se faisait aucune illusion, connaissant
trop l’influence qu’exerçait Fritz sur le caractère de sa sœur. Il lui
fallait
donc renoncer à jamais au rêve qu’il avait fait et pour la réalisation duquel
il vivait uniquement.
Puis
son regard se porta au loin sur les vastes plaines fertiles de cette belle
France que l’ouragan de fer dévastait, il aperçut les villages paisibles qui
flambaient, il songea aux femmes, aux enfants que les barbares égorgeaient
sans |41 pitié ; il jeta un regard attristé sur les corps mutilés
de ses braves tirailleurs qui ne reverraient plus jamais leurs oasis ensoleillées.
Il songea à la
France
qui jouait sa dernière chance de salut pour ne pas périr sous les trahisons
accumulées grâce auxquelles elle avait pu être souillée.
— Qu’on
fusille ce lâche ! commanda-t-il d’un ton sec.
Et il
disparut à l’intérieur de l’église, pour cacher le désespoir qui lui brisait
le cœur.
La détonation
sèche des lebels déchira l’air. Les camarades, morts au champ d’honneur, étaient
vengés.
Dans
la tranchée, le capitaine René d’Egronne rêvait mélancoliquement. Son fidèle
ordonnance s’approcha discrètement et lui tendit une lettre :
—
Elle vient de là-bas, murmura-t-il.
Les yeux
de l’officier brillèrent tout à coup d’une lueur d’espoir. D’un coup sec,
il fit sauter l’enveloppe et lut les simples mots qu’elle renfermait :
« Avant
de partir pour une lointaine mission, dans le fond de l’Afrique, Marguerite
Muller, désormais sœur Renée en religion, envoie au capitaine René d’Egronne
sa dernière pensée d’amour et le prie de l’oublier à jamais... »
Jointe
à cette courte missive, une boucle de cheveux blonds, délicatement nouée par
une faveur bleue, laissait échapper un discret parfum de fleur, dernier souvenir
d’amour des heures enivrantes vécues dans le charme troublant des belles
nuits du ciel africain.
Le capitaine
pâlit et, au lieu de l’expression de gaîté que l’ordonnance espérait voir
à nouveau luire dans les yeux de son chef, ce furent |42 des larmes qui s’échappèrent, larmes amères qui tombèrent
sur les débris du bonheur mort, tout là-bas, dans les lointains brumeux du
pays ensoleillé…..
Le soir
même, à la tête de sa compagnie, le capitaine René d’Egronne enlevait une
batterie allemande et tombait, frappé d’une balle au cœur, face à l’ennemi.
5 mai 1915.

58
Le
Châtiment
Souvenir
de l’invasion de 1914.
Germaine
Vallorgues venait de quitter le couvent où s’était écoulée sa jeunesse, lorsqu’un
terrible accident d’automobile lui ravit son père. Quoique sachant fort bien
le peu de place qu’elle avait tenu dans la vie de cet infatigable brasseur
d’affaires, cette perte cruelle lui causa un violent chagrin auquel se joignit
l’appréhension d’un avenir fort précaire ; elle ne tardait pas, en effet,
à savoir qu’elle était ruinée.
Fort
heureusement, elle était douée d’un caractère énergique et courageux ; l’adversité
ne l’abattit point et elle se mit en devoir de subvenir à ses besoins par
son travail. Les bonnes sœurs du couvent qui avaient cultivé chez elle de
réelles aptitudes pour la peinture lui conseillèrent de donner des leçons
et lui procurèrent aimablement quelques riches élèves. Elle put ainsi envisager
l’avenir avec plus de confiance et, poussée par une légitime ambition, résolut
de profiter de ses loisirs pour se perfectionner dans cet art qui, peut-être,
la ferait parvenir à la célébrité.
Mais
la destinée la mit en présence, chez une de ses élèves, d’un étudiant étranger
qui, par la réserve de son maintien et la
douceur
de |44 son caractère, sut rapidement gagner sa sympathie
et en obtint la faveur d’aller en sa compagnie faire l’étude des chefs-d’œuvre
des Maîtres exposés dans les musées.
La jeune
fille qui, depuis son départ du couvent et la mort de son père, s’était trouvée
plongée dans une solitude profonde, déprimante, s’abandonna sans méfiance
au charme juvénile qui se dégageait de leurs entretiens presque quotidiens.
À ses yeux, si attentifs naguère à détailler les célèbres peintures,
l’enthousiasme
du jeune homme évoquait les paysages enchanteurs de son pays natal : prairies
d’Alsace, toutes fraîches encore de la rosée matinale,
villages perchés sur les crêtes bleues des Vosges, forêts profondes dormant
au clair de lune, ruisseaux tumultueux bondissant de roche en roche en cascatelles
irisées...
Et souvent
elle se sentait étrangement frissonner en songeant combien la vie devait y
être belle et douce pour deux âmes sentimentales et aimantes…
Quant
au jeune Frantz — ainsi l’appelait-on chez ses amis — il ne sut résister longtemps
à la folle passion qu’avait fait naître en son cœur la joliesse de cette
jeune fille dont les dix-huit printemps rayonnaient d’un éclat sans pareil
dans le regard de beaux yeux noirs, la fraîcheur de lèvres exquisément roses,
les moindres mouvements d’un corps aux formes idéales.
Aussi,
de la franche camaraderie qui les unissait au début, il ne tarda pas à glisser
au flirt galant, mettant en œuvre toutes les forces de séductions dont il
était capable pour arriver à conquérir ce cœur ingénu. Par de tendres paroles,
par de mirifiques promesses, il plongea bientôt Germaine dans une griserie
dont elle ne parvint plus à se dégager : ignorant tout des dangers de la vie
et n’ayant jamais connu l’affection d’une mère
et
la douceur d’un foyer |45 elle s’abandonna à cet amour
qui s’exprimait si tendrement et lui faisait entrevoir une existence des plus
charmantes dans un pays enchanteur.
Et certain
beau soir d’été, un brûlant baiser qu’elle ne sut pas refuser eut raison de
sa volonté chancelante et lui fit accepter de partager la vie de celui à
qui elle vouait un éternel amour.
Tout
en haut du boulevard Saint-Michel, ils vinrent cacher leur bonheur ; ils éprouvaient
l’un pour l’autre une si ardente affection, une telle absolue confiance qu’il
semblait que leur beau rêve ne dût jamais finir. Germaine continua à donner
des leçons de peinture, tandis que son ami, négligeant les musées et les
études, s’adonna à la photographie. Elle n’attacha aucune importance à ce
changement et ne le questionna même pas ; les heures leur paraissaient trop
brèves, lorsque la nuit venue ils se retrouvaient dans leur petit nid, pour
les dissiper sottement en causant de leurs occupations journalières ; l’amour
emplissait toutes leurs pensées.
Puis
Germaine crut pouvoir affirmer qu’elle allait être mère et leur bonheur s’accrut
à l’espoir que la venue du cher petit être influencerait favorablement la
décision des parents de Frantz qui hésitaient à légitimer leur union.
Hélas
! ce bonheur ne devait pas être de bien longue durée. Sous les yeux épouvantés
de Germaine, deux inspecteurs de la Sûreté vinrent, certain soir, perquisitionner
à leur domicile. Ils lui apprirent que le jeune homme avec lequel elle vivait
s’était enfui dans le courant de la journée après avoir failli se faire pincer
pour espionnage près d’un des forts de la ceinture nord de Paris.
Elle
put facilement se disculper de l’accusation de complicité qui pesa sur elle,
mais faillit en mourir de chagrin et de honte. Plusieurs semaines, elle resta
sur son lit de douleur, |46 appelant la mort comme une
délivrance ; mais l’implacable destinée lui réservait d’autres souffrances
; seul, son amour succomba à l’épreuve et, en ce cœur cruellement
meurtri,
l’oubli du séducteur se fit absolu.
Elle
sortait de convalescence lorsqu’elle reçut d’Allemagne une lettre par laquelle
le jeune Frantz lui apprenait sa véritable identité : fils d’un riche métallurgiste
d’Outre-Rhin, il était venu à Paris pour y faire ses études et n’avait fait
de l’espionnage que... par instinct... comme tous ses compatriotes. Il demandait
humblement pardon à la jeune fille du chagrin qu’il lui avait causé et désireux
de ne pas avoir brisé à jamais la vie de celle qu’il avait très sincèrement
aimée, il lui proposait de venir le rejoindre dans son pays pour y reprendre
leur existence d’avant ou, tout au moins, d’accepter une somme d’argent suffisamment
élevée pour que ni elle, ni le petit être qui allait naître, ne se trouvassent
dans le besoin. Elle ne lui répondit pas et toutes ses illusions de jeunesse
ayant sombré dans cette détresse morale, elle résolut de consacrer sa vie
à son enfant.
Grâce
à quelques petites économies, Germaine put vivre modestement jusqu’à l’époque
de l’accouchement. Elle mit au monde un garçon dont la chétive constitution
nécessita immédiatement de grands soins ; elle l’en aima plus encore et toute
l’affection dont débordait son cœur se concentra sur cette innocente petite
tête blonde. Il lui fallait travailler désormais pour elle et pour son enfant.
Rude tâche ; certes, mais qui ne l’effraya pas. Et courageusement elle se
mit à lutter dans la fournaise parisienne.
De
compatissantes voisines, prises de pitié |47 pour cette jeune femme dont elles admiraient l’esprit
de sacrifice et la scrupuleuse honnêteté s’offrirent à garder le petit Louis,
durant les heures d’absence de sa mère ; elle put ainsi s’occuper activement
dans quelques lithographies et imprimeries du quartier où son talent de fine
et spirituelle dessinatrice fut hautement apprécié.
Quelques
années s’écoulèrent ainsi. Le petit Louis grandissait péniblement et Germaine
s’acharnait au travail dans l’espoir d’emmener son enfant à la campagne pour
qu’il se fortifiât dans l’air vivifiant des champs. Non contente de travailler
tout le jour à ses croquis, elle passait ses nuits à écrire de courtes nouvelles
pour une revue artistique ; mais à ce labeur surhumain sa santé eût fatalement
succombé si un professeur de lettres, M. Nermon, un des rédacteurs principaux
de la revue dans laquelle écrivait Germaine, ne se fût épris d’elle et ne
lui eût offert de l’épouser.
De quelques
années plus âgé qu’elle, il sut trouver de si affectueuses paroles et se montra
d’une telle délicatesse en ce qui touchait la navrante histoire de la jeune
femme qu’elle accepta cette union, beaucoup moins pour sa satisfaction personnelle
que pour le bonheur de son enfant. En effet, les deux époux convinrent d’aller
habiter à la campagne dans l’espoir que la santé du petit Louis s’améliorerait.
M. Nermon
sollicita donc un emploi dans un collège de Seine- et-Marne ; il l’obtint
facilement et c’est dans une coquette petite villa, accrochée au flanc du
coteau qui surplombe la Marne, tout près de la ville de C..., qu’ils vinrent
habiter. Dans ce charmant séjour, Germaine connut, durant plusieurs années,
un bonheur sans mélange ; son mari l’adorait et son enfant, dont la santé
paraissait s’améliorer, promettait d’être un jeune homme de
grand
avenir. Il |48 reçut de M. Nermond qui fut pour lui un second père,
une éducation des plus soignées et à l’âge de seize ans, il allait être admis
à une école d’arts-et-métiers lorsqu’un fâcheux accident, survenu au cours
d’une partie de canot en Marne, lui occasionna une broncho-pneumonie dont
il ne parvint pas à se guérir. Fatalement, la maladie engendra la tuberculose
; trois longues années, les parents désolés luttèrent contre le funeste fléau
; mais le moment arriva où ils comprirent que tous leurs efforts seraient
vains et que l’issue fatale ne pouvait tarder. Les tendres paroles de son
mari parvenaient seules à calmer quelque peu le chagrin de Germaine ; mais
elle se demandait avec angoisse si elles suffiraient à lui faire supporter
cette surhumaine épreuve.
Et c’est
à ce moment critique que la guerre éclata tout à coup, privant la pauvre mère
de son unique soutien.
M. Nermon,
en sa qualité de lieutenant de réserve, fut appelé dès le début de la mobilisation
et laissa ceux qu’il aimait ardemment en lutte avec la mort qui rôdait autour
de la paisible villa.
Le coup
fut terrible pour Germaine ; mais il amena en ce pauvre cœur que l’inexorable
destinée s’acharnait à meurtrir, une violente réaction ; et n’ayant plus à
compter sur le secours de personne, elle voulut être forte pour que son enfant
ne souffrît pas des tragiques événements et s’éteignît doucement dans ses
bras.
Un
de leurs vieux voisins qui, chaque année, au printemps, prenait soin du jardin,
accepta de loger dans la villa et d’aider Germaine dans les soins que nécessitait
l’état du malade. |49
Chaque
matin, dès que le soleil inondait de ses chauds rayons la verte pelouse, on
descendait Louis et on l’installait commodément sur les moelleux coussins
d’une chaise longue pour qu’il pût, jusqu’au crépuscule, se baigner dans la
vivifiante chaleur. Germaine ou le vieux jardinier s’asseyaient à ses côtés
et lui racontaient les événements quotidiens jusqu’à ce qu’il s’assoupît ;
le soir, on l’aidait à monter dans sa chambrette et Germaine prenait place
à son chevet.
Il ne
fut pas possible de lui cacher que la guerre était déclarée ; cependant, il
fut convenu qu’en cas de revers, on ne lui avouerait pas la véritable situation.
Au début,
cela fut facile. Mais rapidement la situation devint critique et, malgré l’optimisme
des communiqués officiels, Germaine ne put plus douter de la gravité du danger
: c’était l’invasion.
Elle
vécut dès lors dans une effroyable angoisse ; les événements se précipitaient
rapides et tragiques. Et chaque jour, le lamentable spectacle auquel elle
assistait, augmentait son effroi. En effet, tout le long de la route blanche
et poussiéreuse qui longeait la villa un flot humain se déversait sur Paris
; c’était un pêle-mêle navrant de vieillards qui s’appuyaient sur les faibles
épaules des adolescents que leur jeune âge empêchait d’aller, avec leurs aînés,
défendre la Patrie en danger ; des femmes échevelées serrant farouchement
sur leur poitrine les nouveaux-nés qui pleuraient tandis que les plus grands,
les pieds nus et sanglants, s’accrochaient à leurs jupes en lambeaux ;
des infirmes qui se traînaient lamentablement, hurlant de souffrances, mais
préférant mourir en terre française plutôt que d’être martyrisés dans quelque
lointain bagne allemand. Et sur cette foule épuisée, mourant de faim et de
soif,
|50 marchant dans un nuage de poussière qui
desséchait les
poitrines,
un rude soleil d’août déversait la brûlure de ses ardents rayons.
Parfois
un remous se produisait dans la cohue apeurée ; le flot des fuyards se répandait
à travers les champs, se glissait dans les fossés de la route ; dans un tourbillon
de poussière, batteries d’artillerie, escadrons de cavalerie passaient dans
un éclair d’acier, volant à la gloire en chantant la Marseillaise.
Alors
un peu d’espoir ranimait les volontés défaillantes. Le miracle allait peut-être
se produire et les Barbares, cruellement châtiés, regagneraient rapidement
leurs sombres repaires ?
Hélas
! bientôt un nouveau flot de fuyards arrivait, et la fuite tragique reprenait
désordonnée, lamentable, la cohue devenant de plus en plus compacte au fur
et à mesure que les villages se vidaient au son du tocsin que les vieilles
cloches de bronze tintaient désespérément comme, un glas de mort.
Germaine
venait souvent jusqu’à la grille de fer qui clôturait le jardin et s’efforçait
de secourir le mieux qu’elle le pouvait les malheureux fugitifs. Parfois,
elle les interrogeait sur leur pays d’origine, et c’est ainsi qu’elle sut
la défaite de Charleroi, les glorieuses batailles de Guise, de Saint-Quentin...
À son
tour, elle commença à envisager sérieusement l’idée de fuir. Mais l’appréhension
d’un si grand bouleversement dans la vie du pauvre valétudinaire dont les
forces allaient sans cesse en déclinant et son inaltérable confiance en un
brusque retour de la fortune de nos armes la retint hésitante, en sa villa.
Un
après-midi de septembre, se trouvant dans le jardin, près de Louis qui sommeillait
sur la |51 longue chaise, Germaine vit venir à elle le vieux jardinier
; son visage était si bouleversé
qu’elle
en ressentit une vive inquiétude ; aussi, lui faisant signe de ne pas parler
haut de peur qu’il éveillât le malade, elle se leva pour aller à sa rencontre.
Alors
le vieillard expliqua qu’un cuirassier, dont le cheval exténué s’était abattu
à quelques pas de la porte, lui avait appris que l’armée prussienne victorieuse
ayant occupée Creil avait brusquement obliqué vers le sud et descendait sur
la Marne.
Cette
nouvelle la glaça d’effroi. L’invasion foudroyante ne pouvant plus être contenue
désormais, elle allait être entraînée dans la débâcle et l’affreuse vision
qui lui traversa l’esprit, la fit sangloter.
Au bruit
qu’elle fit, le malade s’éveilla et lorsque Germaine se tourna vers lui, elle
s’aperçut qu’il la contemplait tristement, comme s’il eût voulu lire dans
son tendre regard de mère, la vérité qu’on lui cachait. Depuis plusieurs jours,
il se méfiait des réponses évasives, hésitantes qu’on faisait à ses questions.
On ne lui disait plus mot de cette marche triomphale à travers l’Alsace,
ni de cette grande bataille, engagée dans les plaines de Belgique où, un
siècle auparavant, les Anglais avaient abattu le formidable Colosse dont
Guillaume n’était qu’un bien pâle imitateur. Aussi, à ce silence gêné, à
l’expression d’angoisse que reflétait le visage de sa mère, si charmant à
son ordinaire, Louis avait compris qu’on le trompait.
Germaine
s’aperçut-elle que le doute était entré dans le cœur de son enfant et voulut-elle
l’en chasser à tout prix ?
Refoulant
ses sanglots, elle eut le courage de lui sourire gaiement :
-
J’ai une lettre de père, dit-elle vivement,
en s’approchant de lui. Il me conte une histoire |52 amusante, une farce héroï-
comique
que les soldats de sa compagnie ont joué aux Boches. Il me dit combien il
regrette que tu n’aies pas été là ?
-
Moi aussi, petite mère, répondit le malade
d’une voix faible, et je serais vraiment heureux si je pouvais aller le rejoindre.
Comme je voudrais être enfin guéri ! Comme je serais content de courir défendre
notre belle France afin d’avoir ma part de gloire dans le triomphe de la
Liberté.
Et
comme il faisait mine de vouloir se dresser, les yeux brillants d’une fiévreuse
exaltation, Germaine approcha ses lèvres de son front brûlant, le baisa doucement
et lui murmura de tendres paroles :
-
Calme-toi, mon Louis ; pour guérir rapidement
il faut être prudent et ne pas t’exalter pareillement. Laisse-toi soigner
et dorloter ; puis, lorsque tu seras à nouveau le beau garçon de jadis, tu
iras à ton tour cueillir les lauriers de la gloire.
Une
violente quinte de toux qui déchira la poitrine du malheureux, l’interrompit
; un instant, il resta immobile, les yeux clos, ses pauvres poignets amaigris
serrant désespérément le bras, de sa mère ; puis il parut faire un effort
surhumain pour aspirer un peu de l’air pur du soir, tout imprégné du parfum
des roses ; un peu de sang lui colora les joues ; il eut un regard triste
et las :
-
Hélas ! murmura-t-il, retrouverai-je suffisamment
de force pour aller me battre ?
Epuisé,
il s’abandonna à l’étreinte de sa mère qui, lentement, avec mille précautions,
le coucha sur les moelleux coussins où il resta étendu, la figure livide,
les yeux grands ouverts obstinément fixés vers le ciel qui s’empourprait à
l’horizon des reflets sanglants du soleil couchant. |53
Germaine
le contempla longuement ; puis ses beaux yeux s’emplirent de larmes amères
et la tête cachée dans ses mains pour qu’il ne la vît pas pleurer, elle s’abandonna
à son désespoir...
Elle
sanglotait ainsi silencieusement depuis un long moment, sans s’apercevoir
que la nuit venait, lorsqu’un son lointain de cloche la fit tressaillir et
se dresser brusquement ; elle tendit l’oreille, anxieuse, le visage effroyablement
pâle. Avait-elle rêvé ? Elle eût voulu le croire et chercha à se persuader
que les sons graves et tristes que lui avait apportés un lointain écho n’étaient
que le chant mélancolique d’une vieille cloche sonnant l’Angélus ! Son cerveau
bouleversé par les tragiques événements avait dramatisé la douce prière du
soir qui s’envolait vers le ciel enflammé.
Mais non
! elle ne rêvait pas...
Tout
à coup, de tous les villages qui doucement s’endormaient au flanc du coteau
brumeux montèrent les mêmes notes lugubres ; puis un sourd grondement, comparable
au roulement du tonnerre, se mêla à la triste mélopée des cloches. Et elle
comprit que c’était la sinistre voix du canon qui commençait la danse.
À son tour,
le vieux clocher du village lança son cri d’alarme :
-
Le tocsin, le tocsin ! pensa-t-elle en frémissant
d’épouvante.
Du
fond d’une allée, le vieux jardinier accourait. À voix basse, pour que Louis
n’entendit pas, il dit à Germaine :
-
Madame, l’ordre d’évacuer le village vient
d’arriver. Tout le monde fuit... Une formidable bataille se prépare pour sauver
Paris
; toute l’armée d’Afrique est là ; l’ordre est de tenir, d’avancer
ou de mourir... Le temps presse. Que décidez-vous ?
Une
lueur sombre passa dans les yeux de la malheureuse ; d’une voix lasse, elle
répondit :
-
Partez, brave ami. Je resterai seule avec
mon enfant ; son transfert est impossible et le moindre choc aurait raison
de sa faiblesse. Puisqu’il n’y a plus à espérer le sauver, je mourrai avec
joie à ses côtés si le veut la destinée.
Puis
jetant un tendre regard à son enfant qui semblait la fixer étrangement, elle
dit d’une voix qu’elle s’efforça de rendre ferme :
-
Aidez-moi à rentrer notre cher malade ; la
nuit vient et la fraîcheur est dangereuse. Ne soyons pas imprudents, si nous
voulons guérir. N’est-ce pas, mon Louis ?
Le
malade eut un pâle sourire ; délicatement soutenu de chaque côté, il gagna
sa chambre et se mit immédiatement au lit prétextant une extrême fatigue.
Au bout de peu de temps, il ferma les yeux et parut dormir profondément.
Sur
son large front brûlant de fièvre, Germaine déposa un long baiser :
-
Dors, mon pauvre enfant, murmura-t-elle tristement.
De quoi demain sera-t-il fait ?
Puis
elle se retira, fermant légèrement la porte pour ne pas l’éveiller.
Mais
à peine eut-elle disparu que Louis souleva doucement les paupières ; il écouta
s’éloigner sa mère ; puis quand il fut certain qu’elle ne pourrait pas l’entendre,
il se glissa hors de son lit, et, avec une peine infinie, s’aidant aux meubles,
s’arrêtant
pour
réprimer les accès de toux qui lui déchiraient la poitrine, il gagna la fenêtre.
Sa mère y avait installé un petit secrétaire et un fauteuil ; les jours de
pluie, ils venaient s’y asseoir pour lire ou se distraire en jouant. Dès qu’il
y fut parvenu, il se laissa choir sur le fauteuil, les yeux clos, épuisé par
un tel effort. Son cœur battait à se briser et il râlait...
Ce ne
fut qu’au bout de quelques minutes que |55 sa respiration redevint un peu normale ; alors il se
pencha sur le petit secrétaire de bois rouge, ouvrit le tiroir et en tira
un revolver d’ordonnance dont il fit jouer la gâchette ; elle fonctionnait
à merveille. Satisfait par cette constatation, il arma le barillet de six
cartouches, puis, le regard brillant d’une étrange exaltation, il fixa la
porte du jardin qu’une lune radieuse inondait de sa douce clarté.
Germaine,
à l’ordinaire, ne quittait plus son cher malade de la nuit ; au matin, seulement,
elle le laissait seul quelques instants, le temps de faire sa toilette et
de régler les petits détails de leur vie quotidienne. Mais ce soir-là, elle
pensa que son dévouement maternel pourrait s’exercer plus efficacement en
se tenant prête à tout événement.
D’un
moment à l’autre, des hulans en reconnaissance pouvaient surgir et elle savait
parfaitement bien de quelles cruautés ces bandits étaient capables. Le bruit
de leurs méfaits les précédait et la terreur qu’ils inspiraient était une
des meilleures armes dont la Kultur allemande avait cru devoir se servir pour
arriver à ses fins.
L’écho
apportait de plus en plus nettement le bruit sourd d’une violente canonnade
et il n’était pas douteux que les hordes ennemies approchaient rapidement.
Le
vieux jardinier qui avait refusé de fuir, conseilla à Germaine de clore simplement
la porte de fer du jardin ; résister lui semblait une folie car ce serait
vouer à une mort certaine le malheureux jeune homme dont les bandits n’auraient
aucune pitié, vu son jeune âge. Mieux valait attendre les événements et si
les ennemis voulaient pénétrer dans la villa, Germaine, qui |56
avait
quelques connaissances de la langue allemande, viendrait au-devant de leur
chef et s’efforcerait d’éviter le pillage et le meurtre en faisant appel à
la générosité du vainqueur.
Elle
laissa donc le vieillard près de la grille où il s’était installé un abri
provisoire et elle revint vers la villa silencieuse. La nuit était très claire
; la lune poursuivait sa course vagabonde dans un ciel étoilé, sans paraître
se soucier de l’effroyable drame qui se déroulait sous les éclats argentés
de ses rayons ; une brise légère caressait les vergers et effeuillait les
roses, emportant leur suave parfum vers les charniers humains où il se mêlait
à l’âcre odeur du sang et de la poudre.
Elle
pensa tristement, en embrassant d’un coup d’œil, le paisible jardin :
— Ici,
c’est encore la France et la nature y rayonne dans sa tendre poésie nocturne
; mais là-bas, sur cette terre désormais souillée par les bandits, à quel
spectacle d’horreur et d’épouvante est-on convié ?
Comme
pour confirmer ses craintes, une rouge lueur s’éleva à l’horizon ; des coups
de feu retentirent très proches ; le torrent dévastateur approchait.
Elle
rentra précipitamment dans sa demeure et se mit en devoir de cacher les valeurs
et les bijoux qui eussent pu attirer la cupidité des soudards au cas où ils
fouilleraient la villa.
Mais
à peine avait-elle eu le temps de pénétrer dans le cabinet de travail où se
trouvait le petit coffre-fort qui recélait leur fortune que le cri d’alarme
du vieux jardinier retentit ; elle comprit que l’heure était venue d’être
forte. Seule, désormais, par son courage et son énergie, elle pouvait influencer
le cours des événements ; elle n’hésita pas, et les yeux brillants d’une sombre
résolution, elle courut à la grille où elle arriva juste à temps pour voir,
sur la |57 route blanche, baignée de lune, une patrouille de uhlans
mettre pied à terre et s’apprêter à faire
sauter la
porte.
Elle
ne leur en laissa pas le temps et l’ouvrit toute grande. En voyant cette femme
seule qui semblait vouloir leur barrer l’entrée avec son corps, les bandits
s’arrêtèrent hésitants. Ils n’étaient plus guère accoutumés à trouver sur
leur passage que des demeures inhabitées qu’ils pillaient consciencieusement
ou gardées par des infirmes qu’ils fusillaient.
Aussi,
leur surprise fut extrême et ils laissèrent leur chef s’avancer seul au-devant
de Germaine immobile.
C’était
un jeune lieutenant, grand, aux larges épaules, à la moustache blonde ; il
s’arrêta à quelques pas d’elle et, sans daigner saluer, d’une voix brutale,
il demanda :
-
La maîtresse de maison, vite, j’ai à lui causer.
-
C’est moi, répondit-elle d’une voix ferme.
Devant l’arrogance de l’homme, elle retrouvait tout son sang-froid.
L’officier
la dévisagea avec une insolente fatuité ; son regard perçant se plut à la
détailler, sans se soucier du sentiment de répulsion qu’il semblait inspirer
à cette femme.
Il
poursuivit dans un français très net :
-
C’est bien ! Mes hommes ont besoin d’un instant
de repos ; nous nous arrêterons ici car vous devez avoir des provisions. Vos
maudits compatriotes ont tout emporté ou détruit en fuyant. Apportez-nous
ce que vous avez de meilleur à manger et à boire ; les soldats de l’Empereur
ont droit aux meilleurs vins de France.
Puis
montrant le vieux jardinier qu’un uhlan maintenait à quelques pas de là, il
ajouta :
-
Deux de mes hommes aideront ce vieillard à
faire le service ; nous mangerons dans ce |58 délicieux
jardin ; les nuits de France sont si douces, si parfumées qu’elles éveillent
en mon cœur une poésie troublante. Quant à vous, eh bien, vous resterez près
de moi ; et puis vous êtes si belle…
Il
n’eut pas l’audace de terminer la phrase, mais il tendit les bras vers Germaine
qui, devant ce geste odieux, recula et perdit son sang-froid :
-
Lâche, lui jeta-t-elle d’un ton méprisant.
Il ne vous suffit pas de voler, de piller, il vous faut encore déshonorer
les femmes. Mais croyez-vous que j’aie peur de mourir ! Allons donc ! Vous
ne connaissez pas les femmes françaises ! Je préfère supporter tous les supplices,
je préfère être fusillée plutôt que me soumettre à vos odieux caprices.
Et ses yeux exprimaient
un tel dégoût que l’officier s’arrêta.
Mais
un sourire cynique se dessina sur ses lèvres épaisses. Nonchalamment, en frappant
ses bottes du bout de sa cravache, il dit en fixant sur elle son regard dur
:
-
Vous refusez ? À votre aise. Dans un quart
d’heure votre demeure flambera. Je vais donner des ordres.
Il
se retourna pour faire signe aux hommes qui l’accompagnaient.
Mais
Germaine, les mains jointes, arrêta son geste par un cri suppliant :
-
Grâce ! grâce ! Épargnez ma demeure
et je me soumettrai à vos volontés.
L’officier
la contempla ironiquement :
Je savais
bien que les Françaises n’étaient pas farouches ! Allons ! Vous serez enchantée
d’avoir obtenu les faveurs d’un officier allemand. Mais le temps presse. J’ai
une mission à remplir avant l’aube. Quelle drôle d’idée ont ces Français de
vouloir résister ! Est-ce un piège ? En tout cas, le colonel Weisster, mon
père, eût mieux fait de confier cette dangereuse patrouille |59 à mon camarade Otto ; je n’ai guère de goût pour les
aventures de ce genre ; je préfère de beaucoup les aventures amoureuses...
Germaine
ne l’écoutait plus. À 1a seule pensée qu’elle allait avoir à supporter la
présence de cette brute, son cœur défaillait.
Et cependant…
Si elle
refusait, les bandits mettraient à exécution leurs sinistres projets et c’était
vouer à une mort atroce, épouvantable, le malheureux enfant qui périrait dans
les flammes !
Cette vision
d’épouvante lui ôta toute idée de révolte et, par amour maternel, elle se
résigna aux caprices du bandit...
Bientôt,
sous la conduite du vieillard auquel Germaine, avait donné des ordres, les
soldats eurent pillé les caves et les buffets, et sans songer à visiter les
étages supérieurs, ils se répandirent à travers le jardin, s’étendant sur
les fraîches pelouses vertes pour partager leurs victuailles. L’orgie ne tarda
pas à battre son plein et, vaincus par l’ivresse et la fatigue, ils finirent
par s’endormir lourdement, laissant un camarade à la garde des chevaux.
Près
d’une magnifique corbeille de roses, le lieutenant avait fait installer un
guéridon et, assis à côté de Germaine, il se grisait inlassablement de champagne
et de vins capiteux, sans plus paraître se soucier de la mission que son père
lui avait confiée. Parfois il s’arrêtait de boire, cherchait à se dresser
et lorsqu’il y était parvenu, levant sa coupe vers le ciel qu’une rouge lueur
embrasait à l’horizon, il lançait des hymnes de gloire en l’honneur de son
Empereur-Dieu qu’il verrait bientôt nouveau Néron devant une autre Rome, chanter
les bienfaits de la Kultur devant Paris en feu. Puis quand il se rasseyait,
il demandait à boire et Germaine espérant le voir succomber à
son
tour à l’ivresse, lui versait à flot le champagne doré. |60 Mais, tout à coup, jetant loin de lui la coupe qui se
brisa, il
leva
sur son hôtesse frémissante de terreur, son visage congestionné ; il apparut
hideux, les yeux brillants de luxure, les lèvres blanches d’écume. De sa main
puissante, il avait saisi Germaine qui voulut fuir l’effroyable étreinte.
Une courte lutte s’engagea ; le guéridon s’abattit et le fracas des verres
brisés éveilla quelques-uns des soldats qui se dressèrent en ricanant. Germaine,
les vêtements en lambeaux, la gorge mise à nue, résista quelques secondes,
puis s’affaissa brusquement en poussant un cri d’horreur. Sans hésiter, le
vieux jardinier s’était précipité à son secours ; dans un violent effort,
il était parvenu à dégager Germaine, jetant à terre l’officier prussien affreusement
ivre, lorsqu’un des soldats le renversa à son tour et l’assomma à coups de
talon et de sabre.
Déjà
le lieutenant s’était redressé et, poussant un cri de triomphe, se précipitait
vers sa malheureuse victime, lorsqu’un coup de feu déchira l’air et la brute,
le crâne fracassé, tomba à la renverse, tué net.
À la
fenêtre d’une des chambres du premier étage, une ombre, penchée sur la barre
d’appui, se dessina, tragique, le bras tendu armé d’un revolver, visant le
groupe compact des bandits qui se détachait nettement dans la nuit claire.
Cinq
coups de feu retentirent encore et quelques hommes tombèrent.
— Mère,
mère, cria une voix déchirante, viens près de moi, je te défendrai et nous
mourrons enlacés.
Au son
de cette voix, Germaine s’était ressaisie. Instinctivement, ses yeux se portèrent
sur la fenêtre de la chambre où devait dormir son enfant et, en l’ombre vengeresse
qu’un rayon de lune éclairait, elle reconnut Louis qui tendait les bras. Hélas
! à l’appel qu’il lui fit, elle |61 répondit par un cri de désespoir
; le malheureux qu’elle avait voulu sauver par son sacrifice, s’était perdu
lui-même en voulant la défendre !
Mais
au moins elle mourrait avec lui puisque le voulait la destinée !
Elle n’hésita
pas et courut vers la villa.
Subitement
dégrisés, les soldats s’étaient dressés et saisissant leurs armes, se mirent
à sa poursuite. Ils la rattrapèrent lorsqu’elle arrivait à la chambre de Louis
; un coup de sabre l’atteignit à la tête et elle tomba évanouie près du corps
inanimé de son enfant qui, épuisé par l’effort qu’il avait fait, s’était
abattu sur le parquet, vomissant le sang à pleine bouche.
La
vue de ce moribond les arrêta, indécis. Comment allaient- ils se venger sur
ces mourants ? Les achever d’un coup de fusil eût été trop humain pour ces
bêtes fauves déchaînées. L’un d’eux dont le visage empreint d’une indicible
cruauté semblait porter les stigmates d’un long séjour parmi les forçats,
émit l’idée de mettre le feu à la villa et d’y laisser brûler les deux malheureux.
La proposition
plut aux bandits dont les larges visages s’épanouirent de satisfaction. En
peu de temps, ils eurent fait les préparatifs, imbibé de pétrole les rideaux,
les étoffes et ils allaient accomplir leur ignoble forfait lorsque le cri
de ralliement poussé par la sentinelle, restée sur la route près des chevaux,
vint les troubler et leur rappeler la mission interrompue. Sortant rapidement
de la villa, ils se précipitèrent sur la route et se trouvèrent juste au port
d’armes lorsqu’une troupe de cavaliers déboucha au tournant du chemin.
Le
colonel Frantz von Weistter [sic], accompagné de son officier d’ordonnance
et de son escorte de hulans [sic], arrivait au galop au rendez-vous qu’il
avait assigné à son fils. |62
Dès
qu’il eut sauté de cheval, il le chercha des yeux
et s’étonna de ne pas le voir se précipiter au-devant de lui ; d’un ton brusque,
il s’adressa à un des soldats :
-
Que faites-vous là ? Où est votre lieutenant
?
Le
soldat interpellé balbutia :
-
Mon colonel..., nous fûmes surpris dans un
guet-apens. Trois hommes et mon lieutenant furent tués…
Le
colonel porta la main à son front et vacilla, comme étourdi par le choc
que lui produisait l’effroyable nouvelle, si
imprévue.
Mais cette défaillance n’eut que la durée d’un éclair. Il redressa la tête,
saisit l’homme par le bras et dit :
-
Conduis-moi ?
Ils
pénétrèrent tous deux dans le jardin et se dirigèrent vers l’endroit où le
drame avait eu lieu. Il ne jeta pas un regard aux corps des soldats qui baignaient
dans une mare de sang, et ne parut pas s’apercevoir des débris de l’orgie
qui jonchaient le sol. Mais, arrivé près du corps de son fils, il s’agenouilla,
dégrafa le dolman, chercha la place du cœur. Et quand il fut certain qu’il
ne battait plus, il approcha ses lèvres du pâle visage, inondé de sang et
le baisa.
Puis
il se redressa, le visage dur, la voix rauque, et s’adressant au soldat qui
se tenait immobile à ses côtés, il lui dit :
-
Fais-moi un rapide énoncé de ce qui s’est
passé.
L’homme,
sachant qu’il lui en coûterait de dire la vérité, raconta que le lieutenant,
avec quelques hulans, ayant voulu fouiller cette demeure qui leur avait paru
suspecte avaient été lâchement assassinés par des civils, cachés à l’étage
supérieur. Poursuivis, ils étaient parvenus à fuir, ne laissant dans la villa
qu’une femme et un jeune homme malade. Il termina |63 en
demandant
hypocritement s’il fallait les fusiller tous les deux.
Le regard
du colonel s’abaissa jusqu’au cadavre de son enfant. Et lorsqu’il le releva,
une lueur de colère et de haine l’animait.
D’une
voix forte, il appela son officier d’ordonnance qui accourut.
— Otto,
lui dit-il, vous allez mettre sous les ordres d’un sergent quelques hommes
qui me fusilleront l’assassin de mon fils, mais ne toucheront pas à la femme
qui, sœur ou mère de
cet
individu, souffrira plus de la mort d’un être cher que de sa propre mort.
Ainsi sa douleur égalera la mienne et je serai vengé. Cela fait, les hommes
disponibles enterreront mon fils. Quant à vous, lieutenant, rassemblez vos
cavaliers et partez aux renseignements. La situation me paraît s’aggraver.
Je ne serais pas surpris qu’une forte armée se soit concentrée à Paris et
nous prenne de flanc. Ce canon qui tonne à notre droite m’inquiète et le raid
audacieux qui surprendrait Paris et nous livrerait le Gouvernement m’apparaît
de plus en plus impossible. Enfin, hâtez-vous, je vous attends ici.
Le lieutenant
salua et sortit rapidement du jardin, donna quelques ordres brefs au sous-officier
chargé de l’exécution du prisonnier, et prenant le commandement de la troupe
de hulans, il partit au galop sur la route de Paris.
Le colonel
les suivit des yeux et lorsqu’ils eurent disparu, à pas lents, il se dirigea
vers la maison silencieuse.
Il gravit,
pensif, les quelques marches de l’escalier de pierre qui amenait au large
perron du rez-de-chaussée et poussa la porte d’entrée qui était restée entr’ouverte
après la rapide sortie des bandits. Il se trouva dans un long couloir sur
lequel deux portes donnaient. Un rais de lumière se glissait sous celle de
gauche ; |64 il l’ouvrit et pénétra dans la pièce qu’à l’ameublement
il jugea être le salon.
D’un
coup d’œil, il en admira la gracieuse ornementation. Tout y révélait le goût
exquis de la Parisienne coquette : meubles originaux et claires tentures,
d’une élégance et d’une finesse toute française ; au mur, de fins pastels
voisinaient avec des étagères finement découpées, supportant mille bibelots
charmants ; à droite, une haute cheminée de marbre rose, avec sa garniture
Louis XVI faisait face au piano autour duquel de
hautes
sellettes supportaient de superbes vases en cuivre doré, dans lesquels s’épanouissaient
de splendides gerbes de fleurs.
-
Comme c’est gai, ici ! se prit-il à murmurer.
Quel contraste avec nos prudes logis allemands, aux meubles lourds, aux sévères
couleurs, au religieux silence. Oh ! certes, si les Français étaient à quelques
kilomètres de Berlin, il n’y aurait pas dans les vases de nos villas d’aussi
jolis bouquets de fleurs. Quelle insouciance devant le danger ! Pauvre France
! Elle succombera parce qu’elle s’abandonna trop à son bonheur.
Puis,
pensif, le front barré d’un pli soucieux :
-
Elle succombera parce qu’elle fut aussi trop
confiante, pensa-t-il, en se dirigeant à pas lents vers la fenêtre grande
ouverte près de laquelle un petit guéridon chargé d’illustrations avait attiré
son attention. Il saisit un fascicule et le feuilletait négligemment lorsque
le bruit des pas cadencés d’une petite troupe retentit au-dehors et le fit
se pencher sur la barre d’appui de la fenêtre. Dans la nuit très claire, il
vit s’avancer le peloton d’exécution qui conduisait Louis près du mur où
il allait expier son héroïque sacrifice.
Le jeune
homme semblait avoir recouvré un |65 peu de force et marchait au
milieu des soldats, la tête haute, le regard assuré. Seule, la pâleur cadavérique
de son visage annonçait ses souffrances.
Il passait
sous la fenêtre à l’instant précis où le colonel se pencha. Instinctivement
le regard des deux hommes se croisa. Et ce fut le bourreau qui se sentit frissonner...
Il porta
la main à son front, fit un violent effort comme pour se souvenir... Etait-il
le jouet d’une hallucination ? Paris ! Sa première maîtresse ! C’est toute
sa jeunesse que le
profil
si pur, le regard si fier du jeune homme venaient d’évoquer en son cerveau
bouleversé. Et subissant l’étrange et subite impulsion de son cœur, ses lèvres
machinalement voulurent prononcer un ordre de grâce... Mais des yeux du jeune
homme, brusquement retourné, jaillit un suprême regard de dédain et de haine
; il vint frapper au cœur le colonel qui, blessé dans son orgueil, rejeta
toute idée de pitié et laissa les soldats exécuter l’ordre de représailles.
Mais,
à peine se fut-il retiré de la fenêtre qu’il se sentit envahir d’un malaise
indéfinissable ; son cœur battait à se rompre et il avait la tête en feu.
Il voulut lutter contre cette étrange faiblesse qu’il attribua à la douloureuse
émotion ressentie devant le cadavre de son fils et pour donner une diversion
à ses pensées, il se mit à consulter une carte des forts environnants Paris.
Mais cela ne dura qu’un court instant. D’un geste rageur, il remit les papiers
dans son portefeuille et martelant le parquet de ses lourdes bottes, il reprit
sa promenade autour de la chambre, cherchant à s’intéresser aux délicieux
pastels qui ornaient les murs.
Mais
l’obsédante pensée du malheureux qui allait mourir lui rappela tout à coup
qu’une femme était enfermée à l’étage supérieur. Appelant le soldat qui lui
servait d’ordonnance |66 il l’envoya chercher et vint
s’adosser négligemment à la cheminée.
Dans
l’escalier, le bruit d’une course rapide retentit ; les pas se rapprochèrent
et, sous une brusque poussée, la porte s’ouvrit toute grande, livrant passage
à une forme blanche qui se détacha nettement sur l’obscurité du couloir.
Germaine,
les cheveux dénoués, les vêtements en lambeaux, le visage baigné de sang,
se tint l’espace d’une seconde
immobile
dans l’encadrement de la porte, l’éclat de la lumière faisant clignoter ses
paupières.
Mais
à la vue de l’officier, elle se précipita, les mains jointes, à ses genoux.
-
Grâce pour mon enfant ! Grâce pour mon Louis
bien- aimé ! cria-t-elle.
Son
regard suppliant se leva vers l’homme qu’elle implorait. Et tout à coup, elle
se redressa d’un bond, et les bras tendus, elle recula comme devant une funèbre
apparition.
Le
colonel stupéfié n’avait pas fait un mouvement. Un instant, ils se regardèrent,
les pupilles dilatées par l’épouvante. Enfin, deux cris jaillirent de leurs
gorges oppressées :
-
Germaine !
-
Frantz !
Et
brusquement, Germaine éclata d’un rire insensé et se précipita vers le colonel.
-
Frantz ! mon Frantz bien-aimé ! Je savais
bien que tu reviendrais me chercher ! Oh ! oui, nous allons être heureux désormais.
Notre fils a grandi et peut-être ne le reconnaîtras-tu pas ? Mais tu l’aimeras
bien vite ; il est beau et bon comme toi. Nous allons nous retrouver unis
dans notre petit nid, tu te souviens, notre petit nid du boulevard Saint-Michel.
Ce sera charmant ; nous irons, les soirs d’été, nous enlacer dans les
brumeuses
allées du Luxembourg. Oh ! les tendres souvenirs de jeunesse… |67
La raison
de la malheureuse avait sombré dans l’épouvante.
Enlaçant
étroitement le colonel qui n’osait pas la repousser brutalement, elle mêlait
des baisers à ses paroles insensées, rappelant dans ses moindres détails l’idylle
qui les avait unis.
Mais
comme il ne répondait pas, le regard de Germaine se fit dur tout à coup.
Elle
s’arrêta de parler et parut faire un violent effort pour se souvenir.
-
Mon fils, cria-t-elle, sans desserrer son
étreinte, notre Louis, vas-tu me le rendre. Ah ! tu es donc officier allemand
! Tant mieux ! Tes soldats ont pillé ma demeure ; ton lieutenant a voulu me
violenter. Mais ton fils, Frantz, le fruit de notre amour veillait. Oh !
il n’était plus très fort, le pauvre enfant, sans quoi il eût été dans les
rangs de ceux qui se font tuer pour défendre la patrie envahie. Mais quand
il a vu sa mère en danger, il a tiré et tes ignobles coquins et leur chef
sont tombés sous ses coups vengeurs. Seulement, les autres nous ont brutalisés
et je crois bien qu’ils voulaient nous fusiller. Tu les empêcheras de commettre
ce crime, n’est-ce pas ? Tu ne voudras pas qu’on fusille ton enfant, le défenseur
de ta maîtresse ?
Epuisée,
le regard insensé, la poitrine haletante, elle cria encore :
-
Réponds donc, Frantz, réponds-moi donc ! Le
colonel ne l’écoutait pas. Brusquement, il venait de comprendre quelle effroyable
tragédie se déroulait : Louis, le condamné à mort, c’était son fils…
Alors,
par de violents efforts, il voulut se dégager de l’étreinte de Germaine ;
mais la folle, hurlant de détresse, cramponnée à son cou, ne lâcha pas.
Il
n’hésita pas et, violemment, l’entraîna vers la fenêtre pour crier l’ordre
de grâce qui empêcherait l’atroce infanticide… |68
Mais
lorsqu’il y parvint, l’épouvantable drame qui se déroulait à l’extrémité
du jardin touchait à sa fin. Dans une vision tragique, il vit les soldats
mettre en joue, le sergent lever le bras pour commander…
De sa
gorge contractée, un ordre bref put jaillir, mais les hurlements que poussait
Germaine couvrirent le son rauque de sa voix. Il entendit le dernier
cri poussé par son enfant :
« Adieu,
mère chérie ! Vive la France ! » ; puis le claquement sec des mausers retentit
et, les yeux dilatés par l’épouvante, il vit le corps de son fils osciller,
puis s’abattre dans une mare de sang, au pied du sergent qui déchargea sur
lui son revolver...
Ce ne
fut que lorsque les soldats passèrent au-dessous de la fenêtre et présentèrent
les armes encore fumantes que le colonel put s’arracher à l’horrifiant spectacle.
Par un effort de volonté surhumain, il rassembla ses idées et, ramenant avec
lui la malheureuse insensée à l’intérieur de la pièce, il la força à s’asseoir
sur un canapé. Elle y resta sans mouvement, le buste droit, le regard obstinément
fixé sur la fenêtre.
Alors,
se laissant tomber à genoux, la tête dans ses mains, il se mit à sangloter
éperdument. Sous la morsure du remords, le cœur de cet homme qui était prêt
à toutes les bassesses pour servir son Maître, l’Empereur d’Allemagne, se
déchirait. Il avait ordonné de fusiller son fils ! Et ce fils avait légitimement
tué son frère ! La Guerre, avec ses massacres, avec ses pillages, cette Epouvante
qu’il avait ardemment désirée comme tous ses semblables, venait de lui apporter
le Châtiment.
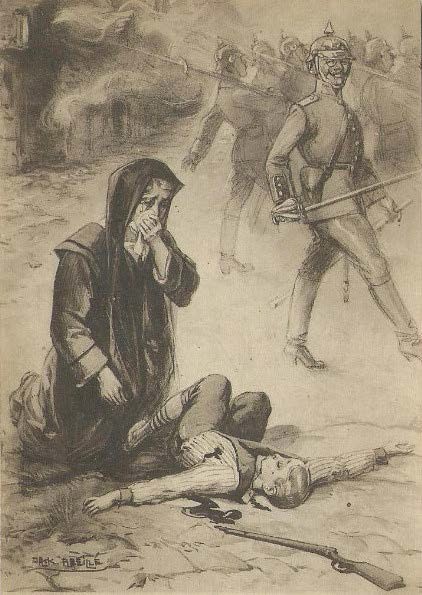
Celui
des autres viendrait. Il ne pouvait en douter. Et la vision de la Défaite
lui traversa l’esprit.
Alors
un besoin instinctif de crier sa douleur lui vint aux lèvres et, relevant
son visage |69 bouleversé par les larmes, il s’adressa, d’un ton suppliant,
à la folle impassible :
— Germaine,
la destinée nous remet en présence dans une situation tragique. Puisse-t-elle
au moins me permettre de racheter mes fautes ! Ecoutez-moi et vous pardonnerez
celui qui souffre comme un damné. Ma vie fut très triste. De retour chez mes
parents, après ma fuite de France, je contractai, avec la riche héritière
d’un grand nom prussien, une alliance qui ne fut pas heureuse. Un enfant naquit
de notre union, mais sans se soucier de l’honneur de son foyer et du bonheur
des siens, ma femme déshonora mon nom. Je la chassai ; mais elle se vengea
en me ruinant. Grâce à certaines influences, je pus rentrer dans l’armée
et parvenir, vous le voyez, à un grade élevé. Mon fils fut le seul être que
j’affectionnai. Je ne vécus que pour lui et lui fit embrasser la carrière
des armes ; depuis le début de la guerre je veillais sur lui avec un soin
jaloux et la destinée semblait lui sourire. Hélas ! il vient tomber sans
gloire sous les balles de son frère ! Comprenez-vous, Germaine, l’horreur
de la situation ! Et tant de souffrances ne méritent-elles pas le pardon ?
Oubliait-il
qu’il parlait à une folle ! Ou bien les yeux de Germaine avaient-ils repris
une expression plus vive d’intelligence qui lui permit de croire que la crise
était passée ?
Peut-être,
car il continua d’une voix singulièrement exaltée :
Pardonnez-moi
et laissez-moi réparer le mal que je vous ai fait. Vous serez belle, vous
serez riche ! Je vous emmènerai à la cour et vous oublierez dans les honneurs
les souffrances passées. Demain, nous serons à Paris ; maîtres de la Capitale,
la France est à nous. Sur cette terre féconde, nous ferons régner nos principes.
Notre Empereur lui donnera un de ses fils pour roi et, sous son règne, la
Kultur germanique |70 apportera ses
bienfaits
à cette terre, déshonorée par la frivolité de ses enfants. Nous unirons nos
robustes soldats aux femmes françaises et…
Un rire
strident l’interrompit :
—
Oui, mes petits, cria la folle en se dressant soudainement et en serrant à
le briser le poignet de Frantz à genoux devant elle. Votre peuple de brigands
conquerra le Monde, puis le Ciel. Et votre Empereur s’asseyera2 à la place de Dieu ! Insensés ! Votre
Empereur n’est pas plus prêt d’être sur le Trône divin que son fils sur le
trône de France. Ah mais ! croyez-vous donc que c’en est fait des Français
! Halte-là, bandits ! J’entends dans le lointain les clairons qui sonnent
la charge triomphale ; le canon
vengeur
écrase sous ses bordées de mitraille l’hydre de la tyrannie. Ecoutez, l’heure
du Châtiment va sonner. Ah ! comme on va rire !
Livide,
le colonel, brusquement rappelé à la réalité, s’était dressé à son tour et
s’efforçait d’échapper à l’étreinte de la malheureuse ; mais elle l’avait
enlacé à nouveau et cherchait à l’entraîner dans une ronde fantastique.
À cet
instant, la porte s’ouvrit violemment et le lieutenant Otto apparut sanglant,
déchiré, couvert de poussière. Cette arrivée inopinée surprit la folle et,
profitant de cette minute de distraction, Frantz la repoussa rudement. Germaine
chancela sous la poussée et vint s’abattre en travers de la porte en poussant
un cri de douleur.
Mais
Frantz n’y prêta pas attention ; l’état pitoyable dans lequel il voyait son
subalterne l’épouvantait. D’une voix rauque, il demanda :
2 S’assiéra.
-
Qu’y a-t-il, Otto ? Expliquez-vous, de grâce
!
-
Mon colonel, il faut fuir. Les Français ne
sont pas encore vaincus. Les voici qui prennent l’offensive et accourent en
chantant. Ce sont des lions ; une artillerie merveilleuse leur ouvre le chemin.
Tous mes hommes sont tombés et les zouaves sont à mes trousses... |71
-
Fatalité ! hurla Frantz.
Des
coups de feu très proches se firent entendre et les deux hommes se précipitèrent
vers la porte pour fuir à travers le jardin.
Mais
une forme humaine, les bras en croix, barrait la sortie.
-
Ah ! comme on va rire, disait la folle. Ton
lieutenant me voulait, mais il me faisait horreur. Toi, tu fus mon amant et
je te veux encore. Ne suis-je plus assez belle ?
Et
d’un geste farouche, elle découvrit son sein. Elle apparut ainsi d’une beauté
tragique, effrayante ; le sang qu’elle perdait abondamment par la blessure
qu’elle avait à la tête coulait le long de sa joue, glissait sur son corps
et cette tâche rouge faisait contraste avec sa peau blanche et transparente.
Frantz voulut la repousser. Mais la malheureuse semblait douée d’une force
extraordinaire ; une lutte s’engagea entre elle et son ancien amant.
Le lieutenant Otto voulut dégager son chef et s’apprêtait à frapper Germaine
à coups de sabre lorsqu’un coup de feu, tiré par la fenêtre l’étendit raide
mort. Et au même instant, les zouaves firent irruption dans le salon. Frantz
von Weisster se sentit perdu. Un jeune officier s’était précipité sur lui
et, d’un brusque mouvement, pour sauver la femme qu’il croyait en danger,
le jeta à terre, en lui criant :
-
Lâche ! qui osez assassiner les femmes.
Il frémit
sous l’insulte, tira son revolver ; mais deux gaillards le saisirent et, tandis
qu’ils l’emportaient au-dehors, il entendit, dominant le bruit du clairon
vainqueur qui sonnait la charge dans le lointain, une voix stridente qui
criait : « Châtiment ! Châtiment ! »
Août 1915.

Le
Pardon de Francine
(Mœurs
parisiennes)
À Madame
Francine F…
Quatre
heures sonnaient lorsqu’ils sortirent du Palais de Justice.
Ils ne
se séparèrent pas immédiatement et descendirent, côte à côte, le boulevard.
Une petite pluie tombait, glaciale et pénétrante ; le vent soufflait en
rafales violentes et Gaston, s’étant aperçu que Francine n’avait pas de
parapluie, s’offrit à l’accompagner jusqu’à la plus prochaine station d’omnibus.
Elle
ne refusa pas et ils continuèrent à marcher rapidement, sans plus se causer,
un peu intimidés de se trouver si près l’un de l’autre, eux qui, depuis un
an, ne s’étaient entrevus que deux ou trois fois chez le juge de paix pour
les tentatives de conciliation.
D’un
rapide coup d’œil, ils s’examinaient furtivement : elle le trouva vieilli,
voûté, d’un maintien un peu négligé ; lui, la trouva toujours jolie, coquette
poupée parisienne échappée de la devanture d’un grand magasin.
Maintenant,
ils étaient divorcés et ils allaient se séparer amicalement, comme de bons
camarades qui, las de vivre sous le même toit, reprenaient leur entière liberté.
Pas ennemis pour cela, n’est-ce pas ? |74
Cependant,
Francine, impressionnée par les sévères paroles du juge, sentait une infime
tristesse l’envahir. Quoi, c’était ça la vie ? Le bonheur était donc une chimère
qui se dérobait impitoyablement lorsqu’on croyait la bien tenir ! Toute sa
jeunesse s’évoquait brusquement à son esprit ; enfant, elle avait été heureuse,
choyée par des parents aisés qui tenaient un commerce lucratif dans la ville
de province où elle était née. À quinze ans, au moment où elle allait vraiment
entrer dans une vie que sa coquetterie flattée lui faisait entrevoir sous
les aspects les plus séduisants, la catastrophe s’abattit sur la famille
; le père, mourant subitement, ne put mettre tout l’ordre nécessaire au bon
règlement de ses affaires et les deux malheureuses femmes furent habilement
dépouillées par des associés peu scrupuleux qui prétendirent, cependant,
leur avoir sauvé l’honneur. Ecœurées par ces bassesses, trop fières pour
demander l’aide de parents indifférents, elles quittèrent le pays natal et
vinrent habiter Paris.
Leurs
débuts y furent pénibles ; elles eurent bien du mal à oublier le pays où s’étaient
écoulés de si heureux jours et elles étouffaient dans le petit logement assombri
où se cachait leur détresse. Où était-il le beau ciel bleu qui se reflétait
dans les eaux limpides du grand lac ? Et l’air pur embaumé des senteurs des
sapins ? Et les hautes montagnes aux cimes neigeuses que le soleil couchant
teintait délicatement de rose ! Ah ! misère ! Que ce Paris leur paraissait
affreux avec son ciel immuablement gris de plomb, l’air infect qui se dégageait
des rues noires et boueuses, les hautes maisons grises qui leur cachaient
le soleil ! Mais quoi ! Il fallait vivre et se résigner.
Peu
à peu, elles s’étaient habituées à. l’existence mélancolique et rude. Francine
s’était placée vendeuse dans un grand magasin. L’animation qui y régnait l’amusa
; la vie lui apparut sous un tout autre aspect ; au contact quotidien des
belles filles qui venaient acheter de la parfumerie et des bijoux, elle devina
tout un monde jusqu’alors ignoré, monde de plaisir et de luxe, dont l’influence
ne tarda pas à transformer la candide petite provinciale qu’elle avait été
jusqu’à ce jour en une délurée parisienne, avide de goûter aux multiples
jouissances que la grande ville renferme dans son sein.
Mais
la vieille maman veillait jalousement sur le cher trésor dont elle faisait
l’unique but de sa vie et Francine devait — oh ! combien tristement ! — rentrer
chaque soir dans le sombre logement qu’elles occupaient rue des Martyrs, tandis
qu’à quelques pas des vieilles maisons tranquilles, les boulevards et la
Butte rayonnaient de lumière et de gaîté.
Cette
existence paisible, mais par trop monotone, ne devait cependant pas être d’une
trop longue durée. Elle était dans toute la fraîcheur de ses vingt ans lorsqu’elle
s’aperçut de l’attention toute particulière que lui témoignait un jeune ouvrier
électricien, habitant son quartier, qui, venu à son rayon pour y faire une
emplette, lui avait adressé un galant compliment qui l’avait délicieusement
troublée. Elle eut vite fait de bâtir son petit roman, rendit salut pour
salut, sourire pour sourire et finalement accepta, certain beau dimanche
de juin qu’ils se perdirent dans les bois de Saint-Cloud, de devenir sa femme.
Il l’aimait
réellement et lui donna deux années d’un bonheur sans mélange. Très éprise
elle-même de ce joli garçon brun, au teint mat, à la fine moustache, aux yeux
vifs et profonds, elle lui prodigua les trésors de sa jeunesse et de son
cœur et elle put
croire
un instant au bonheur éternel. Tout leur souriait dans la vie ; ils avaient
fait leur nid dans un petit |76 logement, tout ensoleillé,
perché au sixième étage d’un vaste immeuble de la place Pigalle ; là, ils
étaient à proximité des théâtres, des bals, des concerts, lieux de plaisirs
que Gaston n’avait pu se résigner à complètement délaisser et que Francine,
heureuse de pouvoir
enfin
satisfaire sa curiosité, si longtemps excitée, adorait fréquenter. Ah ! certes,
en les voyant tourner dans une valse endiablée sur le parquet luisant de Tabarin-Bal,
on les eût pris plutôt pour de fols amants que pour deux époux !
Parfois,
la vieille maman grondait bien un peu.
-
Petite imprudente, disait-elle, en hochant
tristement la tête, les tentations qui vous sont offertes me font trembler
pour votre bonheur !
Mais
Francine, cambrant sa fine taille et secouant sa tête mutine, un peu pâlie
par les veilles, mais si jolie encore avec ses yeux cernés, sa petite bouche
fraîche, ses bouclettes de cheveux blonds, répondait invariablement :
-
Bah ! l’amour qu’éprouve Gaston pour ma petite
personne est si grand, si grand, que je ne crains nullement les comparaisons
qu’il pourrait faire !
Et cependant,
la vieille maman eut raison : Gaston rencontrait trop de jolies femmes, sur
son chemin, dans ce quartier excentrique ; il frôlait trop de fines tailles
dans les bals et voyait trop d’épaules, délicatement dévoilées, sous les lumières
étincelantes des salles de spectacles, pour qu’il ne lui arrivât pas de désirer
changer un peu d’avec les tendresses conjugales.
Le fruit
défendu se présenta sous les apparences d’une jolie blondinette, danseuse
au Casino, la délicieuse Yvette Freddy, qui, chaque soir, se faisait acclamer
dans l’apothéose de la
Grande
Revue où elle remplissait le rôle de Vénus. Le hasard amena Gaston dans
la loge |77 de l’actrice pour y réparer un branchement de fils électriques
; c’était au moment de la représentation et, sans plus se soucier de sa présence,
Yvette se dévêtit, jetant sans façon sa jupe et son corsage sur le canapé
et les chaises qui meublaient la loge; de toutes ces
dentelles,
de cette chair ferme, aux tons chauds, se dégagea bientôt un parfum enivrant
qui s’accrut de l’odeur des eaux de violette, de rose, de cyclamen dont elle
s’imprégnait toute avant de se grimer et glisser son maillot. Nue sous sa
chemise ajourée, elle frôla tout à coup Gaston qui, audacieusement, mit, sur
son épaule ronde, un fou baiser. Sous le chatouillis des moustaches, Yvette
poussa un petit cri nerveux, mais loin de se fâcher, se mit à traiter en
camarade le galant indiscret. Le soir même elle était sa maîtresse ! Une telle
liaison lui avait bien paru dangereuse, mais ce fut trop tentant pour qu’il
put résister. Cependant, par scrupule de conscience, il s’efforça de cacher
ses fredaines à Francine ; toujours prévenant, empressé à satisfaire ses
moindres désirs, il la berçait dans la douce illusion d’un bonheur constant
et durable, profitant de sa trop grande crédulité pour multiplier ses sorties
nocturnes sous le fallacieux prétexte d’assister aux réunions des sociétés
mutuelles ou politiques du quartier dont il était un des membres influents.
L’inévitable
dénouement se produisit, cependant, lorsqu’ayant trop abusé des concessions
qu’elle lui faisait, il se montra tout à coup violent à son égard et abandonna,
plusieurs jours durant, leur petit nid. Francine n’eut pas de peine à comprendre
qu’elle était délaissée, méprisée pour une autre. Regrettant alors de ne pas
avoir écouté les avertissements que lui avaient prodigués sa mère, elle s’attribua
une part de responsabilité dans le malheur qui lui arrivait et chercha à
lutter contre la rivale qui |78 venait lui ravir l’époux
qu’elle aimait ; elle se montra donc
conciliante,
pardonnant généreusement lorsqu’il revenait repentant et désillusionné. Mais
il vint un jour où Gaston se montra particulièrement cruel ; après une scène
violente durant laquelle il menaça à plusieurs reprises de la frapper, il
emporta leurs plus chers souvenirs communs et ne revint plus au domicile conjugal.
Elle comprit bien dès lors qu’elle ne parviendrait pas à ramener l’infidèle
et, lasse de lutter, elle résolut de divorcer.
Gaston
qui, après trois ou quatre passagères liaisons, était à cette époque solidement
lié à une plantureuse brune dont l’automne agonisant désirait jeter ses derniers
feux en compagnie de ce beau garçon, accepta avec empressement ce moyen de
reprendre sa liberté et ils entreprirent d’un commun accord, les formalités
légales.
C’était
fait maintenant !
Et cependant,
ils s’en allaient tristes, tous deux, étonnés de ne pas mieux apprécier cette
liberté qu’ils avaient volontairement revendiquée...
Ils arrivèrent
au bout du pont. Instinctivement, ils se tendirent la main, prolongèrent cette
étreinte un peu longuement et disparurent, l’un à droite, l’autre à gauche,
sans plus se retourner pour ne pas augmenter le trouble angoissant qui étreignait
leurs cœurs.
Eh oui
! c’était triste cette séparation tant désirée, triste comme la nuit qui tombait
froide et silencieuse, sur les quais déserts ; comme la Seine qui roulait
furieusement ses eaux grises sous les ponts faiblement éclairés par quelques
lumières rouges ; comme le ciel, sombre et nuageux qui déversait toutes ses
larmes glacées sur les rues boueuses et noires...
Gaston
partit avec sa nouvelle conquête pour l’Amérique dans l’espoir d’y faire fortune.
|79
Francine
retourna à son magasin et, ne voulant pas sombrer dans la tristesse des premières
années, chercha l’oubli dans la fréquentation des skatings, des bals où jeune,
jolie, elle s’attira les bienveillantes faveurs de nombre de jeunes gens qu’elle
y croisait ; et si elle ne succomba pas aux sollicitations flatteuses des
amoureux qui tourbillonnaient autour d’elle, c’est que sous son apparence
de Parisienne frivole, se cachait toujours la petite montagnarde candide et
foncièrement vertueuse.
Puis
elle se lassa de ces vains plaisirs, refusa plusieurs offres de mariage et
reprit la vie mélancolique auprès de sa vieille maman.
La guerre
éclata tout à coup.
Et le
grand magasin, autrefois si bruyant, si plein d’animation tapageuse, devint
triste, avec ses rayons inoccupés, ses couloirs mornes et silencieux, ses
galeries désertes.
Les hommes
allaient se faire tuer pour défendre la liberté. Est- ce que les femmes allaient
rester frivoles, gaspiller l’argent en coquetteries inutiles, en toilettes
excentriques, en chapeaux panachés ? Non ! La robe noire de deuil ou la robe
blanche d’infirmière serait de rigueur et le simple bonnet de police, posé
à la hussarde sur les têtes mutines des midinettes, coifferait toutes celles
qui n’auraient pas à porter la cape noire ou le béguin blanc.
Francine
s’ennuyait devant son comptoir vide, n’ayant pas même l’angoisse héroïque
des mères et des épouses pour occuper sa pensée durant les longues heures
d’inutile attente. Et
dans
les rues, désormais silencieuses où ne passaient plus ni gens, ni autos, où
ne brillait plus aucune lumière, elle se sentait envahir d’une profonde tristesse,
voisine d’un immense dégoût de toutes choses.
Or, un
soir de septembre, la concierge l’appela lorsqu’elle rentrait de son travail
et lui |80 montra une carte postale qu’elle venait de recevoir ;
ces simples mots y avaient été hâtivement écrits :
Rentré
en France pour faire mon devoir.
Gaston.
Francine,
ce soir-là, ne put dormir. De tristes pensées lui traversèrent l’esprit. Elle
se tourna nerveusement dans son grand lit, appelant en vain le sommeil, pour
chasser les sombres visions qui la faisaient trembler d’effroi. Oh ! ces
champs de bataille couverts de morts, de blessés râlant dans le silence lugubre
de la nuit ; ce silence rompu tout à coup par le hurlement des canons, le
crépitement de la fusillade ; cette nuit couvrant de son ombre sinistre et
traîtresse les monts et les plaines, puis s’illuminant brusquement de la
rouge clarté des incendies. Et ces hommes étendus sur la terre froide, glacée,
sentant par la blessure ouverte dans leur flanc, la vie qui s’échappe lentement
avec le sang vermeil, le sang qui coule à flot, partout, se mêlant aux ruisseaux
de boue, se congelant avec la neige blanche...
Très
tard, elle s’endormit ; mais le cauchemar sanglant, n’étant plus limité par
la volonté de la pensée effrayée, l’emporta vers des batailles gigantesques,
des assauts héroïques et, tout à coup, l’arrêta près d’un monceau de cadavres
d’où un être cherchait en vain à se dégager.
Oh
! ces bras tendus, ce râle d’impuissance et là, entre les yeux, ce trou d’où
s’échappait le sang et faisait, de la figure livide, un spectre d’épouvante...
— Gaston
!
Quoi !
Était-ce elle qui avait crié ?
Elle
se dressa sur son lit, les cheveux en désordre, couverte de sueur, brûlante
de fièvre. Quel rêve atroce ! Elle eut peur, n’osa pas se |81 rendormir et, ayant fait de la lumière, pria, comme lorsqu’elle
était enfant, pour tous les malheureux qui se mouraient, là-bas, sur les
champs de bataille...
Le matin,
Francine sortit de meilleure heure que de coutume, mais au lieu de se rendre
au magasin, elle se dirigea vers la mairie où se faisaient inscrire les femmes
de bonne volonté désirant servir comme infirmières. Après quelques rapides
leçons, elle fut acceptée, envoya la vieille maman à la campagne, chez de
bons amis et partit pour Belfort où on demandait des infirmières courageuses
et prêtes à tous les sacrifices.
Gaston,
volontaire dans une batterie d’un régiment actif d’artillerie, se trouvait,
un triste soir d’octobre, dans les environs de Saint-Dié où se livrait un
combat acharné.
Avertis
par leurs espions que de forts prélèvements de troupes avaient été faits sur
l’armée de l’Est pour parer au danger d’un débordement de notre aile gauche,
les Allemands lançaient, depuis le matin, colonnes sur colonnes à l’assaut
des positions françaises.
Sur
l’horrible hécatombe, la nuit descendait lentement ; le ciel s’enflammait,
dans le lointain : sanglants rayons du soleil couchant, rouges lueurs des
incendies, tout se confondait dans le même sinistre embrasement.
Tout
à coup, un léger flottement se produisit dans les rangs d’une compagnie d’infanterie,
qui protégeait les abords de la colline d’où la batterie de 75, dont Gaston
faisait partie, dirigeait un feu meurtrier sur les colonnes ennemies.
Les
Allemands en profitèrent aussitôt et se précipitèrent à l’assaut de la position.
|82
Le commandant
de la batterie, un jeune lieutenant, frais émoulu de Polytechnique, fit accomplir
des prodiges à ses hommes : lorsque les assaillants arrivaient trop près pour
que les terribles faucheuses puissent accomplir leur rude besogne, les artilleurs,
à genoux devant leurs pièces, faisaient héroïquement le coup de feu avec
les survivants de la compagnie décimée. Mais la lutte devenait par trop inégale
et le lieutenant, jugeant inutile de faire massacrer jusqu’au dernier ses
vaillants soldats, donna l’ordre de démolir les pièces pour que les ennemis
ne trouvassent que des débris de ferrailles inutilisables. Puis il commanda
la retraite.
Mais,
tout à coup, il s’aperçut que deux pièces, près desquelles gisaient inertes
les corps des malheureux servants, n’avaient pu être détruites.
— Un homme avec moi, cria-t-il,
un homme qui veut mourir !
Une minute,
la poignée des survivants se concerta. Il y avait là Jean Ténard, père de
deux enfants, Louis Monier, Pierre Grandet, soutiens de vieux parents infirmes,
tous, enfin, qui
n’avaient
pas peur de mourir, mais qui pensaient à ceux qui resteraient là-bas...
Lequel
allait mourir ?
Gaston,
lui aussi, réfléchissait profondément. Qui donc le regretterait ? Il n’avait
pas de petit gars qui pleurerait un père aimé ! Son frère ! Il l’avait si
totalement négligé depuis des années !... Sa dernière maîtresse ! Si elle
n’avait pas échoué dans quelque lupanar, il y avait beau temps qu’elle avait
dû trouver un autre amant !... Francine ! Ce nom lui vint aux lèvres brusquement.
Le souvenir de la jeune femme lui traversa l’esprit ; le regrettait-elle ?...
Allons-donc ! Lui qui l’avait si cruellement meurtrie dans sa chair, dans
son âme ! Oh ! non, ce n’était pas possible... C’était donc à lui que revenait
l’honneur
du
sacrifice. |83
Alors,
d’une voix forte, il cria :
—
Présent !
Et d’un
bond, il disparut derrière le lieutenant. La tâche était périlleuse. Les balles
et les obus pleuvaient autour d’eux et c’était miracle qu’ils ne fussent pas
atteints.
Enfin,
ils parvinrent aux deux canons qui, toujours menaçants, allongeaient leurs
gueules bronzées dans la direction des bêtes fauves accourant. Le lieutenant
desserra les freins ; Gaston mit la charge de poudre. Et les coups partirent
tandis que, dans un brusque recul, les pièces allaient se briser contre les
parois d’un rocher.
La manœuvre
avait réussi, mais les Bavarois n’étaient plus qu’à quelques mètres des deux
héros. À coups de revolver, ils se dégagèrent des premiers qui arrivaient
sur eux, baïonnette au
canon,
puis ils cherchèrent à fuir. Mais une mitrailleuse arrosa de balles les buissons
à travers lesquels ils cherchaient à se défiler. Le lieutenant tomba le premier
frappé de part en part ; Gaston reçut le choc en plein front, battit l’air
des deux bras et s’abattit sur le sol.
Comme
dans un rêve, il entendit les hurlements sauvages que poussaient les Allemands,
parvenus au sommet de la crête ; sa plus grande souffrance fut de songer qu’il
allait tomber entre leurs mains ; et il désira ardemment mourir.
Mais,
tout à coup, il perçut faiblement le son du clairon des chasseurs de la division.
Il comprit que les renforts arrivaient, qu’il n’irait pas mourir dans un bagne
allemand... Alors, unissant ses dernières forces, il cria : « Vive la France
! » et s’évanouit.
Le crépuscule
gris n’éclaire plus que faiblement les longues salles de l’hôpital. C’est
l’heure |84 désespérément triste où les blessés que la vivifiante
clarté du jour avait ranimés, sentent à nouveau l’atroce douleur des plaies
béantes, la fièvre tenace qui va les emporter dans des visions délirantes,
la mort enfin qui va rôder dans l’ombre propice de la nuit.
Le major
fait une rapide inspection, passe à côté de chaque petit lit blanc, dicte
des ordres aux infirmiers qui l’accompagnent. Puis des ombres blanches apparaissent,
glissent sur les parquets luisants et vont s’installer au chevet de ceux qui
commencent peut-être l’éternel sommeil.
Francine,
infirmière depuis quelques semaines, est chargée de la surveillance des deux
derniers lits de la grande salle. Elle se prodigue envers les blessés, toute
dévouée, toute prête au sacrifice d’une vie qu’elle ne regrettera pas, si
ses soins attentifs
peuvent
éviter des larmes de désespoir aux inconnues dont les êtres chers se meurent
loin de leur amour.
Actuellement,
elle soigne un jeune sergent de chasseurs, encore imberbe, qu’on a amputé
de la jambe gauche ; malgré qu’il souffre atrocement, il ne se plaint jamais,
et si parfois une larme brille au coin de ses yeux, c’est qu’il songe à celle
qu’il a laissée au village à la veille d’être mère et dont jamais il n’a eu
de nouvelles.
L’autre,
arrivé de la veille seulement, est un artilleur dont le visage affreusement
mutilé est entièrement couvert de pansements ; le malheureux blessé, soigné
durant plusieurs semaines dans une ambulance mobile, son transfert ayant été
jusqu’alors impossible, est complètement déprimé.
Ce soir,
la fièvre le tient fortement et il râle d’une façon inquiétante. Francine,
craignant quelque complication, fait prévenir le major qui accourt aussitôt
et s’apprête à renouveler les pansements. |85
-
Vous sentez-vous le courage de m’aider ? demande-t-il
à la jeune femme. Ce blessé est horrible à voir.
-
Je serai courageuse, Monsieur.
Délicatement,
le major découvre la face tuméfiée du blessé qui délire. Puis tendant à la
jeune femme une bande de pansement imbibée d’acide :
-
Posez-la délicatement sur le front, dit-il.
Francine
se penche sur le blessé. Mais un cri d’horreur, qui résonne lugubrement dans
la salle, s’échappe de sa poitrine haletante ; sa tête vacille, elle croit
s’évanouir. Mais non ! Elle
réunit
toute son énergie, toute sa volonté pour suivre et apprendre la délicate opération.
Jusqu’au bout, elle reste la tête penchée sur le malheureux, suivant attentivement
les moindres gestes du major, anxieuse et frémissante lorsque la douleur
arrache un cri au patient.
Mais
lorsque c’est fini, qu’elle relève la tête, elle est si pâle que le major
inquiet veut la faire immédiatement remplacer.
-
Non, monsieur, répond-elle ; j’ai eu un instant
de faiblesse, mais c’est fini. Je vous demanderai même la faveur de me consacrer
entièrement aux soins de ce blessé.
-
C’est impossible, madame. Le spectacle est
trop affreux et le sacrifice me paraît au- dessus de vos forces.
-
Je vous en prie...
Et ses
yeux, subitement pleins de larmes, semblent implorer avec tant de ferveur
que le major a la brusque intuition qu’il se trouve en présence d’un de ces
drames intimes que crée la guerre, et accorde la faveur demandée si ardemment.
Et
lorsqu’il a refermé la porte de la salle derrière lui, Francine, épuisée,
tombe à genoux |86 près du lit où râle le malheureux,
et sanglote éperdument...
Francine
se dévoua admirablement à la tâche douloureuse qu’elle avait sollicitée. Le
major loua l’extraordinaire courage de cette jeune femme qui n’hésitait pas
à donner avec une patience infatigable, les soins les plus intimes au malheureux
que les souffrances rendaient très exigeant. Elle s’appliqua à renouveler
seule les pansements et cela plusieurs fois par jour. Le blessé en
ressentait un grand bien-être et son état
s’améliorait
rapidement ; il ne voulait des soins que des mains de celle dont il appréciait
la douceur ; il savait qu’il resterait aveugle, mais il ne se plaignait pas
de son sort, n’exprimant que le vif regret de ne pouvoir jamais contempler,
ne fut-ce qu’une minute seulement, le visage de l’ange de bonté qu’il devinait
constamment penché sur son chevet.
Au bout
de quelques semaines de soins attentifs et dévoués, il put se lever et demanda
à se promener quelques instants dans le jardin de l’hôpital.
-
Il faudrait quelqu’un pour vous conduire,
mon ami, répondit le major, très embarrassé ; tout mon personnel d’infirmiers
est surchargé de besogne.
Le
blessé, soulevant le drap qui le couvrait, chercha, à tâtons, de ses bras
amaigris, les petites menottes douces qui, si souvent, restaient blotties
dans les siennes lorsqu’il souffrait trop et dont le doux contact lui donnait
du courage.
-
Voulez-vous vous charger de cette pénible
corvée ? murmura-t-il d’un ton suppliant où sa crainte d’un refus se devinait,
angoissante. |87
Elle
répondit « oui », très bas, comme si elle se fut parlée à elle-même.
Et les
promenades commencèrent, courtes d’abord, car le malade, déprimé par la fièvre,
n’avait que peu de force ; mais elle lui donnait le bras et il s’y appuyait
avec une telle confiance qu’il ne sentait pas la fatigue et ne demandait à
rentrer que lorsqu’il pensait être une cause d’ennui pour celle qui conduisait
avec tant de dévouement ses pas hésitants.
Lorsqu’il
fit beau, ils vinrent s’asseoir sur un banc, tout au fond du grand jardin
que le soleil inondait de ses rayons caressants ; l’hiver s’achevait et un
vent plus doux emportait vers les lointains brumeux, les gros nuages blancs
chargés de pluie et de neige ; les arbres commençaient à se couvrir de bourgeons
printaniers et les moineaux voletaient de ci, de là, semblant appeler par
leurs pépiements d’allégresse, le retour des hirondelles. Un grand souffle
parfumé d’amour et de vie passait sur la terre endeuillée et meurtrie, un
souffle fécond qui ressusciterait les jours de bonheur et de paix ensevelis
dans les sillons sanglants.
Le blessé
sentait une sève nouvelle monter en lui ; il ne se reconnaissait plus et,
très causeur, il exprimait constamment son étonnement à la jeune infirmière
qui l’écoutait toujours attentivement, mais ne répondait jamais que par quelques
phrases brèves prononcées à mi- voix.
Très
intrigué, au début, par le mutisme presque absolu de sa bienfaitrice, il en
avait demandé la raison à un infirmier qui lui expliqua, qu’à l’hôpital, l’infirmière
était considérée comme une douloureuse éprouvée de la vie et que chacun respectait
son chagrin muet. Il se contenta de l’explication, mais n’en continua pas
moins à prendre la jeune femme pour confidente de ses secrètes pensées. |88
— « Comme
je me trouve changé depuis le début de la guerre, disait-il, d’un accent empreint
d’une profonde mélancolie. Savez-vous, Madame, que vous avez devant vous
un grand coupable. Oh ! je n’ai jamais tué personne, mais j’ai meurtri, brisé
un jeune cœur qui ne méritait qu’amour et bonheur. J’étais fou, désireux d’une
liberté sans entrave, bien peu compatible avec la vie intime du foyer conjugal
; je ne sus pas, hélas ! comprendre qu’une femme qui aime ne peut
admettre le
partage
! Elle était cependant bien jolie, ma petite femme ! Pourquoi diable m’en
fallait-il d’autres qui certainement ne l’égalaient pas en beauté ! Etait-ce
l’attrait du fruit défendu qu’on va cueillir, en cachette, dans quelque discret
boudoir, avec les frissons de coupables qui risquent constamment d’être surpris
? Etait-ce l’ennui d’une vie trop paisible ? Etait-ce le contact trop souvent
répété des femmes que je croisais dans les milieux de plaisir que nous fréquentions
? Je ne sais ! Mais je fus assez sot pour ne pas savoir profiter de la douce
intimité de notre nid. Chaque soir, je sortais, et lorsque ma femme, fatiguée
par son pénible labeur, restait à la maison, j’allais aux réunions politiques
de mon quartier, crier mes idées de rénovation sociale ; j’en sortais enfiévré,
courant au rendez-vous donné par quelque femme névrosée, grisée par mes paroles,
tandis qu’elle, la chère petite femme, sous ses allures de parisienne coquette,
gardait son âme candide et sentimentale qui ne savait pas aimer le mari folâtre
que j’étais, l’amant désireux de sensations sans cesse renouvelées.
« Mais
n’étais-je pas plus coupable encore de lui en faire un grief ? N’aurais-je
pas dû, au contraire, l’aimer davantage pour répondre à cet amour si pur,
si précieux par sa rareté ! Quand je songe à ce que je l’ai fait souffrir,
pleurer, j’éprouve le regret de ne pas avoir trouvé la |89 mort sur le champ de bataille. Quelle belle expiation,
c’eut été, n’est-ce pas ! Mais la destinée me réserve, sans doute, un plus
dur châtiment. Je m’en irai donc par
le monde,
les yeux clos, sans soutien, sans appui, sans affection, éternellement hanté
par la vision du nid d’amour, bouleversé par mes fureurs, par mes trahisons,
où ma pauvre compagne se traînait à genoux, me suppliant de ne pas l’abandonner,
de lui dire pourquoi elle ne me plaisait plus, pourquoi je ne voulais plus
de son corps, de son amour, de son dévouement ! Oh ! quel remords, Madame,
pour celui qui aurait pu avoir — car elle m’aurait aimé encore, la chère petite
— un gai logis tranquille où il aurait vécu heureux, entouré de l’affection
et de l’amour
d’une
brave et dévouée compagne et de beaux petits gars, peut- être, qu’il aurait
amusés avec des histoires de guerre, de beaux petits gars, fruits de leur
amour…
« Mais
vous tremblez, Madame ! Rentrons, je vous en prie ! Que je suis donc ridicule
de vous ennuyer constamment de mes confidences ! Pardonnez-moi ! C’est si
bon de pouvoir s’épancher !... »
Ainsi
finissait toujours la causerie quotidienne du blessé à l’infirmière ; ils
revenaient lentement vers la grande salle, elle, refoulant les larmes dont
son cœur était plein, lui, pensif et rêveur, songeant tristement à ce qu’il
deviendrait, épave roulant sans cesse entre des mains inconnues.
Et lorsqu’il
était couché à nouveau, il saisissait la petite main de la jeune femme, petite
main tremblante qui ne se retirait pas...
Sa guérison
s’accéléra du jour où il fut décoré de la Médaille militaire ; le légitime
orgueil que lui procura cette récompense influa favorablement sur son état
moral et physique et il lui fallut songer à quitter l’hôpital. Il fit écrire
à |90 son frère qui accepta de le venir chercher et de l’aider
moralement par la suite, car sa pension de réforme et son petit avoir personnel
lui permettraient de vivre modestement.
La veille
du départ arriva. Ce soir-là, ils s’attardèrent plus longuement sous le grand
arbre du jardin. Le malheureux infirme se sentait infiniment triste à l’idée
qu’il allait quitter cette petite confidente, si douce, si patiente à laquelle
il causait librement et qui semblait comprendre sa douleur morale. Elle ne
le lui avait pas dit, mais il le devinait aux tremblements de sa main qui
jamais ne se retirait de la sienne, aux soupirs profonds qui s’échappaient
souvent de ses lèvres silencieuses. Un secret
instinct
l’avertissait que cette femme avait, elle aussi, le cœur brisé par quelque
atroce chagrin et que de leurs communes souffrances avait jailli une sympathie
puissante qui les faisait se comprendre mutuellement dans un simple frisson.
Oh !
que de fois, il fut sur le point de lui demander qu’elle le prît pour confident,
qu’elle lui dît toute la douleur qui oppressait sa poitrine ! C’était si doux
de crier ses regrets, sa douleur à une âme compatissante qui les partageât
!
Puis
il s’avouait secrètement qu’un sentiment puissant l’unissait chaque jour davantage
à sa dévouée bienfaitrice, sentiment d’infinie reconnaissance, certes, mais
aussi d’un charme troublant, d’une douceur exquise : il aimait !
Le contact
de ces petites mains blanches le faisait frissonner et lorsqu’il s’appuyait
sur le bras de la jeune femme, il tremblait d’émoi à deviner la joliesse de
ce jeune corps brûlant sous les étoffes blanches et dont le parfum le grisait.
Oh ! si elle l’eût aimé, peut-être aurait-il pu chasser les remords qui le
poursuivraient éternellement !
Mais
n’était-ce pas ridicule que de s’abandonner |91 à une telle pensée ? Quoi ? Aimer cet homme affreusement
mutilé, ces yeux sans lueur, ce visage sans expression ! Qu’allait-il être
? Un corps incapable de se diriger, qu’il faudrait guider pas à pas, comme
un enfant, à travers la maison, à travers les rues, un objet encombrant, bon
à remiser, en somme, dans un coin où il ne gênerait pas trop.
Et si,
négligeant les misères physiques dont la laideur était grandement atténuée
par la gloire qui s’en dégageait, il eût pu inspirer encore un peu d’amour
à une femme, comment espérer que ce serait à celle qui connaissait son âme,
cette âme dont il
avait
montré tout l’égoïsme et le manque de loyauté à la parole donnée ! Oui, il
exprimait bien des remords. Hélas ! des remords obligés, sans doute, par l’état
physique qui ne permettrait plus jamais les folies d’antan !
Vraiment,
il était fou d’avoir espéré — ne fût-ce qu’une minute seulement — trouver
en cette femme dévouée, en ce cœur meurtri, l’amie dévouée, la compagne fidèle
qui accepterait de partager sa vie.
II réfléchissait
à tout cela, tristement, sentant que l’heure de la séparation brutale était
arrivée et que plus jamais il ne connaîtrait les sensations infiniment douces
et apaisantes que la présence de la jeune femme lui procurait.
La nuit
venait rapidement ; il ne voyait pas, mais il devinait la beauté de ce soir
printanier, illuminé par les derniers rayons du soleil couchant, l’ombre bleue
qui envahissait les allées du jardin embaumé où les arbres parés de leurs
nouveaux feuillages, balançaient doucement, sous les frissons de la brise,
les petits oiseaux blottis dans les nids reconstruits sous le beau ciel de
France.
Ses
mains cherchèrent tout à coup celles de la jeune femme ; elle les donna toutes
deux. |92
Oh !
mourir à cette heure troublante, n’emportant dans l’au- delà mystérieux que
le souvenir d’une femme au visage inconnu, qui frissonnait sous son étreinte
nerveuse.
Il crut
entendre tout à coup le bruit d’un sanglot mal contenu.
— Vous
souffrez, Madame ? dit-il doucement. Pardonnez- moi, mais au risque de vous
paraître indiscret, je vous supplie
de
me confier votre chagrin. Pourquoi ne voulez-vous pas répondre à l’élan qui
m’a porté vers vous ? Me laisserez- vous partir sans m’avoir fait connaître
le son de votre voix qui doit être douce comme celle des anges ? Me laisserez-vous
croire que je ne suis pas digne de votre confiance ? Refuserez-vous de me
donner cette illusion, qu’étant devenu meilleur, une femme m’a pardonné le
mal que je fis à une autre...
Les mots
maintenant s’étranglaient dans sa gorge.
Francine
sanglotait sans contrainte. Il semblait que de son cœur gonflé par la souffrance,
toutes les larmes contenues jusqu’à ce jour s’échappaient librement.
Le blessé
s’était approché plus près de sa compagne et doucement il glissa son bras
autour de la taille fine de la jeune femme qui frissonnait.
En termes
émus, il chercha à calmer cette explosion de désespoir ; mais lui-même se
sentait étrangement angoissé ; sa gorge se serrait d’émotion et son cœur battait
à se briser dans sa poitrine haletante.
Et cependant,
il ressentait une joie immense et pure. Cette femme qui tremblait dans ses
bras, qui n’avait pas repoussé l’étreinte dont il enlaçait sa taille, l’aimait
donc un peu ! Cette pensée, infiniment douce, le grisait quoiqu’il n’espérât
pas de lendemain à cet aveu muet.
Oh !
comme il eût aimé la connaître, emporter |93 avec lui l’image de cette amie chère auprès de laquelle
il croyait revivre, étrangement précises à maints détails, les heures charmantes
de ses fiançailles, de ses rendez-vous nocturnes durant les belles soirées
d’été ! Etait-elle belle celle qu’il enlaçait maintenant ? Il
ne
le saurait jamais ; mais un sentiment irrésistible l’emportait fougueusement
vers elle.
Tout
à coup, un désir fou lui traversa l’esprit. Audacieusement, il chercha les
lèvres de la jeune femme...
-
Oh ! Madame, s’écria-t-il, extasié, après
l’ardent baiser qui avait fait vibrer son âme, soyez bénie pour l’inoubliable
minute de bonheur que vous m’avez donnée. J’ai cru revivre des heures lointaines,
des sensations divines que je n’osais plus espérer ici- bas. Ce baiser que
vous m’avez permis, ce baiser de fraîcheur et d’amour me fut aussi doux que...
-
Celui que vous donna, Gaston, une petite épouse,
toute blanche d’émotion à la sortie de l’église où vous veniez de lui jurer
fidélité, après avoir glissé à son doigt l’alliance d’or qui allumait votre
sincérité en l’union éternelle de nos cœurs.
En
entendant ces mots, le blessé, desserrant son étreinte, s’était dressé, pâle
comme un mort.
-
Francine, cria-t-il, est-ce toi ? Oh ! pardon,
pardon...
Ses forces
l’abandonnèrent et, fondant, en larmes, il s’affaissa aux genoux de la jeune
femme.
Francine
prit la pauvre tête fiévreuse dans ses mains et sur le front brûlant déposa
un long, très long baiser d’amour qui accordait le pardon…
Le
clairon lança, tristes et graves, les notes mélancoliques de l’extinction
des feux. |94
Et
ce soir-là, malgré la sévérité de la consigne, un couple étrange erra longtemps
à travers le grand jardin endormi : un artilleur aveugle s’appuyant sur le
bras d’une infirmière, toute mignonne sous sa mante noire, ornée de la Croix-Rouge
; ils allaient lentement par les allées pierreuses et la lune éclairait leur
bonheur de ses éclats argentés. Parfois, lorsqu’un buisson haut et touffu
jetait une tache noire sur leur chemin, ils unissaient leurs lèvres, longuement.
Juin 1915.

Grand’Mère
Comédie
en un acte
A ma Mère.
LAVAL, gros industriel, 58 ans.
HORTENSE, sa femme, présidente de la Société « Le
Relèvement de la Jeunesse », 53 ans.
SOLANGE, 24 ans.
MARNIER, 56 ans, ami de Laval. PETIT
PIERRE, 5 ans.
LA BONNE.
La scène
se passe sous la Grande Guerre, dans un salon bourgeois. Une fenêtre
donne à gauche sur la rue ; deux portes, une à droite donnant sur un cabinet
de travail, l’autre à doubles battants s’ouvrant dans le fond sur un vestibule.
Des tables, des canapés composent l’ameublement sévère. Au mur quelques
tableaux. |96
SCÈNE
I.
LAVAL, MARNIER.
Les deux
hommes examinent une carte étalée sur la table.
LAVAL. — Voyons... Saint-Dié ?... Là. Taintru ?,.. Là.
C’est à trois ou quatre cents mètres de ce petit village que mon fils fut
mortellement blessé. Son capitaine, qui échappa par miracle à la sanglante
hécatombe, vint, de passage à Paris pendant une convalescence, me dire comment
il tomba héroïquement par ce beau soir de septembre. La compagnie dont il
était le lieutenant avait été cernée sur un petit mamelon par les Bavarois.
Pendant deux jours, les vaillants chasseurs résistèrent à tous les assauts,
mais, menacés de mourir de faim, ayant tiré leurs dernières cartouches, ils
durent songer à se rendre ou à se frayer un chemin à travers les rangs épais
des assiégeants. C’est à ce dernier parti qu’ils se résolurent. Rassemblant
tous les survivants, ils formèrent un seul bloc, au milieu duquel ils mirent
leurs blessés. Puis, baïonnette au canon, le capitaine d’Arval et mon Paul
à leur tête, ils dégringolèrent la pente du mamelon, en chantant, pénétrèrent
comme un coin d’acier dans les rangs ennemis, les traversèrent et, profitant
de la surprise causée par cet extraordinaire coup d’audace, parvinrent à rejoindre,
après de rudes épreuves, les lignes françaises qui, reformées derrière Saint-Dié,
avaient interrompu leur retraite. Mais combien manquaient à l’appel ! Partie
à l’effectif de 400 hommes, la compagnie se trouvait réduite à une centaine
de survivants. Paul était de ceux qui ne revinrent pas. Le capitaine d’Arval
le vit s’affaisser, frappé d’une balle au ventre. Il voulut
le
soutenir, le faire porter par |97 les vaillants soldats
qui s’étaient précipités à son secours. Mais lui refusa, ordonnant, au
contraire,
qu’on le laissât seul pour que la retraite n’en fût pas
un
instant ralentie. Il se sentit perdu, demanda simplement qu’on l’adossât à
un arbre pour qu’il mourût face à l’ennemi. Puis il pria son capitaine de
nous apporter ses dernières paroles, fit un suprême geste d’adieu à ses soldats
et expira. (Il s’arrête un court instant de causer, passe la main sur
son front.) Mon pauvre gars ! Parfois j’ai d’horribles cauchemars ! Je
le vois, livide, étendu sur le sol, perdant à flot le sang généreux qui coulait
dans ses veines. Il appelle son vieux père ! Il demande un dernier baiser
à sa mère ! Ah ! c’est atroce. (Il se met à sangloter.)
MARNIER, lui frappant sur l’épaule. — Courage,
mon vieux camarade ! Certes, la perte de ton enfant est un trop grand malheur
pour que je songe à m’étonner de l’étendue de ta douleur ; moi-même, vieux
garçon, sans famille, sans affection, il m’arrive de sécher une coquine de
larme qui perle au coin de mes yeux lorsque je songe aux effroyables massacres,
aux tueries sans fin qui ensanglantent quotidiennement notre pauvre humanité.
Et je me souviens avoir pleuré comme un enfant lorsque, le jour de la mobilisation,
je vis toute cette ardente jeunesse partir à la mort en chantant. Mais doit-on,
nous autres de l’arrière, s’abandonner au désespoir ? Doit-on sous la morsure
de la souffrance, laisser s’amollir nos cœurs ? Non, non. Car il faut tenir,
il faut vaincre, et pour cela il faut rester fort, il faut être prêt à tous
les sacrifices. N’y a- t-il pas, d’ailleurs, de puissants dérivatifs à nos
sombres pensées ! L’admiration que nous inspire l’héroïsme de nos enfants
ne peut-elle pas atténuer nos souffrances ? Et l’avenir ? Ne mérite-t-il pas
qu’on y songe beaucoup aussi ! De ce bain
de
sang, une humanité nouvelle |98 va sortir ; la concorde, la
liberté, l’amour régneront sur le monde régénéré, sur le
monde délivré
de l’effroyable cauchemar que, depuis des siècles, la race maudite faisait
lourdement peser sur lui.
C’est
à nous qu’incombe le devoir de réorganiser l’humanité et c’est pour accomplir
cette œuvre que nous devons conserver intacte notre force morale.
LAVAL. — Tu as raison. Et puis il y a la haine aussi, la
haine qui parfois est plus forte que ma douleur. Ah ! que la guerre terminée,
tous, industriels, commerçants, ouvriers, nous leur refusions l’entrée de
nos usines, nous fermions nos portes à leurs marchands, nous repoussions leurs
mains sanglantes afin qu’ils soient acculés à la ruine, à la mort. (Il
reste un instant pensif.) Et puis, il me faut aussi réagir pour Hortense.
Les femmes ne trouvent pas en leur cœur de mère, d’amante les mêmes ressources
de courage que nous autres pour supporter le poids de la fatalité.
MARNIER. — Le temps apaisera sa douleur !
LAVAL. — Je l’espère. Depuis quelque temps, elle se reprend
à vivre. Ses œuvres de charité l’intéressent et l’occupent de plus en plus.
Mais j’ai cru longtemps qu’elle succomberait sous le choc brutal de la douloureuse
épreuve. Nous vécûmes des heures pénibles ; durant plusieurs jours, elle ne
prit pour toute nourriture qu’un peu de thé et quelques biscuits aux heures
des repas, pour ne pas me laisser seul à table. Nous étions là tous deux,
sans causer, refusant les mets, paraissant nous plonger attentivement dans
la lecture des journaux, alors que nous eussions bien été incapables d’en
répéter une seule ligne. Couchée, elle sanglotait doucement, croyant que je
dormais ! Notre chagrin était d’autant plus grand que nous
n’eûmes
pas la |99 suprême consolation d’embrasser notre
Paul
avant son départ. La mobilisation le surprit à Bruxelles où, depuis six mois,
il dirigeait, avant de revenir à Paris, la succursale des Leblanc, nos
amis. Il ne put
passer
à Paris, rejoignit à Lyon et partit immédiatement pour le front. Aussi, dès
l’annonce officielle du décès, Hortense, impuissante à se résigner, ferma
sa porte, paraissant décidée à s’isoler dans une solitude absolue qui l’eût
fatalement déprimée et conduite au tombeau. Ah ! comme je les ai alors enviés
ceux à qui les fils, mariés avant l’horrible drame, laissaient une jeune femme
à aimer, de petits-enfants à choyer ! Avec quelle joie, nous les aurions installés
dans notre demeure, désormais trop grande, pour les combler de gentillesses,
les couver tendrement !
MARNIER. — Est-ce que Paul n’avait pas une fiancée ?
LAVAL. — Non. Hortense voulut bien, à un certain moment,
lui faire épouser la fille d’un riche banquier boche de la rue d’Aboukir.
Une belle fille, certes, mais sotte, d’un esprit lourd, incapable de sentimentalité,
et avec ça, confite de dévotion, abhorrant les mœurs françaises, trop indécentes,
disait-elle, ce qui ne l’empêchait pas d’étaler sa gorge à tous les regards
et de faire suffisamment échancrer et entraver ses robes, rue de la Paix,
pour que nul ne pût douter de la splendeur de ses formes et de la finesse
de sa jambe. Elle déplut à Paul qui refusa de souscrire à cette union. Heureusement,
d’ailleurs, car elle doit être, à l’heure présente, dans un camp de concentration
où elle peut gémir sur la sévérité de nos mœurs.
MARNIER. — Tu ne lui connaissais pas de maîtresse ? Voyons,
un si joli garçon ! N’avait-il pas quelque part, dans Paris, sa petite garçonnière
|100 et sa Mimi Pinson ? Ne crois-tu pas qu’il y a, en ce
genre d’idée, une bonne action à faire, un pauvre cœur meurtri à consoler,
une misère, peut-être, à soulager ? Un
de
nos amis, établi au Maroc, a recherché la maîtresse de son fils, tué à l’ennemi,
et l’a installée sous son toit.
LAVAL. — En effet, c’est un acte généreux et que j’apprécie,
mais que, malheureusement, je ne puis pas imiter car jamais Hortense n’accepterait
la présence ici d’une de ces femmes qu’elle considère comme irrémédiablement
déchues. Et cependant, j’y ai eu songé. Je savais par mon ami Leblanc que
Paul affectionnait, de longue date, une de ses jeunes employées dactylographes.
J’eus même l’occasion de les apercevoir se donnant le bras, un jour que le
hasard d’une course m’avait amené à la sortie de son bureau. Je me gardai
bien, d’ailleurs, de troubler leur promenade, me contentant de les suivre
un court instant pour admirer le couple gracieux qu’ils formaient. Et, étrange
coïncidence, cette personne quitta la maison lorsque Paul partit pour Bruxelles.
Était-ce sa maîtresse ? L’emmena-t- il avec lui. Je l’ignore absolument. Il
connaissait trop les sentiments de sa mère au sujet de ce genre de liaison
pour nous en causer. Hortense est d’un cœur d’or ! Mais elle réprouve énergiquement
nos mœurs modernes. Toute sa jeunesse s’écoula dans un austère couvent de
province et l’éducation qu’elle y reçut influe encore, à l’heure présente,
sur son caractère et ses idées. Ses amies ayant fondé une œuvre pour la préservation
de la jeunesse, elle en accepta la présidence et elle n’eût pas manqué d’admonester
sévèrement Paul, voire même de lui fermer notre porte, malgré le chagrin
qu’elle en eût
éprouvé,
si elle avait eu connaissance de ses coupables relations. |101
MARNIER. — C’est peut-être excessif.
LAVAL. — Je suis de ton avis. Il faut bien que jeunesse
se passe ! Et puis, j’estime qu’une femme honnête et courageuse est digne
d’être épousée par son amant, qu’elle soit riche ou
pauvre.
Mais Hortense ne comprendrait pas cela et il est inutile que j’aborde un tel
sujet avec elle. Mais, chut ! je l’entends rentrer.
SCÈNE
II.
HORTENSE, LES MEMES puis LA BONNE.
Hortense
ouvre la porte. Elle paraît en grand deuil. D’un mouvement rapide, elle rejette
son voile de crêpe sur l’épaule et s’avance à la rencontre de Marnier en lui
tendant la main.
HORTENSE. — Quelle surprise ! Je vous croyais encore au
Maroc.
MARNIER. — Madame, je ne suis de retour à Paris que depuis
hier seulement. J’avais appris en son temps votre deuil cruel, mais j’ai tenu
à vous présenter de vive voix mes condoléances émues.
HORTENSE. — Brave ami, merci. Hélas ! notre chagrin est
toujours aussi grand et paraît devoir bien difficilement s’atténuer… Cependant,
il est très doux, très réconfortant de recevoir les marques de sympathie des
bons amis qui, malgré les soucis de l’heure présente, acceptent encore de
partager notre chagrin.
MARNIER. — J’affectionnais Paul que j’avais connu tout
enfant. D’ailleurs, il ne m’oubliait pas non plus ; il m’adressa, au début
des hostilités, une carte d’Alsace, où il m’exprimait avec son enthousiasme
juvénile sa foi en la victoire. |102
HORTENSE — Cher enfant ! il était beau, il était brave
! Il eût fait la joie de notre vieillesse ! Hélas ! la destinée ne l’a pas
voulu. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Puissions-nous bientôt nous
retrouver unis dans l’au-delà !
LAVAL, nerveusement. — C’est entendu, ma chérie,
mais en attendant, il faut vivre. La France a besoin de toutes les bonnes
volontés, de tous les courages et c’est un devoir sacré que de lutter toujours
et malgré tout… Voyons ! faut-il sonner la bonne, pour le thé ? Ne te déshabilles-tu
pas ?
HORTENSE. — C’est vrai, j’oubliais… Excusez- moi, je n’ai
plus la tête à moi...
MARNIER. — Vous êtes tout excusée, Madame.
La bonne
entre et prend le chapeau et les fourrures que lui tend Hortense.
HORTENSE, à la bonne. — Vous servirez le thé ici.
Apportez quatre services. (À son mari.) J’attends une jeune personne
que m’envoient les Leblanc. Ma secrétaire me laisse pour s’unir à un glorieux
mutilé. Je cherche à la remplacer et si la jeune fille qui va venir me convient,
j’ai l’intention de l’installer dans une de nos chambres. La pauvre enfant
revient d’Allemagne où elle resta prisonnière depuis le début des hostilités
; sa présence ici fera peut-être une heureuse diversion à notre chagrin. Mais
en l’attendant, veux-tu me rendre un petit service ? (Se retournant
vers
Marnier.) Vous nous excuserez, n’est-ce pas ? Voici une longue liste de
malheureux que Mme de Boildieu
et moi devons visiter demain. Les noms soulignés de rouge me sont réservés
; en me les dictant, tu me feras gagner un temps précieux.
Elle
tend une feuille à son mari, s’assied près d’une table et se met en devoir
d’écrire tandis que Marnier allume une cigarette et que 1a bonne dispose le
service à thé sur une autre table. |103
LAVAL, lisant. — Georges Vantold, sujet belge.
HORTENSE. — C’est le chef d’une famille très intéressante.
Sept enfants et la grand’mère infirme ! Au début de l’invasion, il amena tout
ce monde jusqu’à la frontière et le sachant en sûreté, revint faire le coup
de feu sur l’Yser et y fut grièvement blessé. Je m’efforce de lui trouver
un travail peu pénible, garçon de bureau, par exemple.
MARNIER. — J’aurai peut-être un emploi pour votre protégé,
Madame ! Demain, je le ferai mander.
HORTENSE. — Je vous en serai très reconnaissante. LAVAL. — Veuve Hamelet, trois enfants.
HORTENSE. — La pauvre petite femme est mignonne comme un
ange ; de grands yeux noirs, de beaux cheveux, des lèvres roses. Et cependant,
elle reste honnête ! Son mari est tombé dans un combat près d’Arras. Elle
ne peut se consoler et, pourtant, elle n’a pas même le loisir de pleurer en
paix son cher disparu. Que de couvre-bidons, de protège-nuques passent dans
ses mains agiles depuis l’aube jusqu’à une heure avancée de la nuit. Une
vraie et courageuse Française. Ce matin, j’ai débarbouillé moi-même un des
enfants et je veux être marraine du dernier.
LAVAL. — Brave cœur, va !
HORTENSE. — Il y a une telle jouissance à venir en aide
aux malheureux que je n’ai pas grand mérite à le faire. Dans ce peuple que
nous ne connaissions pas assez avant la guerre, il y a des vertus magnifiques
qui ne demandent qu’à être aidées pour s’épanouir. |104
LAVAL. — Andrée Desornes, vingt-deux ans, fille-mère, tuberculeuse.
HORTENSE, levant la tête. — Plaît-il ? Je n’ai pas
compris. LAVAL, répétant. — Andrée
Desornes, vingt-deux ans, fille-
mère...
HORTENSE, d’un ton sec. — Je dirai à ma nouvelle
secrétaire qu’elle ne consigne jamais sur ses listes les infortunes de ce
genre-là. Une fille-mère ! Je ne pourrai jamais m’intéresser aux épaves du
vice, ni me résoudre à adoucir les souffrances de ces femmes, considérant
qu’elles sont les légitimes expiations de leur inconduite.
LAVAL. — Ma bonne, tu exagères.
HORTENSE. — Non, je suis juste, malgré mon apparente sévérité.
Filles galantes, filles-mères, pour moi, c’est tout comme. Les unes et les
autres facilitaient l’incroyable relâchement de nos mœurs ; l’union libre,
le divorce, la protection des filles-mères, toutes ces sottises, toute cette
fausse sentimentalité ne servaient qu’à encourager la mauvaise conduite. Et
la France se mourait de la corruption des masses ! Nos enfants ne pouvaient
sortir sans risquer de tomber dans les filets tentateurs de toutes ces femmes
perfides. Dans l’orgie sombraient toutes les intelligences, toutes les énergies.
Le sexe féminin, s’offrant à l’enchère, viciait le sang de notre pays, nous
faisait méconnaître à l’étranger, autorisait toutes les espérances sur notre
chute rapide. Et si la guerre n’était pas faite de telles horreurs, elle serait
une juste expiation.
La bonne
entre pour servir le thé.
LAVAL. — Tu as peut-être raison. Mais l’heure n’est plus
de maudire, il faut pardonner, il faut |105 régénérer. Songe à cette jeune femme qui se meurt dans
un taudis, à cet enfant qui pleure parce qu’il a faim et froid tandis que
son père, quelque pâle faubourien, peut-être, nous fait de sa poitrine un
rempart contre les bandits. Que penserait-il de nous s’il savait que nous
laissons
mourir le fruit de son amour et celle qu’il aimait plus que lui-même, peut-être
!
HORTENSE. — Je te répète que je considère la guerre comme
une juste expiation qui frappe malheureusement sans distinction bons ou mauvais.
Quant à la femme, elle a failli une fois, elle faillira une seconde, le vice
est incurable.
LAVAL. — J’en connais, cependant, qui, une fois mariées,
font d’honorables mères de famille.
HORTENSE. — Quelques rares exceptions ! LA BONNE. — Madame est servie.
Hortense
et son mari viennent s’asseoir près de la table à thé où attend Marnier. Une
sonnerie retentit, annonçant un visiteur. La bonne sort.
HORTENSE. — Ce doit être ma nouvelle secrétaire. (Consultant
sa montre.) Elle est exacte au rendez-vous.
La
bonne rentre et tend une carte à Hortense. HORTENSE.
— Oui, c’est elle. Faites entrer.
SCÈNE
III.
SOLANGE,
LES MEMES.
La jeune
fille fait quelques pas et s’arrête hésitante.
HORTENSE, se lève ainsi que les deux hommes, s’avance
vers elle et lui tend les deux mains. — Solange Morteuil, n’est-ce pas
? Vous êtes ici la |106 bienvenue. Mme Leblanc, qui vous envoie,
m’a exposé brièvement qui vous étiez et ce que vous aviez souffert ; aussi
ma bienveillante amitié vous est acquise. Veuillez donc nous considérer comme
de bons amis qui s’efforceront, si vous acceptez de partager leur vie, de
vous faire oublier les souffrances de votre captivité.
SOLANGE. — Oh ! merci, Madame. Il est doux de sentir autour
de soi une affection sincère lorsqu’on a vécu les cruelles tortures pratiquées
dans les camps allemands. Mais... (hésitante) Mme Leblanc m’avait promis d’être présente à ce rendez-vous.
Je..., je suis peut-être
en avance... Excusez mon indiscrétion... Je puis revenir un peu plus tard...
lorsqu’elle sera là...
HORTENSE. — Mais non, ma mignonne, sa présence n’est pas
obligatoire, puisqu’il s’agit de régler une simple question d’organisation
de vie entre vous et moi. Je vous répète que vous êtes chez des amis, de bons
amis qui vous veulent beaucoup de bien. Tenez, je vous présente. Solange Morteuil,
une victime des Allemands. M. Laval, mon mari ; M. Marnier, un de nos bons
amis.
Les deux
hommes saluent.
LAVAL. — Mademoiselle, être présentée par mon ami Leblanc
est déjà suffisant pour que vous nous soyez sympathique. Mais
le
fait d’avoir été torturée par les bandits qui ont tué notre fils (mouvement
nerveux de Solange) crée, entre vous et nous, un lien bien plus puissant
encore qui me fait espérer que notre entente sera parfaite.
SOLANGE. — Monsieur, je suis confuse de tant d’amabilité
pour moi qui vous suis une inconnue. Mais si la haine peut, comme l’amour,
être un lien, sachez que ma haine à l’égard de nos |107 ennemis est sans borne pour tout le mal qu’ils m’ont
fait, pour tous les crimes qu’ils ont commis, pour tous les innocents qu’ils
ont martyrisés.
HORTENSE, lui offrant une chaise. — Eh bien ! Puisque
l’entente est parfaite, asseyez-vous et acceptez un peu de thé.
SOLANGE. — Oh ! Madame, c’est de l’indiscrétion.
Elle va
s’asseoir à la place que lui indique Hortense tandis que les deux hommes se
placent de l’autre côté de la table, en s’en écartant un peu.
LAVAL, à Marnier, très bas — Je connais cette frimousse-là
! mais je ne suis pas fichu de lui donner un nom.
Pendant
ce temps. Hortense aide Solange à quitter sa fourrure et la dépose sur un
canapé.
LAVAL, à Solange qui enlève lentement ses gants.
— Où étiez- vous, Mademoiselle, lors de la déclaration de guerre ?
SOLANGE. — À Bruxelles, Monsieur.
LAVAL, sursautant. — Vous êtes donc de nationalité
belge ?
SOLANGE. — Non, Monsieur, je suis Française ; mais la destinée
m’avait amenée depuis six mois dans cette ville où je donnais des leçons
de sténographie pour gagner ma vie.
HORTENSE. — Vous fûtes orpheline très jeune, je crois ?
SOLANGE, répondant d’une voix hésitante.
— Vraiment,
Madame,
je suis de plus en plus confuse du fâcheux contre- temps qui fait que Mme Leblanc n’ait pu me présenter
elle- même... |108
HORTENSE, un peu étonnée. — Mais je n’en comprends
pas la raison ?
LAVAL, d’un ton amical. — Mademoiselle me
paraît timide ! Là est certainement la cause de ses hésitations. Cependant,
ne voyez pas en nos questions un désir d’information qui serait peu discret,
mais seulement une réelle preuve de sympathie et de confiance.
SOLANGE. — C’est précisément votre
grande bienveillance qui m’intimide un peu ! Mais je suis sotte. (Riant
timidement.) Je vais me présenter moi-même.
Elle trempa
ses lèvres dans la tasse.
LAVAL, toujours bas à Marnier. — Cette confusion,
cette coïncidence !
Il semble
profondément réfléchir, puis fixe attentivement la jeune fille.
SOLANGE. — Ma mère mourut en me mettant au monde et mon
père me fit élever au couvent où j’acquis une solide
instruction.
Fort heureusement, car il se remaria et ne s’occupa plus de moi. À dix-sept
ans, je me trouvai donc seule à Paris, sans fortune, obligée de subvenir à
mes besoins. Grâce à ma connaissance approfondie de la sténographie, je pus
toujours gagner honorablement ma vie soit à Paris, soit à Bruxelles où je
suivis (hésitante) mon...
LAVAL, l’interrompant brusquement. — Vous n’avez
pas songé à regagner la France dès la mobilisation ?
SOLANGE, paraît surprise de l’interruption, hésite,
puis répond. — Je croyais comme tout le monde une rapide victoire et me
trouvais très fatiguée à ce moment-là !
HORTENSE. — Les Prussiens vous surprirent donc à Bruxelles
? |109
SOLANGE. — Non, Madame. Mon odyssée fut beaucoup plus lamentable.
Et vous comprendrez mieux en la connaissant à quel point je hais les bandits
qui, après avoir tué mon... fiancé, ont failli me ravir l’honneur !
HORTENSE. — Ah ! vous aviez un fiancé ?
SOLANGE. — Un être noble, un être fier ! J’ai appris sa
mort, il y a quelques jours à peine, au retour de ma captivité, par un officier
qui me cherchait depuis de longs mois. Le souvenir de celui que j’aimais restera
éternellement gravé dans ma mémoire et je mourrai, heureuse d’aller le rejoindre,
lorsque j’aurai accompli tout mon devoir de...
LAVAL, l’interrompant à nouveau brusquement. — Française
! C’est très bien, Mademoiselle, de ne pas vous laisser abattre par la
fatalité. L’heure est venue d’être forte et d’oublier
momentanément
ses souffrances personnelles pour songer à la grande blessée, la France !
SOLANGE, paraît à nouveau étonnée
de cette interruption, puis pensive elle continue.
— Oui, il faut que je réagisse, que je sois plus forte que la fatalité,
que je pleure en cachette pour éviter... Mais que dis-je ! que vous raconté-je
là ! Pardonnez-moi, j’ai tant souffert !... Enfin, voici le récit de l’atroce
aventure. Lorsque je sus les Allemands maîtres de Liège et de Namur, je me
décidais à fuir, malgré ma faiblesse, non pas que j’eusse peur pour ma vie,
mais parce que, sachant qu’ils violentaient les femmes et tuaient les enfants,
je craignais pour… (hésitante) pour mon…
LAVAL, même jeu. — Votre honneur ! Cela se
comprend. Ces bandits ne respectent rien ! |110
SOLANGE, regarde Laval avec étonnement, puis continue,
d’une voix lente. — Donc, je voulus fuir. Mais l’encombrement des trains
était tel qu’il ne fallait pas compter sur ce moyen de salut. La Providence
me mit heureusement en présence d’un brave négociant, ami de mon fiancé, qui
fuyait en auto avec sa famille et m’offrit de m’emmener avec mon... unique
trésor.
Elle trempe
ses lèvres dans la tasse.
LAVAL, tout bas à Marnier qui opine de la tête.
— Il y a un enfant dans ce drame.
SOLANGE. — Le début du voyage fut relativement bon, mais
à quelques kilomètres de Charleroi, je ressentis un violent malaise et m’évanouis.
Lorsque je revins à moi quelques heures après, j’étais couchée dans le lit
d’une brave et généreuse fermière. Je demandais de suite à reprendre le chemin
de la
France.
Hélas ! je n’en avais plus la force. Alors je suppliais mes charitables compagnons
de poursuivre leur route, et, le cœur brisé, mais consciente que le sacrifice
était nécessaire, je les vis partir, leur confiant tout ce qu’il me restait
de cher au monde. Huit jours après, la bataille faisait rage autour de la
ferme. Les filles de la fermière m’en apportaient les échos sur mon lit de
douleur. C’est ainsi que je sus les charges héroïques de nos soldats d’Afrique
dont la vaillance ne pouvait avoir raison au nombre de leurs ennemis. J’appris
aussi la retraite et je vécus, dès lors, dans des transes épouvantables et
en proie aux plus sinistres pressentiments qui ne devaient pas tarder, d’ailleurs,
à se réaliser. Un soir, trois officiers se présentèrent à la ferme et ordonnèrent
à la fermière et à ses filles de préparer un festin. Vous décrire ce que fut
cette orgie n’est pas possible. Honteusement, ils traitèrent des femmes qui,
quelques instants
auparavant,
donnaient des soins à leurs |111 soldats blessés. Et
eux,
monocles à l’œil, des fleurs à la boutonnière de leur dolmen, chantaient et
buvaient, menaçaient de mort les malheureuses jeunes filles terrorisées qui
devaient servir, nues, leur monstrueuse orgie et subir leurs odieux caprices
!
HORTENSE. — C’est affreux, j’eusse préféré la mort.
SOLANGE. — Hélas ! ce n’était pas possible. Les malheureuses
ne pouvaient pas échapper à ces brutes avinées. Quant à moi, l’espoir qui
me berçait de ne pas être aperçue des bandits fut de courte durée ; en effet,
la porte de la chambre où je reposais s’ouvrit tout à coup sous la poussée
d’un corps qui vint s’étaler sur le parquet : c’était un des officiers qui,
ivre- mort, avait, sans doute, cherché un appui contre la porte qui céda sous
son poids. Un instant, il resta ainsi vautré, grognant et jurant ; puis il
parvint à se redresser et fit, du regard, le tour de la chambre ; lorsque
nos yeux se rencontrèrent, je sentis courir par mon être un frisson d’épouvante...
Je me demande parfois
comment
ma raison ne sombra pas devant l’horreur de la situation.
LAVAL. — De tels souvenirs vous sont cruels. C’est
abusif de notre part que de vous les faire rappeler !
SOLANGE. — Non, Monsieur. C’est un peu dégonfler mon pauvre
cœur meurtri que dire ce que j’ai souffert.
HORTENSE. — Encore un peu de thé, de liqueur ?
SOLANGE. — Merci, Madame. D’ailleurs, j’ai fini. La scène
qui suivit se déroula en quelques |114 minutes : l’homme me fixa
de son regard troublé par l’ivresse, puis un rugissement semblable à celui
que doit pousser un fauve qui découvre une proie, sortit de sa poitrine et
d’un bond fut près du lit, rejeta les draps qui me couvraient et se laissa
pesamment choir sur moi. Paralysée par la terreur, j’étais restée jusqu’alors
sans faire un
mouvement
; mais lorsque je sentis sur mon visage le souffle fétide de la brute, lorsque
sur mon corps, ses mains voulurent se poser, je retrouvais soudain l’usage
de mes membres ; de la main droite, je cherchai à le repousser et, tout à
coup, je sentis sous mes doigts le froid de l’acier d’un revolver à moitié
sorti de l’étui, accroché à son ceinturon. Je ne réfléchis pas une seconde
aux conséquences de ce que j’allais faire et, tirant à moi l’arme vengeresse,
je la braquais sur le flanc gauche de l’homme qui me pressait de plus en plus
fortement et, par trois fois, j’appuyais sur la gâchette. Foudroyé, il roula
au bas du lit, m’entraînant dans sa chute, et je m’évanouis dans une mare
de sang. Lorsque je revins à moi, plusieurs heures après, j’appris coup sur
coup de la bouche d’un sous-officier chargé de me surveiller, que j’avais
été condamnée à mort par les officiers amis de ma victime, puis graciée par
un général, survenu inopinément, et mis au courant de l’orgie qui
devait si
tragiquement
se terminer. Mais, sans pitié pour ma faiblesse, les bourreaux m’acheminèrent
d’étapes en étapes jusqu’à ce camp de misère, perdu dans le Hanovre où, mise
au cachot, je subis les plus cruelles humiliations, où j’eus faim, où j’eus
froid, où j’implorais quotidiennement la mort de me délivrer. Notre généreuse
patrie obtint enfin ma libération plus de vingt mois après mon internement.
HORTENSE. — De telles souffrances sont imméritées et, en
attendant que sonne pour l’Allemagne |113 l’heure du châtiment, nous
allons nous efforcer, Mademoiselle, de vous faire oublier le cauchemar tragique,
les douloureuses épreuves de votre long calvaire, l’irréparable deuil de
votre amour ! En échange, votre rôle ici sera, non seulement d’être une dévouée
secrétaire, mais encore une charmante et enjouée compagne qui fera oublier,
un tout petit peu, aux deux vieillards que nous serons bientôt, la
cruelle
perte de leur enfant, l’anéantissement de leurs espérances, de leurs beaux
rêves. Nous allons être amies, n’est- ce pas ?
SOLANGE, avec effusion, tendant ses deux mains à Hortense.
-
Pourrait-il en être autrement, Madame, pour
tant de bienveillance !
LAVAL, à Marnier. — Il faut que
j’aie le cœur net au sujet de cette jeune fille. (Une sonnerie de téléphone
retentit.) On m’appelle au téléphone. Deux minutes seulement.
MARNIER, se levant. — J’en profite pour faire mes adieux à ces dames ; j’ai un rendez-vous
au Ministère des Colonies. Je te suis. Madame… Mademoiselle…
HORTENSE. — Au revoir, cher ami, et à bientôt.
SCÈNE
IV.
HORTENSE, SOLANGE.
Toutes deux
sont debout.
HORTENSE, tenant les deux mains de Solange dans les
siennes. — Eh bien, c’est convenu. Si vous vous plaisez près de nous,
vous pourrez, dès ce soir, prendre possession de la chambre qui vous est réservée.
Votre travail consistera à |114
dépouiller
le courrier, à organiser notre itinéraire quotidien de visites charitables.
L’après-midi, vous m’accompagnerez chez nos pauvres, et le soir… eh bien !
si vous aimez les cartes, ce sera un plaisir pour mon mari que de faire une
partie avec vous. Quant à vos gages, vous les fixerez vous-même.
SOLANGE, hésitante. —
Madame, je suis confuse de tant de bonté ! Mais… je crois comprendre de plus
en plus nettement que Mme Leblanc
ne vous a pas mise au courant de ma réelle situation.
HORTENSE. — Expliquez-vous. À mon tour de ne pas comprendre.
SOLANGE, toujours hésitante.
— Madame, dans tout l’emploi du temps que vous me fixez, il n’est pas questions
des heures de loisir dont j’ai besoin pour l’éducation de… mon enfant.
HORTENSE, reculant brusquement. — Vous dites ? Votre
enfant ! Ah : je comprends vos hésitations, car enfin, puisque vous n’êtes
pas mariée, cet enfant est le fruit d’une liaison non légitime !
SOLANGE, joignant les mains. — Vous l’ignoriez donc, Madame ?
HORTENSE. — Si je l’avais su, jamais vous n’auriez mis
les pieds dans cette demeure.
SOLANGE, suppliante. —
Mon crime est donc bien grand pour que vous m’infligiez un tel affront ?
HORTENSE. — Il est irréparable à mes yeux. Outre votre
bonheur perdu, vous avez donné la vie à un pauvre petit être qui traînera,
durant son existence entière, la tare ineffaçable d’être
|115 un bâtard, d’être un malheureux enfant ne pouvant
pas dire qui fut son père !
SOLANGE, se redressant, énergique.
— Si, Madame, il saura qui fut son père, car avant de mourir, l’être noble
et généreux, le vaillant soldat qui tomba pour la France, songea à ceux qu’il
laissait dans le déshonneur et remit à un homme dont la loyauté ne peut être
suspectée la preuve de sa paternité.
HORTENSE. — Un tardif scrupule de conscience ne peut légitimer
une situation telle que la vôtre. Quel motif empêcha donc votre amant de vous
épouser avant votre chute ? Sans doute la crainte d’une mésalliance. Et puis,
est-ce qu’on épouse sa maîtresse ?
SOLANGE. — Madame, c’était son plus grand
désir. Mais seule l’opposition de ses parents qu’il prévoyait irréductible
l’en empêcha et il résolut d’attendre que sa situation soit définitivement
établie pour respectueusement solliciter leur consentement ou… passer outre.
HORTENSE, éclatant. — Passer outre ! Ah ! voilà
bien le grand mot lâché. Vraiment, ma sympathie s’égarait en se portant sur
vous. Je ne pouvais pas prévoir, il est vrai, que vous étiez une de ces femmes
sans cœur, sans pitié, qui auriez l’audace d’amener la discorde entre un fils
et sa mère ! Vous êtes donc une de ces intrigantes qui, sans pudeur, volez
le nom de nos enfants après en avoir vicié l’âme ?
SOLANGE, suppliante. —
Oh ! pitié, Madame. Ne soyez pas aussi injuste, aussi cruelle ! Vous ne devinez
donc pas que… (s’interrompant brusquement) Non, vous ne pouvez pas
comprendre. (Avec énergie) Madame, j’étais honnête et courageuse. Un jeune homme
vint qui me promit son nom, sa vie, si je voulais l’aimer. Je me |116 confiais à la noblesse de son
cœur,
je m’abandonnais sans méfiance au charme de ses paroles et nous nous aimâmes
éperdument, sans bas calcul d’intérêt, sans honte, simplement parce que nos
cœurs battaient du même rythme, vibraient des mêmes sensations ; parce que
toutes nos pensées s’associaient, parce que nos jeunesses se désiraient d’une
pareille ardeur. Eus-je tort de céder à son caprice, un soir de printemps
que l’air était tout imprégné d’un parfum de fleur, qu’un grand souffle d’amour
et de vie passait sur la terre, rendant aux forêts le chant des oiseaux, aux
mansardes des pauvres le rayon de soleil, aux cœurs de vingt ans l’éternel
frisson ! Peut-être ! Mais j’avais confiance en celui que j’aimais. Et pourquoi,
lorsqu’il m’eut prise, toute, lorsqu’en mon sein eut frémi le fruit de notre
commun amour, lorsqu’il eut façonné à son image pendant trois années l’enfant
qu’il avait créé, pourquoi n’aurais-je pas eu le droit d’exiger de lui son
nom, son aide, sa vie ?
HORTENSE. — Pourquoi ? Mais en vérité, parce qu’il serait
trop facile d’obtenir de cette façon la légitimité des plus monstrueuses mésalliances.
Mais parce que la plus hypocrite, la
plus
vicieuse des femmes n’aurait qu’à jouer habilement la comédie de l’amour
vis-à-vis du jeune homme dont elle veut le nom ! Quelques sourires, quelques
baisers qui sauraient se faire savamment désirer, au besoin, l’inévitable
enfant pour compléter la petite comédie sentimentale et le tour serait joué
? Mademoiselle, une femme qui se donne avant d’avoir eu son union bénie par
le prêtre ou tout au moins autorisée par la loi est une intrigante ou une
vicieuse, je le répète. D’une façon comme d’une autre, c’est une femme
dangereuse et qui ne
mérite
pas de pitié. |117
SOLANGE, pâle, se dirigeant
vers la porte. — Pas un mot de plus, Madame. Vous pourriez un jour regretter
vos injustes paroles ; vous pourriez souffrir d’avoir meurtri un pauvre cœur
d’amante et de mère. Craignez que le Dieu de miséricorde et de bonté qui
nous jugera…
HORTENSE. — Dieu ! Ne voyez-vous pas qu’il châtie la France
que le vice perdait ? Ne comprenez-vous pas que vos souffrances sont la juste
expiation de votre faute ? Puisse-t-il vous pardonner !
SCÈNE
V.
HORTENSE, seule.
Elle revient
lentement vers la table où elle écrivait.
Ai-je
bien fait de chasser cette jeune fille ? C’est étrange ; j’ai comme un remords
qui m’oppresse. Cette pauvre enfant a souffert… Elle paraît honnête, courageuse.
Que va-t-elle devenir avec son petit ?... (Elle reste un instant pensive,
puis se redresse brusquement.) Non, c’est impossible. Une fille-mère,
chez moi ! Que penseraient mes amies ! (Elle s’assied et se met à écrire.)
Voyons, où en étais-je restée ? Andrée Desornes, fille… Non… Madeleine Dodé…
Laval entre
en coup de vent et l’interrompt bruyamment, en frappant joyeusement dans
ses mains.

SCÈNE
VI.
HORTENSE, LAVAL, puis LA BONNE et LE PETIT PIERRE.
LAVAL. — Veux-tu bien me laisser ces écritures ! |118 Il
faut qu’aujourd’hui et demain, toute la maison soit en fête ; j’ai donné congé
aux employés. Ah ! dès que cette jeune fille m’eut apparu, j’ai eu l’intuition
très nette que c’était du bonheur, qui nous arrivait. Mais je ne le prévoyais
pas si grand. Et puis, la mâtine est jolie et si le petit gars leur ressemble,
il doit être à croquer !... Hortense, je suis fou de joie... Mais toi-même
? Tu ne me dis rien ?...
HORTENSE, lentement. — Je ne comprends pas un traître
mot à ton verbiage !
LAVAL, surpris et brusquement soucieux. — Voyons
! Ta nouvelle secrétaire ! Qu’elle ait eu devant Marnier la délicatesse de
taire sa véritable situation, je l’admets. Mais lorsque tu fus seule, elle
aurait dû te sauter au cou, te crier sa joie de faire partie de notre famille
!
HORTENSE, se levant. — Veux-tu me parler de cette
fille que m’a envoyée Mme Leblanc
?
LAVAL, inquiet. — Mais oui ! De Mlle Solange !
HORTENSE, froidement. — Cette jeune personne, mon
ami, n’est pas du tout intéressante. Elle m’a, en effet, avoué qu’elle avait
un enfant, je l’ai, de ce fait, rapidement éconduite.
LAVAL. — Malheureuse ! Qu’as-tu fait ! HORTENSE. — Ce que m’ordonnait ma conscience.
LAVAL, éclatant. — Ta conscience ! Mais comprends
donc que tu as commis une infamie ! Que cette jeune femme, Hortense, avait
droit à notre affection, plus encore, à notre respect ! Sache que Paul va
nous maudire si, de là-haut, il juge nos actes car cette femme que tu as chassée,
qui a gardé le silence sous ton injure, |119 c’était sa maîtresse ! Et l’enfant est le fils
de
Paul Laval, notre petit-fils à nous deux ! Comprends-tu quels tourments nous
seront réservés si, s’abandonnant an désespoir, cette femme est à jamais perdue
pour nous.
HORTENSE, très pâle, s’appuyant contre la table.
— Si cruelle que soit cette nouvelle épreuve, je l’accepterai, sans faiblesse,
comme venant de Dieu.
LAVAL. — C’est toi qui parles ainsi ! Toi dont le
cœur est d’or, toi qui consoles sans jamais te lasser des souffrances d’autrui
! Non ! Tu te trompes, sur tes propres sentiments. Ton cœur t’eut dit de
pardonner et non pas de maudire ! Mais, orgueilleusement, tu veux te montrer
capable de tout faire plier sous l’inflexibilité de tes principes. Tant pis
si ton cœur se déchire, si les sanglots t’étouffent : tu n’as pas failli
à tes principes ! Et, pourtant, n’en vois-tu pas en ce moment, la grande
erreur ! Tes amies et toi-même jugez les malheureuses qui sont tombées avec
sévérité et vous les condamnez irrémédiablement sans songer que, dans bien
des cas, les seuls et vrais coupables sont vos propres enfants. Qu’ils s’amusent,
eux, et surtout, qu’ils vous le laissent ignorer ! Mais, elles, qui ne peuvent
pas cacher leur faute, vous les repoussez, vous les acculez à la mort ou,
ce qui est pis, au déshonneur. Et si vous croisez sur votre route une de
ces malheureuses qui, tombées trop bas pour se relever, s’offrent à vos enfants,
pour un morceau de pain et détruisent leur santé, vous lui jetez l’anathème,
vous la maudissez, sans songer qu’un peu de pitié, d’aide affectueuse, lui
eût évité l’irrémédiable chute. Hortense, que va devenir cette malheureuse,
livrée à elle-même, qui doit maudire la destinée par la
faute
de notre fils ? |120 Que deviendra l’enfant, sans
père pour l’élever
dans
le chemin de l’honneur ? Ne sera-t-il pas un de ces êtres tragiques que la
destinée rend, à force de les frapper, semblables à des bêtes fauves qui hurlent
vengeance après l’humanité… Oh ! pourquoi me suis-je absenté ! Pourquoi ai-je
répondu à l’appel de mon ami Leblanc qui, connaissant l’idylle de longue date,
n’avait jugé à propos de nous la dévoiler qu’après avoir connu l’impression
produite sur nous par la jeune fille ! Ah ! Paul ! Paul ! Pardonne-nous…
Il tombe
sur un fauteuil en sanglotant tandis qu’Hortense réfléchit.
La porte
s’ouvre tout à coup laissant passage à la bonne qui tient par la main un bambin
de quatre à cinq ans, aux cheveux bouclés. Laval se lève d’un bond.
LA BONNE. — Madame, un fâcheux
incident vient de se produire. La jeune femme s’est évanouie tout à coup en
revenant à la cuisine chercher cet enfant qu’elle nous avait priées de garder
un instant. Avec l’aide de Gertrude, je l’ai couchée sur le lit de M. Paul.
Mais le petit réclame sa maman ! Il ne cesse de pleurer et je ne sais comment
le calmer.
LAVAL, se précipitant vers lui. — Bonheur ! Jamais
je n’aurais pu supporter cette nouvelle épreuve. (Il le saisit, le soulève
et l’embrasse) Quel beau petit gars et comme il ressemble à Paul ! Voyons,
petit, dis-moi, voudrais-tu rester près de moi ?
PETIT
PIERRE, timidement. — Est-ce que tu es mon grand- père ?
LAVAL. — Oui. Et voici ta grand’mère.
PETIT PIERRE, la regardant
avec émotion. — Petit père me disait toujours de bien vous aimer lorsque
je vous verrais. Aussi
je
veux bien |121
rester avec vous à condition que maman reste également.
De grands
cris retentissent au-dehors. La bonne ouvre la fenêtre. On entend des camelots
qui crient : L’Intransigeant, la Presse,
la Grande Victoire française ! La foule chante
la Marseillaise et le Chant du Départ.
LAVAL, tendant l’enfant à Hortense. — Tu disais
que Dieu voulait punir la France et le voici qui nous donne la victoire !
Ne seras-tu pas aussi généreuse que lui ? Tiens ! aime cet enfant, façonne-lui
un cœur bon et noble. Et surtout pardonne à la génération passée pour que
la future soit meilleure. Vois-tu, ce sont ceux-là qui pourront profiter du
sang que leurs pères ont versé. Il faut qu’ils soient dignes de leur tâche.
HORTENSE, le regarde un instant, puis le saisit brusquement
et l’embrasse. — Allons, viens, mon petit gars, embrasser ta grand’mère.
LAVAL, les contemplant. — C’est parfait. Moi, je
vais chercher Solange.
RIDEAU.
4 août 1916.
BERNARD GINESTE
TERRIER FRÈRES…
UNE HISTOIRE ÉTAMPOISE
1884-1934
ÉTAMPES
CORPUS ÉTAMPOIS 2016
Terrier
Frères… une histoire étampoise
CINQUANTE DOCUMENTS

-
Origine des Terrier d’Étampes
Denis Terrier,
né le 2 septembre 1832 à Clermont (Haute- Savoie), s’installe comme charpentier
à Annecy où il épouse le 1er octobre
1857 Louise Excoffier (1835-1891), et décèdera le 2 juillet 1912, âgé de
79 ans.
Le
couple aura sept enfants : 1° Louis (1858-1895)3 ; 2° Jean-
Claude
(1860-1925) ; 3° François Joseph (1864-1897) ; 4°
Franceline
(née en 1866) ; 5° Léon Francis (1869-1937) ; 6°
Henri
Claudius (1871-1921) et 7° Auguste Jean François (1873-
1932).
3 À ne pas
confondre avec son contemporain et homonyme Louis Terrier (1854-1895), aussi
né à Annecy, député-maire de Dreux et ministre du commerce et de l’industrie
en 1893.
Quatre
de ces enfants s’installeront à Étampes, ou du moins collaborèrent étroitement
à l’hebdomaire local L’Abeille d’Étampes : Louis, Jean, Léon et Auguste.
C’est ceux qui nous intéressent ici. Il ne faut pas confondre le troisième
d’entre eux, Léon Francis Terrier, avec son neveu et homonyme, l’auteur des
Nouvelles et Contes de l’Arrière que nous venons de rééditer,
à savoir Léon Louis Terrier, fils de Jean, alias Léon Terrier-Mugnier.
-
Synthèse sur chacun des sept Terrier
Nous récapitulons
ici l’état civil des sept enfants Terrier tel que nous avons pu l’établir,
apparemment pour la première fois, d’après la longue série de pièces justificatives
qui suivent, en soulignant aussi les liens de la plupart d’entre eux avec
Étampes tels que les révèlent ces mêmes documents.
-
Louis Terrier, né
le 27 juin 1858 à Annecy (Haute- Savoie), marié à Louise David le 7 août 1893
à Tréméven (Finistère), mort le 7 mai 1897 à Vichy (Allier).
Collaborateur
de L’Abeille d’Étampes depuis 1884, il meurt à 39 ans, rédacteur en
chef de cette Abeille d’Étampes, depuis Paris, et en même collaborateur
du Journal des Débats, en même temps que directeur de L’Union Agricole
et maritime de Quimperlé (Finistère).
Ami intime
de Harry Alis et d’Anatole Le Braz, auteur lui- même d’un recueil de poèmes
en patois savoyard, officier de l’ordre tunisien du Nicham Iftikhar de Tunisie,
de l’ordre royal du Cambodge et officier d’Académie, il laissait une veuve
et deux enfants en bas-âge.
-
Jean Claude Terrier,
né le 28 février 1860 à Annecy, marié avec Joséphine Décarroz le 25 avril
1885 à Annecy, mort le 7 juin 1936 à Annecy.
D’abord
et longtemps imprimeur à Annecy il rejoint au début de 1914 ses frères à Étampes
pour y diriger l’imprimerie Terrier frères, c’est-à-dire celle de
L’Abeille d’Étampes, jusqu’à sa mort survenue en 1936.
Résidant
à Étampes 4 rue de la Plâtrerie, il meurt à 66 ans, laissant une veuve et
trois enfants.
Le deuxième
de ces enfants, Léon Louis Terrier (1889-1968), le suit à Étampes.
Il compose en 1916 un recueil de Nouvelles et Contes de l’Arrière édité
par l’imprimerie familiale. Après avoir été lui-même rédacteur à L’Abeille,
résidant alors 31 bis rue des Cordeliers, il succèdera à son père à la direction
de l’imprimerie Terrier.
-
François Joseph Terrier,
né le 25 avril 1864 à Annecy, marié à Élisabeth Joséphine Beaufrère le 3
janvier 1893 à Quimperlé (Finistère) où il meurt le 25 mars suivant.
Il rejoint
à Quimperlé son frère aîné Louis, venu y relancer une feuille républicaine
locale. Il y est journaliste et se marie à la fille d’un entrepreneur de peinture
du lieu, mais y meurt moins de trois mois plus tard à l’âge de 32 ans.
-
Franceline Terrier,
née le 17 octobre 1866 à Annecy, mariée à Jean Revil le 11 août 1888
à Annecy.
Bien que
son mari ait été un cordonnier d’Annecy, et que nous ne connaissions pas la
suite de sa vie, ni même à cette heure la date de sa mort, nous n’hésitons
pas à l’identifier à la voyageuse du même nom, Franceline Terrier qui donna
en 1912 à la Revue Coloniale un magnifique et copieux reportage
illustré
sur « La côte tripolitaine et la Cyrénaïque »4. Cette
région touche en effet à la Tunisie si chère à ses frères Louis et Auguste,
ce dernier ayant joué précisément un rôle considérable dans l’exploration
coloniale française en Afrique.

-
Léon Francis Terrier, né le
1er juillet 1869 à Annecy,
marié à Marguerite Charlotte Égré le 23 octobre 1899 à Étampes, où il meurt
le 14 mai 1937, des suites d’un accident de voiture à Ablis.
D’abord
correspondant d’une agence d’informations à Bizerte en Tunisie, il s’y lia
d’amitié au gendre du directeur de L’Abeille d’Étampes, Harry Alis.
Après la mort de ce dernier il lui succéda
comme rédacteur
au Journal des Débats, dont son frère aîné Louis Terrier était déjà
le secrétaire général en même temps que rédacteur politique de
L’Abeille d’Étampes.
Vers 1897,
Léon s’installa à Étampes comme comptable de l’entreprise Lecesne. À partir
de février 1914, il prit la direction de L’Abeille, qu’il conserva
jusqu’à la fin de 1934, tout en s’associant avec son frère Jean pour l’exploitation
de la Société d’imprimerie Terrier frères et Cie.
Il
épousa en 1899 une Étampoise qui lui donna deux fils5.
Nous le
trouvons d’abord au n°24 de la rue de la Juiverie (vers 1899), puis au 24-28
de la rue Sainte-Croix (vers 1901-1902), au n°1 de la rue Magne (au moins
de 1906 à 1909) et enfin 130 rue Saint-Jacques (au moins depuis
1911). Officier de
4 La dépêche
coloniale illustrée 12/4 (29 février 1912), pp. 43-54
5 Henry et
Olivier, qui étaient respectivement en 1937 géomètre et rédacteur à la Préfecture
de police.
l’instruction
publique, il s’était de fait investi dans la vie locale comme vice-président
de la société gymnique des Enfants de Guinette, ainsi que de la Section
des Vétérans, car il avait été mobilisé en 1914 comme G.V.C. à la gare
d’Étampes puis comme comme instructeur au Centre d’Instruction Physique de
Romorantin.
On lui
doit, outre naturellement de nombreux articles parus dans L’Abeille d’Étampes,
des contributions hebdomadaires à L’Écho de Savoie en patois d’Annecy,
sans parler d’un opuscule militaire de 16 pages imprimé à Étampes en 1916,
sur la lecture des cartes militaires.
-
Henri Claudius Terrier,
né le 8 août 1871 à Annecy, marié à Marie Louise Décarroz le 17 août 1895
à Annecy, mort le 5 mars 1921 à Étampes.
Ayant suivi
ses frères à Paris, où il fut journaliste, résidant dans le 5e arrondissement. Il travailla
longtemps dans les services administratifs du Journal des Débats, mais
aussi comme secrétaire administratif du Comité de l’Afrique Française dirigée
par son frère Auguste, ainsi que du Comité de l’Asie Française. Abattu par
une longue maladie, il vint en 1921 mourir chez son frère Jean à Étampes,
âgé de 49 ans, officier d’académie.
-
Auguste Jean François
Terrier, né le 11 juillet 1873 à Annecy, marié à Renée Charlotte Albertine
Lecesne le 7 janvier 1901 à Étampes, mort le 27 avril 1932 à Annecy.
Le benjamin
des Terrier fut aussi celui d’entre eux qui a connu la plus grande notoriété.
Sa bibliographe à elle-seule pourrait facilement occuper quelques dizaines
de pages. Nous ne nous y étendrons pas excessivement parce que les liens d’Auguste
avec le pays d’Étampes sont relativement ténus, même s’il a donné un assez
grand nombre de contributions, soit sous son nom ou sous le pseudonyme de
Paul Clermont, au
journal
local L’Abeille, propriété de son beau-père, puis de ses frères à partir
de 1914.
En effet
il se maria en 1901, à l’une des filles de l’imprimeur étampois Ollivier Lecesne,
et nous le voyons séjourner à demeure chez son beau-père 29 rue Saint-Jacques,
du moins en 1912 et 1913.

Retenons
ici seulement qu’Auguste Terrier a joué un rôle important dans l’exploration
et la colonisation de l’Afrique française, rôle qu’on lui a reconnu dès son
vivant, et pour lequel il a été fait même commandeur de la Légion d’honneur.
Il a beaucoup fait pour impulser, préparer, coordonner et valoriser les missions
d’exploration et de colonisation qui donnèrent vers cette époque à la France
un des plus vastes empires que l’histoire ait connus.
En la matière,
les intérêts de la science et de la patrie allaient de pair. D’une part,
en effet, seule une exploration méthodique et pour ainsi dire scientifique
de l’Afrique pourrait ouvrir la voie à la conquête de ces vastes territoires
inconnus, en prenant de vitesse les puissances rivales. Mais il fallait aussi
conquérir l’opinion publique, autant que mettre le monde devant le fait accompli.
C’est pourquoi il s’investit autant dans la coordination que dans la promotion
de ce vaste effort. Il ne se contenta pas d’organiser ou de coordonner des
voyages d’exploration — que pour certains il effectua lui-même. Il y consacra
aussi de nombreux ouvrages, bien des conférences, et
il fit des participations remarquées à des expositions coloniales
ou universelles du temps.
Quand on
feuillette L’Abeille d’Étampes de ces années-là, on ne manque pas d’être
étonné du nombre des articles qui y traitent la question coloniale sous tous
ses aspects. Partout en effet les frères Terrier participaient à cet immense
effort, en propageant l’idée coloniale non seulement dans les grands journaux
parisiens mais encore jusque dans les campagnes du Finistère et de l’Étampois.
-
Naissance
de Louis à Annecy (1858) 6
« N°107 — Terrier Louis — L’an mil huit cent cinquante-huit et le
vingt-huit du mois de juin à quatre heures et quart du soir, en la paroisse
de Notre-Dame, commune d’Annecy, a été présenté à l’Église un enfant de sexe
masculin né le vingt sept du mois de juin à huit heures et quart du soir en
cette paroisse, fils de Denis Terrier, charpentier de profession, demeurant
à Annecy, et de Louise Excoffier son épouse en légitime mariage, blanchisseuse
de profession, demeurant à Annecy. — L’enfant a été baptisé par moi vicaire
soussigné et a reçu le nom de Louis. — Ont été parrain Claude Excoffier, cultivateur
de profession, demeurant à Balloire, et marraine Louise Varay, domestique
de profession, demeurant à Annecy. — L’indication de la naissance et la réquisition
pour l’administration du baptême ont été faites par le père du nouveau-né.
— Signature du requérant [Signé :] Terrier Denis — Signature du curé,
recteur ou administrateur de la paroisse [Signé :] Descombes
vic. »
-
Naissance
de Jean à Annecy (1860) 7
« N°38 — Terrier Jean Claude — L’an mil huit cent soixante et le
vingt-neuf du mois de février à onze heures du matin, en la paroisse de Saint-Maurice,
commune d’Annecy, a été présenté à l’Église un enfant de sexe masculin né
le vingt huit du mois de février à onze heures du soir en cette paroisse,
fils de Denis Terrier, charpentier de profession, demeurant à Annecy et de
Louise Excoffier son épouse en légitime mariage, repasseuse de profession,
demeurant à Annecy. — L’enfant a été baptisé par monsieur l’abbé Porret vicaire
et a reçu les noms de Jean Claude. — Ont été parrain Claude Barut, charpentier
de profession, demeurant à Annecy, et marraine Louise Barut, ouvrière de profession,
demeurant à Annecy. — L’indication de la naissance et la réquisition pour
l’administration du baptême ont été faites par le père du nouveau-né. — Signature
du requérant [Signé :] Terrier — Signature du curé, recteur ou administrateur
de la paroisse [Signé :] Jorat curé. »
-
Naissance
de François à Annecy (1864) 8
« N°106
— Terrier François Joseph — L’an mil huit cent soixante-quatre et le vingt-six
du mois de avril à neuf heures avant midi, par devant nous Louis Chaumontel,
adjoint du
7 AD74 2E
360.
maire, délégué par acte du quinze mars mil huit cent soixante-
un, aux fonctions d’officier de l’état civil de la ville d’Annecy, arrondissement
d’Annecy, département de Haute-Savoie, a comparu le sieur Terrier Denis, charpentier,
fils de vivants Antoine Terrier et Claudine Dupont, né à Clermont (Haute-
Savoie) le deux septembre mil huit cent trente-deux, demeurant à Annecy,
rampe du Château, n°2, maison Dunand, lequel nous a présenté un enfant du
sexe masculin, qu’il nous a dit être né le vingt-cinq avril courant, à sept
heures du soir, dans la maison qu’il habite, de lui déclarant, et de la nommée
Excoffier Louise, son épouse, blanchisseuse, fille de défunt Jean-Pierre Excoffier,
et de vivante Marie Rachel, né à Talloires (Haute-Savoie) le dix-neuf mai
mil huit cent trente-cinq, demeurant avec son mari, auquel enfant il a déclaré
devoir être donnés les nom et prénoms de Terrier François Joseph. — Ces déclaration
et présentation ont été faites en présence de messieurs Bouvard François,
charpentier, âgé de trente-quatre ans, et Fontaine Jean Pierre, laboureur,
âgé de trente-quatre ans, domiciliés à Talloires. — Lecture faite du présent
acte, le déclarant et les témoins l’ont signé avec nous. — Les témoins. [Signé
:] Bouvard François — Fontaine Jean Pierre — Le déclarant [Signé :] Terrier
Denis — L’officier de l’état civil [Signé :] Chaumontel. »
-
Naissance
de Franceline à Annecy (1866) 9
« N°259
— Terrier Franceline — L’an mil huit cent soixante- six et le dix-sept du
mois d’octobre à onze heures avant midi, par devant nous François Duparc,
adjoint du maire, délégué par
acte du cinq septembre mil huit cent soixante-cinq aux fonctions
d’officier de l’état civil de la ville d’Annecy, arrondissement d’Annecy,
département de Haute-Savoie, a comparu le sieur Terrier Denis, charpentier,
fils de vivant Antoine Terrier et de défunte Claudine Dupont, né à Clermont
(Haute-Savoie) le deux septembre mil huit cent trente-deux, demeurant en
cette ville place du Théâtre, maison de ce nom, lequel nous a présenté un
enfant du sexe féminin, qu’il nous a dit être né le dix-sept octobre courant,
à trois heures du matin, dans la maison qu’il habite, de lui déclarant, et
de la nommée Excoffier Louise, son épouse, blanchisseuse, fille de défunt
Jean-Pierre Excoffier, et de vivante Marie Rachel, née à Talloires (Haute-Savoie)
le dix-neuf mai mil huit cent trente- cinq, demeurant avec son mari, auquel
enfant il a déclaré devoir être donnés les nom et prénoms de Terrier Franceline.
— Ces déclaration et présentation ont été faites en présence de messieurs
Vagnous Jean, menuisier, âgé de quarante-un ans, et Perroux Gaspard, serrurier,
âgé de trente-quatre ans, domiciliés à Annecy. — Lecture faite du présent
acte, le déclarant et les témoins l’ont signé avec nous. — Les témoins. [Signé
:] Vagnous Jean — G. Perroux — Le déclarant [Signé :] Terrier Denis — L’officier
de l’état civil [Signé :] Duparc. »
-
Naissance
de Léon à Annecy (1869) 10
« N°151
— Terrier Léon Francis — L’an mil huit cent soixante-neuf et le premier du
mois de juillet à onze heures avant midi, par devant nous Louis Chaumontel,
adjoint du maire, délégué par acte du dix juin mil huit cent soixante-neuf,
aux fonctions d’officier de l’état civil de la ville d’Annecy,
arrondissement d’Annecy, département de Haute-Savoie, a comparu le sieur Terrier
Denis, charpentier, fils de défunts Antoine Terrier et Claudine Dupont, né
à Clermont (Haute- Savoie) le deux septembre mil huit cent trente-deux, demeurant
à Annecy, place du Théâtre, maison de ce nom, lequel nous a présenté un enfant
du sexe masculin, qu’il nous a dit être né le premier juillet courant, à
quatre heures du matin, dans la maison qu’il habite, de lui déclarant, et
de la nommée Excoffier Louise, son épouse, blanchisseuse, fille de défunt
Jean-Pierre Excoffier, et de vivante Marie Rachel, née à Talloires (Haute-Savoie)
le dix-neuf mai mil huit cent trente-cinq, demeurant avec son mari, auquel
enfant il a déclaré devoir être donnés les nom et prénoms de Terrier Léon
Francis. — Ces déclaration et présentation ont été faites en présence de messieurs
Bouchet Pierre, sous-chef-de bureau à la mairie, âgé de vingt-sept ans, et
Salomon Joseph, appariteur de ville, âgé de trente-cinq ans, tous deux domiciliés
à Annecy. — Lecture faite du présent acte, le déclarant et les témoins l’ont
signé avec nous. — Les témoins. [Signé :] Bouchet — Salomon — Le déclarant
[Signé :] Terrier Denis — L’officier de l’état civil [Signé :] Chaumontel.
»
-
Naissance
de Henri à Annecy (1871) 11
« N°164
— Terrier Henri Claudius — L’an mil huit cent soixante-onze et le neuf du
mois d’août à onze heures avant midi, par devant nous Félix Brunier, adjoint
du maire, délégué par acte du trente-un mai mil huit cent soixante-onze, aux
fonctions d’officier de l’état civil de la ville d’Annecy,
arrondissement d’Annecy, département de Haute-Savoie, a
comparu le sieur Terrier Denis, charpentier, fils de défunts Antoine Terrier
et Claudine Dupont, né à Clermont (Haute- Savoie) le deux septembre mil huit
cent trente-deux, demeurant à Annecy, place du Théâtre, maison de ce nom,
lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, qu’il nous a dit être né
le huit août courant, à cinq heures du soir, dans la maison qu’il habite,
de lui déclarant, et de son épouse, Excoffier Louise, blanchisseuse, fille
de défunt Jean-Pierre Excoffier, et de vivante Marie Rachel, née à Talloires
(Haute-Savoie) le dix- neuf mai mil huit cent trente-cinq, demeurant avec
son mari, auquel enfant il a déclaré devoir être donnés les nom et prénoms
de Terrier Henri Claudius. — Ces déclaration et présentation ont été faites
en présence de Berger Jean François, comptable, âgé de trente-quatre ans,
et Pissard Charles Eugène, sous-chef de bureau à la mairie, âgé de vingt-trois
ans, tous deux domiciliés à Annecy. — Lecture faite du présent acte, le déclarant
et les témoins l’ont signé avec nous. — Les témoins. [Signé :] Berger — C.
E. Pissard — Le déclarant [Signé :] Terrier Denis — L’officier de l’état civil
[Signé :] F. Brunier. »
-
Naissance
d’Auguste à Annecy (1873) 12
« N°151 — Terrier Auguste Jean François — L’an mil huit cent soixante-treize
et le douze du mois de juillet à dix heures un quart avant midi, par devant
nous Félix Brunier, adjoint du maire, délégué par acte du trente-un mai mil
huit cent soixante- onze, aux fonctions d’officier de l’état civil de la ville
d’Annecy, arrondissement d’Annecy, département de Haute-
Savoie, a comparu le sieur Terrier Denis, charpentier,
fils de défunts Antoine Terrier et Claudine Dupont, né à Clermont (Haute-Savoie)
le deux septembre mil huit cent trente-deux, demeurant à Annecy, place du
Théâtre, maison de ce nom, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin,
qu’il nous a dit être né le onze juillet courant, à trois heures après-midi,
dans la maison qu’il habite, de lui déclarant, et de son épouse, Excoffier
Louise, blanchisseuse, fille de défunt Jean-Pierre Excoffier, et de vivante
Marie Rachel, née à Talloires (Haute- Savoie) le dix-neuf mai mil huit cent
trente-cinq, demeurant avec son mari, auquel enfant il a déclaré devoir être
donnés les nom et prénoms de Terrier Auguste Jean François. — Ces déclaration
et présentation ont été faites en présence de Berger Jean François, comptable,
âgé de trente-six ans, et Pissard Charles Eugène, sous-chef de bureau à la
mairie, âgé de vingt- cinq ans, tous deux domiciliés à Annecy. — Lecture faite
du présent acte, le déclarant et les témoins l’ont signé avec nous.
-
Les témoins. [Signé :] Berger — C. E. Pissard
— Le déclarant [Signé :] Terrier Denis — L’officier de l’état civil [Signé
:] F. Brunier. »
-
Mariage
de Jean à Annecy en 1885 13
«
N°32 — Terrier Jean-Claude et Décarroz Joséphine. — L’an mil huit cent quatre-vingt-cinq,
le vingt-cinq du mois d’avril, à cinq heures et demie du soir, à Annecy, chef-lieu
du département de la Haute-Savoie, dans la salle de l’état civil située en
l’hôtel-de-ville, par devant nous Félix Francoz, adjoint, délégué, par acte
du dix-neuf mai dernier, aux fonctions
d’officier
de l’état civil de la dite ville, se sont présentés, d’une part, Terrier Jean-Claude,
compositeur typographe, âgé de vingt-cinq ans, né à Annecy, le vingt-huit
février mil huit cent soixante, domicilié à Annecy, où il demeure, fils majeur
de vivants Denis Terrier, maître charpentier, et Louise Excoffier, son épouse,
ménagère, tous deux domiciliés en cette ville, présents et consentant ; d’autre
part, Décarroz Joséphine, lingère, âgée de dix-neuf ans, née à Annecy le
premier août mil huit cent soixante-cinq, domiciliée à Annecy, où elle demeure,
fille mineure de vivants François Décarroz, tailleur de pierres, et Geneviève
Vincent, son épouse, ménagère, tous deux domiciliés en cette ville, présents
et consentants ; lesquels, après avoir déclaré qu’il n’existe entre eux aucun
degré de parenté ni d’alliance, nous ont requis de procéder à la célébration
de leur mariage dont les publications ont été faites en cette ville les dimanches
douze et dix-neuf avril courant. La naissance des futurs étant inscrite aux
registres de l’état civil déposés au secrétariat de la mairie, nous avons
dispensé les parties de produire une expédition authentique des actes, à
l’appui de leur réquisition. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée,
nous, officier de l’état civil, après avoir reçu des futurs époux et des
personnes présentes pour autoriser le mariage, la déclaration qu’il n’a pas
été passé de contrat, avons donné lecture des dispositions du code civil
relatives au mariage ; après quoi, nous avons demandé aux requérants s’ils
veulent se prendre pour époux. Chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement,
nous avons prononcé qu’au nom de la loi, Terrier Jean-Claude et Décarroz
Joséphine sont unis par le mariage. Le tout a été fait publiquement aux lieu,
jour et heure indiqués et nous en avons immédiatement dressé acte en présence
de Terrier François Joseph, employé des ponts et chaussées, âgé de vingt-un
ans, frère germain de l’époux, Dufresne Louis, employé à la mairie, âgé de
vingt-six ans, Revil Jean, cordonnnier, âgé de vingt-cinq ans, et
Grandi
Édouard,
tapissier, âgé de vingt-quatre ans, ces trois derniers non parents avec les
nouveaux époux, tous quatre témoins majeurs, domiciliés en cette ville. Lecture
faite du présent acte, tous l’ont signé avec nous. — [Signé :] Josephine Decarre
[sic]
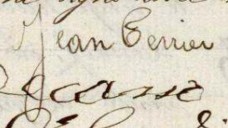
-
Jean Terrier — Terrier Denis —Décarroz
— Decarre [sic] — Revil Jean. — E. Grandi — Excoffier Louise
-
F. Terrier — L. Dufresne
-
L’officier de l’état civil, Francoz. »
-
Mariage
de Franceline à Annecy en 1888 14
«
N°42 — Revil Jean et Terrier Franceline. — L’an mil huit cent quatre-vingt-huit,
le onze du mois d’août, à cinq heures du soir, à Annecy, chef-lieu du département
de la Haute-Savoie, dans la salle de l’état civil située en l’hôtel-de-ville,
par devant nous Camille Dunant, premier adjoint, remplissant, en l’absence
du maire, les fonctions d’officier de l’état civil de la dite ville, se sont
présentés, d’une part, Revil Jean, maître cordonnier, âgé de vingt-neuf ans,
né à Annecy, le cinq juillet mil huit cent cinquante-neuf, domicilié à Annecy,
où il demeure, fils majeur de défunt Antoine Revil, en son vivant maître cordonnier,
domicilié en cette ville, décédé à Annecy-le-Vieux (Haute- Savoie) le trois
avril mil huit cent quatre-vingt-sept, et de survivante Jacqueline, dite
Franchette, Pétrod sa veuve, ménagère, aussi domiciliée en cette ville, présente
et consentante ; d’autre part, Terrier Franceline, sans profession,
14 AD74
4E 2812.
âgée
de vingt-un ans, née à Annecy le dix-sept octobre mil huit cent soixante-six,
domiciliée à Annecy, où elle demeure, fille majeure de vivants Denis Terrier,
maître charpentier, et Louise Excoffier, son épouse, ménagère, tous deux domiciliés
en cette ville, présents et consentant ; lesquels, après avoir déclaré qu’il
n’existe entre eux aucun degré de parenté ni d’alliance, nous ont requis
de procéder à la célébration de leur mariage dont les publications ont été
faites en cette ville les dimanches vingt- deux et vingt-neuf juillet proche
passé. À l’appui de leur réquisition les parties nous ont remis l’acte de
décès du père du futur ; la naissance des futurs étant inscrite aux registres
de l’état civil déposés au secrétariat de la mairie, nous avons dispensé les
parties de produire une expédition authentique des actes. Aucune opposition
ne nous ayant été signifiée, nous, officier de l’état civil, après avoir reçu
des futurs époux et des personnes présentes pour autoriser le mariage, la
déclaration qu’il n’a pas été passé de contrat, avons donné lecture de la
pièce produite ainsi que des dispositions du code civil relatives au mariage
; après quoi, nous avons demandé aux requérants s’ils veulent se prendre pour
époux. Chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous avons
prononcé qu’au nom de la loi, Revil Jean et Terrier Franceline sont unis
par le mariage. Le tout a été fait publiquement aux lieu, jour et heure indiqués
et nous en avons immédiatement dressé acte en présence de Revil Félix, cordonnier,
âgé de vingt-sept ans, frère germain de l’époux, Terrier Louis, journaliste,
âgé de trente ans, et Terrier Jean, compositeur typographe, âgé de vingt-huit
ans, frères germains de l’épouse, et Coutin Joseph, employé de commerce,
âgé de trente ans, non parent avec les nouveaux époux, tous quatre témoins
majeurs, domiciliés, les premier, troisième et quatrième, en cette ville,
et le deuxième, à Paris, lesquels, ainsi que les parties contractantes, nous
a affirmé par serment, conformément à l’avis du Conseil d’État du 30 mars
1808, que les vrais nom et prénom de la mère de l’époux sont :
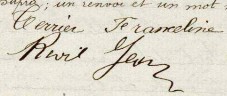
Pétrod
Jacqueline, et que c’est par erreur qu’elle a été désignée sous ceux de Pétrot
Jacqueline Françoise, dans l’acte de naissance de son fils, et Pétrod Fanchette,
dans l’acte de décès de son mari. Lecture faite du présent acte, tous l’ont
signé avec nous, à l’exception de la mère de l’époux, qui a déclaré être illettrée.
— [Signé :] Terrier Franceline — Revil Jean — Terrier Denis — F. Revil —
L. Terrier
—Jean Terrier — Terrier Louise — J. Cautin
C.
Dunant. »
-
Naissance
de Léon Louis à Annecy (1889) 15
«
N°142 — Terrier Léon Louis — L’an mil huit cent quatre- vingt-neuf, le dix-neuf
du mois d’août, à quatre heures et demie après-midi, par devant nous, Émile
Duparc, adjoint du maire, délégué, par acte du vingt-six novembre mil huit
cent quatre- vingt-huit, aux fonctions d’officier de l’état civil de la ville
d’Annecy, chef-lieu du département de la Haute-Savoie, a comparu Terrier Jean-Claude,
compositeur-typographe, fils de vivants Denis Terrier et Louise Excoffier,
né à Annecy, le vingt-huit février mil huit cent soixante, demeurant en cette
ville, rue Notre-Dame, n°14, maison Perroux, lequel nous a présenté un enfant
du sexe masculin, qu’il nous a dit être né le dix-neuf août courant, à onze
heures du matin, dans la maison qu’il habite, de lui, déclarant, et de son
épouse, Décarroz Joséphine, lingère, fille de vivants François Décarroz et
Geneviève Vincent, née à Annecy, le premier août mil huit cent
15 AD74
4E 2781.
soixante-cinq,
demeurant avec son mari, auquel enfant il a déclaré devoir être donnés les
nom et prénoms de Terrier Léon- Louis. — Ces déclaration et présentation ont
été faites en présence de Terrier Denis, maître charpentier, âgé de cinquante-
sept ans, et Revil Jean, cordonnier, âgé de trente ans, le premier, grand-père
paternel, et le second, oncle par alliance du nouveau-né, tous deux domiciliés
en cette ville. —Lecture faite du présent acte, le déclarant et les témoins
l’ont signé avec nous. — Les témoins. [Signé :] Terrier Denis — J. Revil —
Le déclarant [Signé :] Terrier Jean — L’officier de l’état civil : [Signé
:] E. Duparc. »
-
Mariage
de François à Quimperlé (1893) 16
«
1 — Mariage de François Joseph Terrier et Élisa Joséphine Beaufrère — L’an
mil huit cent quatre-vingt-treize, le trois janvier à dix heures du matin,
devant nous Charles Richard adjoint au maire remplissant par délégation les
fonctions d’officier public de l’état civil de Quimperlé, ont comparu, en
l’hôtel de la mairie, toutes portes ouvertes, le sieur François Joseph Terrier
âgé de vingt huit ans, rédacteur administrateur de l’Union agricole et maritime,
domicilié à Quimperlé, né à Annecy (Haute-Savoie) le vingt-cinq avril mil
huit cent soixante quatre comme le constate son acte de naissance ci- annexé,
fils majeur et légitime de Denis Terrier âgé de soixante ans entrepreneur
domicilié à Annecy, consentant suivant acte authentique passé devant maître
Grivaz notaire à Annecy (Haute-Savoie) le trois décembre mil huit cent quatre-vingt-
douze ci-annexé, et de feue Louise Excoffier décédée à Annecy
16 AD29
1Mi EC 289/15.
le
dix décembre mil huit cent quatre-vingt-onze comme le constate son acte de
décès ci-joint d’une part. — Et demoiselle Élisa Joséphine Beaufrère âgée
de vingt-cinq ans, sans profession, domiciliée et née à Quimperlé le huit
juin mil huit cent soixante-sept comme le constate le registre des naissances
de cette commune, fille majeure et légitime de Eugène Louis Henri Beaufrère
entrepreneur de peinture âgé de cinquante-cinq ans et de Françoise Marie Mélançon,
âgée de cinquante-un ans, sans profession, domiciliés à Quimperlé, ci-présents
et consentant d’autres part ; — Lesquels nous ont requis de procéder à la
célébration du mariage projeté entr’eux dont les publications ont été faites
et affichées en cette mairie, les dimanches dix-huit et vingt-cinq décembre
mil huit cent quatre- vingt-douze à l’heure de midi, comme le constate le
registre des publications de cette commune. — Aucune opposition au présent
mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition ; après
avoir donné lecture de toutes les pièces ci- dessus mentionnées, et du chapitre
VI du titre du code civil, intitulé : Du mariage, nous avons, conformément
à la loi, interpellé les futurs époux et les personnes qui les assistent,
d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage ; à quoi ils ont
répondu négativement. Nous avons ensuite demandé au futur époux et à la future
épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme : Chacun d’eux ayant
répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que le sieur
François Joeph Terrier et demoiselle Élisa Joséphine Beaufrère sont unis
par le mariage. En foi de quoi nous avons dressé acte en présence de Louis
Terrier, âgé de trente-quatre ans, directeur de l’Union agricole et maritime
domicilié à Paris, frère du contractant, de Anatole Jean Le Braz, âgé de
trente-trois ans, professeur domicilié à Quimper, ami des contractants, Victor
Auguste Mélanson, âgé de cinquante-deux ans, garde maritime domicilié à Concarneau,
oncle de la contractante et Eugène Beaufrère, âgé de vingt-quatre ans,
peintre, frère de la
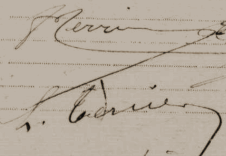
contractante. Et ont les contractants, leur père et mère
et les quatre témoins signé avec
nous
le présent acte après qu’il leur en a été fait lecture.
-
Décès
de François à Quimperlé (1893) 17
«
58 — François Joseph Terrier — L’an mil huit cent quatre- vingt-treize, le
vingt-cinq mars à onze heures du matin devant nous Charles Richard adjoint
au maire remplissant par délégation les fonctions d’officier public de l’état
civil de Quimperlé, ont comparu Sosthène David, âgé de quarante-huit ans,
agriculteur, conseiller général domicilié à Tréméven, et Gustave Le Folcalvez,
âgé de quarante-trois ans, conducteur des ponts et chaussées domicilié à Quimperlé,
amis du défunt, lesquels nous ont déclaré que François Joseph Terrier, âgé
de vingt-huit ans, publiciste né à Annecy (Haute-Savoie), domicilié à Quimperlé,
fils de Denis, âgé de soixante ans, entrepreneur domicilié à Annecy et de
feue Louise Excoffier, époux de Élisa Joséphine Beaufrère, âgée de vingt-cinq
ans, sans profession, domiciliée à Quimperlé, est décédé ce jour à deux heures
et quart du matin en sa demeure, place Hervo, ainsi que nous nous en sommes
assuré ; et ont les comparants signé
avec nous le présent acte après qu’il leur en a été fait
lecture. — [Signé :] G. Lefolcalvez — S. David — C. Richard. »
-
Mariage
de Louis à Tréméven (1893) 18
NOTES MONDAINES. CARNET DE MARIAGE.
Lundi
prochain 7 août, sera célébré, en l’église de Trémeven, prés de Quimperlé,
le mariage de notre collaborateur M. Louis Terrier, secrétaire général du
Journal des Débats, avec Mlle Louise David, fille de M. David, conseiller général du
Finistère.
-
Mariage
de Henri à Annecy (1895) 19
N°38
— Terrier Henri Claudius et Décarroz Marie Louise — L’an mil huit cent quatre-vingt-quinze,
le dix-sept du mois d’août, à quatre heures trois quarts du soir, à Annecy,
chef-lieu du département de Haute-Savoie, dans la salle de l’état civil située
en l’hôtel-de-ville, par devant nous Damille Dunant, premier adjoint, remplissant,
en l’absence du maire, les fonctions d’officier de l’état civil de la dite
ville, se sont présentés, d’une part, Terrier Henri-Claudius, journaliste,
âgé de vingt-quatre ans, né à Annecy, le huit août mil huit cent soixante-onze,
domicilié à Paris, quai aux Fleurs, numéro 11, fils majeur de vivant
Denis Terrier, maître charpentier,
18 Journal
des débats politiques et littéraires (3 août 1893), p. 3
; même texte dans Le Figaro 39/214 (3 août 1893),
p. 1 (avec « confrère » au lieu de « collaborateur »).
domicilié
à Annecy, consentant par acte passé cejourd’hui, devant maîtres Louis Grivaz
et son collègue, notaires en cette ville, et de défunte Louise Excoffier,
son épouse, en son vivant ménagère, aussi domiciliée à Annecy, où elle est
décédée le dix décembre mil huit cent quatre-vingt-onze ; d’autre part, Décarroz
Marie Louise, couturière, âgée de vingt-deux ans, née à Annecy le vingt-quatre
décembre mil huit cent soixante- douze, domiciliée à Annecy, où elle demeure,
fille majeure de vivants François Décarroz, tailleur de pierres, et Geneviève
Vincent, son épouse, ménagère, tous deux domiciliés en cette ville, présents
et consentants ; lesquels, après avoir déclaré qu’il n’existe entre eux aucun
degré de parenté ni d’alliance, nous ont requis de procéder à la célébration
de leur mariage dont les publications ont été faites en cette ville les dimanches
vingt-un et vingt-huit juillet dernier, et à Paris (quatrième et cinquième
arrondissements) les vingt-huit juillet et quatre août de l’année courante.
Et à l’appui de leur réquisition les parties nous ont donné l’acte de consentement
du père du futur et les certificats de publications et de non opposition délivrés
par les maires des quatrième et cinquième arrondissements de la ville de
Paris ; la naissance des futurs et le décès de la mère du futur étant inscrits
aux registres de l’état civil déposés au secrétariat de la mairie, nous avons
dispensé les parties de produire une expédition authentique des actes. Aucune
opposition ne nous ayant été signifiée, nous, officier de l’état civil, après
avoir reçu des futurs époux et des personnes présentes pour autoriser le
mariage, la déclaration qu’il n’a pas été passé de contrat, avons donné lecture
des pièces produites ainsi que des dispositions du code civil relatives au
mariage ; après quoi, nous avons demandé aux requérants s’ils veulent se
prendre pour époux. Chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement,
nous avons prononcé qu’au nom de la loi, Terrier Henri Claudius et Décarroz
Marie Louise sont unis par le mariage. Le tout a été fait publiquement aux
lieu, jour et heure indiqués et
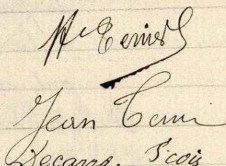
nous
en avons immédiatement dressé acte en présence de Terrier Jean, compositeur
typographe, âgé de trente-cinq ans, frère germain de l’époux, Décarroz François,
chapelier, âgé de vingt-huit ans, frère germain de l’épouse, Encrenaz Claudius,
typographe, âgé de vingt-quatre ans, et Laffin Georges, coiffeur, âgé de vingt-huit
ans, ces deux derniers non parents avec les nouveaux époux, tous quatre témoins
majeurs, domiciliés en cette ville. Lecture faite du présent acte, tous l’ont
signé avec nous. — [Signé :]
Marie
Louise Décarroz — H. Terrier — Terrier Denis — Décarrouz Fransos [sic] — Decarroz
— Jean Terrier. — Laffin Georges — Encrenaz Claudius — Décarroz Fçois
—L’officier
de l’état civil, C. Dunant. »
-
Publication
de poèmes de Louis à Annecy (1894) 20
Louis
Terrier, Choses et gens d’Annecy (poèmes en patois annécien), Annecy,
Hérisson, 1894. — Réédition en fac-similé : Frangy, La Margande, 1994.
20 AD74
4E 2781.
-
Décès
de Louis à Vichy (1897) 21
«
87 — Terrier Louis, 38 ans, marié, 7 mai — L’an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept
le sept mai à quatre heures et demie du soir, par devant nous Pierre Melchior
Ferdinand Desbrest chevalier de la Légion d’honneur, maire, officier de l’état
civil de la commune de Vichy, chef-lieu de canton, département de l’Allier,
ont comparu en la maison commune : Alexis Vigier, trente-huit ans, employé,
et Jean Baptiste Mansard, vingt-quatre ans, employé, domiciliés à Vichy, lesquels
nous ont déclaré que ce soir à deux heures Louis Terrier, âgé de trente-huit
ans, domicilié à Paris, rue Lagrange n°10, rédacteur au Journal des Débats,
époux de Louise David, né à Annecy (Haute-Savoie) le vingt-huit juin mil
huit cent cinquante-huit, fils de Denis Terrier et de feue Louise Excoffier
son épouse, est décédé à l’hôtel d’Amérique situé rue Petit ainsi que nous
nous en sommes assurés et les comparants ont signé avec nous le présent acte
après lecture faite. — [Signé :] A. Vigier — J. B. Mansart — F. Lesbrest.
-
Nécrologie
orléanaise de Louis (1897) 22
«
Nous avons le regret d’apprendre la mort de M. Louis Terrier, rédacteur en
chef de L’Abeille d’Étampes et collaborateur du Journal des Débats.
Notre
estimé confrère n’était âgé que de 39 ans ; il a succombé, à Vichy, aux suites
d’une maladie dont il était atteint depuis longtemps. Il laisse une veuve
et deux enfants.
21 AD3 2E
311/22.
22 Journal
du Loiret 80/112 (jeudi 13 mai 1897), p. 3.
Nous
adressons tous nos compliments de condoléances à toute la famille.
-
Nécrologies
bretonne et étampoise de Louis (1897) 23
LOUIS TERRIER
Deux
ans sont écoulés depuis qu’à cette place Louis Terrier a rendu le dernier
hommage à celui dont la mort a été pour lui et pour nous doublement cruelle,
à Hippolyte Percher, auquel il avait associé sa vie par une amitié sans limites.
Courageusement alors, il avait continué seul dans L’Abeille 1’œuvre
commencée et si brillamment menée, et, guidé par cette fidélité éclairée,
cette inaltérable confiance dans la cause qu’il défendait, il a lutté pour
le triomphe des idées républicaines modérées qu’il estimait avec nous être
le salut du pays.
Il
a eu la satisfaction de les voir·se répandre dans presque toutes les communes
de notre arrondissement d’Étampes, et si dans quelques-unes l’opinion publique
égarée par des compétitions, par des alliances inattendues, y est restée rebelle,
du moins la loyauté, la sincérité et la modération de sa polémique lui ont-elles
donné droit à l’estime de tous.
Aujourd’hui
c’est lui que nous pleurons.
Depuis
1884, il nous aidait de son labeur et de son amitié. Ceux qui l’ont connu
à Étampes ou à Paris, savent de quelle obligeance éclairée et cordiale il
servait ses amis. C’était un rude travailleur, arrivé par son seul labeur
à une situation estimée. Il avait débuté au Journal des Débats comme
simple
23 Abeille
d’Étampes 86/20 (15 mai 1897), p. 2.
reporter,
et en était devenu pendant la période de la double édition, l’administrateur
général. Il avait aidé en plus d’une occasion à la diffusion de l’instruction
populaire, et il en fut récompensé par le ruban d’officier d’Académie.
Ajoutons
que ce n’est pas seulement à Étampes qu’il luttait avec ardeur pour la défense
de ses convictions républicaines ; en Bretagne, il dirigeait avec succcès
le journal L’Union Agricole et Maritime de Quimperlé, qui assura la
réélection de
M.
de Kerjégu dont l’avis, dans toutes les questions maritimes fait autorité
à la Chambre, et 1’élection du regretté sénateur Rousseau, gouverneur de l’Indo-chine.
Là-bas,
dans ce pays breton qui était devenu pour Louis Terrier un pays d’adoption,
— il s’y était marié il y a trois ans
si
profondément attristé comme le plus complet et le plus bel hommage qui puisse
être rendu à notre ami regretté.
Et
maintenant, lorsque nous aurons accompagné sa dépouille au champ de l’éternel
repos, dans cette terre de Bretagne où sa jeune femme et ses petits enfants
pourront chaque jour aller fleurir sa tombe, nous reprendrons l’œuvre pacifique
et libérale de nos devanciers : L’Abeille d’Étampes restera demain
ce qu’elle était hier, et tout imprégnés de leur souvenir, nous suivrons sans
défaillance la voie qu’ils nous ont tracée.
L’ABEILLE.
Voici
le touchant adieu adressé par M. Le Braz à Louis Terrier dans L’Union Agricole
et Maritime de Quimperlé :
24 Anatole
Le Braz (1859-1926) avait été brièvement professeur de philosophie au collège
d’Étampes, vers 1880, période pendant laquelle il avait collaboré avec L’Abeille
d’Étampes (B.G.).
«
LOUIS TERRIER
«
J’ai la triste mission d’annoncer aux lecteurs de L’Union Agricole et Maritime
la perte douloureuse que fait le journal en la personne de son directeur,
M. Louis Terrier. Je sens d’avance, au moment de prendre la plume, que je
m’acquitterai fort mal de cette tâche. La mort de Louis Terrier me frappe,
en effet, dans une de mes affections les plus chères, et mon émotion présente
est trop vive pour que je puisse parler dignement de l’ami qui vient de m’être
enlevé. Il est difficile de retracer comme il faudrait une physionomie qu’on
ne peut plus regarder au fond de soi, qu’à travers un brouillard de larmes.
«
Et puis, vraiment, je suis incapable de me faire à cette idée que Louis Terrier
n’est plus. Il y a six mois à peine, il m’apparaissait encore si plein de
vie, de force sereine, menant de front les besognes les plus multiples avec
cette ardeur tranquille, cette aisance sérieuse et calme qu’on ne se lassait
point d’admirer en lui ! Car c’était un homme complet, celui-là, et qui réalisait
à un degré rare le parfait équilibre des facultés humaines : intelligence
lucide et volonté droite, toujours de sens rassis, ouvert à toutes les idées,
rebelle à tout fanatisme, il avait, par surcroît, le cœur le plus généreux
et la conscience la plus probe. C’était une âme haute et salubre, comme ces
montagnes de Savoie où il naquit, où vit encore sa famille et d’où, ses études
achevées, il s’achemina vers Paris pour s’y tailler une place. Que de fois
en nos causeries d’antan, ne m’a-t-il pas raconté ses premiers rêves, ses
premiers efforts, ses premières luttes ! Il aimait à se retremper dans ces
souvenirs de son passé, comme à la source de ses plus belles énergies. Le
destin mit sur sa route Hippolyte Percher (Harry Alis) dont la mémoire, voilée
d’un crêpe si tragique, n’est certainement pas tombé en oubli auprès des lecteurs
de cette feuille. Percher, observateur aigu, se connaissait en hommes. Tout
de suite, il s’associa ce montagnard viril et doux, l’adopta pour frère d’armes.
Il le fit
entrer
avec lui au Parlement, puis aux Débats. Cette profession si
décriée par des gens qui n’en jugent que d’après quelques aventuriers malpropres,
Louis Terrier est de ceux qui l’ont le plus honorée depuis leurs débuts jusqu’à
leur fin.
«
Je n’ai pas à dire ici quelle a été sa carrière parisienne. Les hautes personnalités
qui président aux destinées du Journal des débats rendront à ce travailleur
acharné l’hommage auquel il a droit et veilleront à ce qu’il ne s’en aille
point dans l’éternel repos, sans qu’une plume plus autorisée que la mienne
rappelle ses brillants états de services. Quant aux circonstances dans lesquelles
il prit en main la direction de L’Union Agricole et Maritime, il y
a peu de nos lecteurs qui ne s’en souviennent. Il s’agissait d’amener à la
République des adhésions encore hésitantes, des esprits insuffisamment éclairés
ou même des récalcitrants qu’aveuglaient de trompeuses images. Nul n’était
mieux fait que Louis Terrier pour conduire à bien cette campagne d’apaisement,
de réconciliation, d’unification de toutes les bonnes volontés dans une large
et hospitalière conception de l’intérêt commun. Le spectacle politique que
présente aujourd’hui l’arrondissement de Quimperlé est en grande partie son
œuvre. L’entreprise était délicate : il sut y
apporter
le tact qu’il fallait. Point de personnalités25 irritantes, point de sectarisme, une lumière paisible, toujours
égale,
désillant
les yeux sans les blesser. Telle fut sa méthode. C’était la seule qui convînt
à son tempérament, la seule aussi qui eût chance de réussir auprès de populations
auxquelles il avait accepté de prêcher la bonne parole. Relisez ces articles
honnêtes et francs, signés : Jacques Rude ; comment l’accent de sincérité,
de droiture, de tolérance et de simplicité qui s’en dégage n’eût-il pas séduit
des âmes bretonnes ?
25 C’est-à-dire
d’attaques personnelles (B.G.)
«
L’effet en fut sûr et prompt. Bientôt L’Union Agricole et maritime franchit,
par une sorte d’expansion naturelle, les frontières qu’elle s’était d’abord
assignées, gagna les arrondissements limitrophes, poussa des pointes en dehors
du pays cornouaillais, devint une lecture du dimanche jusque sous les chaumes
trégorrois. Louis Terrier en éprouvait une satisfaction qu’il ne chercha à
point déguiser. Car, cette Bretagne qu’il rêvait de conquérir à des idées
plus modernes, après l’avoir étudiée pour la comprendre, il en était venu
rapidement à l’aimer. Il l’avait parcourue tout entière, non en touriste de
passage, mais en observateur curieux, attentif, passionné. Et, quand
il l’eut pénétrée, elle le charma.
«
Décidément, m’écrivait-il un jour, une part de mon âme devient vôtre ». Il
ne croyait pas alors si bien dire. Moins de quatre ans après, il prenait ses
lettres de grande naturalisation en épousant une Bretonne… Et voici que je
ne me sens plus le courage de continuer. Ces noces d’un caractère si local,
là-haut, dans le vert pays de Tréméven, elles sont presque d’hier ! Avec quelle
joie nous lui faisions cortège· sous les voûtes de la vieille église rustique,
aux cintres surbaissés !
«
L’ère d’un long bonheur semblait s’ouvrir devant lui. Il n’en a goûté que
les premières ivresses. Sa toute jeune femme vient de lui fermer les yeux,
dans la banalité sinistre d’une ville d’eaux, à Vichy; les deux orphelins
qu’il laisse ne l’auront même pas connu !...
«
De cette vaillante famille des Terriers, il est le second qui tombe pour la
cause de l’idée bretonne.
«
L’autre, son frère cadet, nous l’enterrions, il y a quatre ans à peine, sur
une des hauteurs qui dominent Quimperlé. À côté de l’ancienne fosse une fosse
nouvelle va s’ouvrir. Je ne doute pas que sur ses bords on ne s’empresse nombreux
; et je suis sûr aussi d’être à cette place, l’interprète de tous les lecteurs
de ce journal, en offrant aux deux familles si cruellement atteintes l’expression
d’une condoléance émue. Pour moi, je n’hésite pas
à
considérer la mort de Louis Terrier, non comme un deuil personnel, mais comme
un deuil breton.
« A.
Le Braz.
« Quimper,
Stang-ar-C’hoat, 7 mai 1897.
-
Nécrologie
parisienne de Louis (1898) 26
M.
Louis Terrier, né à Annecy (Haute-Savoie), le 27 juin 1858, décédé à Vichy,
le 7 mai 1897, a été inhumé le dimanche 16 mai 1897, à Tréméven (Finistère),
après un service religieux à l’église paroissiale.
Entré
au Journal des Débats le 1er janvier 1884, et attaché au service des informations.
Détaché
le 23 mars de l’année suivante à Quimperlé pour organiser le journal républicain
L’Union agricole et maritime.
Rentré
au service des informations du Journal des Débats, le 1er décembre, tout en conservant
le titre et les fonctions de directeur de L’Union agricole et maritime
que M. Terrier a dirigé de Paris, depuis ce temps.
M.
Terrier a pris, le 1er mai
1891, les fonctions de secrétaire de rédaction du Journal des Débats,
qu’il a conservées jusqu’au 1er janvier 1893, date à laquelle il a été choisi par la
nouvelle
société
du journal comme secrétaire général des services administratifs.
Depuis
deux ans, M. Louis Terrier était chargé, aux Débats, de la rédaction
parlementaire du Sénat.
Il
était, en outre, rédacteur en chef de L’Abeille d’Étampes.
M.
Terrier s’était engagé, en 1870, dans l’administration de l’armée. Il avait
été nommé officier de réserve après sa libération, et il était
officier d’administration adjoint de 2e
26 Bulletin
de l’Association des journalistes parisiens 13 (15
avril 1898),
pp.
21-22.
classe
du cadre auxiliaire des Bureaux de l’intendance militaire.
|22
M.
Louis Terrier était officier de l’ordre du Nicham Iftikhar de Tunisie (1886),
de l’ordre royal du Cambodge (1889), et officier d’Académie (1889) pour services
rendus à l’instruction publique.
Il
faisait partie de l’Association depuis le 20 février 1889. (Voir page 46,
le Rapport du Comité.) […]|23-46 […]
LOUIS TERRIER.
M.
Louis Terrier, très jeune encore, avait, comme tant de nos confrères, une
existence entièrement consacrée au travail.
Il
ne se contentait pas de servir ses idées dans un des journaux les plus réputés,
le Journal des Débats, dont il était devenu le secrétaire général,
en même temps que l’informateur parlementaire, il avait, en outre, organisé
un journal républicain dans le Finistère et il dirigeait lui-même L’Union
agricole et maritime.
-
Mariage
de Léon à Étampes (1899) 27
«
N°54 — Terrier et Égré — L’an mil huit cent quatre-vingt- dix-neuf, le lundi
vingt-trois octobre, à dix heures et demie du matin, par devant nous, Édouard
Joseph Béliard, maire de la ville d’Étampes, officier de l’état civil de la
dite ville, département de Seine-et-Oise, officier d’académie, sont comparus
Léon Francis Terrier, comptable âgé de trente ans, demeurant à Étampes rue
de la Juiverie numéro vingt-quatre, né en la ville d’Annecy département de
la Haute-Savoie le premier juillet mil huit cent soixante-neuf, fils majeur
de Denis Terrier,
27 AD91
4E 3647.
entrepreneur
de charpente, âgé de soixante-sept ans, demeurant en la ville d’Annecy place
du Théâtre, et de Louise Excoffier, son épouse, décédée au même lieu le dix
décembre mil huit cent quatre-vingt-onze. Et demoiselle Marguerite Charlotte
Égré, brodeuse âgée de dix-sept ans, demeurant à Étampes place de l’Hôtel-de-Ville,
numéro premier, avec ses père et mère, et y étant née le deux juillet mil
huit cent quatre-vingt-deux, fille mineure de Germain Edmond Égré, employé
au chemin de fer d’Orléans, âgé de cinquante-trois ans, et de Marie Sylvie
Picandet, son épouse, sans profession, âgée de quarante-deux ans, tous deux
demeurant à Étampes place et numéro susdits, ici présents et consentants au
mariage de leur fille. Lesquels nous ont présenté leurs actes de naissance,
l’acte de décès de la mère du futur, le consentement donné au présent mariage
par le père du futur le six septembre dernier devant monsieur l’adjoint au
maire de la ville d’Annecy, officier de l’état civil, enregistré et légalisé
au même lieu le dit jour et les actes de publication du présent mariage faits
en cette mairie les deux dimanches premier et huit octobre présent mois sans
opposition. Ici les futurs époux avec les père et mère de la future nous ont
déclaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage. Et après avoir vérifié
sur nos registres de l’état civil l’acte de naissance de la future, nous
avons visé pour être annexées les autres pièces énoncées ci-dessus et nous
avons donné lecture du tout aux parties comparantes assistées des quatre témoins
ci-après nommés et qualifiés, ainsi que du chapitre six du titre du mariage
sur les droits et devoirs respectifs des époux. Ensuite nous avons reçu la
déclaration de Léon Francis Terrier qu’il prend pour son épouse la demoiselle
Marguerite Charlotte Égré, et celle de la demoiselle Marguerite Charlotte
Égré qu’elle prend pour son époux Léon Francis Terrier. En conséquence nous
avons déclaré au nom de la loi que Léon Francis Terrier et Marguerite Charlotte
Égré sont unis par le mariage. Tout ce que dessus fait publiquement à Étampes,
en l’hôtel de la mairie, les
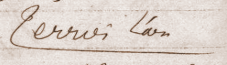
dits
jour, mois en an, en présence de Paul Louis Ollivier Lecesne, imprimeur, âgé
de cinquante-deux ans, ami de l’époux, demeurant en cette ville, Auguste Jean
François Terrier, publiciste, âgé de vingt-sept ans, frère de l’époux, demeurant
à Paris rue de Bourgogne numéro trente-six, Charles Égré coiffeur âgé de
quarante-huit ans, oncle de l’époux, demeurant à Bourges (Cher), et de Ernest
Labbé, négociant âgé de trente-un ans, ami des époux, demeurant à Étampes,
qui ont signé avec les époux, les père et mère de l’époux et nous maire sus-nommé,
après lecture faire. — [Signé :] M. C. Égré — Terrier Léon — E. Égré — Silvie
Picandet — O. Lecesne — A. Terrier — Ch. Égré — E.
Labbé
— E. Béliard. »
-
Léon
Francis journaliste de Seine-et-Oise en 190028
Les
journalistes de Seine-et-Oise se sont réunis hier à Versailles, au Dîner Français,
sous la présidence de M. Arthur Bailly, directeur du Courrier de Versailles
et de Seine-et-Oise.
Le
Syndicat qu’ils ont formé et dont ils ont élaboré les statuts, prendra le
titre de Syndicat des Journalistes de Seine-et-Oise. Ont été nommés : MM.
Victor de Bonaffos, rédacteur en chef du Journal de Versailles et de Seine-et-Oise,
président ; Jacquemin, de la Tribune de Seine-et-Oise, vice-président
; Guichon, rédacteur en chef de la Rive Gauche, syndic ; d’Angluse,
rédacteur au Petit Journal, secrétaire ; Arthur Bailly, trésorier.
Ont
été nommés, en outre, membres du comité d’organisation : MM. Léon Terrier,
de L’Abeille d’Étampes ;
28 Le
XIXe siècle 11.182 (22 octobre 1900), p. 2.
Phavidier,
de L’Abeille de Corbeil ; Beaumont, du Journal de Mantes ; Jean
Vilain, du Républicain de Pontoise ; Jules Maillard, du Progrès
de Rambouillet ; et Paul Espéron, du Réveil de Seine-et-Oise.
-
Mariage
d’Auguste à Étampes (1901) 29
«
N°1 — Terrier et Lecesne — L’an mil neuf cent un, le lundi sept janvier, à
onze heures du matin, par devant nous, Pierre Jules Frédéric Louis, maire
de la ville d’Étampes, officier de l’état civil de la dite ville, département
de Seine-et-Oise, sont comparus Auguste Jean François Terrier, secrétaire
général du comité de l’Afrique française, âgé de vingt-sept ans, demeurant
à Paris rue de la Bourgogne numéros trente-six et trente-huit, septième arrondissement,
né en la ville d’Annecy département de la Haute-Savoie, le onze juillet mil
huit cent soixante-treize, fils majeur de Denis Terrier, ancien entrepreneur
de charpente, âgé de soixante-huit ans, demeurant en la ville d’Annecy place
du Théâtre, et de Louise Excoffier, son épouse, décédée au même lieu le dix
décembre mil huit cent quatre-vingt-onze. Et demoiselle Renée Charlotte Albertine
Lecesne, sans profession, âgée de vingt-quatre ans, demeurant à Étampes rue
Saint- Jacques numéro vingt-neuf, avec ses père et mère, née en la ville de
Château-Thierry, département de l’Aisne, le douze mars mil huit cent soixante
seize, fille majeure de Louis Paul Olivier [sic] Lecesne, imprimeur âgé de
cinquante-trois ans et de Mathilde Élisabeth Allien, son épouse, sans profession,
âgée de cinquante ans, demeurant ensemble à Étampes rue Saint- Jacques numéro
susdit, ici présents et consentants au mariage
29 AD91
4E 3647.
de
leur fille. Lesquels nous ont présenté leurs actes de naissance, l’acte de
décès de la mère du futur, le consentement donné au présent mariage par le
père du futur le vingt-quatre décembre dernier devant monsieur Bock maire
de la ville d’Annecy, officier de l’état civil, enregistré et légalisé un
certificat délivré le trente décembre mil neuf cent, par maître Prat Marca
notaire à Étampes, constatant que les futurs époux ont fait un contrat mariage
devant lui le dit jour, et les actes de publication du présent mariage faits
tant en cette mairie qu’en celle de Paris, septième arrondissement, les deux
dimanches vingt-trois et trente décembre de l’année dernière sans opposition
. Et après avoir visé ces pièces, nous en avons donné lecture aux parties
comparantes assistées des quatre témoins ci- après nommés et qualifiés, ainsi
que du chapitre six du titre du mariage sur les droits et devoirs respectifs
des époux. Ensuite nous avons reçu la déclaration de Auguste Jean François
Terrier qu’il prend pour son épouse la demoiselle Renée Charlotte Albertine
Lecesne, et celle de la demoiselle Renée Charlotte Albertine Lecesne qu’elle
prend pour son époux Auguste Jean François Terrier. En conséquence nous avons
déclaré au nom de la loi que Auguste Jean François Terrier et Renée Charlotte
Albertine Lecesne sont unis par le mariage. Tout ce que dessus fait publiquement
à Étampes, en l’hôtel de la mairie, les dits jour, mois en an, en présence
de messsieurs Edmond Marcel Dubois, professeur à la Sorbonne, âgé de quarante-quatre
ans, chevalier de la légion d’honneur, demeurant à Paris, 76 rue Notre-Dame-des-Champs,
sixième arrondissement, ami des époux, Roch Auguste Henri Lecesne, propriétaire,
âgé de cinquante-huit ans, demeurant à Châteaudun, Eure-et-Loir, cousin de
l’épouse, Étienne Alfred Léonore de Valèche, directeur du Journal des débats,
âgé de trente-cinq ans, demeurant à Paris, 40 rue de Berlin, huitième arrondissement,
ami de l’époux, et Marie Joseph Laurent Amodru, député, vice- président du
conseil général de Seine-et-Oise, âgé de cinquante-
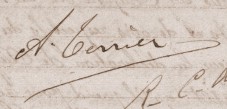
un
ans, demeurant à Paris, avenue des Champs Élysées, numéro soixante-six, ami
de l’époux, qui ont signé avec les époux, les père et mère de l’époux et nous
maire sus-nommé, après lecture faire. — [Signé :] A. Terrier
Léon
— R. C. A. Lecesne — V — O. Lecesne — M. Allien
-
Recensement
d’Étampes (1901) 30
Le
recensement de 1901 trouve à Étampes :
-
29 rue Saint-Jacques : 1° Ollivier Lecesne,
53 ans, imprimeur ; 2° Mathilde Allien, 51 ans, sans profession, son épouse
; 3° Gabrielle Lecesne veuve Percher, 28 ans, sa fille ; 4° Thérèse Lecesne,
20 ans, sa fille ; 5° Alice Percher, 6 ans, sa petite-fille ; et trois domestiques
: 6° Jean Guego, 24 ans ; 7° Juliette Villass, 22 ans ; 8° Rachel Morin, 16
ans.
-
26-30
rue Sainte-Croix31 : six ménages
dont celui de : 1° Léon Terrier, 31 ans, comptable ; 2° Marguerite Égré, 18
ans,
sans
profession, son épouse ; 3° Henri Terrier, 6 mois, son fils.
-
Recensement
d’Étampes (1906) 32
Le
recensement de 1906 trouve à Étampes :
30 AD91
6M 125.
31 Les almanach
d’Étampes pour 1901 et 1902 (le premier édité à l’extrême fin de 1900) montrent
tout deux Terrier à cette adresse.
32 AD91
6M 126.
-
29 rue Saint-Jacques : 1° Ollivier Lecesne,
né en 1847 à Tours, imprimeur journaliste, chef de ménage ; 2° Mathilde Allien
née en 1849 à Paris, sans profession, son épouse ; 3° Marguerite Marie Grimaud,
née en 1871 à Château-Thierry, sans profession, sa fille ; 4° GabrielleAugustine
veuve Percher, née en 1873 à Château-Thierry, sa fille ; 4° Fernande Amélie
Lecesne, née en 1883 à Étampes, sans profession, sa fille ; 5° René Étienne
Grimaud, né en 1898 à Étampes, son petit-fils ; 6° Marguerite Berthelot, née
en 1877 à Brières-les-Scellés, sa domestique.
-
1 rue Magne : 1° Léon Terrier, né en 1869
à Annecy, comptable employé par Lecesne, chef de ménage ; 2° Marguerite Égré,
née en 1882 à Étampes, sans profession, son épouse ; 3° Henri Terrier, né
à Étampes en 1900, son fils ; 4° Olivier Terrier, né à Étampes en 1902, son
fils .
-
Pourquoi
Auguste mérite la Légion d’honneur (1906) 33
-
Éléments présentés par l’intéressé.
Terrier Auguste-Jean-François,
né à Annecy le 11 juillet 1873.
-
Rédacteur du Bulletin du Comité
de l’Afrique française de 1891 à 1893. — Secrétaire-adjoint au Comité
de 1893 à 1897.
-
Secrétaire général depuis 1898. —
Secrétaire général du Comité du Maroc depuis sa fondation. — Membre de la
commission chargée de préparer la participation du ministère des colonies
à l’exposition universelle de 1900. A rédigé en cette qualité le 1er volume de la série des publications
de l’Exposition coloniale, Un siècle d’expansion coloniale,
33 Archives
nationales, dossier 19800035/1244/43579.
rapport
sur les explorations du XIXe siècle. A dressé en outre pour le volume du ministère des colonies la
notice relative aux auxiliaires de la colonisation. — Médaille d’or de l’Exposition.
Lauréat
de l’académie française (prix d’histoire Marcellin- Guérin 1902), de la Société
de géographie de Paris (1902) et de la Société de géographie commerciale (prix
Castonnet des Fosses, 1902). — Licencié en droit de la faculté de Paris.
Voyages
en Afrique : 1899. Délégation du Comité de l’Afrique française au congrès
de géographie qui sous la présidence de MM. Laferrière et de Brazza étudia
la question des chemins de fer sahariens. Voyage dans le Sud constantinois
et en Tunisie. — 1901. Voyage d’études en Algérie et en Tunisie. — 1904. Voyage
d’études sur la côte du Maroc, d’Oran à Tanger. Délégation de l’Alliance française
à Tanger pour arrêter le programme scolaire au Maroc. — 1905. Mission d’études
du comité du Maroc sur la côte ouest, de Tanger à Mogador. Préparation des
missions Leclerc, Dyé, Dehors, etc.
Au Comité
de l’Afrique française et au Comité du Maroc M. Terrier a été l’organisateur
et l’auxiliaire de toutes les missions d’études accomplies en Afrique en ces
dernières années. Il a notamment pris une part active à la préparation des
missions Cazemajoin, Bretonnet, Gentil, Thomas, etc.
Dans le
Bulletin qu’il dirige il a défendu les intérêts de la politique
française notamment dans les affaires du Niger et du haut Dahomey. — A été
correspondant du Journal Égyptien, organe des intérêts français au
Caire, jusqu’à la disparition de ce journal en 1899. — A dirigé le journal
de Tanger Le Maroc.
— Nombreuses
conférences et articles dans les principales revues coloniales.
-
Éléments retenus par le ministère
du commerce.
République
française Légion d’honneur — Ministère du commerce et de l’industrie — Légion
d’honneur.
Nom : Terrier
— Prénoms : Auguste, Jean, François — Date et lieu de naissance : le 11 juillet
1873 à Annecy (Haute- Savoie) — Domicile : 17 avenue de Tourville, Paris
— Situation : Directeur de l’office du gouvernement chérifien et du protectorat
de la République — Grades universitaires : licencié en droit ; lauréat de
l’académie française.
Services
militaires : services auxiliaires (classe 1893) — Durée total des services
: 21 annés — Situation diverses (fonctions électives, professions) : Secrétaire
général du Comité de l’Afrique française et du Comité du Maroc ; conseiller
du Commerce extérieur. — Missions à l’étranger, dans les colonies : Rapport
sur l’expansion française au 19e siècle ; membre de la Commission du ministère des colonies.
Publications
littéraires, scientifiques, artistiques : Publication du ministère des colonies
; Exposition de 1900 ; La formation territoriale de l’Afrique occidentale
française.
Distinctions
honorifiques : Chevalier de la Légion d’honneur en avril 1906. —
Détail
des services extraordinaires rendus par le candidat : Délégué pour le Maroc
aux expositions de Marseille et de Londres.
Observations
: Délégué du Maroc à l’exposition de Gand.
Le ministre
du Commerce et de l’industrie certifie, en outre, qu’il résulte de l’enquête
que la moralité de M. Terrier permet son admission dans l’Ordre de la Légion
d’honneur.
À Paris,
le …. 191…. — Le ministre du commerce et de l’industrie. — [Signé :] Peret.
-
Éléments retenus par le ministère
de l’instruction.
République
française — Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts — Renseignements
produits à l’appui du projet de décret tendant à nommer chevalier de la Légion
d’honneur un candidat n’ayant pas le temps de services exigé par l’article
11 du décret du 16 mars 1852.
Nom et
prénoms : Terrier Auguste Jean François — Date et lieu de naissance : 11 juillet
1873 à Annecy (Haute Savoie) — Domicile : 15, rue de la Planche (7e arrondissement) — Nationalité
: française — Situation : Secrétaire du Comité de l’Afrique française et du
Comité du Maroc. — Grades universitaires : licencié en droit.
Services
militaires : classé dans les services auxiliaires de l’armée.
Services
civils : conseiller du commerce extérieur de la France 1904 ; membre de la
commission chargée de préparer la participation du ministère des colonies
à l’exposition universelle de 1900 ; chargé par le ministère des colonies
en 1900 du rapport sur les missions d’exploration au 19e siècle (Un
siècle
d’exploration coloniale, 1902) ; organisation, avec le ministère
des colonies, de missions d’exploration et d’enquête en Afrique (missions
Baud, Bretonnet, Hourst, Cazemajoin, Foureau, Lamy, etc.) ; a dresssé pour
le ministère des colonies en 1900 la Notice sur les Auxiliaires de
la Colonisation ; attaché au comité de l’Afrique de 1890 à
1897 ; secrétaire général du Comité depuis 1897 ; secrétaire général du Comité
du Maroc depuis sa fondation, 1904.
Missions
à l’étranger, dans les colonies : délégation du Comité de l’Afrique française
au congrès de géographie d’Alger 1899 et voyage dans le Sud constantinois
et en Tunisie ; voyage en Tunisie, Algérie et frontière marocaine en 1901
; mission de l’Alliance française à Tanger et du Comité du
Maroc
sur la côte septentrionale (juillet-août 1904) pour la réorganisation des
écoles de l’alliance au Maroc ; voyage à Tanger et dans le Maroc occidental
(avril-mai 1905) avec mission du Comité du Maroc et de l’Alliance française
(création de groupes français à Mazagan et Mogador).
Services
rendus dans les établissements de bienfaisance, les commissions, etc. : Commission
du commerce extérieur (ministère du commerce) ; commission d’organisation
de l’exposition coloniale de Marseille.
Publications,
titres littéraires, scientifiques, artistiques : lauréat de l’académie
française (prix d’histoire Marcellin- Guérin 1902) ; volume : Un
siècle d’expansion coloniale, publié par le ministère des colonies
dans la collection de 1900 ; lauréat de la Société de géographie de Paris
et de la Société de géographie commerciale (1902) ; direction depuis
1897 du Bulletin du Comité de l’Afrique française et de la série
de publications du Comité du Maroc ; conférences à la Société de géographie
commerciale, à la Ligue de l’enseignement ; ancien correspondant du Journal
Égyptien, organe des intérêts français en Égypte, et direction du journal
français deTanger, Le Maroc.
Distinctions
honorifiques : officier d’académie ; médaille d’or de collaborateur à l’exposition
de 1900.
Détails sur
les services extraordinaires rendus par le candidat :
M. Terrier,
en qualité de secrétaire général du Comité de l’Afrique française, a été l’organisateur
et le collaborateur de toutes les missions accomplies en Afrique en ces dernières
années : il a notamment pris une part personnelle très active à la préparation
des missions du Niger et du Chari. Dans le Bulletin qu’il dirige, M. Terrier
a défendu, sous la haute direction de la Direction de l’Afrique au ministère
des colonies, les résultats des missions françaises et les intérêts menacés
par nos concurrents allemands et anglais. M Terrier a été, sous la présidence
de MM. Étienne et Guillain, l’organisateur du Comité du Maroc et des missions
formées par ce Comité. Il a
lui-même
rempli une mission en Algérie Tunisie pour le Comité du Maroc et l’Alliance
française.
Le ministre
de l’instruction publique et des beaux-arts certifie, en outre, qu’il résulte
de l’enquête que la moralité de M. Terrier permet son admission dans l’ordre
de la Légion d’honneur.
Paris,
le 20 janvier 1906. — Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
[Signature illisible]
-
Léon,
rue Magne (1909) 34
L’annuaire
d’Étampes pour 1909 mentionne maintenant :
« Terrier
Léon, comptable, rue Magne, 1 ».
-
Recensement
d’Étampes (1911) 35
Le
recensement de 1911 trouve à Étampes :
-
29 rue Saint-Jacques : 1° Ollivier Lecesne,
né en 1847 à Tours, imprimeur, chef de ménage ; 2° Mathilde Lecesne née en
1849 à Paris, son épouse ; 3° Gabrielle veuve Percher, née en 1873 à Château-Thierry,
sa fille ; 4° Marguerite Berthelot, née en 1877 à Brières-les-Scellés, sa
cuisinière ; 5° Alcide Ronce, né en 1896 à Chouzy, son valet de chambre.
-
130 rue Saint-Jacques : 1° Léon Francis
Terrier, né en 1869 à Annecy, comptable employé par Lecesne, chef de ménage
; 2° Marguerite, née en 1882 à Étampes, son épouse ;
34 AD91
6M 127.
35 AD91
6M 127.
3°
Henri Terrier, né à Étampes en 1900, son fils ; 4° Olivier Terrier, né à Étampes
en 1902, son fils .
-
Auguste
à Étampes (1912-1913) 36
Il
semble bien d’après les annuaires de ces deux années qu’Auguste Terrier a
habité quelque temps à Étampes, précisément au n°29 de la rue Saint-Jacques,
c’est-à-dire chez Ollivier Lecesne, beau-père de son défunt ami Harry Alis,
car on y lit : « Terrier A., publiciste, 29 rue Saint-Jacques ».
-
Mariage
de Léon Louis à Annecy en 1913 37
«
Par acte en date du 5 avril mil neuf cent treize inscrit le même jour à la
mairie de Annecy, [blanc] dont la naissance est constatée dans l’acte ci-contre
a contracté mariage avec Mugnier Jeanne Franceline, dont mention faite par
nous greffier du tribunal d’Annecy le 2 août mil neuf cent quatorze.— [Signé
:] Denivet. »
-
Auguste
mérite de passer officier de la Légion (1914) 38
République
française — Ministère des affaires étrangères — Direction des affaires politique
et commerciales — Maroc — N°412. A. S. de M. Terrier — Paris, le 9 avril 1914.
— Le
36 Almanach
de 1912, p. 157 ; et de 1913, p. 153. Mais il
faut noter que ces listes contiennent par ailleurs des erreurs manifestes,
notamment dans ce passage.
37 Première
mention marginale à son acte de naissance de 1889 à Annecy, AD74 4E 2781.
38 Archives
nationales, dossier 19800035/1244/43579.
Président
du Conseil, ministre des affaires étrangères, à monsieur le ministre du commerce
et de l’industrie (Direction des transports et des Expositions)
La
participation de mon Département à l’Exposition de Gand, pour laquelle le
Parlement avait accordé un crédit spécial, a consisté dans l’exposition du
Maroc à laquelle a été délégué M. Auguste Terrier, directeur de l’Office
du gouvernement chérifien et du Protectorat de la République française
au Maroc. Ainsi que vous le savez, l’exposition du Maroc à Gand a été très
remarquée. C’était la première fois que le Maroc français
participait
à une exposition.
Le
délégué a présenté le Maroc avec les documents les plus complets et les plus
variés, à la fois au point de vue économique, au point de vue historique,
au point de vue agricole, au point de vue pittoresque et au point de vue scientifique.
De l’avis général, le pavillon du Maroc a été le principal attrait de la
Section Coloniale française et c’est avec succès qu’il a paru devant le jury
international, qui lui a accordé :
1°
au titre « Exposants » : 13 grands prix
7
diplômes d’honneur
19
médailles d’or
16
médailles d’argent 20 médailles de bronze 6 mentions honorables
2°
au titre « Collaborateurs » : 6 diplômes d’honneur
53
médailles d’argent Soit en tout 140 récompenses.
Dans
ces conditions, j’estime qu’il serait équitable de reconnaître l’effort ainsi
accompli en inscrivant dans la liste des décorations de la promotion de l’Exposition
de Gand le seul
délégué
de mon Département qui a figuré à cette exposition et je vous serais très
obligé de bien vouloir reconnaître les excellents services que M. Terrier
a rendus à la cause marocaine en lui réservant une des 45 croix d’officier
de la Légion d’Honneur qui ont été mises à la disposition de votre ministère.
[Signé
: ] P. de Margerie.
-
Léon gérant de L’Abeille au début
de 1914
Le
numéro de L’Abeille d’Étampes du 7 février 1914 mentionne encore Lecesne-Allien
comme « directeur » autant que comme « imprimeur gérant », tandis que le numéro
suivant du 14 février mentionne seulement « Léon Terrier, gérant. »
-
L’Imprimerie
Terrier et la Guerre (1914-1924) 39
-
Pendant la guerre de 1914.
Petit bulletin des paroisses de Guillerval, Monnerville, Chalou-Moulineux,
Congerville- Thionville, Oysonville (23 cm), Guillerval, V.
Oury (Étampes imprimerie Terrier frères), 1914-1918 (publication mensuelle
dont le n° 33 paraît en février 1918).
-
Victor Antoine, Viv’nt les Carpintiers
d’ la victoire. Marche de départ d’un réfugié de Lille, en patois de la région
de Lille. Paroles et musique de l’auteur Victor Antoine (musique imprimée
; 28 cm ; 4 p., couverture illustrée), Dunkerke, Aux Chansonniers lillois
(Cassoret de Geyer) et Étampes, imprimerie Terrier frères et Cie, sans date
(vers 1915).
39 D’après
le catalogue de la BnF.
-
Georges Grandjean, Les Fleurs de sang
(in-16 ; 143 p. ; figures), Étampes, Terrier frères, 1915.
-
P. Fabreguettes,
Les Batailles de la Marne (4-15 septembre 1914). 2e édition (in-18
; 123 p. ; figures, cartes ; extrait de la Grande Revue), Étampes, Terrier frères, 1915. Réédition 1916.
-
Xavier Lendormy (1893-1915), L’Œuvre d’un poète de vingt ans. Poèmes (in-12 ; 22 p. ;
extrait de L’Abeille-réveil d’Étampes), Étampes, Terrier frères, (1916)
-
Léon Francis Terrier, Adjudant Terrier.
Petit cours de nivellement en vue de la lecture des cartes de l’état-major,
à l’usage des sociétés de préparation militaire (in-16 ; 15 p. ; figures),
Étampes, Terrier frères, 1916.
-
Leblanc, Collège Geoffroy-Saint-Hilaire
d’Étampes. Allocution prononcée à la clôture annuelle des classes, le 13 juillet
1916 (in-16 ; 11 p.), Étampes, Terrier frères, 1916.
-
A. L. (peut-être Auguste Lecesne), La
Question des loyers (in-12 ; 12 p. ; extrait de L’Abeille-Réveil d’Étampes
2/101 du 3 juin 1916, p. 1), Étampes, Terrier frères, 1916.
-
A. G. (sans doute le Dr Alphonse Grenet), Sœur Sainte-
Colombe, supérieure des Augustines de l’Hôtel-Dieu d’Étampes (1865-1917)
(in-16 ; 8 p. ; portrait), Étampes, Terrier frères, 1917.
-
Narcisse Lefèvre, et Roger Masson, Nos
centres industriels du nord après guerre, relèvement économique, concours
financier (in-8° ; 29 p.), Étampes, Terrier frères et Cie, 1917.
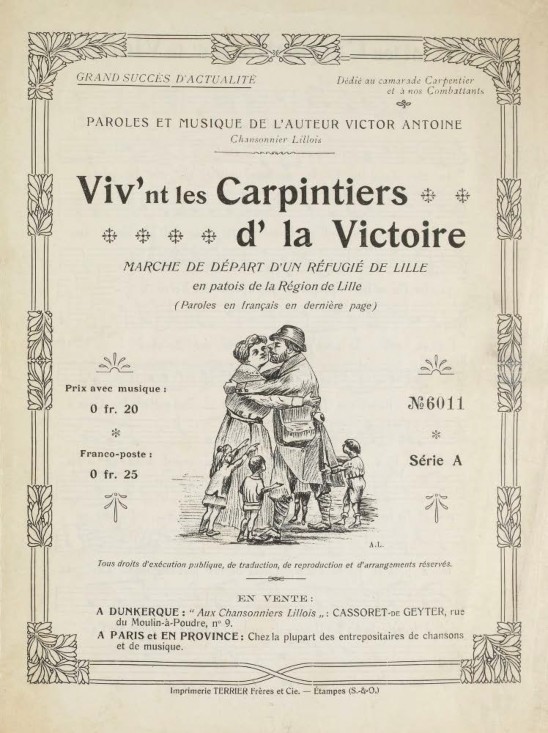
195
-
Marcel Bouilloux-Lafont, Essai sur
le rôle économique et financier de la Société des nations, la liquidation
des comptes de guerre sans nouveaux impôts chez les Alliés (in-8°; 24
p.), Étampes, Terrier frères, 1918. — Dont une version anglaise : Essay
on economical and financial role of the society of nations. Liquidation of
war expenses without new taxes upon the Allies, Caen, E. Domin, 1919.
-
Mathilde Désormaux. Voix de la guerre
(1914-1918) (in-
16 ; 36 p.), Étampes, Terrier frères, 191940.
Jean
Fontaine-Vive (1895-1917), Lieutenant Jean Fontaine- Vive. Fleurs printanières
(in-8°
; 115 p. ; portrait ; préface de Joseph Désormaux, 1867-1933), Étampes, Terrier
frères, 191941.
40 Compte-rendu
dans la Revue Savoisienne 60 (1919), p. 188 : « Voix de la guerre,
par Mathilde Désormaux. Étampes, Terrier, 1919. — Nous signalons avec plaisir
cette élégante plaquette, qui a été éditée, avec beaucoup de goût par notre
confrère Léon Terrier, et dont quelques pièces viennent d’obtenir une mention
honorable à l’Académie de Savoie. — Les vers de Mlle Désormaux sont écrits sans affectation : le style est
naturel et se ressent d’une longue fréquentation des bons auteurs. Les idées
sont nettes et témoignent d’une maturité d’esprit plutôt rare chez une jeune
fille. Nos lecteurs connaissent déjà l’Église abandonnée, qui a paru
dans la Revue Savoisienne. Ils apprécieront comme nous Les morts
fécondes, Aux Soldats de France, Le Rêve, etc. Mlle Désormaux sent ce qu’elle
écrit, et communique son émotion aux lecteurs : ce sont bien là les signes
qui caractérisent le véritable talent poétique. Tous nos compliments. — F.
M. »
41 Compte-rendu
dans la Revue Savoisienne 60 (1919), p. 120 : « Séance
du 23 décembre
1919. […] M. Désormaux présente, pour la Bibliothèque Florimontane, le premier
exemplaire d’un volume qui vient de paraître et dont il a préparé l’édition
: Fleurs printanières. Cet élégant ouvrage, sorti des presses des
habiles artistes que sont les imprimeurs savoyards Terrier frères (Étampes,
1919), contient les premiers vers d’un jeune poète
Ville d’Étampes, Troisième (3e)
fête des fleurs, au bénéfice des gazés de la guerre de l’arrondissement d’Étampes
(22 cm ; non paginé ; illustrations dont la couverture
de Louis Icart, 1888-1950), Étampes Terrier frères, 1924.
-
Décès
de Henri à Étampes (1921) 42
CARNET DE DEUIL
La famille
de nos directeurs et rédacteurs vient d’être cruellement éprouvée. M. Henri
Terrier, secrétaire administratif du Comité de l’Afrique Française et du Comité
de l’Asie Française, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge
de 49 ans, chez son frère, M. Jean Terrier, 4, rue de la Plâtrerie, à la
suite d’une longue et cruelle maladie.
Henri
Terrier avait appartenu pendant de longues années aux services administratifs
du Journal des Débats, qu’il dut se résoudre à quitter par suite de
fatigue. Les services qu’il avait rendus à la presse lui valurent d’être nommé
officier d’académie.
Plusieurs
de ses anciens collègues sont venus se joindre à ceux de nos concitoyens qui
ont bien voulu suivre son cercueil. MM. Terrier frères, ainsi que Mme veuve
Henri Terrier et la
annécien,
le lieutenant Jean Fontaine-Vive (1895-1917), mort au champ d’honneur. Outre
ces premières « fleurs », M. Désormaux a recueilli dans ce volume des « Poèmes
écrits pendant la guerre » (complément de la belle plaquette parue antérieurement
sous le titre de Jeunesse Ardente), des extraits de la correspondance adressée
par Jean Fontaine-Vive à sa famille, et une série de Poèmes nouveaux.
Le recueil, ornée d’un portrait, est précédé d’une préface et d’une biobibliographie
dues à M. J. Désormaux.
42 L’Abeille
d’Étampes 110/11 (13 mars 1921), p. 2.
famille
les remercient vivement les uns et les autres de cette marque de sympathie
à laquelle ils sont très sensibles.
[…] États
civils — Commune d’Étampes. […] Décès […] Du
5. Henri-Claudius
Terrier, secrétaire administratif du Comité de l’Afrique Française, 49 ans,
rue de la Plâtrerie, 4. […]
-
Remarques
historiques de Jean (1923) 43
«
Académie Florimontane — Annecy. — Séance du 11 avril 1923 . […]
«
Notre collègue M. Jean Terrier, imprimeur à Étampes, écrit qu’en parcourant
L’Abeille d’Étampes de 1860, il a trouvé, à la date du 30 juin,
un article qui rend compte de la manière dont le curé de Boissy-la-Rivière
a célébré la réunion de la Savoie à la France. Le 17 juin, ce curé, l’abbé
Joseph Bel, de Rumilly, “est monté en chaire et a témoigné, d’une voix émue,
toute sa reconnaissance aux événements qui lui avaient rendu le titre de citoyen
français, et il a fini son allocution en invitant ses paroissiens à se rendre,
à l’issue de l’office, au presbytère, où
une
collation toute fraternelle les attendait pour fêter en commun l’annexion”.
|46
«
L’abbé Bel desservit pendant 36 ans la paroisse de Boissy- la-Rivière (Seine-et-Oise),
et y mourut le 22 décembre 1880.
«
M. Terrier ajoute que d’autres ecclésiastiques savoyards occupaient des postes
dans le diocèse de Versailles et il cite M. l’abbé Bize, curé de Saclas, et
M. l’abbé Quenard, curé de Guillerval. »
43 Revue
Savoisienne 64 (1923), pp. 46-46 et 150
«
Académie Florimontane — Annecy. — Séance du 3 octobre 1923.
«
M. Jean Terrier, imprimeur à Étampes, nous adresse une liste de quinze prêtres
savoyards qui ont exercé leur ministère dans le diocèse de Versailles, au
cours du XIXe siècle. Ces
prêtres avaient été recrutés en Savoie par Mgr Mabille, évêque de Versailles, qui lui-même avait pris
en main toutes les formalités d’incorporation, veillant avec un soin jaloux
à ce que son personnel fût une élite. »
-
Annuaire
d’Étampes (1925) 44
« Terrier,
Léon, directeur de L’Abeille d’Étampes, rue Saint- Jacques, 130.
«
Terrier Jean, directeur d’imprimerie, rue de la Plâtrerie, 4.
« Terrier,
Léon, fils, rédacteur de L’Abeille d’Étampes, rue des Cordeliers, 31
bis. »
-
Décès
de Jean à Annecy (1925) 45
Séance
du 1er juillet 1925. — Présidence
de M. Miquet, président. — La séance est ouverte
à 17 heures. Après lecture du procès-verbal de la réunion précédente, qui
est approuvé, le Président s’exprime ainsi :
«
Messieurs,
«
Nous avons appris avec un vif regret la mort, de notre excellent collègue,
M. Jean Terrier, maître-imprimeur à Étampes, décédé le 7 juin dernier, à Annecy,
sa ville natale, à
44 Almanach
d’Étampes pour 1925, p. 179.
45 Revue
savoisienne 66 (1925), p. 124.
laquelle
il était venu, depuis quelques semaines, demander un allégement à ses souffrances.
«
Pendant plus de quarante années, M. Terrier, professionnel hors de pair, prote
consciencieux et averti, s’était fait remarquer à l’imprimerie Abry par ses
mérites et le soin qu’il apportait à la composition de la Revue Savoisienne,
et la Florimontane lui avait accordé, dans son assemblée générale du 14 janvier
1914, une médaille d’honneur en témoignage de gratitude.
«
Peu de temps avant la grande guerre, il avait acquis à Étampes, une imprimerie
dont l’importance était en rapport avec ses aptitudes, mais il n’oubliait
pas son pays, et il nous envoyait en 1923 deux communications sur des ecclésiastiques
savoyards qu’il avait découverts dans le diocèse de Versailles.
«
Nous garderons de M. Terrier le meilleur souvenir. J’adresse à sa veuve et
à ses fils, ainsi qu’à toute sa famille et spécialement à notre éminent collègue,
M. Auguste Terrier, nos respectueuses condoléances. »
-
Nécrologie de Jean dans L’Abeille (1925)
46
JEAN. TERRIER
L’Abeille
d’Étampes a la douleur de faire part à ses lecteurs et à ses
amis de la mort du directeur de son imprimerie, M. Jean Terrier, décédé dimanche
7 juin, à l’âge de 66 ans, à Annecy (Haute-Savoie).
Originaire
de ce pays, Jean Terrier entra à 1’âge de 13 ans dans une imprimerie ·semblable
à la nôtre où il fit son apprentissage dans les dures conditions où
on le faisait
46 L’Abeille
d’Étampes (juin 1925), p. 1.
autrefois.
Puis, une fois ouvrier, il partit à Genève, ville où la typographie était
en honneur, pour se perfectionner dans sa profession. C’était en effet un
ouvrier de l’ancienne école, un artisan qui considérait son métier comme un
art. Il en avait fait le but de sa vie et dans maints concours, notamment
à l’Exposition de 1900, ses travaux lui avaient valu des distinctions officielles.
Il
avait à peine 22 ans que son ancien patron le rappelait et lui donnait la
direction de ses ateliers qu’il assura, sous son successeur, jusqu’au jour
où il prit, à la suite de M. Lecesne, avec M. Léon Terrier, son frère, la
direction de la Société d’imprimerie Terrier frères et Cie et du journal L’Abeille
d’Étampes. À un âge où tant d’autres songent déjà au repos, il pensa de
suite à faire bénéficier de ses capacités professionnelles la vieille maison
dont il prenait la tête.
C’était
en avril 1914 ; quelques mois après éclatait le grand cataclysme — qui dure encore. La mobilisation avait enlevé aux deux
journaux d’Étampes leur direction et la plus grande partie de leur rédaction
et de leur personnel. Jean Terrier, aidé de notre regretté prote Charles Quérard,
rassembla jeunes et vieux et sous sa direction parut L’Abeille-Réveil d’Étampes
dont on n’a pas oublié la belle tenue, l’optimisme, l’esprit d’union
sacrée.
Pendant
la guerre et depuis, tous ceux de nos lecteurs, tous ceux des clients de notre
imprimerie qui avaient affaire dans nos bureaux ont été accueillis par cet
homme dont l’obligeance, la bonté et la sereine philosophie, même aux heures
les plus inquiétantes de 1914 et de 1918, faisaient de tous un ami.
Puis
un jour, en décembre dernier, on ne le vit plus à son poste. D’une robuste
santé, aimant sa tâche quotidienne comme tous ceux qui considèrent le travail
comme le but de la vie, Jean Terrier n’avait su, n’avait pu, par la force
des choses, l’âge venant, envisager un repos qu’il avait bien mérité cependant
par 52 années de dur labeur. La maladie qu’il n’avait jamais connue
jusqu’alors
l’avait atteint ; malgré des soins éclairés et affectueux, elle l’emportait,
dimanche matin, dans son pays natal qu’il eut cette dernière satisfaction
de revoir en des jours ensoleillés.
Si
les clients de la maison étaient ses amis, ses ouvriers — dont il connaissait, étant travailleur lui-même, les
aspirations, les besoins — lui portaient une affection
presque filiale ; ils perdent en lui le Maître vénéré qui savait leur faire
aimer l’art typographique et qui fut toujours pour eux un patron juste et
soucieux d’améliorer dans la mesure du possible leur situation.
La
dureté des temps fit qu’il ne songea pas assez à lui- même… Mais quand il
vit que son mal, dont la gravité lui avait été cachée, allait 1’emporter,
c’est avec la satisfaction du devoir accompli qu’il a pu évoquer sa longue
carrière de travail et d’honneur et donner sa dernière pensée à cette maison
d’imprimerie de la rue de la Plâtrerie où il laisse son fils pour continuer
son œuvre, un personnel pénétré de ses enseignements pour l’y aider.
Nous
demandons à tous nos lecteurs de garder dans leur souvenir le nom de Jean
Terrier comme celui d’un des maîtres qui depuis un siècle ont contribué à
la prospérité de notre journal et qui en ont fait un lien si utile et apprécié
entre les divers membres de la grande famille Étampoise.
La
Rédaction.
Les obsèques
de M. Jean Terrier ont eu lieu mardi après-midi, à Annecy, dans un tombeau
de famille. Une foule considérable suivait le cercueil qui disparaissait littéralement
sous les gerbes de fleurs et les couronnes.
Au cimetière,
en présence des notabilités, plusieurs discours furent prononcés et le délégué
de l’Amicale des Protes de France adressa un adieu ému à l’excellent confrère
qui, devenu patron par son labeur, n’oublia jamais les humbles. C’était là
le plus bel adieu que pouvait espérer notre directeur.
Puissent
sa veuve inconsolable, ses enfants et ses frères, trouver une atténuation
à leur douleur dans cette manifestation d’ardente sympathie.
-
Léon
Francis officier d’académie (1926) 47
«
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, vu les décrets des
24 décembre 1885, 25 mars 1921, 4 février 1922 et 13 décembre 1924, arrête
: Sont nommés […] Officiers d’académie : […]
«
Terrier (Léon-François [sic]), publiciste à Étampes (Seine- et-Oise).
[…]
«
Fait à Paris, le 12 février 1926. – Daladier. »
-
Nécrologie
parisienne d’Auguste (1932) 48
MORT DE M. AUGUSTE TERRIER
C’est
avec un vif regret que nous apprenons la mort, survenue à Annecy, de notre
confère Auguste Terrier, secrétaire général du Comité de 1’Afrique française,
professeur à l’École libre des sciences politiques et à l’École coloniale,
conseiller de l’Office du protectorat public.
M
Auguste Terrier était né en 1873. Rédacteur au Journal des Débats,
il s’était consacré de bonne heure aux questions africaines et était devenu
très vite l’un des animateurs du comité de l’Afrique française.
47 Journal
officiel de la République française 58/38 (14 février
1926), pp. 2039, 2048, 2075 et 2078.
48 L’Écho
de Paris 48/19186 (28 avril 1932), p. 2.
Les
grandes missions qui pénétrèrent l’Afrique noire, dans les dernières années
du XIXe siècle, l’eurent
comme conseil et comme organisateur, et le général Meynier a pu le faire
figurer parmi les « conquérants du Tchad ». Lorsque se posa la question du
Maroc, M. Auguste Terrier fonda avec Eugène Étienne le comité du Maroc et
contribua puissamment à créer
l’irrestible
courant d’opinion qui aboutit au protectorat.
M.
Auguste Terrier devint, par la suite, directeur de l’Office français au Maroc
et continua à se consacrer aux campagnes destinées à faciliter la consolidation
et à l’organisation de l’Afrique française, notamment à la campagne pour le
Transsaharien.
Son
autorité dans les milieux coloniaux et africains était considérable. Elle
a rayonné sur les jeunes générations, notamment par ses cours à l’École des
sciences politiques et à l’École coloniale. Avec lui disparaît un haut exemple
de conscience professionnelle, une belle figure de la presse française et
l’un des meilleurs artisans de l’expansion de notre pays, dont il a eu le
grand bonheur de voir l’épanouissement.
M.
Auguste Terrier était commandeur de la Légion d’honneur Les obsèques auront
lieu à Annecy demain 29 avril, à 9 h. 30.
-
Nécrologe
étampoise d’Auguste (1932) 49
AUGUSTE TERRIER
Au
mois de novembre dernier, l’Abeille d’Étampes avait le grand plaisir
de donner la relation d’une cérémonie au cours de laquelle son ancien rédacteur
en chef, M. Auguste Terrier,
49 L’Abeille
d’Étampes 121/17 (30 avril 1932), p. 1.
secrétaire
général du Comité de l’Afrique française, avait reçu des mains d’Albert Lebrun,
président du Sénat, une plaquette, en souvenir de l’effort opiniâtre qu’il
avait accompli pendant plus de quarante années pour le développement de notre
expansion coloniale et le succès de la dernière Exposition coloniale en particulier.
Nous
avons la douleur d’annoncer aujourd’hui qu’Auguste, Terrier qui s’était rendu
dans son pays natal, à Annecy, dans l’espoir d’y rétablir sa santé compromise
par l’excès de travail, qui était sa règle de vie depuis sa plus tendre jeunesse,
y est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, malgré les soins éclairés et
affectueux dont il était entouré.
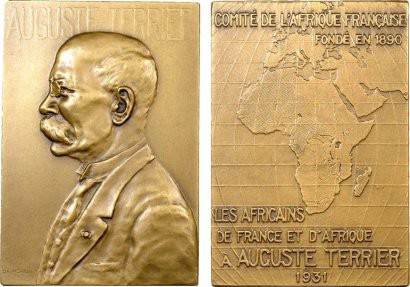
Auguste
Terrier
(par François
de Hérain)
Né
en 1873, Auguste Terrier fut au Lycée d’Annecy un brillant élève, sur lequel
ses maîtres fondaient les plus belles espérances ; mais il dut, à peine bachelier,
entreprendre la lutte pour la vie et demanda au journalisme ses moyens d’existence,
ce
qui ne l’empêcha pas de poursuivre ses études et à l’âge où les soucis de
chef de famille deviennent pressants, de passer brillamment son examen de
licence en droit.
La
mort si brutale, d’un des nôtres aussi, M. Percher50,
fit
qu’Auguste
Terrier eut à assumer, tout jeune, la charge du secrétariat général du Comité
de l’Afrique française, et ceux-là seuls qui ont suivi avec attention le mouvement
colonial depuis un demi-siècle peuvent se rendre compte du labeur énorme
qu’il a fallu accomplir pour mener cette œuvre à bien. Il est mort à la peine,
laissant le meilleur souvenir à tous ceux qui l’ont connu, et hautement estimé
des pouvoirs publics, qui avaient bien voulu reconnaître ses services par
l’éoile de commandeur de la Légion d’honneur.
Auguste
Terrier avait scellé les liens qui l’unissaient à notre ville en épousant
en 1901 l’une des filles de M. Lecesne-Allien, alors imprimeur et directeur
de L’Abeille d’Étampes. De cette union sont nés deux vertueux enfants,
qui, ainsi que Mme Auguste
Terrier, firent le charme de son foyer et qu’il eut la dernière joie de voir
réunis autour de lui dans ses derniers moments.
Au
nom de tous ses amis connus et inconnus, l’Abeille d’Étampes présente
à la veuve et aux orphelins l’expression de sa douloureuse sympathie et adresse
à sa mémoire le témoignage de son admiration et de sa reconnaissance.
*
L’Écho
de Paris a bien voulu rappeler en ces termes l’œuvre accomplie
par Auguste Terrier :
«
Rédacteur au Journal des Débats, etc. [Voyez ci-dessus (B.G.)]…
dont il a eu le grand bonheur de voir l’épanouissement. »
50 Hippolyte
Percher (1857-1895) plus connu sous son nom de plume Harry Alis, autre gendre
de Lecesne-Allien, mort en duel (B.G.).
-
Nécrologie
africaniste d’Auguste (1932) 51
AUGUSTE TERRIER
Né
le 11 juillet 1873, Auguste Terrier est mort le 27 avril 1932, âgé seulement
de 59 ans. Secrétaire depuis la fondation (1890), puis secrétaire général
(1899) du Comité de l’Afrique française, il y consacra l’activité
de toute sa vie et en fut véritablement l’âme. Sous son impulsion le Bulletin
du Comité de l’Afrique française, devenu plus tard l’Afrique française
devint un remarquable organe de documentation sur notre empire africain
; il y réunit une quantité considérable de matériaux qui constituent une véritable
histoire de notre colonisation en Afrique, et en fit également un organe
de défense des intérêts français en Afrique du Nord et en Afrique noire.
Chargé
de nombreuses missions au Maroc et en Afrique occidentale, il créa en 1913
l’Office du Protectorat du Maroc, et fut après la guerre et jusqu’en 1924
délégué du Haut- Commissariat de la République en Syrie et au Liban. Son activité
coloniale fut énorme et il exerça une influence très forte sur les coloniaux
des jeunes générations.
Outre
les innombrables articles qu’il publia dans le Bulletin du Comité de l’Afrique
française, on lui doit en particulier les ouvrages suivants : L’œuvre
de la troisième République en Afrique occidentale, Paris, Larose, 1910,
558 p. (publié avec Charles Mourey) ; Le Maroc, Paris, Larousse, 1931,
224 p. ; L’Afrique équatoriale française, Paris, Plon, 1931 (Gabriel
Hanotaux et Alfred Martineau. Histoire des colonies françaises et de l’expansion
française dans le monde, t. IV).
51 Journal
de la Société des Africanistes 2/2 (1932), p. 244.
Rien
de ce qui touchait aux questions africaines ne le laissait indifférent ; lorsque
se constitua la Société des Africanistes, il fut parmi ses fondateurs et
ce sera toujours un grand honneurpour nous qu’il ait bien voulu en accepter
la vice- présidence.
P.
Lester.
-
Léon Terrier passe la main à Dormann (1934/1935)
La
série des Abeille d’Étampes en ligne est malheureusement lacunaire,
à l’heure qu’il est, pour 1934 et 1935. Le 4 août 1934, c’est encore Léon
Terrier qui est directeur général, et l’imprimerie est au nom de M. Terrier.
En revanche le numéro du 13 avril 1935 trouve Maurice Dormann « directeur
politique » et René Collart « directeur général » de L’Abeille d’Étampes.
-
Accident
de Léon à Ablis (1937) 52
M.
LEON TERRIER VICTIME D’UN ACCIDENT
Notre
collaborateur et ami, M. Léon Terrier, gérant de L’Abeille, a été victime,
dimanche dernier [9 mai 1937], dans l’après-midi, d’un accident d’automobile.
Il
se rendait, en compagnie de Mme Terrier et de deux
membres
de sa famille, à la fête du Muguet, lorsqu’à Ablis, une voiture Renault conduite
par des jeunes gens, vint tamponner à un carrefour l’auto que Mme Terrier pilotait.
52 L’Abeille
d’Étampes 125/20 (15 mai 1937), p. 1.

Le
choc fut rude et l’auto réduite en miettes. Des quatre occupants, M. Léon
Terrier fut le plus touché. On put cependant le ramener en ambulance à son
domicile à Étampes où l’on constata qu’il avait plusieurs côtes fracturées.
Mme Terrier, elle, ne souffrait que de quelques contusions sans gravité. Quant
aux
deux jeunes gens qui les accompagnaient, ils en avaient été quittes pour la
peur.
Aux
dernières nouvelles, l’état de notre cher collaborateur est des plus satisfaisants.
Il ne lui faut plus qu’un bon repos. C’est du fond du cœur que nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.
-
Décès
de Léon (1937) 53
«
M. Léon Terrier, 67 ans, ancien directeur de L’Abeille d’Étampes, succombe
à ses blessures recues au cours d’un accident d’automobile, dimanche dernier
[9 mai] à Ablis. »
-
Nécrologie
parisienne de Léon (1937) 54
Nous
apprenons la mort de M. Léon-Francis Terrier .ancien directeur de L’Abeille
d’Étampes, officier de l’Instruction publique, décédé à Étampes, des suites
d’un accident, dans sa soixante-huitième année. Ses obsèques auront lieu
demain mardi, 18 mai, à 10 h. 30, en l’église Saint-Gilles, sa paroisse.
Il
était le frère d’Auguste Terrier qui fut secrétaire général du Comité de l’Alliance
française, de Louis Terrier, ancien secrétaire de l’administration du Journal
des Débats et de Henri Terrier, également notre collaborateur.
53 Le Matin
54/19.413 (dimanche 16 mai 1937), p. 6 :
54 Le Journal
des débats 149/136 (18 mai 1937), p. 2.
-
Nécrologie
étampoise de Léon (1937) 55
«
L’ABEILLE » EN DEUIL
Je
ne me doutais guère, en mettant L’Abeille sous presse, jeudi après-midi,
13 mai, que notre cher Léon Terrier décéderait le lendemain matin, trop tard
pour que nous puissions porter la triste nouvelle à la connaissance de ses
innombrables amis.
Je
l’avais vu moi-même quelques instants plus tôt, immobilisé sur son lit de
souffrance après ce stupide accident d’automobile, pestant contre une blessure
qui le devait retenir quelques semaines à la chambre, mais rien ne faisait
prévoir une fin aussi rapide et aussi tragique.
Nous
en restons tous désemparés, sa famille, ses collaborateurs, ses bons camarades,
et le signataire de ces lignes.
Et
maintenant, que pourrais-je dire de Léon Terrier, que tous les lecteurs de
ce journal.ne sachent mieux que moi ? devrai-je rappeler son talent, sa probité,
sa modestie, sa bonté, toutes qualités qui demeurent gravées sur un livre
d’or de quarante années de travail acharné et le dévouement consacrés au service
de L’Abeille d’Étampes ?
Durant
vingt ans, il fut le directeur éminent et intègre de cette feuille.
Toutes
les choses, tous les objets qui m’entourent portent son empreinte profonde
et ne cessent de me parler de lui.
Léon
Terrier, spectateur repu de l’inanité des hommages posthumes, et trop modeste
ouvrier devant l’Éternel, a demandé sur son testament qu’on ne prononce devant
son cercueil aucun discours et qu’on ne dépose aucune fleur sur son tombeau.
Que ses dernières volontés soient respectées, mais qu’il me permette
55 L’Abeille
d’Étampes 125/21 (22 mai 1937), p. 1.
à
tout le moins de lui dire ici, sur le « papier »-qu’il a tant aimé, l’estime
et l’affection que je lui portais.
Je
le considérais comme un bon maître, comme un père, et je l’aimais comme tel.
Lorsque sonna pour lui le moment de me passer la direction de ce journal,
je sentis dans son cœur s’opérer un tel déchirement dissimulé sous une résignation
si émouvante, que je fus pris à son endroit d’une affection spontanée et filiale
qui ne fit que gagner en profondeur et étendue avec le temps.
Puis
il voulut bien, peu à peu, m’accorder sa confiance et, depuis, nous ne cessâmes
point de vivre dans une mutuelle sympathie.
Son
expérience, ses connaissances, son exemple furent jusqu’au dernier jour des
biens précieux pour moi.
Qu’aurais-je
fait sans lui, à la tête de cette Abeille, petite par le format, mais
si grande par l’influence et le prestige, si je n’avais eu près de moi « papa
» Terrier pour me guider dans l’inconnu ?
Si
j’ai pu reprendre le flambeau de ses mains et m’efforcer de conserver sa flamme,
c’est à son concours que je le dois.
Devant
sa dépouille mortelle, je m’incline profondément et je me souhaite à moi-même
d’être imprégné de son exemple et digne de sa mémoire.
René Collard.
NOTES BIOGRAPHIQUES
Léon-Francis
Terrier était né le 1er juillet
1869, à Annecy, sixième enfant. d’une famille de 7 garçons et d’une fille.
Il fit ses études secondaires au lycée de cette ville, puis accomplit son
service militaire au 11e bataillon
de chasseurs alpins à Annecy. Son service terminé, il devint correspondant
d’une agence d’informations à Bizerte, dirigée par M. Percher, gendre de .M.
Lecesne, alors directeur de L’Abeille. A la suite d’un
duel,
au cours duquel M. Percher trouva la mort, il entra comme rédacteur au Journal
des Débats, dont son frère Louis était le secrétaire général.
Il
vint alors à Étampes en 1897, et devint le collaborateur de
M.
Lecesne à L’Abeille.
À
ce moment, M. Louis Terrier, outre ses fonctions à Paris, était rédacteur
politique de L’Abeille.
A
la suite de son décès, M. Auguste Terrier, autre frère de Louis et de Léon,
assura cette rédaction sous la signature de Paul Clermont ou la sienne propre.
Léon-Francis
Terrier se maria à Étampes le 23 octobre 1899. Il eut successivement deux
fils, Henry et Olivier, qui sont aujourd’hui, le premier géomètre et, le second,
rédacteur à la Préfecture de police.
Léon
Terrier devint Directeur de L’Abeille au début de 1914, s’associant
avec son frère Jean pour l’exploitation de la Société d’ Imprimerie Terrier
frères et Cie.
Dès
le premier jour de la guerre, Léon Terrier fut mobilisé dans une formation
des G. V. C. en gare d’Étampes. C’est à cette époque, jusqu’en octobre 1916,
qu’il organisa, avec la société de gymnastique Les Enfants de Guinette,
la préparation militaire des jeunes classes, dont il fut l’animateur.
Après quoi, on l’affecta comme instructeur au Centre d’Instruction Physique
de Romorantin.
Léon
Terrier était officier de l’instruction publique, vice- Président des Enfants
de Guinette, vice-Président de la Section des Vétérans. Outre ses
fonctions de gérant à L’Abeille, il collaborait régulièrement à L’Écho
de Savoie où il publiait chaque semaine des articles en patois fort goûtés
des Savoyards.
AUX ENFANTS DE GUINETTE
Léon
Terrier, depuis 40 années, a toujours eu en grande estime la Société Les
Enfants de Guinette et honorait d’une
solide
amitié le moniteur-chef, Fernand Girard, qui en était fier et touché et la
lui rendait bien ; une identique communauté d’idées les rassemblait.
Pendant
la guerre, les moniteurs étant tous partis aux armées combattantes, c’est
avec un dévouement inlassable qu’il seconda le Président d’alors, son ami,
M. Félix Chanon, le Vice-Président, M. Téton, et M. Louis Jousselin dans la
préparation militaire des jeunes gens qui rejoignaient leurs aînés, au fur
et à mesure de l’appel de leurs classes. Quand vint la création du brevet
de préparation militaire, il aida, par ses connaissances techniques, le Directeur
dans l’enseignement des appelés et de ceux qui désiraient devancer l’appel.
Son
rôle d’informateur public, malgré ses attaches profondes avec la société,
l’avait empêché d’entrer ouvertement dans son sein, mais lors du dècès de
M. Téton, il céda aux sollicitations affectueuses qui lui furent adressées
; il fut nommé vice- président le 29 avril 1929 et coopéra ainsi à la vie
active des Enfants de Guinette. Dans les diverses réunions, son jugement
juste et pondéré, sa grande bienveillance envers les membres actifs lui avaient
attiré, de leur part, une grande reconnaissance et, soit à leurs fêtes, soit
à leurs banquets, c’est toujours avec le plus grand plaisir qu’il y assistait.
D’un esprit qui avait conservé, malgré le temps, toute l’ardeur de la jeunesse,
il aimait cette jeunesse, il suivait de près et avec intérêt ses travaux et
avait été heureux de faire, avec elle, quelques longs déplacements.
Aussi,
en perdant leur vice-président, les Enfants de Guinette vont se trouver
maintenant en présence d’un grand vide causé par cette disparition trop tôt
survenue de l’un de leurs meilleurs guides.
AUX VETERANS
Léon
Terrier était vice-président de la 1359e section des Vétérans des Armées de Terre, de Mer et
de l’Air. Il avait été élu à ce poste en 1924 et y avait toujours été
maintenu depuis.
Il
entra à la section en 1899 et fut nommé membre du bureau le 19 mai 1901.
Il
devint pensionné en 1920.
Nul
plus que lui n’était fidèle à toutes les réunions et assemblées auxquelles
il se faisait un devoir d’assister. S’il n’était pas un des doyens par l’âge,
il l’était certainement par le grand nombre d’années (38) passées au milieu
de ses camarades de la section.
LES OBSEQUES
Les
obsèques de notre cher collaborateur ont eu lieu mardi dernier, en l’église
Saint-Gilles et au cimetière Notre-Dame Nouveau.
De
nombreux amis avaient tenu à l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure.
Des
nombreux élus de la région, M. Maurice Dormann en tête, et des confrères du
département, au nombre desquels figurait M. Robert Durocher, directeur de
la Gazette de Seine- et-Oise, étaient venus lui rendre un suprême hommage.
Une délégation des Enfants de Guinette et une autre des Vétérans
accompagnaient le cortège. Les cordons du poêle étaient tenus par
MM. Marcel Duclos, Paul Jousset, Fernand Girard, Lucien Renard et René Collard.
Le
défunt, ayant déclaré dans ses dernières volontés ne vouloir ni fleurs, ni
couronnes, ni discours, ses obsèques revêtirent ainsi une émouvante simplicité
à la mesure du modeste et honnête homme qu’il ne cessa d’être toute sa vie.
Aussi bien les fleurs et les hommages étaient-ils dans le cœur de tous ceux
qui le menèrent jusqu’à sa tombe et la crispation des visages en disait plus
long que les plus longs discours.
À
Mme Léon Terrier, digne compagne de cet être exquis que nous pleurons aujourd’hui,
à ses enfants et à tous ceux qu’atteint ce deuil prématuré et tragique, nous
présentons nos respectueuses et attristées condoléances.
*
À
peine la tombe vient-elle de se refermer sur notre regretté ami Léon Terrier,
que nous apprenons une autre triste nouvelle : sa belle- fille, Mme Yvonne Terrier, épouse de
M. Olivier Terrier, rédacteur à la Préfecture de Police et fils de notre regretté
collaborateur, est décédée à son tour subitement·à la suite d’une opération
chirurgicale, mercredi, à son domicile à Paris.
La
défunte, qui n’était âgée que de 32 ans, laisse un mari éploré et une petite
fille de deux ans.
Les
obsèques religieuses auront lieu samedi 22 courant, à 9 heures, en l’église
Saint-Séverin, rue St-Jacques, Paris, et l’inhumation au cimetière Notre-Dame
nouveau, le même jour, vers 11 heures 30.
Le
présent avis tient lieu d’invitation.
À
la famille, si durement éprouvée, nous adressons nos douloureuses condoléances.
[…]
REMERCIEMENTS D’OBSEQUES
Étampes.
— Mme Veuve Terrier,
MM. Henri et Olivier Terrier et la famille, très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l’occasion du décès de M. LÉON TERRIER remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil.
Ils
s’excusent auprès de celles qui n’auraient pas été avisées.
-
Décès
de Léon Louis Terrier à Paris (1968) 56
«
Décédé à Paris (10ème) le 13 juin 1968 — Le 28 septembre
1968, le greffier en chef. [Signé :] E. Sender. »
56 Deuxième
mention marginale à son acte de naissance de 1889 à Annecy, AD74
4E 2781.
Table des
Matières
Préface
3-7
Nouvelles
et contes
de
l’arrière, 1914-1916
par Léon Terrier
|
I
.
|
Le
Noël de Marthe
|
13-30
|
|
II.
|
Poupée
de Noël
|
32-43
|
|
III.
|
L’espion
|
44-57
|
|
IV
|
Le
Châtiment
|
58-90
|
|
V
|
Le
pardon de Francine
|
92-115
|
|
VI
|
Grand’Mère
|
116-145
|
Terrier-Frères,
Une
histoire étampoise, 1884-1934
par
Bernard Gineste
49
documents 147-217
Nouvelles
et contes
|
Préface
|
3-7
|
|
I
.
|
Le
Noël de Marthe
|
13-30
|
|
II.
|
Poupée
de Noël
|
32-43
|
|
III.
|
L’espion
|
44-57
|
|
IV
|
Le
Châtiment
|
58-90
|
|
V
|
Le
pardon de Francine
|
92-115
|
|
VI
|
Grand’Mère
|
116-145
|
de
l’arrière, 1914-1916
Terrier-Frères
Une histoire
étampoise, 1884-1934 (49 documents)
147-217
|
BHASE n°30
(juillet 2016)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de
ce numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase030w.pdf
|
|
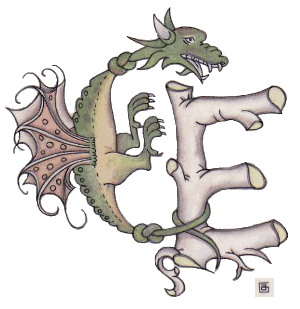
|