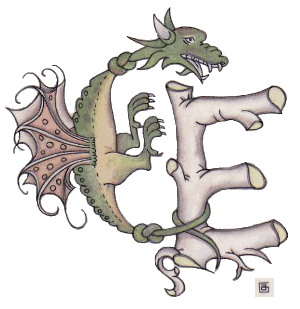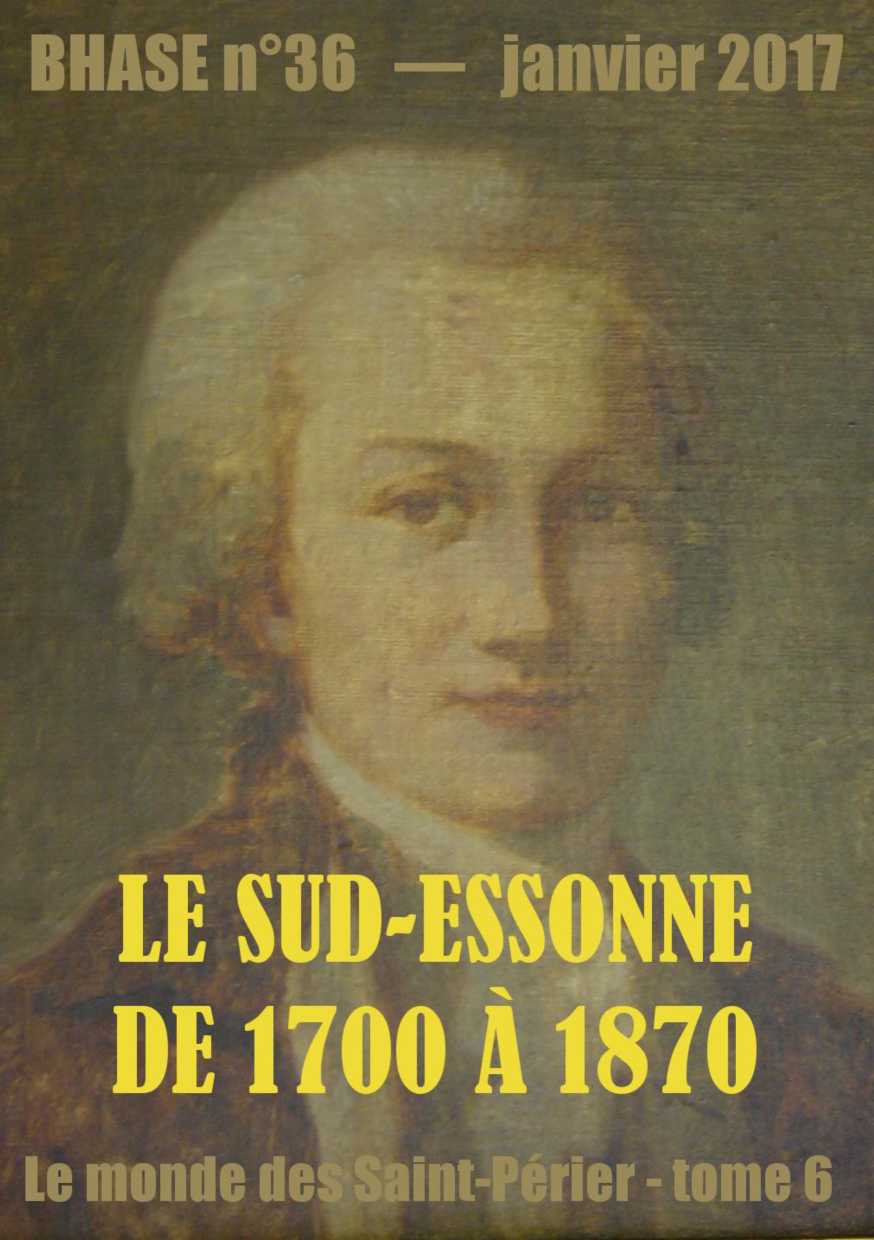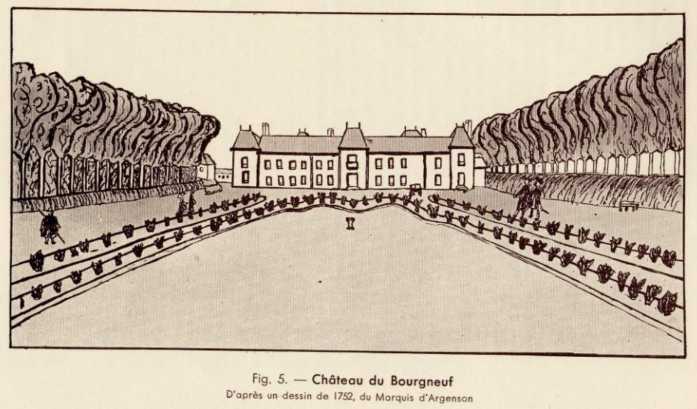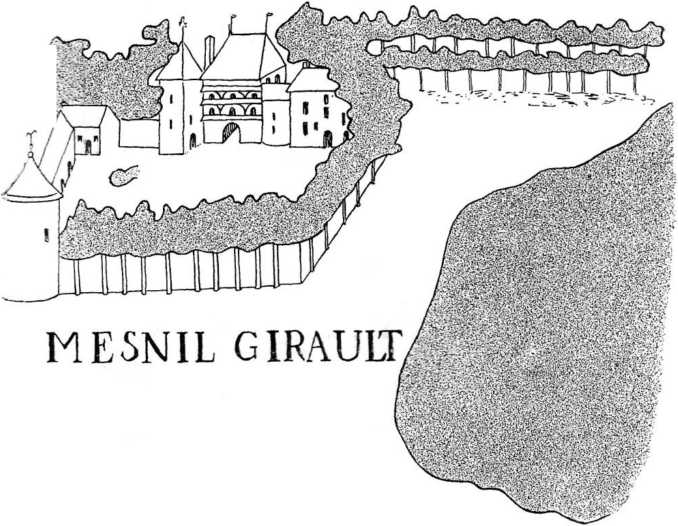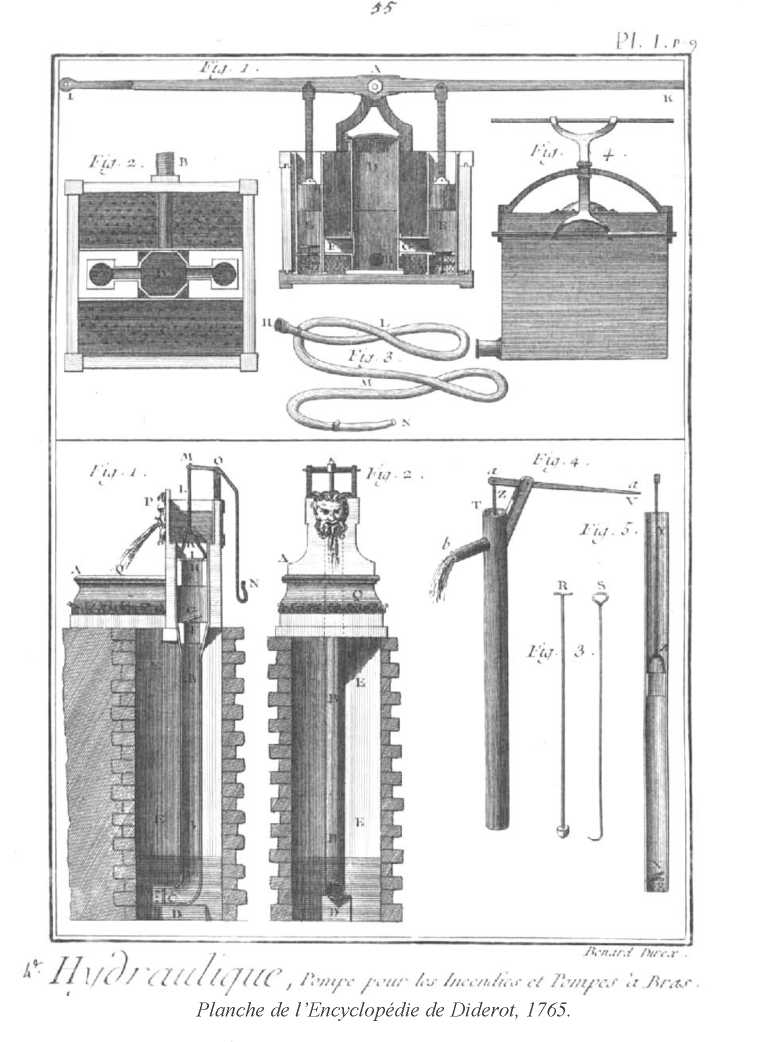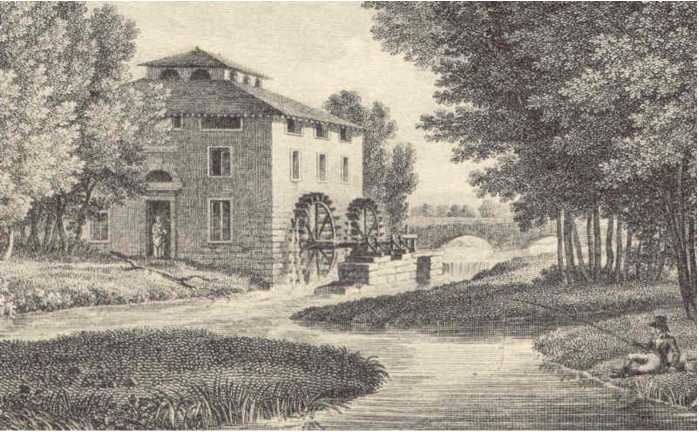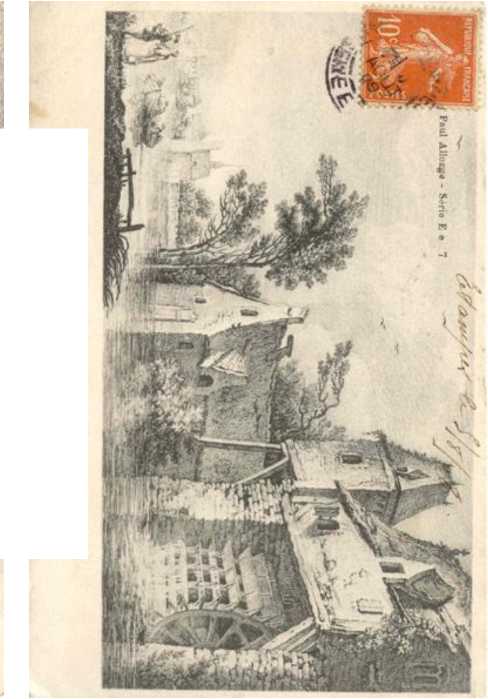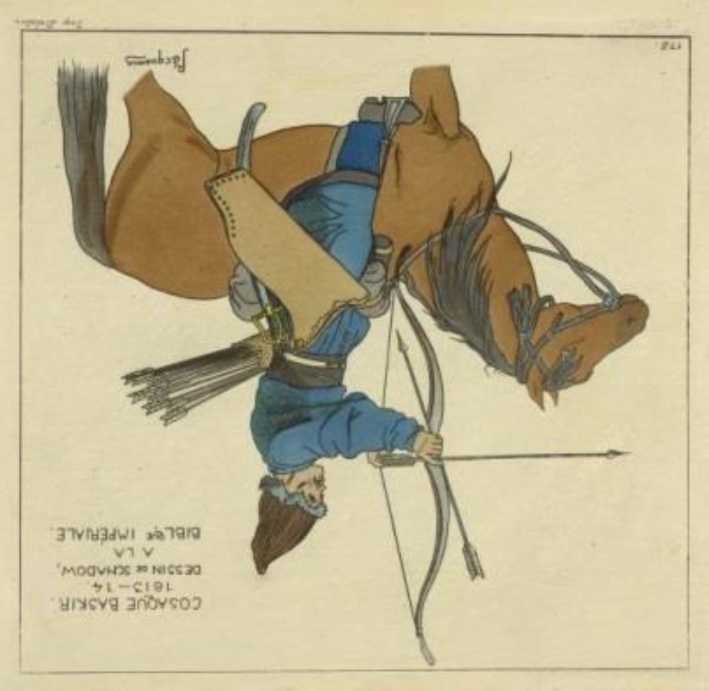|
BHASE n°36
(janvier 2017)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase036w.pdf
|
|
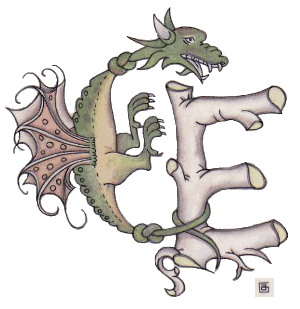
|
Le monde des Saint-Périer
— tome 6 LE SUD-ESSONNE DE 1700 À 1870
Préface.—Bibliographie.—01. Le XVIIIe
siècle.
— 02. Gentilshommes de Beauce. — 03. Les Dépenses
d’un gentilhomme étampois au XVIIIe siècle. — 04. Une ancienne
vue de Mesnil-Girault. — 05. La première pompe à incendie a Étampes.—06.
La Police municipale à Étampes en 1779. — 07. Le chien pêcheur des Cordeliers d’Étampes.
— 08. Les Plantes des Environs d’Étampes au xvme siècle.—09. Jean
Guettard.
— 10. Malesherbes botaniste. — 11. Le Temple de
Jeurres.—12. Le Gué des Sarrasins.—13. La Juine navigable. — 14. La Révolution
et le XIXe siècle. — 15. Le premier musée d’Étampes. —
16. Les Cosaques à Étampes en 1814 et le pillage du
château de Bois-Herpin.—17. Le passage de la duchesse de Berri à Étampes
en 1828. —
18. Le choléra à Étampes en 1832 et en 1849. —
19. une inondation à Étampes en 1841. — 20. À propos
de Geoffroy-Saint-Hilaire.
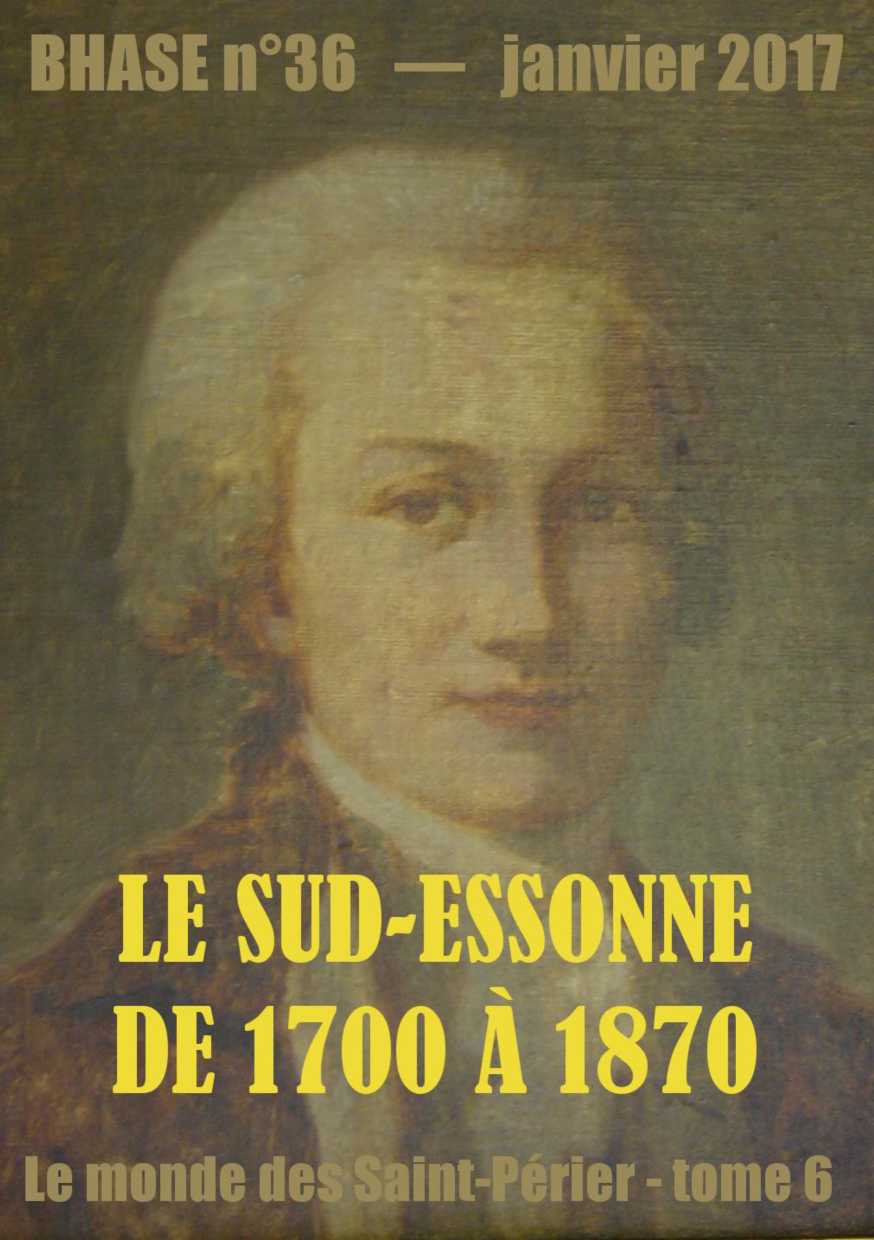
ISSN 2272-0685
Publication du Corpus Étampois Directeur de publication
: Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois. com
BHASE n°36
Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne

publié par le Corpus Étampois
janvier 2017
Le monde des Saint-Périer. Tome 6
Le Sud-Essonne

Edité par le Corpus Etampois
de 1700 à 1870
COMITÉ DE LECTURE
Bernard Gineste Bernard Métivier Bernard Minet f
Bernard Paillasson
Préface
Voici le sixième volume des Œuvres Locales Complètes
du comte de Saint-Périer. Il regroupe toutes les études qu’il a consacrées,
de 1919 à 1950, à l’histoire de l’ancien arrondissement d’Étampes pendant
les XVIIIe et XIXe siècles, auxquelles nous avons joint
deux autres articles publiés par sa veuve en 1961 et 1965.
Ce recueil comprend deux parties : la première est
consacrée au XVIIIe siècle sous l’Ancien Régime, et la deuxième
traite de la suite, depuis et y compris la période révolutionnaire, jusqu’en 1871
précisément.
Dans la première partie, on trouvera d’abord une
histoire générale de la ville d’Étampes, à savoir le chapitre IV de La Grande histoire d’une petite
ville, publiée par Saint-Périer en 1938, intitulé
« Le XVIIIe siècle ». Nous la ferons suivre de dix études particulières
relatives à cette période.
La deuxième partie commence par le chapitre suivant
de La Grande histoire, « La Révolution et le XIXe siècle », et elle
se poursuit par six autres articles. L’Histoire s’arrête pour Saint-Périer
peu avant sa naissance. La suite en sera constituée par ses quatre récits
autobiographiques.

René de Saint-Périer
(1877-1950)
Bibliographie des articles
ici réédités
A. — Le XVIII' siècle
01. René de Saint-Périer, « Le XVIIIe
siècle », in La grande histoire
d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition
du Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 71-83. — Réédition posthume
in Étampes. Bulletin
Officiel Municipal (janvier 1966), pp. 13-16.
02. « Gentilshommes de Beauce », in Le Beauceron de Paris 35/4 (juin-octobre 1932), pp. 37-38 ; 35/5 (15 décembre 1932), pp.
48-49 ; 36/2 (avril-juin 1933), pp. 5-7.
03. « Les Dépenses d’un gentilhomme étampois au
XVIIIe siècle », in L ’Abeille d’Étampes - Le Réveil d’Étampes.
Édition spéciale 5/259 (3 mai 1919), pp. 1-2,
sous la rubrique « Variété historique ».
04. « Une ancienne vue de Mesnil-Girault », in
Bulletin de la Société
des Amis du Musée d’Étampes 7 (1929), pp. 47-49.
05. « La première pompe à incendie à Étampes »,
in Le Journal de
Seine-et-Oise 6/204 (26 janvier 1950).
06. « La Police municipale à Étampes en 1779 »,
in L ’Abeille d’Étampes 115/50 (8 décembre 1923), p. 1.
07. « Le chien pêcheur des Cordeliers d’Étampes»,
in L ’Abeille
d’Étampes 117/32 (11 août 1928), sous la rubrique
« Bibliographie étampoise ». — Tiré à part (in-18
; 6 p. ; avec un fac-similé), Étampes, Terrier, 1929.
08. « Les Plantes des Environs d’Étampes au XVIIIe
siècle », in L’Abeille
d’Étampes 113/5 (2 février 1924), p. 1.
09. Raymonde-Suzanne de Saint-Périer, « Jean Guettard
», in
Bulletin des Amis d’Étampes 12 (1965), pp. 9-13.
10. René de Saint-Périer, « Malesherbes botaniste
», in Annales de
la Société Historique et Archéologique du Gâtinais 44 (1938), pp. 1-6 (avec des corrections manuelles de l’auteur
en 1939).
11. « Le Temple de Jeurre », in Bulletin de la Commission des Antiquités
et des Arts de Seine-et-Oise 52 (1945-1948),
pp. 113115.
12. « Le Gué des Sarrasins », in Le Journal d’Étampes 1/32 (3 novembre 1945), sous la rubrique « Étampes dans
le passé »..
13. « La Juine navigable », in Le Journal d’Étampes 2/91 (21 décembre 1946), p. 2, sous la rubrique « Étampes
dans le passé ».
*
B. — Révolution et XIXe
siècle
14. René de Saint-Périer, « La Révolution et le XIXe
siècle », in Id., La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938,
pp. 85-99. — Réédition posthume partielle in Étampes. Bulletin Officiel
Municipal (1er semestre 1967), pp. 13-25 ; (2e
semestre 1967), pp. 9-11 ; (1er semestre 1969), pp. 17-19.
15. « Le premier musée d’Étampes », in Bulletin de la Société des Amis
d’Étampes et de sa région 11 (1961), pp. 30-31.
16. « Les Cosaques à Étampes en 1814 et le pillage
du château de Bois-Herpin », in Conférence des Sociétés savantes, littéraires
et artistiques du département de Seine-et-Oise (1933), pp. 103-106.
17. « Le passage de la duchesse de Berri à Étampes
en 1828 », in L’Abeille
d’Étampes 115/50 (25 décembre 1926), pp. 1-2
— Tiré à part (in-16; 10 p.), sans nom de lieu ni d’éditeur, 1926.
18. « Le choléra à Étampes en 1832 et en 1849
», in Le Journal d’Étampes 3/138 (samedi 15 novembre 1947), p. 3, sous la rubrique
« À travers le temps... ».
19. « Une inondation à Étampes en 1841 », in L’Abeille d’Étampes 120/5 (31 janvier 1931), p. 2, sous la rubrique « Notes d’histoire
locale ».
20. « À propos de Geoffroy-Saint-Hilaire », in
Le Journal d’Étampes 4/2 (10 janvier 1948), p. 2.

01. Le xvnie
siècle >
Réceptions des princes
et du roi Louis XV.— Fête originale en 1 ’honneur
du duc de Bourgogne.— Les imprimeurs d’Étampes.— La vie intellectuelle et l’Académie d’Étampes.— Le naturaliste Guettard.—Le Bourgneuf et la
vie mondaine.—Mesures d’hygiène.— La variole.— Le dernier bourreau.— Étampes, berceau de l’aviation.
Les dernières années du XVIIe siècle et
tout le XVIIIe siècle, jusqu’à la Révolution, s’écouleront dans
le calme pour notre ville. Elle ne traversera plus d’épreuves tragiques,
elle ne sera plus mêlée aux grands événements du royaume. Elle ne retrouvera
pas non plus la prospérité et l’animation qu’elle a connues durant des siècles
: le siège de 1652, s’ajoutant avec toutes ses conséquences à tant de ravages
passés, fut pour elle une atteinte dont elle ne se relèvera pas. Sa grande
histoire est terminée. Elle se débattra, avec tous ses habitants, au milieu
de difficultés financières grandissantes. Cependant, elle vivra, dans
1 On reproduit
ici le chapitre V de La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire
de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 71-83. Réédition posthume in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 5 (janvier 1966), pp. 13-16,
où la série des sous-titres résumant le chapitre est légèrement remaniée
et transformée en intertitres : « Période d’apaisement, de réjouissances, d’activités
neuves. — La vie intellectuelle : les Imprimeurs d’Étampes,
l ’Académie, notre grand naturaliste Guettard. — Le Bourgneuf et la vie mondaine.
Transformation de la ville. Hygiène et sécurité. — Le dernier bourreau et
le droit de havage. Étampes, berceau de l’aviation ». Réédition signée avec une soigneuse
ambiguïté « R. de Saint-Périer, conservateur du Musée d’Étampes », ou « R.
» signifie Raymonde, et non René.
son obscurité ; elle consolidera au moins quelques-unes
de ses acquisitions et s’efforcera de réaliser quelques nouveaux progrès,
dans la mesure où le lui permettront ses faibles ressources. Malgré les abus
dont elle souffre, elle conserve un profond attachement pour le roi, n’ attendant
que de lui les réformes nécessaires. Elle saisira toutes les occasions, petites
ou grandes, de le lui marquer et s’associera à tous les événements qui intéressent
le royaume et la couronne.
Au nombre de ces occasions, il faut compter les réceptions
des membres de la famille royale. En 1700, passe à Étampes le petit-fils
de Louis XIV, second fils du Grand Dauphin, ancien duc d’Anjou2,
|72 roi d’Espagne depuis trois semaines sous le nom de Philippe
V, par suite du testament du précédent roi, Charles II, et de l’ imprudente
acceptation de Louis XIV. Le nouveau roi, qui n’a que dix-sept ans, va prendre
possession de son royaume, accompagné de son frère, le duc de Bourgogne,
père de Louis XV, et d’une escorte innombrable. Il y a quatre carrosses pour
le roi et sa suite immédiate, quatre pour le duc de Beauvilliers, son gouverneur,
quatre encore pour le maréchal de Noailles, plusieurs autres pour diverses
gens de qualité qui les avaient à eux ou les avaient loués et de nombreuses
chaises de poste. Ils arrivent à Étampes le 5 décembre vers midi, par un
beau temps très froid ; le maire et les échevins accueillent le roi à la
porte de la ville, le lieutenant du bailliage Liénart prononce une harangue flatteuse
à l’excès et trois compagnies de milice sous les armes l’accompagnent jusqu’à
l’hôtel des Trois Rois. Les officiers de ville y apportent leurs présents,
qui sont, pour une part, symboliques, mais savoureux, pour une autre : du
pain, du vin et des écrevisses, que l’on jugea « les meilleures du monde
», et les pauvres finances de la ville n’en furent pas plus obérées. Dans
la soirée, le roi et sa suite s’amusèrent à tirer toutes sortes d’oiseaux et
à mettre au net des dessins de maisons et de châteaux qu’ils avaient ébauchés
sur la route, comme la tour de Montlhéry tandis qu’ils étaient arrêtés par
un embarras de voitures à la porte de Linas. Les suisses de la garde, se
référant à un vieil usage, prétendirent qu’il leur était dû un minot de sel,
comme dans toute ville en possession d’un grenier à sel qui recevait le roi.
Le receveur d’Étampes ne voulut point se laisser faire et porta la contestation
devant Philippe V, qui lui donna raison, du fait qu’il était un roi étranger
et non le roi : cette décision fort juste fut très bien accueillie par ceux
de notre ville. Le lendemain matin, après la messe, le nombreux cortège reprit
sa route vers l’Espagne.
En 1705, une fête fut organisée par les chevaliers
de l’arquebuse d’Étampes pour célébrer la conquête du Piémont et les victoires
que Louis-Joseph de Vendôme, duc d’Étampes, venait de remporter sur le prince
Eugène. Ils tirèrent le canon, puis, un feu d’artifice, rue des Cordeliers,
devant l’hôtel de Vendôme, où l’on avait préparé un « souper magnifique »,
qui fut suivi d’un grand bal. Ce duc d’Étampes était connu pour sa bonté
et sa familiarité avec ses soldats, dont il était fort aimé. Le chevalier
de Quincy, qui servait sous lui dans sa campagne du Piémont précisément,
cite dans ses Mémoires cette jolie anecdote: « Un jour que j’étais avec lui
(pour visiter les tranchées), un grenadier lui dit : “Monseigneur, donnez-moi
une prise de votre tabac, on dit que vous en avez toujours d’excellent”.
— “Tiens, prends, mon camarade, lui répondit le prince. ” — “Non, mon général,
lui répliqua le grenadier, j’aime mieux que vous m’en donniez vous-même ;
la raison en est simple : vous m’en donnerez |73 davantage”. Alors,
M. de Vendôme lui versa toute sa tabatière ». Il mourut en 1712, en Catalogne,
« d’une indigestion de poisson », bien qu’il y fût pour combattre les ennemis
de Philippe V1,
qui lui dut entièrement le maintien de sa couronne. Un service funèbre fut
alors célébré solennellement à Étampes, en son honneur, à Notre-Dame.
En 1721, la misère s’est encore étendue. Le système
de Law a ruiné d’innombrables gens, s’il en a enrichi d’autres. Le Régent soulève
l’indignation. Au milieu de ces troubles et de ces inquiétudes, toutes les
espérances se portent vers le jeune roi, Louis XV. Or, à la fin de juillet,
il tombe gravement malade, d’un mal qui reste indéterminé. En quelques jours,
il est hors de danger et c’est alors dans tout Paris et dans tout le royaume
une explosion de joie, qui donne la mesure des sentiments qu’il inspirait
à son peuple. Pendant des semaines, se poursuivent des actions de grâce et
des Te Deum, des feux d’ artifice, des illuminations, des chants, des
cavalcades, des fêtes bourgeoises et populaires. À Étampes, c’est le 24 et
25 août qu’ont lieu ces réjouissances, à Notre-Dame, à Saint-Basile et dans
la rue de la Juiverie. Si nous n’en avons pas le détail, nous avons du moins celui
de la réception qui fut faite, l’année suivante, à la petite infante Marie-Anne-Victoire,
que doit épouser Louis XV. Elle n’a que cinq ans et elle vient de traverser
toute la France en carrosse, quand elle arrive à Étampes, le 27 février.
Le maire et les échevins se sont multipliés. Depuis huit jours, ils ont arrêté un
programme minutieux. Le matin du 27, dès sept heures, les officiers de la
bourgeoisie et les habitants « des mieux faits, habillés et équipés le plus
uniformément possible », au nombre de 600, se rassemblent devant l’Hôtel
de ville, puis, se rendent au son des fifres, tambours et trompettes à l’hôtel
des Trois Rois, où l’intendant de Paris, arrivé la veille, les passe en revue
et leur assigne leurs postes. Vers midi, ils se rangent sur deux rangs depuis
l’hôtel jusqu’à l’Ecce
homo, tandis que le maire et les échevins, avec
tous les anciens échevins et officiers, en robe, manteau et rabat, vont attendre
à la première porte de la ville du côté de Saint Martin. Les rues sont sablées
et la porte décorée de lierre et de couronnes. L’infante arrive à trois heures.
Le maire, Gabriel Pichonnat, fait une petite harangue à « l’ infante-reine pour
ainsi dire encore au berceau ». Puis, le corps de ville suit le carrosse
jusqu’aux Trois Rois, où, présenté à l’infante, dans son appartement, par
le maître des cérémonies, il lui offre le présent de la ville : contenue
dans une manne d’osier, portée par quatre gardes, c’est toute une pâtisserie
en pyramide, surmontée d’une couronne aux armes de France et d’Espagne en
peinture dorée, autour de laquelle on a réuni des gâteaux, des confitures
sèches et liquides, du cotignac, des massepains, des dragées, des oranges,
des citrons, des fruits de toute espèce et des liqueurs de toutes façons,
« le tout bien arrangé et venant de Paris », et séparément, des truites,
des brochets et des écrevisses. La petite infante |74 parut satisfaite,
mais elle voulut passer à son bras la couronne et la laissa tomber, si bien
qu’elle se brisa en plusieurs morceaux. Fâcheux présage ! La petite Marie-Anne-Victoire, après
cinq années mélancoliques passées au Louvre dans le pavillon du jardin de l ’Infante, retourna en Espagne et ne fut, en effet, jamais reine de
France4.
La municipalité revint alors à l’Hôtel de ville «
où elle fit une collation médiocre ». Elle eût mérité mieux, en vérité, mais
il fallait tout prévoir, afin que l’ordre ne cessât pas de régner pendant
toute la nuit, où de grandes réjouissances devaient avoir lieu. Le lendemain
matin, la petite infante partait pour Paris, saluée à la porte Saint-Jacques
par tout le corps de ville.
En 1745, c’est le roi lui-même qui vient à Étampes,
avec le dauphin, âgé de seize ans, pour y recevoir une autre infante,
Marie Thérèse-Antoinette, la fille de Philippe V,
qui sera dauphine pendant un an seulement, emportée dès ses premières couches.
Cette réception fut pour notre ville une lourde tâche, dont elle s’acquitta
dignement et avec une ardeur émouvante. On disposa pour le roi la maison
de M. Rousse de Saint-André, rue Saint-Antoine, en face du collège des Barnabites,
pour le dauphin, celle de M. Lepetit, près du Moulin Sablon, et pour l’infante,
la maison Hémard de Danjouan, rue de la Juiverie. Louis XV avait été précédé
de nombreux gardes de la maréchaussée, de 400 gardes françaises et de 400
suisses et il amenait avec lui, outre les princes du sang, une partie de
la cour, tous ses ministres, les grands officiers de la couronne et un gros détachement
militaire de sa maison. Malgré cette extraordinaire affluence de personnes,
non seulement aucun accident, ni aucun désordre ne se produisit, mais encore
rien ne manqua, ni en provisions de bouche, ni en logement, ni en moyens
de transport ; tout avait été prévu, même au-delà du nécessaire « Étampes pendant
ces beaux jours-là était devenue Paris ».
Louis XV arriva le 20 février. La milice bourgeoise,
toujours composée de 600 hommes, était venue au-devant de lui jusqu’aux Capucins
et formait la haie sur la route. Il entra par la porte Évezard, qui était
décorée d’un arc de triomphe, et fut conduit par un immense cortège jusqu’à
son logis ; il y dîna, avec quelques privilégiés seulement, puisque la table
n’était que de dix-huit couverts. Après le dîner, le roi joua au passe-dix,
jeu de dés avec une banque, et gros jeu, puisque le duc de Richelieu y aurait
gagné 1.800 louis, ce qui représente plusieurs centaines de mille francs5
de notre monnaie. Les principaux habitants d’Étampes avaient été admis au
jeu du roi, c’est-à-dire à le voir, et non à y participer, ce dont ils purent
se divertir sans péril pour leur bourse. Pendant ce temps, la ville s’illuminait.
On avait installé, entre le logis du roi et celui du dauphin, trente caisses, ornées
de girandoles et des chiffres royaux, qui portaient chacune 250 lampions.
Le lendemain soir, la dauphine étant arrivée, les illuminations furent encore
plus nombreuses : soixante-dix caisses semblables |75 étaient
disposées rue Saint-Antoine et rue de la Juiverie, jusqu’à la maison Hémard
de Danjouan. L’Hôtel de ville et les jardins des trois logis royaux étaient
aussi brillamment éclairés. Il y eut ainsi 22.000 lampions allumés pendant
toute la nuit. Le lendemain 21février, Louis XV et le dauphin allèrent jusqu’à
Mondésir, qui était la première poste au-delà d’Étampes, pour recevoir l’infante.
À son arrivée, elle descendit de carrosse et vint s’ agenouiller devant le
roi, sur le tapis qui couvrait la route. Louis XV la releva, l’embrassa et
lui présenta le dauphin, qui l’embrassa à son tour. Un mémorialiste de la
cour nous apprend qu’elle n’était ni grande, ni petite, mais bien faite et
d’allure noble, pâle et extrêmement blonde, jusqu’aux sourcils mêmes ; ses
yeux étaient vifs, mais ce qui la déparait « le plus », c’était son nez,
grand, peu agréable, et paraissant « tenir à son front sans qu’il ait ce
qui s’appelle la racine du nez ». Cependant, le dauphin parut content, en
dépit du nez de sa fiancée, qui était d’ailleurs un héritage des Bourbon. Revenus
à Étampes par le faubourg Saint-Martin, au milieu des soldats et de tout
un peuple enthousiaste, les princes restèrent jusqu’au lendemain. Le roi
joua tout l’après-midi au lansquenet, jeu de cartes avec banque, qui avait
été interdit par Louis XIV, mais qui, par réaction, était fort en faveur
à la cour de Louis XV. L’infante n’y prit point de plaisir, elle n’aimait
pas le lansquenet et pas davantage le cavagnole, sorte de loto, qu’on lui
avait fait jouer auparavant, pour lequel les vers de Voltaire lui donnent raison
:
On croirait que le jeu
console,
Mais l ’ennui vient à
pas comptés
À la table d’un cavagnole
S ’asseoir entre deux
majestés.
Ainsi la dauphine commençait à connaître l’ennui,
dès son passage dans notre ville, alors que tant de choses y eussent été susceptibles
de la divertir si elle n’avait été une pauvre petite princesse, prisonnière
de l’étiquette et des préjugés.
Le lendemain, les princes entendirent la messe à
Saint-Basile, pour laquelle le curé reçut un demi-écu d’ or, et quittèrent Étampes
par la porte Saint-Jacques.
Les frais de cette luxueuse réception furent évidemment
considérables pour les ressources toujours précaires de notre ville. Les
illuminations coûtèrent à elles seules 4.500 livres. Mais la municipalité,
se montrant digne et soucieuse de marquer son attachement au roi, estima
« qu’on ne pouvait moins faire en cette occasion ».
Quelques années plus tard, elle manifesta ces mêmes
sentiments sous une forme nouvelle qui révèle beaucoup de sagesse et de discernement.
Ce fut pour fêter la naissance du duc de Bourgogne, le premier fils du dauphin
qui avait été reçu à Étampes avec Louis XV en 1745 et qui, devenu veuf, s’était remarié
avec Marie-Josèphe de |76 Saxe. Au lieu d’organiser à cette occasion
des réjouissances d’ un jour, coûteuses et dont il ne reste rien, le corps
de ville eut l’ idée de témoigner sa joie de l’événement en consacrant une
somme de 1.550 livres, sur les deniers d’octrois, à doter et à marier une
fille de chacune des cinq paroisses. Les cinq mariages eurent lieu le 8 février
1752 à l’église Saint-Basile, « parée et lavée », en présence du maire, des
échevins et des officiers de ville. Chacun des mariés reçut un cierge, une
pièce de douze sols pour l’offrande, une paire de gants et un anneau d’argent.
Après le mariage, ils furent conduits à l’Hôtel de ville, précédés des violons
et des tambours, où la dot de 250 livres fut remise à chaque ménage. En outre,
un festin y fut offert à tous les mariés et à leurs parents, au nombre de
trente personnes, et servi par les deux bedeaux de ville et les quatre hallebardiers,
« revêtus de leurs robes et habits ». On voit que la municipalité avait fait
largement les choses.
À côté de ces fêtes pittoresques, le XVIIIe
siècle apporte à notre ville des formes d’activité nouvelles. L’une des plus intéressantes
concerne l’imprimerie. Malgré son importance réduite et sa proximité de Paris,
Étampes vit s’établir un imprimeur dans ses murs, non pas seulement à la
Révolution, comme il a été dit et répété à tort, mais dès 1709. C’était un nommé
Jean Borde, issu d’une famille d’imprimeurs d’Orléans, né dans cette ville
en 1682, qui avait appris son art, d’abord, dans l’atelier de son père, puis,
à Paris dans d’excellentes maisons, entre autres chez le célèbre Coignard,
où il avait gagné l’estime de ses maîtres et « avait acquis les connaissances
nécessaires pour s’acquitter de sa profession avec honneur ». Depuis le milieu
du XVIIe siècle, l’exercice de cette profession était réglementé
; en 1704, un arrêt avait fixé le nombre d’imprimeurs dans chaque ville et
l’on ne pouvait installer d’imprimeries nouvelles sans une décision du Conseil
d’État ; en outre, le candidat devait passer un examen qui exigeait une culture approfondie.
Jean Borde avait satisfait à ces épreuves, « expliqué des vers latins et
lu des vers grecs ». Il ouvrit donc en 1709 une imprimerie à Étampes, où
il réédita (la première édition est jusqu’ici inconnue, mais peut-être fut-elle
faite déjà à Étampes la même année) un petit ouvrage connu aujourd’hui par
un seul exemplaire, qui n’existe même pas à la Bibliothèque nationale. Il contient
l’Office du Saint
Sacrement comme il se dit dans les paroisses et environs d’Étampes et la
Vie et les miracles des saints Can, Cancien et Cancienne, les patrons d’Étampes. On ne connaît pas d’autres publications
de l’imprimerie étampoise, mais il y en eut certainement, malgré son existence
éphémère, puisque dès 1712, Jean Borde quittait notre ville pour s’installer à
Orléans, où il mourut presque aussitôt. En 1719, le maire, les échevins et
les officiers de ville adressent une requête au Conseil d’État afin d’obtenir
le rétablissement de l’imprimerie locale, « pour le bien et l’utilité de
|77 la ville, attendu qu’il s’y présente journellement assez d’ouvrages
utiles au public pour qu’un imprimeur puisse s’y établir et y exercer avec
succès ». Il y avait deux candidats Michel Carlu, compagnon imprimeur à Paris,
qui avait fourni les preuves de sa capacité, fut agréé et demeura sans doute
l’imprimeur d’Étampes de 1720 à 1734, puisqu’on sait que la seconde imprimerie
subsista pendant ces quatorze années. Mais on ne connaît pas de pièce éditée
qui porte son nom. Peut-être est-ce lui qui publia, vers 1722, le poème bien
connu des Étampois, Le chien pêcheur, en vers latins et français, de Claude Charles Hémard de
Danjouan, petit-fils du maire René Hémard, dont on ignore l’éditeur original.
Le chien des Cordeliers d’Étampes, qui en est le héros, a-t-il vraiment existé
et recueilli des écrevisses parce qu’elles s’attachaient à ses longs poils
? C’est peu probable, d’autant moins qu’un auteur normand du XVIe
siècle, Philippe Le Picard, a conté une histoire tout à fait analogue. Mais
la légende était sans doute répandue dans Étampes. Si elle a inspiré à Charles
Hémard d’assez bons vers latins, ses vers français sont malheureusement bien
dénués de poésie et tantôt plats, tantôt d’une pesante emphase, qui répond mal
au pittoresque du sujet. Charles Hémard n’était pas cependant un esprit ordinaire.
Il faisait partie du petit groupe de lettrés et de savants étampois dont
nous parlerons plus loin.
Depuis 1734, il n’y avait plus d’imprimeurs à Étampes,
à cause du décès ou du départ de Michel Carlu à cette date, et parce qu’ensuite,
il ne s’était présenté personne pour lui succéder. Mais en 1757, François
Izenard, originaire de Poitiers, qui avait fait son apprentissage d’imprimeur
chez son oncle dans cette ville, ouvre une librairie à Étampes et bientôt
se rend compte « que non seulement il y pourrait subsister avec une imprimerie,
mais encore qu’elle y était nécessaire ». Il sollicite donc et obtient le
8 février 1759 de Louis-Philippe, duc d’Orléans et d’Étampes, l’autorisation
d’établir une imprimerie et de s’intituler « son imprimeur en la ville d’Étampes
». Mais à peine né, son atelier était interdit par un arrêt du Conseil, qui
supprimait les imprimeries dans un certain nombre d’autres petites villes
où l’autorité n’admettait pas leur utilité. Cependant, Izenard demeura libraire
à Étampes, en exerçant aussi l’art du relieur : l’église de Congerville possédait
encore, il y a quelques années, un missel et un graduel reliés par lui, comme
en faisait foi la signature. Il fit deux tentatives, en 1765 et en 1778,
pour obtenir du Conseil le rétablissement de son atelier typographique, mais elles
restèrent inutiles. En 1780, le maire et les échevins adressèrent la même
requête en sa faveur à l’intendant, toujours en vain. C’est seulement en
1790 que s’ouvrira, sous la direction de Claude Dupré, une nouvelle imprimerie,
à laquelle les événements révolutionnaires donnèrent beaucoup d’activité
et dont nous parlerons en son temps. |78
L’existence d’une imprimerie à Étampes dès 1709 et
les raisons qui furent invoquées avec insistance pour son rétablissement chaque
fois qu’elle fut supprimée montrent déjà que notre ville était alors animée
d’un certain mouvement intellectuel. On sait par ailleurs qu’elle comptait,
en effet, tout un groupe de gens fort instruits dans les matières les plus
diverses, qui se réunissaient chez M. Geoffroy (peut-être le grand’père de
Geoffroy-Saint-Hilaire) : Pichonnat, médecin, dissertait sur l’anatomie,
Claude-Charles Hémard, l’abbé Lemaître, curé de Notre-Dame, Michel Godeau,
recteur de l’université de Paris, né à Étampes et toujours en relations avec
ses compatriotes, représentaient les belles-lettres et Descurain, maître
apothicaire et botaniste, s’intéressait à toute l’histoire naturelle. Il
y eut là, pendant de nombreuses années, une manière de petite Académie, dont
tous les membres étaient entourés de respect et d’admiration et ce n’est
pas à cette époque qu’un Labiche eût pu ridiculiser l’Académie d’Étampes.
Le grand naturaliste Guettard, petit-fils de Descurain,
qui fut élevé dans ce milieu et nous l’ a fait connaître, atteste que les travaux
de ces excellents observateurs « les avaient rendus dignes de la plus célèbre
Académie ». Descurain était l’âme de ce petit groupe.
La botanique surtout le passionnait. Il avait constitué
un jardin d’expériences, où il réunissait les plantes singulières de la région et
des plantes étrangères que lui procuraient ses correspondants, en particulier
les Jussieu, professeurs au Jardin du roi, devenu aujourd’hui le Muséum d’histoire
naturelle. En outre, il avait rédigé un ensemble d’observations sur les plantes
locales, que publia, en 1747, son petit-fils Guettard, en y ajoutant un travail personnel,
sous le titre Observations
sur les plantes. Nous voyons ainsi que la répartition
des cultures a peu varié depuis cette époque, sauf en ce qui concerne la
vigne, très abondante alors, et que la flore indigène ne s’est guère modifiée
non plus. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver deux plantes rares dans
les stations mêmes signalées par Descurain, l’Aristoloche « dans le cimetière
Saint-Germain », aujourd’hui le cimetière de Morigny, et l’Asarum europaeum, plante extrêmement rare aux environs de Paris, qui continuait
de fleurir depuis le début du XVIIIe siècle dans le bois du Chesnay,
au-dessus de Brières, tandis que tant de choses ont disparu à jamais. L’autorité
de Descurain auprès de ses compatriotes était grande. Il avait fait des études
de médecine à Paris, sans avoir eu le temps de les achever, ce qui lui permit,
cependant, de soigner beaucoup de malades à Étampes et même aux environs
: c’est ainsi qu’il herborisait dans toute la campagne. Et lorsque survint
une aurore boréale, le 19 octobre 1726, l’effroi fut si vif qu’on fit aussitôt demander
à Descurain ce qu’il pensait de cette troublante apparition. II assura qu’il
n’y avait rien à craindre et « l’on se crut en sûreté, puisque Monsieur Descurain
pensait y être ».
Le plus grand mérite de Descurain fut peut-être de
déterminer |79 l’orientation de son petit-fils vers les sciences
naturelles. En effet, si Guettard est assez peu connu du grand public, il
est pourtant une des gloires de notre ville. Dirigé d’abord vers la médecine
par Bernard de Jussieu, l’ami de son grand’père, il étendit ses travaux à
toutes les branches de l’ histoire naturelle, botanique, zoologie, minéralogie,
paléontologie et dès l’âge de vingt-huit ans, il entrait à l’Académie des
Sciences. On lui doit de nombreuses découvertes ; la plus importante est
celle des volcans éteints d’Auvergne, dont il reconnut le premier la nature. Mais
nous ne saurions omettre qu’il fut aussi le premier à signaler la présence
d’ossements fossiles d’une faune froide (Renne et Mammouth) aux portes mêmes
d’Étampes, au-dessus de la maladrerie Saint-Lazare.
Pendant une partie du XVIIIe siècle, un
faubourg de notre ville connut une animation d’un autre ordre. C’est Saint-Pierre,
qui depuis longtemps déjà constituait une sorte de petite ville un peu à
l’écart de l’autre, avec son église, son prieuré, sa chapelle Saint-Symphorien,
son hôpital de Buval, ses écoles et enfin, son château du Bourgneuf. Le fief
du Bourgneuf et son château existaient dès le XVIe siècle2 et ils avaient appartenu
par acquisitions successives à Claude de l’Isle, seigneur du Grand-Boinville,
à François Roiger, seigneur de Mauchesne, à Bénigne Le Ragois, seigneur de
Guignonville, à Nicolas de Cœurs, et enfin à Alphonse-Germain de Guérin,
seigneur de Moulineuf, qui l’acheta en 1710. Ce dernier eût été, contrairement
à ses prédécesseurs, en état de conserver ce lourd domaine par le riche mariage
qu’il avait fait en épousant Henriette-Françoise Le Camus, fille du trésorier
général des états de Courtrai, mais il fut tué dès 1713 au siège de Fribourg-en-Brisgau.
Sa veuve épousa en 1721 Louis-Guy-Henri de Valori, qui devint ainsi seigneur
du Bourgneuf et le resta jusqu’à sa mort, en 1774, après avoir apporté dans
sa demeure et le petit bourg environnant une vie toute nouvelle. En effet,
le marquis de Valori3,
allié aux plus vieilles maisons de France, possesseur d’une immense fortune, qui
avait fait4 la
guerre avec Villars et rempli des missions auprès de Frédéric II, avait des
relations innombrables. Aussi, quand il venait au Bourgneuf, il y recevait
tant de monde que la cour devenait déserte5, disait-on. On y jouait la comédie et les réceptions
étaient fastueuses. Voltaire y séjourna souvent et il y subit une mésaventure
dont on fit grand bruit, non seulement à Paris, mais jusqu’à Berlin : poursuivant
de ses assiduités une servante farouche du marquis de Valori, il reçut d’elle
un bon soufflet. Le château avait été agrandi et aménagé par Valori. Il s’étendait,
avec ses dépendances et son parc, entre la rue Sadi-Carnot actuelle et la
rue de l’Alun. Il comprenait aussi « l’auditoire » du bailli, avant même
que le marquis de Valori fût nommé gouverneur et bailli d’Étampes, en 1767.
Il mourut en 17746,
à quatre-vingt-deux ans, et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Un fragment
de sa pierre tombale |80 a été retrouvé en 1927 lors de la démolition
d’une maison de la rue Évezard, où elle constituait une partie de cheminée
: image des bouleversements aveugles qu’accomplissent les hommes. Le petit-fils
du vieux marquis de Valori, Charles-Jean-Marie de Valori, lui succéda dans
sa propriété et dans sa charge de gouverneur et grand bailli d’Étampes, qu’il
exerça jusqu’à la Révolution. Il émigra en 1791 avec sa femme, qui était
la fille de Dupleix. Ses biens furent vendus au profit du domaine et sa belle demeure
(fig. 5)7 fut
entièrement démolie. Quelques dépendances, comme le colombier, en subsistèrent
longtemps et c’est à notre époque même qu’on en acheva sans scrupules la destruction.
La bibliothèque, qui était considérable, fut cependant sauvée à la Révolution
et fait partie maintenant de la bibliothèque de l’Arsenal.
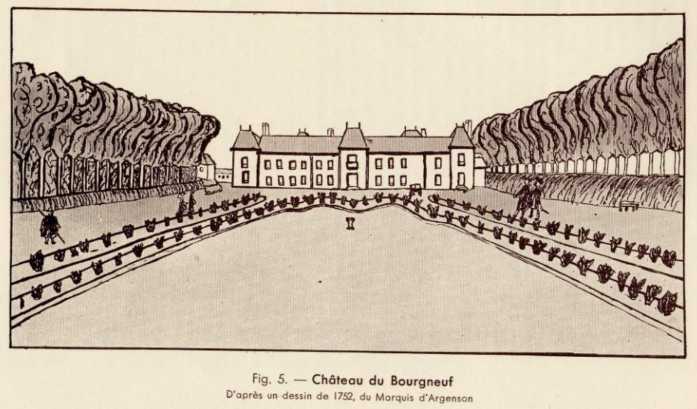
Au temps où nous parvenons, notre ville commence
à perdre sa physionomie ancienne. Les portes de son enceinte menaçaient ruine
on décida la démolition de plusieurs d’entre elles en 1771. La porte Saint-Jacques
fut abattue la première et remplacée par deux piliers à chapiteaux. Le fossé
de la fortification, en avant des murs, qui mesurait près de vingt mètres
de largeur, fut comblé sur la moitié de sa longueur dans la direction de
la rue Évezard, avec des déblais qu’on enleva de la rue du Rempart, pour
niveler son sol, auparavant très inégal. Deux allées de tilleuls furent plantées
sur la partie du fossé comblée, tandis que le reste fut conservé pour abriter
le jeu de paume, qui était très en faveur et se jouait jusque-là dans tout
le fossé. La porte Saint-Martin ou de la Barre, qui évoquait tant de souvenirs,
fut entièrement démolie, « jusqu’à un pied au-dessous du sol », la même année
1772, et l’on mit à sa place une simple barrière pour les droits d’entrée.
Déjà quelques années avant, le fossé avait été comblé et la muraille rasée
sur une douzaine de mètres en descendant vers les Portereaux. La porte du
Château ou des Lions fut remplacée par des piliers surmontés de deux lions.
Enfin, la porte Évezard fut abattue vers 1775 et des piliers, qui furent d’abord
élevés à sa place, s’écroulèrent presque aussitôt.
C’est aussi à cette époque, en 1774, que la foire
Saint-Michel, qui se tenait depuis le XIIe siècle près de la maladrerie
de Saint-Lazare, au lieu-dit Saint-Michel, fut transférée sur les promenades
du Port, agrandies par le comblement du fossé. On sait que le port ne fonctionnait
plus depuis un siècle ; les bassins avaient été comblés et l’on y avait planté
des ormes et des tilleuls. La foire était alors très brillante, parce que
le haut commerce de la ville et des alentours y participait en même temps
que les bateleurs et les fripiers.
Des mesures d’un autre ordre, prises soit par le
lieutenant de police, soit par le corps de ville, montrent que des conceptions nouvelles
commencent à s’imposer. Ainsi, les règlements relatifs à la propreté des
rues et même à l’hygiène sont renouvelés en 1779. Les habitants |81
sont tenus de balayer deux fois par semaine devant leurs portes « même jusqu’à
la moitié de la chaussée », d’arroser avant, en temps de sécheresse, et de
ne faire aucun amas de paille, fumier, pierres, tuileaux ou débris de légumes
dans les rues ; un entrepreneur est chargé d’enlever les tas de boue après
le balayage des habitants et de nettoyer les places publiques. Les bêtes
mortes doivent être « traînées dans les terres hors la ville et les faubourgs,
à un quart de lieue des maisons, routes et chemins et enterrées dans des
fosses profondes au moins de sept pieds ». Ces ordonnances étaient d’autant
plus justifiées que des épidémies fréquentes désolaient la ville. En 1754,
ce sont des « fièvres putrides » difficiles à déterminer, mais en 1781, c’est
la variole, qui fauche près de deux cents enfants en trois mois. La population,
très diminuée par les suites du siège de 1652, durant près d’un siècle, était
remontée en 1740 à 1.628 feux ; elle retombe, après les épidémies de 1754,
à 982 feux, mais à l’aube de la Révolution, elle dépasse 2.000 feux, à peu
près comme au milieu du XVIIe siècle.
La sécurité et la paix des habitants font également
l’objet des soins de la police urbaine. On interdit dans les rues les jeux dangereux,
le jet des boules de neige, les pétards et fusées, le tir de toutes armes
à feu, les charivaris, les essais de chevaux, les chiens errants. Mais l’éclairage
des rues fait totalement défaut : en 1788, M. de Poilloüe de Bierville réclame
en vain l’installation de réverbères.
Cependant, la municipalité marque son zèle à défendre
les droits de ses administrés, en particulier par un long et dispendieux
procès qu’elle entame, en 1764, contre le dernier exécuteur des sentences
criminelles du bailliage. On sait que ce titre pompeux s’appliquait tout
simplement au bourreau, mais cette dernière appellation était considérée
comme si infâmante que plusieurs arrêts de Parlements l’avaient interdite
et punissaient d’amendes ceux qui l’employaient. Dès une haute époque et
partout, des conflits s’ étaient élevés entre les habitants des villes et
le bourreau, en raison de la singulière manière dont étaient réglés ses émoluments.
En effet, d’une part, il était payé, à des tarifs divers, pour chacune de
ses interventions, qui étaient nombreuses et variées : attacher au carcan,
marquer et flétrir, fouetter aux carrefours, percer ou couper la langue,
appliquer la question, pendre, rouer, décapiter, brûler, rompre vif et ensuite jeter
au feu, ce qui était le plus chèrement indemnisé : 50 livres au présidial
de Bourges, en 1666. D’autre part, il touchait une redevance en nature, appelée
le droit de havage, qui consistait à prendre lui-même autant que sa main
pouvait contenir de céréales, de légumes, de fruits, d’œufs, etc., mis en
vente dans les marchés. Il était accompagné d’un valet, qui marquait à la craie
le dos des marchands qui s’étaient acquittés. Cette curieuse rétribution
fut abolie à Paris en 1721 ; mais |82 elle subsistait à Étampes,
en dépit des nombreuses contestations auxquelles elle avait déjà donné lieu
au XVIe et au XVIIe siècles. Le droit pour le bourreau
de prendre à la main les denrées du marché avait été remplacé par celui de
les mesurer au moyen d’une cuiller en fer, mais la dimension de la cuiller,
d’ abord fixée, avait constamment grandi et le bourreau ainsi que « les gens
de la lie du peuple qu’il employait » ne manquaient pas de la prendre comble,
au lieu de la prendre rase, et de lui donner des secousses pour y faire tenir plus
de choses. En 1760, les abus commis par le bourreau Desmorets causaient un
si grand tort aux marchands qu’ils commençaient à déserter le marché d’Étampes.
C’est ainsi que le maire et les échevins, s’appuyant sur le précieux mémoire
rédigé par Plisson au XVIIe siècle au sujet précisément des droits
du bourreau, portèrent l’ affaire devant le Parlement, qui donna raison à
la ville, par un arrêt de 1767. Le droit de havage était réduit à une perception
fixe, en argent, qui devait être levée aux barrières de la ville, sur les
grains et les légumes secs exclusivement. Ainsi ce vieil usage perdait enfin,
à la grande satisfaction des habitants, son caractère abusif et si curieusement moyenâgeux.
Desmorets fut le dernier bourreau d’Étampes. Il ne devait plus d’ailleurs
exercer souvent son office, puisqu’au cours du procès, la suppression en
est envisagée. Les exécutions avaient lieu place Saint-Gilles, à l’angle
de la rue Traversière, que l’on surnommait, à cause de cela, la rue de la
Femme-sans-Tête ou Monte-à-Regret. C’est là qu’étaient placés une potence pour
les condamnations capitales et un pilori qui servait, avec le carcan, à infliger
la peine du fouet ou de l’exposition, aggravée par l’écriteau infâmant. Ces
divers supplices reprirent activement à Étampes pendant la seconde partie
de la Révolution et dans les années suivantes, durant lesquelles les vols
et les brigandages se multiplièrent.
Notre ville nous offre à cette époque un exemple
des idées nouvelles et originales, qui surgissaient alors dans les esprits
de toutes les classes sociales, et de la hardiesse des conceptions et des
tentatives. Un chanoine de l’église Sainte-Croix, l’abbé Desforges, annonça
dans le Mercure de
France, en juillet 1772, qu’il avait trouvé le
moyen de faire voler les hommes en l’air dans un cabriolet. Il demandait
à ceux que cette invention, évidemment merveilleuse, pouvait intéresser une
somme de 100.000 livres, si son expérience réussissait, mais qui devait être préalablement
déposée chez un notaire. La curiosité de ces choses était telle qu’il trouva
la somme auprès de plusieurs habitants de Lyon, qui la remirent effectivement
à un notaire. L’abbé Desforges avait déjà construit sa machine : elle avait
la forme d’ une gondole, couverte pour mettre à l’ abri de la pluie, mesurait
environ 2 m. 25 sur 1 m. 15, et ne pesait que quarante-huit livres. Mais
le pilote pouvait emporter, en sus de son propre poids, une valise de quinze
livres. Toute la gondole était enduite de plumes |83 et surmontée,
en outre, d’un parasol de plumes. Deux rames, également à longues plumes,
maniées par le pilote, devaient assurer le maintien et la progression dans
les airs. Il paraît que la machine était, en principe, à l’épreuve des grands vents,
de la pluie, des orages et pouvait même servir de bateau, en cas de besoin.
Elle devait voler à la vitesse de trente lieues à l’ heure et pouvait faire
trois cents lieues par jour pendant quatre mois. L’abbé Desforges avait bien
prévu qu’il faudrait protéger l’homme contre la violence de l’air et pour
cela, il devait porter une grande feuille de carton sur sa poitrine et un
bonnet sur sa tête, avec des verres pour les yeux. On ne peut nier que cette invention
reposait sur une vue prophétique de ce qui devait être
réalisé dans l’avenir, mais là se borna le mérite
du pauvre chanoine puisqu’en dépit de tous ses efforts, il ne réussit pas
à s’envoler. Il avait hissé sa machine au sommet de la tour de Guinette,
au milieu d’un grand nombre de curieux. Installé dans son cabriolet, il donna
le signal du départ, « les ailes se déployèrent et se mirent en mouvement
avec une grande vitesse », mais dès qu’on le lâcha, il retomba à terre. Il
en fut quitte pour une contusion au coude. Il paraît que sa foi dans son invention
n’en fut pas ébranlée, mais on ne connaît pas de lui d’autres tentatives.
S’il avait rencontré en France beaucoup de railleurs ou d’indifférents, il
n’en fut pas de même à l’étranger, « où l’on s’attendait, en plusieurs endroits,
le voir arriver dans sa gondole aérienne ». Sachons-lui gré, au moins, d’avoir
porté loin le nom de notre ville, associé à l’idée d’un rêve merveilleux
et non absurde, puisqu’il devait être un jour une réalité. Malgré son échec,
Desforges n’est pas tombé dans l’oubli et son effort permet de considérer
Étampes comme un des berceaux de l’aviation.
29
Gentilhomme de Beauce,
Qui reste au lit quand
on rac’mode ses chausses.
(Illustration de l’humoriste chartrain Auguste Hoyau,
pour Le Messager
de la Beauce et du Perche, l’almanach bien connu,
aujourd’hui disparu).
02. Gentilshommes de Beauce
2
Par le comte R. de Saint-Périer
« Gentilhomme de Beauce, disait-on jadis, se couche
quand on lave ses chausses », pour donner à entendre qu’il n’en possédait qu’une
paire. Cette indigence n’était pas spéciale aux Beaucerons ; il est probable
qu’on en eût pu dire tout autant des gentilshommes berrichons, poitevins
ou bretons et que la Beauce a été choisie, dans ce dicton, pour former une
assonance avec chausses. L’état de la noblesse campagnarde, avant la Révolution,
excellement étudié par M. de Vayssière, nous offre des exemples analogues
en toutes provinces. Mais c’est dans la nôtre que nous voudrions aujourd’hui
rappeler quelques traits de la vie sans éclat de la noblesse locale.
Certes, la Beauce posséda, aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles, de grands domaines, appartenant à des financiers
ou à des hommes de cour, enrichis par l’intrigue ou la faveur, et quelquefois
par leur talent. Leurs châteaux, à la mode du jour, entourés de beaux jardins
et de vastes parcs, avaient parfois remplacé les forteresses médiévales,
bien rares maintenant dans notre région. On chercherait, en vain, au Puiset,
les restes du château d’où Hugues du Puiset menaçait les communications entre
Étampes et Orléans, comme le sire de Montlhéry 8 commandait la route entre Étampes et Paris.
Le petit roi de l’Ile-de-France, dont les |38 successeurs devaient,
au cours des siècles, annexer toute la France, tremblait devant ces puissants
vassaux et Philippe Ier disait à son lit de mort, à son fils «
je vous laisse deux redoutables ennemis : le sire de Montlhéry et le sire
du Puiset ». Quelques vestiges demeurent cependant, de ces édifices du moyen-âge
: nous citerons, près d’Étampes, le château de Farcheville construit en1291
par Hugues de Bouville, qui fut tué, à la bataille de Mons-en-Puelle en 1304.
On y voit la ligne des remparts avec le chemin de ronde, une cuisine voûtée,
avec un puits intérieur qui permettait d’alimenter le château en eau au cours
des sièges, et une chapelle édifiée en 1304, dont le plafond à caissons,
malheureusement très dégradé, est orné de peintures représentant des anges
qui jouent de divers instruments de musique.
Au XVe siècle, la plupart de ces forteresses
sont démantelées, dans notre Beauce, qui fait alors partie du domaine royal,
et c’est dans les villages que les gentilshommes habitent « l’Ostel » qui remplace
l’antique château-fort. Ces villages sont fortifiés pour la plupart, afin
de résister aux incursions constantes des pillards et gens de guerre et le
seigneur y remplit l’office de commandant de la place. En 1500, le seigneur
de Poilloüe est « capitaine pour le Roi du bourg fortifié de Saclas ». Ces
ostels seigneuriaux, comparables aux casas solariegas
espagnoles, ont, pour la plupart disparu. Cependant, on en peut citer quelques-uns
dans la région d’Étampes, qui nous est familière : à Saclas, à Estouches,
à Guillerval, à Bleury, on retrouve, dans les maisons de ferme, ces hauts
combles, surmontant des logis quadrangulaires accostés d’une tour polygonale
où s’élève l’escalier, qui sont les derniers restes de ces demeures rustiques, mi-citadines,
mi-guerrières, où le gentilhomme rural menait la vie simple et rude du soldat
et du laboureur.
Au XVIe siècle, si les villes, comme Étampes
s’ornent d’édifices aux décorations gracieuses qui rappellent le goût italien,
fort à la mode alors, l’architecture ne change guère dans les campagnes.
C’est toujours le style simple du siècle précédent, avec quelques détails,
fenêtres à meneaux ornés, portes à tympan décoré, où s’affirme un goût délicat
de l’ornementation. Les gentilshommes sont toujours chargés de la défense
des « villes et bourgs fortifiés ». Ils exploitent leurs terres, chassent
avec ardeur, vont parfois en Italie aux guerres du roi, mais reviennent en
leur village, où ils assurent l’ordre et dont ils défendent les habitants.
Les guerres de religion leur en fournissent de trop fréquentes occasions
et les désordres de cette période troublée ne sont pas moindres en Beauce
que dans les autres provinces du royaume. Les reîtres de Condé brisent, à
leur passage à Étampes, les têtes des statues qui décorent le beau portail
du XIe siècle de Notre-Dame, avant de gagner Auneau où ils sont
taillés en pièces par le duc de Guise en 1587. Les gentilshommes prennent
parti pour ou contre le roi de Navarre. 38||48
À Étampes, on se réunit pour signer la Ligue le 19
août 1587, et l’ardeur politique est si grande que l’on fait participer des enfants
à cet acte solennel : Urban de Poilloüe âgé de 17 ans et son frère Abel âgé
de 13 ans, dont le père est mort, signent avec les autres seigneurs du pays.
D’autres ont embrassé la Réforme et la guerre des
partisans se poursuit. Cette même année 1587, François de Prunelé, un des chefs
protestants de notre région, est assassiné par les ligueurs, près de Tignonville.
Après cette période sanglante, la vie en Beauce se
pacifie et malgré les désordres de la Fronde qui désolent Étampes en 1652, les
campagnes goûtent une paix inconnue depuis près d’ un siècle. Les murs qui
entouraient les villages sont rasés, les gentilshommes, suivant la centralisation
qui fut l’œuvre de la royauté devenue toute puissante, entrent comme officiers
dans les armées du roi. Quelques-uns y poursuivent une longue carrière, gravissant
un à un les degrés de la hiérarchie, contrairement aux nobles de la Cour
qui trouvent parfois dans leur berceau le brevet de colonel et doivent trop
souvent leur élévation jusqu’au grade de maréchal de France à leurs appuis
et à leur naissance plus qu’à leur valeur militaire. Cette lente accession
aux grades supérieurs oblige nos gentilshommes à de longues années de service.
C’est ainsi que César Joachim de Saint-Périer, né à Corbreuse en 1662, ne
fut nommé qu’en 1734 lieutenant -général des armées, après avoir pris part,
durant 55 ans, à toutes les guerres de la fin du règne de Louis XV. Il mourut à
87 ans, commandant encore l’artillerie du département de Flandre. Son neveu,
César Joachim de Poilloüe de Saint-Périer, entré dans l’artillerie comme
officier pointeur en 1747, à 13 ans, fit les six campagnes d’ Allemagne,
assista aux batailles de Laufeld, Crefeld, Minden, Filimausen, Grabinslen,
fut blessé à Maestricht et servit encore dans l’armée de Condé, pendant l’émigration,
à près de 60 ans.
Nos gentilshommes beaucerons ne demeuraient pas tous
si longtemps éloignés de leur province.
... Les champs de la Beauce avaient leurs cœurs,
leurs âmes... a dit justement Vigny. En général,
ils servaient vingt ou vingt-cinq ans, gagnaient la croix de Saint-Louis
et revenaient en Beauce pour n’en plus quitter les vastes horizons. Âgés
de 45 à 50 ans, ils épousaient la fille d’un seigneur voisin et vivaient noblement,
comme on disait alors. Le |49 gouvernement de leur bien, médiocre
le plus souvent, et très morcelé, leur donnait de grandes occupations, à
cause de la complexité des droits féodaux et de la variété des juridictions
de l’ancien régime. La chasse les occupait aussi ; ce sont les « gentilshommes
à lièvre » comme disait dédaigneusement Louis XIV, qui méprisait en eux la simplicité
de leurs équipages, en oubliant les services rendus aux armées par ces braves
gens et leur dévouement absolu.
Si, à cette époque, le gentilhomme n’était plus le
défenseur du village, par suite de l’organisation d’une armée et d’une police régulières,
il demeurait le conseiller, le protecteur, souvent le meilleur ami des habitants.
On le voit aux innombrables filleuls dont étaient gratifiés les gentilshommes
beaucerons. Peu de baptêmes où ils ne fussent parrains, peu de mariages où
ils ne signaient point avec les mariés et leurs parents. Ils étaient fort jaloux
de leur noblesse et de ses prérogatives et exigeaient, comme la loi le prescrivait
en ce temps, l’hommage féodal de leurs vassaux. Cet hommage comportait encore
au XVIIIe siècle, un apparat solennel. Le vassal devait se présenter
devant la demeure du suzerain, sans ceinturon, épée, dague ni éperons, tête nue.
Il mettait un genou en terre et « demandait à haute et intelligible voix,
par trois diverses fois, si ledit seigneur suzerain ou autre ayant pouvoir
de recevoir ses vassaux en foy et hommage était au dit lieu et château, et
en signe d’humilité devait baiser l’un des jambages de la principale porte
dudit château. Tel était, du moins, le cérémonial officiel, mais dans la
plupart des cas, il n’était pas observé. On se contentait d’envoyer par un huissier,
une pièce indiquant les formalités requises et dressées par un notaire. Car
les notaires étaient alors appelés pour tous les actes, transactions, contrats
même de très minime importance, pour lesquels nous nous contentons aujourd’hui
d’une simple lettre ou même d’un accord verbal. Et l’on dressait par devant l’homme
de loi de longs mémoires diffus, en ce jargon judiciaire, conservé du moyen-âge
où s’accumulent les redites et les périphrases et dont l’usage, aujourd’hui
encore, n’est pas complétement perdu dans les études notariales. Aussi les
notaires étaient-ils nombreux dans les campagnes et les gentilshommes leur
confiaient des missions parfois singulières. C’est ainsi qu’en 1602, au mois
de juin, Jacques et Robert de Paviot, habitant à Varennes, au bailliage de
Clermont-en-Argonne, envoyaient leur notaire, Lestaleux, à Boissy-le-Sec,
près d’Étampes, pour s’assurer que Charles de Paviot, seigneur de Boissy,
dont la famille était établie en ce lieu depuis le XIVe siècle,
était bien leur parent. Lestaleux mit six jours à accomplir le voyage. Charles
de Paviot le reçut courtoisement, le mena à l’église de Boissy où il lui
montra ses armes « peintes en plusieurs vitraux », lui déclara que « Sa maison
était vieille de 4 à 500 ans », ce qu’il « ferait voir par preuves, quand
le besoin serait ». 49||5
Muni de ces renseignements, Lestaleux remonta à cheval
et regagna l’ Argonne où il rédigea un bel acte, relatant sa visite en Beauce
et tirant de cette entrevue avec Charles de Paviot des conclusions tout à
fait erronées sur les prétentions de ses clients.
Joseph de Tarragon, seigneur de Mainvilliers, près
de Pithiviers, avait fait une curieuse convention avec son notaire, en 1788
; il le logeait gratuitement dans une maison qu’il lui avait fait construire,
à charge par le notaire d’exécuter aussi gratuitement tous les actes qui
concernaient la châtellenie de Mainvilliers et sa justice. Etant donné la
multiplicité de ces actes, ce loyer était peut-être plus lourd qu’il ne paraît
tout d’abord.
Les honneurs ou « prééminences » accordées à l’église
paroissiale, aux seigneurs, donnaient souvent lieu à des querelles entre
eux. Le seigneur prééminent devait recevoir le premier, à la messe du dimanche,
l’eau bénite et le pain bénit. Et c’était un sujet de violentes protestations
quand le curé enfreignait ce droit. Parfois même, les choses allaient plus
loin. C’est ainsi qu’en 1658, à Bonnevaux, nous voyons Guy de Poilloüe, seigneur
du lieu, « battre et violenter » le sacristain qui avait présenté d’abord aux
Bienvenu, co-seigneurs de Bonnevaux, le pain bénit. D’où plainte et procès
devant le Parlement entre Guy de Poilloüe et
François de Bienvenu, procès qui après de longs débats,
se termina cependant par un accord amiable en dépit de l’irritable susceptibilité
des deux gentilshommes. |6
Il fallait aussi s’occuper de l’établissement des
enfants. Ceux-ci étaient nombreux : les familles de dix ou douze enfants
n’étaient pas rares et les maigres revenus de la terre suffisaient à peine
à leur entretien. Les filles épousaient des gentilshommes voisins ou entraient
en religion ; les garçons partaient pour l’armée souvent très jeunes. Pour
leur acheter une charge dans un régiment d’élite, comme leur noblesse le
leur permettait, les parents empruntaient et connaissaient la gêne. Il fallait
aussi entretenir le jeune officier, dont la solde n’était pas suffisante pour
qu’il tint un rang honorable à côté des fils de la riche noblesse de cour.
Il fallait encore engager des hommes pour leur corps, afin de les faire bien
voir du colonel, toujours à la recherche de nouvelles recrues. Nos gentilshommes
n’y manquaient pas et nous voyons Jacques Auguste de Poilloüe, seigneur de
Bonnevaux, consigner ses dépenses, en 1745, ces deux mentions relatives à
son fils, le chevalier de Bonnevaux : « J’ai fait faire au chevalier un habit
uniforme et une veste et une culotte de velours cramoisi, le tout coûte 204
livres. Le 2 décembre j’ai engagé le nommé Louis Moineau, dit Saint Martin, natif
de la paroisse de Saint-Martin d’Étampes et je lui ai donné six livres pour
boire à la santé du roi ».
Accablés d’enfants, jouissant d’ une maigre pension
accordée parcimonieusement à ces anciens soldats, alors que les hommes de
cour se partageaient les faveurs royales, ne tirant de leurs terres, morcelées
et de médiocre étendue, que des revenus insuffisants, les gentilshommes beaucerons
connurent même la misère. Leurs demandes, le plus souvent repoussées, sont
parfois poignantes, comme celle de Marc-Antoine d’Averton, ancien major de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Milly en 1757 « qui ne peut
subsister que par une grande économie, n’ayant d’autre ressource qu’une pension
de 1200 livres accordée par le roi en raison de 30 ans de service et de blessures reçues
en différentes affaires », et dont les sept fils étaient à l’ armée.
On sait de reste que c’était la condition ordinaire
des gentilshommes campagnards, même en une province de terres riches et fertiles
comme en Beauce. Ils se résignaient cependant, pleins de courage et de dignité,
conservant à l’égard d’un régime qui ne faisait rien pour eux, un attachement
de tradition, dont l’abnégation leur semblait naturelle. Et malgré leur gêne
ils se montraient pitoyables aux plus malheureux qu’eux. Nous trouvons, dans
le livre de comptes de Jacques Auguste de Poilloüe de Bonnevaux, que nous
avons déjà cité, cette mention, inscrite avec la minutie que l’ancien officier
apportait dans la rédaction de ses dépenses, souvenir du temps où il devait contrôler
les comptes de sa compagnie, au régiment d’ Artagnan : « Après avoir compté
les anciens arrérages que Claude Lhoste me devait, il s’est trouvé me devoir
la somme de 230 livres, mais ayant égard à la misère et à la pauvreté dudit
Lhoste et de sa famille je lui ai fait remise de la dite somme et lui ai
donné par charité une quittance générale ». |7
À la Révolution, beaucoup émigrèrent, si attachés
à la personne du Roi, qu’ils ne connaissaient guère cependant, que la Patrie leur
paraissait être là où il se rendait. D’autres, restés dans leurs terres,
traversèrent la tourmente grâce à l’affection des habitants de leur pays,
qui ne voulurent point les dénoncer. Enfin, moins heureux, beaucoup d’entre
eux, expièrent sur l’échafaud révolutionnaire, les fautes que d’autres avaient
commises.
Au retour de l’émigration, ils reprirent leur vie
modeste ; on vit se rouvrir les vieux hôtels des petites villes où les plus
fortunés de nos gentilshommes venaient passer l’hiver. Étampes, Pithiviers,
Châteaudun, Vendôme, avaient alors une société de vieilles familles locales,
abritant leur rancœur contre Bonaparte dans ces demeures aux lignes un peu
sévères, mais de bon air, au fond des cours au pavé raboteux, s’ouvrant sur
la rue par une porte majestueuse flanquée de bornes.
Puis, ce sont les temps modernes, l’époque du développement
industriel, la mobilité des événements et des hommes à côté de la vie lente,
paisible, un peu endormie de nos anciennes provinces.
Bien peu de ces familles de vieille souche beauceronne
habitent encore leur région. Emportées par les nécessités de la vie actuelle,
elles se sont dispersées et ne savent plus rien, pour la plupart, des traditions
et des idées qui ont soutenu leurs pères.
Cependant, le souvenir de ces gentilshommes de Beauce
demeure encore en quelques coins de notre vieille province. Un mur à demi
écroulé, dont le lierre couronne le faîte, indique l’emplacement d’un parc
que la culture a remplacé, un pignon aperçu entre deux hangars, dans une
cour de ferme, rappelle la gentilhommière d’autrefois, un écusson martelé
au-dessus d’une porte évoque un fief, dont le nom seul a subsisté. Et nous
croyons alors, dans la brume dorée qui s’ élève au couchant sur la vaste plaine
qui fut leur berceau et qui est maintenant leur tombe, voir nos bons gentilshommes
revenir à cheval au logis, graves, un peu solennels dans leurs habits brodés,
un peu naïfs aussi, mais si pleins de résignation, de courage et d’honneur,
qu’ils nous semblent résumer toutes les qualités de la race, tout ce qu’a
de grand, de fier et de désintéressé, l’âme française.
Comte de Saint-Périer.
Portrait de Louis-René
de Poilloüe de Bonnevaux, fils de Jacques-Auguste
03. Les Dépenses d’un gentilhomme
étampois au XVIIIe siècle 3
À l’époque actuelle9 10
où chacun a lieu de se plaindre du prix de la vie, il peut être intéressant
de rechercher comment vivait un gentilhomme à Étampes, vers le milieu du
XVIIIe siècle.
Nous avons un livre de comptes qui fournit des indications
à cet égard. C’est un registre relié en vélin blanc, fermé par deux petites
courroies de cuir, contenant environ trois cents pages de ce papier ancien,
à peine jauni par le temps, que nous ne connaissons plus aujourd’hui.
Il appartient à Jacques-Auguste de Poilloüe, Chevalier
de Bonnevaux, né le 30 octobre 1694, fils de Louis de Poilloüe de Bonnevaux
et d’Angélique-Clémence Hémard, dame et héritière du Petit-Saint-Mars. Capitaine
au régiment d’Artagnan en 1712, il épousa en 1719 Marie-Catherine Foudrier
de Boisrevaux dont il eut dix enfants. Il quitta bientôt l’armée pour se
retirer à Étampes, où il appartenait à la paroisse de Saint-Basile. Sa vie semble
avoir été tout entière consacrée à l’ éducation de ses enfants et à l’administration
de ses biens qui n’étaient point considérables. Sa fortune s’élevait, dit-il,
à 31.360 livres. Elle était constituée par des terres sises à Saclas, à Étampes,
à
Morigny, à Mainvilliers, à Marolles, etc. et par
une action et deux dixièmes d’action de la Compagnie des Indes.
La modicité de sa fortune l’ obligeait à une surveillance
incessante : il s’occupait lui-même du fagotage de ses bois, de ses fermages
et redevances, de ses vendanges, c’était le temps où les vignes étaient prospères
dans la région d’Étampes. Et il tenait un compte scrupuleux de toutes ses
dépenses. Elles n’étaient point très élevées pour sa vie ordinaire, si nous
nous en référons à cette note :
« Le vingt de mars mil sept cent cinquante et un,
j’ai conté avec maître Pinet mon boucher, de toute la viande que nous avons mangée
pendant la précédente année. Le tout est monté à la quantité de 1.450 livres
pesant, qu’il m’a fait payer sur le pied de cinq sols 6 deniers la livre.
Le tout fait la somme de 397 livres. »
Heureux le temps que celui où la viande valait cinq
sous la livre !
Ce prix subissait d’ailleurs des modifications légères,
suivant les années ; en 1753, de six sols six deniers.
M. de Bonnevaux mangeait aussi du gibier, mais également
à peu de frais, comme en témoigne la mention suivante de l’année 1755.
« Le dix août j’ai donné au nommé Durand garde de
Maisse, une commission pour garder mes bois et ma chasse sur l’étendue de
mes fiefs de la Motte d’Arcis et du Boulay de Bonnevaux, aux gages dont nous
sommes convenus, à la charge de ne point chasser ailleurs que sur les dits
fiefs et de se conformer aux règlements des chasses et de me donner du gibier
dont je lui paieray pour chacques pièces cinq sols. »
Et ainsi M. de Bonnevaux acquit quatre-vingt-sept
pièces de gibier pour la modique somme de 18 livres. Dans cette liste figurent
des perdreaux rouges et gris, des lapins, des lièvres, des bécassines, des
cailles, et même, détail singulier, un héron butor.
L’entretien des bois à cette époque n’était pas non
plus très onéreux. Au mois de décembre 1769, M. de Bonnevaux fait planter
« autour du pré apelé le Saint-Foin, 116 peupliers d’Italie qui lui coultent
huit sols chacun et quatre sols pour les planter. »
Nous savons aussi quels gages il donnait à ses domestiques
:
« Le 10 décembre 1754, j’ay conté avec Antoine Tardif,
dit Saint-Jean, mon domestique, des gages que je luy dois à raison de 60
livres par an. »
Cependant ces gages sont portés à 75 livres à partir
du 1er octobre 1755. Mais il ne faudrait point croire que Saint-Jean
fût vêtu comme un maître jacques. Bien au contraire, « le 1er
de janvier 175611,
M. de Bonnevaux fait faire à Saint-Jean un habit, veste et culotte, plus
au dit pour un chapeau bordé en argent. » Et le 1er novembre 1756,
il lui fait faire encore « une veste de peluche avec des parements de velours
cramoisi. »
Malgré ses gages modestes, Saint-Jean vivait sans
doute heureux chez son maître, car nous le trouvons encore au service de
Mme de Bonnevaux plus de trente ans après, recevant toujours «
soixante et quinze livres pour une année. »
Il semble donc qu’en dépit de sa médiocre fortune,
M. de Bonnevaux dût vivre à l’aise. Il n’en était rien cependant parce que
l’entretien et l’établissement de ses enfants lui coûtaient de gros sacrifices.
Son fils René-Louis, le Chevalier, était lieutenant
au régiment de Luxembourg et venait passer ses congés chez son père, avec son
frère Jean-Baptiste, seigneur d’Izy, officier au même régiment.
Nous trouvons en l’année 1746 les dépenses faites
pour les deux frères :
POUR LE CHEVALIER.
Pour des bas à Paris et autres bagatelles. 12
livres
Pour son cheval limousin. 60
—
Pour son cheval auvergnat.
60 —
Pour trois mois d’un maître à danser. 7 livres
10
Pour une boucle à cheveux.
3 —
Pour deux paires de souliers.
8 —
Pour le ferrage de ses deux chevaux, etc. 4 —
POUR D’IZY.
Pour l’habit uniforme. 60 livres
Pour une épée. 8 —
Pour trois mois d’un maître à danser. 7 livres
10
Pour faire habiller ses deux
valets. 10 —
Donné en partant pour le régiment.
200 —
Le 26 novembre 1747, les deux frères arrivent de
nouveau à Étampes avec trois valets et quatre chevaux.
Le 20 décembre, M. de Bonnevaux fait faire au Chevalier
« un habit uniforme et une veste et une culotte de velours cramoisi. Le tout
coutte deux cent quatre livres ».
En février 1748, il achète pour d’Izy un cheval de
cinq ans moyennant 80 livres. En outre, M. de Bonnevaux se chargeait de recruter
des soldats pour les régiments de ses fils. On sait qu’à cette époque il
n’y avait pas de tirage au sort. L’armée était uniquement composée d’engagés
volontaires et le recrutement en était parfois malaisé. Il fallait attirer
les jeunes gens par des pourboires, des promesses d’ avantages pécuniaires,
faire miroiter à leurs yeux la perspective flatteuse de la gloire et du butin.
Des sergents recruteurs étaient officiellement préposés à cette mission.
Mais les officiers s’occupaient eux-mêmes d’engager des hommes pour leur
régiment et pendant qu’ils étaient en campagne, leurs parents se chargeaient
du même soin.
M. de Bonnevaux ne s’en faisait pas faute ainsi que
le prouvent les notes suivantes :
« Le samedi 19 décembre 1744 le nommé Cananaux anbaucheur
et tambour à Estampes a battu la quesse pour la recrue du Chevalier. Je luy
ay donné 1 livre 10.
« Le 2 février 1745, j’ay engagé le nommé Jacques
Guérin, natif de la paroisse d’Étréchy. Je luy ay donné 3 livres pour boire et
j’ay donné aux deux embaucheurs qui me lonst ammené 6 livres.
« Le deux décembre 1745 j’ay engagé le nommé Louis
Moineau dit Saint-Martin, natif de la paroisse de Saint-Martin d’Estampes
lequel s’est engagé pour servir en qualité de soldat pendant six années.
Je lui ay promis de luy faire donner trente livres en arrivant au régiment.
De plus, je luy ai donné six livres pour boire à la santé du Roy. »
Enfin, les officiers devaient acheter leurs charges.
C’était une lourde dépense, qui dépassait même les possibilités de M. de Bonnevaux,
puisque nous relevons cette note :
« Le 10 décembre 1746, jay emprunté pour avoir une
compagnie au Chevalier, la somme de 5.000 livres, par contrat passé devant
M. Sauvage, notaire à Paris. »
M. de Bonnevaux était un père trop généreux pour
que sa modeste fortune ne fût point rapidement entamée. Aussi trouvons-nous
à diverses dates la mention d’emprunts faits à des « bourgeois de Paris,
aux dames Religieuses de la Congrégation d’Estampes, aux Pères Barnabites,
etc. », emprunts dont les intérêts absorbaient une grande partie des faibles
ressources de M. de Bonnevaux.
Mais ses fils ne furent point ingrats. L’aîné, connaissant
sans doute la situation obérée de son père, renonce en sa faveur le 14 mars
1747, aux avantages que sa grand’mère, mère de M. de Bonnevaux, lui avaient
assurés par testament. |2 Rare exemple de désintéressement ! D’autre
part ; M. de Bonnevaux eût la satisfaction de voir, avant sa mort, plusieurs
de ses fils atteindre une situation assez élevée dans la carrière qui lui
avaient coûté tant de sacrifices. En particulier, son fils Louis-René fut
nommé Lieutenant-Colonel du régiment de Royal-Lorraine et Chevalier de Saint-Louis
en 1757, dès l’âge de 31 ans et brigadier des armées du Roi en 1766. C’est
encore le registre de M. de Bonnevaux qui nous apprend ces nominations, car
il offre plus qu’un aride exposé des comptes ; c’est une manière de Livre de raison, de ces livres où nos pères inscrivaient à côté de leurs recettes
et de leurs dépenses les événements principaux de leur vie et de leur temps.
M. de Bonnevaux consigne les noms et le jour de naissance
de tous ses enfants, leur mariage, les étapes remarquables de leur carrière.
Il confie aussi à ce cahier les dates douloureuses de sa vie. Ce n’est pas
sans émotion qu’on lit à la suite d’un banal compte d’ écurie :
« Mon pauvre fils aîné a esté tué d’un coup de canon
au siège de Berg-op-Zoom, à la tranchée, la nuit du 19 au 20 d’aoust 1747. Il
avait esté nommé quelques jours devant capitaine en segond des mineurs...
»
Et les comptes, en cette page, sont demeurés inachevés,
comme si la force lui avait manqué pour les poursuivre.
Ces quelques notes, bien qu’éparses, nous font connaître
le cœur de M. de Bonnevaux. C’était un homme sensible à la misère des humbles
et qui s’efforçait de les adoucir dans la mesure de ses faibles moyens.
Ainsi trouvons-nous au mois de novembre 1766 :
« Après avoir conté des anciens arrérages que Claude
Lhoste me devait, il s’est trouvé me devoir la somme de 230 livres, mais ayant
égart à la misère et la pauvreté du dit Lhoste et de sa famille, je luy ay
fait remise de la ditte somme de 230 livres et luy ay donné par charité une
quittance générale. »
M. de Bonnevaux vécut jusqu’à un âge avancé. En 1770,
alors qu’il avait 76 ans, il tient encore ses comptes avec la même exactitude
scrupuleuse et note de temps à autre un fait qui l’a frappé. Ainsi nous trouvons
:
« le 16 may 1770, Mgr le Dauphin a esté
marié à Versailles. Le 30, beau feu d’artifice à Paris, mais par un fascheux
accident, il a péri plus de 200 personnes. »
« Ce fascheux accident » est la terrible bousculade
qui se produisit place Louis XV et que le malheureux Louis XVI regarda comme
un funeste présage pour son règne.
En 1771, M. de Bonnevaux n’écrit plus. Une écriture
de femme apparaît. Sans doute celle de Mme de Bonnevaux, qui relève
les comptes avec un soin pareil, mais sans y joindre les quelques faits personnels
que nous aimions à trouver sous la plume de son mari. Il mourut à Étampes,
le 16 février 1773 et fut inhumé dans le cimetière de la paroisse Saint-Basile.
M. de Bonnevaux vécut une longue vie non exempte
de tristesses, ni de gêne, mais du moins put-il emporter en mourant la satisfaction
d’avoir accompli modestement son devoir de chaque jour et de s’être, jusqu’au
bout, dévoué pour les siens.
Dr de Saint-Périer.
iïfev
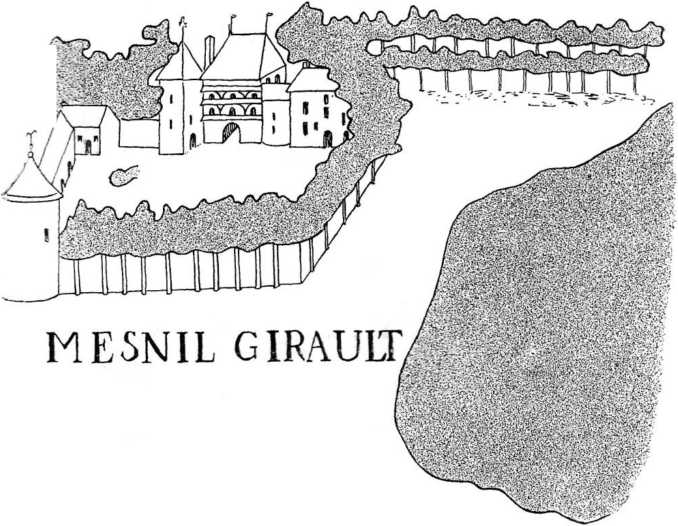
Fig. 1. - La ferme de
Mesnil-Girault en 1764.
04. Une ancienne vue de
Mesnil-Girault >«
Il existe à Versailles12 13 un plan de la terre de La Montagne dressé
pour Pépin, seigneur de La Montagne, en 1764, qui comprend un dessin de Mesnil-Girault.
Ce dessin (fig. 1) nous montre qu’à cette époque la ferme de Mesnil-Girault
comprenait encore un grand bâtiment à l’entrée, haut de deux étages et coiffé
d’un comble élevé, orné de deux girouettes. À gauche, une tour carrée à comble
pointu, terminée également par une girouette, accostait le bâtiment central
qu’un passage couvert |48 faisait communiquer avec une maison
d’habitation moins élevée. Des bâtiments d’exploitation occupaient le côté
gauche de la cour et s’appuyaient sur une grosse tour ronde qui se reliait
au mur d’enceinte. De grands arbres formaient un rideau à l’extérieur et une
avenue bordait la route d’accès à l’est.
La très ancienne origine de la ferme de Mesnil-Girault
nous |49 a paru mériter la publication de cette figure qui, sans
avoir la valeur d’un document photographique, doit cependant donner, dans
son ensemble, une idée assez exacte de ce qu’était la ferme au milieu du
XVIIIe siècle. On sait que Mesnil-Girault formait une châtellenie
déjà citée dans des lettres de Philippe-Auguste, en 119414. En 1229, on trouve
Geoffroy de Mesnil-Girault, puis en 1240, Jean et Pierre de Mesnil-Girault,
seigneurs de la terre ou d’une partie seulement de la châtellenie. En effet,
dès 1224, le chapitre de l’église Sainte-Croix d’Orléans apparaît comme le seigneur
le plus important de Mesnil-Girault. À cette date, le chapitre affranchit
les serfs de son domaine, moyennant une redevance d’une gerbe sur douze.
Il exerce la justice haute, moyenne et basse, et possède, pour l’administration
de son domaine et l’exercice de cette justice, un hôtel à Étampes, rue de la
Coutellerie (aujourd’hui rue de la Tannerie), dit hôtel de Sainte-Croix ou
de Mesnil-Girault. Cet hôtel fut vendu comme bien national, en 1791, à Michel
Laglace15.
A l’époque de notre dessin, le revenu de la terre de Mesnil-Girault était
de 22.600 livres.
Il demeure aujourd’hui une belle porte (fig. 2) et
quelques détails d’architecture intérieure des XIVe et XVe
siècles ; des bâtiments de ferme qui, jadis, portaient les noms de « grande
et petite besongne », il ne semble rien subsister.
R. de Saint-Périer

Fig. 2. - Porte actuelle
de Mesnil-Girault.


Entrée d’Étampes du côté
de Paris, porte Saint-Jacques, auXVIIIe siècle
05. La Police municipale
à Étampes en 1779 ^
Si les habitants de notre ville connaissent aujourd’hui
une bonne voirie, des rues paisibles et une police vigilante, il semble qu’il
n’en ait pas toujours été ainsi et qu’à la fin du XVIIIe siècle, l’ordre
public ait été souvent troublé à Étampes. Aussi, sur les remontrances du
Procureur du Roi, qui se plaignait des contraventions journalières auxquelles
donnaient lieu l’inobservation des règlements, Jacques-Julien-François Picart, écuyer,
seigneur de la Châtellenie de Noir-Épinay, etc., lieutenant général civil
et criminel de la police royale de la ville d’Étampes, rendit-il, le samedi
10 juillet 1779, une ordonnance de police concernant l’ordre et la sûreté
publique, qui fut homologué par un arrêt de la Cour de Parlement de Paris,
le 6 avril 1780.
Le lieutenant-général se propose de renouveler les
anciens règlements relatifs « aux contraventions dans lesquelles les habitants
de la ville tombent le plus souvent, et même d’ y ajouter ».
Tout d’abord, il se préoccupe de la propreté des
rues. Tous les habitants seront tenus de balayer ou de faire balayer les
rues devant leurs portes jusqu’aux ruisseaux, « même la moitié des chaussées
» les mercredis et les dimanches de chaque semaine et 16 les jours de processions
générales. Ils devront ramasser les boues en tas sur le bord des ruisseaux,
afin que l’entrepreneur de l’enlèvement des boues puisse les emporter, arroser
avant de balayer en temps de sècheresse, tendre enfin le devant de leurs maisons
de « tapisseries ou draps les jours de la grande et la petite Fête-Dieu,
sous peine de six livres d’amende ».
L’entrepreneur de l’enlèvement des boues devra parcourir
les rues une heure avant le moment du balayage avec une sonnette « qu’il
sonnera ou fera sonner » pour avertir les habitants qu’ils aient à balayer.
Ses tombereaux devront porter une sonnette, être étanches et il devra assurer
le nettoyage des places publiques.
Les habitants ne devront faire aucun amas de paille,
fumier, pierres, ni tuileaux dans les rues ou places « sous prétexte de faire du
ciment », ni jeter « aucunes cosses de pois et fèves, pieds et feuilles d’artichauts,
de choux ou d’autres légumes », non plus que répandre de l’eau ou « aucune
autre chose » sur les voies publiques. Ils devront casser la glace et enlever
les neiges devant leurs maisons.
La tranquillité des rues est ensuite l’objet de la
sollicitude du Lieutenant-Général. Il fait défense aux habitants de la ville
« de se jeter ou à qui que ce soit des boules de neige, comme aussi de jouer
dans les rues, places et promenades publiques à la paulme, aux quilles, au
volant, au bâtonnet, au dégaut et à tous autres jeux dont les passants puissent
être incommodés ou blessés ». Il interdit aussi de faire « aucuns charivaris
avec poëles, chaudrons, violons, tambours ou autrement sous prétexte de mariages
ou autres objets ». Il faut croire que cette coutume, qui existe encore dans
quelques villages de France, était répandue alors à Étampes, car une amende
de cinquante livres est prononcée contre chaque contrevenant et « même de
plus grande s’il y échet ».
Les marchands ou loueurs de chevaux ne devront pas
essayer leurs chevaux dans les rues, « ni faire conduire leurs animaux par des
enfants en bas-âge ». Les charretiers devront marcher à pied et non conduire
montés sur leurs chevaux, sous peine de six livres d’amende.
Les rues ne devront pas être encombrées la nuit par
des charrettes, haquets et autres voitures » ou si les habitants de trouvent
« dans l’absolue nécessité de laisser quelques voitures ou autres objets
la nuit dans les rues, ils devront placer une lanterne allumée devant leur
maison ». Cette prescription était d’autant plus sage qu’on sait que les
rues d’Étampes n’étaient pas éclairées au XVIIIe siècle. En 1788,
M. de Bierville demanda que des réverbères fussent placés dans toutes les
rues, ce qui ne lui fut pas accordé.
Notre ordonnance contient encore quelques prescriptions
sur les constructions des maisons, les alignements, le dépôt des matériaux,
qui ne diffèrent guère des règles usitées aujourd’hui en pareille matière.
Mais le souci de la sécurité publique retient davantage
l’attention du Lieutenant-Général. Tous les propriétaires et principaux locataires
« de quelque état et condition qu’ils soient » devront tenir les portes de
leurs maisons fermées la nuit. Les chiens ne devront pas « vaguer dans les
rues ». Les habitants ne devront « tirer dans les rues aucuns pétards ou
fusées, pistolets, fusils ou mousquetons ou autres armes à feu » non plus que
brûler dans les rues « toutes matières combustibles ». Les propriétaires
devront faire ramoner leurs cheminées et une amende de cent livres sera payée
par « ceux dans la cheminée desquels le feu aura pris ».
En cas d’ incendie, le Lieutenant-Général reprend
le texte d’ un arrêté de 1670 et enjoint aux charpentiers, maçons et couvreurs «
de se rendre au lieu où sera l’incendie, d’y emporter avec eux leurs outils
ou instruments nécessaires, à peine de 100 livres d’amende contre les ouvriers
refusans et même de plus grande suivant l’exigence du cas ». Le service des
incendies était fort sommaire à Étampes à cette époque. On avait bien décidé
en 1778, l’achat de deux pompes qui devraient être placées dans un local
de l’Hôtel de Ville, mais la somme de 1.100 à 1.200 livres, nécessaire à
l’achat, manquait.
Enfin, il fut défendu à toutes personnes « si elles
n’en ont le droit et qualité de porter épée, canne ou bâtons et à toutes personnes
de quelque état, qualité et condition qu’elles soient de porter épée ou autres
armes étant masquées !
Nous trouvons encore des mesures relatives à l’hygiène
et à la moralité publiques. Les bêtes mortes devaient être « traînées dans
les terres hors de la ville et les faubourgs à un quart de lieue au moins
des maisons, routes et chemins et enterrées dans des fosses profondes au
moins de sept pieds ». Les jeux de hasard sont règlementés sévèrement, ce
qui est fort bien, mais ce qui nous paraît un peu singulier aujourd’hui est
d’y voir compris le jeu de billard. Il y a, dit le Lieutenant-Général, «
onze jeux de billards dans cette ville, plusieurs personnes se proposent
même d’en établir encore et il est dangereux de laisser se multiplier des établissements
qui sont souvent pour les jeunes gens une occasion de déranger leur fortune
». Il faut donc que « ceux qui tiennent des billards soient d’une conduite
et d’une réputation suffisamment connues ». Aussi tout jeu de billard ne
sera-t-il établi qu’après autorisation, sur les conclusions du Procureur
du Roi, sous peine de 300 livres d’amende et de confiscation du jeu. Ces
établissements seront fermés à sept heures du soir en hiver et à neuf heures
en été : « Il est défendu de faire aucuns paris et il est enjoint à ceux
qui joueront au jeu de billard d’y jouer un jeu très modéré ».
L’ordonnance contient encore quelques règlements
sur les auberges, les affiches, la vérification des poids et se termine par l’injonction
à « tous les aubergistes, cabaretiers, taverniers, limonadiers, vendeurs
de bière, d’eau-de-vie, etc., de liqueurs en détail et maîtres de jeu de
billard d’avoir, en tout tems, un exemplaire de la présente ordonnance attaché
dans le lieu le plus apparent de leur maison, auberge, cabaret et jeu de
billard ».
Ainsi, par une sage règlementation, dont bien des
articles se retrouvent dans nos codes actuels de police urbaine, M. le Lieutenant-Général
assurait-il le calme et la sécurité des habitants d’Étampes.
R. de Saint-Périer.
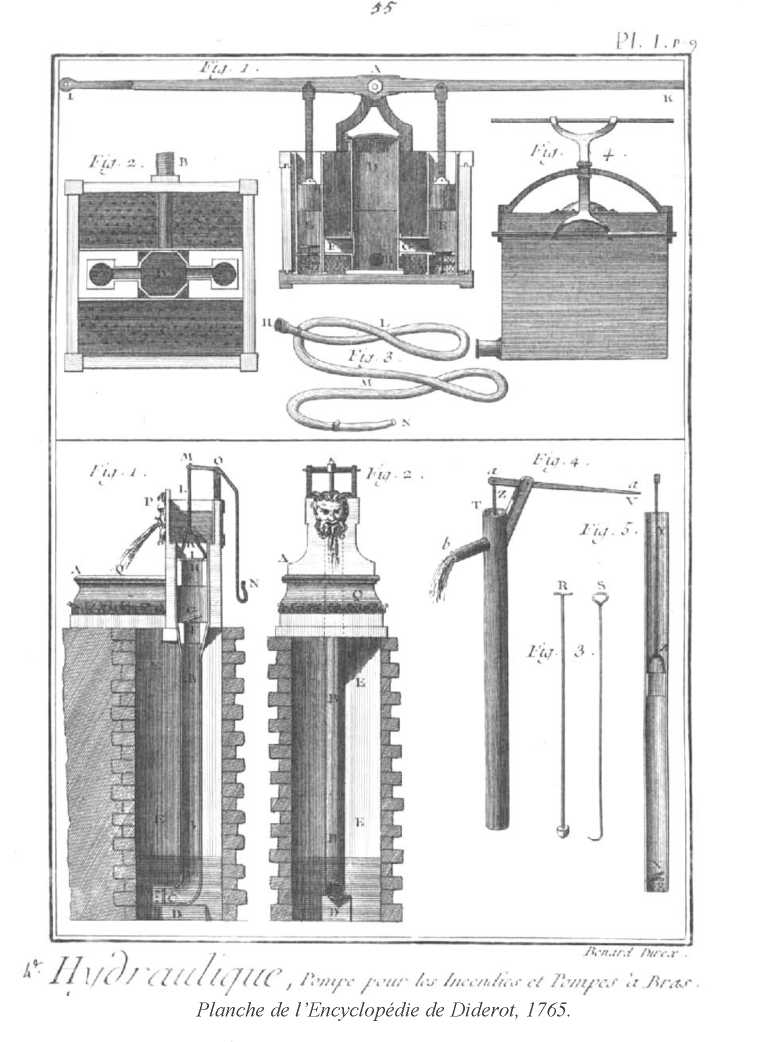
06. La première pompe a
incendie à Étampes 2>
par le comte R. de Saint-Périer
On a pu voir dans le numéro du 29 décembre dernier
du Journal de Seine-et-Oise, le projet d’installation au marché franc d’une caserne de
pompiers dotée de tous les perfectionnements modernes qui doit faire d’Étampes
une des villes les mieux défendues contre les incendies.
Il nous paraît intéressant d’évoquer à cette occasion
ce qu’était jadis ce service municipal dans notre ville. La première mention que
nous en trouvions remonte seulement à 1670 : c’est une simple ordonnance
de police qui enjoint aux charpentiers, maçons et couvreurs « de se rendre
au lieu où sera l’incendie, d’y emporter avec eux leurs outils nécessaires,
à peine de 100 livres d’amende contre les ouvriers refusant ». En 1728, la
municipalité achète 50 seaux de cuir garnis d’osier pour servir aux incendies, acquisition
certes insuffisante ! et le 15 janvier 1778, à la suite d’un sinistre, il
fut décidé qu’on ouvrirait un crédit e 1 200 livres pour acheter deux pompes.
Mais les fonds manquèrent et l’on dut se borner à porter le nombre des seaux
de cinq à onze douzaines. Enfin, en 1788 une souscription permit de faire
l’acquisition des deux pompes. En outre, le Conseil décida qu’un maçon-couvreur,
Pommeret, se rendrait à Paris et y resterait le temps nécessaire pour y étudier
le maniement de ces nouveaux engins : il n’y demeura pas moins de 25 jours.
Néanmoins, la 17
municipalité dut être satisfaite de lui puisqu’elle
lui accorda une gratification de 125 livres.
Mais ce n’ était pas la première fois que des pompes
à incendie faisaient leur apparition à Étampes. En 1745 dans une occasion solennelle
pour notre ville, la réception du Roi, des pompes de Paris furent amenées
spécialement pour parer à un danger possible d’incendie. En effet, le 20
février 1745 Louis XV et le Dauphin, âgé de 16 ans, arrivaient à Étampes,
afin de recevoir, le lendemain, l’ Infante Marie-Thérèse-Antoinette la fille
de Philippe V, roi d’Espagne, qui était fiancé au Dauphin. Tout au long de
sa route, elle était reçue avec solennité à chaque étape de son grand voyage
: notre ville ne voulut pas être en reste et fit bien les choses. Il était
venu de Paris, avant le Roi, un grand nombre de gardes de la maréchaussée,
400 gardes françaises et autant de suisses. Le Roi amenait avec lui les princes
du sang, tous ses ministres, les grands officiers de la couronne, un gros détachement
militaire de sa maison. Et tout ce monde fut logé et nourri, sans accident,
sans désordre et sans que rien manquât. On avait aménagé pour le Roi une
maison rue Saint-Antoine, en face du collège ; pour le Dauphin, la maison
de M. Lepetit, près du Moulin Sablon et pour l’Infante, celle d’Hémard de
d’Anjouan, rue de la Juiverie (où habite aujourd’hui Me Leflon).
Pour illuminer la ville, on avait installé, entre ces logis, dans les rues et
dans les jardins cent caisses ornées de girandoles qui portaient chacune
250 lampions. Durant toute la nuit, 22 000 lampions restèrent allumés. Les
risques d’incendie étaient considérables. C’est pourquoi les fonctionnaires
royaux se préoccupèrent d’apporter à la ville d’Étampes le matériel de secours
qu’elle ne possédait pas encore. 26 janvier|9 février
Marville, lieutenant de police à Paris, écrit au
comte de Maurepas, ministre d’État, dont les services comprenaient ce que nous
appellerions aujourd’hui le ministère de l’Intérieur : « Le sieur du Périer
m’a dit qu’il avoit reçu vos ordres pour envoyer des pompes à Étampes, qu’il
verroit M. de Sauvigny et se concerterait avec lui sur les arrangements à
prendre. Nous avons aussi tout réglé hier avec ledit sieur du Périer et M.
le Prévôt des marchands tant pour la tranquillité et la sûreté dans les salles
de bal que pour les précautions à prendre contre le feu ». Dumouriez du Périer
était le directeur des pompes à incendie à Paris : c’est ainsi qu’il avait
reçu du comte de Maurepas l’ordre d’en faire transporter à Étampes et d’y
envoyer des gens pour les servir. Cet ordre précise « qu’il y aura, à la
portée de chaque salle de bal, deux pompes, de l’eau tirée dans deux tonneaux,
des pompiers, des seaux, des crocs et des charpentiers avec des haches et
des échelles. Et pour la garde de chacune de ces salles, il y aura quatre
escouades, deux brigades de guet, deux sergents aux gardes françaises et
pour garder les buffets et les orchestres, M. le Prévôt des marchands mettra
aussi des suisses ». Ces sages précautions furent heureusement inutiles puisqu’aucun
accident ne vint assombrir « ces beaux jours durant lesquels, dit un contemporain
enthousiaste, Étampes était devenu Paris ».
Quant aux pompes à incendie, elles regagnèrent aussitôt
les services de M. du Périer et Étampes se trouva ramené au secours ordinaire
des seaux, des crocs, échelles et cordages, organisation plus primitive encore
qu’à l’époque romaine où la défense contre le feu était minutieusement réglée.
Durant tout le Moyen-Âge et même jusqu’à l’époque moderne, la lutte contre
ce fléau demeura rudimentaire. Félicitons-nous des perfectionnements dont
enfin notre ville sera prochainement dotée sous ce rapport.
Comte R. de Saint Périer.
07. Le Chien pêcheur des
Cordeliers d’Étampes 22
Dans son supplément au numéro du 10 septembre 1927,
l’Abeille d’Étampes a publié un manuscrit, communiqué par M. Mille, qui relate
en des vers sinon très harmonieux du moins assez alertes les curieux exploits
d’un barbet que les Cordeliers du monastère d’Étampes, situé dans l’actuelle
rue des Cordeliers, utilisaient à la pêche des écrevisses et qui trouva dans
cette mission une fin misérable et héroïque.
Ce manuscrit n’est point inédit et nous pensons qu’il
peut y avoir quelque intérêt, pour les lecteurs de l’Abeille qui ne connaîtraient pas ce petit ouvrage, à rappeler ses
diverses éditions et la vie de son auteur.
Il s’agit sans doute d’une copie et non point de
l’original, d’ ailleurs fautive en quelques points (un vers faux, par exemple). Mais
la copie peut être contemporaine de l’œuvre, un poème en latin et en français
de Claude-Charles Hémard, seigneur de Danjouan, né à Étampes le 3 février
1690, secrétaire du cabinet du Duc d’Orléans, mort au château de Gironville
qu’il possédait par sa femme, le 4 juillet 1740. Il publia le Chien pêcheur
vers 1720 ou 1724 en une petite brochure de 15 pages ; cette édition originale
est fort rare. Elle ne se trouve pas à la Bibliothèque Nationale et nous
n’en avons jamais rencontré d’exemplaire. Il n’est pas impossible qu’elle
ait été imprimée à Étampes, car il 18 existait, avant Dupré, premier imprimeur
connu de notre ville, des presses locales, supprimées par un arrêt du Conseil
en 1759, comme ne présentant pas un caractère d’utilité |2 suffisant.
À cette époque, en effet, l’exercice de l’imprimerie n’était pas libre.
Une seconde édition, publiée par le père Desmolets,
bibliothécaire de l’Oratoire, dans le tome X de sa Continuation des mémoires de
littérature et d’histoire, parut quelques années après
; cette seconde édition, que nous possédons, (Bibl. nat. Yc. 8740), est également
rare : nous donnons ci-dessous une figure de la première page du poème qui
comprend, comme l’édition originale, 15 pages.
En 1736, dans la IXe brochure du Glaneur français, parut une troisième édition chez Prault père, quai de Gesvres,
1736. Cette édition (Bibl. Nat. Yc. 10546), n’a pas été signalée par Paul Pinson
dans sa bibliographie d’Étampes.
Une quatrième édition fut donnée à la suite des œuvres
de Gresset, par Cubières de Palmezeau qui attribue, par ignorance ou par
supercherie, à Gresset, l’œuvre de notre poète étampois.
Maxime de Monrond, dans ses Essais historiques sur la ville
d’Étampes en 1836, a donné de longs extraits
du Chien pêcheur.
Enfin, en 1875, Paul Pinson a publié une dernière
édition, tirée à 125 exemplaires, chez Léon Wilhem à Paris, petit in-4°.
On voit donc que l’œuvre de Claude Charles Hémard
a connu une certaine fortune : l’auteur, d’ailleurs, jouissait en son temps d’une
réputation de lettré et de bel esprit. Tout d’abord avocat au Parlement,
puis entraîné par son frère, clerc et ami intime du fameux diacre Pâris,
dans la société des Jansénistes, il abandonna sa charge et se consacra à
la poésie religieuse. Il publia plusieurs poèmes en latin et en français,
notamment des hymnes en l’honneur des saints martyrs Cantiens, patrons de
la ville d’Étampes, qui lui valurent de grands |3 éloges des Pères
de l’Oratoire qui le tenaient en haute estime. Nous apprécions moins aujourd’hui
ce genre qui exige évidemment une connaissance approfondie du latin et de
la versification, mais qui manque de fantaisie et de lyrisme.
Claude Hémard appartenait à une vieille famille étampoise,
dont Paul Pinson a donné une généalogie dans son édition du Chien Pêcheur. D’après cet auteur, le premier des Hémard serait mort de
la peste vers 1630 : ses papiers auraient été brûlés, ce qui empêcherait
de remonter plus haut. Mais avant cette date, nous trouvons des Hémard très
vraisemblablement de cette famille. Jean Hémard est cité en 1527 et Pierre,
seigneur de Denonville, était convoqué au ban et à l’arrière-ban du bailliage
d’Étampes en 1544. Jacques Hémard est présent en 1556 à Étampes à l’assemblée
qui rédigea les coutumes du bailliage. Du frère puîné de N. Hémard, mort
de la peste, sortit une lignée qui occupa pendant deux siècles des charges
civiles à Étampes ; nous trouvons un receveur de la terre de Mesnil-Girault,
un prévôt des maréchaux, un lieutenant particulier au bailliage, un maire d’Étampes.
Ce dernier, René, né en 1622, écrivit un recueil d’épigrammes et déploya
dans l’administration de la cité de grandes qualités d’ordre et d’énergie.
Il reçut Louis XIV à son passage à Étampes en 1668 et résista à Louvois qui
avait envoyé à Étampes une compagnie du régiment du Dauphin y tenir garnison.
Les gens de guerre, à cette époque, ne montraient guère de courtoisie envers
les habitants des villes qui les hébergeaient et René Hémard, pour faire
cesser les vexations infligées aux Étampois par les Chevau-légers indisciplinés
du Duc de la Vallière, déploya une résistance qui faillit le faire |4
envoyer à la Bastille. Sa nièce Clémence Angélique, dame du Petit-Saint-Mars,
épousa Louis de Poilloüe, Chevalier, seigneur de Bonnevaux dont sont issus
les Poilloüe de Saint-Mars et de Saint-Périer.
De cette nombreuse famille étampoise, Claude Charles,
notre poète, petit-fils du maire d’Étampes, devait être avec son frère aîné
Pierre, le dernier du nom. En eux s’éteignit, en 1740 et 1763, une famille
qui prétendait se rattacher, comme tant d’autres de notre ville, à la fameuse
lignée des Chalo-Saint-Mars. On sait aujourd’hui que ce privilège extraordinaire
qui ne visait à rien moins qu’à exempter de tous impôts les innombrables descendants
d’Eudes Le Maire, reposait sur une imposture et une falsification d’un diplôme
original, mais on conçoit qu’un tel privilège déjà fort appréciable à l’époque
— et que serait-ce aujourd’hui ! — fût jalousement défendu.
Si le poème de Claude Charles Hémard est parfois
d’une emphase un peu outrée, il n’en demeure pas moins un exercice littéraire
digne d’éloge. Peut-être, comme le pense Paul Pinson, l’idée lui en a-t-elle
été inspirée par une œuvre du XVIe siècle de Philippe-le-Picard
et le chien des Cordeliers d’Étampes n’a-t-il jamais existé. C’est le sort
de bien des fictions poétiques qui ont enchanté les hommes et de bien des
héros exaltés par les poètes et qui n’étaient d’ordinaire que de pauvres
personnages. Qu’il nous soit permis de regretter que les écrevisses qui,
dans notre enfance encore, peuplaient les rivières d’Étampes, soient-elles aussi
passées dans le domaine du souvenir et qu’elles aient rejoint le chien courageux
et avisé qui savait si bien les capturer pour la plus grande joie des bons
pères Cordeliers de notre ville.
R. de Saint-Périer. |5
67
Qua per odoriferos Stemparum Naïades hortos Implicuêre
duos, undis concordibus, amnes Nympha Loë, germana Loës et Junia Nympha, Est
antiqua domus sacris habitata colonis, [Seraphidas dixere pio cognomine Patres,] Frondibus
umbrosis et amœnæ cespite ripæ Grata domus, grati jucundior arte Catelli.
Non huic de trivio genitor, nec degener ipse Fert
oculis atavos et totam pectore gentem : Crispula cæsaries, patrium Barbatulus
unde est Cognomen, vultuque resert animoque leones, Viribus inferior, per
quas nec tender cervis,
Se neque fulmineos valeat committere in apros, [Nam
quis Seraphidis non sic venantibus, usus ?] Liminis hinc custos latratibus
impiger arcet Quos auferre videt potiùs quam affere paratos ; Idem blandus
heris, notoque affabilis ori, Quisquis Seraphicis incesserit ornamentis.
Sed cui commissa est beneolentis cura culinæ, Gratior
is, quotiesque pium vectigal ab urbe, Hinc collectitium, perâ bipatente,
lyæum Inde refert cererem, sub pondere fessus amico, Obvius it et peram Barbatulus
ambit odoram, |6
Dans ce charmant vallon où Loëte et sa sœur, Unissent
deux ruisseaux d’inégale grosseur,
S’élève un bâtiment d’architecture antique,
De tout tems habité par l’Ordre Séraphique,
Un verger le couronne et des arbres épais Y donnent
à qui veut le couvert et le frais.
Par mille autres endroits ce séjour est aimable,
Mais un Barbet surtout le rend considérable.
Issu d’illustre race, il porte dans ses yeux Le beau
feu qu’y jetta le sang de ses ayeux.
Des flots de ses longs poils l’élégante frisure,
Imite du lion la vaste chevelure.
La nature, il est vrai, par une heureuse erreur,
Le revêtit d’un corps bien moindre que son cœur.
Aussi n’étant pas né pour la chasse ordinaire, Inutile talent dans un bon
Monastere,
Il se borna d’abord à garder la maison,
Aboyant le passant, quelquefois sans raison, Lorsqu’
il le voit surtout vêtu de telle sorte Qu’il vient en demander plutôt qu’il
n’en apporte. Aux Peres, comme il doit, toujours il rend honneur. Aux Freres
fait sa cour, et surtout au Quêteur.
Du plus loin qu’il revoit ce moissoneur habile, Courbé
sous le doux faix des présens de la ville, Par l’ odeur attiré comme par
un aymant Il court, en sa façon, lui fait son compliment.

Jean-Étienne Guettard
par Théodore Charpentier (Musée d’Étampes)
08. Les Plantes des Environs
d’Étampes au xviii e siècle 3
La ville d’Étampes a donné le jour à deux hommes
qui, avec un égal éclat, ont brillé, à des époques différentes, dans l’étude
et l’enseignement de l’histoire naturelle : Guettard au XVIIIe
siècle Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, au XIXe.

Le duc d’Orléans
C’est du premier que je désire entretenir aujourd’hui
les lecteurs de Y
Abeille d’Étampes, à propos d’un petit livre
qu’il publia sous ce titre modeste : Observations sur les Plantes et qui offre encore un grand intérêt pour notre région.
Ce livre parut en 1747, chez Durand, libraire à Paris, rue Saint-Jacques,
à l’enseigne du Griffon, en deux volumes in-12.
Guettard était déjà fort connu parmi les naturalistes
de son époque : docteur en médecine, membre de l’Académie royale des Sciences,
il tenait auprès du duc d’Orléans, bisaïeul du roi Louis-Philippe, l’emploi
de médecin-botaniste et conservateur 19
de son cabinet d’histoire naturelle. Ce prince différait
fort de son père, le Régent : aussi studieux que celui-ci était porté au
plaisir, il avait de bonne heure abandonné la cour et les affaires publiques et
cultivait, dans la retraite, les lettres et les sciences. Il avait créé un
« cabinet » comme on disait alors, où, sous la direction de Guettard, il
rassemblait les curiosités de la nature : minéraux, plantes et animaux. Il
mourut en 1752 et légua à Guettard les collections dont celui-ci avait eu
la charge.
C’est au duc d’Orléans que le naturaliste étampois
dédie son livre, dans le style ampoulé et laudatif qui était alors de rigueur pour
ces épîtres liminaires.
Guettard nous annonce ensuite que l’ouvrage comprend
deux parties : des observations qui regardent les glandes et les filets ou poils
des plantes, ce qui est son œuvre propre, et des indications sur les plantes
des environs d’Étampes : cette partie est presque entièrement due à son grand-père,
M. Descurain. À dire vrai, l’œuvre de M. Descurain nous intéresse aujourd’hui
plus que les observations de Guettard sur l’ anatomie végétale, car celle-ci
a été renouvelée par les méthodes de la micrographie moderne et il reste
peu de choses des remarques faites par Guettard.
Mais M. Descurain était un bon observateur et il
herborisait avec passion. Il était, nous dit Guettard, fils de François Descurain,
maître apothicaire à Étampes et de Cantienne Ramon. Il naquit le 22 août
1653 et fit ses études de médecine à Paris, montrant déjà un goût très vif
pour la botanique. Mais la mort de son père l’obligea à revenir à Étampes
pour lui succéder dans sa profession, avant que ses études fussent achevées.
Les médecins étaient rares alors et les apothicaires les remplaçaient souvent. Descurain
s’appliqua donc à lire les meilleurs auteurs de médecine et de pharmacie
de son temps et il fit ce que nous appellerions aujourd’hui de la médecine
illégale, montrant, dit
Guettard, « une prudence qui le faisoit agir ou rester
dans l’inaction, selon que la nature le demandoit ». Il eut bientôt une belle
clientèle, tant aux environs d’Étampes que dans la ville. C’est ainsi qu’il
herborisa, en parcourant la campagne, et qu’il dressa le catalogue des plantes
de la région, que son petit-fils devait publier.
Mais M. Descurain ne se bornait pas à recueillir
des plantes et à les étudier ; il faisait part de ses découvertes à quelques
amis et il forma avec eux une petite Académie, où ces honnêtes gens se communiquaient
leurs travaux qui « les auroient rendus dignes, nous dit Guettard, de la
plus célèbre Académie ».
Ils se réunissaient chez M. Geoffroy, père d’un médecin.
M. Pichonat, également médecin à Étampes, dissertait sur l’anatomie. M. Descurain
apportait les plantes qu’il avait recueillies, M. Le Maître, curé de Notre-Dame,
représentait les Belles-Lettres. Par les nuits claires d’hiver, ils observaient
le ciel. La curiosité de nos académiciens étampois s’étendait même jusqu’au
grec et à l’hébreu « où ils devinrent habiles ».
Le 19 octobre 1726, il y eut une aurore boréale à
Étampes. Toute la ville observa le phénomène, mais sans le calme qui convient
à l’étude scientifique. L’effroi fut si vif qu’on délégua quelques personnes
auprès de M. Descurain pour savoir ce qu’il pensait de cette troublante apparition.
Descurain était retenu au lit par la fièvre, mais son attitude était calme
et sereine. Il dit qu’il n’y avait rien à craindre et « on se crut en sûreté
puisque M. Descurain pensoit y être ».
Ce botaniste zélé avait formé un jardin d’expériences
où il avait réuni les plantes « singulières » de la région et des plantes étrangères
que lui procuraient ses correspondants, M. Mayo, apothicaire à Dourdan, et
surtout MM. de Jussieu qui professaient alors, avec l’éclat que l’on sait,
au Jardin du Roi, à Paris, devenu le Museum d’histoire naturelle.
Ce fut dans son jardin que Descurain gagna « par
le travail des mains auquel il s’occupoit » une pleurésie qui l’emporta le
17 mars 1740.
Je n’entreprendrai pas d’ analyser en détail le catalogue
des plantes publié par Guettard, à qui son grand-père l’avait légué par testament.
Il est souvent difficile de reconnaître aujourd’hui quelques-unes des plantes
signalées par Descurain. Bien que la première édition du Systema naturae de Linné ait paru en 1745, ses Fundamenta botanica en 1739 et les Genera plantarum
en 1737, bien des noms donnés par Descurain ne se rapporte pas à la nomenclature
du célèbre naturaliste suédois et leur identification demanderait de longues
recherches, laissant même parfois une grande incertitude. C’est ainsi, par
exemple, que Descurain cite le Cypripedium dans
les bois du Rousset et autour de Gravelles. Or cette orchidée n’est indigène
en France que dans l’Est, dans le Jura, dans les Alpes. Elle ne croissait
certainement pas aux environs d’Étampes au XVIIIe siècle. Descurain
doit désigner sous ce nom soit un Orchis, soit un
Ophrys, qui sont abondants autour d’Étampes mais nous ne pouvons
faire une identification certaine.
Ces réserves faites, nous trouvons dans l’ouvrage
de Guettard des indications intéressantes sur la région. La répartition des cultures
paraît être à peu près la même qu’aujourd’hui. Cependant, les vignes étaient
abondantes alors, notamment à l’entrée de Bouville ; elles ne sont plus guère
cultivées aujourd’hui dans nos environs. Il n’y a plus derrière la ferme
de Champdoux des « endroits humides et stériles » que signale Guettard. Mais
l’ensemble de notre flore n’a guère varié. J’ai eu la curiosité de vérifier
quelques-unes des stations où le bon et savant M. Descurain avait recueilli,
il y a deux cents ans, des plantes rares. Et j’ai eu la satisfaction que
comprendront tous ceux que l’observation de la nature ne laisse pas indifférents,
de les retrouver parfois.
Je signalerai seulement Y Aristolochia clematis L. que Descurain avait récoltée dans le « Cimetière Saint-Germain
» et qui n’est pas fréquente aux environs d’Étampes. Cette plante croît encore
dans le cimetière de Morigny, qui est, comme on sait, l’ancien cimetière
de Saint-Germain-lès-Étampes.

Plus curieuse est l’existence de l’Asarum europaeum L. dans notre pays. Cette plante est localisée dans quelques
points très disséminés du bassin de Paris. Or, Descurain l’a recueillie dans le
bois du Chesnay et les bois de Boutervilliers. Je l’ai retrouvée, croissant
en abondance, dans le petit bois du Chesnay où, il y a deux siècles, le botaniste
étampois avait observé déjà ces étranges fleurs purpurines, épanouies presqu’au
ras du sol, sous un beau feuillage d’un vert marbré. Ainsi, dans ce petit boqueteau,
s’est perpétuée cette plante modeste, qu’on ne trouve nulle part ailleurs
dans notre région, tandis que se modifiaient les formes sociales et les gouvernements,
image de la sereine impassibilité de la nature devant les événements qui
agitent les hommes.

On voit, par ces exemples, que Guettard a rendu quelques
services en faisant connaître le résultat des recherches de son grand-père.
Notre région offre aux amateurs de la nature bien des sujets d’étude attachants
et, comme le dit Claude Charles Hémard de Danjouan, Stampensis, étampois, qui dédia, au début du livre de Guettard, une
pièce de vers latins à la mémoire de Descurain :
Fœlices quibus has eadem
quae protulit herbas Protulit has doctum noscere terra virum.
« Heureux ceux pour qui une même terre a vu naître
et ces plantes et l’homme habile à les connaître ! » 20
77

Jean-Étienne Guettard
vu par Henri Richou (Musée d’Étampes)
09. Jean Guettard 4
Par Raymonde de Saint -Périer
On sait que notre Ville a 1’honneur d’avoir vu naître
deux grands naturalistes au XVIIIe siècle. La gloire du plus illustre, Geoffroy
Saint-Hilaire, a quelque peu voilé celle de son aîné Jean-Étienne Guettard,
moins brillant, à la fois par son caractère et par la nature de ses études,
et qui vivait à une époque où la Science commençait seulement à prendre son
magnifique essor. Au contraire, Geoffroy Saint-Hilaire, qui a vingt ans à
la Révolution, participe, non certes à aucune de ses violences, mais à l’exaltation
qui règne alors dans tous les domaines. Ses travaux sont déjà si remarqués
que la Convention lui offre — à 21 ans ! — une des douze chaires qu’elle
vient de créer au Muséum et sa carrière ne cessera de se poursuivre avec
le même éclat.
Nous voudrions remettre en lumière celle de Guettard,
qui s’est enveloppée d’obscurité dans sa propre ville, devenue bien ingrate à
son égard. En effet, de son vivant, et longtemps encore après sa mort, il
y connut une grande célébrité. On y parlait avec fierté de sa « réputation européenne », qui ne l’empêchait pas, modeste comme tous les grands esprits,
de garder des liens profonds avec Étampes.
Il était né le 22 septembre 1715. Nous ignorons malheureusement
dans quelle rue, nous savons seulement que ce fut dans le quartier Notre-Dame,
par son acte de baptême, d’une 21 lecture très facile : il nous dit que son
père était « marchand épicier », son parrain, oncle de son père, également
marchand, tandis que sa mère, Marie-Françoise Descurain, appartenait à une famille
d’intellectuels très connue à Étampes et dont le nom n’est pas encore oublié.
François Descurain, père de Marie-Françoise, donc grand-père de Guettard,
était médecin et maître apothicaire, comme son propre père, déjà établi en
cette qualité à Étampes au début du XVIIe siècle. C’est par le
petit-fils reconnaissant que nous est révélée la figure si originale et si
attachante du grand-père apothicaire. Son activité ne se bornait pas à vanter
les bienfaits de la thériaque à ses clients. L’heureuse époque à laquelle
il appartenait ignorait encore la spécialisation et comptait des chercheurs
passionnés pour |10-11 toutes les branches du Savoir. Si Descurain
avait le plus vif penchant pour la botanique, il se gardait d’oublier le
latin et le grec qu’il avait appris au collège des jésuites à Paris, l’anatomie
et la médecine que lui avaient enseigné « les écoles », également à Paris,
et qu’il dut bientôt pratiquer à Étampes, où la mort prématurée de son père
avait obligé sa mère à le rappeler, pour prendre la succession de la charge
d’apothicaire-médecin. En ce temps, les apothicaires exerçaient également
la médecine, en particulier dans les petites villes comme Étampes, qui ne
comptait qu’un ou deux médecins, souvent tenus de faire des tournées dans
la campagne. Dans ces fonctions, pourtant lourdes de responsabilités, Descurain
avait acquis la confiance de toute la ville par sa prudence, sa connaissance
de la nature, qu’il laissait agir quand il le fallait, et aussi sa « compassion,
car il s’affectionnait auprès des malades ».
Malgré ses nombreuses obligations, il trouvait le
temps de tenir les séances d’une petite Académie qu’il avait fondée avec quelques
Étampois amateurs de belles-lettres, de physique, d’astronomie, de botanique,
d’anatomie. « Leurs entretiens, nous dit Guettard, étaient dignes de la plus
célèbre Académie ».
C’est dans ce milieu que fut élevé Guettard et qu’il
prit la passion de la Science et des valeurs spirituelles, à l’exemple de son
grand-père, qui inspira visiblement toute sa destinée. C’est pourquoi nous
avons désiré faire revivre, avec Guettard, quelques traits de cette noble
figure de François Descurain, qui jette un éclat particulier sur la vie d’Étampes
au XVIIIe siècle. Il ne reste de lui que le reflet de ses pensées,
de ses actes et de ses « Observations sur les plantes », publiées grâce à
la piété de son petit-fils, en 1747, sept ans après sa mort. Ce joli geste
de gratitude n’a pas été vain. Il a sauvé de l’oubli celui dont il a créé une
si vivante image qu’elle est devenue familière à tous ceux qui se sont penchés
sur l’histoire d’Étampes.
Lorsque Descurain eut la joie de reconnaître chez
son petit-fils de remarquables dispositions pour les Sciences naturelles,
il entreprit son éducation dans ce sens. Mais, il l’envoie bientôt à Paris
compléter ses études, en le confiant aux Jussieu, les deux frères botanistes,
professeurs au Jardin du Roi (le Muséum actuel), dont il était l’ami depuis
de longues années. Réaumur, qui n’était pas seulement un physicien, se l’attache
également comme aide dans ses recherches en histoire naturelle. Ces travaux
de jeunesse, limités à la botanique, sont déjà d’une telle valeur qu’ils
enthousiasment le grand Linné et qu’ils le font entrer à l’Académie des sciences
dès l’âge de 28 ans. Mais, comme son grand-père, il n’est pas l’homme d’une
seule science. Il s’adonne avec la même ardeur à la minéralogie à laquelle
il ouvre des voies toutes nouvelles. À cet effet, il parcourt d’abord toute
la France, puis, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne. Il est le premier à comprendre
la nécessité d’établir des cartes minéralogiques et il en établit lui-même
un grand nombre concernant les pays qu’il a étudiés, fondement de notre institution
de la Carte géologique, qui fonctionne toujours.
Il s’occupe de bien d’autres sciences : l’Académie
possède de lui plus de 200 mémoires de botanique, minéralogie, géologie, paléontologie,
zoologie, météorologie, de médecine même. Ses découvertes offrent la même
diversité. C’est lui qui reconnut des volcans éteints dans les montagnes
d’ Auvergne et un peu plus tard, des gisements de kaolin près de Limoges
et près d’Alençon, ce qui marqua une date considérable (1765) dans l’histoire
de la céramique |12 et le développement de l’industrie et de l’art
de la porcelaine française. Il peut être considéré comme un des créateurs
de la manufacture de Sèvres.
Une de ses multiples activités doit retenir particulièrement
notre attention, c’est celle qu’il consacra à notre région. Même parvenu
au faîte des honneurs à Paris, il garde à sa ville natale un attachement
filial, qui se traduit, entre autres témoignages, par des études approfondies
de sa région, de ses plantes, de son sol, de ses fossiles. Il est encore
le premier à déceler parmi des ossements recueillis à la maladrerie de Saint-Lazare,
entre Étampes et Morigny, du mammouth et du renne, faune froide, qui est
l’objet, à cette époque, d’un grand étonnement. Il détermine la cause de
l’affaissement de la tour de l’église Saint-Martin : un sol très compressible,
formé de végétaux à tiges creuses, principalement des joncs, mal consolidés
par du tuf, sol appelé vulgairement cornet au XVIIIe
siècle, auquel Guettard donne le nom d’ostéocolle, parce
qu’il avait observé qu’il était propre à favoriser la soudure des os après
une fracture.
Une autre de ses recherches basée sur sa connaissance
de notre région a été récemment évoquée à Mayence, en Allemagne, dans deux
articles d’une revue qui est consacrée à l’histoire du papier, Papiergeschichte, ce qui s’explique, Mayence étant la patrie de Gutenberg.
Nous en avons eu connaissance par l’auteur des articles : un ingénieur parisien,
M. Henri Gachet22,
qui nous demandait s’il existait bien au Musée d’Étampes un portrait de Guettard.
Nous avons toujours, heureusement, ce charmant portrait de Guettard dans
sa jeunesse (fig.) M. Gachet le recherchait parce que, ayant choisi pour
sujet de son diplôme de l’École des Hautes-Études de la Sorbonne, Les Papeteries d’Annonay au XVIIIe
siècle, il avait été amené à consulter les travaux
de Réaumur d’abord, qui, le premier, en 1719 et en 1739, a suggéré l’idée,
par ses observations sur le comportement des guêpes cartonnières, que certains
végétaux pouvaient servir à fabriquer du papier. C’est son disciple Guettard
qui réalisa les expériences que Réaumur n’avait pu entreprendre, « grâce,
dit-il, à la facilité que les moulins à papier des environs d’Étampes, ma
patrie, semblaient me fournir23. Après avoir surmonté toutes les difficultés
que l’ on trouve toujours chez les ouvriers quand il s’agit de les engager
à faire quelque chose de nouveau dans leur métier, je suis enfin parvenu
à avoir quelques expériences et à me flatter de pouvoir continuer celles
que j ’ ai en vue ».
« Le dessein de Guettard », nous dit M. Gachet, «
fut de présenter ce qu’il appelle dans une formule heureuse, ‘la botanique
de la papeterie’. C’est un récit minutieux des expériences auxquelles il
s’est livré et qu’il a publiées, sous le titre Recherches sur les matières qui
peuvent servir à faire du papier, dans le Journal œconomique, édité à Paris, chez Antoine Boudet, rue Saint-Jacques, juillet
et août 1751 ».
Ces multiples recherches lui ont fait retenir comme
plantes utilisables les graminées, le lin, l’ortie, le mûrier, le tilleul,
les plantes à chatons et à duvet, les chénevottes de chanvre — qu’il fit
pourrir parce qu’il a observé « dans les étangs de la région de Dourdan que
la nature, plus tranquille en ses opérations que l’art, forme souvent un
papier très fin avec les plantes qui pourrissent dans ces endroits aquatiques
».
Qu’est-il advenu de cette longue étude ? Nous tenons
à reproduire ici la conclusion que M. Gachet en a si justement tirée, avec
sa compétence. « Si les études scientifiques se multiplient [à cette |13
époque], par contre, la technique ne fait que de lents progrès. Les mémoires
sont rarement lus par ceux auxquels ils devraient être destinés. À côté d’un
Montgolfier... il y a la masse des artisans éminemment routiniers. Ainsi
les suggestions de Réaumur, reprises et approfondies trente ans plus tard
par les travaux de Guettard, puis, les expériences de Schaeffer, n’eurent guère,
en définitive, leur conclusion sur le plan industriel que vers le milieu
du XIXe siècle !
Le palmarès scientifique de Guettard est riche et
varié. Ses recherches et ses expérimentations en vue de l’emploi des végétaux
en papeterie comptent, en raison des voies nouvelles qu’elles ouvraient,
parmi les titres les plus dignes de sauver son nom d’un injuste oubli »24.
Si le savant mérite ce bel éloge, l’homme n’est pas
moins intéressant. Robuste, travailleur infatigable, resté célibataire, il n’a
cessé de mener une vie quasi monastique, comme d’autres savants de ce siècle,
qui fut en même temps celui des mœurs légères et de la passion des sciences
de la nature. Le duc d’Orléans, fils du Régent, animé lui-même de cette passion
et aussi austère que son père l’ était peu, retiré jeune encore à l’abbaye
de Ste-Geneviève, avait constitué une importante collection d’histoire naturelle
: il choisit Guettard pour en être le conservateur et la lui légua à son
décès, en 1752. Guettard crut de son devoir de la restituer au fils de son
donateur, qui lui en confia de nouveau la garde, avec un logement au Palais-Royal, où
il demeura jusqu’à sa mort en 1786.
Cet homme, sensible et charitable comme l’était son
grand-père Descurain, passait pour avoir un caractère difficile. On sait cependant
qu’il eut la générosité d’adopter et d’élever à ses frais les enfants de
sa servante.
Cette réputation, due peut-être à son austérité,
à sa franchise, ou à sa rigueur d’esprit et à son incessant labeur, n’est-elle
pas démentie d’ailleurs par la douceur d’expression que nous montre, au moins
dans sa jeunesse, ce séduisant visage ? On est tenté de le croire ou alors
de l’excuser. Et l’on peut, certes, accorder à notre Guettard, l’hommage
d’une admiration sans réserve.

10. Malesherbes botaniste
*
On sait combien l’étude de l’histoire naturelle fut
à la mode au XVIIIe siècle et quelle part cette branche des connaissances humaines
tint dans la culture des personnes de qualité, alors même que leur profession
les engageait dans une voie toute différente. C’est ainsi que Lamarck, jeune
officier, herborisait entre deux campagnes et qu’il publia un manuel de botanique pour
les gens du monde, premier modèle de ces flores régionales si nombreuses
aujourd’hui, qui eut tant de succès que ce petit ouvrage contribua plus que
ses travaux spéciaux à le faire entrer à l’Académie des Sciences, à 51 ans.
Ainsi, comme, la plupart des esprits distingués de
son temps, Malesherbes joignait à sa compétence juridique des connaissances
étendues en histoire naturelle. Il avait même écrit en 1749, à vingt-huit
ans, des « Observations sur l’histoire naturelle générale et particulière
de Buffon et Daubenton ». Il ne publia pas ce travail, où il critique Buffon,
parce que, dès l’ année suivante, en 1750, élu à l’Académie des Sciences
en remplacement du duc d’ Aiguillon, il était devenu le collègue de Buffon,
scrupule qui n’arrête guère d’ordinaire la plupart des auteurs. L’ouvrage
parut après la mort de Malesherbes en l’an VI, chez Charles Pougens, en deux
volumes. Malesherbes y 25 faisait preuve de beaucoup de lectures,
embrassant toute la cosmogonie; il défendait Linné contre Buffon et soutenait l’
immutabilité des espèces, en quoi il avait tort, mais cette erreur était
de son âge et de son temps.
Au cours de sa carrière administrative et politique,
jamais sa curiosité de la nature ne l’abandonna et, dans son beau domaine du
Gâtinais, il multiplia les essais d’acclimatation végétale et les expériences
d’agronomie. Nous en trouvons la |2 preuve dans un de ses ouvrages,
dont le titre seul reflète ses préoccupations et celles de son époque : «
Idées d’un Agriculteur patriote sur le défrichement des terres incultes »,
paru seulement en 1794. Il y révèle une compétence agronomique certaine.
Mais sa correspondance nous montre mieux encore combien il s’intéressait
à la botanique appliquée et à l’étude des formes végétales récemment introduites
en Europe. Nous possédons une lettre de lui sur ce sujet, datée de Paris,
le 11 septembre 1782. Nous l’avons acquise d’un bouquiniste, qui n’a pu malheureusement
nous indiquer sa provenance parce qu’elle faisait partie de tout un lot de
vieux papiers d’origines différentes. Cette lettre ne portait pas le nom
du destinataire, mais une phrase, relative « au terrain de la Rochette »,
nous fit penser qu’elle avait dû être adressée à Moreau de la Rochette (17201791),
inspecteur des Pépinières de France, qui demeurait au château de la Rochette,
près de Melun. C’est ce qui nous fut confirmé par Mademoiselle Constance
de la Rochette, qui voulut bien, avec une bonne grâce dont nous sommes heureux
de lui témoigner ici notre reconnaissance, nous donner communication de la
correspondance de Malesherbes avec son arrière-grand-père, qu’elle se réserve
de publier, mais dont elle nous a autorisé à donner quelques extraits. Nous
avons retrouvé dans ces lettres conservées à la Rochette un second exemplaire
de la nôtre, celui-là certainement de la main de Malesherbes, tandis que
le nôtre est une copie de l’époque, comme le prouvent d’abord la différence
d’écriture, puis, l’omission d’un membre de phrase à la suite d’un mot répété
plus loin, fameuse faute des copistes que l’on rencontre si souvent dans-les
manuscrits. Notre copie dut être faite sur la lettre reçue par M. de la Rochette
et non avant son expédition par Malesherbes. En effet, les deux exemplaires portent
dans la marge gauche, en haut de la première page, la mention : r. le 18, ce qui signifie évidemment : reçu ou répondu le 18, sept
jours après la date du départ de la missive. Cette mention n’a pu être portée
que par Moreau de la Rochette, qui a dû délivrer une copie à quelque amateur
de jardins que les détails horticoles donnés par Malesherbes intéressaient.
Mais, petit fait singulier, les deux lettres portent |3 la signature
de Malesherbes, comme si le possesseur de la copie avait voulu la faire authentifier
par l’auteur. Quoiqu’il en soit de ces points de détail, nous sommes en mesure,
avec notre lettre et celles qui demeurent à la Rochette, de connaître la
nature des cultures expérimentées à Malesherbes par l’ancien ministre de
la Maison du Roi, retiré en son domaine.
C’est surtout de dendrologie, comme il convient pour
un inspecteur des Pépinières de France, que Malesherbes entretient son correspondant.
Il lui propose de nombreux plants et des échanges : « Le meilleur moyen de
nous faire ces envois est qu’à la fin de février j’envoie d’ici un homme
à la Rochette qui vous portera ce que j’ ai à vous envoyer et me rapportera
ce que vous voulez bien me donner. Comme vous me mandez que vos hêtres sont
très petits, je pense qu’un paysan avec un âne suffira pour cela et c’est
la voiture la plus aisée qu’on ait dans ce pays-ci ». La distance entre Malesherbes
et la Rochette étant d’environ 45 kilomètres, le trajet à l’allure d’un âne
devait demander au moins deux jours.
Les échanges entre les deux amateurs portaient sur
des essences variées : arbres de boisement ou d’ornement, arbres fruitiers, «
Pruniers de Sicile nommés Mirobolan, Pruniers de Canada », etc. Malesherbes
aimait fort le raisin : « Vous me demandez, Monsieur, ce que j’aurai moi-même
à vous demander. Mes demandes se termineront à des crossettes de votre Chasselas musqué
dont j’ai déjà quelques-unes et que je désirerais de multiplier plus en grand.
C’est pourquoi je vous en demanderai le plus que vous pourrez ».
Il serait fastidieux de donner la liste complète
des arbres et des arbustes dont Malesherbes essayait la culture. Beaucoup
sont indigènes et récoltés dans la région même, dont il connaissait fort bien
la flore. Il dit notamment de l’Amélanchier (Amelanchier vulgaris Moench) : « L’Amélanchier de France est beaucoup plus rare
que celui d’Amérique, parce qu’il n’est pas si aisé de le multiplier. Vous
êtes plus à portée que personne d’en avoir, car il se trouve entre les rochers
de Fontainebleau. J’ai vu cet arbuste faire un effet très agréable dans les
Alpes et dans le Mont-Jura. Chez moi, le seul terrain |4 où il
se plaise est celui des sables humides. Vous me direz que le sable des rochers
de Fontainebleau est très sec, aussi il y vient moins beau qu’au pied des
grandes montagnes où il est arrosé toute l’ année par la fonte des neiges.
Cependant, il est bon d’observer que dans les rochers mêmes de Fontainebleau
il se trouve des mottes de sable très humides, dans ces cavités où les eaux
pluviales n’ont point d’ écoulement.
« J’ y ai trouvé la Rosée du Soleil et plusieurs
plantes des marais. Je n’y ai pas vu les Amélanchiers de Fontainebleau, mais je
soupçonne que c’est dans de pareilles cavités qu’on les trouve ».
La présence de plantes des marais dans les sables
de Fontainebleau a pu être observée par notre auteur à Malesherbes même,
au lieu-dit le « Chemin-aux-Vaches », qui s’amorce sur la route de Malesherbes
à Buthiers, à 1 kilomètre à peine du village de Malesherbes. Là, en effet,
un niveau imperméable sous-jacent aux sables dont est formé le coteau a pour conséquence
la résurgence d’ une petite source qui sort au milieu d’un terrain essentiellement
sec et perméable. Auprès d’elle, nous avons recueilli nous-mêmes Pinguicula vulgaris L., plante essentiellement de marais, et Osmunda regalis L., qui croît d’ordinaire en des milieux humides.
Plus heureux que nous, Malesherbes avait observé,
en outre, la « Rosée du Soleil » ou Rossolis, plante
rare vivant dans le même milieu.
Ce petit groupe de plantes marécageuses dans une
flore essentiellement xérophile est une curiosité naturelle, connue de tous
les amateurs d’herborisation de la région parisienne et que Malesherbes n’ignorait
pas.
À côté de notre flore indigène, Malesherbes acclimatait
beaucoup d’espèces étrangères, surtout de l’Amérique du Nord, où, dit-il,
des correspondants lui expédiaient des graines. Il donne sur ces végétaux,
encore rares en France, des détails fort intéressants. Nous apprenons ainsi
que le Bonduc du Canada (Gymnocladus canadensis Lk.), introduit en France en 1748, a fructifié pour la première
fois dans notre pays en 1781 au Jardin du Roi.
C’est également en 1781 que le Sophora sinica ? (sans doute |5 Sophora japonica
L.) introduit en 1761, a fructifié à Saint-Germain dans le jardin du maréchal
de Noailles.
Enfin, un très beau Liquidambar styraciflua L., espèce apportée en Europe en 1681, existait, nous dit
Malesherbes, chez Duhamel du Monceau à Bondaroy.
Il cultive encore le Cassia Marylandica L., connu chez nous depuis 1723.
« C’est une grande plante, mais non un arbuste, ainsi
je vous préviens que vous verrez les tiges disparaître à l’entrée de l’hiver. Quant
au terrain qui lui est propre, c’est toujours dans le terrain humide que
je les plante par préférence, puisque, dans les pépinières d’Angleterre et
de Hollande, on la nomme Water acacia ou
acacia d’eau. Il y a dix ou douze ans que ce Water acacia me fut envoyé d’Angleterre.
Comme je croyais que c’était un arbre, je le crus mort quand je vis les tiges
mortes et on retourna la terre sans prendre garde aux racines. Je l’ai vu
depuis dans les pépinières de Hollande où on le nommait également Water acacia.
J’en rapportai deux plants. Je mis l’un des deux tout à fait dans la fange
tourbeuse et presque le pied dans l’eau, l’ autre dans le sable humide de
mon jardin, mais plus haut que le précédent. Celui qui était le pied dans
l’ eau a poussé sa tige la première année et n’ a pas paru depuis, soit que
le terrain tout à fait aquatique ne lui convienne pas, soit que les roseaux,
joncs et autres plantes de marécage du voisinage aient étendu jusqu’à lui leurs
fortes racines qui l’ auront fait périr; mais celui qui était planté plus
haut a repoussé la seconde année et même, dès cette année, a donné de la
racine quelques rejetons, que j’ai replantés ailleurs en terrain semblable
et qui ont bien réussi. Au bout de trois ou quatre ans, le pied principal
a fleuri et on a reconnu que ce n’ était pas un acacia, mais un cassia.
« Ce sont de superbes bouquets de fleurs jaunes très
propres pour l’ornement des jardins. La plante s’élève à peu près à la hauteur
de la Réglisse et, comme la Réglisse, paraît un assez grand arbuste.
« Les fleurs de la première année n’ ont point donné
de fruits mûrs, mais, l’année suivante, j’ai eu beaucoup de siliques remplies
de graines qui lèvent très bien ». |6

Fig. 1. — Deux aspects actuels d’un cyprès
chauve planté par Malesherbes dans une île de son parc.

|7 Malesherbes distingue avec soin les
diverses espèces de Cornus américains,
notament le Cornus
canadensis L., de la forme qui porte le même
nom dans les cultures et qui, en fait, en est fort différente. La même compétence
botanique lui permet de distinguer les espèces diverses du genre Viburnum, qui sont nombreuses et fort voisines les unes des autres.
Mais c’est surtout le Cyprès chauve (Taxodium distichum Richard) qui suscite son enthousiasme. Ses exemplaires n’avaient
pas fructifié encore ; en 1780, un pied eut deux pommes qui avortèrent, mais
en 1781 et 1782, il n’en avait point montré. Aussi, Malesherbes en demandait
avec instance des graines à ses correspondants américains, qui ne lui en
avaient pas encore adressé, « bien qu’ils en aient envoyé à plusieurs curieux
». « Si j’en avais cent mille pieds, ajoute-t-il, j’aurais du terrain pour
les planter ». S’il ne put en planter cent mille, il orna cependant son domaine
d’un grand nombre de ces beaux arbres, qui traversèrent tout le XIXe
siècle. Beaucoup d’entre eux, atteints par l’ âge, durent être abattus il
y a une vingtaine d’années, mais il demeure encore à Malesherbes, dans une
île de l’Essonne, appelée l’île de Rosambo en l’honneur de la Mise
de Rosambo, l’une des filles du défenseur de Louis XVI, un témoin vénérable
de ces plantations faites avec autant d’ardeur que de discernement. Nous
devons à notre cousin, le prince de Robecq, arrière-petit-fils de Malesherbes
et, de ce fait, propriétaire actuel du domaine, deux photographies de ce
Taxodium (fig. 1). Si les arbres environnants masquent ses racines saillantes,
qui donnent un si singulier aspect à cet arbre magnifique, sa cime majestueuse les
domine tous et se reflète dans le calme miroir de la petite rivière. Ainsi
se dressaient leurs fûts élevés dans les cyprières d’Amérique, où ils croissent
innombrables, le pied dans l’eau, et dont Chateaubriand nous a laissé une
si évocatrice description. Il les parcourut peu d’années après cette époque,
ayant été encouragé à son voyage d’Amérique par M. de Malesherbes lui-même,
dont la petite-fille, Mademoiselle de Rosambo, avait épousé le frère aîné
de Chateaubriand. Malgré la différence d’âge et parfois d’opinions, les deux
hommes s’étaient liés d’amitié. Malesherbes avait préparé |8 avec
Chateaubriand cette grande exploration du N. O. de l’Amérique et regrettait
de n’être plus assez jeune pour s’embarquer avec lui.

Fig. 2. — Cèdre du Liban, planté par Malesherbes,
qui domine aujourd’hui la route de Puiseaux.

Fig. 3. — Entrée du jardin d’essais de
Malesherbes, dit Jardin des Plantes. ^
« Quel dommage, ajoutait-il, que vous ne sachiez
pas la botanique ! » « Au sortir de ces conversations, dit
Chateaubriand, je feuilletais Tournefort, Duhamel,
Bernard de Jussieu, Grew, Jacquin, le Dictionnaire de Rousseau, les Flores élémentaires
; je courais au Jardin du Roi et déjà je me croyais un Linné ! »26
Malesherbes faisait ces nombreux essais d’acclimatation
non seulement dans son parc, mais encore dans un jardin, dit Jardin des Plantes,
qui leur était spécialement affecté et dont la porte subsiste encore (fig.
3). Et pour constituer une perspective à sa demeure, il planta au lieu-dit
La Combe, exactement en face du château, sur la commune de Buthiers, cinq
cèdres du Liban, arbres dont la vogue était si grande depuis leur introduction
par Jussieu. L’un d’eux vit encore (fig. 2) ; il domine de sa puissante silhouette
la route de Puiseaux.

Fig. 4. — Malesherbes s ’entretenant avec
ses jardiniers dans son parc (d’après une estampe).
Ainsi tout le domaine de Malesherbes devait être,
à la fin du XVIIIe siècle, un lieu plein d’attraits et d’enseignements
pour les botanistes et les arboriculteurs. Malesherbes pouvait leur faire admirer
ses sujets et leur apprendre également à les cultiver, car sa compétence
en cette matière n’était pas moindre que dans la connaissance du végétal
lui-même. Il donne à M. de la Rochette des conseils avertis et très précis
sur la multiplication, lui indiquant les végétaux qui se reproduisent par
graines, par boutures ou par marcottes. Une vieille estampe (fig. 4) dont
nous devons la reproduction, comme les figures précédentes, à l’amabilité
du prince de Robecq, nous le montre donnant des indications à l’un de ses
jardiniers. Mais il avait dû lui-même également faire des essais et travailler
de ses propres mains pour acquérir cette pratique horticole qui ne s’apprend
qu’à la suite de tentatives répétées et souvent de nombreux déboires.
Lorsqu’on vint arrêter à la fin de l’année 1793,
à Malesherbes, |10 dans une allée de son parc que l’on ne peut
revoir aujourd’hui encore sans émotion, celui que ses contemporains mêmes nommaient
le plus vertueux des hommes, on le trouva, dit un récit, au milieu de sa
famille et, malgré son grand âge, une bêche à la main. Cette bêche était
bien pour lui un symbole : il avait su la manier et retourner le sol pour
y faire croître des plantes que, dans son inlassable curiosité, il voulait
connaître. Il avait passionnément aimé et interrogé la nature, trouvant sans
doute dans sa majesté sereine et paisible l’oubli des maux que lui avait fait
souffrir la méchanceté des hommes.
R. de Saint-Périer.
Environs d'Étampes.
104. JEU R RE, par Étrèchy. — Le Grand Temple
11. Le Temple de Jeurres
-
Le temple du XVIIIe siècle, actuellement
dans le parc du château de Jeurres, près d’Étampes, classé comme monument historique,
en 1926, à la suite du vœu émis par notre Commission27 28, a été construit primitivement à Méréville
par la Marquise de Laborde entre 1785 et 1788, sur le modèle du temple de
Tivoli. M. de Laborde avait acheté le domaine de Méréville au Mis
de La Tour du Pin, à la fin de 1784, sans doute pour remplacer son château
de La Ferté-Vidame, qu’il avait dû céder au duc de Penthièvre sur la prière
expresse du roi et de la reine, acquéreurs eux-mêmes du château de Rambouillet,
dont le duc de Penthièvre s’était ainsi trouvé dépossédé. M. de Laborde reçut
en compensation la somme considérable de 5.500.000 livres et le titre de
marquis. Il possédait déjà des terres dans la région d’Étampes, à Saint-Escobille,
où il avait un petit château et une faisanderie, à Garancières-en-Beauce,
où il entretenait une chasse, dont le gibier endommageait les cultures des
paysans, qui s’en plaignaient amèrement. Il se trouvait ainsi le voisin de
la Marquise d’Oysonville, née Briçonnet, dont nous avons une correspondance
précieuse, inédite29
qui nous apporte des précisions sur les travaux entrepris par M. de Laborde.
À
Méréville, il voulut rétablir un luxe comparable
à celui de La Ferté-Vidame : en neuf ans, il y dépensa seize millions, ce
qui fit dire un jour à Madame de Laborde : « C’est trop beau pour des particuliers,
à la bonne heure pour des grands seigneurs ou des princes ! » « Qu’importe,
Madame, lui répondit son mari, quand on paie ! » Les travaux d’aménagement
du parc, |114 dit « jardin à l’anglaise », où il fit détourner
le cours de la Juine, établir des cascades, édifier des rocailles, nécessitèrent
le concours de 500 ouvriers nous dit la Marquise d’Oysonville, que l’on faisait
venir de tous les pays et d’une honorabilité souvent suspecte. On leur attribuait
tous les vols de la région, qui se multipliaient alors.
La construction du temple ne se fit pas sans difficulté
; elle allait s’achever quand, au mois de mars 1788, le monument s’écroula.
Madame d’Oysonville, se montrant peu amateur d’archéologie, écrit à ce sujet
: « J’ai mandé à votre frère le désastre affreux de M. de Laborde. C’est,
dit-on, une perte de 100.000 écus ; son temple édifié sur un terrain montant,
près d’être achevé, a écroulé, mais je ne prise pas cette perte, ayant cette
somme à perdre pour un édifice aussi inutile ! Mais c’est les pauvres victimes
d’ouvriers, dix de morts, plusieurs blessés encore en danger : un quart d’
heure plus tard leur journée était finie. C’est un malheur bien marqué ».
Mais le Marquis de Laborde ne se découragea point et le temple fut réédifié.
Une aquarelle d’Hubert Robert, que nous avons vue chez le Cte Alexandre
de Laborde descendant du financier, représentait le temple avec ses échafaudages,
tout près de son achèvement. La Révolution le laissa intact et il demeura
dans le parc de Méréville jusqu’à la fin du XIXe siècle. Mais
vers 1895 tous les monuments du parc furent mis en vente et acquis par le
Cte Dufresne de St Léon, qui les fit réédifier dans
le parc du château de Jeurres, à 25 km de Méréville. Le transport des pierres,
par route, sur des chariots plats, fut si heureusement exécuté qu’il n’y
eut qu’une bucrâne du temple légèrement endommagé. La réédification, près
du canal de Jeures, se fit sans accident.
La dédicace du temple a été l’ objet d’une erreur
constamment répétée : M. de Laborde l’avait consacré à la Piété filiale et non à l’Amour, comme on le dit communément, par exemple Maxime
Legrand30 et
c’est ainsi que le Bulletin de la |115 Commission a enregistré
la même erreur, au moment du classement. Avant la révolution, le temple renfermait
une statue représentant une des filles de M. de Laborde, Nathalie, qui avait épousé
le Cte Charles de Noailles, depuis duc de Mouchy. Costumée en
Minerve, elle s’ appuyait sur un bouclier où étaient figurés les traits de
son père, ce qui confirme bien la dédicace. Cette statue fut transportée
à une époque que nous ignorons, au château de Mouchy, dans l’Oise, où elle
est encore actuellement. Nous espérons nous en procurer une photographie
que nous communiquerons à la Commission, ce que nous n’avons pu faire pour
aujourd’hui.
Comte de Saint-Périer.
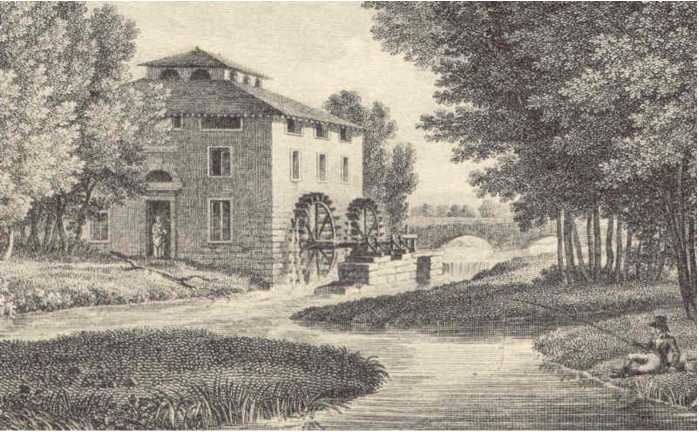
Détail d’une vue du parc
de Brunehaut en 1808 (gravure de Constant Bourgeois)
12. Le Gué des Sarrasins
4
Avant que des ponts modernes eussent réuni les deux
rives de la Juine, de nombreux gués permettaient le passage de notre petite
rivière en différents points de son parcours. Le gué des Sarrazins, dont
nous ignorons l’emplacement exact, est cité dans un texte de 1560 relatif
à l’état de la Juine à cette époque. Nous savons au moins que les voitures
l’empruntaient pour passer de la rive gauche de la Juine au village de Morigny,
en amont du confluent des deux rivières, la Juine et le Juineteau, dit la «
jonction », situé dans le parc actuel de Brunenaut. Cet ancien gué ne nous
intéresserait pas autrement si son nom étrange ne posait un petit problème
d’ histoire locale.
Pourquoi a-t-on donné à ce passage le nom des Musulmans,
qui, bien évidemment, ne sont jamais venus dans notre région ?
On sait que les Arabes, partis vers le milieu du
VIIe siècle des rives de la Mer Rouge, après la prédication de
la guerre sainte par Mahomet, firent la conquête de l’ Afrique du Nord. Une
de 31 leurs
armées, commandée par Tarik, parvenue à l’extrémité occidentale du Maroc,
traversa le détroit qui sépare l’Afrique de l’Europe et qui prit le nom de
Djebel Tarik, dont on a fait ensuite Gibraltar. Les Arabes ou Sarrazins,
comme on les appelait alors, envahirent l’Espagne, franchirent les Pyrénées,
et s’avancèrent à travers la Gaule, en incendiant et ravageant notre malheureux pays.
Mais, en 732, Charles Martel leur infligea près de Poitiers une défaite si
cruelle que l’invasion fut arrêtée et toute la Gaule rapidement délivrée.
On dit bien qu’une petite colonie de Sarrazins s’installa dans le Chinonais,
où certains types de la population actuelle révéleraient encore une origine
orientale. Si le fait est exact, il demeure isolé et nous n’avons aucune
raison de penser que les Sarrazins se soient avancés, même pacifiquement,
jusqu’à Étampes.
Mais l’invasion sarrazine avait laissé un souvenir
de terreur profonde qui, bien des siècles après, subsistait encore dans les esprits,
entretenu par la présence en Espagne de puissants royaumes arabes contre
lesquels guerroyaient en vain les rois chrétiens espagnols, réfugiés dans
le Nord et l’Ouest de la péninsule. Ce voisinage redoutable pouvait toujours
faire craindre le retour de l’invasion triomphale qui avait précédé Poitiers.
Ainsi, lorsqu’à la fin du XIe siècle,
commença la prédication des Croisades, ce fut, outre le désir de reconquérir
le tombeau du Christ sur les Infidèles, une manière de revanche de l’Occident sur
l’Orient qui entraîna la foule des soldats et des pèlerins. La dénomination
de Sarrazins devint commune à cette époque pour désigner, d’une part, des
peuples ennemis ou étrangers qui n’avaient rien de commun avec les Arabes,
d’autre part, des objets de provenance orientale ou des monuments anciens
dont on ignorait l’origine.
C’est ainsi que la chanson de Roland, écrite au XIe
siècle, attribue aux Sarrazins la défaite de l’armée de Charlemagne, alors
que l’arrière-garde de cette armée commandée par Roland fut taillée en pièces
par les Basques, petit peuple farouche et belliqueux des Pyrénées, qui n’avait
aucun lien ethnique avec les Arabes, mais qui attaquaient indistinctement
tous ceux qui pénétraient sur son territoire. Or la France médiévale était
encore couverte de ruines romaines. Les Barbares du Nord et de l’Est, qui
avaient envahi la Gaule du IVe au VIe siècle, avaient
incendié et détruit les villas, les thermes, les aqueducs qui attestaient
la prospérité du pays et la grandeur de Rome. Ces ruines frappaient l’ imagination
des populations ignorantes du moyen âge qui, par suite de la même erreur,
attribuaient les monuments qu’elles représentaient aux Sarrazins. Le terme
de caves sarrazines, murs sarrazins, désigne presque toujours des ruines
romaines. On y adjoignit dans la tradition populaire, au moins dans le Nord
de la France, le souvenir de la reine Brunehaut, qui avait fait restaurer, au
VIe siècle, beaucoup de voies romaines endommagées et rétabli
des fortifications. Les noms de chaussée Brunehaut, tour de Brunehaut désignent
des restes de l’époque gallo-romaine aussi souvent que le terme de Sarrasin.
Nous citerons comme exemple de ces dénominations
erronées le cahier de l’architecte Villard de Honnecourt qui, dessinant des monuments
anciens au cours d’un voyage en France, écrit au-dessous du dessin d’un monument
gallo-romain de bonne époque : « De telle manière fut la sépulture d’un Sarrazin
que je vis une fois. »
Près d’Étampes même, à Souzy-la-Briche, on a découvert,
au lieu-dit la Cave Sarrazine, les restes d’un important édifice romain,
thermes ou villa, où plusieurs salles étaient pavées de belles mosaïques,
dont l’une, mise à jour par nous en 1913, est conservée au Musée d’Étampes.
Entre Auvers et Villeneuve-sur-Auvers, un monument
ancien, représenté par une couche de grès dont une cavité profonde et naturelle
est couverte de signes gravés très probablement de l’époque préhistorique,
porte le nom de Trou du Sarazin.
Enfin, dans le parc actuel de Brunehaut, on a découvert
des substructions gallo-romaines et de nombreux objets mobiliers, notamment
une statuette en bronze et des pièces de monnaie. Pendant l’occupation allemande,
on y a recueilli de nouvelles monnaies romaines : celles que nous avons pu
examiner dataient de l’époque des Antoniens. D’après le docteur Bourgeois, historien
de notre ville, qui vécut toute sa vie à Étampes, une partie d’une vieille
tour dite de Brunehaut, mais d’origine gallo-romaine, avait été enclavée
dans la construction de l’ancien château de Brunehaut, édifié au début du
XIXe siècle et qui fut remplacé par le château actuel vers 1875.
Nous pensons donc que le nom de gué des Sarrazins
fut donné au passage sur la rivière en raison des nombreuses ruines gallo-romaines
qui l’avoisinaient et que le nom même de Brunehaut, qui ne remonte qu’à la
fin du XVIIIe siècle, fut attribué au parc et au château à cause
de la vieille tour romaine connue depuis des siècles sous le nom de tour
de Brunehaut. La légende qui veut que la reine Brunehaut ait subi son affreux
supplice dans la vallée de Brières ne repose sur aucun fondement historique
et il est même probable qu’elle doive son origine à l’existence de la tour romaine
qui portait le nom de l’infortunée reine d’Austrasie.
Nous ne connaissons pas de texte postérieur à 1560
qui fasse état du gué des Sarrazins, mais ce vieux nom ne s’est pas perdu. En
effet, lorsque le vicomte de Viart constitua, à la fin du XVIIIe siècle,
son domaine de Brunehaut, il fit construire, sur une dérivation empruntée
à la Juine, un pont auquel il donna le nom de Pont des Sarrazins pour rappeler
le nom du gué, sans chercher la véritable origine de cette dénomination.
Et il eut l’idée originale de donner à cette construction un caractère de
style arabe.
C’est ainsi que s’est perpétué jusqu’à nous le nom
pittoresque d’un passage sur notre rivière qu’on n’utilise plus depuis des siècles.
R. de Saint-Périer.

a »u*s * a***ur tn*j
III- ÉTAMPES (S.-et-O.) — Vue d’un Moulin aur la
rivière d'Étampes
S«rr«»n <J*lin. - la Venu «culp. — Cr. XVIII*
iiécl«
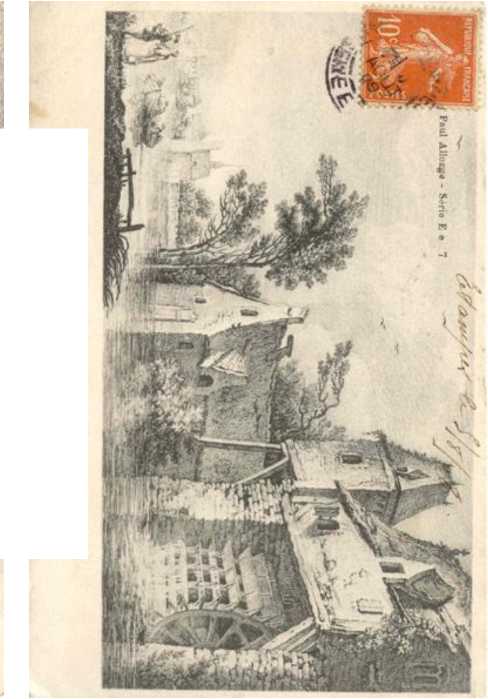
13. La Juine navigable
35
On sait que notre paisible rivière de Juine fut utilisée
du XVe au XVIIe siècle comme moyen de transport pour
les grains de Beauce et les vins que produisait alors notre région. Ces marchandises
étaient embarquées au pied des remparts, dans un port dont l’emplacement
porte encore ce nom à Étampes et elles arrivaient à Paris par l’Essonne et
la Seine depuis Corbeil. Jusqu’en 1676, le trafic fut important et des voyageurs
même empruntaient ce mode de transport sûr, mais peu rapide. Puis il fut
abandonné et des tentatives de reprise au XVIIIe siècle n’aboutirent
pas.
Mais, en 1790, un projet beaucoup plus vaste fut
envisagé par « les sieurs Gerdret, Grignet et Cie », propriétaires
de martinets à taillanderie, c’est-à-dire de forges mues par une roue hydraulique sur
la Juine, qui reprirent en l’amplifiant un programme rejeté en 1767. Ce projet,
exposé dans un long mémoire, était plus ambitieux que celui de leurs prédécesseurs.
On devait canaliser la Juine depuis Étampes jusqu’au confluent avec l’Essonne
en créant un nouveau port, l’ancien ne devant servir qu’à garer des allèges
utilisables seulement lors d’un trafic imprévu. Un contre-fossé devait suivre
le canal et drainer tous les prés voisins, un chemin « de tirage », de douze
pieds de large, devait suivre le canal et on planterait une rangée d’arbres,
saules, peupliers ou platanes sur tout son parcours. À l’époque, dix usines
ou 32 « retenues
» barraient la Juine, d’Étampes à Essonnes et quarante-six barraient l’Essonne
de Pithiviers jusqu’à son confluent avec la Seine. On créerait des écluses
pour passer ces barrages, onze ponts étaient prévus, dont trois en pierre
et à plein cintre, au Bouchet, à Lardy et à Morigny. Ainsi pourrait s’établir une
navigation active, qui transporterait à Paris les grains, paille, foin, eaux-de-vie,
vins, bois, charbon, tourbes, pierres, pavés, de la Beauce, du Gâtinais,
de l’Orléanais et du pays chartrain. Enfin, par le ruisseau du Remard, qui
prend sa source dans la forêt d’Orléans et se jette dans l’Essonne, les bois
de la forêt pourraient être acheminés par flottage vers la capitale et contribuer
ainsi puissamment à son alimentation en bois de chauffage. Notons en passant
que nos auteurs ne sont pas encore très familiarisés avec la division de
la France en départements, qui date seulement du mois de décembre 1789, puisqu’ils
placent les eaux de cette petite rivière dans le département de l’Oise, alors
qu’il s’agit du Loiret.
Un tarif des futurs frais de transport est annexé
au mémoire : un sac de grains de farine, des haricots coûteraient un sou
par lieue, un veau, deux sous, un poinçon de vin, quatre sous, mille pavés,
dix sous, le cent de fagots, six sous, etc. Les personnes pouvaient également
être transportées moyennant quatre sous par lieue.
En dehors de ces avantages commerciaux, la région
traversée par la Juine et l’Essonne connaîtrait une prospérité qui lui manquait
alors. En effet, les prés envahis par des eaux stagnantes ne donnaient qu’une
herbe rare et acide, que les vaches mangent avec répugnance ; drainés par
le contre-fossé, ils donneraient une nourriture saine et nutritive. La santé
publique est gravement compromise par l’air malsain et fiévreux qui émane
de ces eaux stagnantes : elle redeviendrait bonne si celles-ci étaient évacuées.
Enfin, quelques tourbières constituent « des précipices dangereux et effrayant
» qui disparaîtraient si le projet était exécuté.
À ces considérations, les auteurs du mémoire joignent
les espérances et les illusions chères à leur époque. Il y a longtemps, disent-ils,
qu’ils mûrissent leur projet. La Révolution les a encouragés. Ils pensent
que les travaux ne seront plus entravés par les péages que les seigneurs
imposaient dans l’étendue de leur seigneurie, car « un nouveau jour luit
sur le plus beau royaume du monde » et « la liberté, principe de tous les
biens, est le phare qui dirige les sieurs Gerdret, Grignet et Cie
».
Leur requête ayant été présentée au Conseil du Roi,
le grand maître des Eaux et Forêts, M. de Cheyssac, fut chargé de commettre
un ingénieur, afin de juger de l’intérêt du projet. C’est ainsi que l’ingénieur
Dransy établit à son tour des mémoires, approuvés par les députés des bailliages
d’Étampes et d’Orléans, qui invitèrent ensuite les municipalités et propriétaires
riverains à donner à Dransy « toutes les facilités dont il aura besoin pour la
levée de ses plans dans une entreprise qui leur a paru aussi importante et
avantageuse au bien public ». Enfin, le 18 août 1791, un décret de l’Assemblée
nationale autorise les sieurs Gerdret, Grignet, Jars et Cie à
rétablir à leurs frais la navigation sur la rivière de Juine. C’est seulement
en 1794 que les travaux purent commencer en raison des sommes considérables
qu’il fallait réunir. Mais hélas ! il en fut de ce grand projet comme de tant
d’autres entreprises humaines : l’enthousiasme faiblit et avec lui, les capitaux
qui étaient épuisés après un percement de quatre kilomètres. En 1803, Grignet,
Gerdret et Cie étaient déchus du bénéfice de la concession, qui
était transférée à un ancien avocat de Paris, Guyénot de Chateaubourg. Il
ne réussit pas mieux et le projet fut complètement abandonné vers 1828.
Il ne fut plus question dès lors de créer un moyen
de transport par les rivières de Juine et d’ Essonne, les routes suffirent
à tous les besoins, bien qu’elles fussent, aux dires de Grignet, dans un tel
état que l’allègement de leur trafic par la voie fluviale fût indispensable.
Quelques années plus tard, le chemin de fer devait bouleverser tout le système
économique antérieur.
Ainsi la Juine a cessé, sans doute pour jamais, de
servir à des transports utilitaires. Elle est redevenue une petite rivière modeste
et paisible coulant entre des prés évidemment mal entretenus, mais dont s’accommodent
à la fois les vaches et la santé publique. Félicitons-nous qu’elle ait conservé
le charme de ses rives sinueuses, la variété de ses ombrages et leur calme solitude.
R. de Saint-Périer.
115

Vestiges détruits de
l’église Sainte-Croix
14. La Révolution et le
XIXe siècle «
La grande espérance. — L ’assemblée des trois ordres et la rédaction
des cahiers. — La première rosière.— La fête de la Fédération. — Le District d’Étampes et l’activité révolutionnaire. — Le Journal d’Étampes. — L ’assassinat de Simonneau et son retentissement. — La Terreur à Étampes. — Le 9 thermidor.—
L ’Empire. — Les Cosaques à Étampes. — Passage de la duchesse
de Berry. — Le choléra. — Le chemin de fer. —
Geoffroy-Saint-Hilaire. — La guerre de 1870.
Nous voici parvenus à la Révolution. Dans Étampes
comme dans presque toutes les petites villes du royaume, elle n’éclata pas
brutalement, au milieu des désordres et des haines, mais bien au contraire,
elle était attendue comme une rénovation nécessaire et elle s’ouvrit dans
une atmosphère d’espérance, de concorde et de bonne volonté pour le travail
à accomplir. Un bouleversement constitutionnel n’y était même pas envisagé
la monarchie restait profondément associée à l’œuvre de réforme sociale qu’on
allait entreprendre.
Les officiers municipaux d’Étampes avaient été renouvelés
en 1787 et dès 1788, ils se préoccupent de la manière dont seront élus les
députés de notre bailliage pour la réunion projetée des États généraux. Ils
envoient des vœux au roi, après les avoir fait approuver par les diverses
corporations d’Étampes. En février 33 1789, ils prescrivent à tous les habitants
de nommer des délégués et aux corporations de présenter par écrit « leurs
doléances, plaintes et remontrances », qui serviront ensuite à la rédaction
du « cahier » du tiers état. Le 3 mars, en vue de cette rédaction, les délégués
nomment quinze commissaires. La municipalité recommandait aux délégués |86
de choisir « ceux à qui ils reconnaîtront le plus de lumières pour les matières
qui doivent être discutées, qu’ils croiront incapables de se laisser éblouir
ni par le rang, ni par des motifs d’ intérêt, en état de soutenir leurs opinions
avec plus de fermeté et en même temps avec le plus d’aménité, enfin ceux
qui seront enclins à entretenir l’union qui doit régner entre les différents
ordres de la société ». Cinq jours après, le cahier est terminé. Il est divisé
en huit chapitres : administration, liberté des personnes et des biens, tribunaux, clergé,
noblesse, tiers état, commerce et agriculture. Enfin, le 9 mars, a lieu,
dans l’église Sainte-Croix, l’assemblée générale des trois ordres, composée
de tous les membres du clergé et de la noblesse et des délégués de toutes
les paroisses nommés par le tiers état, celui-ci étant évidemment trop nombreux
pour être convoqué en son entier. Un événement marquant de cette séance fut
que deux membres de la noblesse, le seigneur de Granville, François-Louis-Joseph
de Laborde, et Choiseau, seigneur de Gravelles, abandonnant leur ordre, se
présentèrent comme délégués du tiers. Ils étaient donc acquis à des idées
libres, comme bien d’autres gentilshommes instruits à cette époque, et guidés
par une pensée généreuse et le désir de mieux travailler aux réformes nécessaires.
Cependant, ils furent mal compris et M. de Laborde, en particulier, fut l’objet
des jalousies et des attaques de certains délégués, mais il fut soutenu par
les gens de sa paroisse qui connaissaient sa valeur et ses vrais sentiments.
Après l’assemblée générale, qui n’avait consisté
qu’à faire l’appel de tous les membres des trois ordres, de nombreuses séances
furent tenues par chaque ordre pour procéder d’une part, à la nomination
des députés aux États généraux qui devaient être réunis à Versailles le 5
mai et d’autre part, à l’élaboration des cahiers. Le 22 mars, les trois ordres
se réunissent de nouveau en l’église Sainte-Croix, sous la présidence du
grand bailli, le marquis de Valori, pour la prestation du serment des députés
élus « de bien et fidèlement faire agréer au roi les remontrances, plaintes
et doléances des trois états du bail liage et de se conformer entièrement
à tout ce qui est porté au cahier particulier de leur ordre à eux à l’instant
remis ».
Le député du clergé était l’ abbé Périer. Il appartenait
à une ancienne famille de commerçants d’Étampes. Né lui-même à Étampes en
1748, il était curé de l’église Saint-Pierre au moment de son élection.
Le député de la noblesse était Jacques-Auguste de
Poilloüe, marquis de Saint-Mars, seigneur du Petit-Saint-Mard, né au château
du Petit-Saint-Mard en 1739. II appartenait à la vieille famille des Poilloüe,
originaire de Guyenne, mais établie à Saclas dès le début du XIVe
siècle. Ancien sous-aide-major aux gardes françaises, il était lieutenant-colonel
d’infanterie et chevalier de Saint-Louis.
Le tiers état avait deux députés. Le premier était
François-Louis-Joseph |87 de Laborde, marquis de Méréville, né
à Paris en 1761. 34
Le second député du tiers était Louis Gidoin, né
en 1727, à Monnerville, où son père était receveur. D’abord cultivateur, puis
receveur lui-même de Chalou-la-Reine, il était « bourgeois d’Étampes » au
moment de son élection.
Le cahier de doléances établi par chaque ordre avait
été remis, nous l’avons vu, durant l’assemblée du 22 mars, au député de l’ordre.
Le cahier du clergé avait été rédigé par des commissaires, curés de diverses
paroisses d’Étampes et des environs, avec l’aide d’autres cahiers particuliers
composés par les curés des paroisses du bailliage. Il n’existe pas d’exemplaire
du cahier général, au greffe d’Étampes. On ne le connaît que par une copie des
Archives nationales. Il demande des réformes dans les procès, le paiement
des impôts par tous en raison de la fortune de chacun, la suppression des
charges du peuple, l’amélioration du sort des curés pauvres par des prélèvements
sur les revenus des abbayes et des bénéfices supprimés, l’établissement de
maîtres d’école dans toutes les paroisses de deux cents feux et au-dessus, la
destruction du gibier, des colombiers, la stricte exécution des ordonnances
contre l’ivrognerie. L’ensemble est empreint de libéralisme et d’esprit de
justice.
Le cahier de la noblesse n’ existe pas non plus au
greffe d’Étampes et les Archives nationales n’en possèdent même pas de copie,
mais seulement des comptes rendus de plusieurs séances où furent examinés
les cahiers particuliers et rédigé le cahier général. Cette disparition est
infiniment regrettable pour l’histoire de notre ville. On a cependant quelques
renseignements intéressants par ces comptes rendus de séances et surtout
par le cahier particulier d’un membre de la noblesse, cousin du député, Jean-Baptiste
de Poilloüe de Saint-Mars, bien qu’il soit malheureusement demeuré inachevé.
On sait ainsi que la noblesse réclamait la suppression des impôts multiples
et leur remplacement par un impôt unique, réparti avec le plus d’égalité possible
sur tous les sujets du roi, sans aucune exception, ni privilège, la suppression
de toutes les barrières qui, à l’intérieur du royaume, entravent la circulation
et le commerce des denrées, la liberté de la vente et de l’achat du sel,
l’unification des coutumes, poids et mesures dans toutes les provinces du royaume,
la suppression de tous colombiers et volières de tous ceux qui n’ont pas
de droit par titre d’en avoir. En échange de sa décision de contribuer à
toutes les impositions, la noblesse demande, comme le tiers état |88
lui-même, que les États généraux seuls les votent et que d’autre part, les
prérogatives purement honorifiques dont elle jouit lui soient conservées.
Mais par ailleurs, elle est prête à tous les sacrifices justes, comme l’y
a incitée le grand bailli dans un noble appel.
Le cahier du tiers état nous a été heureusement conservé.
Il représente une synthèse de tous les cahiers particuliers des paroisses,
— au nombre de quatre-vingt-douze — qui avaient été rédigés auparavant dans
chaque commune, comme nous l’ avons vu pour Étampes. Les rédacteurs furent
rarement les habitants eux-mêmes, mais presque toujours les officiers, tels
que baillis, procureurs et avocats du roi, prévôts, gens de loi instruits
et avertis qui avaient préparé la substance de ces cahiers, qu’ils soumirent
ensuite à l’approbation des habitants. Beaucoup d’entre eux se ressemblent
de très près, d’abord parce que les maux étaient partout les mêmes, puis,
les paroisses voisines se communiquèrent évidemment l’ ébauche de leur rédaction,
quand elle ne fut pas l’œuvre d’un même officier. Le cahier de la ville d’Étampes
est un des plus remarquables ; rédigé en un style sobre et clair, il révèle
l’esprit tout ensemble sage, indépendant et novateur de ses commissaires,
dont s’inspire ensuite le cahier synthétique du bailliage. Les réformes suggérées
y sont exposées avec beaucoup plus de cohésion que dans les cahiers des autres ordres,
fondées sur des principes de gouvernement et d’administration dont la vérité
demeure, tels que la séparation des pouvoirs, la réunion périodique des États
généraux, le vote par tête et non par ordre, la répartition équitable et
simplifiée des impôts, la fixité de toutes les dépenses, la liberté individuelle,
la suppression des tribunaux d’ exception et la réforme de toute la procédure,
la suppression de la vénalité des charges, des loteries, de toutes les entraves
apportées au commerce, l’extension des écoles, etc.
Les cahiers des trois états de notre bailliage offrent
non seulement d’étroites ressemblances, mais sont animés du même esprit.
Ils ont été composés, d’ailleurs, lors des séances préparatoires, avec des
visites renouvelées d’un ordre à l’autre. Les idées d’ union, de nation,
de patrie, d’ intérêt général, de protection des travailleurs et des malheureux,
sont constamment développées dans les discours des membres des trois ordres
et nous n’avons pas le droit de penser que cela ne représentait que des mots.
Nos quatre députés se rendirent dans cet état d’esprit aux États généraux
de Versailles, où ils rencontrèrent certainement un grand nombre d’ hommes
de toutes les régions animés du même désir de bien faire. On sait cependant
que tout travail méthodique et efficace fut rendu impossible par l’absence d’autorité,
le désordre, la difficulté même de se faire entendre, les maladresses des
uns, l’obstination des autres. Nos députés furent noyés dans ce flot montant.
Le seul qui se distingua quelque peu fut Laborde de Méréville, mais sans
résultat utile. Une vraie révolution |89 va suivre son cours au
lieu de la sage rénovation qu’on attendait. Elle se déroulera, néanmoins,
avec relativement peu de violences à Étampes pendant les deux premières années.
Les changements survenus partout dans l’administration des villes y sont
naturellement introduits et nous n’en donnerons pas un fastidieux exposé.
Par ailleurs, la vie privée quotidienne se poursuivra sans grandes modifications, mais
la misère augmente ; beaucoup d’artisans sont bientôt sans travail, la disette
apparaît, en même temps que les vivres
renchérissent, ce qui amène les premiers désordres
sur les marchés en mai 1789. Des envois, à la Monnaie de Paris, d’argenterie
et de bijoux des particuliers, d’objets précieux des églises d’Étampes et
de Morigny, sont faits à plusieurs reprises dès l’année 1789 et en 1790,
en exécution des décrets de l’Assemblée nationale ou par suite de dons spontanés
et patriotiques. Une Société philanthropique est fondée en 1789 pour secourir
les pauvres « les plus vertueux » et l’on prélève sur ses fonds une somme
de 4.000 fr. pour l’établissement d’une rosière. La première fête de la rosière
d’Étampes a lieu en grande pompe le lundi de la Pentecôte 1790 et montre
l’union qui régnait encore entre les diverses classes sociales. La jeune
fille est conduite à travers la ville par la baronne d’Escars, sœur du député Laborde
de Méréville, et Picart, l’ancien maire, jusqu’à l’église Saint-Basile, où
le curé célèbre une messe solennelle en présence des membres de la Société
philanthropique et des gardes nationaux. La quête est faite par la comtesse
de Noailles, seconde sœur de Laborde de Méréville, et par Mlle
de Poilloüe de Bonnevaux. Un dîner est offert à la rosière et le soir, on
danse à l’hôtel de l’Arquebuse.
Le 14 juillet 1790, la prise de la Bastille est commémorée,
comme à Paris et dans toute la France, par la fête de la Fédération et le
serment de fidélité. Dans la matinée, les neuf compagnies de la garde nationale,
la compagnie des grenadiers et celle des chasseurs, toutes deux créées depuis
quelques jours seulement, allèrent prendre solennellement les officiers municipaux
à l’Hôtel de ville pour se rendre en corps à Notre-Dame. Dans l’église, étaient
assemblés les curés, vicaires et chanoines de la ville et les membres des
diverses communautés, barnabites, cordeliers, mathurins et capucins, qui
n’avaient plus que si peu de temps à demeurer à Étampes. Ils se réunirent
au cortège, qui gagna la promenade du Port ; où fut célébrée une grand’messe, sur
un autel en plein air. À midi, au son de toutes les cloches, la messe fut
suspendue : les officiers municipaux et le commandant de la maréchaussée,
montant à l’autel, jurèrent « de rester unis par les liens indissolubles
d’une sainte fraternité et de défendre jusqu’au dernier soupir la constitution
de l’État, les décrets de l’Assemblée nationale et l’autorité légitime de
nos rois ». La garde nationale et tout le peuple répétèrent, « nous le jurons
» puis, la messe fut achevée, sous la pluie et parmi des rafales de vent.
Ensuite, le cortège revint |90 à Notre-Dame, où des prières furent
dites pour le roi, suivies des cris de : « Vive la nation, vive le roi !
» Le soir, les édifices publics furent illuminés, ainsi que les maisons particulières,
qui en avaient reçu l’ordre. On voit, partout le caractère de cette fête,
quel effort de conciliation était encore tenté entre le passé et l’ avenir.
En octobre 1790, Claude Dupré, huissier à Étampes,
rouvre une imprimerie, sous le patronage du District d’Étampes, nouveau corps
de douze membres, créé depuis le mois de juin. C’est à Dupré que sera confiée
l’ impression des innombrables avertissements relatifs aux divers événements
qui vont se précipiter : fermeture de plusieurs églises et des couvents,
ventes des biens nationaux, certificats de civisme, enrôlement des volontaires,
troubles des marchés, réquisitions d’armes, de chaussures, d’habits, d’argenterie,
et surtout de grains, installation d’un magasin de subsistance dans l’ancien
couvent des Cordeliers, dénonciations publiques des citoyens en retard pour
le paiement de leurs impôts, emprunts forcés, fondations d’ateliers de fabrication
du salpêtre, d’abord aux Cordeliers, puis dans l’église Saint-Basile, réquisitions
d’ ouvriers pour la fabrication des armes, des souliers, etc. Ces bulletins,
dont l’énumération a été consignée dans un registre spécial par Dupré, lui
étaient commandés par le Directoire du District d’Étampes, dont nous suivons
ainsi l’activité grandissante. D’autre part, il imprime un périodique hebdomadaire,
Le Journal d’Étampes, fondé en novembre 1790, par l’abbé Ménard, desservant de l’église
Saint-Pierre, en l’absence de son curé, l’abbé Périer, député à l’Assemblée
nationale. Mais, dès février 1791, le journal ne paraît plus, ce qui semble
indiquer une certaine indifférence de la population, en face de la fièvre
du District. Cependant, un club est fondé en juin 1791 « La Société des Amis de
la Constitution », mais il paraît soucieux de vivre en paix avec le corps
municipal, dont plusieurs membres sont affiliés au club. Le goût des distractions
subsiste également puisqu’à la foire Saint-Michel de 1791, une troupe de
comédiens fait imprimer à dix reprises différentes des affiches et des billets
pour ses représentations et y reste installée jusqu’au 13 octobre.
C’est en mars 1792 que se produit le premier événement
tragique à Étampes. La cherté croissante des vivres avait entraîné déjà des
désordres dans les marchés depuis le début de l’année. Aussi le 21 janvier,
le Directoire du District d’Étampes envoya, pour veiller à la sûreté publique,
une compagnie du 18e dragons, qui fut logée à la caserne de la
rue Saint-Jacques et à la maison de ville. Le 3 mars, une bande d’environ
six cents hommes armés de sabres, de fusils et de bâtons, partie de Montlhéry,
de la Ferté-Alais et grossie tout le long du chemin, entra dans Étampes, malgré
l’opposition du corps municipal qui s’était porté à leur rencontre, en tête
de la troupe, dans le faubourg Saint-Jacques. Pour éviter une collision,
les officiers municipaux |91 se retirèrent, ce qui permit aux
mutins de pénétrer en ville et de gagner le marché Saint-Gilles, où, rapidement
maîtres du terrain, ils taxèrent d’autorité tous les grains. Le maire Simonneau
et le corps municipal qui étaient à l’Hôtel de ville, après avoir reçu du commandant
du détachement de cavalerie l’assurance qu’ils pouvaient compter sur sa troupe,
se rendirent, escortés par elle, place Saint Gilles. Ils purent s’avancer
jusqu’à l’endroit où les meneurs veillaient à l’exécution de la taxe qu’ils
avaient imposée. Le maire tenta de leur représenter l’illégalité de leur action,
les insurgés répondirent par des menaces et voulurent le contraindre, au
contraire, à proclamer lui-même cette taxe. Simonneau s’y refusa avec énergie
et tout aussitôt, il fut enveloppé par une foule vociférante, qui rompit
même les rangs de la troupe. Le maire se trouva porté jusqu’à l’extrémité
de la place, dans la rue de l’Étape-au-Vin, aujourd’hui rue Simonneau : atteint
par des coups de bâton, renversé à terre, il reçoit, d’un homme monté sur
une borne, un coup de fusil presque à bout portant, un autre coup de fusil
lui brise le crâne, tandis que le procureur Sédillon et un autre citoyen
sont blessés. Le rôle de la troupe dans ce drame ne fut jamais bien éclairci
: accusée d’infidélité, elle semble au moins avoir manqué de vigueur et s’être
rapidement laissée déborder. Mais le malheureux Simonneau lui-même n’avait
pas déployé assez d’ énergie au début. Il fallait faire appel à la troupe
au faubourg Saint-Jacques : là, une charge de cavalerie eut vite repoussé
les meneurs tandis qu’elle n’était plus guère possible sur la place Saint-Gilles,
bordée de rues très étroites. Le meurtre de Simonneau, victime de son devoir
et de sa fidélité à la loi, eut un grand retentissement, non seulement à
Paris, mais dans toute la France. L’Assemblée législative décréta « d’urgence
», le 18 mars, qu’il serait élevé aux frais de la nation, place Saint-Gilles, une
pyramide triangulaire, sur laquelle seraient gravés le nom de Simonneau et
ses dernières paroles : « Ma vie est à vous : vous pouvez me tuer, mais je
ne manquerai pas à mon devoir, la loi me le défend ». Le monument ne fut
jamais édifié, mais des services funèbres eurent lieu en l’honneur du maire
d’Étampes dans un grand nombre de villes. À Paris, on célébra, le 3 juin 1792,
une fête symbolique à sa mémoire, dite la Fête de la Loi, avec une pompe
renouvelée de l’antique : un immense cortège militaire et civil traversa
tout Paris, portant des bannières couvertes d’inscriptions emphatiques, le
buste de Simonneau, son écharpe, le modèle de la pyramide projetée et le
modèle de la Bastille, l’autel de la Loi, le livre de la Loi ouvert sur un
trône d’or, la figure de la Loi assise sur un socle et appuyée sur ses tables,
etc... pour se rendre au Champ de la Fédération, où l’on avait dressé un
autel de la Patrie et derrière lui, un grand palmier de huit mètres de haut,
qui « le couronnait de son large feuillage ». Le buste de Simonneau fut déposé
sur l’autel de la Patrie, on y plaça la couronne civique et tout le cortège
défila autour |92 de lui. Une ode fut chantée, « dont chaque strophe
était coupée par une musique grave, héroïque ou lugubre suivant le sens de
la strophe », après quoi, on brûla une grande quantité d’encens sur l’autel
de la Loi. Le livre de la Loi fut élevé et montré au peuple et toute la garde
présenta les armes. L’assistance fut évaluée à deux cent mille citoyens et
l’on jugea « que nous n’avions plus rien à envier aux fêtes triomphantes
de l’ancienne Rome ». Aujourd’hui, nous jugeons bien différemment : les triomphes
de Rome nous paraissent toujours grands et dénués de ridicule, tandis que
la pompe du malheureux Simonneau, avec ses accessoires symboliques, prête
à sourire, en dépit des sentiments touchants, et pour beaucoup sincères,
qui l’avaient inspirée.
Les assassins de Simonneau furent recherchés. Vingt
et un accusés parurent devant le tribunal criminel du département qui en
condamna huit à la prison et deux, citoyens d’Étampes, à la peine capitale.
Ceux-ci devaient être exécutés à Étampes, sur la place Saint-Gilles, mais
ils échappèrent au châtiment. Incarcérés à Étampes avec les autres condamnés
pour le meurtre de Simonneau, ils furent élargis par un nommé Fournier, qui
passait, le 8 septembre 1792, en conduisant d’Orléans à Paris un convoi de
prisonniers que l’on massacra à Versailles. Emmenés à Paris, les assassins
de notre malheureux maire furent reçus par Robespierre, les Jacobins, la
commune de Paris et même l’Assemblée législative. On voit quelle évolution
s’était faite dans les esprits en quelques mois. Notre ville ne tardera pas
à en sentir les redoutables effets.
Avant cela, le District et la municipalité se préoccupent
du maintien de l’ordre. La garde nationale est reconstituée et de nouveaux
drapeaux lui sont remis solennellement dans une cérémonie où le curé de Saint-Martin
prononce un discours patriotique, où s’expriment encore la fidélité au roi
et à la loi et la réprobation des violences : Claude Dupré est chargé de l’imprimer
à 700 exemplaires.
Un assez grand nombre de prêtres à Étampes et dans
les paroisses des environs avaient cependant adopté les idées révolutionnaires
et prêté le serment constitutionnel, quelques-uns même avec une farouche
ardeur. Plusieurs d’entre eux s’étaient mariés. Les autres deviennent l’objet
de graves mesures de rigueur lorsque la Convention succède à la Législative,
le 22 septembre 1792 : un vicaire de Notre-Dame, entre autres, est emprisonné
« pour propos incendiaires et manque de respect aux autorités ». On saisit
de l’argenterie et des objets précieux dans les églises et les monastères.
En octobre, la Terreur s’installe dans notre ville
avec l’arrivée du citoyen Couturier, député de la Moselle à la Convention,
qui a reçu la mission de « régénérer révolutionnairement les autorités ».
Il prononce, en effet, la destitution de tous les membres des corps constitués
et les remplace par des hommes sûrs, qui tiennent séance |93 dans
l’ancienne église des Barnabites. Il fait arrêter, le jour même de son arrivée,
le curé de Saint-Basile, le curé de Saint-Pierre et ancien député, Périer, l’aumônier
de l’Hôtel-Dieu, celui des Mathurins, des chanoines, d’autres prêtres encore,
dont les églises, aux environs, ont été fermées, et les fait interner aux
Récollets de Versailles. Il délègue des commissaires dans toutes les communes
du district pour achever le pillage des églises et des biens des émigrés.
Presque toutes les cloches sont emportées à Paris afin de servir à la fonte des
canons notre belle cloche du duc de Berry, vieille de quatre siècles, nous
fut cependant laissée, à Notre-Dame, sans doute en raison des difficultés
que soulevait sa descente. Tous les objets de métal sont saisis et dirigés
sur Paris, pour le même but : Boulence, officier municipal à Étampes, annonce
à la Convention, le 12 décembre, l’ envoi de quatre-vingts voitures de fer
« provenant des ci-devant domiciles de la superstition ».
C’est alors que commence la démolition de la belle
église Sainte Croix, vendue comme bien national à un chaudronnier d’Étampes.
Notre-Dame est transformée en « temple de la Raison triomphante », Saint-Basile,
en salpêtrière et Saint-Gilles sert à la fois de halle au blé et de prison.
L’Hôtel-Dieu et le couvent de la Congrégation sont également utilisés comme maisons
d’arrêt, le nombre des prisonniers ne faisant que s’accroître. Beaucoup de
gentilshommes jeunes et valides avaient émigré, mais leurs femmes, leurs
enfants, leurs parents âgés étaient restés Couturier décrète leur arrestation
comme suspects et les fait interner ou maintenir reclus dans leurs propres maisons.
Nous relèverons parmi eux, Michel de Bouraine, l’ancien receveur des finances
et sa femme, Picart de Noir-Epinay, l’ancien lieutenant général du bailliage
et sa femme, Marie-Geneviève de Bouraine, femme de César-Joachim de Poilloüe
de Saint-Périer, émigré, et ses trois enfants, cinq demoiselles de Poilloüe,
Jean-Baptiste de Poilloüe de Bierville, sa femme et leurs trois enfants,
Claude de La Bigne et sa femme, etc. Les bourgeois n’échappent pas aux rigueurs.
Les prêtres, moins encore : Couturier s’acharne particulièrement contre eux. Installé
au château de Segrez, près de Souzy-la-Briche, il entreprend à Étampes et
dans tout le district une campagne d’intimidation contre les curés restés
encore fidèles à leurs devoirs et les malheureux, cédant à l’épouvante, «
se déprêtrisent », suivant le beau style de l’époque ; c’est-à-dire qu’ils
remettent entre ses mains leurs lettres de prêtrise, qu’il brûle aussitôt
dans des « feux de joie », ou bien, ils se font marier par lui. À Méréville,
à Ormoy, à Saint-Cyr-la-Rivière, à Bouville, à Puiselet-le-Marais, à Saint-Sulpice-de-Favières,
ailleurs encore, ces mariages sont célébrés sur la place publique, devant l’arbre
de la Liberté. À Étampes, c’est le curé de Champigny, âgé de cinquante-six
ans, que Couturier déclare uni en mariage à Anne Chaté, le 29 octobre 1793,
sur la place de la Régénération |94 — nouveau nom de la place
Saint-Gilles —, au milieu d’une grande affluence ; en même temps, il leur
donne acte de leurs conventions matrimoniales, usurpant ainsi les fonctions
de notaire comme celles d’officier d’état-civil. Il se targue ensuite, dans
ses bulletins de victoire envoyés à la Convention, d’avoir anéanti « le préjugé
ridicule qui avait privé jusqu’ici les ministres catholiques de l’ exercice
plein et entier du plus doux des devoirs ». On possède de nombreuses protestations
écrites des habitants et des demandes de rétablissement du culte, qui s’exerçait
de moins en moins, mais loin d’y accéder, Couturier décrète la fermeture
de toutes les églises du district le 29 novembre 1793. Sa fureur prend aussi
des formes mesquines et risibles c’est ainsi qu’il change les noms de trente-trois
rues d’Étampes, que Chalô-Saint-Mars devra s’appeler Chalô-la-Raison, Saint-Sulpice-de
Favières, Favières-Défanatisée, que les hommes eux-mêmes portant le prénom
de Louis seront nommés Sincère.
Enfin, le 28 décembre 1793, Couturier, satisfait
de son œuvre, adresse un rapport à la Convention sur les « régénérations
» qu’il a opérées dans le district d’Étampes. Deux autres députés de la Convention,
Crassous et Roux, remplirent après lui des missions à Étampes, mais avec
moins d’éclat. Le 9 thermidor seulement devait amener la cessation des violences
; cependant, les administrateurs terroristes d’Étampes ne semblent pas avoir compris
tout de suite le caractère de la réaction thermidorienne. Ils n’en saisirent
guère la portée avant d’avoir subi à leur tour, à la fin de l’année 1794,
la destitution que Couturier avait infligée à leurs prédécesseurs. La Convention
assagie envoya à Étampes d’autres représentants du peuple pour accomplir
cet acte d’autorité, rendu nécessaire par des menaces de désordres. En effet,
les lois nouvelles avaient libéré les prisonniers en les autorisant à rechercher
leurs dénonciateurs et demandaient des comptes aux administrateurs sur les
réquisitions opérées partout. Mais les principaux responsables s’étaient
enfuis et leurs complices restés sur place, épouvantés à leur tour, avaient
perdu toute autorité.
La suppression du District et le renouvellement de
l’administration municipale ramenèrent progressivement le calme, auquel tout
le monde aspirait. Mais dans les campagnes et jusqu’aux portes d’Étampes,
sévissaient de redoutables brigands, surnommés les Chauffeurs et formant une bande organisée, la fameuse bande d’Orgères
ils assassinent, en 1797, la fermière de la Grange-Saint-Père, au-dessus
de Gérofosse.
Les églises furent rouvertes et les prêtres, même
ceux qui s’étaient mariés, revinrent exercer le culte. Le retour aux anciens usages,
plus solides que ne l’ avaient cru les terroristes, se faisait assez rapidement.
Il faut parvenir, cependant, jusqu’à l’Empire pour trouver rétablies certaines
institutions, comme le |95 collège, qui ne rouvre qu’en 1807 et
le couvent des religieuses de la Congrégation, en 1808. Mais les autres monastères,
Cordeliers, Mathurins, Capucins, la maladrerie de Saint-Lazare et l’église Sainte-Croix
sont à jamais détruits ; l’église Saint-Pierre est démolie en 1804 et le
Bourgneuf gardera le triste aspect d’un chantier durant près d’un siècle.
La tour de Guinette et ses dépendances avaient été vendues pour 525 fr.,
en 1793, comme bien national à un maçon d’Étampes, et pendant plus de cinquante
ans, notre vieille forteresse fut exploitée comme une carrière. Le donjon
fut seul respecté parce qu’un de ses possesseurs, M. de Grandmaison, en comprit
l’intérêt.
Notre ville reprend une vie régulière sous l’Empire.
En 1809, à l’ apogée de la gloire napoléonienne, le maire, le général de Romanet,
et la municipalité décident, pour célébrer les victoires d’Espagne, de placer
une aigle impériale au sommet du clocher de Notre-Dame et d’orner du même
emblème les étendards de la garde nationale. Une cérémonie solennelle, à
Notre-Dame, comprend la bénédiction des aigles, un Te Deum et la célébration du mariage « d’une fille sage, dotée par
l’Empereur, avec un homme ayant fait la guerre ».
La campagne de France n’ atteignit pas notre ville,
mais ses conséquences amenèrent des Cosaques jusque dans nos murs. Paris
avait été pris par les troupes alliées le 31 mars 1814 et aussitôt après,
12.000 hommes, Cosaques, Tartares et Baskirs, vinrent camper à Gérofosse,
au-dessous de Guinette, et même place Saint-Basile. Ils commirent des pillages
dans toute la région, à Cerny, à Guigneville et surtout à Bois-Herpin, dont
ils dévalisèrent le château de fond en comble, en menaçant de mort le malheureux
propriétaire, M. de Pillot, sa femme et ses cinq enfants. À Étampes, ils
causèrent le plus grand effroi en raison de leur aspect sauvage : « Ils n’ont
pas figure humaine, nous dit une lettre de l’époque, une barbe longue de
six pouces leur couvre toute la figure et ils sont vêtus de peaux d’ours
et de moutons noirs ». Nous avons encore connu un témoin de ce campement,
notre propre grand-père, qui, étant alors tout enfant, en avait gardé un
souvenir d’épouvante. Dans la ville, où logeait le général russe, Stznichef,
les Cosaques ne semblent pas, cependant, avoir commis de violences.
Le retour des Bourbons fut accueilli avec enthousiasme
par bien des familles d’Étampes, puisque la lettre qui nous donne quelques
détails sur le campement des Cosaques nous apprend que « plusieurs jeunes
gens d’ ici sont déjà partis pour Paris se présenter, mais cela se dit à
l’oreille ». Il s’agissait de la formation de la garde du futur roi, pour
laquelle des listes d’inscriptions avaient été ouvertes à Paris dès l’abdication
de l’empereur. Cette garde fut constituée en moins d’une semaine.
Pendant les Cent-Jours, le sous-préfet d’Étampes
invita ces mêmes « jeunes gens », revenus dans leurs familles, à s’éloigner jusqu’à
|96 trente lieues de Paris, sauf s’ils acceptaient de prêter serment
l’Empereur.
Les événements ultérieurs troublèrent peu notre ville.
Nous savons qu’en 1817 « la plus grande tranquillité règne dans l’arrondissement
» et qu’ainsi un détachement de grenadiers à cheval de la garde royale, qui
avait stationné à Étampes, à Milly et à Angerville, est rappelé par le ministre
de la Guerre.
En 1828, la duchesse de Berry traverse Étampes au
retour d’un voyage dans les provinces de l’Ouest. Elle est reçue à la sous-préfecture,
où un déjeuner lui est offert, après lequel toutes les notabilités lui sont
présentées. Réception banale, qui nous vaut seulement un portrait de la duchesse
assez piquant, tracé par un témoin oculaire : « Sa toilette est bien négligée,
ses cheveux sont d’un blond hasardé, en bandeaux, un teint pâle et jaune,
beaucoup de blanc dans des yeux bien clairs et un peu de travers. »
La révolution de 1830 n’amena pas de troubles dans
Étampes. La garde nationale partit bien pour Rambouillet, où se trouvait Charles
X au moment de son abdication, mais elle ne dépassa pas Saint-Arnoult.
En 1832, l’épidémie de choléra, qui avait éclaté
à Paris au mois de mars, atteignit Étampes en avril. Elle dura cinq mois
et s’étendit à plus de trente communes aux environs ; dans notre ville seule,
elle frappa 785 personnes et causa près de 300 morts. Une seconde épidémie
semblable réapparut en 1849, à la même époque de l’année, et dura également
jusqu’en septembre. Elle fit moins de malades, sans doute parce que la première
épidémie avait déterminé, chez un assez grand nombre d’individus restés indemnes,
un état de défense qui les mit à l’abri de la seconde. Mais le choléra avait
acquis plus de virulence, comme il arrive souvent, et le nombre des morts
fut plus élevé. On brûla dans toutes les rues des genévriers, parce qu’on
croyait alors à l’efficacité de ces fumées aromatiques elles n’avaient aucun
effet prophylactique, mais l’inquiétude qui étreignait toute la population
en était un peu apaisée.
Cette double invasion de choléra et l’ignorance où
la médecine était encore de ses vraies causes et des moyens de s’en préserver rattachent
cette époque à un lointain passé tandis que, par ailleurs, les progrès sont
considérables et l’esprit humain fait d’immenses conquêtes.
Notre ville retrouve une prospérité qu’elle ne connaissait
plus depuis des siècles. L’industrie des moulins, dont le nombre s’est beaucoup
accru, est rénovée ; le commerce des grains, des bestiaux, des laines, du
sable, des produits maraîchers, prend une extension nouvelle. C’est ainsi
que, dès 1838, peut être créée la Caisse d’Épargne d’Étampes, fondation qui
a puissamment contribué au |97 développement de la prospérité
et dont le succès montre la sagesse de nos populations beauceronnes.
En 1843, a lieu l’inauguration du chemin de fer de
Paris à Orléans qui donnera un nouvel essor à notre ville, de même que sa
situation sur la grande route avait jadis déterminé sa fondation et plus
tard, sa grande importance. Des travaux considérables, comme le détournement
de la Louette, l’établissement de la grande rampe, avaient été effectués
pour la construction de la ligne. On sait que les premiers chemins de fer
furent l’objet de bien des scepticismes et des railleries, ainsi qu’il en
est trop souvent en France de toutes les inventions, mais les hommes clairvoyants
en pressentaient déjà le succès. « Mystérieux comme tout ce qui est grand,
disait le duc de Nemours à l’inauguration, l’avenir des chemins de fer réalisera,
n’en doutons pas, les magnifiques espérances de gloire, de richesse et de
civilisation qu’il a fait naître ».
En 1844, s’éteignait une des plus belles figures
de la science française, qui était un enfant d’Étampes, Geoffroy-Saint-Hilaire. Né
en 1772, il appartenait à une vieille famille étampoise. Après avoir fait
ses études au collège de Navarre, à Paris, il suivit les leçons de Daubenton
et de l’abbé Hauy, qu’il sauva lors des massacres de septembre par ses démarches
et son dévouement. Presque aussitôt, en 1792, Hauy le fit entrer comme démonstrateur
au Jardin des Plantes, où l’année suivante, un décret de la Convention instituait
douze chaires d’enseignement. Celle de « l’histoire des animaux vertébrés
» fut offerte à Geoffroy-Saint-Hilaire, qui d’abord refusa modestement, parce que
ses travaux jusqu’alors avaient porté davantage sur la minéralogie. Mais
Daubenton leva ses scrupules : « Osez entreprendre, lui dit-il. La zoologie
n’a jamais été professée à Paris ; faites que dans vingt ans, on puisse dire
: la zoologie est une science et une science française ». Geoffroy-Saint-Hilaire
ne devait pas décevoir les espérances de son maître : grâce à lui, la Ménagerie
fut créée, les collections renouvelées et complétées, tandis qu’il publiait,
dès 1795, des études importantes sur les Mammifères et les Orangs. Bonaparte
l’emmène en Egypte en 1798 ; il reprend, au retour, son enseignement et ses
travaux au Muséum, puis, il est nommé, en 1807, à trente-cinq ans, membre de
l’Institut, en 1809, professeur de zoologie à la Faculté des Sciences, chaire
qu’il occupa concurremment avec celle du Muséum jusqu’en 1840 : répondant
au vœu de Daubenton, il avait fait de la zoologie une science française.
Nous ne citerons pas ses nombreux travaux, tant en zoologie qu’en embryologie
et en tératologie, sciences qui, elles aussi, existaient à peine avant lui.
Le titre de son ouvrage capital Principes de philosophie zoologique donne le caractère même de son esprit et de son œuvre ;
il porte, le premier, une vue d’ensemble et vraiment philosophique sur l’anatomie
des animaux. Un de ses plus beaux titres de gloire est aussi d’avoir reconnu
et courageusement |98 proclamé la valeur des idées de Lamarck
sur la variabilité des espèces, contre Cuvier qui croyait à leur fixité.
La lutte entre les deux savants, qui étaient liés d’ une amitié bien ancienne,
puisque Geoffroy-Saint-Hilaire avait fait venir Cuvier à Paris dès 1795, passionna
l’Europe savante. Le vieux Goethe, qui en suivait les péripéties dans les
discussions de l’Académie des Sciences, demandait à un visiteur qui arrivait
de Paris : « Que se passe-t-il à Paris ? » — « Le roi, répondit son interlocuteur,
vient de... » — « Que m’importe la politique, dit Goethe. Je vous demande
où en est la discussion entre Geoffroy-Saint-Hilaire et Cuvier ».
Geoffroy-Saint-Hilaire avait été nommé, en 1815,
député d’Étampes, mais il abandonna bientôt un mandat qui le détournait de
ses études. Une statue lui fut élevée par souscription, en 1857, devant le
théâtre. Le jour de l’inauguration, le 11 octobre, toute sa ville natale,
justement fière de lui, fut décorée et illuminée.
Nous ne pouvons énumérer ici toutes les personnalités
notables de notre région au XIXe siècle : nous citerons, cependant, Narcisse
Berchère, né à Étampes en 1819, parce qu’il fut un grand artiste, dont nous
avons heureusement quelques œuvres dans notre Musée. Ayant longtemps voyagé
en Espagne, en Égypte, en Syrie, il a su rendre la grandeur lumineuse et
la poésie de ces paysages d’Orient.
La révolution de 1848 se déroula sans violences dans
notre sage petite ville. On planta sur la place Saint-Gilles un arbre de
la Liberté, devant lequel fut prêté le serment à la Constitution.
Mais après une période prospère et brillante, la
guerre réapparut, avec tout son cortège de tristesses et de misères. Le l7 septembre
1870, notre ville voyait arriver les premiers Prussiens dans ses murs, tandis
qu’elle était totalement isolée de Paris, dont l’investissement s’achevait.
Étampes allait être occupée pendant cinq longs mois. Au début, les troupes
prussiennes paraissaient prêtes à toutes les violences, mais l’attitude ferme
et courageuse du maire Brunard leur en imposa et l’occupation s’écoula sans graves
désordres. Elle entraîna, bien entendu, les réquisitions de toute nature
: armes, grains, bestiaux, pain et vin. En octobre, une lourde amende de
20.000 fr. fut exigée de la ville parce que le télégraphe prussien avait
été coupé aux environs. Le 8 octobre, eut lieu tout près d’Étampes, à la
ferme de Courpain, un combat héroïque où quelques francs-tireurs tinrent
tête à plusieurs régiments prussiens : petite victoire isolée et sans lendemain.
À plusieurs reprises, passèrent des convois de prisonniers français qui devaient
gagner la Prusse. Ils furent logés au grenier d’abondance et dans les églises
Notre-Dame, Saint-Basile et Saint Gilles. Près de cinq cents d’entre eux
purent s’évader, grâce au concours de courageux habitants, car les représailles
de l’ennemi pouvaient être terribles.
Enfin, le 16 février 1871, notre ville était libérée,
mais encore |99 appauvrie par le versement d’une lourde contribution
de guerre que les autorités prussiennes exigèrent sous des menaces, avant
leur départ.
Nous arrêterons ici l’histoire d’Étampes. Depuis
1870, elle s’est déroulée sans heurts et sans fastes jusqu’à la Grande Guerre et
celle-ci nous paraît trop récente et trop douloureuse encore à beaucoup pour
qu’on en puisse retracer le détail avec la sérénité nécessaire. Depuis, c’est
une époque nouvelle qui s’est ouverte et, selon le mot du sage Montaigne,
il est plus facile de juger et de décrire le temps passé que le présent.
Si le culte du souvenir garde encore dans l’avenir quelques fidèles, ceux-là
qui nous suivront auront la tâche d’écrire notre histoire. |100
139
Le retour de Tobie par
Eustache Lesueur (vers 1640) Source possible
du tableau confisquée à Jeurre
15. Le premier musée d’Elampes
7
Par la comtesse de Saint-Périer
Ce premier Musée ne fut qu’un projet, qui remonte
à l’année 1795. Mais il est attesté par la pièce officielle que nous publions ci-dessous,
conservée au château de Jeurre, qui nous a été aimablement communiqué par
son propriétaire, notre neveu, le Comte de Saint-Léon.
C’est le procès-verbal de la prise de possession
au château de Jeurre, devenu propriété nationale, « d’objets propres à l’établissement
du Musée ». La brève énumération et la nature des objets jugés tels par les
« commissaires artistes » font quelque peu sourire.
On dut renoncer au Musée, sans doute en raison du
maigre résultat obtenu, à Jeurre comme ailleurs, les choses de qualité que
possédaient les émigrés ayant été depuis longtemps mises à l’abri.
Mais le projet de créer un Musée dès cette époque,
dans une petite ville comme Étampes, en dépit des temps troublés qu’on vivait
encore, est bien sympathique. C’est un vivant témoignage de l’ardent état
d’esprit qui régnait en cette période, aux aspects si divers. Ardeur qui
ne tarde pas à s’éteindre dans tous les domaines. Moins de trois ans après
notre procès-verbal, un long inventaire du mobilier existant au château de
Jeurre mentionne les deux tableaux, qui y étaient décrits dans les mêmes
termes : 35 ils
avaient donc été restitués, à défaut des petits paillassons et du plumeau
à épousseter...
Et près d’un siècle s’écoulera avant qu’on ne songe
de nouveau à créer un Musée à Étampes.
*
* *
Aujourd’hui sextidi du
premier decadi de vendémiaire de l’an trois de la république une et indivisible,
nous, Chilibert Lebrun, membre de la commission des arts du district d’Étampes,
nous nous sommes transportés dans la maison de Jeurre, sise dans la commune
de Morigny, laquelle maison est devenue propriété nationale par l’émigration
de Dufresne de Saint-Léon, et afin de procéder à l’enlèvement des objets
d’art, qui n’ont pu être transportés dans le voyage que l’on fit pour faire
l’inventaire des dits objets le duodi de messidor, et pour nous conformer
à la loi du huit pluviose et à l’instruction du comité d’instruction publique
et de la commission temporaire des arts, nous nous sommes fait accompagner
du citoyen Beauvallet, maire de la commune de Morigny, auquel nous avons
exhibé nos pouvoirs, en date du vingt-neuf germinal dernier, ainsi qu’une
nouvelle autorisation du district d’Étampes en date du sept fructidor dernier,
portant que les j1 commissaires artistes pourront même enlever
les objets d’utilité propres à l ’établissement du Musée.
En conséquence, nous
avons procédé à l’enlèvement d’un tableau de cinq pieds huit pouces de large
sur trois pieds onze pouces de haut36, cadre doré à moulures saillantes et de
six pouces de largeur37,
représentant un franciscain prêchant sur une montagne.
Plus un autre tableau,
large de sept pieds cinq pouces, haut de cinq pieds cinq pouces38, cadre saillant
doré de cinq pouces de largeur39, représentant le retour de Tobie dans sa
famille40.
Plus deux petits paillassons
communs.
Plus un plumeau à épousseter.
Lecture faite du présent
inventaire en présence du citoyen Beauvallet, maire, et du citoyen Calté,
gardiens établis par l ’administration du district d’Étampes, auquel nous
avons laissé un extrait du présent procès-verbal pour sa garantie et décharge des
dits objets ci-énoncés et avons le dit clos les jours et an que ci-dessus
de la république une et indivisible, et ont signé avec nous.
(signés) Lebrun, Calté,
Beauvallet (Maire)
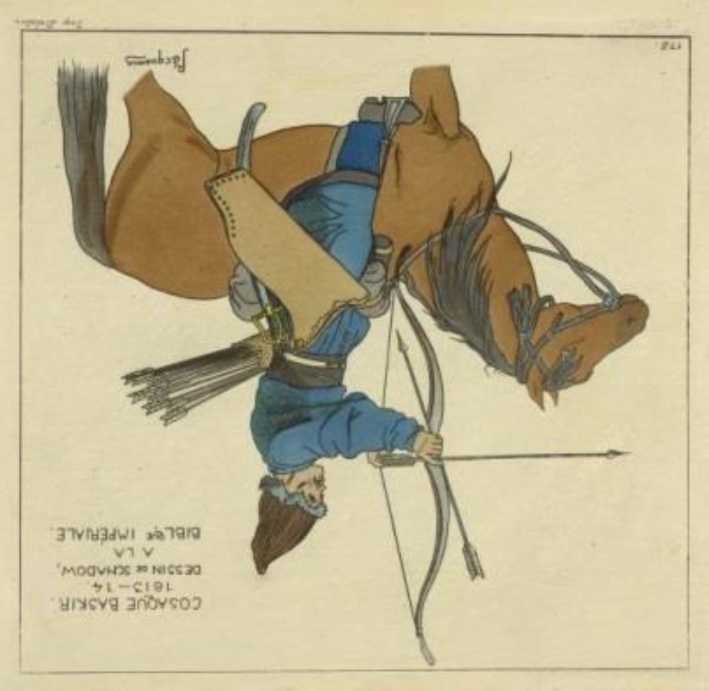
16. Les Cosaques a Etampes
en 1814 et le pillage du château de Bois-Herpin «
Bien que la région d’Étampes, malgré sa proximité
de Paris et de Fontainebleau, n’ait pas été le théâtre d’opérations militaires importantes
au moment de la campagne de France, elle eut à subir l’occupation étrangère,
à la suite de la prise de Paris par les troupes alliées (31 mars 1814).
Les Russes campèrent autour de la ville et les Cosaques
s’établirent en deux points : au-dessous de Guinette, près du Port et faubourg
Saint-Pierre, près de Gérofosse41 42.
Mon grand’père m’a raconté qu’il se souvenait parfaitement,
malgré son très jeune âge, d’avoir vu le campement de Gérofosse, en 1814,
et que son imagination d’enfant avait été vivement frappée par l’apparence
barbare de ces troupes.
Les Cosaques constituaient, en effet, à cette époque,
plutôt une horde indisciplinée qu’un corps régulier ; les nombreux contingents
asiatiques, incorporés dans l’armée russe, contribuaient à faire de ces troupes
des bandes portées au pillage et extrêmement peu civilisées.
Il semble que les habitants d’Étampes et des environs
aient eu beaucoup à souffrir de la présence des Cosaques et que les actes de
brigandage aient été fréquents de la part de ceux-ci.
Nous n’en voulons comme preuve que la lettre que
nous publions aujourd’hui et qui donne de curieux détails sur le séjour de
ces troupes à Étampes et sur les vexations qu’elles firent subir aux habitants
de notre ville et à ceux des environs.
Cette lettre a été écrite par Jeanne de Poilloüe
de Bonnevaux, |106 née à Étampes le 11 juin 1781, cinquième enfant
de Jean-Baptiste de Poilloüe, comte de Bonnevaux, Sieur d’Izy, ancien garde
du corps du Roi, et de Marguerite-Julie de Germay ; elle est adressée à son
frère Auguste-Jean-Baptiste de Poilloue, comte de Bonnevaux, né à Étampes
le 17 avril 1778, ancien officier d’artillerie de la Marine, qui habitait
la ville de Saint-Lô (Manche), en 1814.
Malgré la naïveté de l’expression et, peut-être,
quelques exagérations dans les détails, cette lettre nous a semblé présenter un
certain intérêt, parce qu’elle rend compte d’évènements peu connus et se
rattachant à l’histoire locale de notre région. Nous la publions intégralement,
nous bornant à rectifier l’orthographe très fantaisiste de Mlle
de Bonnevaux et à y adjoindre une ponctuation que, dans son trouble, elle
a complètement négligée.
Étampes, ce 10 avril 1814.
Nous venons de recevoir ta lettre, en date du 30
mars ; elle a calmé un peu l’inquiétude où nous étions sur ton compte, car nous
te croyons aussi bien entouré que nous et peut-être forcé de quitter la Normandie.
Mais, grâce à Dieu, il paraît que tu es fort tranquille
et, selon toute apparence, tu le seras maintenant, encore plus que jamais.
Pour nous, nous avons eu des transes affreuses ;
depuis douze jours ; il y a douze mille hommes campés autour des murs de
la ville. Il y en a de toutes les nations, Cosaques, Kalmouks, Turcs ; les
premiers ne parlent ni n’entendent le français; il y en a même, des seconds,
qui n’ont pas figure humaine, ayant de la barbe longue de six pouces par
toute la figure, vêtus de peaux d’ours et de moutons noirs. On ne peut pas
même les regarder sans horreur ; heureusement que c’est le plus petit nombre
!
Toutes les nuits, il en couche une trentaine sur
le carrefour Saint Basile, avec autant de chevaux, tout pêle-mêle. Les Prussiens
ne leur commandent qu’à coups de bâton c’est, dit-on, pour essayer de les
civiliser, qu’on les amène en France ; il y a aussi quelques Chinois.
Le général Strnichef loge chez le maire ; on le nomme
aussi Glatow.
Il y a, à Brunehaut43 un mille de Tartares et de Baskirs qui sont
|107 les plus indisciplinés et les plus pillards44 ; le reste est
campé au-dessus de Morigny.
Ils viennent de piller entièrement le château de
Bois-Herpin45 46 dont les habitants
sont accourus tous ici ; nous en avons onze, tant maîtres que domestiques,
dont cinq enfants.
Ils (les Cosaques) entrèrent
trente à 10 heures du matin ; l’officier, en entrant dans le château, dit
à sa troupe :
Cherche, cosaque, cherche
! Aussitôt, trois s’emparèrent de M. de P.47 le pistolet à la
tête et sur la poitrine en criant : Argent ! Argent !
Comme ils l’entraînaient dans son petit bois, M.
de P. se souvint heureusement, qu’il avait enterré, au milieu, un sac de cinq
cent livres ; il se mit à le déterrer avec les mains, et aussitôt, ils se
jetèrent sur le sac pour se partager ce qu’il contenait.
Pendant ce temps, le pauvre Antoine s’échappa et
courut de toutes ses forces jusqu’à Mespuits48 ; il croit n’avoir mis que dix minutes à
faire ces trois quarts de lieue. Arrivé plus mort que vif, il n’eut que la
force de se jeter dans une grange et crut mourir de peur et d’inquiétude
sur sa famille.
Pendant ce temps, deux (Cosaques) prirent Madame Anne-Ide par les bras et la traînèrent de
chambre en chambre, la tirant sur les genoux, lorsqu’elle tombait. Ils enfoncèrent
huit portes de chambres, brisèrent partout secrétaires, commodes et fauteuils enfin,
|108 à 4 heures, Madame de G.49 et sa fille se jetèrent à leurs genoux et
les prièrent de leur ôter la vie. Le chef prit la tête de Madame de Pillot
dans ses deux mains avec un air de pitié et, d’un seul signe de main, fit
sortir tout son monde.
Les bonnes avaient sauvé les cinq enfants (dont un
de six mois que la mère nourrit) dans un grenier à la Forêt50 ; les autres domestiques
s’étaient sauvés les uns par les fenêtres, les autres par-dessus les murs
du parc.
Ces deux dames étaient restées toutes seules dans
le château ; un paysan, voyant tout leur monde parti, vint leur dire où était leur
famille ; elles furent toutes deux la rejoindre et passèrent la nuit dans
l’enfêtage d’un grenier, qui était si bas qu’elles ne pouvaient être qu’assises
ou à genoux. Elles étaient dix et d’une inquiétude affreuse sur le sort de
Monsieur de P... qui, de son côté, à la faveur de la nuit, rôdait autour
de son château, pour recueillir les débris de sa famille.
Après deux heures d’attente, on lui dit où elle était
; il se cacha de nouveau, et le lendemain, à la pointe du jour, voyant un
peu de calme, il fut chercher tout son monde pour emballer les restes, ce
qui fut bientôt fait et il vint demander l’hospitalité à maman51.
Ce pauvre M. de P. n’a que deux chemises de reste,
un seul habit, et encore si mauvais qu’il faut tous les jours le raccommoder,
Madame de G. que les seuls habits qu’elle avait sur elle. Leur arrivée ici
était une chose affreuse ; tous les enfants pleuraient, les deux dames si
changées que nous ne pouvions les reconnaître ; M. de P. avait un mauvais
pantalon en loques, une blouse si crottée que je ne sais en quoi elle était,
un bonnet de coton et un mouchoir rouge autour du cou.
Ils sont ici depuis six jours et ce n’est qu’aujourd’hui
qu’ils ont commencé à sourire ; on est déjà venu leur dire qu’on est revenu trois
fois recommencer ; excepté le feu, ils n’ont plus rien à craindre !
Le soin que nous nous donnons pour la nourriture
et le logement de 18 personnes fait que, depuis que nous les avons, nous
n’avons presque plus le temps de nous occuper de ce qui se passe dans la
ville, excepté deux ou trois fois par jour où on fait fermer tous les contrevents
et barricader les portes. |109
Nous commençons à nous y faire.
Plusieurs jeunes gens d’ici, voire même Saint Périer52 sont déjà allés
à Paris se présenter et, dit-on, demander des places ; cela se dit à l’oreille,
car personne ne s’en vante.
Quant à mon voyage, comme les motifs d’empêchement
sont les mêmes, quand la Providence le permettra tout cela s’arrangera. Cerny53 pillé M. de Jumillac54 pillé ils sont
allés aujourd’hui quatre mille chez M. de Bizemont55 il est à Paris.
Bénard va beaucoup mieux.
Pendant que je finis cette lettre, on nous dit qu’on
cherche M. de Gaville56
pour le punir d’avoir fait des plaintes contre un qui voulait piller chez
lui : le général lui fit donner tant de coups de corde (au cosaque) qu’il en est mort.
Il est malheureux d’être commandant de la Garde dans
un tel désordre.
Nous venons de recevoir des nouvelles de Louise sa
lettre est datée de St-Dizier, 15 mars, et timbrée de Chateaudun. Elle se porte
bien, elle est toute la famille de Joinville de Saint-Mars ; ils n’ont pas
trop souffert.
Madame de Saint-Mars et toute la famille57 sont toujours près
de Blois, sans étrangers, mais encombrés de prisonniers et de blessés. Et
notre pauvre Abel, quand le reverrons-nous58 ? Je tremble de ne jamais le revoir que
le temps me semble long sans en entendre parler !
Orléans ne s’est rendu qu’aujourd’hui à 9 heures
du matin.
*
* *
Cette lettre, écrite dans un style familier et parfois
même assez incorrect, ne manque pas, cependant, de coloris dans la description.
Elle montre que les habitants d’Étampes eurent vraiment lieu de se plaindre
de la présence des troupes des Alliés, que le génie militaire de Napoléon
ne put empêcher d’ envahir le territoire, malgré l’ admirable campagne de
France, pendant laquelle il déploya, au dire des techniciens, les ressources suprêmes
d’un incomparable talent de tacticien.
Elle montre aussi que les passions politiques de
cette époque troublée n’étaient pas étrangères aux Étampois d’alors, puisque «
plusieurs jeunes gens d’ici » n’attendirent pas l’abdication de l’Empereur
pour aller solliciter des places du nouveau maître qui devait le remplacer.
Dr René de St-Périer.

Portrait de la duchesse
de Berry par Charles Rauch, vers 1827.
17. Le passage de la duchesse
de Berri à Étampes en 1828 «>
Dans un petit livre paru récemment, M. Armand Praviel
évoque la figure romanesque de la duchesse de Berri, et conte avec verve sa
tentative de soulèvement de la Vendée en 1832.
Quatre années auparavant, la veuve du Duc de Berri
avait parcouru déjà ces provinces de l’Ouest. Elle avait fait un voyage triomphal,
acclamée partout par les anciens Chouans. À son retour, elle traversa la
ville d’Étampes. Il n’y avait pas alors de journaux à Étampes, ou du moins
Y Abeille d’Étampes ne publiait guère que des annonces. Mais nous avons entre
les mains une lettre inédite où la jeune Eugénie de Poilloüe de Saint-Périer, âgée
de vingt ans, raconte à sa mère, momentanément absente, les péripéties de
cet événement.
Le 25 septembre 1828, nous apprend le registre des
délibérations du Conseil municipal, M. Boivin-Chevalier, maire d’Étampes,
réunit son Conseil municipal et lui fait connaître qu’il est officiellement
informé du passage de la duchesse de Berri à Étampes, le 2 octobre suivant.
Il invite le Conseil à voter les fonds nécessaires à cette réception. À l’unanimité,
le Conseil décide que « la réception exige des dépenses auxquelles il est urgent
de pourvoir et que ces dépenses doivent être en proportion 59 des solennités
auxquelles donnera lieu le passage de Madame ». En conséquence, il vote la
somme de quatre mille francs pour la journée du 2 octobre.
Suivons maintenant le récit des événements de la
journée, comme les rapporte Eugénie de Saint-Périer. La duchesse de Berri
avait annoncé son arrivée pour onze heures et demie ; dès dix heures, le
vicomte de Saint-Périer et ses filles, Eugénie et Zéphirine, quittent leur
demeure de Valnay, pour se rendre à la Sous-Préfecture. En arrivant à la
côte de Saint-Martin, ils rencontrent M. Dreymuller, lieutenant de gendarmerie,
avec un de ses gendarmes, qui surveille la route d’Orléans par laquelle doit
arriver la Duchesse. Rien n’annonce, dans le faubourg Saint-Martin, un jour
de fête, mais bientôt voici un arc de triomphe « magnifiquement décoré de
couronnes, de trophées et, tout en haut, la tour de Guinette ; au-dessous
de la corniche, il y avait en grosses lettres : « À Madame ». À partir de
l’arc de triomphe, la rue est sablée. Bientôt arrive tout le corps municipal
auquel se joint le vicomte de Saint-Périer. « Le quartier devient très vivant
», les maisons sont décorées de « drapeaux, de draperies charmantes, de,
guirlandes, de bouquets ». Mlles de Saint-Périer s’arrêtent chez
leur cousine, Mlle de Bierville, qui habitait au coin de la rue
Saint-Jacques et de la rue Saint-Mars, dans cette maison dont beaucoup d’Étampois
se souviennent encore d’avoir vu la tourelle d’angle, aujourd’hui démolie.
Là, elles revêtent une toilette de cérémonie, « uniforme pour les demoiselles
», imaginé par la mère d’Eugénie, puis, elles gagnent la Sous-Préfecture,
où se réunissent les jeunes filles qui doivent offrir une corbeille à la
Duchesse ; un officier de la garde nationale « y avait déposé une ode de
sa façon ». Fort curieuses, les jeunes filles prennent connaissance de cette
production littéraire. « On y parle avec grande pompe de la vallée de Tempé,
des bords de la Juine, etc. » Cependant, on discute sur le programme de la réception
; groupera-t-on les jeunes filles sous le péristyle ou les laissera-t-on
au dehors ? Mais le temps est beau et l’on décide de les placer dans la cour
où elles accueilleront la Duchesse qui doit. descendre de voiture à la grande
porte.
Une grande toile cache la remise qui aurait, sans
doute, déparé la belle ordonnance du lieu ; des colonnes garnissent la cour
: au sommet de chacune d’elles s’érige « un beau vase de fleurs et de fort
belles guirlandes » dessinant un C (initiale de Caroline, prénom de la Duchesse).
L’intérieur de la sous-préfecture n’est pas moins orné ; de l’antichambre,
un tapis s’étend jusqu’au péristyle, de grandes tentures bleues pendent aux
murs de la pièce ; une belle glace en décore 1e fond. Dans le billard, sont placées
des chaises et des banquettes où se placent les dames admises à la réception.
Le temps passe, deux alertes vaines trompent l’impatience
de nos jeunes filles qui attendent debout dans la cour : enfin, à midi et
demi un cri s’élève : « Elle est à l’arc de triomphe... le maire la complimente....
là voilà ! » Les trompettes sonnent, des gardes à cheval passent et une calèche
s’arrête. « Au même instant, dit Mlle de Saint-Périer, qui peint
bien l’extrême vivacité de la Duchesse de Berri, une petite dame en bleu
se lève précipitamment, elle est déjà par terre, salue M. du Roure (Sous-Préfet
d’Étampes), sa mère et s’avance. » Mais elle a compté sans l’étiquette des
réceptions officielles : on porte les armes, « trois jeunes personnes font
quelques pas au-devant de Madame : en lui présentant la corbeille, l’une
d’elles porte la parole en ces termes : « Madame, votre présence répand ici
de toutes parts la joie et le bonheur. Le nôtre sera sans égal si V. A. R.
daigne agréer l’hommage de notre respect, de notre amour et le tribut de ces
modestes fleurs. Votre bonté fera de cet instant le plus beau de notre vie
: heureuses d’offrir nos bouquets à la plus noble et à la plus tendre des
mères dans le jour de la plus belle fête, celui qui va la réunir aux plus
augustes enfants. C’est en leur nom que nous supplions V. A. R. (ici on s’embarrasse
un peu) d’agréer nos vœux et nos cœurs. »
À cette harangue pompeuse, la duchesse ne répond
rien ; elle avait entendu tant de ces discours ampoulés, tous conçus dans
le même style conventionnel ! Cependant, remarque Mlle de Saint-Périer,
« elle avait l’air fort contente ». Elle remet la corbeille à sa dame d’honneur
et pénètre dans la Sous-Préfecture « en saluant de tous côtés ». Alors commence
la série des présentations : la Duchesse fait demande « MM. les curés, le Président
(sans doute du tribunal), le Commandant de la Garde nationale à pied et à
cheval, plusieurs dames et quelques demoiselles ». Un des gens de la Duchesse
de Berri vient annoncer « Madame est servie ». Elle prend le bras de son
écuyer et passe dans la salle à manger. Il y avait là 500 hommes de la Garde
à Étampes et leurs officiers faisaient le service intérieur de la Sous-Préfecture.
Un de ces officiers annonce que Madame permet « qu’on circule pendant son
repas. Alors on se presse, on se pousse, personne n’avance plus, pour sortir,
encore moins ». Cependant Mlle de Saint-Périer peut se faufiler
dans cette foule qui regarde le repas de l’héroïne du jour et elle observe
avec soin la disposition de la table. « Madame avait à sa droite le Préfet, venait
ensuite Mme du Roure, un officier, le petit du Roure et à sa gauche
un général grand cordon rouge, en face de Madame sa dame d’honneur, à droite
le Sous-Préfet, à gauche le Maire, ensuite le Président du Tribunal, le Commandant
de la Garde nationale, des officiers de la suite, enfin un couvert de dix-huit personnes.
Le service était fort beau, au milieu une belle corbeille de fleurs, des
ananas, aussi montés sur des corbeilles de fleurs et de beaux fruits dans
des corbeilles de porcelaine dorée. Le service est à l’ancienne mode française
avec des plats exposés sur la table, du saumon, une carpe du lac de Genève
et des spécialités gastronomiques d’Étampes, des écrevisses et des gâteaux
d’amande. » Et voici un portrait, assez vivement tracé, de la Duchesse de
Berri : « Sa toilette était bien négligée : une robe en mousseline bien épaisse
brodée en blanc, un petit col de mousseline, un petit chapeau de moire blanche
garni de blonde avec des fleurs blanches et bleues et là-dessous des cheveux
d’un blond hasardé et en bandeaux, un teint pâle et jaune, beaucoup de blanc
dans des yeux bien clairs et un peu de travers. » Cette description. n’explique
guère l’enthousiasme que la beauté de la Duchesse de Berri provoquait sur
les foules, séduites surtout par sa grâce et son allure décidée.
Après le déjeuner, on revient au salon où les présentations
reprennent. Madame demande le Corps municipal et les dames qu’elle n’a pas
encore vues. Le Vicomte de Viart, maire de Morigny, est là : il est l’auteur
d’un petit ouvrage : Le jardiniste moderne ou traité de l’art des jardins. Ne voulant pas perdre cette belle
occasion de faire valoir son œuvre, qui renferme une description de son parc
de Brunehaut, il en offre un exemplaire à la Duchesse ! Il est probable que
la fougueuse princesse dont l’ âme était plus guerrière que bucolique, n’
ouvrit jamais ce traité d’architecture paysagiste.
Puis, la Duchesse se dispose à partir ; elle dit
au Sous-Préfet qu’elle enverra un souvenir aux jeunes filles qui lui ont
remis une corbeille. Elle monte en voiture ; tout le monde crie de toutes
ses forces : « Vive Madame ! » Toutes les cloches d’Étampes sonnent, à pleine
volée et la voiture s’éloigne au milieu des acclamations.
Le soir, il y eut une représentation au théâtre d’Étampes
; on y chanta des couplets qui ont été imprimés chez Dupré fils, à Étampes.
Nous ignorons l’auteur de cette œuvre poétique où l’on retrouve le ton emphatique
et prétentieux de cette époque de mauvais goût. La musique était de M. Heudier,
ex-chef d’orchestre du théâtre de Madame, mais on pouvait aussi chanter ces
vers sur l’air du Vaudeville de la Robe et des Bottes, bien oublié aujourd’hui :
Le mois dernier, de notre
France Je parcourais les doux climats ;
Mais partout une foule
immense En voyage arrêtait mes pas ;
Un jour, entre des fleurs
écloses,
Ma voiture s ’embarrassa
:
— D ’où venaient ces lis et ces roses ?
— Caroline passait par là !
Ce matin, dans ces murs,
j ’arrive ;
Et dans mon cœur ému,
je sens,
Bientôt, d’une joie expansive,
Pénétrer les touchans
élans,
Longtemps encore de tant
d’ivresse Cette ville retentira :
— D ’où -venaient ces chants d’allégresse ?
— Caroline passait par là !
Des vieux soutiens de
la patrie,
Sur son passage rassemblés,
J’ai vu, malgré la maladie,
Agir les membres mutilés.
Un médecin, pour leurs
blessures,
A-t-il trouvé ce baume-là
?
— À qui doit-on ces belles cures ?
— Caroline passait par là !
Nos discordes sont étouffées
:
J’ai vu, sous un même
drapeau,
Nos soldats unir les
trophées D’Arcole et du Trocadéro.
— Parmi ces guerriers magnanimes,
Devant qui l’Europe trembla,
Pourquoi ces transports
unanimes ?
— Caroline passait par là !
Ô toi dont la bonté console,
Et l’indigence et le
malheur,
Caroline prends pour
boussole Nos vœux, notre amour et ton cœur.
Tu vois l’effet de ta
présence !
Heureux le jour où l’on
dira Dans tous les hameaux de la France :
Caroline a passé par
là !
Moins de deux ans après ces événements, la Révolution
de juillet éclatait. Après les « trois Glorieuses », Charles X abdiquait
ainsi que son fils et prenait le chemin de l’exil, rejoint bientôt par la
Duchesse de Berri qui avait vainement cherché à faire reconnaître son fils
par le peuple comme héritier du trône. En 1832, elle débarquait près de Marseille,
gagnait la Vendée, après avoir inutilement tenté de soulever le Midi et,
cachée dans le bocage vendéen, lançait des proclamations enflammées avant d’être
capturée à Nantes derrière une cheminée où elle se dissimulait.
Le pays n’avait pas répondu à son appel et il ne
serait resté de cette aventure qu’un souvenir assez comique si |2
les combats du Chêne et surtout la terrible attaque de la Pénissière n’avaient tristement
rappelé les exploits de la Chouannerie où tant d’héroïsme, d’abnégation et
de sacrifices furent prodigués de part et d’autre dans une guerre impie entre
Français.
R. de Saint-Périer.

Tombe de deux victimes
du choléra de 1849 au cimetière Saint-Gilles d’Étampes
18. Le choléra à Étampes en
1832 et en 1849 1
La terrible épidémie de choléra qui désole l’Égypte
depuis deux mois rappelle tristement que ce mal, parti de l’Inde où il existe
à l’ état endémique, ravagea bien des fois le continent européen. Notre ville
elle-même en subit pendant la première moitié du XIXe siècle deux
atteintes cruelles, que nous voudrions évoquer d’après une brochure publiée
en 1851, par le Dr Bourgeois, qui exerça la médecine à Étampes
pendant plus de cinquante ans.
L’épidémie sévissait à Paris, où elle causa des pertes
considérables dans toutes les classes de la société. On sait que Casimir
Perier, alors président du Conseil, en mourut après avoir contracté le mal
au cours de ses visites dans les hôpitaux parisiens encombrés de malades.
Le choléra se déclara à Étampes le 20 avril 1832 chez un homme venant de
Paris, où l’épidémie avait débuté à la fin de mars. Il s’étendit progressivement
à toute la ville et à trente-trois communes environnantes, mais dans des conditions
fort diverses. Du 9 au 17 mai, on notait 131 cas et 35 morts par jour, puis,
pendant trois semaines, il décrut, n’amenant plus que trois à quatre morts
quotidiennes. Quelques communes connurent de véritables désastres comme le
petit village de Thionville qui eut 32 malades et 14 décès ; Milly, au contraire, avec
2 000 habitants, n’eut que six cas et quatre décès. Sur les 60 41 000 habitants
que comptait alors l’arrondissement d’Étampes, il y eut 1 838 cas de choléra
et 713 décès.
En 1849, l’épidémie débuta également vers la fin
d’avril, venant encore de Paris, par un premier cas à Étréchy. Au milieu du
mois de juin, il y avait de cinq à vingt-quatre décès par jour. L’épidémie
s’éteignit en automne comme en 1832. Il y eut 913 cas et 547 morts.
On explique maintenant cette apparition du choléra
au cours du printemps ou de l’été et sa disparition dans nos régions à l’automne
par le rôle des mouches qui transmettent la contagion en se posant sur les
déjections des cholériques, puis, sur les aliments de la population. Les
mouches disparaissant chez nous dès l’automne ne servent plus de vecteurs
à la maladie. Mais, au moment des deux épidémies dont nous parlons, on ignorait
tout des causes du choléra, de sa transmission et de son traitement. Ce n’est
qu’en 1883, à la suite des découvertes de Pasteur sur le rôle des micro-organismes
dans les maladies infectieuses, que le médecin allemand Koch découvrit le
vibrion, agent pathogène du choléra dans un fragment d’intestin de cholérique
qui lui avait été envoyé des Indes. Aussi, ne faut-il pas s’étonner que le
Dr Bourgeois, avec beaucoup de ténacité, recherche les causes
de l’épidémie et les fasse remonter à des conditions qui, aujourd’hui, nous
semblent bien étrangères à ce mal. Cependant, il observe avec justesse que
les cas sont plus fréquents dans les vallées arrosées par les rivières, ce
que nous expliquons aujourd’hui par la contamination des eaux où vit le vibrion cholérique,
mais qui, à cette époque, était attribué à la plus grande humidité de l’atmosphère
dans ces régions. Il invoque ensuite les « miasmes », le génie épidémique,
l’air confiné, l’alimentation insuffisante, l’insalubrité des logements,
etc. Il pose même la question de savoir si le choléra est contagieux. Nous
devons noter à sa louange qu’il résout la question par l’affirmative, malgré
la tendance médicale alors généralement contraire, car il remarque que les
personnes les plus frappées sont celles qui sont en contact avec les malades
ou les cadavres, comme les fossoyeurs, les officiers d’église ou les garde-malades.
L’ignorance où l’on était des causes du choléra en
rendait le traitement fort incertain. En 1832, sous l’influence des idées
de Broussais qui avait voulu faire revivre les traitements classiques antérieurs
à la Révolution, on saignait abondamment les malades et on leur mettait des
sangsues. Le simple bon sens eût dû leur faire proscrire ce traitement, car
il était évident qu’en soustrayant du sang à des malades que leur affection
elle-même privait dangereusement de ce liquide organique, on ne pouvait que
hâter leur mort. Le Dr Bourgeois observe d’ailleurs l’inefficacité
de ce traitement, comme la plupart de ceux que l’ on appliquait. En 1849,
les idées de Broussais s’estompant dans la brume des théories désuètes, on
renonce à la saignée. On emploie alors des remèdes anodins : eau de riz,
opiacés à faible dose, boissons abondantes, qui avaient au moins l’avantage
de désaltérer les malades toujours torturés par une soif inextinguible et
l’on attendait que la nature eût vaincu un mal que la science des hommes
ne pouvait atteindre. On insistait sur le régime alimentaire qui devait mettre
à l’abri de la maladie. Ce régime qui passait alors pour léger semblerait
aujourd’hui, en raison de nos restrictions, particulièrement substantiel.
En effet, on devait « se nourrir simultanément de viandes faites et de viandes blanches,
de gibier, de poisson, arrangés le plus simplement, rôtis, grillés ou bouillis
par conséquent ; de légumes herbacés, accommodés au jus ou au beurre, d’œufs,
surtout mollets, et, suivant la saison, de fruits crus bien mûrs, légèrement
acidulés, comme la cerise, le raisin chasselas, les pêches, surtout au vin. On
pouvait y substituer des compotes de pommes ou de poires et des conserves
bien préparées. Aux repas, des vins vieux de
Bourgogne ou de Bordeaux. Ensuite, une tasse de café
noir, de préférence au thé, ou même un petit verre de liqueur douce chez les
personnes habituées à ce genre de boisson ». Combien d’Étampois de nos jours,
sans redouter le choléra, se contenteraient de ce régime !
Le Dr Bourgeois avait observé très justement
que les atteintes légères du choléra mettaient à l’ abri des formes graves
et que, en quelque manière, l’épidémie s’éteignait d’elle-même. Cette immunité,
dont nous connaissons maintenant les causes humorales, lui donnait à penser
avec raison que la nature agit souvent mieux que la médecine et il écrit
cette phrase remarquable pour son temps : « Comme à l’époque où les rubéfiants
furent employés, il mourait beaucoup moins de malades, le public en fit honneur
à notre expérience. Mais hélas ! Vanité des vanités ! Cela tenait tout simplement
à la diminution du fléau. »
Si la médecine officielle connaissait peu de remèdes,
l’ imagination populaire en inventait plus d’ un : le camphre et l’ail se
disputaient la propriété de conjurer le mal. On portait sur soi des cachets
de camphre, on en mettait dans sa maison, dans sa chambre. Quant à l’ail,
« on en était partout infecté », nous dit le Dr Bourgeois, chacun
en avait dans sa poche et en farcissait ses aliments ». On faisait des fumigations
de chlore, de vinaigre-des-quatre-voleurs, à base de treize essences aromatiques,
ainsi appelé depuis le XVIIIe siècle parce que quatre bandits
de Marseille, lors de la grande peste de 1720, l’avaient employé pour eux
afin de pouvoir dévaliser les pestiférés sans risque de contagion. Les rues
de la ville étaient obstruées par de grands feux qui brûlaient nuit et jour,
entretenus avec des genévriers qu’on allait chercher dans les bois ou sur
les pentes de nos coteaux où ils sont nombreux, parce que leur fumée âcre
devait dissiper les miasmes du mal. Enfin, un grand nombre d’individus portaient
au cou, en guise d’amulette, un tube de plume rempli de mercure et cousu
dans un petit morceau de drap écarlate. On recommandait d’éviter toute cause
de tristesse, de se détourner des convois mortuaires, afin de ne pas augmenter
la dépression morale qui pouvait être une cause d’atteinte du mal, précaution dont
le Dr Bourgeois, sans en nier le principe, trouve fort exagérée.
Enfin, il n’est pas jusqu’à la politique qui n’ait eu sa part dans le bouleversement
bien naturel amené par l’extension du fléau. Dans les milieux opposés au
gouvernement et parmi les gens évidemment non instruits, on affectait de
nier l’existence de l’épidémie et de considérer que « c’était une invention
des dirigeants qui employaient des moyens criminels pour se débarrasser des
pauvres gens trop nombreux ». Cependant, cette opinion n’eut pas longtemps
créance en présence des faits qui parlaient, hélas ! d’eux-mêmes et leur
redoutable réalité s’imposa bientôt à tous.
Le rythme de la vie à Étampes avait subi, du fait
de l’épidémie, de profondes modifications : les quelques établissements industriels
de notre cité étaient fermés. Les rues étaient sillonnées de files de cercueils
que l’on portait à bras au cimetière, sans chantre, ni sonnerie de cloches,
le plus souvent un prêtre seul les accompagnait. Beaucoup de maisons étaient constamment
fermées et les habitants se tenaient loin des rues, comme si la maladie et
la mort en provenaient. On n’entendait que le roulement des voitures qui
conduisaient les médecins. La Faculté de médecine de Paris avait envoyé,
sur la demande des autorités de la ville, quatre « élèves en médecine » pour
seconder les praticiens d’Étampes et beaucoup de personnes charitables de la
ville avaient mis leurs voitures à la disposition des médecins pour qu’ils
puissent se rendre plus rapidement auprès des malades.
Si l’Égypte offre actuellement des spectacles aussi
poignants, elle le doit certainement à la résistance opposée par ses populations
rurales à la vaccination préventive. Les travaux du médecin russe Haffkine
et de nombreux autres chercheurs ont abouti, en effet, à la préparation d’
un vaccin dont l’ efficacité n’est pas douteuse et grâce auquel nous pouvons
espérer que le choléra, cette fois, ne parviendra pas jusqu’en Europe.
Mais la folie des hommes n’est pas moindre que leur
science : l’une les délivre de fléaux redoutables, l’autre les recherche
pour détruire ce qui pouvait être enfin sauvegardé. C’est ainsi que la guerre
bactériologique, dont la préparation est activement poussée, répandra peut-être
sur l’humanité des germes si virulents qu’aucun remède ne pourra plus en
neutraliser les effets.
R. de Saint-Périer
169

La rivière des Prés à
Étampes en 2004
19. Une inondation à Étampes
en 1841
L’année qui vient de s’écouler61 62 aura connu de graves inondations, dont eurent
surtout à souffrir les régions qu’arrosent la Garonne et ses affluents, et
aussi le bassin sous-pyrénéen, envahi par les gaves torrentueux tributaires
de l’Adour.
Si notre pays, grâce à son sol perméable, à ses rivières
paisibles, que gonfle rarement la fonte de neiges abondantes, n’a point éprouvé
de semblables désastres, il subit néanmoins, à de rares intervalles, la fureur
des eaux sauvages, pour employer l’expression des géologues.
Sans rappeler les débordements des années 1513, 1626,
1635, dont Pierre Plisson, dans sa Rapsodie, nous a
conservé le souvenir, il suffit de remonter à moins d’un siècle pour trouver trace
d’inondations dans le plaisant val que Clément Marot comparait à la vallée
de Tempé. En effet, en 1840, et surtout en 1841, nous dit Léon Marquis, d’après
Y Abeille d’Étampes de ces deux années, la Chalouette envahit la ville, forçant
les habitants à se réfugier aux étages supérieurs de leurs maisons et les contraignant
à utiliser des bateaux pour sortir. Un postillon, ayant mené ses chevaux
boire à l’abreuvoir Saint-Gilles, s’avança trop loin et, entraîné par le
torrent, failli être noyé tandis qu’un de ses chevaux était emporté. Il semble,
d’après le récit de l’Abeille, que l’
inondation fut provoquée d’ une manière un peu particulière. La fonte rapide
des neiges, due à un adoucissement brusque des températures, au début de
janvier 1841, avait créé, sur le plateau au sud-ouest d’Étampes, une vaste
nappe d’eau qui fut maintenue d’abord par le remblai de la route de Dourdan
à Angerville. Ce fait peut s’expliquer par une gelée prolongée qui aurait
durci le sol, ne lui permettant plus d’absorber au fur et à mesure l’eau
de fusion des neiges. Le remblai qui retenait les eaux s’étant rompu, la
masse d’eau s’écoula dans la vallée de Chalo-Saint-Mars et transforma la
Chalouette, au cours d’ordinaire si paresseux, en un torrent impétueux qui
envahit la ville.
Nous avons de cet événement un récit inédit, qu’il
nous paraît de quelque intérêt de signaler. C’est une lettre d’Auguste-Jean-Baptiste
de Poilloüe, comte de Bonnevaux, qui faillit lui-même être victime de l’inondation.
Il écrivait cette missive à l’une de ses parentes, mal remis encore de l’émotion
qu’il avait éprouvée. M. de Bonnevaux devrait être connu de tous les Étampois,
car ce fut un des bienfaiteurs de notre ville. Il lui laissa, en effet, toute sa
bibliothèque et les terrains sur lesquels furent établis le jardin Guettard
et l’allée de Bonnevaux. En lui s’éteignit, en 1862, la branche aînée des
Poilloüe. Alors âgé de 62 ans, il habitait une petite maison, qui existe
encore sur la Promenade des Prés. Sa paisible existence fut bien troublée
dans la nuit du 11 janvier 1841. « En effet, raconte-t-il, la Juine, le Juineteau,
Louette et Chalouette ayant débordé et réuni leurs eaux, ne formèrent plus qu’un
lac effrayant par sa largeur et sa rapidité. L’eau se faisait passage au
travers d’un mur qui devait me garantir et entra par les soupiraux des celliers
à trois pieds de haut ; obligé à 2 heures du matin d’ouvrir la porte du jardin
pour donner passage à l’eau, je me suis trouvé séparé de ma maison par un
courant semblable à celui d’une écluse de moulin et que je n’ai pu franchir
que très difficilement. La rue Saint-Pierre a failli disparaître ! »
Il dut y avoir cette année-là des inondations en
d’autres régions, car M. de Bonnevaux nous apprend qu’une collecte pour les inondés
du Rhône avait été faite à Étampes. Mais, heureusement, ajoute-t-il, elle
n’ était pas encore partie et « M. le Maire l’ a retenue pour ses administrés,
disant que charité bien ordonnée commence par soi-même ! »
Enfin, nous savons par M. de Bonnevaux qu’il y eut
une victime à Étampes : un vannier qui périt noyé, mais encore trouva-t-on,
« l’ayant ouvert », qu’il y avait plus de vin que d’eau dans son estomac.
Cette fin lamentable du pauvre vannier nous montre donc — ce sera la moralité
de ce récit — que si la tempérance est une vertu toujours recommandable,
elle devient une impérieuse nécessité en temps d’inondation.
R. de Saint-Périer.

Statue d’Étienne Geoffroy
Saint-Hilaire par Élias Robert à Étampes
20. À propos de Geoffroy-Saint-Hilaire«
Une simple erreur typographique a fait imprimer dans
le dernier numéro du Journal d’Étampes, qu’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, dont la statue, place
du Théâtre, vient d’être heureusement restaurée, était mort en 1884. Le grand
savant, dont s’honore notre ville, né à Étampes, le 15 avril 1772, d’une famille
originaire de Troyes, mais établie à Étampes depuis 1720, s’éteignit à Paris,
à l’âge de 72 ans, le 18 juin 1844.
Rappelons, à ce sujet, que la ville d’Étampes ne
voulut pas être ingrate envers le plus glorieux de ses fils : une cérémonie commémorative
du centenaire de sa mort avait été organisée à Étampes, au mois de juin 1944.
L’Académie des Sciences, dont Geoffroy Saint-Hilaire fit partie, se proposait
d’envoyer un délégué qui devait se joindre à des représentants de diverses organisations
scientifiques pour honorer dans une séance solennelle, en notre ville, la
mémoire du savant professeur au Muséum d’Histoire naturelle. On sait ce qui
advint dans la nuit du 9 au 10 juin 194463 64 et ainsi le projet dut être abandonné.
Mais le souvenir de Geoffroy Saint-Hilaire n’est
pas perdu dans sa ville natale et quelques-uns de nos concitoyens savent certainement,
par les ouvrages de l’époque, l’ardente curiosité qui enflammait tout le
monde savant, en 1830, au moment de la
grande controverse entre Geoffroy Saint-Hilaire et
Cuvier. Les idées transformistes du génial Lamarck, mort peu de temps auparavant,
aveugle, pauvre et méconnu, trouvèrent en Geoffroy Saint-Hilaire le plus
averti et le plus courageux des défenseurs, contre l’illustre secrétaire
perpétuel de l’Académie des Sciences, Cuvier. L’avenir devait donner raison
à Lamarck et à Geoffroy Saint-Hilaire et réaliser ainsi l’émouvante prophétie
de la fille de Lamarck : « Mon père, la postérité vous vengera. » Ce débat scientifique
passionnait tous les esprits cultivés de l’Europe, au point que le grand
Gœthe demandait un jour à un voyageur revenant de France : « Que se passe-t-il
à Paris ? » Son interlocuteur lui répondant : « Le roi a rendu une
ordonnance... », Gœthe l’interrompit impatiemment
: « Il s’agit bien du roi. je veux savoir où en est la discussion entre Geoffroy
Saint-Hilaire et Cuvier. »
Peu d’ hommes ont mérité par leurs travaux et au
cours même de leur vie un intérêt et une curiosité aussi vastes et aussi désintéressés.
C’est un honneur inoubliable pour notre petite cité que de compter une semblable
valeur intellectuelle parmi ses enfants.
R. de Saint-Périer.
177
Credits photographiques
Logo du Corpus Étampois dessiné par Gaëtan Ader.
— Ex-libris du comte de Saint-Périer, p. 1. — Archives des Saint-Périer aux
AD91, cote 76J 17 (cliché de Bernard Métivier), p. 6 — Gravure de Jules Lepoint-Duclos
(1938), pp. 8 et 116. — Illustrations reprises des éditions originales de
ces articles, pp. 8, 23, 30, 48, 51, 93, 94, 96, 97, 98, 116. — Gravure d’Auguste Hoyau,
p. 30 — Catalogue en ligne Millon pour la vente à Drouot du 26 juin 2013,
p. 40. — Détail d’un cliché fait au Musée intercommunal d’Étampes et emprunté
de l’ouvrage Étampes,
un canton entre Beauce et Hurepoix (1999, p.
154), p. 52. — Wikicommons, pp. 58 (planche de l’Encyclopédie), 69, 84, 138, 152.
— Scan et collection de Bernard Gineste, p. 62. — Clichés de Bernard Gineste,
pp. 70 (avec remerciements au personnel du Musée de l’Étampois), 78, 130,
162, 170, 174. — Corpus Étampois (emprunts anciens à des sites internet non
identifiés), pp.75a, 75b, 76a, 76b. — Gravure de Charles-Étienne Gaucher (Wikicommons),
p. 86. — Cliché et carte postale d’Eugène Rameau, p. 100. — Scans par Jean-Michel
Rousseau de cartes postales anciennes de Paul Allorge, pp. 104, 110a, 110b.
— New York Public Libray (dessin de Shadow), p. 144.
Table
des Matières
|
Préface
|
3
|
|
Bibliographie
|
4-7
|
|
01
|
Le XVIIIe siècle (1938)
|
8-28
|
|
02
|
Gentilshommes de Beauce (1932-1933)
|
30-39
|
|
03
|
Les Dépenses d’un gentilhomme étampois
|
|
|
au XVIIIe siècle (1919)
|
40-47
|
|
04
|
Une ancienne vue de Mesnil-Girault
|
|
|
(1929)
|
48-51
|
|
05
|
La première pompe à incendie à
|
|
|
Étampes (1950)
|
52-57
|
|
06
|
La Police municipale à Étampes en 1779
|
|
|
(1923)
|
58-61
|
|
07
|
Le chien pêcheur des Cordeliers
|
|
|
d’Étampes (1928)
|
62-69
|
|
08
|
Les Plantes des Environs d’Étampes au
|
|
|
XVIIIe siècle (1924)
|
70-76
|
|
09
|
Jean Guettard (1965)
|
78-85
|
|
10
|
Malesherbes botaniste (1938)
|
86-99
|
|
11
|
Le Temple de Jeurres (1948)
|
100-103
|
|
12
|
Le Gué des Sarrasins (1945)
|
104-109
|
|
13
|
La Juine navigable (146)
|
110-114
|
|
14
|
La Révolution et le XIXe siècle
(1938)
|
116-138
|
|
15
|
Le premier musée d’Étampes (1961)
|
140-143
|
|
16
|
Les Cosaques à Étampes en 1814 et le pillage
du château de Bois-Herpin (1933)
|
144-153
|
|
17
|
Le passage de la duchesse de Berri à Étampes
en 1828 (1926)
|
154-161
|
|
18
|
Le choléra à Étampes en 1832 et en 1849 (1947)
|
162-168
|
|
19
|
Une inondation à Étampes en 1841 (1931)
|
170-173
|
|
20
|
À propos de Geoffroy-Saint-Hilaire (1948)
|
174-176
|
|
Crédits photographiques
|
178
|
|
Table des matières
|
179-180
|
Le monde des Saint-Périer
— tome 6 LE SUD-ESSONNE DE 1700 À 1870
Préface.—Bibliographie.—01. Le XVIIIe
siècle.
— 02. Gentilshommes de Beauce. — 03. Les Dépenses
d’un gentilhomme étampois au XVIIIe siècle. — 04. Une ancienne
vue de Mesnil-Girault. — 05. La première pompe à incendie a Étampes.—06.
La Police municipale à Étampes en 1779. — 07. Le chien pêcheur des Cordeliers d’Étampes.
— 08. Les Plantes des Environs d’Étampes au XVIIIe siècle.—09.
Jean Guettard.
— 10. Malesherbes botaniste. — 11. Le Temple de
Jeurres.—12. Le Gué des Sarrasins.—13. La Juine navigable. — 14. La Révolution
et le XIXe siècle. — 15. Le premier musée d’Étampes. — 16. Les
Cosaques à Étampes en 1814 et le pillage du château de Bois-Herpin.—17. Le
passage de la duchesse de Berri à Étampes en 1828. —
18. Le choléra à Étampes en 1832 et en 1849. —
19. une inondation à Étampes en 1841. — 20. À propos
de Geoffroy-Saint-Hilaire.
1
La réédition
de 1965 supprime la fin de ce paragraphe : elle aurait pu tailler ailleurs.
2
66 La réédition
de 1965 abrège la suite ainsi : « et passèrent, par acquisitions successives,
entre les mains de diverses familles.
« En 1721, c’est Louis-Guy
de Valori qui devint etc. »
3
La réédition
de 1965 supprime ces quatre derniers mots.
4
Réédition
de 1965 : « ayant fait..., il avait etc. ».
5
La réédition
de 1965 met ces onze derniers mots entre guillemets.
6
La réédition
de 1965 supprime « en 1774 ».
7
La réédition
de 1965 supprime cette figure.
8
Le Beauceron de Paris 35/4 (juin-octobre 1932), pp.
37-38 ; 35/5 (15 décembre 1932), pp. 48-49 ; 36/2 (avril-juin 1933), pp.
5-7 (saisie de Bernard Métivier, 2017).
9
L’Abeille d’Étampes - Le Réveil
d’Étampes. Édition spéciale 5/259 (3 mai 1919), pp. 1-2, sous la rubrique
« Variété historique » (saisie de Bernard Métivier, 2017).
10
En 1919.
11
Le texte de
l’Abeille porte ici par erreur « 1576 ».
12
Bulletin de la Société des Amis
du musée d’Étampes
7 (1925-1929), pp. 47-49 (saisie de Bernard Gineste, 2017).
13
Archives
de Seine-et-Oise, série E.
14
Maxime
Legrand, Étampes
pittoresque.
15
Léon Marquis,
Étampes et ses environs, p. 176.
16
L'Abeille d’Étampes 115/50 (8 décembre 1923), p.
1.
17
Le Journal de Seine-et-Oise 252 (26 janvier 1950), p. 3,
et 254 (9 février 1950), p. 3 (saisie de Bernard Métivier, 2017).
18
L’Abeille d’Étampes 117/32 (11 août 1928), pp. 1-2,
sous la rubrique : « Bibliographie étampoise ». — Tiré à part (in-18 ; 6
p., avec un fac-similé), Étampes, Terrier, 1929 (saisie de B. M.).
19
L ’Abeille d’Étampes 113/5 (2 février 1924), p. 1.
20
décembre 1923 R. de Saint-Périer
21
Bulletin des Amis d’Étampes 12 (1965), pp. 9-13.
22
Henri Gachet,
« Botanique et papeterie, J.E. Guettard, 1715-1786 » [aliter : « Botanik
und Papierfabrikation. Jean Etienne Guettard 17151786 »], in Papier Geschichte [Mainz] 14/3-4 (1964), pp. 23-28
[B.G., 2013].
23
Les moulins
à papier de Lardy, près d’Étampes, sont déjà mentionnés dans un arrêt du
Parlement de Paris du 15 mars 1538 (Renseignement donné par M. Henri Gachet).
Maxime Legrand (Étampespittoresque, III, Étampes, Dormann, 1907,
p. 1137) ignore l’existence de ces moulins de 1538. Il cite seulement à propos
du moulin des Scelles, dans le domaine des Pastoureaux, à Lardy, qu’il fut
vendu en 1792 à un M. Morel qui de concert avec un sieur Vinchon, y établit
une papeterie. Il fait une erreur en ajoutant
: L ’industrie date
de cette époque, puisque
l’arrêt du Parlement prouve l’existence de moulins à papier en 1538. Cette
papeterie fait place dès 1827 à une passementerie, d’après Maxime Legrand.
La Mairie de Lardy, que nous avons consultée, n’a connaissance ni de la papeterie
de 1538, ni de celle de 1792 et il n’en existe pas actuellement (note de
1965). [Il y a là une étourderie soit d’Henri Gachet ou bien de la comtesse,
car l’arrêt en question ne fait aucune allusion à des moulins papetiers situés
à Lardy, mais seulement à du papier fabriqué à Étampes même, comme le notait
déjà Henri Stein en 1894 (Annales du Gâtinais 12, pp. 346-347) ; aussi l’erreur
ici imputée à Maxime Legrand est-elle purement imaginaire (B.G.)].
24
Nous ne saurions
trop remercier M. Henri Gachet d’avoir bien voulu nous communiquer ses deux
précieux articles, qui ont grandement étendu nos connaissances sur l’œuvre
de Guettard, et de nous avoir autorisée à en reproduire des extraits (note
de 1965).
25
Annales de la Société Historique
et Archéologique du Gâtinais 44 (1938), pp. 1-6 (corrigée manuellement en
1939) (saisie de Bernard Métivier, 2017).
26
Mémoires d'outre-tombe. Paris, Legrand, s. d., I, p.
325.
27
Bulletin de la Commission des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, n° 52 (1945-1948), 1950, p. 113-115 (saisie de
B. M., 2017).
28
Bull. de la Com. des Ant. et
des Arts de S. et O., XIV-XVI, p. 19.
29
Communiquée
par notre cousin le Cte de Rélly, descendant de la Marquise d’Oysonville.
30
Étampespittoresque, l’arrondissement, p. 868.
31
Le Journal d’Étampes (3 novembre 1945), p. 1 (saisie
de B. M., 2017). [N.B. : Cette étude sur le nom d’un pont morignacois au
XVIIIe siècle est viciée par la méconnaissance d’un élément essentiel
de la science toponymique, à savoir qu’il faut toujours, à mon sens, favoriser
l’hypothèse d’une origine patronymique des microtoponymes, presque toujours
avérée lorsque la vérification en est possible. Or Sarrasin est bien attesté ici comme nom
de famille (B. G.)].
32
Le Journal d’Étampes 2/91 (21 décembre 1946), p. 2,
sous la rubrique « Étampes dans le passé ».
33
On reproduit
ici le chapitre V de La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire
de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 71-83. Réédition in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 5 (janvier 1966), pp. 13-16.
34
était le fils du célèbre banquier, le marquis de
Laborde, d’origine espagnole, célèbre par sa grande fortune, mais aussi par son
inépuisable bienfaisance, qui avait acheté le château de Méréville, où il
fit des travaux et des embellissements considérables. Le député était garde
du trésor royal et il avait une grande compétence en matière financière.
Il siègera plus tard à la Constituante.
35
Bulletin de la Société des Amis
d’Étampes et de sa région 11 (1961), pp. 30-31.
36
Soit 216,
5 cm sur 127 (B.G.).
37
Soit 16
cm (B.G.).
38
Soit 240
cm sur 176 (B.G.).
39
Soit 13,
5 cm (B.G.).
40
Épisode
final du livre biblique de Tobie, représenté par exemple par la toile d’Eustache
Lesueur conservée au Louvre dont nous avons donné ci-dessus une reproduction
(B. G.).
41
Conférence des Sociétés savantes,
littéraires et artistiques du département de Seine-et-Oise (1933), pp. 103-106.
42
L. Marquis.
Les rues d’Étampes. Étampes. Brière 1880, in-8° p.
37.
43
Le Château
de Brunehaut, à 4 kil. d’Étampes, sur la commune de Morigny, appartenait
alors à la famille de Viart.
44
Marbot
(Mémoires du G1
Bon deMarbot. Paris. Pion 1891, in-8°. T. 5, p. 322) raconte
que les Baskirs n’étaient armés que de flèches qu’ils lançaient paraboliquement,
parce qu’étant totalement irréguliers, ils ne savaient pas se former en rangs,
et marchaient tumultueusement, comme un troupeau de moutons. Cette méthode
de tir était due au désordre de ces cavaliers qui ne pouvaient tirer horizontalement
devant eux, sans tuer ou blesser ceux de leurs
45
camarades qui les précédaient.
Ces flèches étaient fort peu meurtrières Marbot ne cite qu’un cas de mort
dans son régiment assailli par les Baskirs, à la bataille de Leipzig et,
atteint lui-même par une flèche de 4 pieds de long, Il n’en fut que légèrement
blessé.
46
Bois-Herpin,
canton de Méréville, à 10 kil. d’Étampes, comptait 98 habitants en 1812 (Annuaire de Seine-et-Oise).
47
Antoine-Joseph-Judith-Dorothée
Ferrier de Pillot, né à Ornans (Doubs) le 26 mars 1773, épousa à Bois-Herpin,
le 10 novembre 1801, Anne-Ide Le Roy de Grandmaison, née à Bois-Herpin le
2 septembre 1774, fille d’Auguste-Thomas Le Roy de Grandmaison, lieutenant-général
des armées, décédé, et de Marie-Madeleine Perrault de Lessart. Anne-Ide de Grandmaison
était petite-nièce et filleule de Joseph-François Foullon, conseiller d’État
et Intendant des Finances, massacré à Paris par le peuple, le 22 juillet
1789, ainsi que son gendre Bertier. (Voir Ch. Forteau. Les Registres paroissiaux du
Canton de Méréville. Champion 1910, in-4°, p. 100).
48
Mespuits,
commune du canton de Milly, à 13 kil. d’Étampes.
49
Madame
de Grandmaison était alors âgée de 77 ans (Ch. Forteau, loc. cit. )
50
La Forêt-Ste-Croix,
canton de Méréville, à 9 kil. d’Étampes.
51
Mme
de Bonnevaux habitait Étampes, probablement rue Saint-Mars (M. Legrand, Étampes pittoresque. Étampes. Humbert-Droz, 1902,
in-8°, page 140).
52
Auguste de
Poilloue, comte de Saint-Périer, né à Étampes le 5 janvier 1787, septième
enfant de César-Joachim de Poilloue de St-Périer et de Marie-Geneviève
de Bouraine, fut nommé, dès le 15 avril 1814, brigadier-fourrier au 2e
escadron de la Garde nationale à cheval de Paris, constituée le 31 mars
1814, pour former provisoirement
la garde du roi Louis XVIII. Il entra dans les gardes du corps du Roi, avec
rang de lieutenant, le 16 juin 1814. Maréchal des logis, rang de capitaine
de cavalerie, aux gardes du corps de Monsieur, Comte d’Artois, le 15 juillet
1814.
Au moment des Cent-Jours,
il revint à Étampes, où il reçut, le 3 mai 1815, un ordre d’éloignement du
Sous-Préfet d’Étampes, en exécution du décret impérial du 23 mars 1815. Il
était invité à s’éloigner de Paris à la distance de 30 lieues mais cette
mesure pouvait être modifiée et il était autorisé à demeurer dans son domicile
ordinaire, à la condition de prêter serment à l’Empereur et de donner des
garanties sur sa conduite ultérieure.
II ne semble pas qu’il
se soit conformé à cette mesure, car le 30 décembre
1815, il reçut un certificat
du Sous-Préfet constatant « qu’il n’a point prêté le serment de fidélité
à Napoléon Bonaparte, lors de l’interrègne, et que son attachement bien sincère
pour le Roi et son auguste famille n’a jamais varié ».
Ce certificat est signé
par le Sous-Préfet d’Étampes Bouraine et porte les signatures suivantes que
nous reproduisons, à titre documentaire :
Le Maire d’Étampes, maréchal
de camp, Chevalier de St Louis et de la Légion d’honneur Romanet,
le Mis de Talaru, pair de France, De Tarragon, chevalier de St
Louis, Leroy, chevalier de St Louis, Poilloue de Bierville, chevalier
de St Louis, le Chev. de Salvert-Mont-Roignon, chevalier de St Louis,
le Chev, De la Borde, chevalier de St Louis, Gaville, chevalier
de St Louis, Laurent de St Julien, chevalier de St
Louis.
53
Cerny,
canton de la Ferté-Alais, comprenait en 1789 trois fiefs Cerny en partie
et Villiers qui appartenaient au comte de Selve et Presle qui appartenait au
vicomte de Mauroy. (M. Legrand et L. Marquis, Les trois états du bailliage
d’Étampes aux États généraux, Étampes, Brière, 1802, in-8°, page 96).
54
Henri-François-Joseph
Chapelle, baron de Jumillac, possédait en 1789, le château de Guigneville,
canton de la Ferté-Alais, à 18 kil. d’Étampes.
55
Nous trouvons
plusieurs membres de cette famille dans le bailliage, en 1789 à Champcueil
(fief du Buisson), à Champmotteux (fief de Vignay), à Gironville-sous-Buno
et à Tignonville.
56
Un membre
de cette famille d’Étampes, Eugène de Gaville, fils de N... Picard de Gaville
et de N... de Mirebeau, a publié un volume de poésies : Les Soirs. Paris, H. Fournier, 1834, in-8°.
57
Il s’agit,
sans doute, d’Antoinette de Chavannes, fille de Jacques de Chavannes, conseiller
au Parlement de Paris, née à Paris le 1er septembre 1759, qui
épousa le 17 octobre 1774, Jacques Auguste de Poilloue, marquis de St-Mars,
officier aux Gardes Françaises, qui fut député de la noblesse du bailliage
d’Étampes aux États-Généraux de 1789 et qui mourut à Limours (S.-et-O.),
le 21 août 1794.
58
Abel-Jacques
de Poilloüe, vicomte de Bonnevaux, frère de Mlle de Bonnevaux,
né à Étampes le 22 juin 1791, entre à l’Ecole militaire de St Cyr d’où il
sortit le 35 mai 1812, était sous-lieutenant au 33e régiment d’infanterie légère,
et prisonnier en Russie.
Blessé à la tête le 8
novembre 1812 et le lendemain à la jambe gauche d’un coup de feu à la bataille
de Berniki, près de Smolensk, il demeura en captivité en Russie jusqu’au
23 septembre 1814. Il fut reçu le 12 novembre 1814 aux Gardes du Corps du
Roi Louis XVIII.
59
L ’Abeille d’Étampes 115/50 (25 décembre 1926), pp.
1-2 — Tiré à part (in-16 ; 10 p.), sans nom de lieu ni d’éditeur, 1926 (saisie
de Bernard Métivier, 2017).
60
Le Journal d’Étampes, n° 138, samedi 15 novembre 1947,
p. 3, sous la rubrique « À travers le temps... » (saisie de Bernard Métivier,
2017).
61
L’Abeille d’Étampes (31 janvier 1931), p. 2, dans
la rubrique « Notes d’histoire locale ».
62
L’année
1930.
63
Le Journal d’Étampes, n° 146, 10 janvier 1948, p. 2
(saisie de Bernard Métivier, 2017).
64
Étampes
a subi cette nuit-là un bombardement qui a fait des centaines de victimes
(B.G.).
|
BHASE n°36
(janvier 2017)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase036w.pdf
|
|
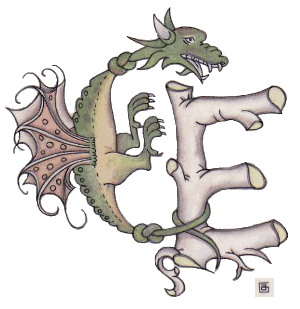
|