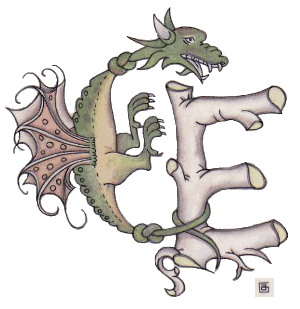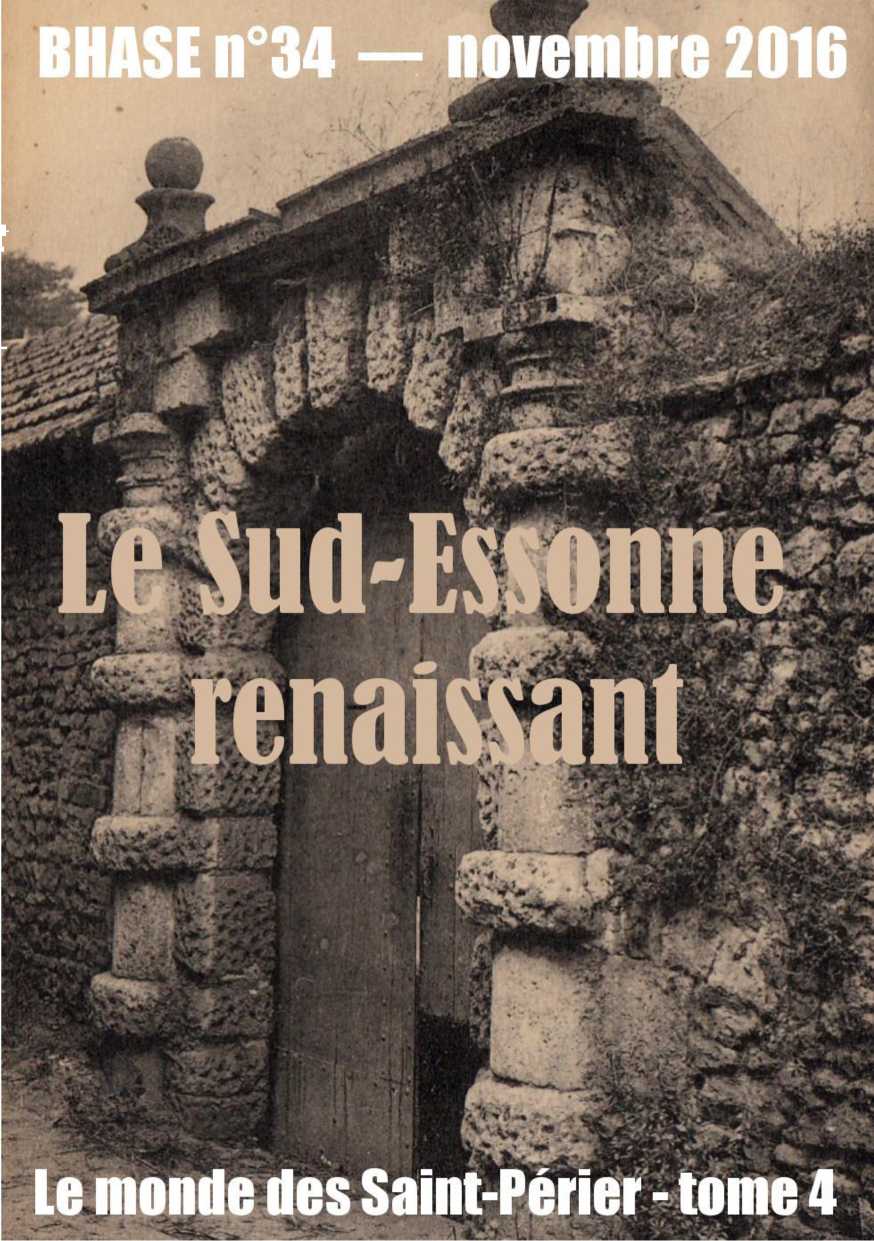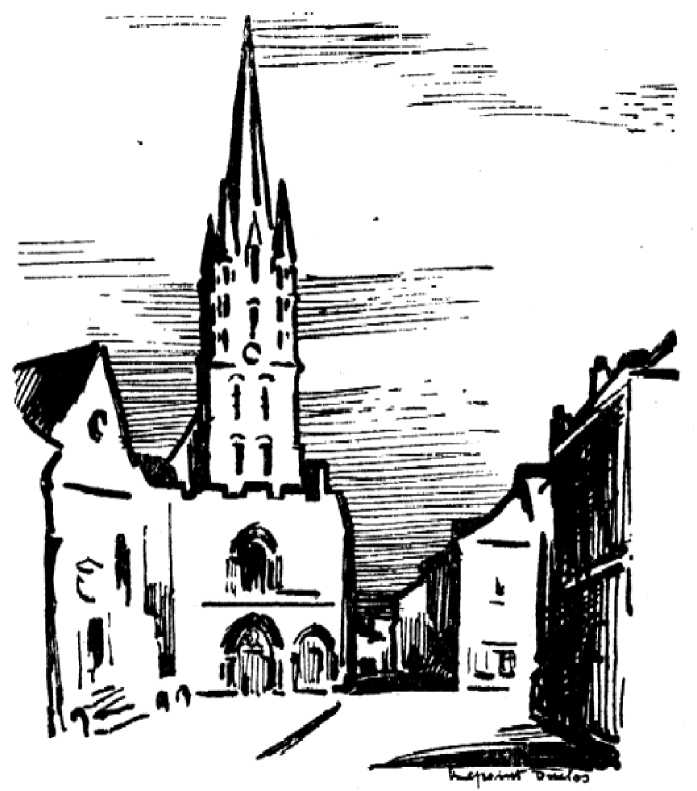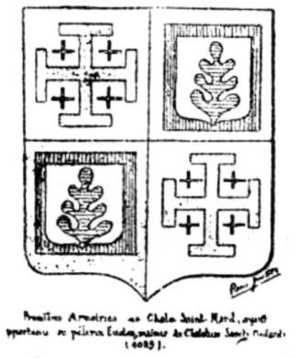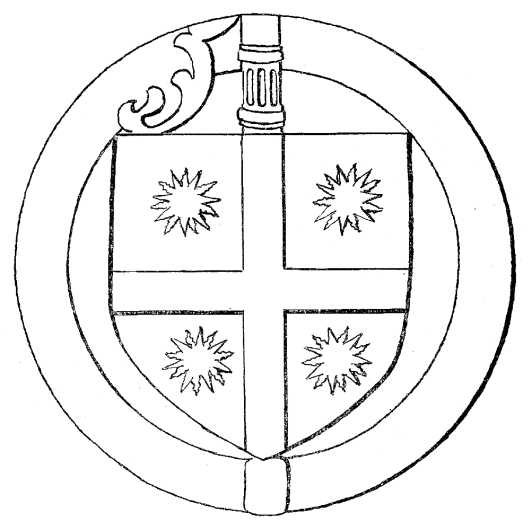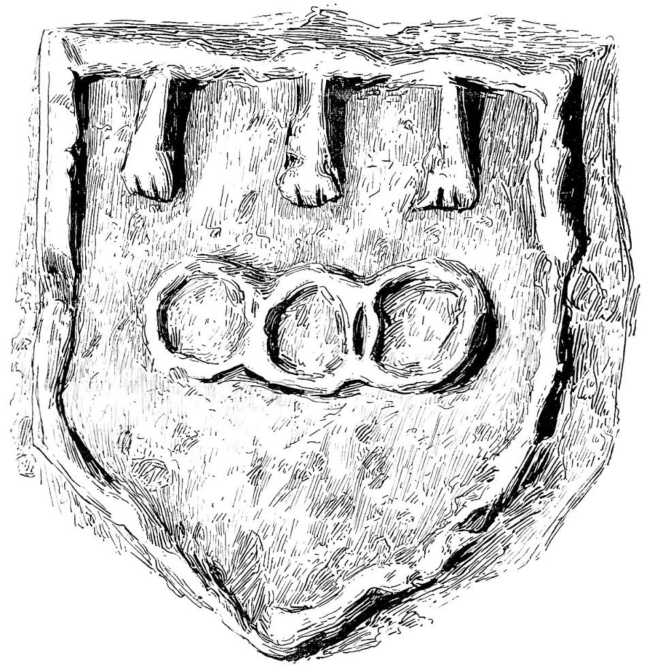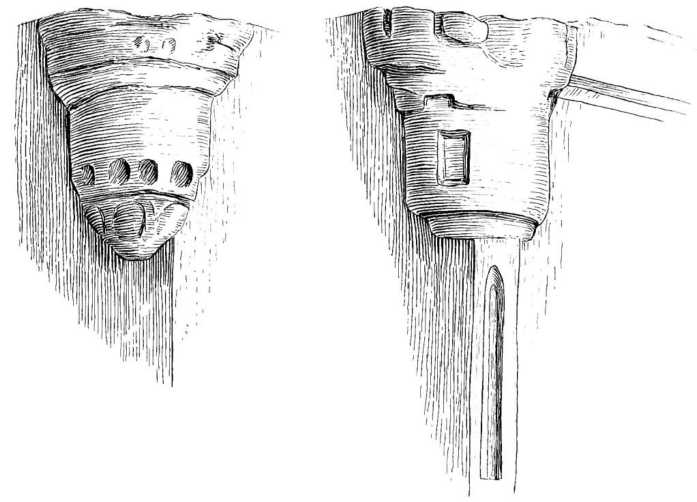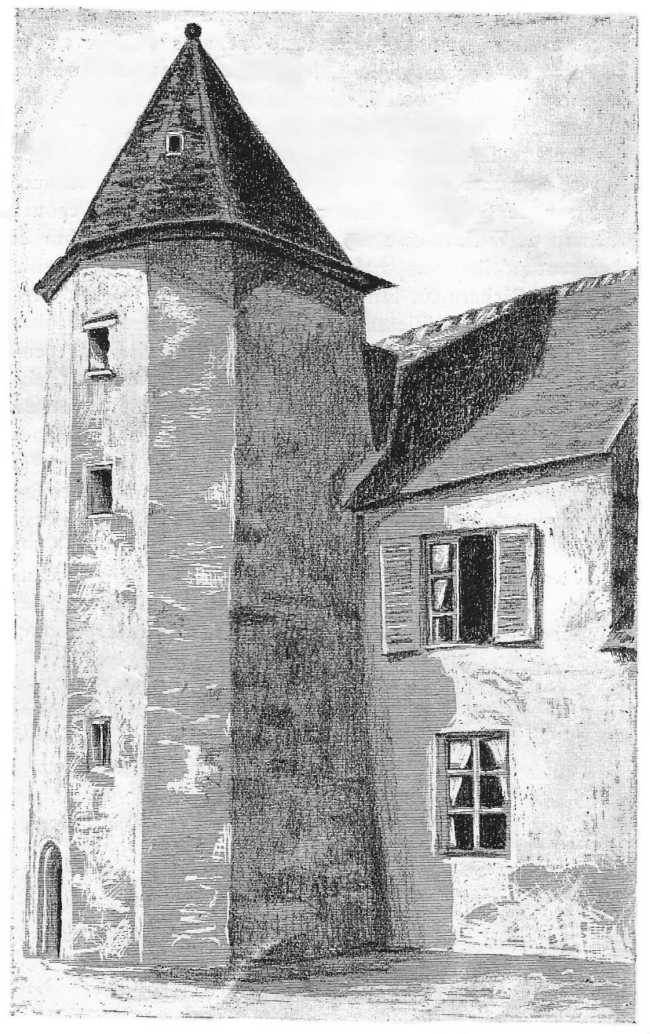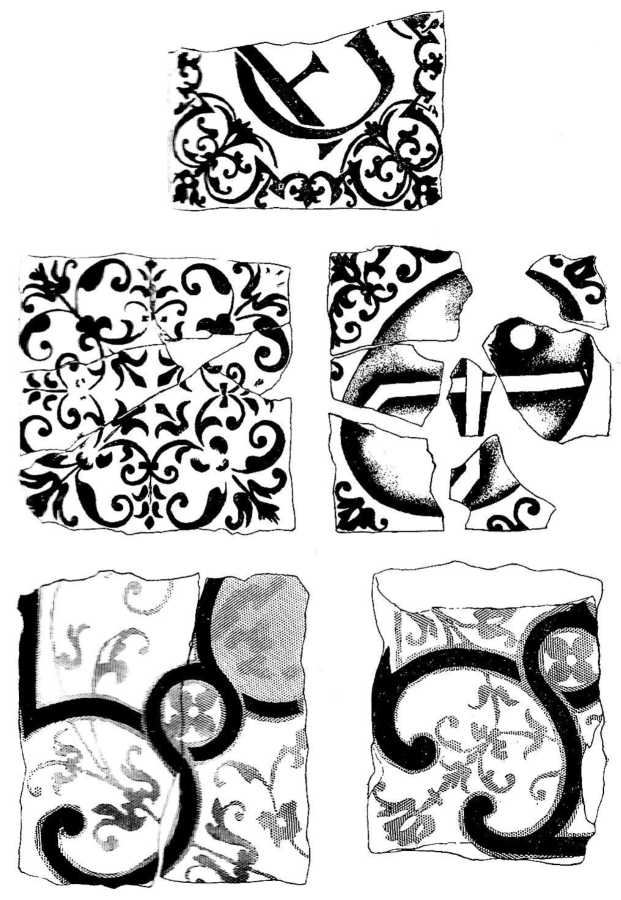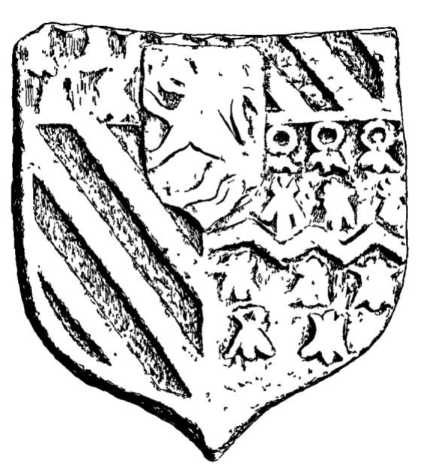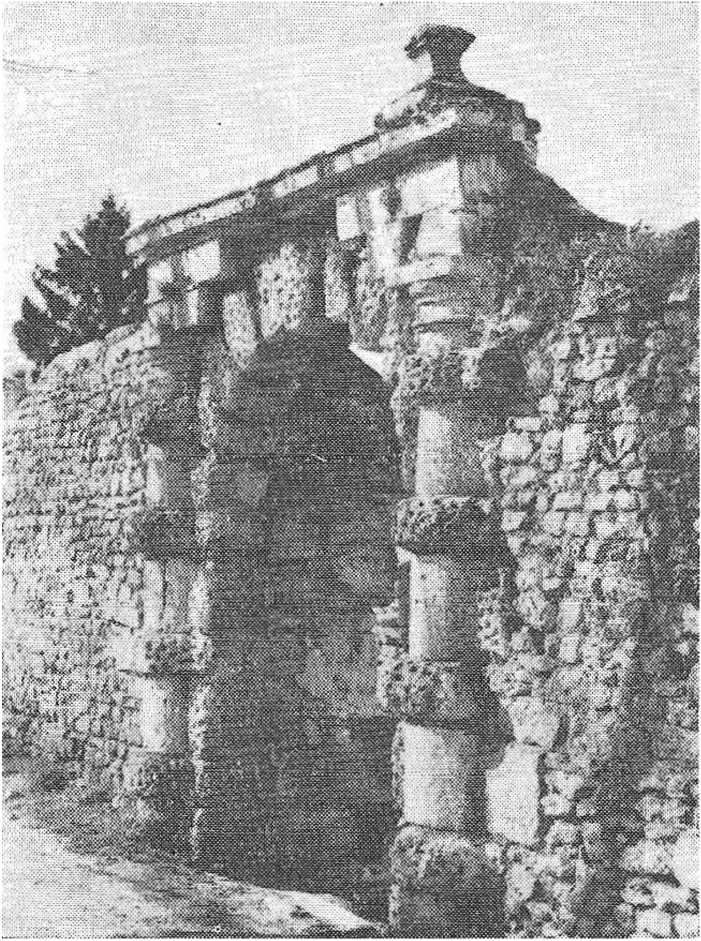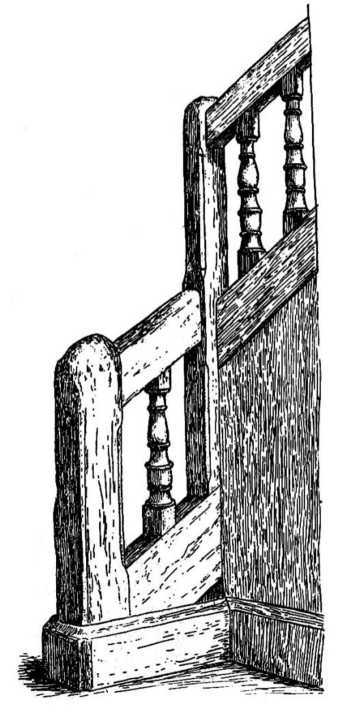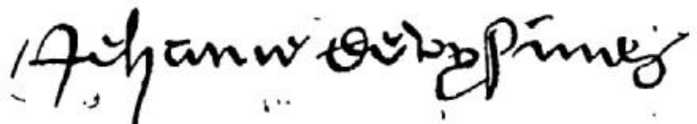|
BHASE n°34
(novembre 2016)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase034w.pdf
|
|
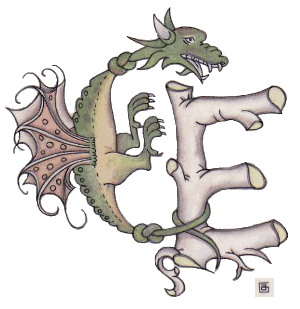
|
Le monde des Saint-Périer — tome 4
LE SUD-ESSONNE RENAISSANT
Préface. — Bibliographie. — 01. La Renaissance.—02.
Les Guerres de Religion. —
03. Le privilège de Chalo-Saint-Mard. —
04. L’écu des Hurault à Morigny. — 05. Les Villezan,
seigneurs de la Tour de Guillerval. —
06. Un petit manoir disparu à Souzy-la-Briche.
—
07. Carreaux de la Renaissance au Musée d’Étampes.—08.
Quelques bornes armoriées de Seine-et-Oise. — 09. Borne armoriée des Bréviaires.
— 10. La porte Bressault. — 11. Les Saint-Périer, ancienne famille des confins
du Gâtinais. — 12. La pierre tombale et la seigneurie de Bonnevaux. — 13.
Une nouvelle donation au musée d’Étampes.
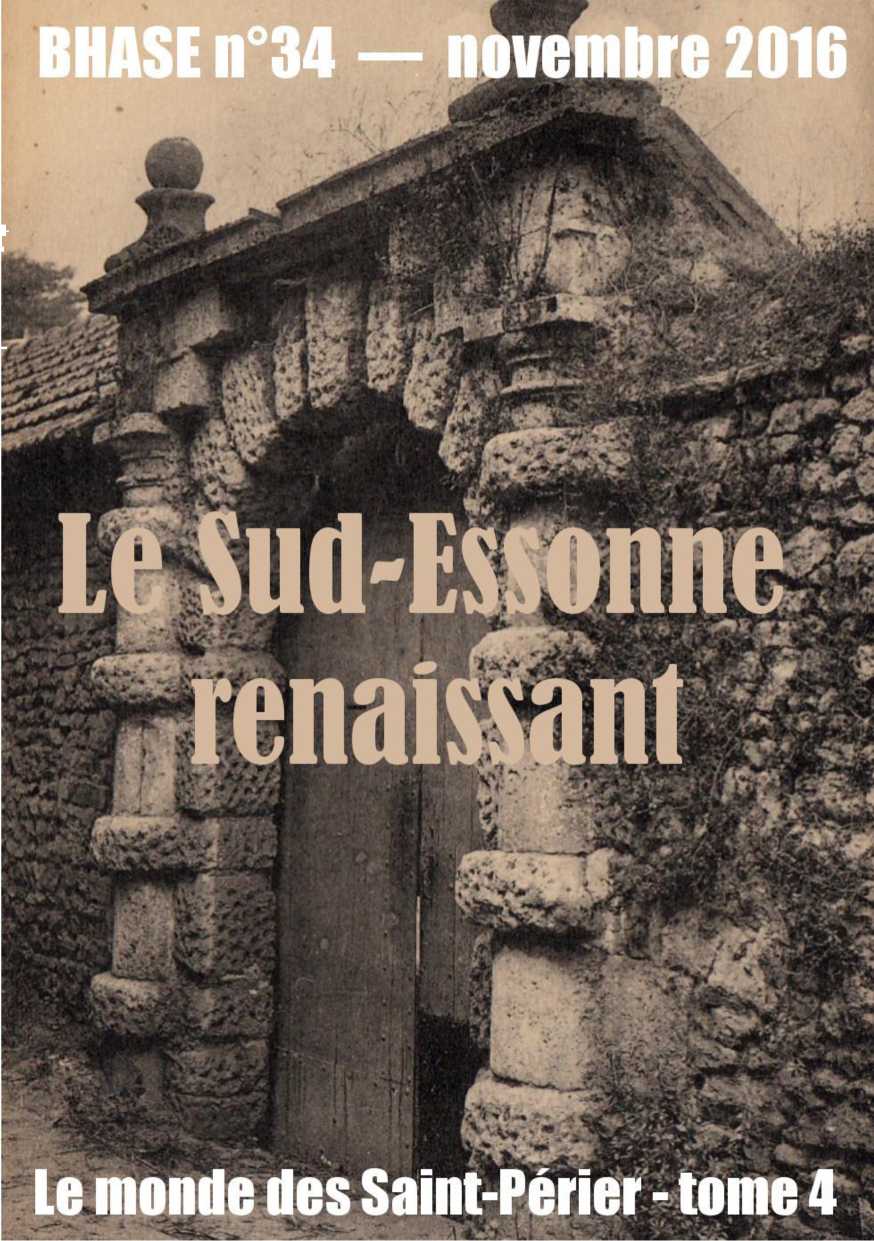
ISSN 2272-0685
Publication du Corpus Étampois Directeur de publication
: Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois. com
BHASE n°34
Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne

publié par le Corpus Étampois
novembre 2016
Le monde des Saint-Périer. Tome 4
Le Sud-Essonne

renaissant
Édité par le Corpus Étampois
COMITÉ DE LECTURE
Bernard Gineste Bernard Métivier Bernard Minet f
Bernard Paillasson
Préface
Voici le quatrième volume des Œuvres Locales Complètes
du comte de Saint-Périer. Il regroupe toutes les études qu’il a consacrées,
de 1925 à 1951, à l’histoire du XVIe siècle dans l’ancien arrondissement
d’Étampes, qui correspond grosso modo à la
partie méridionale de l’actuel département de l’Essonne.
On trouvera donc ci-après, tout d’abord, les deux
chapitres que Saint-Périer, dans sa Grande Histoire d’une petite ville, a consacrés en 1938 à cette période de l’histoire d’Étampes,
à savoir ses chapitres II et III, respectivement intitulés « La Renaissance
» et « Les Guerres de Religion ».
On lira ensuite onze études particulières qu’il a
consacrées à l’histoire du pays d’Étampes, et qui traitent pour l’essentiel
de faits survenus pendant cette même période, même si, naturellement, l’auteur
est souvent amené par son propos à remonter plus haut dans le temps, ou à
déborder sur les deux siècles suivants.

René de Saint-Périer
(1877-1950)
Bibliographie des articles
ici réédités
A. — Présentation générale
01. René de Saint-Périer, « La Renaissance »,
in Id., La grande histoire
d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition
du Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 23-37. — Réédition posthume
légèrement remaniée, in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 3 (2e semestre 1964), pp. 24-29.
02. « Les Guerres de Religion », in Id., op. cit., pp. 39-50. — Réédition posthume légèrement remaniée, in
Étampes. Bulletin Officiel
Municipal 3 (2e semestre 1964), pp.
24-29.
B. — Études de détail
03. « Le privilège de Chalo-Saint-Mard », in L’Abeille d’Étampes 118/23 (8 juin 1929), p. 1.
04. « L’écu des Hurault à Morigny », in Bulletin des Amis d’Étampes et
de sa région 7 (janvier 1951), pp. 123-125.
05. « Les Villezan, seigneurs de la Tour de Guillerval
», in
Bulletin de la Société
des Amis du Musée d’Étampes 7 (19251929), pp.
50-57.
06. « Un petit manoir disparu à Souzy-la-Briche
», in Bulletin de
la Société des Amis du Musée d’Étampes 7 (1925-1929),
pp. 59-61.
07. « Carreaux de la Renaissance au Musée d’Étampes
», in
Bulletin de la Société
des Amis du Musée d’Étampes 7 (19251929), pp.
62-64.
08. « Quelques bornes armoriées de Seine-et-Oise
», in Bulletin de
la Société historique et archéologique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix (1944), pp. 119-124.
09. « Borne armoriée des Bréviaires (Seine-et-Oise)
», in
Bulletin de la Société
nationale des Antiquaires de France (1934), pp.
175-181.
10. Raymonde de Saint-Périer et Bernard Jeanson,
« La porte Bressault », in Bulletin des Amis d’Étampes 12 (1965), pp. 3132.
11. « Les Saint-Périer, ancienne famille des confins
du
Gâtinais », in Annales de la Société historique et archéologique
du Gâtinais 40 (1931), pp. 60-88.
12. « La pierre tombale et la seigneurie de Bonnevaux
», in Bulletin de
la Commission départementale des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 45-46 (1931), pp. 133-152. — Tiré à part (22 p.), sans nom
de lieu ni d’éditeur, 1931.
13. « Une nouvelle donation au musée d’Étampes
», in L’Abeille d’Étampes 122/33 (19 août 1933), p. 1.

01. La Renaissance 1
Étampes port fluvial. — Fêtes et deuils.
— La municipalité
et les officiers du roi. — Le maire et la maison de ville. — Le tribunal. — Les belles favorites. — Travaux,
réformes et progrès. — Les établissements hospitaliers. — Le collège et ses vicissitudes. — L’Arquebuse et l’Arbalète. — La coutume d’Étampes. — Sage administration et douloureux destin.
L’autorité et l’adresse de Louis XI avaient enfin
ramené la paix et l’ordre dans le royaume. Mais il y avait bien des ruines
à relever, en particulier dans notre région. La belle énergie de notre race
y sera déployée avec une telle vigueur que la prospérité ne tardera pas à
renaître. Redevenu libre de disposer du comté d’Étampes, Louis XI en fit
don presque aussitôt à Jean de Foix, comte de Narbonne, qui était digne de
cette faveur. Il s’attacha ses nouveaux sujets en leur accordant un important
privilège, qui devait contribuer au relèvement économique du pays, le droit
de port. La navigation existait depuis longtemps sur quelques rivières d’Étampes
et les chevaliers de Saint-Jacques de l’Épée avaient construit un port, derrière
leur commanderie qui occupait l’emplacement de l’abattoir actuel et dont
la rivière, non détournée alors, était toute proche ; mais il appartenait
au commandeur, qui, bien entendu, percevait des droits élevés. Déjà 1 2 3
Louis XI, sur le conseil du prévôt des marchands
de Paris, avait ordonné aux habitants d’Étampes de rendre navigable la rivière d’Étampes,
afin d’assurer par eau le transport des blés de Beauce jusqu’à Paris. De
grands travaux furent entrepris ; on détourna les ruisseaux qui se perdaient
dans les prairies pour les réunir à la rivière d’Étampes qu’on canalisa et
le nouveau port, |24 autorisé par Jean de Foix, fut construit
près des murailles. Mais de longues années passèrent avant qu’il pût fonctionner régulièrement,
car de nombreuses difficultés surgirent, d’abord l’opposition du commandeur
de Saint-Jacques qui ne voulait pas être dessaisi de ses droits, puis, les
frais considérables d’entretien dus aux risques d’assèchement et à la nécessité
de curages fréquents, surtout en deux points, improprement appelés alors des
gourts, où s’accumulaient des amas détritiques amenés par ruissellement.
Il s’ensuivit des requêtes sans nombre auprès du roi ou devant le Parlement.
Mais ces difficultés vaincues ou au moins aplanies, la navigation connut
un succès grandissant ; elle était lente, certes, le halage ne pouvant guère
se faire qu’à bras d’hommes et les écluses étant nombreuses à cause des moulins, mais
elle était beaucoup plus sûre que la route terrestre, infestée de brigands.
Ce fut pour notre ville, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, un précieux
élément de vie et de richesse. Il n’en reste aujourd’hui qu’un nom, celui
du beau mail ombragé qui occupe l’emplacement du port du XVIe
siècle.
C’est également Jean de Poix qui permit aux boulangers
d’Étampes ainsi qu’aux « brenassiers », c’est-à-dire ceux qui fabriquaient
du pain de son ou de « bren », d’avoir chez eux « des fours pour cuire le
petit pain et d’ autres pour cuire le gros », moyennant une taxe |25
annuelle de 6 sols parisis, alors qu’auparavant ils étaient obligés d’aller
cuire au four banal.
Jean de Foix mourut à Étampes en 1500, après avoir
combattu en Italie avec Charles VIII et Louis XII, et fut enterré en grande pompe
dans le chœur de l’église Notre-Dame. Son fils Gaston, le héros des guerres
d’Italie, ne devait posséder le comté d’Étampes qu’un court espace de temps,
puisqu’il fut tué glorieusement en 1512 à Ravenne, de quinze coups de lance
au visage « montrant bien, le gentil prince, qu’il n’avait pas tourné le
dos ». Sa jeunesse, sa séduction, ses brillantes qualités, lui avaient gagné le
cœur des habitants d’Étampes qui lors de son entrée solennelle dans la ville,
en 1506, lui firent un accueil triomphal, dont le souvenir s’est conservé.
Deux cents cavaliers suivis de six cents petits garçons portant des banderolles
aux armes du comte allèrent au-devant de lui ; les échevins le reçurent à
la porte Évezard « aux fanfares des trompettes et au son des violons et des
hautbois, accompagnés de mille cris de joie d’une multitude innombrable de
personnes et qui le suivit jusques au logis qui lui avait été préparé, devant
lequel une vache dorée jetait par ses cornes du vin, suffisamment pour éteindre
la soif de tous ceux qui assistaient à cette cérémonie ». Les frais de cette
réception furent considérables, tant pour l’achat d’écussons, de rubans,
de drap pour les robes des échevins, de taffetas pour les bannières, de vin,
tartes, pâtés et galettes, que pour la fabrication des nombreuses pièces
d’orfèvrerie offertes au prince et la location des trompettes et ménétriers
et les travaux de peinture et de montage des échafauds, etc.
Sept ans après, c’était la reine Anne de Bretagne
qui, nouvelle comtesse d’Étampes, faisait dans la ville une entrée moins solennelle,
selon le désir qu’elle en avait exprimé. Mais on aménagea pour elle le château,
où elle devait loger, en commandant des travaux « aux maçons, charpentiers,
pionniers et autres manouvriers » ; les habitants reçurent l’ ordre « de
curer les rues et ôter les fiens et de mettre des feuilles et jonchées par les
dites rues ». La reine trouva « le paysage si agréable et l’air du château
si bon qu’elle y séjourna un temps assez considérable, au grand contentement
des habitants ». Mais dès l’année suivante, en 1514, la pauvre reine mourait
au château de Blois. Son corps, pour être inhumé à Saint-Denis, fut accompagné
sur toute la route d’un long cortège, composé des princes et princesses du
sang montés sur des mules noires, des dames d’honneur, sur des haquenées
conduites par des valets de pied, des archers du roi, qui marchaient en tête
pour écarter la foule et enfin, des Suisses de la garde, qui faisaient la
haie de chaque côté, la hallebarde sur l’épaule. Le convoi quitta Blois le
4 février pour n’arriver que le 12 à Paris. Au passage d’Étampes, les échevins, en
robes et chaperons de deuil, les officiers de justice |26 et tout le
peuple l’attendaient à la porte Saint-Martin. En outre, se joignirent au
cortège des hommes qui portaient un millier de torches armoriées, quatre
cents aux armes de la reine, quatre cents aux armes d’Étampes ; les deux
cents autres étaient aux armes du fameux Eudes le Maire, de Châlo-Saint-Mard,
dont nous parlerons plus loin, parce qu’elles étaient portées par des chevaliers
descendants de lui et que leur charge consistait à venir au-devant des princes
morts, de passage à Étampes, et à veiller leur corps. Le char funèbre, qui
était traîné par six grands chevaux, houssés de velours noir croisé de satin
blanc de sorte qu’on ne leur voyait que les yeux, fut dirigé vers l’église
Notre-Dame et reconduit, après la célébration du service, jusqu’à la sortie
de la ville du côté de Paris, avec la même pompe.
La fille aînée d’Anne de Bretagne, Claude, alors
âgée de 15 ans, devenait comtesse d’Étampes en vertu de l’acte de la donation faite
par Louis XII à la reine. Elle était fiancée au duc de Valois, le futur François
Ier, et le mariage eut lieu quatre mois après la mort d’Anne de
Bretagne, qui, disait-on, n’y était pas favorable. Dès l’année 1515, Louis
XII mourait à son tour et la nouvelle comtesse d’Étampes montait sur le trône.
Bientôt après, elle se démit de son comté en faveur d’ Arthus de Gouffier,
sire de Boissy, grand maître de France, qui porta le titre de comte d’Étampes.
Il vint dans notre ville et « pour le remercier de quelque grâce », on lui
offrit une coupe d’ argent « bien dorée d’or », qui avait coûté plus de cent
livres et avait été faite à Paris, et à son barbier, un étui garni de deux
rasoirs et ciseaux dorés, d’un peigne, d’un miroir et d’un cure-oreilles
d’argent. Arthus de Gouffier mourut en 1519 et Claude de France reprit possession de
son bien. Cette « bonne reine », comme elle fut appelée, aussi modeste, douce,
effacée, que son mari était audacieux, belliqueux et galant, n’a guère laissé
dans l’histoire que le souvenir discret de ses vertus domestiques et c’est
surtout par la prune savoureuse qui porte son nom qu’elle est connue de la plupart
de nos contemporains. Cependant, les marques de sa bonté envers Étampes ne
furent pas tout à fait négligeables. C’est grâce à son intervention auprès
de Louis XII que notre municipalité acquit quelque indépendance à l’égard
des officiers du roi. Ceux-ci, pour la plupart, étaient à la fois des administrateurs
et des juges. Ils comprenaient d’abord le bailli, qualifié en même temps
de capitaine et gouverneur, qui devait toujours être un gentilhomme, puis,
ses lieutenants, le lieutenant général et le lieutenant particulier, qui
étaient, le plus souvent, docteurs ou licenciés en droit, le procureur et
l’ avocat du roi, dont les attributions consistaient à défendre les intérêts
de la couronne, et le receveur, chargé seulement de l’administration des
finances. À côté d’eux, le prévôt, très ancien fonctionnaire puisqu’il existait
|27 déjà sous Robert le Pieux, faisait partie du conseil de bailliage,
mais il avait la préséance sur le procureur, l’avocat et le receveur et jugeait,
aussi bien en appel qu’en première instance. Il était assisté également d’un
lieutenant et les charges du garde du scel, du greffier et du tabellion,
toutes trois affermées et consistant à percevoir des droits, étaient rattachées
à son office. Enfin, les notaires et les sergents royaux étaient sous les ordres
des officiers bailliagers et prévôtaux. En face de ces nombreux officiers
qui dépendaient du roi, la municipalité était réduite jusqu’alors à quatre
syndics, qualifiés d’échevins sans en avoir toutes les prérogatives, élus
pour trois ans par les habitants ;
l’élection était présidée par le lieutenant général
du bailliage, chacun pouvait voter, mais le conseil de bailliage, auquel
étaient adjoints six notables de la circonscription, avait le choix en dernier
ressort. Il n’y avait pas de maire alors que son existence est prouvée sous
le règne de Philippe-Auguste, comme nous l’avons vu, il ne semble pas avoir
été rétabli en même temps que l’organisation communale au XIIIe
siècle. Il n’y avait pas non plus d’hôtel de ville ; les réunions et les
élections avaient lieu dans la salle des plaids, au-dessus de la halle de
la boucherie, ou bien « en un autre lieu ». Les échevins avaient pour principale fonction
d’administrer les deniers communs de la ville, mais ils ne pouvaient disposer
d’une somme supérieure à 20 sols parisis, sans une ordonnance de justice.
Ces deniers communs, comme leur nom l’indique, ne pouvaient être utilisés
que pour la communauté. Ils provenaient alors uniquement des droits de barrage, octroi perçu aux portes de la ville sur les chariots chargés,
les bêtes de somme et le bétail, et des droits payés sur le sel vendu au
grenier d’Étampes ; plus tard, il s’y ajouta, quand il y eut une maison de
ville, le montant de la location des greniers de cette maison, puis, le droit
de courtepinte, prélevé sur les vins. Ces deniers communs devaient servir
d’abord à l’entretien du pavé et des chemins de la ville, entretien fort
onéreux en raison de la circulation très active, puis, aux réparations de
l’enceinte et des portes et enfin, aux frais du séjour des rois et des princes, également
fort élevés, comme on a pu le voir. Le contrôle de l’emploi des deniers communs
était fait par les agents royaux et la Chambre des comptes.
Les échevins d’Étampes, supportant avec peine que
la ville d’Orléans eût acquis de nombreux privilèges et possédât un hôtel de
ville, demandèrent aux bourgeois d’ Orléans une copie des lettres qui lui
accordaient ces avantages afin de s’en inspirer pour une requête auprès du
roi. Un bourgeois d’ Orléans vint à Étampes leur apporter ladite copie et
comme il ne voulut point accepter d’ argent en retour, ils lui offrirent
quatre pintes de bon vin et du gibier. Et ils obtinrent du roi Louis XII,
moyennant finances d’ailleurs, le |28 jour du mariage de sa fille
Claude avec François, duc de Valois, une charte, qui les autorisait à nommer un
maire et à construire ou acheter une maison commune, où ils pourraient mettre
en sûreté leurs titres, et s’assembler quand bon leur semblerait C’est ainsi
que fut élu, en 1517, le premier maire dont nous connaissions le nom, Jean
de Villette, qui était lieutenant particulier du bailliage. Cette charte
donna lieu à un procès parce qu’elle rencontra aussitôt l’opposition du lieutenant général,
du prévôt, du procureur du roi, tous craignant l’extension des pouvoirs de
la municipalité à leur détriment. Elle accordait, cependant, peu de chose,
en fait. Louis XII avait passé adroitement sous silence toutes les questions
qui pouvaient devenir litigieuses. Les échevins désiraient être élus sans l’intervention
des officiers du bailliage : ils ne l’obtinrent pas. Leurs ressources restaient
à peu près ce qu’elles étaient. Ils ne pouvaient prendre d’initiatives importantes
sans l’avis des officiers du roi, qu’ils eurent ainsi intérêt à se concilier
: l’ élection du lieutenant du bailliage, Jean de Villette, comme maire,
est significative à cet égard. Louis XII, comme tous les rois, voulait la
collaboration de ses fonctionnaires avec la municipalité et sa charte ne
promettait rien qui y fît obstacle. C’est ainsi qu’elle fut enregistrée finalement
en 1518 et les échevins purent acheter une maison de ville, avec une somme
de 2.000 livres tournois, qu’ils furent autorisés par François Ier à prendre
sur les octrois royaux.
C’est également Claude de France qui accorda aux
officiers royaux d’Étampes l’autorisation de tenir leurs audiences dans son
palais du Séjour afin de leur donner un siège « plus convenable » que la
salle de la boucherie. L’inauguration du nouvel auditoire eut lieu le 28
novembre 1518, en présence des officiers de toutes les justices du bailliage
et des notables de la ville. C’est là que se trouve encore notre tribunal
depuis plus de quatre siècles. Au XVIe siècle, les assises s’y
tenaient deux fois par an, sous la présidence du lieutenant général du bailliage, pendant
une semaine, et les plaids avaient lieu tous les jours, sauf le jeudi, le
prévôt jugeant trois jours de la semaine, et les officiers du bailliage,
deux jours, ce qui montre les habitudes processives de l’ époque.
À la mort prématurée de la reine, en 1524, le comté
d’Étampes rentra dans le domaine royal. En 1526, François Ier le donnait
à Jean de la Barre, premier gentilhomme de sa chambre, pour les bons services
qu’il lui avait rendus, particulièrement à la bataille de Pavie « en laquelle
il ne l’abandonna jamais ». Cette donation, très large, puisqu’elle accordait
au donataire la perception de tous les revenus, même ceux du grenier à sel,
et le pouvoir de nommer à tous les offices vacants, rencontra une vive opposition
à la Chambre des comptes. Le roi dut faire un commandement exprès. La Chambre
ne céda que sur la question des offices. Mais Jean de la Barre |29
reçut directement de François Ier une part des revenus du grenier
à sel d’Étampes. Par une autre marque de la faveur royale, il fut maintenu
dans la possession de son comté jusqu’à sa mort en 1533, en dépit d’un acte
promulgué par le roi en 1531, qui révoquait toutes les donations de terres
qu’il avait consenties. Mais cet acte, comme on pouvait le prévoir, eut toujours
des applications inconstantes.
François Ier était alors sous l’ empire
de sa passion pour une ancienne fille d’honneur de sa mère, Anne de Pisseleu,
la plus belle des
savantes et la plus savante des belles, qui l’avait conquis
dès son retour de captivité par sa beauté et son esprit. Elle avait épousé
Jean de Brosses, issu de la vieille famille féodale des vicomtes de Limoges,
mais complètement ruiné et ainsi fort impatient de reconstituer sa fortune
par ce rôle de mari complaisant. Tous deux obtinrent du roi, en 1534, le
comté d’Étampes, qui moins de deux ans après était érigé en duché. Dans l’
acte qui établit cette nouvelle prérogative, François Ier déclare qu’« il
considère que le comté d’Étampes est de belle et grande étendue, et de bon
et gros revenu, tenu et réputé une des plus notables et anciennes maisons
du royaume, dont dépendent plusieurs beaux fiefs et arrière-fiefs et seigneuries
et il veut pour la décoration dudit royaume élever ledit comté en plus haut
titre et degré ». Ces mentions flatteuses, qui contenaient certes une part
de vérité, cherchaient à masquer l’insigne faveur que le roi accordait à
sa maîtresse et l’ascendant qu’elle possédait sur lui. Ambitieuse, avare,
vindicative, elle sut en user pour acquérir un important domaine, ruiner
ses ennemis, favoriser ses partisans et surtout les membres de sa famille,
fort nombreux puisque, son père s’étant marié trois fois, elle n’avait pas
moins de trente frères et sœurs. Aussi ne fut-elle guère aimée de ses contemporains
qui l’appelaient « la méchante », encore qu’elle encourageât les lettres
et les arts et qu’elle eût beaucoup de courtisans intéressés. La ville d’Étampes
ne peut lui être reconnaissante d’aucune libéralité et la trace de la possession
de son duché aurait presque entièrement disparu, si son nom n’était demeuré
attaché à une maison charmante, au coin de la place de l’Hôtel-de-Ville et
de la rue Sainte-Croix. La date de 1538 gravée sur l’encadrement d’une fenêtre
et un buste mutilé, qui semble représenter François Ier, ont permis cette
attribution. L’édifice et sa décoration sont bien certainement de l’époque
de la favorite. En 1547, François Ier mourait à Rambouillet et
le jour même de sa mort, Anne de Pisseleu était bannie de la cour et le duché d’Étampes
lui fut enlevé. Mais son propre mari lui ayant intenté un procès en reddition,
c’est à lui seul que le nouveau roi Henri II confirme la donation du duché
« en considération et contemplation des bons, grands et recommandables services qu’il
a ci-devant et par longtemps faits |30 au feu roi et à lui pareillement
». Cependant, Henri II ne tarda pas à le retirer à Jean de Brosses pour l’offrir
à la belle duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers, qu’il aimait déjà
dauphin, bien qu’elle eût environ vingt-cinq ans de plus que lui. Cette favorite
« si belle, dit Brantôme, que je ne sache cœur de rocher qui ne s’en fût
ému », douée, en outre, de toutes les grâces de l’esprit, protectrice et inspiratrice
de tous les arts, mais sèche, âpre, intrigante, exerçait sur Henri II une
véritable fascination et seule la mort brutale du roi en 1559, devait lui
arracher presque tous les biens immenses qu’elle avait su obtenir. En vertu
de l’édit de révocation des dons royaux, publié de nouveau par François II
dès son avènement, son duché lui fut enlevé. Elle fut chassée de la cour
avec infamie, par Catherine de Médicis et sous l’ influence des Guise, auxquels elle
était cependant alliée. Mais le roi était mort.
Cette courte possession du duché d’Étampes par Diane
de Poitiers nous a valu au moins l’élégante demeure qui est aujourd’hui celle
de la Caisse d’Épargne. Plusieurs faits permettent de croire qu’elle a bien
été construite et ornée pour la favorite la date de 1554, gravée sur une
fenêtre de la plus jolie partie de cet hôtel, alors que le titre de duchesse
d’Étampes lui fut accordé par Henri II en 1553, la décoration, où l’on retrouve çà
et là les armoiries de France mêlées aux armes de Diane et au croissant,
les lettres H et D entrelacées, enfin la présence, assez insolite, à Étampes
cette même année 1554, authentiquement prouvée par une pièce des Archives
nationales, de Jean Goujon lui-même, le sculpteur du roi. Ce dernier fait
paraît démonstratif, car on ne s’expliquerait guère le séjour à Étampes de
Jean Goujon, si ce n’est parce qu’il était chargé d’y embellir une habitation
de la duchesse, comme il venait précisément de le faire au château d’ Anet.
La pièce d’ archives qui le concerne nous apprend qu’il fut emprisonné à
Étampes, pour une raison qui demeure ignorée4.
Au cours du XVIe siècle, d’ autres travaux
furent accomplis dans notre ville et beaucoup d’ améliorations furent apportées
à l’administration de ses biens. La porte Saint-Jacques fut construite en
1512. Une très médiocre, mais bien curieuse peinture, conservée au Musée,
nous la montre coiffée d’un comble aigu en ardoises et bastionnée de deux
tours, avec la ligne de murailles qui ceignait la ville. Mais nous n’y voyons
point l’état ruineux de cette enceinte, conséquence des sièges qu’elle avait
eu à subir. Elle s’étendait tout le long du boulevard Henri IV actuel depuis
la ruelle d’Enfer, puis, au-delà, jusqu’à la petite place de notre monument
aux Morts, descendait comme la rue des Remparts, suivait la rivière d’Étampes
au sud et rejoignait le boulevard Henri IV par la rue du Filoir. En outre,
les faubourgs eux-mêmes étaient fortifiés, Il y avait quinze portes, dont
les huit principales, défendues par deux tours |31 et munies de
ponts-levis, étaient la porte Saint-Martin, la porte Dorée, la porte des
Lions ou du Châtel, la porte Saint-Jacques, la porte Évezard, la porte Saint-Pierre,
la porte Saint-Fiacre et la porte Saint-Gilles. À chacune, étaient perçues
des taxes, de péage pour le roi et de barrage pour la municipalité, dont
le montant élevé prouve l’importance commerciale d’Étampes à cette époque. Mais
la valeur défensive de la fortification délabrée était presque nulle. Or,
les brigandages aussi bien que les guerres constantes rendaient nécessaires
les enceintes fortifiées. François Ier alors en lutte avec Charles-Quint,
qui venait de ravager la Provence et menaçait de s’avancer jusqu’à Paris,
prescrivit aux habitants d’Étampes, par des lettres datées de Lyon, 1536,
de réparer leurs murs. Les habitants furent aussitôt assemblés et l’on reprit
un projet de restauration du XIVe siècle, qui s’appliquait d’abord aux tours
de la porte Évezard, puis, à la courtine jusqu’à la porte Saint-Fiacre et
qui comprenait, entre l’enceinte et les terrains particuliers, des boulevards,
qui devaient faciliter l’organisation de la défense. On devait, en outre,
garnir de ponts-levis toutes les portes. Les frais de l’exécution de ce plan
seraient pris sur les deniers communs et même sur une taxe nouvelle, s’ils
n’y suffisaient pas. La prompte adhésion des habitants à ces projets montre
qu’ils sentaient l’urgence de la restauration des murs qui les protégeaient.
Et cependant, c’est l’obstination d’un petit groupe d’entre eux qui y mit
obstacle. Car il fallait raser quelques maisons. L’un des propriétaires en
question, un bourgeois riche, nommé Martin Auper, gagnant d’abord à sa mauvaise
cause les officiers royaux, réussit, sans doute par corruption, à obtenir
de la Chancellerie elle-même l’ordre de cesser les travaux. Les échevins
ne se tinrent pas pour battus, ils en appelèrent au roi, qui désigna le bailli
d’Orléans pour juger du différend. Ce fut le lieutenant général de ce bailli
qui décida, en l’ hôtel du Cheval bardé, à Étampes, que Martin Auper et ses
commettants recevraient, pour les dommages qui seraient causés à leurs biens, une
indemnité à dire d’experts. Il semblait que toutes les difficultés fussent
aplanies et que les travaux pourraient être poursuivis Il n’en fut rien.
L’on se heurta à un obstacle insurmontable les ressources de la ville étaient
trop modestes pour faire face aux indemnités en même temps qu’aux frais de
la restauration de l’enceinte. Quand survinrent les guerres de religion,
on n’avait rien pu contre cet état de choses et notre malheureuse ville se
trouva sans défense. Malgré les efforts des échevins et de la majorité des
habitants, quelques intérêts particuliers l’avaient emporté sur l’ intérêt
général.
Nous avons vu que la municipalité avait été autorisée
par Louis XII à construire ou acheter une maison de ville et par François
Ier à y consacrer 2.000 livres. L’Hôtel de Ville ne fut pas construit,
|32 comme il a été dit, mais acheté pour cette somme, en 1514,
à Jacques Doulcet, conseiller du roi, qui le tenait de Jeanne Doulcet, femme
du grenetier d’Étampes à la fin du XVe siècle. C’était un bel
hôtel, qui ne dut pas nécessiter d’aménagements pour sa nouvelle affectation.
La fondation de l’Hôtel-Dieu d’Étampes doit remonter
à la fin du XIIe siècle, sans qu’on ait plus de précision à cet
égard. Auparavant, si l’on s’en rapporte à une tradition, les lits des malades
pauvres étaient installés dans l’église même de Notre-Dame, à l’extrémité
de la nef. L’ incommodité de ce procédé fit décider la construction d’un
bâtiment séparé, dans la cour des chanoines, à l’emplacement de l’hôpital
actuel. Il s’appela d’abord l’aumônerie de Notre-Dame. Au XVIe
siècle, on y adjoignit un dortoir des pauvres, converti plus tard en une chapelle,
qui nous a été conservée.
À la même époque, des changements furent apportés
à l’administration de l’Hôtel-Dieu, qui laissait fort à désirer. Elle était
confiée à un prêtre, désigné comme maître et administrateur par l’archevêque
de Sens. C’était, en 1537, un nommé Jacques de la Vallée, dont l’incurie
avait entraîné la mort de plusieurs pauvres dans les rues, faute de secours.
Les habitants adressèrent à l’archevêque des plaintes qui ne restèrent pas
sans effet. Une transaction s’ensuivit, par laquelle l’administration du
revenu temporel de l’Hôtel-Dieu appartiendrait désormais au maire et aux
échevins, qui donneraient un traitement et une maison près de l’hôpital au
dit Jacques de la Vallée et à ses successeurs. Dès ce moment, il fut établi,
pour le service des malades, des religieuses de l’ordre de Saint-Augustin
qui furent d’abord des filles d’Étampes.
Il existait encore à cette époque plusieurs autres
établissements hospitaliers dans notre ville. Leur administration fut désormais surveillée
par le maire et les échevins, qui devaient élire deux administrateurs tous
les trois ans, en vertu d’un édit de Charles IX, de 1561, motivé par les
désordres et les malversations qui s’exerçaient partout. L’hôpital Saint-Jean-au-Haut-Pavé
était la plus ancienne de ces fondations, de par sa situation même dans la
vieille ville, rue du Haut-Pavé, un peu avant la rue Saint-Jean. En outre,
nous savons par une charte de 1085 que Philippe Ier en fut le
bienfaiteur.
La commanderie ou l’hôpital de Saint-Jacques de l’Épée
avait été fondée par des chevaliers de cet ordre, sur l’emplacement de l’abattoir
actuel, à une date que nous ignorons : un acte de François Ier de 1518 confère
cette commanderie à un nommé Pierre Dance, par un acte qui ne doit pas être
confondu, comme il l’a été par certains historiens d’Étampes, avec un acte
de fondation. L’ordre de Saint-Jacques de l’Épée fondé en Espagne dès le
XIIe siècle, pour enrayer les troubles causés par les Maures aux
pèlerinages |33 de Saint-Jacques de Compostelle, avait établi en
France des refuges pour les pèlerins, principalement sur la route de Saint-Jacques,
et c’est ainsi qu’ils en créèrent un à Étampes, à une époque certainement
bien antérieure à l’acte de François Ier, puisque son existence
est mentionnée dans le droit de port accordé par Jean de Foix en 1490. En
1580, cet hôpital et ses dépendances furent donnés par le roi à des capucins,
qui y entreprirent divers travaux, mais sans que son affectation en fût modifiée,
ni son administration soustraite à la surveillance du maire5.
La maladrerie de Saint-Lazare, sur la route de Paris,
avait reçu dès le XIIe siècle des donations importantes des rois
Louis VI et Louis VII, et plus tard, de nombreux autres bienfaiteurs. Mais
au début du XVIe siècle, elle était administrée d’une manière déplorable.
Les fonds étaient détournés, les lépreux, ne recevant plus de soins, mendiaient
dans la ville et risquaient de propager leur mal. Cette situation n’étant
pas spéciale à Étampes, François Ier, en 1543, avait chargé les
baillis de surveiller les léproseries et de destituer les administrateurs
coupables. Mais les abus persistaient, en particulier à la maladrerie de
Saint-Lazare, où les lépreux, en 1544, n’étaient plus que quatre. Une part
des revenus étaient employés par un administrateur, Jacques Yvon, à poursuivre
un procès pour conserver sa charge. Ses successeurs ne furent pas plus honnêtes
et s’efforçaient de corrompre les officiers royaux, si bien qu’en 1560, un
bourgeois d’Étampes fut désigné comme administrateur et à partir de 1561,
le bienfaisant édit de Charles IX fut appliqué là comme dans les autres établissements.
Enfin, l’hôpital Saint-Antoine, qui existait dès
le début du XIIIe siècle, était destiné à loger « des passants
valides ». Il était situé en face de l’ancien collège, c’est-à-dire à l’emplacement
du collège actuel6,
et comprenait une chapelle pour cette double raison, il fut donné au début
du XVIIe siècle, aux Pères barnabites qui venaient d’être appelés
à la direction du collège comme nous allons le voir.
La première mention des écoles d’Étampes nous est
donnée par une bulle du pape Luce III en 1183, qui accordait au chapitre
de Sainte-Croix le droit d’instituer un maître des écoles. Mais aussitôt
les chanoines de Notre-Dame, qui étaient précisément alors en lutte ouverte
avec ceux de Sainte-Croix, firent opposition à ce privilège. Ils réussirent
à l’enlever à leurs rivaux, en 1191, par une sentence des juges ecclésiastiques
qu’avait désignés le roi pour régler les nombreux points contestés entre les
deux chapitres. Mais cet enseignement n’avait pas de siège ; il était donné
tout simple ment dans la maison du maître, auquel on ne sait s’il était alloué
un bénéfice de l’église en paiement de sa tâche. C’est seulement en 1515
que nous voyons les habitants d’Étampes se préoccuper |34 d’avoir
une maison d’école et des « maîtres gagés » pour instruire gratuitement leurs
enfants. Ils demandent à François Ier l’autorisation de consacrer
une partie des deniers qui avaient été affectés aux fortifications de la
ville à l’achat ou à l’édification « d’une maison commode pour y tenir les
écoliers, estimant que leur ville serait mieux défendue par des citoyens
bien instruits aux bonnes lettres, avec la connaissance desquelles l’on acquiert
aussi la prudence, que par des murailles et autres fortifications ». On voit
que nos bourgeois d’Étampes étaient pleins d’illusions sur l’usage que font
les hommes de la science qu’ils ont acquise, reflet de cette belle époque
de la Renaissance, où la supériorité des choses de l’esprit s’imposait à tous.
Le roi accorda son autorisation, mais on ne sait
quand ni par qui fut donnée à la ville, pour en faire un collège, la maison
sise à l’angle de la rue Saint-Antoine et de la rue du Pont-Quesneaux, aujourd’hui
rue Magne, en face du collège actuel7. Elle était en mauvais état et nécessita
dès 1561 des réparations urgentes, en vue des quelles François II, tout en
accordant 600 livres, ordonna une visite des maçons et charpentiers experts,
sous la foi du serment. L’expertise eut lieu en présence du bailli, Nicolas
Petau, du lieu tenant de la prévôté, du maire, des échevins et d’ un grand nombre
d’habitants. La conclusion fut qu’il fallait « abattre la dicte maison et
la rebastir de nouvel », les murailles étant crevées, le bout du logis pourri,
les planchers rompus... Grâce à une somme de 1200 livres, octroyée en deux
fois, par le roi Charles IX, la ville put acheter en 1564 une maison contiguë
à l’ancienne et la faire aménager. Mais il fallait d’autres ressources pour
l’entretien des maîtres. Une prébende du chapitre de Notre-Dame d’un revenu
annuel de 300 livres étant vacante par le décès de son titulaire, Louis Guibour,
le maire et les échevins obtinrent du roi, en 1566, qu’elle leur fût concédée
pour cet objet. Mais dès 1569, elle leur était enlevée par un arrêt du Parlement
en faveur d’un frère de Louis Guibour, qui, en vertu des provisions qu’il
avait reçues de cette prébende, avait poursuivi le maire et les échevins.
Ceux-ci ne se découragèrent point cependant. Ils savaient que le revenu de
la maladrerie de Saint-Lazare dépassait ses besoins, les lépreux n’y étant
plus qu’en très petit nombre : ils se firent accorder par le roi en 1575
une rente de 300 livres sur ce revenu. C’est ainsi qu’un principal, Nicolas
Charrier, prêtre et maître ès-arts de l’Université de Paris, fut enfin appelé à
la direction des « grandes écoles d’Étampes ». Il avait la charge d’instruire
et faire instruire les enfants d’Étampes et des environs « ès bonnes mœurs
et vie suivant l’institution de l’Eglise catholique, en la connaissance des
lettres et A B C, lire, écrire, jeter comptes tant au jet qu’à la plume,
en la grammaire et les premiers rudiments de la langue latine et lettres
|35 humaines ». Le principal était assisté de deux régents, qu’il
devait loger et entretenir sur les trois cents livres de revenu, et, en outre,
il était tenu de loger, nourrir et instruire gratuitement deux enfants pauvres,
appelés déjà boursiers, qui étaient chargés de nettoyer les classes et de
« faire autre service honnête sans être distrait de leur étude ». Le collège
semble avoir bien fonctionné pendant une cinquantaine d’années, puisqu’il
comptait plus de cent élèves en 1626. Mais le désordre y fut alors introduit
par un principal incapable, presque toujours absent, Claude Vuaflard, et
dès 1628, il n’y avait plus que douze élèves. Vuaflard fut révoqué par le maire
et les échevins, auxquels le bailli, puis, le Parlement donnèrent raison.
Mais ils rencontrèrent encore des difficultés avec un nouveau principal et
c’est alors qu’ayant reçu dans l’intervalle une somme de 8000 livres léguée
au collège par le lieutenant général du bailliage, Jacques Petau, ils firent
appel aux Pères barnabites, établis depuis peu à Montargis. Leur administration,
qui devait durer plus d’un siècle, ne s’écoula pas sans nuages, contrairement
à ce qu’on eût pu espérer. Ils ne tinrent pas l’engagement qu’ils avaient
pris, pour satisfaire aux clauses du testament de Jacques Petau, de construire
un nouveau bâtiment et laissèrent l’ancien tomber en ruines. Ils ne résidèrent pas
au collège, mais dans l’hôpital Saint-Antoine, qui ne leur avait été donné
qu’en attendant l’édification du nouveau bâtiment et d’une chapelle. Enfin,
leur enseignement laissait tant à désirer qu’un mémoire dressé contre eux
par le maire et les échevins signale, entre autres griefs, que « c’est un
hasard quand quelqu’un des pensionnaires apprend le latin » et qu’un des régents
est un Suisse « qui a toutes les peines du monde à s’exprimer en français
». En dépit de nombreux mémoires semblables causés par « l’état affreux du
collège » et consécutifs aux plaintes réitérées des habitants, les barnabites
furent maintenus à la direction du collège jusqu’en 1779, après quoi ils ne
demeurèrent qu’en petit nombre à Étampes.
Parmi les améliorations qui furent apportées à notre
ville au XVIe siècle, il faut compter encore l’organisation de
la police les ravages des pillards et des assassins s’ajoutaient, en effet,
à ceux des gens de guerre et il devenait urgent de « purger » toute la région.
Un prévôt des maréchaux et un lieutenant criminel assisté d’un lieutenant,
d’un greffier et d’abord de quatre, puis de six archers, en furent chargés.
En 1563, Étampes était devenue le centre d’une maréchaussée, qu’elle conserva
après la répression des désordres.
À la même époque, les habitants d’Étampes, désireux
d’épargner aux jeunes gens les dangers de l’oisiveté et « l’occasion d’aller
fréquenter les tavernes et jeux scandaleux », obtinrent du roi Henri II l’autorisation
d’organiser des jeux d’arbalète et d’arquebuse, avec un concours et l’exemption d’impôts
durant un an pour |36 les vainqueurs. Le concours eut lieu chaque
année le 1er mai sur une place d’Étampes celui qui abattait le
« papegaut », l’oiseau de bois monté sur un mât, du trait de son arbalète,
était proclamé roi des arbalétriers, et celui qui triomphait de même en tirant
à l’arquebuse, roi des arquebusiers. L’un et l’autre recevaient un mouton
d’or ou quarante sols tournois. L’hôtel de l’Arquebuse, où se faisaient les exercices,
longtemps situé rue Saint-Jacques, fut transféré au XVIIIe siècle
sur le Port, à l’ emplacement du casino actuel ; il était alors le siège
d’une compagnie nombreuse de chevaliers, au somptueux costume, dont un portrait
conservé au musée
d’Étampes nous donne quelque idée. Ils se réunirent
pour la dernière fois le 15 août 1790 et firent la remise de leurs drapeaux, qui
furent suspendus à la voûte de Notre-Dame.
Enfin, c’est encore au XVIe siècle, en
1556, que fut rédigée « la coutume d’Étampes » c’est-à-dire l’ensemble des
usages locaux en matière de droit, grâce à laquelle les jugements pourraient s’inspirer
des mœurs et des traditions du lieu. Jusqu’alors, on suivait la coutume de
Paris qui avait été rédigée en 1510. À cet effet, les trois états du bailliage
furent convoqués à l’auditoire d’Étampes et les officiers royaux établirent
des cahiers préparatoires, qui furent ensuite discutés en la présence de Christophe
de Thou, premier président au Parlement de Paris et de deux conseillers.
La rédaction fut publiée dès 1557. Le procès-verbal de cette réunion des
trois ordres est un document précieux par les noms et l’état des personnes
qu’il nous fait connaître à cette date.
Cet examen des travaux et des progrès réalisés dans
notre ville au cours de ce siècle nous montre qu’elle était assez sagement administrée,
aussi bien par les officiers royaux que par la municipalité, comme l’avait
voulu le prudent Louis XII. La municipalité eut, en effet, le bon sens d’accepter
sa subordination, au lieu d’ engager de stériles querelles, et l’habileté
de se rendre presque toujours favorables les fonctionnaires du roi et ainsi
le roi lui-même. Elle n’en fut ni moins vigilante, ni moins dévouée aux intérêts
de la cité et c’est ainsi que peu à peu son rôle grandit. Elle ne réussit
pas, cependant, à faire d’Étampes une ville heureuse, comme le montre trop
bien le triste ensemble des plaintes, des suppliques des requêtes, des procès.
Mais cela tenait à deux causes indépendantes de sa volonté, qui réagirent
constamment l’une sur l’autre, et non pas seulement dans la période que nous
venons de considérer : d’abord la fréquence des guerres, civiles ou étrangères,
puis, le déplorable état des finances, entretenu précisément par les frais
de guerre. Les institutions financières présentaient à Étampes la même complexité
que dans les autres villes du royaume et nous n’ entreprendrons pas de les
exposer ici. On sait que les impôts, qu’ils fussent le cens, les aides, la taille
ou la gabelle accablaient |37 tous les non-privilégiés d’un véritable
fardeau, encore aggravé par le détestable système de l’affermage des taxes
à percevoir et par les malversations des receveurs. Notre région constituait
« l’élection d’Étampes », en tant que circonscription financière, vieille
dénomination conservée du temps où le peuple choisissait les hommes, dits «
élus », qui levaient ensuite les impôts sur un ordre du roi. Elle fut spécialement
atteinte par ces abus et ces charges, pour diverses raisons : sa réputation
de contrée riche, en dépit de sa faible étendue, l’impôt étant arbitrairement
réparti, le grand nombre de ses habitants exemptés de taxes et en fin, les
ruines qu’y avaient accumulées tantôt les guerres, dont elle fut si longtemps
le théâtre même, tantôt le passage dévastateur des troupes et des pillards.
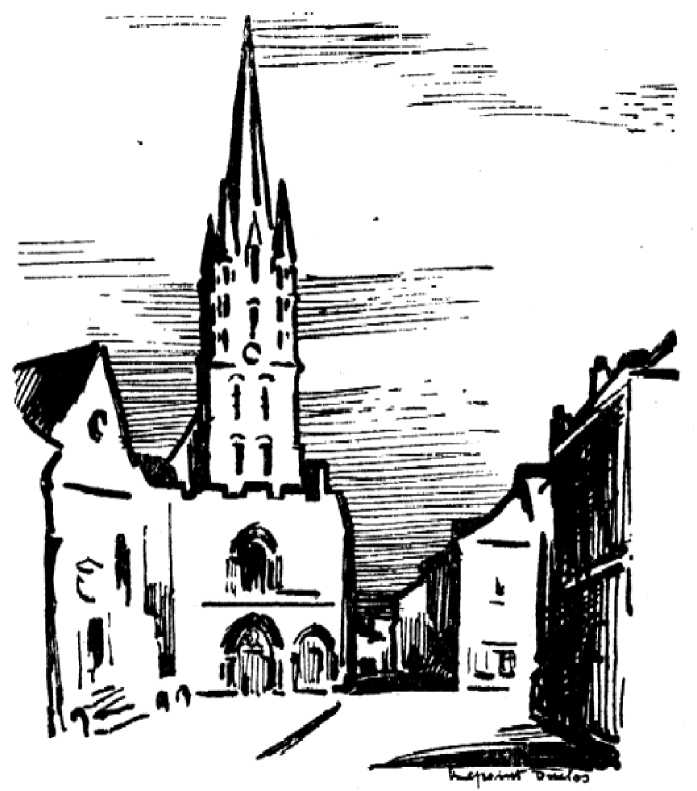
02. Les Guerres de Religion
«
Étampes magasin de vivres. — Ravages des huguenots. — Un prince palatin duc d’Étampes. — Organisation de la défense. — La Ligue et ses violences. — La ville cinq fois assiégée. — Henri IV à Étampes. — L ’apaisement. —
Ravaillac à Étampes.
Nous avons vu que le duché d’Étampes fut retiré à
Diane de Poitiers en 1559, quelques semaines après la mort du roi son amant.
François II n’ayant régné qu’un an, c’est Charles IX, qui, en 1562, renouvelle
le don du duché à Jean de Brosses, le mari d’Anne de Pisseleu, dont le dévouement
aux trois rois qu’il servit ne semble pas avoir eu de défaillances, au milieu
des troubles de l’époque. Il mourut en 1564 et les habitants d’Étampes lui
firent un service solennel en l’église de Notre-Dame.
Nous abordons maintenant une des plus douloureuses
périodes de l’histoire de notre ville. Comme elle avait été victime de la lutte
entre les Armagnacs et les Bourguignons, elle le sera de la nouvelle guerre
civile qui va déchirer la France, pendant plus de trente ans, entre les catholiques
et les protestants, armés les uns contre les autres non pas seulement par
des querelles religieuses, mais encore par les ambitions personnelles de
leurs dirigeants. 8
La mort brusque d’Henri II, la jeunesse des deux
rois qui lui avaient succédé, avaient éveillé, en effet, bien des aspirations rivales
à la cour, les princes du sang, les représentants des vieilles familles,
les grands chefs militaires convoitant chacun une part du pouvoir et cherchant
à prendre une influence prépondérante auprès des enfants qu’étaient les rois,
ainsi qu’auprès de leur mère Catherine de Médicis. À ces conflits d’intérêts
|40 s’ajoutaient les discordes religieuses : les Bourbon, Antoine,
roi de Navarre, père du futur Henri IV et son frère, Louis, prince de Condé,
étaient calvinistes, les Montmorency étaient les uns catholiques, les autres
protestants, comme Coligny, les Guise étaient des catholiques intransigeants.
En face de ces basses intrigues, d’un fanatisme qui s’exaspérait à chaque
incident et aussi du goût des combats, de l’aventure, du pillage, qui sommeille
toujours dans l’ homme et si particulièrement développé à cette époque, il
eût fallu l’ascendant d’une grande figure de roi, comme Henri IV quelques
années plus tard. Mais la carence d’une autorité souveraine devait fatalement
conduire à la guerre civile.
On sait que le premier épisode de cette guerre fut
la conjuration d’Amboise, en 1560. Leur complot ayant échoué, les conjurés protestants,
entraînés par le prince de Condé, en reformèrent aussitôt un autre et c’est
à Étampes qu’il fut déjoué. En effet, le messager ordinaire de Condé, un
Basque nommé Jacques La Sague, traversait la ville pour porter des ordres
au vidame de Chartres. affilié au parti protestant, lorsqu’il fut reconnu
et arrêté. Mais rien ne pouvait plus mettre obstacle à la guerre. « De la goutte
de sang versé à Amboise, avait prédit Calvin, découleraient des fleuves qui
inonderaient la France ». Les tentatives d’apaisement, les appels à la tolérance
que fit Catherine de Médicis, la régente, sous l’influence du chancelier Michel
de l’Hospital, restèrent sans effet.
Antoine de Bourbon, bien que calviniste, était lieutenant
général de l’armée royale. L’objectif principal de chacun des partis étant
comme toujours la prise de Paris, il organisa une partie de sa défense et
le ravitaillement de ses troupes dans la ville même d’Étampes, qui permettait
de garder une des routes de Paris. En avril et mai 1562, il y installa une
nombreuse garnison et un magasin de vivres, destiné non seulement à celle-ci,
mais encore à toute l’armée lorsqu’elle traverserait la région. C’est ainsi
que des mandements successifs ordonnent de réquisitionner tous les blés et
les vins, tant des particuliers que des marchands, avec prohibition de vente
et de sortie, d’établir la liste des vivres qui se trouvent « par toutes
maisons », de convertir les blés en farine, de construire de nouveaux fours
s’il y a lieu, de faire conduire à Guillerval, où l’armée du roi campe au
mois de juin, 5.000 pains cuits, avec avoine, foin et fourrage, de faire
dresser des étapes de « pain, vin, chairs et avoine » pour le passage de
1.200 chevaux pistoliers. En quelques mois, les malheureux habitants d’Étampes
fournirent près de 1.000 quintaux de blé et 100. 000 livres de pain, sans
compter l’ avoine, le vin, le lard, l’huile, la chandelle, le bois. Ces réquisitions
leur furent d’ autant plus préjudiciables que les récoltes de cette année 1562
furent atteintes par des pluies continuelles et glaciales. Enfin, la peste
qui ravagea une partie du nord de la France « jusqu’après la Saint-Rémy |41
(1er octobre) n’épargna pas notre pauvre ville. Et toutes ces
privations furent vaines, puisque le prince de Condé s’en emparait le 13
novembre 1562. Pendant que l’armée royale était occupée au siège de Rouen,
il s’était avancé d’Orléans vers Paris, après avoir joint à son armée des renforts
allemands : plus de 3.000 reîtres, gens de cheval armés de pistolets » et
4.000 hommes de pied. Pithiviers lui ayant ouvert ses portes, le maréchal
de Saint André, acquis aux Guise, se jeta dans Corbeil avec des troupes et
crut devoir appeler à lui la garnison d’Étampes, le matin du 13 novembre.
Le jour même, Condé était devant notre ville et la sommait de se rendre.
Sans défense, elle dut céder. Pendant six semaines, elle fut occupée par
les huguenots qui y commirent les pires excès. Ils avaient transformé les
églises en écuries pour leurs chevaux et, s’il faut en croire une tradition
fort vraisemblable, ce sont les reîtres allemands qui décapitèrent alors
les admirables statues du grand portail de Notre-Dame. Mais le duc de Guise,
ayant remporté la victoire de Dreux sur les protestants en décembre 1562,
allait assiéger Orléans et la nouvelle de son prochain passage à Étampes
mit en fuite les envahisseurs. Peu après, l’édit d’Amboise valut au moins
quatre années de paix à la France, mais les hostilités reprirent bien avant
que notre pays eût pu réparer le mal qui lui avait été fait. En septembre
1567, Condé et Coligny tentèrent de bloquer Paris où Charles IX s’était retiré. Claude
de la Mothe, seigneur de Bonnelles, fut envoyé par le roi à Étampes en qualité
de gouverneur de la ville et du château. Avec le concours de la municipalité,
il créa huit corps de garde, mit tous les habitants sous les armes, aménagea
les chemins de ronde à l’intérieur des murs, fit des réserves de vivres,
de fourrages, de bois et de munitions, réquisitionna des lits, des tables,
du linge, de la vaisselle, qui furent transportés au château. Tout cet effort
demeura vain, comme les précédents. Le 17 octobre, le comte de Montgomery,
commandant de fortes troupes qui venaient de prendre Janville-en-Beauce,
sommait encore Étampes de se rendre. Les habitants refusèrent d’abord et s’efforcèrent
à quelque résistance, mais bientôt la ville était prise par escalade et le
château se rendit. Les vainqueurs y installèrent une compagnie d’arquebusiers,
« pour tenir en sujétion tout le voisinage ». C’est lors de ce siège que
les protestants, entre autres destructions, brûlèrent l’église et le couvent
des Cordeliers, comme nous l’avons vu. Un nouveau monastère fut reconstruit
par les Cordeliers, ainsi qu’une église, quelques années plus tard, grâce
à des dons d’Henri III, de la noblesse et des habitants d’Étampes. Le bois
nécessaire fut pris sur des arbres de la forêt de Dourdan, avec l’autorisation
du roi.
La prise d’Étampes fut pour les conjurés une victoire
inutile. Battus quelques semaines plus tard, à Saint-Denis, ils durent abandonner
toutes les places qu’ils tenaient dans le voisinage de Paris, et |42
parmi elles, Étampes. Mais les hostilités continuaient. Le roi et le duc
d’Anjou, son frère, le futur Henri III, qui était lieutenant général du royaume,
se préoccupèrent de renforcer la défense d’Étampes. Ils y établirent de nouvelles
garnisons, sous le commandement d’officiers éprouvés. Le bailli, Nicolas
Petau, fut chargé d’organiser encore des réserves de grains, de rechercher
les vivres cachés dans les maisons ou abandonnés par les ennemis. Le blé
était déposé dans les greniers de l’hôtel Mesnil-Girault, rue de la Tannerie,
ainsi appelé parce qu’il appartenait au chapitre de Sainte-Croix d’Orléans,
possesseur de la châtellenie de Mesnil-Girault, au sud d’Étampes, dont il
nous reste un beau vestige. Deux bourgeois furent élus par l’assemblée municipale
pour y recevoir les blés, que tous les cultivateurs du bailliage apportèrent,
mais dont ils ne furent payés qu’entre 1573 et 1579. L’armée royale vint
camper quelque temps aux alentours, cherchant les moyens de dégager Chartres,
que Condé assiégeait avec près de 30.000 hommes. La situation était grave pour
le roi et9 Catherine
de Médicis, suivant les conseils avisés de Michel de l’Hospital, offrit la
paix, qui fut laborieusement conclue à Longjumeau en mars 1568. Petite paix, en vérité, ou paix fourrée, selon
les noms significatifs qu’elle reçut, car, six mois après, la guerre était
rouverte. Au moins, notre malheureuse région fut épargnée par ces nouvelles
luttes qui se déroulèrent au sud de la Loire. Elle semble également avoir
échappé aux horreurs de la Saint-Barthélemy, aucun document n’en faisant mention.
On sait que Charles IX mourut peu après en 1574.
Sous son règne, en 1566, une ordonnance importante, qui intéressait notre duché
d’Étampes, avait été rendue à l’instigation du sage Michel de l’Hospital,
pour régler les conditions des apanages : le domaine de la couronne était
déclaré inaliénable et ainsi, les apanages ne devaient jamais être regardés
que comme un usufruit, la propriété en demeurant toujours à la couronne.
Ils ne pouvaient être donnés aux femmes, mais devaient être réservés aux
puînés mâles de la maison de France et revenaient au domaine par la mort
du prince apanagiste sans postérité masculine, par son avènement au trône
ou par confiscation pour forfaiture. Une seule dérogation était prévue :
en cas de guerre, l’apanage pouvait être cédé contre la remise d’une somme d’argent
nécessitée par les circonstances, mais avec faculté perpétuelle de rachat
par la couronne. Cette prudente mesure permit au Parlement de s’opposer à
la concession du duché d’Étampes faite d’abord par Charles IX, au mépris
de sa propre ordonnance, en faveur de Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigues8.
Malgré les lettres de jussion adressées par le roi au Parlement, celui-ci
maintint son opposition. Une autre donation irrégulière du duché d’Étampes
demeura également fictive, celle que fit Henri III, en 1576, à Diane de France,
fille naturelle d’Henri II, femme de François de Montmorency. |10
Mais sous Henri III, l’anarchie gagna tout le royaume.
Les protestants groupés dans l’Union calviniste, réunissaient des assemblées, levaient des impôts, commençaient
de former un État dans l’État. Les catholiques modérés, révoltés devant les massacres
et les ruines et s’ inspirant de la tolérance de Michel de l’Hospital, avaient
constitué, contre les catholiques intransigeants, le parti des Politiques ou des Malcontents, sous
la direction du dernier frère d’Henri III, le duc d’Alençon. En face de ces
divisions, le roi, sans autorité personnelle, ne savait quel parti prendre.
Les calvinistes s’étant unis au duc d’Alençon, firent appel avec lui au comte
Palatin, dont ils reçurent 20.000 hommes, sous la conduite de son fils Jean
Casimir, qui pillèrent une partie de la France jusqu’au Bourbonnais, et ils
marchèrent de concert sur Paris. Le roi, effrayé d’une telle menace et hors d’état
de résister, signa en 1576, près de Sens, un traité dit la paix de Monsieur qui accordait de nombreux avantages aux protestants, augmentait
l’apanage de Monsieur, duc d’Alençon, et abandonnait à Jean Casimir Palatin
le duché d’Étampes. Au milieu de pareils désordres, le Parlement ne s’opposa
pas à cette donation, pourtant moins acceptable qu’aucune autre. Mais dès 1577,
Jean Casimir, mécontent de n’avoir pas touché les paiements convenus, fit
remettre au roi tous les dons qu’il avait reçus de lui et ainsi le duché
revint à la couronne. Deux ans plus tard, le roi se conformait cette fois
à la fameuse ordonnance de Charles IX relative aux apanages : le « cas de
guerre » ne cessait pas d’exister malheureusement et permit d’ engager le
duché d’Étampes, avec faculté de rachat, à la duchesse de Montpensier, fille
de François de Guise, contre un prêt au roi de 100.000 livres, dont elle
devait toucher l’intérêt au denier douze, c’est-à-dire à 8,33%, sur les revenus
du duché. Henri III dut être en état de racheter bientôt le duché d’Étampes,
puisqu’il le donna dès 1582 à sa sœur Marguerite de Valois, pour compléter
la dot qui lui avait été promise au moment de son mariage avec Henri de Bourbon,
roi de Navarre, le futur Henri IV.
La paix de Monsieur, par sa tolérance à l’égard des
protestants, avait violemment mécontenté les catholiques qui formèrent à
leur tour une ligue composée d’associations locales, répandues peu à peu
dans une grande partie de la France ; celle d’Étampes ne fut constituée qu’en
1587. Mais Henri III s’était proclamé le chef de la Ligue dès 1577 et les
calvinistes avaient aussitôt repris les armes. Jusqu’en 1580, la guerre fut
presque constante ; cependant elle épargna notre région11.
En 1584, la mort du duc d’Alençon ralluma les passions,
le chef des calvinistes, Henri de Bourbon, devenant ainsi l’héritier de la couronne
et les catholiques refusant d’admettre qu’un protestant pût être un jour
le roi. Henri de Guise surexcita l’ardeur des catholiques, |44
qui servait son ambition d’accéder au trône à la mort d’Henri III : il donna
une nouvelle impulsion à la Ligue, s’allia avec le roi d’Espagne Philippe
II, leva des troupes dans tout le royaume et obtint du roi la révocation
de tous les édits de tolérance en faveur des calvinistes. Une nouvelle guerre
devenait inévitable. Henri III ordonna de s’ y préparer aux villes qui lui étaient
restées fidèles. Étampes était encore de celles-là. En mars 1585, Philippe
Hurault, comte de Cheverny, gouverneur d’Orléans et de Beauce, avertit les
habitants d’Étampes qu’ils devaient veiller à la sûreté de leur ville. On
décida de fermer cinq portes, en les murant, et d’ en laisser seulement trois
ouvertes, celles de Saint-Martin, de Saint-Jacques et de Saint-Pierre. Le château
était gardé jour et nuit par des habitants, choisis chaque jour par le maire
et les échevins et commandés par le sieur de Blaville, capitaine. Le roi
leur mande le 21 avril : « qu’il juge leur ville très importante pour le
bien de son service et qu’ils ne doivent permettre à aucune troupe d’y entrer
sans son exprès commandement signifié par lettres signées de sa main ». Peu
de temps après, le comte de Cheverny informe les habitants, de la part du
roi, qu’ils doivent lui désigner un nouveau gouverneur pour leur ville, soit
que le sieur de Blaville ait été inférieur à sa tâche, soit qu’on ne voulût
pas laisser le même homme longtemps dans sa charge par crainte des défaillances
ou même des trahisons. Les habitants proposèrent au roi le seigneur de la Mothe-Bonnelle,
qui avait déjà préparé la défense en 1567. Il fut agréé et la municipalité
lui remit le soin d’organiser la garde du château, qu’elle assumait jusqu’alors
au moyen des dizaines : dix hommes étaient placés en sentinelles et remplacés
par dix autres, toutes les quatre heures, nuit et jour. Les habitants, comme
le maire et les échevins eux-mêmes, firent preuve de la plus grande discipline,
qui trouva sa récompense dans le fait que les hasards de la guerre laissèrent
leur ville à l’abri des combats pendant quatre ans. Elle n’eut à subir que
des passages de troupes ou des alertes, lorsque les Allemands et les Suisses,
appelés par les calvinistes, s’étendirent à travers toute la Beauce. Étampes
avait gardé du précédent passage des reîtres de cuisants souvenirs, aussi
les habitants étaient-ils résolus à tenir bon. Ils firent enlever toutes
les échelles des faubourgs pour interdire l’escalade des murailles et ils
reçurent des renforts de l’armée royale, commandés par le seigneur de Sainte-Marie.
Mais la bataille se livra dans Auneau, où le duc de Guise infligea une sanglante défaite
aux Allemands et aux Suisses, le 24 novembre 1587, puis, il se retira dans
Étampes où il fit rendre des actions de grâce. La victoire d’ Auneau permit
au roi d’ obtenir de ces troupes étrangères le serment de rentrer dans leur
pays, ce qui serait exécuté sous son autorité « sans aucun déplaisir pour
elles ». Ce serment fut reçu par le seigneur d’ Inteville, au-dessus de Chalo-Saint-Mard,
et dans la plaine du grand Chicheny, où les |45 Suisses s’étaient
rangés en bataille. Ils s’engagèrent « par acclamation militaire et lévement
de mains » et leurs colonels signèrent l’acte dressé à cet effet par deux
notaires royaux d’Étampes, le 2 décembre 1587.
Quelques autres succès remportés ailleurs par Henri
de Guise, et présentés comme d’éclatantes victoires, enflammèrent les Ligueurs.
Ils fomentèrent des émeutes à Paris contre le roi. Pour les apaiser, Henri
III dut recourir au duc de Guise et bientôt après, il signait sous la contrainte,
à Chartres, en juillet 1588, un traité avec les chefs de la Ligue, qui leur
accordait de nouvelles concessions et ordonnait l’entière extirpation de
l’hérésie. Le traité fut publié en forme d’édit, juré solennellement dans
la cathédrale de Rouen et envoyé dans tous les bailliages pour être aussi
solennellement juré par les habitants. Ceux d’Étampes adhérèrent ainsi à
la Ligue le 19 août 1588 : les ecclésiastiques, le tiers état et le bailli,
Michel de Veillard, sans aucune protestation, mais les autres gentilshommes,
avec des restrictions sur « l’obligation de leurs biens, qu’ils n’entendaient
pas être compris par leurs signatures ». On fit même jurer des enfants, Urban
de Poilloüe et son frère Abel, âgés de dix-sept et treize ans, signèrent
à la place de leur père, mort en 1582.
Le roi avait perdu toute autorité : aux États généraux,
qu’il convoqua à Blois en octobre 1588, Henri de Guise apparut comme le vrai
souverain. Ainsi s’explique la criminelle décision d’Henri III : la mort
de son rival lui sembla la seule délivrance possible de l’étau dans lequel
il s’était laissé prendre. Les deux Guise assassinés, les États généraux
saisis d’épouvante et bientôt congédiés, il put dire : « À présent je suis
roi », mais roi d’un malheureux royaume, soulevé de révolte, déchiré de fanatisme, ivre
de violences et de meurtres. Notre ville, pacifique et soucieuse de justice,
fut victime de ces fureurs. Les Ligueurs, à la suite de l’assassinat de leurs
chefs, avaient déchaîné à Paris une véritable insurrection contre le roi
et aussitôt organisé un gouvernement révolutionnaire, le Conseil des Seize, composé de représentants élus des seize quartiers de Paris.
Voulant s’assurer de la ville d’Étampes, grenier de la Beauce toujours convoité,
qui leur facilitait, en outre, la communication avec Orléans, ils y installèrent
une garnison, sous le commandement d’un de leurs partisans exaltés des environs,
François d’ Izy, seigneur de la Montagne. Il fit emprisonner Nicolas Petau,
l’ancien bailli, avec ses enfants, comme mauvais catholique, puis, le prévôt,
Jean Audren, sous le même prétexte. Mais les habitants d’Étampes donnèrent
un bel exemple de courage par leur protestation : ils témoignèrent que Nicolas
Petau s’était dévoué à la chose publique pendant trente-six ans et qu’il
était bon catholique, de même qu’Audren. Puis, ils convoquèrent une assemblée
spéciale, le 18 février 1589, pour refuser un successeur d’Audren, Simon de
Lorme, avocat au Parlement qui avait été |46 envoyé d’office comme
nouveau prévôt par le Conseil des Seize.
Henri III, pour reconquérir son royaume, s’était
réconcilié avec Henri de Navarre, en avril 1589, et tous deux s’avancèrent
sur Paris avec une armée de 35.000 hommes de pied et 5.000 cavaliers. Lorsque
cette nouvelle parvint à Paris, le duc de Mayenne, dernier des Guise, qui
avait été fait lieutenant général du royaume par le gouvernement révolutionnaire,
renforça la garnison d’Étampes et la mit sous le commandement d’un autre ligueur,
le seigneur de Pussay, le château devant être défendu par le capitaine de
Saint-Germain. Mais ces troupes étaient bien trop insuffisantes pour résister
à la forte armée qui mit le siège devant Étampes le 23 juin 1589. Deux batteries
furent installées, l’une à l’extrémité de la ville, du côté d’Orléans, l’autre
sur la colline en face du château pour abattre la courtine qui le couvrait.
La première ayant bientôt ouvert une brèche, l’assaut fut donné et la place
fut prise, malgré quelque résistance des défenseurs, qui furent faits prisonniers,
puis, le château se rendit. La ville fut livrée au pillage pendant trois
jours ; les officiers royaux qui se trouvèrent convaincus de rébellion furent
punis et le seigneur de Saint-Germain, capitaine du château, qui avait été
page d’Henri III, eût été pendu, quoiqu’il fût gentilhomme, si le duc d’Épernon,
son ami, ne lui eût obtenu la grâce du roi. Enfin, nous dit le bon Fleureau,
« le viol ne fut pas permis, néanmoins, il y eut quelques femmes qui ne l’évitèrent
point ».
Pendant le court séjour que fit Henri III à Étampes,
il y reçut la nouvelle qu’il était menacé d’excommunication s’il ne consentait à
une pénitence pour le meurtre du cardinal de Guise et s’il ne libérait pas
les prélats emprisonnés par lui. Il en fut si affecté qu’il refusa de manger
durant vingt-quatre heures. À quoi, le roi de Navarre, qui connaissait les
hommes, lui dit : « Sire, le plus sûr remède est de vaincre, ainsi, nous
serons absous. Mais si nous sommes vaincus, nous demeurerons excommuniés,
voire même aggravés ». Après s’être emparés de Châtres (aujourd’hui Arpajon),
de Pontoise, 1’Isle-Adam, Creil, Poissy, ils mirent le siège devant Paris,
mais c’est alors qu’Henri III fut assassiné, le 1er août, par
le moine Jacques Clément. On sait qu’Henri IV devait mettre près de cinq
ans à conquérir son royaume.
En juillet 1589, un nouveau gouverneur avait été
envoyé à Étampes, le seigneur Paul Touzin, pour y tenir garnison avec trois
compagnies. Tous les habitants avaient prêté serment de fidélité au roi Henri
III et ils se mirent en demeure de réparer la brèche faite par lui à leurs
murs. Touzin avait été remplacé par le capitaine Rigault, dans le commandement
de la place, lorsqu’elle fut encore assiégée le 20 octobre 1589, mais par
les Ligueurs cette fois. En effet, le duc de Mayenne, à la mort d’Henri III, avait
vu son armée s’accroître de tous ceux qui abandonnaient Henri IV, puisque
la fortune semblait |47 lui devenir hostile. En outre, la tolérance
et le désir d’ union du roi de Navarre ne pouvaient être compris que d’une
faible élite et les innombrables fanatiques des deux partis se dressèrent
contre lui. En quelques jours, son armée fut réduite de moitié. Il dut lever
le siège de Paris, mais il demeura en Normandie, au lieu de se retirer dans
le Midi où se trouvaient les vieilles troupes calvinistes, comprenant bien
que la conquête de Paris devait être son objectif essentiel. Le duc de Mayenne,
resté maître de la capitale, étendit ses forces autour d’elle et, comme il
fallait des vivres, Étampes fut une des premières villes attaquées. Elle
capitula, bien que le capitaine Rigault fût un brave, mais il avait une garnison
trop réduite et il se rendit, au moins avec composition, au lieutenant du
duc de Mayenne, Chrétien de Savigny, seigneur de Rosne. Néanmoins, d’abominables
exécutions furent commises : le bailli Nicolas Petau fut tué et le prévôt
Jean Audren, nous dit un témoin, « encore plus maltraité », poursuivis par
la rancune des Ligueurs, qui déjà les avaient fait emprisonner l’année précédente,
comme mauvais catholiques. L’on sait, par ailleurs, que Jean Audren fut pendu
par les soldats le 23 octobre. C’est donc à tort que ces deux meurtres furent
imputés aux protestants de l’armée d’Henri de Navarre, comme l’a fait un
historien moderne.
Cependant, Henri IV commençait à donner la mesure
de sa vaillance, de son esprit organisateur et de sa valeur militaire. Il avait
battu le duc de Mayenne dans une série de combats à Arques, à la fin de septembre
1589. Mayenne s’étant retiré en Picardie, le roi ordonna de rompre les ponts
de l’Oise pour couper la route de Paris au vaincu et il vint assiéger Paris,
le 31 octobre. Mais un pont n’avait été détruit qu’à moitié : en quelques
heures il fut rétabli, Mayenne passa avec son armée et pénétra dans Paris.
Malgré quelques succès dans les faubourgs, le roi jugea plus sage de se replier,
dès le 3 novembre, sur Linas et le 5, il campait sous les murs d’Étampes.
Alexandre de Castelnau, comte de Clermont-Lodève, occupait la place pour
la Ligue avec cinquante gentilshommes et quelques gens de guerre. Il dut
renoncer à toute résistance, les habitants « ayant abandonné la garde pour
ne pas tenir contre leur roi », et se rendit à la première sommation. Cette
fois, il n’y eut ni sang versé, ni pillage, quoique les troupes « du roi
sans couronne et général sans argent » n’eussent pas de solde. Henri IV demeura
sept jours à Étampes. La tradition veut qu’il ait séjourné à Brières-les-Scellés,
dans le petit château, dont une partie, devenue une ferme, subsiste encore,
en particulier une belle salle du XVIe siècle, qui entendit sans
doute les joyeux propos du Béarnais. Les habitants d’Étampes profitèrent
du séjour du roi pour lui demander l’autorisation de détruire leur château,
qui, faisant d’Étampes une ville dite « forte », avait entraîné pour elle
tant de combats, de ruines et de misères. Henri IV, non seulement consentit
à la démolition du château, mais fit entreprendre |48 la destruction
de ce qui restait des murailles. II acheva de donner la preuve de son libéralisme
en permettant aux habitants de rester neutres dans la lutte qu’il poursuivait.
Un conseil du roi fut tenu à Étampes à ce moment,
réunissant des princes du sang, les maréchaux de France, des officiers et
des gentilshommes du royaume. Un envoyé de la reine Louise de Lorraine, la
veuve d’Henri III, y vint de sa part réclamer justice de l’assassinat de
son mari, en priant que fussent recherchés les complices éventuels de l’assassin,
Jacques Clément, qui avait été massacré sur place et ainsi, n’avait pu être
interrogé. À la lecture de ce message, le hardi Béarnais se demanda-t-il
si le sort d’Henri III ne lui était pas réservé ? C’est possible, en ce temps où
le péril de mort était partout, mais il n’ était pas homme à s’y arrêter,
lui qui répondait aux reproches de Sully sur sa témérité : « C’est pour ma
gloire et pour ma couronne que je combats ma vie ne me doit être rien à ce
prix ». Mais comment cette requête de la reine Louise, adressée à Henri IV
et reçue à Étampes précisément, ne nous ferait-elle pas songer au même destin tragique
qui devait atteindre vingt ans plus tard le malheureux roi ? Son assassin
eût été, lui aussi, massacré dans la rue de la Ferronnerie, si d’Épernon,
comme saisi d’un souvenir, n’avait crié qu’on se gardât bien de tuer le régicide,
ce régicide qui avait pris sa fatale décision dans notre ville même.
Henri IV poursuivit sa route vers Orléans. Nous ne
le suivrons pas dans sa difficile et glorieuse conquête. Mais nous signalerons qu’au
moment où parvint à Étampes la nouvelle de l’intervention de plus en plus
active du roi d’Espagne dans les affaires de France, de l’installation d’une
de ses garnisons dans Paris pour aider les Ligueurs, enfin, de ses visées
sur le trône même de France pour sa fille, les habitants furent si émus qu’ils
se réunirent en une assemblée générale. Ils jurèrent d’une commune voix de
vivre et mourir en bonne union et concorde et de se maintenir sous l’autorité
de la seule couronne de France.
En 1590, le duc de Mayenne leur demanda de constituer
un magasin de vivres pour son armée et de lever une contribution : ils purent
refuser l’un et l’autre en alléguant leur misère, qui n’ était que trop réelle.
Mais ils furent obligés d’ accueillir une garnison pour assurer la liberté
de la route de Paris à Orléans et la subsistance de l’armée espagnole voisine
sur le pays d’ alentour.
On sait que Paris se rendit enfin à Henri IV le 22
mars 1594. Mais il restait des Ligueurs impénitents : nous en citerons un exemple
caractéristique qui intéresse quelque peu notre ville. C’est celui de Marie
Baron, femme du jurisconsulte René Choppin, seigneur d’ Arnouville-en-Beauce,
qui furent enterrés tous deux d’abord à Paris, mais dont la pierre tombale
est conservée maintenant au musée |49 d’Étampes. Marie Baron était une
ligueuse si passionnée qu’à l’entrée d’Henri IV à Paris, elle se jeta par
la fenêtre.
Cependant, sous l’autorité du roi, si heureusement
tempérée de bonhomie souriante, grâce à sa compréhension des hommes et au dévouement
qu’il ne cessa d’apporter à son œuvre immense de reconstruction, après tant
de ruines, l’apaisement se fit dans les esprits, l’ordre fut restauré et
le relèvement s’accomplit peu à peu. Notre région nous offre une image de
cette pacification, au moins sous une forme indirecte, puisque, comme les
peuples heureux, elle n’a plus d’histoire jusqu’à l’aurore du règne de Louis
XIV. Nous citerons, pourtant, un exemple local de l’entente survenue entre
les partis, armés naguère dans une lutte sans merci. François de Prunelé,
seigneur de Guillerval, blessé à Cérisoles en 1544, protestant convaincu,
avait été tué en Beauce par les Ligueurs, en 1587, et sa propre fille Anne,
épousa en 1596, Abel de Poilloüe, qui avait été cependant un des signataires de
la Ligue à Étampes.

Nous ne pouvons omettre non plus le passage de Ravaillac
dans notre ville et notre région, qui n’est point une légende. On sait que
l’assassin conçut longuement son projet. Après un premier séjour à Paris,
en janvier et février 1610, où il n’avait pu approcher le roi, il rentra
chez lui à Angoulême, puis en repartit le 11 avril, pour arriver à Paris
vers le 25. De son aveu même, il ne tente plus alors de voir le roi ; il
s’installe dans une auberge du faubourg Saint-Jacques et, presque aussitôt
son arrivée, dérobe dans une hôtellerie un couteau, dont il fait remplacer
le manche de baleine par un manche en corne de cerf. Puis, brusquement, il
semble abandonner sa criminelle intention et quitte Paris, au début de mai,
pour rentrer à Angoulême. Il passe par Auvers-Saint-Georges et s’arrête au hameau
de Chanteloup, où il brise la pointe de son couteau en l’introduisant dans
l’essieu d’une voiture, comme pour s’interdire l’usage qu’il avait médité
d’en faire. Il reprend sa route, traverse Étampes, mais arrivé au faubourg Saint-Martin,
devant la statue de l’Ecce homo, en
un petit carrefour qui occupait l’angle actuel de la rue de Saclas, il a,
dira-t-il lui-même, une vision, qui le pousse brusquement à aiguiser
son couteau sur une pierre. Alors, il reprend le
chemin de Paris et son forfait s’accomplira le 14 mai.
On sait que la tête de cette statue de l’Ecce homo, de si tragique mémoire, a été conservée et qu’elle est aujourd’hui
au musée d’Étampes.

Eudes le Maire, vue d’artiste
(détail d’un vitrail de l ’église parisienne de Saint-Étienne-du-Mont en
date de 1614 (© Benoît Maury)
03. Le privilège de Chaio-Saini-Mard
0
Dans les intéressants articles qu’il a publiés récemment
dans Y Abeille d’Étampes (mars 1929), M. René Guitton12 13 rappelle le singulier privilège dit de Chalo-Saint-Mard, accordé
à la descendance d’ Eudes Le Maire. Il est peut-être de quelque intérêt d’
examiner l’origine de cette institution et d’en discuter la légitimité.
Le pèlerinage à Jérusalem, qu’accomplit, en un long
voyage de deux années, pour le compte du roi de France, un habitant d’Étampes
nommé Eudes Le Maire, surnommé Chaillou ou Challot, est d’une date incertaine.
Suivant une tradition consacrée en 1514 par deux lettres patentes et un arrêt
du Parlement, Eudes Le Maire aurait vécu sous Philippe-le-Bel, pour d’ autres
sous Philippe-Auguste et il aurait pris part à la troisième croisade en 1191.
Enfin, selon la plupart des auteurs, c’est pour Philippe Ier,
en 1085, que le pèlerin aurait accompli le vœu imprudent du roi. Cette première
hésitation n’embarrassait point cependant les descendants présumés du personnage,
car les privilèges attachés à cette ascendance illustre valaient bien qu’on ne
s’arrêtât pas trop à des difficultés d’ordre purement historique. On sait
en effet, que les descendants d’Eudes jouissaient d’une exemption totale
d’impôts, tailles, aides, subsides et droits quelconques à l’égard du roi
et des vassaux. En outre, ils étaient investis du privilège de la noblesse,
ce dernier point, il est vrai, d’après les privilégiés eux-mêmes. On comprend
donc quel intérêt il y avait à se rattacher à la lignée de Challot et, comme les
femmes bénéficiaient de la franchise aussi bien que les hommes, tout le monde
voulait prendre femme à Étampes, où vivaient la plupart des descendants d’Eudes.
Aussi la fécondité de la famille devint-elle si prodigieuse que François
Ier dit un jour que bientôt tous les marchands du royaume descendraient d’Eudes
Le Maire. À Paris, organisés en communauté, ces privilégiés élisaient annuellement
un syndicat. C’est là qu’on vérifiait les titres des nouveaux postulants
pour les admettre.
Ces preuves étaient toutes simples : il suffisait
d’établir que le candidat se rattachait à l’une des familles qui se disaient
issues d’Eudes Le Maire. La famille Chartier était du nombre. Alain Chartier
ayant épouse, affirmait-on, Tiphaine Le Maire, propre fille d’Eudes. Nous
donnons, à titre d’exemple, les preuves que fit valoir, en 1593, un riche
bourgeois d’Étampes, Jehan Fouldrier, pour obtenir le privilège. Nous avons
l’expédition sur parchemin de cette pièce, datée du 29 octobre 1593, passée devant
Claude Hamoys, notaire royal à Étampes. Par devant lui comparaissent : «
Étienne Poignard, Pierre Pouville et François Canivet, bourgeois d’Étampes,
gardes jurés et établis par justice pour régir, garder et gouverner les droits,
statuts, franchises, libertés donnés et octroyés par les rois de France à
défunt Eudes Le Maire et à ceux de sa postérité, consanguinité et ligne ».
Ces gardes jurés du privilège attestent, après avoir entendu, à la requête
de Jehan Fouldrier, cinq témoins « ni suspects, ni favorables » que Noelle
David, femme dudit Fouldrier, est « issue et descendue de la lignée dudit
Eudes Le Maire, ainsi qu’il leur est apparu parce que Noelle est fille d’Émery,
lequel était fils de Pierre, lequel était fils de Henry et de Thiphanne Hardy,
ladite Thiphanne étant fille de Marc et de Simone Chartier, ladite Simone
fille de Jehan Chartier, ledit Jehan fils de Guillemin, et le dit Guillemin
fils de Jehan Chartier ». la preuve s’arrête là, puisque la descendance remonte
à un Chartier. Il n’est point question de date, d’actes d’état-civil ou notariés
ou judiciaires ? L’ attestation des cinq témoins « ni suspects ni favorables
» a suffi. Sur ce, Accurse Cassegrain, licencié ès-lois, prévôt d’Étampes,
proclame que Jehan Fouldrier doit « jouir desdits droits, franchises et libertés
concédés par les rois de France à Eudes Le Maire ». Cet acte fut passé dans
la salle de l’Hôtel de Ville d’Étampes et scellé au contrat de la Prévôté.
Rien ne manquait donc au caractère officiel de la franchise.
Examinons maintenant, à la lumière de la critique
moderne, en suivant l’argumentation qu’a donnée l’archiviste Noël Valois, l’
authenticité réelle du privilège. À la vérité, dès une époque très reculée,
cette franchise fut contestée. Le nom des descendants d’Eudes et, par suite,
des Français exempts d’impôts, avait, dès le XVIe siècle, inquiété
les rois. Henri III, en 1578, qualifie leur nombre d’excessif. En 1596, Henri
IV les évalue à 7 ou 8.000 et s’en préoccupe. Mais ce ne sont pas là des
arguments décisifs. En examinant les textes originaux, diplômes des rois
octroyant le privilège, on s’aperçoit qu’une note, invoquée par les descendants
d’Eudes, soi-disant insérée « dans les registres de la Chambre des Comptes
sous Charles-le-Bel », ne se retrouve ni dans les mémoriaux reconstitués
après 1737, ni dans les mémoriaux anciens de nos archives nationales. Un
passage d’une ordonnance de Saint-Louis, de 1254, citée pour la première
fois par Dom Basile Fleureau, est rédigée par un éditeur de 1528. Or Fleureau,
ainsi que Nicolas de la Mare dans son Traité de la Police, a confondu la
prose de l’éditeur et le texte de l’ordonnance. En 1336, divers héritiers
d’Eudes demandent à Philippe VI la reconstitution d’une charte « détruite
pour avoir été laissée dans l’excavation d’un vieux mur et dont il ne reste que
le sceau ». Onze témoins affirment la conformité de cette copie avec la charte
qui avait été octroyée par le Roi dans les huit années précédentes. Philippe
VI fait reconstituer cette charte qui ratifie les dispositions d’un ancien
diplôme de Philippe Ier. Mais ni Philippe VI ni ses gens ne virent
ce fameux diplôme délivré près de trois siècle auparavant. Trois abbés de
Paris, les abbés de Saint-Magloire, de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève, certifièrent
bien que cette copie était conforme au texte du diplôme, mais la compétence
des bons abbés était fort douteuse et, de plus les héritiers de Challot présentèrent
aux abbés une notice s’écartant, par la forme au moins, du texte de l’original. Les
héritiers avaient évidemment intérêt à faire disparaître le diplôme auquel
ils ont substitué la notice. Enfin ce diplôme lui-même devait être faux,
comme d’Hozier, dans son Armorial général publié au XVIIIe siècle,
l’a déjà montré. En effet, les grands officiers qui ont signé cette pièce
en 1085 ou 1086, ne sont entrés en possession de leur charge qu’en 1106.
C’est à cette date seulement qu’apparaissent leurs signatures dans les diplômes
de Philippe Ier. Les formules de ce diplôme ne sont connues qu’en
1106 ou 1107 dans les diplômes de Philippe Ier et appliquées à
des concessions solennelles faites à des églises ou à des monastères. Il
semble donc bien que les héritiers d’Eudes Le Maire, au courant de ces formules,
les aient postérieurement appliquées à une charte fort simple qu’ils pouvaient
posséder.
D’Hozier croit que la rédaction de cette pièce a
été inspirée surtout d’emprunts faits à la Chronique de Morigny et il accuse même
ces héritiers d’avoir détruit une partie de cette chronique parce qu’elle
gardait le silence sur les exploits d’Eudes Le Maire, ce qui constituait
une forte présomption contre l’authenticité de la légende. Cette accusation
est évidemment hasardée, mais elle suffirait, s’il fallait y ajouter foi,
à faire maudire la mémoire de ces héritiers, avides de privilèges, car nous
aurions perdu par leur faute un des plus précieux documents historiques sur
cette époque reculée. Malgré l’ incertitude des documents, les descendants
d’Eudes obtinrent de Philippe VI l’homologation de leur charte. Puis tous
ses successeurs furent saisis d’une demande tendant à sa ratification, ce
qu’ils accordèrent sans restriction jusqu’en 1541 où François Ier
parle seulement d’un « certain prétendu privilège de feu bonne mémoire le
roi Philippe-le-Bel ». Mais la restriction qu’il apporte alors est oubliée
en 1550 et Henri II confirme l’ancien privilège. Cependant, en 1598, Henri
IV le supprime par un édit, mais le Parlement donne encore gain de cause
aux héritiers d’Eudes contre les collecteurs des tailles. Henri IV entreprend
une lutte pied à pied contre le Parlement qui s’oppose à sa volonté et il
obtient enfin satisfaction en 1602 : le Parlement « cède au très exprès commandement
du roi plusieurs fois réitéré ».
C’est la fin du privilège, malgré la résistance des
intéressés qui luttèrent encore pendant un siècle au moins. Vers 1752, d’Hozier veut
voir la copie de la notice conservée à Étampes, à l’Hôtel de Ville, au dire
de Dom Basile Fleureau, afin de vérifier l’authenticité du privilège. Il
écrit au maire de notre ville sans en obtenir de réponse, puis à un chanoine
d’Étampes connu pour son érudition sans plus de succès. Il estime la question
jugée et la fausseté démontré.
Rien ne permet aujourd’hui d’infirmer ce jugement
et la légende du pèlerinage et du privilège qui s’ensuivit doit être rangée
parmi ces contes poétiques et charmants qui bercent l’ imagination des hommes
sans emporter leur conviction. 14 disparaître, dans la suppression générale
des privilèges, les droits vraiment singuliers des hoirs de Chalo-Saint-Mard.
Nous pouvons nous demander aujourd’ hui comment même ils se perpétuèrent
si longtemps.
Mais ceux qui, comme l’ auteur de ces lignes, croient
pouvoir se rattacher encore à la lignée du bon pèlerin de Chalo évoquent parfois
avec mélancolie son dévouement héroïque et la récompense qu’en obtinrent
ses descendants. En recevant l’avertissement annuel par lequel le percepteur,
cet actuel collecteur des tailles, leur rappelle leur devoir fiscal, ils
songent qu’il fut un temps où la vertu de leur ancêtre et son laborieux voyage
leur eussent évité le titre honorable, mais toujours plus lourd à porter,
de contribuable.
R. de Saint-Périer.
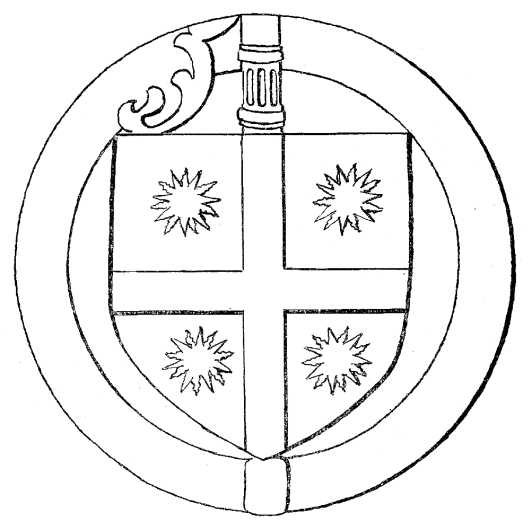
Fig. 1 — L ’écu des Hurault, abbés de l ’ancienne abbaye
de Morigny. Clef de voûte de la chapelle de l'abbé. (Parc du château de Morigny)
04. L’écu des Hurault à
Morigny 2
On sait que le village de Morigny n’est devenu paroisse,
puis commune, que dans les dernières années du XVIIIe siècle,
après la Révolution. Jusque-là, il s’appelait Saint-Germain-les-Étampes et
groupait ses quelques maisons autour de l’emplacement du cimetière de Morigny,
qui lui-même entourait l’église paroissiale, dédiée à Saint-Germain, à 1.500
mètres environ au sud du village actuel de Morigny. Celui-ci ne comprenait
qu’une grande église abbatiale, des bâtiments conventuels et quelques petites
maisons destinées à l’usage de l’abbaye bénédictine. Cette abbaye avait été
fondée en 1084 ou 1094 sur des terres données par un seigneur nommé Anseau
de Garlande, frère d’Étienne, sénéchal et chancelier du roi Louis VI le Gros.
Des religieux bénédictins d’une abbaye des environs de Beauvais, Saint-Germer-de-Fly,
dont la magnifique église existe encore aujourd’hui, étaient venus s’établir
d’abord à Étréchy, sur l’invitation de ce seigneur de Garlande, puis à Morigny,
où leur fondation devait subsister jusqu’à la Révolution. |124
L’église abbatiale fut achevée dès le début du XIIe
siècle et consacrée en 1119 par le pape Calixte II lui-même, alors en France
pour la réunion d’un concile. Il ne demeure de cette église que la première
travée de l’édifice actuel. La seconde travée, en tiers point lancéolé, faisait
partie d’une seconde église, du XIIIe et du XIVe siècle,
à laquelle appartenait aussi le beau clocher qui nous reste, mais sur laquelle
nous n’avons aucun document. 15
Enfin, tout le chœur fut reconstruit en 1542, en
raison de la ruine de l’édifice primitif, car nos moines étaient pauvres
alors, et ne pouvaient guère entretenir leurs vastes bâtiments. À l’arrière
de ce chœur, il existe encore une petite chapelle de cette époque qui porte
à sa clef de voûte l’écu dont nous vous communiquons le dessin.
Vers 1860, la comtesse Mollien, qui habitait le château
de Jeurre, sur la commune de Morigny, et dont le goût était bien de son époque,
jugea qu’un chœur en pierre était bien nu pour son église et elle le fit,
hélas ! revêtir de coûteuses boiseries, du style Louis-quinzième-second-Empire.
Il fallut à cette occasion murer la chapelle et ainsi la séparer de l’ église,
ce qui fut fait par une cloison de briques. Puis, afin de donner un accès
à la chapelle, la fenêtre qui dominait le sol seulement de 0 m 60, fut transformée en
une porte, qui s’ouvre sur le parc du château de Morigny.
La clef de voûte en question porte un grand écu peint,
dont les armes sont celles des Hurault, d’or à la croix d’azur cantonnée de
quatre ombres de soleil de gueules. Cette famille des Hurault, originaire
de Blois, comptait parmi elle des seigneurs de Bois-Taillé et de Bélesbat,
fiefs de Boutigny, à 15 kilomètres environ d’Étampes, dans la vallée de l’Essonne.
Trois de ses membres au XVIe siècle furent abbés de l’ abbaye
de Morigny et la mère de l’un d’eux contribua puissamment de ses deniers
à la réfection de l’église. La fille de Michel de l’Hôpital, qui est enterré16 dans l’église de
Champmotteux, épousa un Hurault de cette branche.
L’intérêt de cet écu est double, car, portant les
armes de plusieurs abbés, il nous montre que c’est dans cette chapelle que le
chef de l’abbaye devait assister aux offices. On sait en effet, par un document
ancien, que l’autel était plus éloigné du fond de l’abside qu’il ne l’est
aujourd’hui et ainsi, la chapelle n’était pas masquée par l’autel, comme
elle le serait, actuellement.
Au-dessus de l’écu, on voit un ornement, en bas-relief,
qui devait faire partie de la crosse symbolique de l’abbé.
C’est un des seuls souvenirs tangibles que nous avons
des abbés de Morigny, avec trois sceaux du XIIIe et du XIVe
siècle qui sont aux Archives Nationales, mais qui ne portent pas de nom d’abbés,
ainsi qu’un autre sceau du XVIIe siècle dont la matrice en cuivre
appartenait à Maxime Legrand et que nous avons publié en 1921 dans le Bulletin de la Société des Amis
du Musée d’Étampes.
Nous espérons que notre sèche description inspirera
à nos collègues-amis d’Étampes le désir de venir voir sur place l’écu des
Hurault et de nous donner ainsi le plaisir de les accueillir dans notre maison.
|125
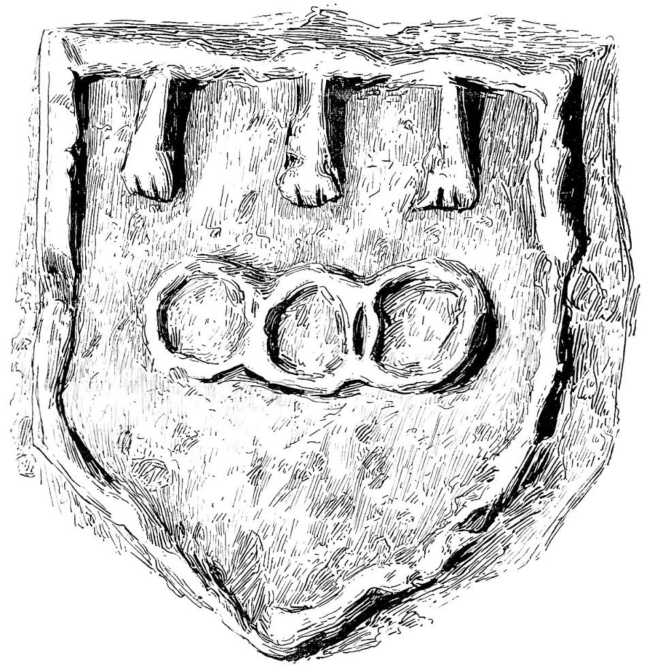
Fig. 1. — Écu des Villezan, provenant de Monnerville (1/3
gr. nat. environ).
05. Les Villezan seigneurs de
la Tour de Guillerval (1929) 4
Mon attention a été attirée .sur la famille de Villezan,
éteinte aujourd’hui, mais qui vécut plusieurs siècles dans notre région, par
une indication de Ch. Forteau17 18 reproduite sans modification par Maxime
Legrand19.
« Michel Thiboust, seigneur de Choisy (Choisy-au-Bac,
Aisne), peut-être parent des seigneurs de Thionville, dit Forteau, possédait
à Monnerville le domaine dit des Charnaux, aujourd’hui maison Lécuyer. On
.voit sur le mur extérieur un écusson portant un lambel à trois pendants
et au-dessous, en fasce ; trois annelets entrelacés. Étaient-ce les armes
de cette famille » ? Il est facile de répondre à la question de Forteau.
Les Thiboust, seigneurs de Thionville20, étaient une très
ancienne famille, établie à Thionville depuis le XVe siècle, par
le mariage de Robert Thiboust, conseiller au Parlement, avec Jeanne Raguier,
dame de la seigneurie de Thionville. Les Raguier, d’origine bavaroise, étaient
seigneurs de Thionville à la fin du XIVe siècle ; Jacques Raguier,
qui devint évêque de Troyes, et son frère Jehan, avaient en leur jeunesse
hanté les tavernes de Paris avec le poète Villon21 qui les cite dans
son Grand et son
Petit Testament. Le futur évêque était alors
un rude buveur, dont la première visite, au matin, était pour le fameux cabaret
de la Pomme de Pin. Mais les Thiboust, dont l’un fut premier président au Parlement
de Paris à la fin du XVe siècle et dont une branche possédait
les Charneaux, à Monnerville, portaient : de sinople à trois limaçons d’argent posés 2
et 1. Ce n’étaient donc point leurs armes qui
ornaient le mur |51 extérieur de la propriété Lecuyer à Monnerville.
L’écu en question était incontestablement, d’après la description de Forteau,
celui .des Villezan qui portaient : d’argent à trois annelets d’azur entrelacés
en fasce surmontés d’un lambel de gueules.22
Ayant identifié ces armes, nous nous sommes rendus
à Monnerville où nous avons cherché en vain, sur le mur extérieur de la propriété
Lécuyer, située sur la place de l’Église, l’écu annoncé par Forteau. Le doyen
des habitants de Monnerville, âgé de 89 ans, nous dit qu’il avait bien connu
la pierre |52 qui, jadis, était encastrée, non dans la propriété
Lécuyer, mais dans le mur de la propriété Genêt, contiguë. Là, nous nous
trouvâmes en présence d’un mur restauré récemment et le propriétaire nous avoua
n’avoir pas remarqué la pierre que nous lui décrivions. Cependant, nous lui
demandâmes de poursuivre quelques recherches dans les décombres provenant
de l’ ancien mur, recherches qui furent couronnées de succès, puisque le
9 juillet 1927, M. Genêt nous écrivait qu’il avait retrouvé la pierre en question.
Nous en fîmes aussitôt l’acquisition.
Il s’agit (fig. 2) d’un bloc quadrangulaire de pierre
calcaire d’un blanc grisâtre (calcaire de Beauce ?) qui mesure 0 m 30 de longueur
et de largeur sur 0 m 25 environ d’épaisseur. Sur la face aplanie du bloc,
l’écu est sculpté en faible relief ; de forme basse et trapue, il porte,
en son centre, les trois annelets dont le premier est contigu au second,
celui-ci entrelacé au troisième. La fasce n’est plus visible ; au-dessus,
se détache le lambel de trois pendants. Cet écu est assez fruste à cause
de l’altération de la roche, très dégradée par l’ érosion des agents atmosphériques parce
qu’il a dû toujours être placé à l’extérieur d’un bâtiment. Mais il est parfaitement
identifiable.
Il nous a paru intéressant de rappeler, à l’occasion
de cette découverte, l’histoire des Villezan et de leur habitation à Guillerval,
ce qui nous permettra de dater notre écu avec quelque approximation.
C’est en 1467 que nous trouvons la première mention
des Villezan comme seigneurs d’un fief à Guillerval. Le 7 avril de cette
année, Jean de Villezan, seigneur de la Maladrerie d’Orgères23, donne quittance
pour ses enfants mineurs à cause de leur « ostel et seigneurie de Guillerval
»24. Ces mineurs
étaient fils d’Emyne de Fraville qui, sans doute, avait légué à ses enfants la
seigneurie de Guillerval. Le 25 juillet 1484, Jean de Villezan, seigneur
de Guillerval, épouse Guillemine de Saint-Martin. Au XVIe siècle,
nous trouvons de nombreux Villezan à Guillerval. Ils sont alors seigneurs
de la Tour de |53-54 Guillerval, le nom de ce fief s’appliquant
sans doute à un édifice aujourd’hui disparu. Le 9 décembre 1508, Richard
de Villezan épouse, à Saclas, Françoise de Poilloüe, fille de Jean, seigneur
de Saclas, et de Louise de Marolles. Leur fils, Jean, seigneur de la Tour
de
Guillerval, épouse, le 28 avril 1564, Yolande de
Wicardel, d’une famille originaire de Flandre établie dans notre région au
XVe siècle et qui posséda Villemartin en-1472, Le Fresne en 1544, Saudreville
en 1556 et Gravelle et Chalou en 1572. Nous ne donnons pas ici la généalogie
complète des Villezan. Citons seulement : Claude, convoqué au ban et à l’arrière-ban
du bailliage d’Étampes, le 22 février 1544, et qui « absent, viendra comparaître
devant les commissaires, dès qu’il sera de retour et déclarera sous huitaine
ses projets »25.
À cette même convocation, Richard de Villezan le jeune, écuyer, est exempt
de contribution, comme homme d’armes de la compagnie d’ordonnances26. Jean l’aîné et
Jean le jeune comparaissent à la rédaction de la coutume d’Étampes en 155627. Au XVIIe
siècle, une branche des Villezan, qui possédait le fief de Guignonville, quitte
le pays d’Étampes pour s’établir, d’une part dans le pays du Mans, d’autre
part dans les environs de Châteaudun et de Vendôme. Cependant, le l6 janvier
1686, nous trouvons encore Jacques de Villezan, porte-étendard des gardes
du corps du roi, qualifié seigneur de Guillerval.

Fig. 2. — Fenêtre de la ferme Blot, à Guillerval.
C’est la dernière mention que nous connaissions des
Villezan à Guillerval. En 1747, plusieurs membres de cette famille habitent dans
la région de Châteaudun. M. de Crépainville, sub-délégué de Châteaudun, écrit
à cette date : « Il n’est pas douteux que MM. de Villezan sont de très bons
gentilshommes » et il raconte qu’en 1715 « MM. les élus de Vendôme s’imaginèrent,
par un zèle indiscret, de faire exhiber à toute la noblesse vendômoise ses titres
et que MM. de Villezan avaient été extrêmement blâmés d’avoir eu envie de
le faire ou de l’avoir fait28. On sait, en effet, que l’ancienne noblesse
dédaignait |55-56 de prouver son origine lorsque celle-ci n’était
pas douteuse et qu’elle ne produisait ses titres que pour obtenir des charges
officielles, dans l’armée, par exemple, ou à la Cour.
Nous ne savons pas où s’élevait le donjon qui dut
donner son nom au fief des Villezan, car il n’existe plus de tour à Guillerval, mais
les bâtiments de la ferme où habite aujourd’hui la famille Blot, située près
de l’église de Guillerval, ont fait partie du logis des Villezan au XVIe
siècle, car ils conservent des traces de cette origine. Une fenêtre à meneaux
et une porte à montants cannelés ornent la façade au midi et une autre fenêtre
haute et étroite, au premier étage, est surmontée d’un arc en accolade qui
contient un écusson tenu par deux écureuils (fig. 2). Nous ne pouvons plus aujourd’hui
distinguer les pièces de ce blason dont la pierre a été rongée par les pluies.
Mais la dégradation était moins complète lorsque Maxime Legrand visita cette
ferme et notre regretté collègue dit qu’à ce moment « on y distingue ces
ornements à trois pendants droits surmontant trois annelets entrelacés que nous
avons remarqués à Monnerville sur la maison Lécuyer »29. Il s’agit donc
bien d’un logis des Villezan. À l’intérieur de la ferme, une grande cheminée
à hotte, aujourd’hui sans ornements, montre encore à chaque angle un bastion
engagé qui décore le coin du manteau (fig. 3). Est-ce une allusion au nom
de la Tour donné au fief ? Si modestes que soient ces témoins du style de
la Renaissance, ils suffisent à évoquer ces « ostels » seigneuriaux, devenus
bien rares aujourd’hui dans un pays de reconstruction constante, où vivaient
autrefois les « bons gentilshommes » comme les Villezan, mi-agriculteurs,
mi-soldats, menant une vie rude et joyeuse au milieu des villages qu’ils
défendaient au besoin, lorsque les appels des bans ne les entraînaient pas
au loin dans les compagnies d’ordonnances du roi.
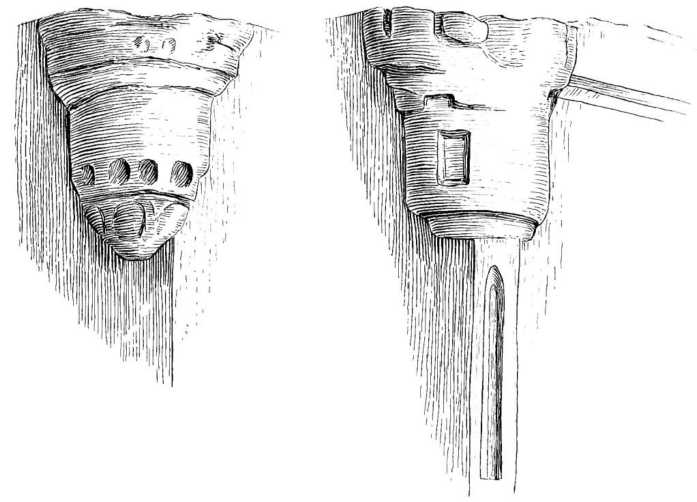
Fig. 3. — Cheminée de la ferme Blot, à Guillerval : Angles
de la hotte.
Il nous reste à expliquer pourquoi l’écu des Villezan
se trouvait enclavé dans un mur à Monnerville et à chercher à quelle époque il
peut remonter. Sur le premier point, nous manquons de documents, car nous
n’avons point trouvé de traces d’un fief des Villezan à Monnerville. Il se
peut que cet écu ait été apporté de
Guillerval et enclavé postérieurement |57
dans le mur de la maison Genêt, mais cette fantaisie d’archéologue est bien
peu probable. Peut-être, sans qu’il en ait été conservé de document écrit,
les Villezan ont-ils possédé à Monnerville un « ostel », comme leurs alliés
les Poilloüe. Arthur de Poilloüe, en effet, se voit attribuer, en 1430 «
l’ostel de Monnerville avec ses terres » dans le partage qu’il fit avec son
frère et sa sœur des biens de leur père Jean de Poilloüe, seigneur de Saclas30. Françoise de Poilloüe,
qui épousa Richard de Villezan en 1508, était la petite-nièce d’Arthur et
il se peut qu’elle ait apporté à son mari l’ostel de Monnerville sur lequel
Richard eût fait apposer son écu. Il faudrait supposer alors que les Villezan
conservèrent peu de temps l’habitation de Monnerville, puisque nous ne les
y trouvons pas mentionnés. Un argument qui appuierait cette hypothèse est
l’époque à laquelle a été sculpté notre écusson. En comparant, en effet,
le contour de cet écu à celui des écus de France frappés sur les monnaies
nous retrouvons le même galbe trapu et élargi sur les monnaies de la fin
du XVe ou du commencement du XVIe siècle, époque du mariage
de Richard de Villezan avec Françoise de Poilloüe.
Ces modestes monuments d’un lointain passé sont devenus
si rares maintenant qu’il nous a paru intéressant de signaler celui-ci comme
contribution à notre histoire régionale, puisque, aussi bien, c’est là le
but essentiel de notre Société.
R. de Saint-Périer.
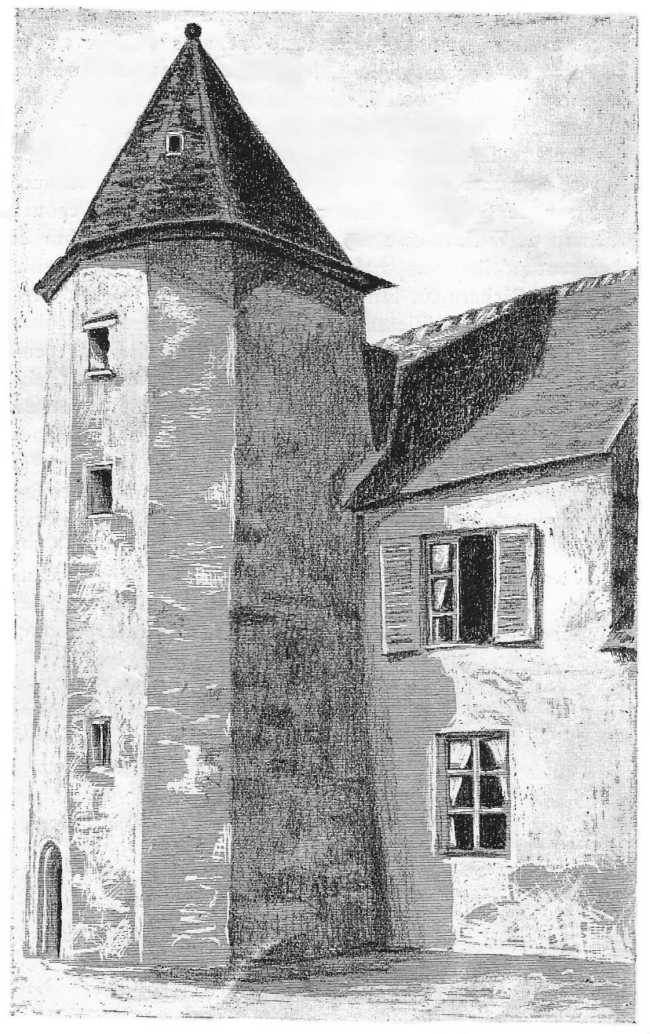
06. Un petit Manoir disparu à
Souzy-la-Briche »
Le petit édifice, dont nous donnons ci-contre une
figure, s’élevait dans le village de Souzy-la-Briche, au tournant de la route
de Saint-Chéron et en face de l’entrée du château de Souzy. Il occupait,
sur le plan cadastral de la commune, le numéro 363 de la section A.
Ce manoir menaçait ruine en 1912 et fut alors complètement
démoli. J’en avais pris, peu de temps auparavant, une photographie d’après
laquelle a été fait le dessin que nous publions aujourd’hui. Il s’agissait
d’une demeure modeste, dans l’état où nous l’avons connue, mais qui conservait
des traces d’une assez ancienne origine. Une tour hexagonale flanquait un bâtiment
percé de fenêtres modernes, mais dont la toiture avait conservé un comble
à grands rampants. Une porte cintrée à chambranle mouluré donnait accès à
un escalier en vis, éclairé par trois ouvertures rectangulaires, qui s’élevait
dans la tour. Sur les paliers de cet escalier, s’ ouvraient les portes des
chambres du logis principal. Une toiture, dont les arêtes prolongeaient les lignes
verticales des pans de la tour, coiffait celle-ci et se terminait par une
boule. Il est probable que l’ édifice, dans son état primitif, comprenait
d’ autres bâtiments sur la disposition desquels nous n’avons aucune indication.
La transformation des fenêtres du logis montre que l’édifice dut subir bien
des modifications ; seule, la tour avait conservé son architecture 31 primitive. Elle
nous permet de dater la construction du XVIe siècle, sans qu’il
soit possible de préciser davantage. En effet, nous n’avons aucun motif décoratif
sur cette demeure rustique, qui permette une plus grande approximation. Ces
tours polygonales, contenant les escaliers, ainsi que les toits à grand rampant,
comme celui du logis principal, étaient en usage dès le XVe siècle
et se sont prolongés pendant tout le |60 XVIe siècle. On
retrouve ce type à Étampes à la tour de l’Hôtel de Ville, bâtie en 1502.
Il faut tenir compte aussi que les bâtiments des campagnes subissaient autrefois
moins rapidement qu’aujourd’hui l’influence des modes nouvelles de construction. Les
maçons des villages suivaient l’enseignement de leurs pères sans connaitre
le goût nouveau imaginé par les architectes de la cour, et c’est ainsi que
des édifices ruraux peuvent être d’un style qui retarde d’un siècle, ou même
davantage sur les demeures des grandes villes. Si nous ne pouvons dater plus
exactement notre manoir de Souzy, connaissons-nous du moins l’histoire de
ses habitants ? Il y eut à Souzy plusieurs hôtels seigneuriaux dès une époque
ancienne. En 1487, Pierre Desmazis, qui avait épousé l’année précédente Jeanne
Constance, héritière d’un seigneur de Souzy, achète à Guillaume Satenay «
tous les droits qui peuvent lui appartenir dans les hôtels, terres et seigneuries
de Souzy »32. Puis
nous trouvons, en 1493, Guillaume de Saint-Germain et, au XVIe
siècle, les Reviers auxquels succèdent, au début du XVIIe siècle,
Poisson, apothicaire du roi. Nous savons que les Cousinet, seigneurs de Souzy
au XVIIIe siècle, descendaient de Poisson et qu’ils habitaient
le château actuel de Souzy33. S’ils possédaient notre petit manoir, ils
l’avaient donc déjà transformé en ferme.
En 1826, le cadastre de Souzy donne, comme propriétaire
du manoir, Picart de Gaville, qui appartenait à une famille bien
connue de notre région. On sait, en effet, que Louis
Picart de Noirépinay, né à Étampes le 9 octobre 1754, mort en 1823, fut lieutenant
général du bailliage d’Étampes, comme l’avait été son père. Mais nous ne
savons depuis quelle époque les Picart de Gaville possédaient la demeure
de Souzy.
Il est probable que notre petit manoir, ancien «
ostel » habité par un modeste gentilhomme au XVe ou XVIe
siècle, fut assez rapidement absorbé par une seigneurie plus importante,
comme celle des Poisson ou des Cousinet, et qu’il fut alors consacré uniquement
à l’exploitation rurale. C’est le sort de la plupart de ces petites gentilhommières,
dont se contentaient |61 les seigneurs ruraux à l’époque de la
Renaissance. Ces demeures ont disparu pour la plupart dans l’ Île-de-France,
alors que dans le Centre et le Midi de la France, il en subsiste un certain
nombre et qu’en Espagne, ces casas solariegas
abritent encore les descendants des familles qui les ont fait construire.
C’est pourquoi 1 ‘image de ces rares témoins de notre petite histoire mérite
d’être conservée.
R. de Saint-Périer.
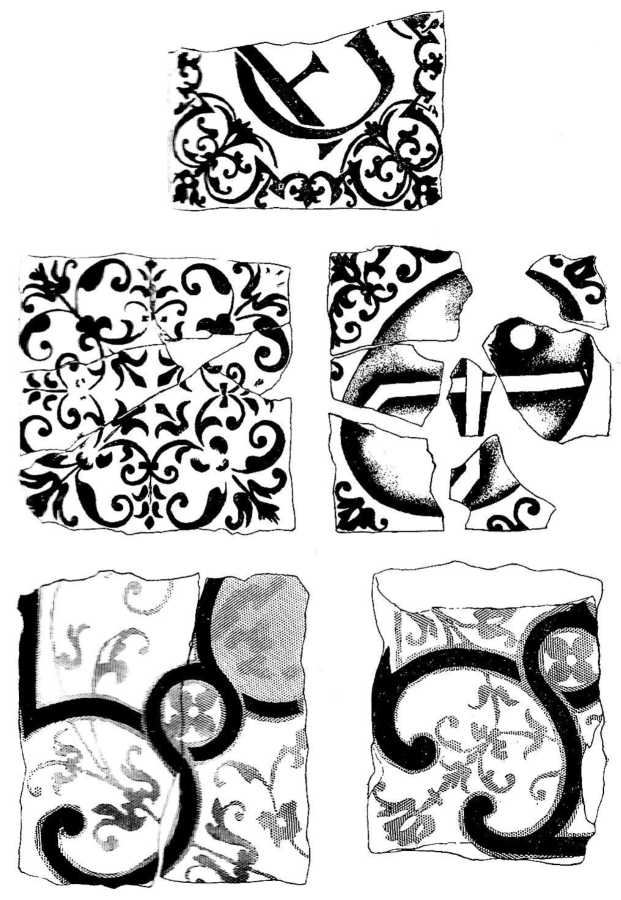
Carreaux de la Renaissance
(Musée d’Étampes).
07. Carreaux de la Renaissance au
musée d’Étampes 3>
Le Musée d’Étampes a reçu, après le décès de M. Lenoir.
quelques carreaux de terre cuite que nous figurons ci-dessous. Ils sont fragmentés
et maladroitement réparés ; nous ignorons, malheureusement, leur provenance.
Ils sont en terre rouge bien cuite ; sur une de leurs faces, on a ménagé
dans la pâte fraîche un dessin en creux qui a été ensuite rempli par une
pâte colorée, formant la décoration. C’est ainsi que les deux carreaux inférieurs
qui ont fait partie du même pavage sont composés de grands entrelacs bleu
foncé et de fleurons d’un jaune verdâtre. Les deux carreaux supérieurs présentent
une décoration noire et bleue sur un fond rose saumon. Enfin le carreau supérieur fragmenté
montre la moitié du monogramme EG en marron qu’entoure une couronne de fleurons
de même teinte ; le fond offre la couleur de la terre cuite naturelle. Malgré
leur mauvais état de conservation et l’atténuation de leurs teintes due à
l’usure, ces carreaux, qui peuvent être datés de la première moitié du XVIe
siècle, nous offrent encore un spécimen remarquable de ces décorations élégantes
et variées de la belle Renaissance française. Nous retrouvons les grands
entrelacs aux courbes harmonieuses qui décorent les riches reliures de cette
époque, notamment les reliures faites pour Jean Grollier, l’ argentier de
34
François Ier et les bouquets de fleurons
évoquent ces décorations de pilastres et de jubés à la fois si ornés et d’un
goût si sûr.
On sait que le pavage des édifices religieux et civils,
a été pratiqué au moyen de carreaux ornés, depuis l’époque romaine, dans
notre pays. Ce furent d’abord des mosaïques à petits cubes de marbres et
de verres de couleurs diverses formant des dessins et des figures, puis des
carreaux plus grands constituèrent l’opus tessellatum de la fin de l’époque romaine, qui se prolongea aux |63
époques mérovingienne et carolingienne. De ce mode de pavage dérivèrent les
dalles incrustées de figures variées dont de beaux spécimens ont été relevés
dans bien des églises et dans quelques châteaux. Il en existe des fragments importants
au château de Saumur (aujourd’hui musée) qui appartint à Jean, frère de Charles
V, duc de Berry et comte d’Étampes. Mais ces dalles |64 étaient
souvent incrustées de figures diaboliques ou indécentes, qui amenèrent Saint-Bernard à
proscrire ce mode de pavage dans les églises et, de son interdiction, naquit
l’essor des carreaux vernissés. Ceux-ci furent en usage pendant tout le Moyen-Âge
et la Renaissance, malgré un essai au XVIe siècle de carreaux
en faïence, qui n’eut point de succès en France. À la fin du XVIe
siècle, les carreaux vernissés se font plus rares ; on les remplace bientôt
par les parquets en bois. Aussi les carreaux de pavage sont-ils peu fréquents
dans les édifices civils et aussi dans les églises où l’usage d’enterrer
sous le dallage a fait remplacer, jusqu'au XVIIIe siècle, bien
des carrelages anciens par des dalles funéraires ; c'est pourquoi il est intéressant
de rechercher ces témoins d'un art à peu près disparu, même lorsqu'ils sont
aussi fragmentés que les carreaux du Musée d’Étampes.
R. de Saint-Périer

Borne armoriée de Puiselet-le-Maris
(© Armand Caillet, 1951)
08. Quelques bornes armoriées de
Seine-et-Oise 2
Les bornes seigneuriales marquant les limites des
fiefs et portant les armoiries de leurs possesseurs sont devenues rares. Elles
tombaient, en effet, directement sous le coup des arrêts des Assemblées de
la Révolution et, notamment, du décret de la Convention qui ordonnait la
suppression de toute marque de féodalité. Elles durent alors être détruites
pour la plupart. Cependant, quelques-unes, isolées dans les plaines ou cachées dans
les bois, sont heureusement parvenues jusqu’à nous, sans doute aussi parce
que leur nombre était considérable. Il semble, en effet, qu’on ne limitait
pas une terre seulement par quatre bornes aux angles, peu saillantes et de
faibles dimensions, comme nous le faisons aujourd'hui, mais par de hautes
bornes nombreuses, érigées en file et assez rapprochées les unes des autres,
ainsi que nous en verrons quelques exemples. Il n’en demeure pas moins que
ces petits monuments ne se rencontrent plus qu'exceptionnellement. Leur rareté,
le souvenir précis qu'ils évoquent de familles presque toujours disparues
et oubliées, aux lieux mêmes pourtant où elles ont vécu, rendent digne d’intérêt le
relevé de ceux qui subsistent encore. Nous avons tenté de le faire pour la
région d’Étampes et de Rambouillet, sans prétendre, certes, être complet
et sans qu'il nous soit possible actuellement 35 de donner une iconographie, toujours plus
instructive en cette matière qu’une description même détaillée.
Saclas, canton de Méréville. — Il existe sur cette commune, au lieu-dit La Pièce-de-la-Borne-à-la-Calende, sur le plateau dominant la vallée de la Juine (section A,
n°1302 du cadastre) une grande borne quadrangulaire, en grès (grès de Fontainebleau),
de 1m, 50 de hauteur, qui porte sur deux de ses faces, gravé assez
profondément, un écu à trois fusées en fasce, timbré d'un casque sans lambrequins.
Il s'agit des armes des Fusée : d’azur à trois fusées d’or rangées en fasce. Les Fusée, famille originaire du Gâtinais, étaient, au début
du XVIIe siècle, seigneurs de Bierville, commune de Boissy-la-Rivière,
près de Saclas. Le château de Bierville est situé à quelques centaines de mètres
seulement à l’est de la borne, au bord de la Juine. Nous trouvons des Fusée
cités aux registres |120 paroissiaux de Boissy-la-Rivière depuis
le début de ces registres, en 1603, jusqu’en 1737. Après cette date, la famille
était éteinte ou avait quitté la région, puisque Bierville, en 1768, appartient
à Jean-Baptiste de Poilloüe de Saint-Mars, lieutenant de vaisseau. Nous pouvons donc
dater notre borne du XVIIe siècle ou tout au plus du début du
XVIIIe. Nous l'avons publiée36 avec une figure au trait et, sur notre demande,
elle a été classée comme monument historique (arrêté du 13 septembre 1920).
Avrainville, canton d’Arpajon. — Une borne quadrangulaire, en grès, de plus d'un mètre
de hauteur, nous a été signalée sur le territoire de cette commune par notre
regretté collègue M. Vivaux, avec qui nous l’avons examinée en 1934. Elle
doit être inédite. Elle est située en plein champ, à 200 mètres environ de la
route de Lardy à Torfou, à droite en allant vers ce dernier village, en face
de la ferme des Bois-Blancs. L'une de ses faces porte une figure héraldique
qui ne peut être qu'une herse sarrasine, bien que le nombre des pals et des
traverses soit de trois au lieu de six et que les clous ne soient pas figurés
aux interstices. La présence de l'anneau ne permet pas de la confondre avec
une herse de labour, et les inexactitudes de la figure peuvent être attribuées
aussi bien aux difficultés qu'offre 1e grès pour une gravure détaillée qu'à
l'ignorance du graveur. L'autre face, montre une crosse, réduite à sa forme
essentielle, sans aucun ornement, sans doute pour la même raison. Enfin,
sur l’une des petites faces, on remarque un B majuscule, plus grossier que
les gravures. La herse indique la propriété des Karnazet, seigneurs de Lardy,
qui portaient : de
gueules à trois herses d’or, à l ’écu en abîme burelé d’argent et de gueules
; à la bordure contre-componée de même, et au cerf (alias à la guivre) de
sinople traversant les burelles. Le premier de
cette famille bretonne, Karnazet ou Kernazret, qui vint s'établir dans notre région,
fut Yves, qui rendit aveu au roi des terres de Lardy, en 1446. Il fut le
premier capitaine des francs archers créés par Charles VII. Il restaura l’église
de Lardy, où il fut inhumé. Un fragment de sa pierre tombale subsiste dans
la sacristie et l'on y retrouve, gravée sur sa tunique, la herse de ses armes,
qui caractérise notre borne. Ses descendants mâles demeurèrent à Lardy jusqu’au
milieu du XVIe siècle et la seigneurie de Lardy devint alors,
par alliance des filles, la propriété des Champgirault et, plus tard, des
d’Allonville. La crosse gravée sur l’autre face de la borne doit indiquer
une propriété de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. |121 En effet,
les Archives nationales possèdent un plan de bornage daté de 1521 des terres
de cette abbaye situées à Lardy et à Torfou et une ligne de bornes figurée sur
ce plan paraît coïncider à peu près exactement avec l'emplacement de notre
borne. M. Vivaux, qui a retrouvé ce plan aux Archives, en a fait exécuter
quelques reproductions et a fait don de l’une d’entre elles au Musée d’Étampes.
Enfin le B majuscule est d’une interprétation plus difficile. Peut-être représente-t-il
la propriété des Buz, la veuve d'Yves de Karnazet, ayant épousé Charles de
Buz, dont elle eut deux fils.
Chauffour-lès-Étréchy,
canton d’Étampes. — On trouve sur le territoire
de cette commune, notamment sur la route de Chauffour aux Émondants et sur
route de Chauffour à Villeconin, des bornes quadrangulaires, en grès, de
60 à 80 centimètres de hauteur, qui portent sur leurs faces des croix de Malte.
Notre collègue, M. G. Courty, en possède une de même provenance. Il s'agit
des bornes de 1a Commanderie de Chauffour. On sait, en effet, que Chauffour
appartenait jusqu'à la Révolution à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit
de Malte. Nous ne pensons pas que la gravure de ces bornes, assez fruste, ait
été publiée. M. M. Legrand a signalé l'existence de l'une d’elles37.
Les Bréviaires, canton
de Rambouillet. — Dans le massif domanial de
la forêt de Rambouillet (15e série, dite de Vilpert), à une centaine
de mètres du carrefour du chêne dit « la Tête d’Alouette », existe une très
belle borne armoriée, en grès, malheureusement quelque peu mutilée à sa partie
supérieure. Elle nous a été signalée par un jeune érudit de Rambouillet,
M. Pierre Villeneuve de Janti. Elle montre, sur la grande face orientée au
sud-ouest, un écu écartelé, incomplet au sommet, qui porte au 1 et 4 des
mouchetures d'hermine, des tourteaux et une fasce vivrée, au 2 et 3 des cotices
et, en abîme, un écu portant un lion. Nous avons pu identifier ces armoiries
: au 1 et 4, Silly : d’hermine à la fasce vivrée de gueules, surmontée
de trois tourteaux de même ; au 2 et 3, La Roche-Guyon
: d’or à cinq cotices
d’azur et l’écu en abîme, Sarrebruck : d’azur semé de croisettes recroisettées,
au pied fourchu d’or, au lion d’argent couronné d’or sur le tout. L’autre grande face, orientée au nord-est, porte un écu
parti : à dextre écartelé au 1 et 4 de.. ,38 à deux fleurs de lis et une cotice, armoiries
d’ une branche des Bourbon, réduites à deux fleurs de lis par manque de place
sur la pierre ; au 2 et 3, un lion : Luxembourg ; à senestre, burelé au lion brochant
sur le tout : Estouteville. On peut attribuer ces armes |122 à
François de Bourbon, comte de Saint-Pol et de Rochefort. Il écartelait ses
armes de celles de sa mère, Marie de Luxembourg, et avait épousé Adrienne
d’Estouteville. Cette borne indiquait, d’une part, les possesseurs du comté
de Rochefort, d’autre part, ceux du domaine de La Roche-Guyon, au XVIe
siècle. À cette époque, en effet, le comté de Rochefort appartenait à François
de Bourbon-Vendôme, l’ami de François Ier, qui fit avec lui toutes
les guerres d’ Italie, et le domaine des La Rochy-Guyon était à Charles de
Silly, dernier enfant de Marie de La Roche-Guyon, dont la femme était Philippe
de Sarrebruck. Des querelles de famille, que nous avons exposées en publiant cette
borne39, s’étaient
élevées entre les enfants des deux lits de Marie de La Roche-Guyon, qui avait
épousé d’abord Michel d’Estouteville, puis Bertin de Silly, seigneur de Lonray.
Elles avaient amené une telle animosité entre les descendants de Marie de
La Roche-Guyon que le roi Henri II imposa, en 1547, à Fontainebleau, un arbitrage
entre les parties. Il est probable, bien qu’aucune pièce ne l’indique, qu’un
bornage dut consacrer cet arrangement et que notre pierre en est un témoin.
Ainsi s’explique qu’elle porte les armes de cinq familles. La date de l’arbitrage
est en accord avec le style des écussons. Un plan du XVIIIe siècle
de la forêt de Rambouillet, nous a dit M. Villeneuve de Janti, indique en
ce lieu une file de bornes et, postérieurement à notre publication, M. Villeneuve
de Janti a retrouvé, dans l’enceinte de taillis au sud, une autre borne
portant les mêmes armoiries, mais plus frustes, que nous n’avons pas vue.
Gazeran, canton de Rambouillet. — Dans le bois des Batonceaux,
en bordure d’une ligne de forêt, se trouve une file de onze bornes consécutives,
en grès, quadrangulaires, d’un mètre environ de hauteur, dont une des faces
porte sept annelets disposés 3-3 et 1, et l’autre face, une tunique aux manches écartées.
Il n’est pas douteux que ces bornes, très probablement inédites, sont aux
armes des Prunelé : de gueules à sept annelets d’or, 3-3 et 1. Les Prunelé étaient seigneurs
de Gazeran dès le début du XVIe siècle, et le porche d’un vieux
logis dans le village de Gazeran est encore orné d’un écu parti à dextre
de Prunelé. Une borne qui paraît se rapporter à cette série, bien que fort éloignée,
gît sur le sol dans la forêt de Rambouillet, près du carrefour Sédillot,
non loin de l’emplacement de l’ancien étang de la Cerisaie. Elle porte sur
sa face exposée à l’air les mêmes annelets que les bornes de Gazeran, mais
son poids ne nous a pas permis de la retourner afin d’examiner |123
l’autre face. La tunique des bornes de Gazeran peut représenter le chapitre
de la cathédrale de Chartres, qui aurait possédé des terres en ce lieu.
Nous signalerons encore
d’ autres bornes armoriées de la forêt de Rambouillet, bien que nous n’ayons
pas déterminé la commune à laquelle elles appartiennent. Entre Saint-Léger
et la Croix-Pater, en lisière de la forêt, sur l’accotement de la route, une
grande borne en grès porte de ... à trois fleurs de lis à la bande de. Il
s’agit des armes du même François de Bourbon, comte de Saint-Pol, avec une
légère variante de la brisure, bande au lieu de cotice. M. Villeneuve de
Janti nous a signalé deux bornes semblables également dans la forêt de Rambouillet.
L’écusson de l’une d’elles est parti des hermines de Bretagne, sans doute
en raison du comté de Montfort, dont elle devait marquer la limite, mais
nous n’avons pu examiner ces bornes.
Près de l’étang de Hollande, à l’extrémité du chemin
des Vaches et un peu à gauche de ce chemin, une grande borne en grès, fortement
inclinée, porte, sur une face, un écu parti de France et de Navarre et, sur
l’autre face, un écu peu distinct, où l’on peut reconnaître cependant un
sautoir surmonté d’un annelet : il pourrait s’agir des d’Angennes, marquis
de Rambouillet, qui portaient : de sable au sautoir d’argent, l’annelet ajouté représenterait la brisure d’une branche
de la famille. Mais ce n’est là qu’une hypothèse. L’écu de l’autre face, aux
armes royales, peut être daté de la fin du XVIe siècle, car le tracé
stylisé de la chaîne de Navarre se retrouve sur des reliures d’Henri IV,
en particulier sur un volume de 159 1 40.
Non loin de cette dernière borne, à l’ angle du même
étang, une borne moins élevée et plus large porte simplement des fleurs de lis.
On en connaît plusieurs analogues dans la forêt, elles passent pour avoir
servi de marchepied au roi Louis XV pour monter à cheval lorsqu’il chassait.
Un historien de Rambouillet, M. Maillard, a signalé,
près de l’Étang-Neuf, une borne qui porterait de ... à la croix de ... cantonné
de quatre molettes d’éperon. D’après cet auteur, ces armes seraient celles
de Louis de Rohan, grand veneur, décapité en 1674 pour avoir conspiré contre
Louis XIV. Nous n’avons pas vu cette borne, dont l’attribution serait à vérifier,
car ces armes ne sont pas celles des Rohan, qui portent : de gueules à neuf macles d’or,
3-3 et 3. |124
Nous citerons enfin, bien que ce soit seulement par
ouï-dire, une borne près de l’entrée sud de Longjumeau, non loin de la route
nationale n° 20, qui porterait un grand écu aux armes de France.
Il pourrait s’agir d’une borne de la route royale
de Paris à Toulouse.
Nous espérons que cet exposé, si aride qu’il soit
dépourvu de figures, incitera nos collègues à relever avec soin les bornes armoriées
dont ils pourraient avoir connaissance et contribuer ainsi, plus tard, à
l’établissement d’un inventaire pour notre département de ces intéressants
vestiges du passé.
Comte de Poilloüe de Saint-Périer.
Ces pages étaient écrites lorsque nous avons eu connaissance41 d’une borne armoriée
située à l’intersection des communes de Bois-Herpin, de Puiselet-le-Marais
et de la Forêt-Sainte-Croix. Cette borne, en grès, de un mètre de hauteur,
porte gravée sur une face un P et un écu aux armes des du Monceau : de gueules à la fasce d’argent,
accompagnée de 6 annelets de ... 3, 2 et 1. Les
du Monceau, très ancienne famille de notre région, étaient seigneurs de Bois-Herpin
au XVIe siècle.
S.-P.

Borne armoriée découverte
aux Bréviaires
09. Une borne armoriée
du milieu du XVIe siècle
découverte aux Bréviaires, Seine-et-Oise 42
Les bornes seigneuriales ne sont plus communes en
France dans notre région, aux environs d’Étampes, nous n’en connaissons qu’une,
à Saclas, aux armes des Fuzée, seigneurs de Bierville au XVIIe
siècle43, qui
a été classée, sur notre demande, comme monument historique.
Aussi pensons-nous qu’il est intéressant de faire
connaître une autre de ces bornes, plus importante que celle de Saclas, malgré sa
mutilation, et qui est située à une quarantaine de kilomètres de Paris, en
bordure de la forêt de Rambouillet. Elle se trouve sur le territoire de la
commune |176 des Bréviaires, dans le massif domanial de Rambouillet
(15e série, dite de Vilpert). On y accède par le chemin vicinal
de Poigny aux Bréviaires, que l’on quitte dès l’entrée en forêt en venant
des Bréviaires pour prendre à gauche un chemin forestier qui mène à un petit
carrefour où s’élève un très beau chêne appelé « la Tête d’Alouette ». On prend
ensuite un sentier à droite du chêne et l’on trouve, à une centaine de meures,
la borne plantée dans le talus du fossé qui borde le sentier à droite. En
partie enfouie, elle ne montre plus que 0m42 au-dessus du sol,
mais sa hauteur primitive devait être beaucoup plus élevée.

Il s’agit d’un bloc de grès local (grès stampien)
à section rectangulaire. Les deux faces les plus larges, orientées l’une
au sud-ouest et l’autre au nord-est, portent chacune un écusson sculpté qui
mesure environ 0m32 de largeur sur 0m35 de hauteur. La
borne a été brisée à sa partie supérieure et cette fracture a fait disparaître
une partie des écus, dont nous ne possédons plus que les trois quarts inférieurs.
Sur la face sud-ouest, l’écu est écartelé. Le quartier
1, dont il ne subsiste que la partie inférieure, montre des mouchetures d’
hermine, que l’ on retrouve au 4, beaucoup plus lisibles, avec, en outre,
une fasce vivrée, surmontée de trois pièces circulaires. On peut identifier
ces armes avec celles des Silly, d’hermine à la fasce vivrée de gueules surmontée
de trois tourteaux de même. Le 2 ne montre que
trois cotices visibles, certainement à cause de la mutilation de la borne,
mais le 3 en porte quatre. Nous pensons qu’il s’agit des armes de la Roche-Guyon
: d’or à cinq cotices
d’azur. Enfin, en abîme, un écu porte un lion
très altéré, au fond indistinct. Cependant, nous pouvons rapporter cet écu
aux Sarrebruck : d’azur
semé de croisettes recroisettées, au pied fourchu d’or, au lion d’argent couronné
d’or sur le tout.
Sur l’autre face, l’écu est parti à dextre, écartelé,
au premier quartier, incomplet, il ne subsiste que deux fleurs de lis et
une cutice ; au 4, on ne reconnaît également que deux fleurs de lis avec
la cotice, mais on peut |177 attribuer ces armoiries aux Bourbons.
Aux 2 et 3, on distingue seulement un lion, que nous pouvons identifier avec
le lion de Luxembourg. À senestre, burelé au lion brochant sur le tout : nous
pensons qu’il s’agit ici des |178 d’Estouteville : burelé d’argent et de gueules
de 10pièces au lion de sable brochant sur le tout, armé, lampassé et couronné
d’or.
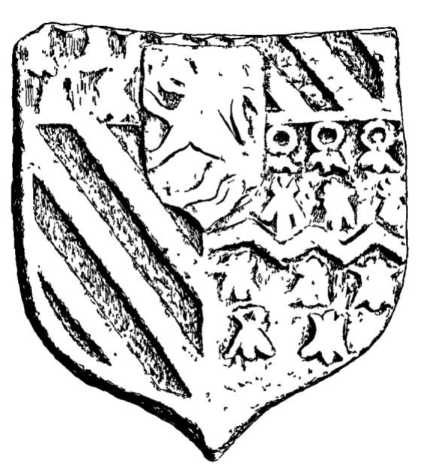
« Il faut, pour déterminer les armoiries de notre
borne, admettre l’omission par le sculpteur de plusieurs détails héraldiques,
ce qui s’explique, d’une part, par le peu d’espace dont il disposait et,
d’autre part, par la difficulté de sculpter avec précision dans une matière
aussi rebelle que le grès. Cependant, nous allons voir que l’identification
ne reste pas douteuse quand on recherche les circonstances qui ont pu déterminer
la pose de cette borne. Nous nous sommes reportés pour cela à l’histoire
de la seigneurie de la Roche-Guyon. Un chartrier important fait connaître
les longs
dissentiments qui mirent aux prises, pendant près
d’un siècle, ses divers possesseurs44.
« Vers 1450, Marie de la Roche-Guyon45, fille de Guy VII
et de Catherine Turpin de Crissé, épouse Michel d’Estouteville, seigneur
de Valmont46
et, de Hambye47,
et lui apporte la seigneurie de la Roche-Guyon et, après le décès de ses
parents et de sa grand’mère, les seigneuries d’Auneau48, de Franconville49, des terres en
Gâtinais, etc. Séquestrée au château de Hambye par son mari et son beau-frère,
qui avaient dépouillé le château de la Roche-Guyon, après la mort de Guy
VII, de tout son mobilier « tellement qu’on n’y eût su ni coucher ni loger
», Marie connut une vie fort malheureuse jusqu’à la mort de Michel d’Estouteville,
en 1469 ou 1470. Elle avait eu six enfants, dont l’aîné, Jacques, était seigneur
d’Estouteville50
et de Hambye. Adoptant le parti de leur oncle, Jean d’Estouteville, |180
seigneur de Bricquebec51, qui déjà, avec leur père, s’était efforcé
de déposséder Marie de la Roche-Guyon de ses vastes domaines, les enfants
de la pauvre femme continuèrent à la persécuter. Mais, en 1474, Marie s’était
remariée à Bertin de Silly, seigneur de Lonray52 et de la Houlette, bailli du Cotentin, qui
assura la défense des intérêts de sa femme contre ses enfants. De ce second mariage
naquirent trois fils Jacques, Louis et Charles. Alors commença, entre les
frères des deux lits, une lutte incessante, qui alla même jusqu’à une agression
à main armée, pour s’emparer de l’héritage considérable qui devait leur échoir
après le décès de leur mère. Nous n’insisterons pas sur cette interminable
querelle et les fastidieux procès qu’elle engendra. Rappelons seulement qu’en
1488 une transaction paraissait avoir clos toutes difficultés entre les d’Estouteville
et les Silly. Mais, après la mort de Marie de la Roche-Guyon, le 14 janvier
1497, la lutte reprit de plus belle. Charles de Silly, dernier survivant
des enfants du second lit, avait épousé, en 1504, Philippe de Sarrebruck,
dame de Commercy, qui, veuve en 1542, soutenait encore la lutte avec Jacqueline
d’Estouteville, veuve de Jean III d’Estouteville, son cousin, Adrienne d’Estouteville,
fille de Jacqueline, veuve de François de Bourbon, comte de Saint-Pol et
de Rochefort53,
et Marie de Bourbon, petite-fille de Jacqueline d’Estouteville.
Mais, alors, le roi Henri II, mécontent de ces querelles
qui duraient depuis quatre-vingts ans, intervint personnellement. Sur son
ordre, en 1547, « les parties entrèrent en volonté d’accord » et se soumirent,
à Fontainebleau, à l’arbitrage, imposé par le roi, d’Antoine, duc de Vendôme,
et du cardinal de Guise pour les d’Estouteville, du cardinal de Châtillon
et du connétable de Montmorency pour la dame de Sarrebruck et ses enfants
Silly. Les enfants de Charles de Silly étaient confirmés dans.la propriété
|181 des terres de la Roche-Guyon, d’Auneau, de Rochefort et autres.
Les héritiers d’Estouteville recevaient une indemnité pécuniaire de 50 000
livres tournois et se voyaient, en outre, autorisés à prendre la coupe de
466 arpents de haute futaie dans les bois de Rochefort, la Roche-Guyon et
Auneau.
Cette convention fut-elle scellée par un bornage
des propriétés ainsi reconnues ? Les pièces du chartrier de la Roche-Guyon
n’en font pas mention, mais nous avons toutes raisons de le penser. Notre
borne représenterait donc un témoignage matériel de l’accord intervenu entre
les descendants de deux mariages successifs, puisqu’elle porte, sur une face,
les armes des Silly, des Sarrebruck et des La Roche-Guyon, sur la face opposée, celles
des d’Estouteville et des Saint-Pol. Ainsi s’explique la présence en deux
groupes distincts sur une même borne des armes de cinq familles. D’autre
part, la date de l’accord n’est pas en contradiction avec le style des écussons.
Il nous reste, en terminant, à exprimer notre gratitude
à M. Max Prinet, qui nous apporta le concours de sa grande science héraldique
dans l’identification des armoiries de notre borne. Nous tenons, d’autre
part, à signaler que c’est un jeune érudit de Rambouillet, M. Pierre Villeneuve
de Janti, qui, ayant discerné l’intérêt de cette borne, a bien voulu nous
conduire à son emplacement.
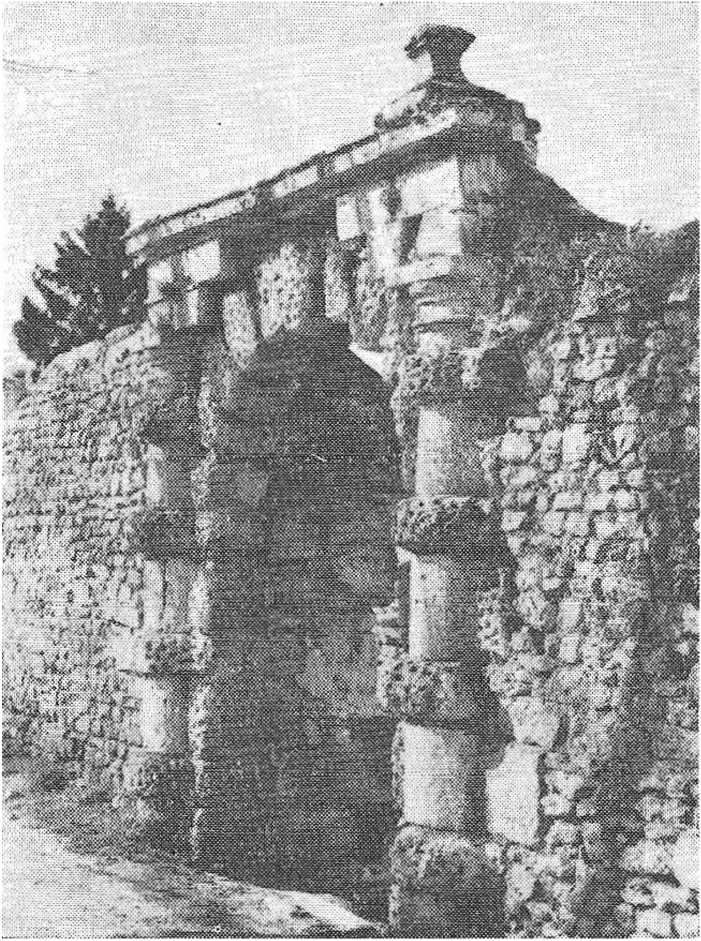
La porte Bressault en
août 1962
10. La Porte Bressault
'
Par Raymonde de Saint-Périer et Bernard Jeanson
Dans la rue de la Digue, qui longe la Chalouette,
s’élevait encore jusqu’à la fin de l’été 1962, une très belle porte Renaissance,
à bossages vermiculés, à peu près intacte, ouverte dans un long mur qui clôturait
un vaste terrain, ayant appartenu, précisément au XVIe siècle,
à un domaine fort important54 55, sans doute par suite d’une ancienne donation
royale, ce qui explique la qualité de la porte. Le moulin qui en faisait
partie, situé sur la Chalouette, était un des quatre moulins d’Étampes dont
le propriétaire avait, par privilège spécial, droit de chasse à une bête,
sans payer aucune redevance au fermier dudit domaine.
Ce moulin prit successivement les noms de ses propriétaires
: Moulin de la Maladrerie, du XIIe au XVIe siècle, puis, de l Hospice. Le nom de Bressault, qui lui a été attribué on ne sait à quelle
époque, ainsi qu’à la porte Renaissance, est celui d’un très vieux hameau
du quartier, qu’une rue rappelle également.
À l’automne de 1962, cette porte a été abattue à
cause de l’incurie administrative.
Dès 1913, la Société des Amis du Musée d’Étampes s’inquiétait du sort de la porte Bressault. Lors de son
Assemblée générale,
M. Girondeau, secrétaire de la Société, s’exprime
ainsi : « Nous avions pensé que cette porte très intéressante était exposée
à être tôt ou tard démolie ; il nous semblait désirable que ce spécimen de
l’art architectural sous François Ier devint la propriété du Musée...
Les démarches faites auprès du propriétaire de la dite porte ont été vaines
»56.
Cinquante ans plus tard, la porte est toujours debout
et peut être sauvée. Mais elle est menacée. Une démarche pressante auprès des
autorités ne donne aucun résultat et la pioche des démolisseurs commence
son œuvre. Une seconde démarche, alors que les éléments de la porte gisent,
encore complets, sur le sol et peuvent donc être réédifiés, rencontre la
même indifférence. Et tout a disparu. Pourra-t-on |32 retrouver
ces beaux fragments, et reconstituer une arcade dont la sobre élégance eût fort
bien décoré un jardin de la Ville ? Nous soumettons la question à notre Municipalité
qui montre un si réconfortant souci de promouvoir notre Ville, tout en lui
conservant sa beauté.
Nous venions d’écrire ces lignes — tristement ! —
lorsque nous avons eu la bonne fortune de rencontrer M. le Maire et M. Bellier, plus
tôt que nous n’osions l’espérer. Ils ont immédiatement dissipé notre amertume
en nous assurant que tous les éléments de la porte Bressault ont été mis
en sûreté et comptés par M. Bellier lui-même : il n’en manque aucun et la
porte sera reconstituée.
Nous nous hâtons d’annoncer cette heureuse nouvelle
à nos lecteurs, attachés comme nous au passé et au charme d’Étampes. Et nous
tenons à exprimer déjà toute notre reconnaissance à M. le Maire, ainsi qu’à
M. Bellier pour sa prévoyance et son dévouement.

La porte Bressault en
octobre 1962

Fig. 2 — Monument funéraire d'Adrien de Wignacourt et
de Louise de Saint-Périer (Église d ’Étouv)
11. Les Saint-Périer, ancienne
famille des confins du Gâtinais »
Un de mes collègues de la Société préhistorique française,
aujourd’hui décédé, M. Bazin, demeurant à Rebais (Seine-et-Marne), voulut
bien attirer mon attention, en 1913, sur une pierre tombale conservée dans
l’église de Villiers-Saint-Georges (Seine-et-Marne), qui portait le nom d’un
seigneur de Mauperthuis, Jacques de Saint-Périer. Des recherches sur ce personnage
m’ ayant permis de retrouver également les tombes de ses deux filles, il
m’a paru intéressant de publier ensemble ces trois monuments, avec les indications
que je possède et que j’ai pu recueillir sur cette famille de notre région.
Dès le XVe siècle, nous voyons les Saint-Périer
posséder fiefs en Brie. Il semble, cependant, qu’ils aient vécu antérieurement dans
le Vexin car Guillaume de Saint-Périer, « de la baillie de Gisors », donne
quittance, en 1302, à Chantre de Milly, de 16 livres tournois pour ses gages
en l’ost de Flandre57
58. Mais c’est en 1475
seulement que nous les trouvons à Mauperthuis59 par le mariage de Henri de Saint-Périer
|61 avec Élisabeth de Meaux, fille de feu Jean de Meaux60, écuyer, et de
Marie de Charny. Le contrat fut passé devant Montion, tabellion à Coulommiers,
le 1er janvier 1475. Élisabeth de Meaux apportait en dot la terre
de Mauperthuis61.
Le 2 juillet 1476, le même Henri rend hommage au roi, châtelain de Coulommiers,
pour le fief de Mauperluis-le-Haren, appartenant à Isabelle (Élisabeth) de
Meaux, sa femme62. Il
meurt avant 1513.
Nous trouvons, à la même époque, un Antoine de Saint-Périer,
peut-être frère de celui-ci, conseiller et chambellan du roi, qui obtint
des lettres de terrier pour la terre de Vaux en 148663. Henri de Saint-Périer
eut un fils Jean, seigneur de Mauperthuis, qui épousa, le 15 avril 1513,
Catherine de Chevry, fille de feu Antoine de Chevry64 seigneur de Vaudoy65, de La Motte, de Flaix66 el de La Charmoye67, et de Marie Dubois,
veuve de
Charles Godonvilliers, seigneur de Touquin68, également décédée.
Les Chevry étaient seigneurs de Vaudoy dès 131269.
Catherine était assistée de son frère Jean de Chevry,
écuyer, |62 seigneur de Chevry70 et de Malvoisine71, qui, d’après le
contrat reçu par Charpentier, tabellion à Jouy-le-Châtel, lui donne une dot
de 550 livres, plus dix arpents de bois à prendre dans les bois de Malvoisine
« près le bois de Cardon ». La terre de Malvoisine avait été achetée, le
6 juin 1497, par Antoine de Chevry pour son fils Jean72. Isabelle de Meaux,
qui assiste son fils, lui donne l’hôtel seigneurial de Mauperthuis, contenant
sept à huit arpents, avec la moitié du revenu de la terre de Mauperthuis
« appartenant de son propre à ladite dame ».
Ce contrat fut passé en présence de Jean de Meaux,
seigneur de Charny, Adam du Bois, seigneur de Verneil, et Guillaume Élyon, seigneur
de Brizon73.
Le 1er septembre 1543, Jean de Saint-Périer rend hommage du fief
de Mauperthuis-le-Haren à Guy comte de Laval, seigneur de Coulommiers74. Jean de Saint-Périer
était mort en 1554.
Il laissait trois fils, Jean, Gabriel et Roch, que
nous allons reprendre, et cinq filles dont nous ne poursuivrons pas les destinées.
Le second fils, Gabriel, qui épousa, après 1555,
Françoise de Laval, née en 1520 à La Faigne75, veuve de Georges
de Cazenove, seigneur de Gaillardbois76, fille aînée de René de Laval, seigneur
de La Faigne et de Marie de Bussu, ne laissa pas de descendants. Nous retrouverons
plus loin le troisième fils, Roch.
L’aîné, Jean IIe du nom, seigneur de Mauperthuis,
épousa, le 11 août 1547, Marguerite de Montgarny77. Il partagea le
|63 9 mars 1554, avec ses frères Gabriel et Roch, les biens qui
leur étaient échus par la mort de leur père et de leur mère78. Nous avons de
lui deux procurations, du 9 juillet 1583 et du 11 février 1584, pour donner
quittance à François de Vigny, receveur de la ville de Paris, d’arrérages
échus d’une rente sur la ville de Paris79. Il était mort en 1598. Il avait eu trois
enfants : Jacques, qui va suivre ; Hector, qui d’après une montre faite en
la ville d’Ardres80
le 24 août 1572, fut bailli de Nevers81 et ne paraît pas avoir laissé de descendants
; et Judith, mariée à son cousin Louis de Meaux, seigneur de Charny et de
Drouaise, fils d’Abel de Meaux et de Marie de Chevry, écuyer ordinaire du
cardinal d’Este82.
Jacques, seigneur de Mauperthuis, de Grayon-sur-Seine83, de Rozelles84 et de Villiers-Saint-Georges
en partie, est celui dont la pierre tombale existe encore dans l’église de
Villiers-Saint-
Georges. Il naquit à une date que nous ignorons,
postérieurement à 1547, et mourut en 1591. Il était parti jeune pour l’armée,
car nous le voyons figurer avec son frère Hector dans la montre85 de 20 hommes d’armes
et de 34 archers des ordonnances du roi, sous la charge et la conduite du
chevalier de Seure, grand prieur de Champagne, tenue à Ardres le 24 août
1572. Il était alors archer et fut fait homme d’armes à cette montre en remplacement d’Hector
Ajusson. Plus tard, nous trouvons Jacques gentilhomme ordinaire de la chambre
du duc d’Alençon86.
Le 10 avril 1576, il épousa, par contrat passé devant Villette, notaire à Balloy,
Louise de |64 Challemaison87, fille de Jacques de Challemaison, seigneur
de Balloy et de Gravon, et de Marguerite de Richebourg. Les Challemaison
étaient une des familles les plus anciennes et les plus importantes de la
Brie champenoise88. On
trouve un Eudes de Challemaison dans un ate de vente de 120889. Au XVIe
siècle, ils possédaient les fiefs de Gravon, de Rozelles, de Balloy90, de Chalautre-la-Grande91, de la Tombe92.
Le père de Louise, mort en 1577, et son oncle Mathieu,
grand vicaire de Sens, furent inhumés, ainsi que leurs parents, Gaucher de
Challemaison et Annette de Guerchy, dans l’église de Balloy.
La pierre tombale de Mathieu, fort belle, subsiste
encore, ainsi qu’une inscription relative à Jacques93.
Au moment de son mariage avec Jacques de Saint-Périer,
Louise de Challemaison était veuve de Charles de Verdelot94, fils de Charles
et de Geneviève de Meaux; dont elle avait un fils, Mathieu, qui fut conseiller
du roi, gentilhomme de sa chambre et bailli de Provins. Les Verdelot95 étaient seigneurs
de Villiers-Saint-Georges, où Regnault de Verdelot en 1340 fonda dans l’église
une chapelle au vocable de saint Jacques96.
Par son premier mariage, Louise de Challemaison possédait
le château de Villiers-Saint-Georges où Jacques de Saint-Périer vint s’installer
avec elle ; son père, Jean, habitant à Mauperthuis. Jacques et sa femme possédaient
de nombreuses terres aux environs de Provins. Gravon, Refuge et Rozelles
avaient été attribués à Louise dans un partage avec |65 François
et Mathieu de Challemaison97. Le seul fief de Rozelles comprenait un
hôtel seigneurial avec une ferme et 400 arpents de terre, pâtures et « bois
broussailles ». En outre, Jacques était possesseur, à Gravon, des fiefs de
l’Islotte, des Osches de Savins, de La Mothe et du Plessis ; à Villiers-Saint-Georges,
des fiefs de Laistre, de L’Espauche, des Fosses-Rapillad, des Granges-sous-Luardon,
et, dans le canton de Sergines (Yonne), des fiefs des Barres et du Bois des
Arres98. Nous
savons, par ailleurs, qu’il avait acheté, le 11 avril 1577, le fief de Laistre
, « sis devant l’église de Villiers », et celui de l’Espauche pour 420 livres
de rente, de Jean Retel, avocat du roi au bailliage de Provins, par un acte
passé devant Antoine Macé, notaire99.
Jacques de Saint-Périer fut mêlé aux troubles qui,
en Brie comme dans la plupart des provinces de France, désolèrent la fin du
XVIe siècle. Il vivait alors à Villiers-Saint-Georges et il intervint
plusieurs fois, avec les gentilshommes de la région, pour réprimer le pillage
et rétablir un calme relatif dans les campagnes. En 1578, le duc d’Anjou,
voulant soutenir les Flamands révoltés contre l’Espagne, commence à réunir
une armée dans ce dessein. Il fait lever des troupes par son lieutenant général,
M. de Rosne ; les Bretons, les Normands, les Bourguignons et les Picards
se groupent sur les apanages du duc. En juin et juillet de cette même année,
les levées de Champagne, de Brie, du Hurepoix et du Gâtinais s’assemblent
aux environs de Montereau, et, en attendant leur départ pour les Flandres, commencent
à ravager le pays où ils cantonnent. « Les compagnies qui s’assemblèrent
à Montereau-fault-Yonne n’avaient oublié le métier de rançonner, battre et
désoler leur |66 hôte ès maisons où ils étaient logés. Sous le
nom et prétexte d’aller en Flandre, tous, bannis, vagabonds, voleurs, meurtriers, renieurs
de Dieu et de vieilles dettes, remenans de guerre, restes de gibets, massacreurs,
vérolés, gens mourant de faim, se mirent aux champs pour aller piller, battre
et ruiner les hommes des villes et villages qui tombaient en leurs mains
ès lieux où ils logeaient et par les chemins, sans crainte aucune »100. Une de ces bandes,
forte de 1 800 hommes et commandée par un sieur Mirloset, fait le siège de
Chalautre-la-Grande et s’y distingue par une cruauté qui dépasse en raffinement
les exploits précédents de ces bandits. Le samedi 31 août, Jacques de Saint-Périer
fait partie d’une délégation de gentilshommes de la région qui viennent demander
au farouche Mirloset la délivrance de leurs compagnons, gentilshommes comme
eux, prisonniers de sa bande101. Le 10 septembre, « il advint que voleurs
et gens de guerre avaient de nuit efforcé la personne et maison de M. de Saint-Bon,
gentilhomme honneste, lequel eut for t à faire en ces besognes et, pour se
délivrer d’ iceux, envoya appeler tous les gentilshommes ses voisins et nommément
M. de Maupertuis le jeune, demeurant au château de Villiers-Saint-Georges,
qui, avec le plus de gens qu’il put, alla le secourir102 ».
En janvier 1581, les troupes du duc d’Anjou passent
de nouveau en Brie, à leur retour de Flandre, et ravagent encore le pays.
Le duc d’Anjou loge à Provins et répartit son armée dans les villages des
environs « à dix lieues en longueur et en largeur. Dieu sait combien il y
eut de requêtes par les gentilshommes pour exempter leurs sujets ; mais peu
s’en sauvèrent. Le sieur de Besancourt exempta la paroisse de Bauchery et
M. de Maupertuis le village de Villiers-Saint-Georges pour la grande connaissance
qu’ils avaient aux dits commissaires et maîtres de camp »103.
|67
Jacques de Saint-Périer mourut dix ans après ces
évènements, jeune encore, et fut inhumé dans l’église de Villiers-Saint-Georges.
Sa pierre tombale104
est scellée verticalement dans le mur gauche de la nef de l’église (fig.
1). Elle mesure 2 m. 42 sur 0 m. 97. Son état de conservation, malgré quelques
martelages, est excellent et paraît indiquer qu’elle n’était pas posée primitivement
sur le passage des fidèles. En effet, deux autres pierres tombales de la
même église, placées au milieu du carrelage de la nef et du chœur, celle
d’un Verdelot et celle de Guillaume de Vièvre, maître d’hôtel de Louis XI,
époux de Jeanne de Verdelot (1502), sont si altérées que la lecture de leurs inscriptions
est devenue difficile. Il se peut que notre pierre ait recouvert un monument
surélevé au-dessus du pavage de la nef, comme il en était pour une autre
pierre (1536) de la région d’Étampes, à Buno-Bonnevaux105, dont la disposition
primitive en surélévation m’a été révélée par un texte inédit du XVIIe siècle.
Sous un entablement supporté par quatre pilastres
ornés de feuillages et de pampres, le défunt est figuré les mains jointes,
la tête découverte. Il porte toute sa barbe, ses cheveux, sont bouclés, ses
pieds reposent sur un lion dont la queue, terminée par un panache de poils,
apparaît entre les jambes du défunt. Celui-ci est revêtu d’une armure damasquinée
dont les jambières montrent des têtes d’enfants, encadrées de feuillages
et de rinceaux. On retrouve les rinceaux et les feuillages sur les brassards,
les cuissards et les genouillères, mais l’une d’elles est martelée. C’est
là une de ces armures italiennes, chef-d’œuvre de la belle époque de la Renaissance,
comme en ont laissé les maîtres armuriers de Milan, Missaglia et Negroli106.

3Wf) itq oaBJff gtttyulnBm ^ atmtffu/la^rujji nwfflq.
noj iu £Tmiiÿiu»j ^ gitrbj^jüT
Zeqatl frreùùa le\)ruï>reî|yJroiir
tara et au&w apoQre fermer Jo ur Ur nouembtf mil cmjï'quatTf*?!
L’armure est recouverte d’un vêtement très ample,
à col plat, à larges manches évasées au coude, sorte de surplis |68
fendu sur le côté gauche pour laisser apparaître la poignée de l’épée. Celle-ci passe
derrière le corps, mais, par une erreur assez singulière de la part du graveur
d’une pierre aussi ornée, l’épée, poursuivant un trajet oblique de haut en
bas, vient perforer la partie postérieure de la cuisse droite et sortir en
avant sous la rotule. S’agit-il bien d’une maladresse ou l’épée qui traverse
la jambe du personnage serait-elle le symbole d’une blessure qui aurait entraîné
la mort ? À la gauche du défunt, se tient debout un jeune garçon en costume
de page, avec l’épée, la tête nue et les mains jointes ; derrière lui, on
aperçoit le casque à vantail du défunt. L’entablement est surmonté de l’écu
des Saint-Périer: écartelé d’argent et d’azur à la bande de gueules
brochant sur le tout, à la cotice de gueules104. Cet écu est timbré d’un casque à lambrequins surmonté d’un
lion de face pour cimier ; il a deux lions pour supports. Le casque ne porte
pas de grilles, mais une tête de mort apparaît en son centre. Ce motif, qui
n’est pas héraldique, se retrouve sur d’ autres pierres tombales, notamment sur
celle de Jean Girard (1598) dans l’église de Guyancourt (Seine-et-Oise) ;
une tête de mort apparaît sous l’arc cintré qui surmonte l’effigie du défunt107 108.
Des deux côtés de l’ écu central, des rameaux de
lauriers accompagnent deux cartouches qui portent, à droite, les armes de Challemaison
(inexactes d’ ailleurs, car la rose centrale de la fasce est remplacée par
une molette d’éperon) et à gauche un écu parti de Saint-Périer et de Challemaison.
Aux quatre angles de la pierre, quatre médaillons sont si altérés qu’il est
difficile d’en distinguer les gravures. Cependant, à gauche, sur le médaillon inférieur,
on reconnaît un lion, sur le médaillon supérieur, un oiseau : il est possible
qu’on ait voulu figurer les symboles des quatre évangélistes. L’épitaphe
est ainsi conçue en lettres gothiques : |69
Cy gist Jacques de sainctpérier
en son vivant escuyer seigneur de maupertuis gravo sur seine 11 rozelles el villers sainct georges ë partie |1 lequel decedda le vendredy jour sainct andré
apostre dernier jour de novembre mil cinq c quatre xx et || onze. priez dieu pour luy.
Cette belle pierre tombale, peut-être un peu trop
chargée de détails et d’un style qui manque de sobriété, comme le voulait
le goût italien de l’époque, nous donne-t-elle une figure ressemblante du
personnage qu’elle représente ? Cela est peu probable, car il semble bien
que les tombiers avaient des modèles qu’ils proposaient à leurs clients et
qu’aucun souci d’iconographie n’intervenait dans leur composition109.
Nous n’avons pu retrouver à Villiers-Saint-Georges
d’autres documents concernant .Jacques de Saint-Périer. Les registres paroissiaux
débutent en 1641 seulement; ils contiennent de nombreuses signatures des
Verdelot. Gaspard de Verdelot, marquis de Villiers-Saint-Georges, fils de
Mathieu qui était le beau-fils de Jacques de Saint-Périer, vécut en effet
jusqu’à 1664. Le château actuel, qui paraît avoir conservé quelques parties anciennes,
est bordé d’un fossé d’eau vive indiquant que c’est bien là l’ emplacement
de l’ ancien édifice seigneurial.
La veuve de Jacques, Louise de Challemaison, vécut
longtemps après lui ; en 1605, elle donne un reçu d’arrérages de rente constituée
sur la ville de Paris par son beau-père, Jean de Saint-Périer ; nous savons
qu’elle vit encore en 1621 par une procuration donnée à son fils, Mathieu
de Verdelot110.
Jacques de Saint-Périer laissait deux filles dont
nous allons poursuivre la descendance. Peut-être eut-il un fils, mort jeune, dont
les documents, à défaut des registres paroissiaux, ne font pas mention, car
le jeune page figuré sur la pierre tombale pourrait être son fils. On sait
qu’au XVIe siècle il était d’usage de représenter sur les pierres
tombales des |70 hommes les fils qu’ils avaient perdus et, sur
les pierres des femmes, les filles décédées jeunes111.
Quoi qu’il en soit, nous connaissons seulement ses
deux filles : Louise et Françoise.
Louise naquit en 1584 ; dès l’âge de quatorze ans,
le 17 novembre 1598, elle épousait Adrien de Wignacourt, seigneur de Litz112, de La Rue Saint-Pierre
et d’Etouy113,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chevalier de son ordre, gouverneur
de la ville et château de Bray-sur-Somme114, capitaine-lieutenant de la compagnie
des gendarmes du duc de Vendôme. Il était fils de Jean, seigneur de Litz
et de La Rue-Saint-Pierre, et de Marie de la Porte. Les Wignacourt115, une très ancienne
maison du nord de la F rance, avaient déjà pris alliance en Brie. Joachim
de Wignacourt, frère aîné d’Adrien, avait épousé, en 1582, Claude de Challemaison,
sœur de Louise et tante de Louise de Saint-Périer. Il vivait en Brie où il
possédait de nombreux fiefs dont nous ne donnerons pas le détail116. Nous dirons
seulement qu’il fut le premier Wignacourt seigneur de Balloy, et cela par
sa femme, Claude de Challemaison, contrairement à l’assertion de Haudicquer
de Blancourt dans son Nobiliaire de Picardie, en 1693, puis de d’Hozier117. Balloy appartenait, nous l’avons dit,
aux Challemaison dès le XVIe siècle et passa entre les mains d’Adrien
de Wignacourt après la mort de son frère Joachim et de Claude de Challemaison.
Adrien fit, en effet, dresser le terrier de Balloy en 1625118. Son autre frère,
Alof, dont on connaît le beau portrait par le Caravage119, devait être
élu grand maître |71 de l’Ordre de Malte en 1601 et le resta pendant
plus de vingt années. Il soutint contre les Turcs de nombreux combats et
fit construire à Malte un aqueduc « digne de la grandeur des Romains »120. Il mourut à
75 ans « d’une attaque d’ apoplexie dont il fut surpris, étant à la chasse
et poursuivant un lièvre dans la plus grande chaleur du mois d’août121 ».
Alof et Joachim de Wignacourt assistaient leur frère
Adrien à son mariage avec Louise de Saint-Périer qui eut lieu à Balloy, près
de Provins. Le contrat fut passé devant Coppe, tabellion à Marolles-sur-Seine
(Seine-et-Marne). Joachim de Wignacourt et Claude de Challemaison, n’ayant
pas d’enfants, donnaient aux époux la terre de Chailly et le fief de Macherin
au bailliage de
Melun, et les instituaient leurs héritiers. Louise
était également assistée de son demi-frère, Mathieu de Verdelot, et de Louis
de Meaux, son oncle122.
En 1608, Adrien de Wignacourt obtint la terre d’Etouy123 par échange
avec Jacques d’ Estampes, qui avait acheté ce domaine deux ans seulement
auparavant à la famille d’Ongnies, qui le possédait depuis plus d’un siècle124. Adrien de Wignacourt
quitta La Rue-Saint-Pierre, où avaient vécu ses ancêtres, et vint habiter Étouy.
Il ne subsiste rien aujourd’hui du château, démoli en 1758 par Charles de
Fitz-James, mais on connaît son emplacement par un large fossé qui séparait
la demeure seigneuriale de la ferme construite par Adrien de Wignacourt en
1616, date qui était
encore visible il y a quelques années au-dessus de
la porte d’une
122
grange125.
Adrien de Wignacourt et Louise de Saint-Périer moururent
tous deux en 1628 à quelques mois d’intervalle, « après trente |72
ans de l’ union la plus parfaite et la plus sainte », nous dit leur épitaphe.
Elle nous apprend encore qu’Adrien mourut « dans la soixante et onzième année
de son âge, des suites de la maladie de la pierre, après de nombreux exemples
de courage militaire et une existence réputée à bon droit comme tout à fait
intègre. Sa très noble et très chère épouse avait assuré l’avenir de sa noble maison
par une nombreuse postérité ».

Fig. 2 — Monument funéraire d’Adrien de Wignacourt
et de Louise de Saint-Périer (Église d’Étouy)
Cette épitaphe, en latin, est gravée derrière le
monument que les enfants du défunt « pleins d’ affliction, élevèrent à leurs excellents
parents » dans l’ église d’ Étouy. Nous donnons (fig. 2) une reproduction
photographique de ce monument, figuré seulement jusqu’ici par un dessin au
trait, fort peu exact, d’abord dans l’ouvrage de Debeauve et Roussel que
nous avons cité et ensuite dans l’étude anonyme sur Etouy. Sous un arc en
plein cintre, dans la chapelle Saint-Fiacre de l’église d’Etouy, les deux défunts
sont représentés en ronde bosse, agenouillés sur des prie-Dieu couverts de
housses et richement ornés. Les mains sont jointes et les têtes découvertes.
Adrien de Wignacourt porte la moustache relevée au petit fer et une courte
barbe en pointe. Il est revêtu d’une armure complète que cache en partie
une cotte d’armes à manches courtes, ornée des pièces d’armes des Wignacourt
(fleurs de lis et lambel). Son cou est entouré d’une fraise. On distingue
la poignée de son épée et les branches de ses éperons, mais le reste en a
été brisé. Sur son prie-Dieu est gravé un écu parti de Wignacourt et de Saint-Périer.
Louise de Saint-Périer est vêtue d’une ample robe, à nombreux plis et à large collerette.
Son prie-Dieu porte un écu aux armes des Wignacourt seules. Les deux têtes
sont en marbre blanc, rapportées sur les corps qui sont en pierre calcaire
jaunâtre, à grain fin. Les mains devaient être également en marbre : elles
sont remplacées par de grossières ébauches en plâtre. Elles durent être brisées
en même temps que le nez d’ Adrien de Wignacourt, qui n’ a pas été restauré.
Une grille de bois protège aujourd’hui le monument. Ici encore, il ne s’agit
pas de portraits, car la tête à cheveux bouclés de Louise est certainement
copiée sur une effigie de Marie de Médicis, dont elle évoque la face large
et inexpressive. |73 Sur le mur du fond, derrière les statues,
est fixée la dalle de marbre noir qui porte l’épitaphe latine dont nous avons
cité des extraits126.
Adrien de Wignacourt et Louise de Saint-Périer eurent
trois fils et deux filles. L’aîné, Alof, filleul du grand maître de Malte,
son oncle, marquis de Wignacourt à la mort de son père, premier veneur de
Gaston d’Orléans, épousa Marguerite Gouffier de Bonnivet dont il eut deux
fils. L’ aîné, Claude Adrien, dut abandonner ses terres d’Étouy, de Litz
et de La Rue-Saint-Pierre, saisies et adjugées en 1685 ; le second, Pierre
Adrien, appelé à Malte par son oncle, devint à son tour grand maître de l’Ordre
en 1690. Une des filles d’Adrien de Wignacourt et de Louise de Saint-Périer,
Louise, épousa en 1610 Claude de La Viefville127, seigneur d’Orvillers128, cornette de
la compagnie des gendarmes du duc de Vendôme. Elle fut, en 1619, la marraine
d’une cloche de l’église de Montigny-sur-Loing129, transportée en 1793 dans l’église de
La Genevraye (Seine-et-Marne).
La seconde fille de Jacques de Saint-Périer, Françoise,
dont nous ignorons la date de naissance, épousa le 10 juin 1600 Charles de
Melun130,
chevalier, seigneur du Bignon131, des Hayes, de Pierre-Aiguë et autres
1ieux, gentilhomme ordinaire de la chambre de Henri de Bourbon, prince de
Condé, puis de la chambre du roi, né le 29 novembre 1571 de Philippe de Melun
et de Françoise de Grailly. « Charles de Melun, dit Dom Morin132, est descendu
d’une des plus nobles, illustres et |74 anciennes familles de
France, à savoir des comtes de Melun, issus de la maison de Poitiers, laquelle
prend son origine du côté des mâles de la très noble et renommée maison de
Lusignan ». L’année même de son mariage, il fit construire au Bignon, « à
une portée de mousquet dudit village, dans le fond et en la prairie, un très beau
château, tout environné de larges fossés à fond de cuve et pleins d’ eau,
ayant fait démolir deux autres fiefs et châteaux attenant ledit village133 ».
Charles de Melun mourut le 13 mars 1627 et sa femme
le 29 juin de la même année. Tous deux furent inhumés dans l’église du Bignon.
« On y voit, dit Michelin en 1843134, son tombeau en marbre noir, avec ses
armes et celles de sa femme ».
Actuellement, ce « tombeau » dalle en marbre noir,
qui mesure 2 m. sur 0 m. 72 en sa partie visible, si altérée qu’il nous a
fallu beaucoup de patience et de soin pour calquer l’ inscription mutilée que
nous figurons (fig. 3).
Elle a été martelée, mais il semble étrange que celle mutilation
soit postérieure à l’époque où écrivait Michelin. Il est plus probable que
cet auteur n’ a pas vu la pierre et qu’il l’a signalée d’ après une description
antérieure à la Révolution.
D’ autre part, une transformation du chœur de l’église faite en
1895,
comme nous l’ a appris un maçon qui y travailla,
a fait dissimuler une partie de la pierre sous la marche du sanctuaire. Cependant,
on reconnaît, sur la partie visible, un fragment
d’écusson où l’on devine
encore les besans des Melun. Autour de l’ écu, un
collier d’ ordre est entièrement martelé. À droite, un autre écu entouré
d’ un collier également martelé laisse
n’ est représenté que par une
5*£NC&«MAVFBftfrvf JCB^ferCT SA#*âhw k/€L DS (ÎEA^ri
fc
#].é\i\l. 1() 2 7 pm E f ««IS [U'H^E
'•: SA FF MME pi%*. : * j f iv iv A\ vKU Afà
Fig. 3 — Stèle de Charles de Melun et de Françoise de
Saint-Périer.
deviner l’écartelé des Saint-Périer. Nous avons réussi
à lire ce
qui demeure visible de l’inscription : ..... Charles de ..... un
Chevalier .. .. tilhomme
ordire a Chabre du Roy Bugnon
Mauperluis.....Payg et Savigny .. quel décéda le 13e
mars 1627
. .. Dame Françoise ...
Sf Périer sa femme ... céda le 29e juin audict an ...
Priez |75-76 Dieu... Cette inscription est destinée à disparaître totalement
en quelques années ; c’est pourquoi nous avons cru intéressant de la publier,
malgré son état de délabrement. Deux autres pierres, mieux conservées, concernent des
Melun, ainsi qu’un gisant brisé au-dessous des genoux, représentant Louis
de Melun, mort en 1568, grand oncle de Charles. Ces trois derniers monuments
sont classés.
Les enfants de Charles de Melun et de Françoise de
Saint-Périer furent Joachim et Louis.
Joachim, comte de Melun, seigneur du Bignon, de Pierre-Aiguë,
des Hayes, de Savigny132 et de Brumetz133, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du roi, naquit en 1601 en la maison seigneuriale
des Barres, paroisse de Gravon, qui appartenait aux Challemaison. Son parrain
fut Joachim de Wignacourt et sa marraine Louise de Challemaison. Il épousa,
en 1628, Françoise de Dillon de la Bécherelle, fille d’honneur d’Anne d’Autriche.
Il était mort en 1677134. L’arrière-petite-fille de ce Joachim,
mariée en 1736 à François de Laurens, marquis de Brue, à Aix-en-Provence,
vendit au père de Mirabeau son château du Bignon, en 1740135.
C’est ainsi que le grand tribun provençal naquit dans un petit village du
Gâtinais et dans « le très beau château » construit par Charles de Melun
et Françoise de Saint-Périer. Ce château 135 136 137 138 n’existe plus ; il a été remplacé, vers
1880, par une construction moderne.
Le second fils de Charles de Melun, seigneur de Mauperthuis
et de Gravon par sa mère, lieutenant-colonel du régiment de Picardie, maître
d’hôtel de Louis XIII, naquit vers 1604. « Homme intrépide et excellent officier,
dit J. François d’Hozier139, il fut blessé au siège de Thionville
le 8 août 1643 », |77 et tué à l’ennemi, selon les uns140 au siège de
Circq, le 2 septembre 1643, selon les autres141 en mai 1649.
Louis de Melun laissait un fils, Louis, né en 1634,
qui devint marquis de Mauperthuis. Sa carrière militaire fut longue et brillante
: mousquetaire en 1661, il fit partie de la compagnie qui arrêta Fouquet
à Nantes et fut chargé d’apporter à Louis XIV la nouvelle de cette arrestation.
Il fut ensuite capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires,
lieutenant général en 1693, se distingua à Candie, aux sièges de Maëstricht,
de Valenciennes, de Cassel, à Ypres, à Mons, à Namur et fut nommé grand croix
de Saint-Louis sans avoir été commandeur142. Malgré la fatigue de ces longs services
militaires, il mourut à 87 ans, le 18 avril 1721. En lui s’éteignit la branche
directe des seigneurs de Mauperthuis, car sa veuve, Madeleine Peufait des Tournelles,
dont il n’avait pas eu d’enfants, institua pour légataire de la seigneurie
de Mauperthuis Louis de Montesquiou d’Artagnan, brigadier des armées, et
celui-ci la laissa à son frère
Pierre. C’est ainsi que Mauperthuis, apporté en dot
à Henri de Saint-Périer par Isabelle de Meaux en 1475, sortit de la famille des
Saint-Périer et de leurs descendants, les Melun, après deux siècles et demi.
Nous n’avons rien retrouvé à Mauperthuis qui évoquât
directement le souvenir des Saint-Périer. Cependant nous savons qu’en 1622
on voyait encore « les armes de Saint-Périer dépeintes tant aux vitres du
château de Mauperthuis qu’en plusieurs endroits au dit lieu et à la grande
vitre de l’église, avec plusieurs autres armes d’alliances et parents, comme
|78 celles de Meaux, et de Chevry, dépeintes aux vitres de la
salle et chambres du château dudit Mauperthuis »143.
Il semble que les Montesquiou, au XVIIIe
siècle, aient considérablement modifié l’ancienne habitation, car un plan descriptif,
établi vers 1780, qui nous a été aimablement communiqué par la gardienne
de ce qui reste du domaine, mentionne des constructions dont le goût et le
style sont du XVIIIe siècle. La façade du château comprenait alors
« trois édifices parallèles à 29 croisées ; le bâtiment principal était couronné
d’un fronton sculpté». On y accédait par une chaussée « en revers de grès
» qui arrivait en pente douce à un grand fer à cheval conduisant à la cour
d’honneur. Il y avait dans le parc un temple des Arts, un Lambeau de Coligny
et un pavillon chinois. On reconnaît bien là les « fabriques » en honneur
au XVIIIe siècle. Dans les communs, il y avait une écurie pour
huit chevaux, un grand colombier, une bergerie et un pressoir. L’entrée était
fermée d’une grille avec deux pavillons carrés. Le domaine, qui appartenait
alors à Anne-Pierre de Montesquiou de
Fezensac, premier écuyer de Monsieur, comprenait
31 arpents de parc et 1 267 arpents avec les terres. Cette demeure était gracieusement
située au flanc d’une pente boisée qui dévale vers la petite rivière de l’Aubetin,
dont le gué, peu sûr durant les crues, avait donné le nom de Mauperthuis
au village. Il ne subsiste rien du château, mais des murs limitent encore
une partie du parc où l’on retrouve une construction en briques dont le revêtement
a été arraché : ce fut peut-être « le temple des Arts ». Le colombier subsiste
également, mais enclavé dans une propriété moderne.
Nous aurions pu trouver à Mauperthuis des documents
plus anciens, sans doute relatifs aux Saint-Périer et à leur seigneurie, puisqu’il
nous a été dit, à Mauperthuis, que plusieurs liasses de parchemins, provenant
du château, avaient été brûlées, il y a une vingtaine d’années seulement,
par un |79 habitant du pays dont les parents étaient détenteurs
de ces papiers depuis la Révolution.
*
* *
Nous avons vu que Jacques de Saint-Périer était le
dernier représentant mâle de la branche aînée de la famille établie en Brie.
Si le nom a subsisté, c’est par la descendance de Roch, troisième fils de
Jean, seigneur de Mauperthuis, dont le fils aîné fut le père de Jacques.
Nous allons dire quelques mots de cette dernière branche.
Roch de Saint-Périer, seigneur de Mauperthuis, avait
quitté la Brie par son mariage qui eut 1ieu le 4 février 1554 et dont le contrat
fut reçu par Ligier, tabellion à Gallardon (Eure-et-Loir). Il avait épousé
Philippe de Sabrevois, fille de feu Renaud de
Sabrevois144, seigneur de Bouchemont145, et de Michelle
de Pouy-Cougnères. Les Sabrevois, connus dès 1177146 ont possédé de
nombreux fiefs en Beauce chartraine du XIIIe au XVIIIe siècle.
Plusieurs ont été gouverneurs de Dreux et quelques-uns d’ entre eux se sont
illustrés au Canada pendant la guerre où nous perdîmes cette colonie147.
Roch de Saint-Périer avait guerroyé comme tous les
siens : un gentilhomme du bailliage de Dourdan, Nicolas de Ramezay, dit, en
1622, avoir ouï dire à son père N. de Ramezay que Roch et lui « avaient été
souvent ensemble ès guerres passées »148. |80
Du mariage de Roch et de Philippe de Sabrevois naquirent
Claude et Abel ; ce dernier mourut sans descendants. Claude, seigneur de
Bandeville149,
fit partie, comme son cousin Jacques de Saint-Périer, seigneur de Mauperthuis,
de la maison du duc d’Alençon. Il fut sept ans page, puis écuyer de la grande
écurie, et reçut, le 1er juin 1579, un brevet de pension de 1
000 livres « pour avoir toujours suivi ce prince à la guerre et dans tous
ses voyages ». En 1597, il est homme d’armes d’une compagnie d’ordonnances
et dispensé par le roi de la contribution au ban et à l’arrière-ban « en
considération des services qu’il rend à l’armée au siège d’Amiens »150.
Claude épousa, le 27 octobre 1591, par contrat passé
devant Le Dreux, tabellion à Corbreuse, Élisabeth de Languedoüe151, fille de Louis
de Languedoüe, seigneur de Pussay152, et de Marie Le Chat. On trouve les Languedoüe
seigneurs de Pussay vers le milieu du XVe siècle ; mais les parents
d’Élisabeth habitaient « la maison seigneuriale du Grand-Pressoir, paroisse
de Corbreuse, qui était le lieu originaire des père et grand-père de ladite demoiselle
et lieu de sa naissance et de tous ses prédécesseurs, auquel lien nous avons
vu les armes dudit seigneur de Pussay, où est dépeint trois serpents couronnés,
attachés à un manteau de cheminée et buffet fait à l’antique »153. Le père d’Élisabeth «
avait eu de belles charges ès armées de sa Majesté »154, d’abord gentilhomme
ordinaire |81 de la maison du maréchal de Montmorency, il devint
lieutenant de l’ artillerie de France.
Claude de Saint-Périer mourut à 80 ans; il avait
eu cinq fils et trois filles : Claude, César, Louis, Charles, Antoine, Philippe, Anne
et Elisabeth155.
Claude IIe du nom, seigneur de Bandeville,
n’eut qu’un fils, François, lieutenant de cavalerie au régiment de Montgomery
et gendarme de la garde du roi, dont les enfants ne laissèrent point de postérité.
Nous citerons seulement sa fille, Gabrielle-Françoise, née en 1674, entrée
en 1686 à Saint-Cyr où elle fit profession en 1697. Elle occupait les fonctions
de première maîtresse des « bleues » (classe supérieure). Madame de Maintenon
lui adressa plusieurs lettres, en 1698 et 1708156. Elle mourut à Saint-Cyr en 1712.
César et Louis furent chevaliers de Malte : le premier
entra dans l’ Ordre en 1612 et mourut à Malte en 1619 des blessures qu’il
avait reçues au siège de Sousse, sur la côte de Barbarie157. C’ est à tort
que Mathieu de Goussancourt, dans son Martyrologe158, donne la
date de 1608 comme celle du siège de Sousse. |82
Louis, reçu dans l’Ordre en 1622, mourut également
à Malte à une date que nous ignorons.
Antoine, IIe du nom, seigneur de Bandeville
en partie, mourut sans enfants, en 1675, et fut enterré au cimetière de Corbreuse, «
au bout de la chapelle Sainte-Anne ». Par son testament, il laisse le fief
de Bandeville avec toutes ses dépendances aux enfants de son frère Charles,
seigneur de Durand159.
D’autre part, il lègue « une maison située à Corbreuse, dite « maison de
la Butte », pour servir à tenir les petites écoles dudit lieu et 4 arpents
40 perches de terre, acquises par lui au terroir de Corbreuse, au maître
de l’école, pour servir à une partie de son entretien, à la charge par le
dit maître d’ école d’ entretenir la maison en réparation, d’acquitter annuellement
la censive due au fief de Bandeville, dont elle est mouvante, et de faire
dire à perpétuité par deux de ses écoliers à la fin de la classe un De Profundis et un Requiescat à l’intention
dudit Antoine160
» .
Des trois filles de Claude, seule Anne se maria avec
André de Carival, seigneur du Plessy, capitaine au régiment de Navarre. Leur
fils, André, est parrain à Bleury161 le 27 juin 1632. Une autre fille, Elisabeth,
mourut à Corbreuse en 1697 à l’âge de 89 ans. Elle laissait à l’école de
Corbreuse, par donation de 1681, une pièce de terre de 93 perches, à la charge
par le maître d’école d’instruire un pauvre au choix du curé162.
C’est le quatrième fils de Claude et d’Élisabeth
de Languedoüe qui assure la descendance : Charles de Saint-Périer, seigneur
de Durand163,
capitaine d’infanterie. Il épousa, le 27 avril 1650, à Étampes, Marie Foudrier164, fille de feu
Jean |83 Foudrier, lieutenant de la maréchaussée d’Étampes et
de feue Marie Guisenet. Il eut cinq enfants : Jean-Baptiste, César-Joachim, Anne-Henry,
Charles et Marie. Ses quatre fils devaient être les derniers représentants
mâles du nom. L’aîné seul, Jean-Baptiste, eut des enfants, deux filles, dont
nous verrons plus loin la descendance.
Marie mourut sans alliance à Corbreuse en 1739, à
80 ans.
Charles IIe du nom, seigneur de Coignières165 par son oncle
Antoine, fut baptisé le 3 mai 1669 à Boissy-le-Sec166 où son père possédait
une métairie ; son parrain était le mari de Jacqueline de Paviot, J.-B. Cochon,
seigneur de Bonneval, sa marraine, Madeleine de Paviot, famille dont nous
avons parlé dans un précédent travail167. Il était commissaire de l’artillerie
en 1699 et se maria à Anvers.
Anne-Henry, né à Corbreuse en 1664, était garde de
la marine en 1684, et fut fait prisonnier lors du bombardement de Gênes par
Duquesne à cette date168 ; en 1699, il était lieutenant de vaisseau
et capitaine d’une compagnie franche de la marine.
Devenu capitaine de frégate, il épousa à Marseille,
le 3 mai 1700, Marie Bérault, demi-sœur d’André d’Antan, trésorier des galères du
port de Marseille. Celui-ci, en considération « de l’amitié qu’il avait toujours
eue pour sa sœur », lui offrait pour son mariage, outre une somme d’ argent,
un mobilier estimé à 12000 livres qui comprenait « un lit de bois de noyer,
garni de ses matelas, chaînes et couvertures, le tout de damas cramoisi doublé de
satin blanc et broderies au ciel, dossier et chantourné et courtepointe,
neuf chaises dorées et brodées ou à petit point, deux placets de même, le
tout bordé de velours vert, tapisserie et portière de damas cramoisi, rideaux
de fenêtre de lizac rayé, un bureau d’écaille |84 bronzé, un miroir
et deux guéridons avec un tabouret en pied, façon de la Chine, garni de porcelaine
». Anne-Henry fut capitaine général et inspecteur des milices garde-côtes de
Provence, puis capitaine des vaisseaux du roi et mourut sans enfants.
César-Joachim, marquis de Saint-Périer, naquit le
14 décembre 1662 et fut baptisé dans l’église N.-D. de Corbreuse le 28 décembre
; son parrain fut César de Paviot, seigneur de Boissy-le-Sec, sa marraine,
Anne Élisabeth de Besançon, cousine de son père par les Carival169. Il eut une
carrière militaire fort longue et brillante dont nous donnerons seulement
un aperçu, car, pour en suivre les péripéties, il faudrait rappeler toutes
les campagnes de la fin du règne de Louis XIV et des premières années du
règne de Louis XV170.
Nous dirons seulement que, parti des grades subalternes de l’artillerie,
il franchit successivement tous les échelons jusqu’à celui de lieutenant
général des armées du roi en 1734 (fig. 4)171. Il participa aux batailles de Steinkerque
et de Neerwinden, fit toute la campagne d’Italie en 1701 et 1702, toute la
guerre de la succession d’Espagne, durant laquelle il commanda en chef l’
artillerie, se distingua aux sièges de Lerida et de Tortosa, puis, appelé
au commandement de l’artillerie au département général de l’ Alsace, « servit
supérieurement aux sièges de Landau et de Fribourg ». À 71 ans, en 1733,
alors qu’il était lieutenant général de l’artillerie au département de Flandre, il
reçut le commandement de l’artillerie de l’armée d’Italie, sous les ordres
du maréchal de Villars. Il traverse les Alpes au mois de décembre, « ayant
trouvé beaucoup de difficultés |85 dans le passage des montagnes
par les glaces dont une partie sont
remplies172 ».
Dès la fin de la première campagne, il revint, sur
sa demande, à son département de Flandre. Il avait eu, en effet , quelques difficultés
avec le maréchal de Coigny, qui avait succédé à Villars, comme en témoignent
certaines de ses lettres à M. d’Angervilliers. « Lorsque j’aurai fait toutes
les dispositions que vous jugerez nécessaires pour bien assurer tout ce qui
peut concerner le service de l’artillerie pour la campagne prochaine, écrit-il,
j’espère, Monseigneur, qu’il me sera permis de m’en aller de ce pays-ci,
où M. le maréchal de Coigny ne me paraît pas disposé à avoir en moi toute
la confiance dont jusqu’à lui j’ai été honoré de tous les généraux avec qui
j’ ai servi, ce qui ne diminue en rien le parfait respect que j’ai pour lui
» (7 novembre 1734). Ces lettres montrent, en outre, combien la pénurie d’argent
se faisait déjà sentir aux armées et compliquait la tâche des officiers supérieurs.
Le Pelletier, dans ses Mémoires, que nous
avons cités plus haut, parle en termes assez amers de ses rapports avec le marquis
de Saint-Périer durant cette campagne. Au contraire, dans ses lettres (inédites),
le lieutenant-général vante à plusieurs reprises les qualités du commissaire
Le Pelletier, « sujet de mérite », et demande pour lui la croix de Saint-Louis.
Au reste lettres et mémoires révèlent des foyers d’intrigues aussi ardents qu’à
la Cour.
Fait commandeur de l’ordre de Saint-Louis, en 1744,
César de Saint-Périer mourut à Douai en 1749, encore en activité de service
à 87 ans. Il ne laissait pas d’enfants de son mariage avec Renée Ansard de
Mouy. Il légua aux écoles de Corbreuse « une rente de 18 livres pour l’instruction
de six pauvres enfants, trois filles à la nomination du seigneur de Coignière
et trois garçons à la nomination du curé, et 18 autres livres à la Charité
dudit Corbreuse »173.
|86
Jean-Baptiste, le frère aîné du lieutenant général,
servit comme lui dans l’artillerie. Né à Corbreuse en 1656, il était commissaire provincial
à Metz en 1609, lorsqu’il épousa Marie de Gaullier174, fille de Martin
de Gaullier, seigneur d’Aulnoy-en-Brie175 et du Theil176, lieutenant général d’artillerie, commandant
le département de Metz, et de Marie Desnoyers. Il mourut à Corbreuse en 1716,
laissant deux filles. L’aînée, Charlotte-Anne-Marie, née en 1699, reçue à
Saint-Cyr en 1706, épousa le 8 novembre 1718, à Corbreuse, Henri, marquis
de Sarevois, seigneur de Bleury177, lieutenant général des armées, dont elle n’eut
qu’une fille, Charlotte-Henriette, mariée à François-Henri de Salvert, comte
de Montroignon , sans descendants mâles. Charlotte-Anne-Marie mourut à Corbreuse
le 9 août 1756178.
La seconde fille de Jean-Baptiste de Saint-Périer,
Élisabeth, née à Corbreuse le 3 octobre l701, épousa, le 9 août l728, Louis-René
de Poilloüe179
de Saint-Mars, seigneur du Petit-Saint-Mars180 et de Valnay181, fils de Louis
de Poilloüe, seigneur de Bonnevaux182 et de Saclas183, garde du corps
du roi, et d’Angélique-Clémence Hémard, dame du Petit-Saint-Mars. Les Poilloüe,
peut-être originaires de Guyenne où ils seraient venus d’Écosse avec les
rois d’ Angleterre, étaient seigneurs de Saclas depuis le début du XIVe
siècle. Le fils aîné d’Élisabeth de Saint-Périer et de Louis-René de Poilloüe,
César-Joachim, trisaïeul de l’auteur de ces lignes, releva le nom de sa mère,
comme seul descendant mâle des Saint-Périer. Il écartela ses armes des armes des
Saint-Périer et forma la |87 branche des Poilloüe de Saint-Mars
de Saint-Périer, dite plus simplement Poilloüe de Saint-Périer. Un de ses
frères, Jacques-Auguste de Poilloüe, marquis de Saint-Mars, député de la
noblesse pour le bailliage d’Étampes aux États-Généraux de 1789, forma la
branche des Poilloüe de Saint-Mars encore existante. Le dernier des fils,
Jean-Baptiste, forma la branche des Poilloüe de Bierville éteinte aujourd’hui.
Élisabeth de Saint-Périer mourut à Étampes le 4 juin
1777. Elle avait quitté Corbreuse après son mariage et ses enfants ne revinrent
plus dans le pays où les Saint-Périer avaient vécu du XVIe au
XVIIIe siècle. Corbreuse, dont une étymologie plus poétique que
rationnelle, veut que le nom signifie « Corbeille de roses », est aujourd’
hui un village agricole du vaste plateau beauceron, mais à quelques centaines
de mètres seulement des hautes futaies de la forêt de l’Ouye. Un vaste terrain,
entouré de murs, porte encore le nom de « Clos de Coignières ». À l’un de
ses angles, une maison d’ancienne apparence, mais restaurée, a été le siège
de l’école à l’époque la plus reculée dont puissent se souvenir les anciens
du pays.
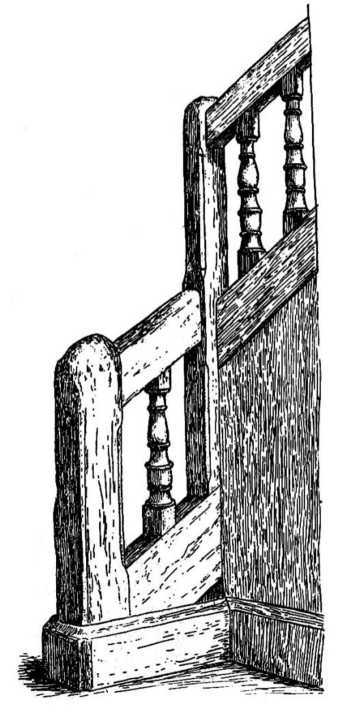
Fig. 5. — Rampe du XVIIe siècle à Corbreuse.
Sans doute était-ce la « Maison de la Bulle » que
laissa Antoine de Saint-Périer pour y installer les petites écoles de Corbreuse.
On voit encore dans une dépendance de cette maison un escalier à petits paliers
avec une belle rampe en bois du XVIIe siècle (fig. 5). Le haut
retable de l’église, dans le goût sévère et un peu lourd du début du XVIIe siècle,
aurait été donné, dit-on, par les Saint-Périer. Enfin, Durand est aujourd’hui
une vaste ferme dont les bâtiments ne conservent aucune trace visible d’
une ancienne origine.
Nous venons de passer rapidement en revue l’histoire
d’une famille qui, du XIVe à la fin du XVIIIe siècle,
posséda des terres aux confins du Gâtinais et qui fut alliée à bien des maisons
de ce pays. Peu de monuments témoins de cette histoire subsistent. Il ne
reste rien des logis seigneuriaux de Mauperthuis, de Villiers-Saint-Georges,
d’Étouy, du Bignon et de Corbreuse ; seules trois tombes conservent le souvenir
de ces âges passés. En publiant ces monuments, nous avons voulu rappeler
quelques faits de notre histoire locale, avant |88 que, effacées
à leur tour, les effigies des morts disparaissent, elles aussi, dans un éternel
oubli.
R. de Saint-Périer.
135

Fig. 1. - Pierre tombale de René de La Motte et de
Jehanne de Voysines. — (Château de Morigny)
12. La pierre tombale et
la seigneurie de Bonnevaux ^
La pierre tombale de l’ancienne église de Saint-Sulpice
de Bonnevaux184
185 a été publiée
déjà dans un ouvrage de MM. Quesvers et Stein186. Les auteurs ont figuré la pierre et donné
une généalogie des personnages, René de La Mothe et Jehanne de Voysines.
Cependant, nous pensons qu’il y a un certain intérêt à faire paraître cette
pierre tombale dans notre Bulletin, tant à cause des mentions qui en ont
été faites ici même187
qu’en raison de quelques modifications et d’indications complémentaires que nous
pouvons apporter à l’histoire des familles de ce lieu. Nous nous proposons,
en effet, de résumer l’histoire de la seigneurie de Bonnevaux et des divers
fiefs qui la composèrent, grâce aux renseignements fournis par d’Hozier (Bibl.
nat., Cabinet des titres), par nos archives personnelles relatives à la famille
de Poilloüe et surtout par les archives du château de Bonnevaux, que M. Peuvrier,
son propriétaire actuel, a bien voulu mettre à notre disposition avec une
obligeance dont nous tenons à le remercier ici.
C’est par notre ami le docteur Amand Trousseau, décédé
accidentellement en 1910, que nous avons eu connaissance de la pierre tombale.
Son grand-père, le professeur |134 Trousseau bien connu, avait
possédé, sous le Second Empire, le château de Bonnevaux et avait fait sceller
la pierre verticalement, à gauche de l’autel, dans le mur de l’église Saint-Sulpice
devenue la chapelle du château. Il fit entourer la dalle funéraire d’un cadre en
bois sculpté, dans le style du quinzième siècle. La réfection de la chapelle
à cette époque est indiquée par la lettre T et la date 1861, ajoutées par
le professeur Trousseau à une litre aux armes des seigneurs de Bonnevaux,
qu’il fit peindre ou repeindre sur les murs- de la chapelle.
En 1928, nous pûmes acquérir la pierre ; descellée,
elle fut apportée dans notre demeure à Morigny, près d’Étampes, où elle est
actuellement fixée verticalement au mur de fond du grand vestibule.
***
La pierre (fig. 1), est un calcaire à grain fin,
d’un blanc crème légèrement rosé ; elle mesure 2 m. 42 de hauteur, 1 mètre
de large et 0 m. 10 d’épaisseur. Les personnages sont figurés sous une architrave,
soutenue par trois colonnes de style composite, dont le fût, étranglé vers
son tiers inférieur, porte en ce point une décoration de tores superposés.
Aux colonnes sont attachées des masques grotesques, traités avec une certaine
variété : le masque supérieur de la colonne droite tire une langue recourbée
en volute, alors que les autres ont la bouche close.
L’entablement porte une riche décoration dans le
meilleur style de la Renaissance française, où trois vases reliés par des rinceaux,
des guirlandes et des cornes d’abondance occupent le registre supérieur.
Les registres inférieurs, ornés de festons, d’oves et de rinceaux reposent
sur deux cintres garnis. de feuillages. Au-dessus du vase qui occupe le milieu
du registre supérieur, est gravée, dans un cartouche rectangulaire, la date
: 1536, dont le 6 est renversé.
Le personnage de gauche est un homme tête nue, portant
de longs cheveux ondés, la face rasée, les mains jointes. |135
Ses pieds reposent sur un lévrier qui porte un collier à gros clous, muni
d’un anneau. Le costume comprend un colletin de mailles, apparaissant au-dessus
d’une cotte d’ armes qui s’arrête aux coudes et au milieu des cuisses. Cette
cotte est ornée des pièces d’armes du défunt : une fasce sur chaque bras,
une autre à la taille et sept têtes d’ours, semées sur la cotte. Les avant-bras
sont garnis de brassards, dont on aperçoit les coudières, les membres inférieurs,
de cuissards avec genouillères et grèves ; enfin, de grands solerets en pieds
d’ours, munis de longs éperons droits à molettes, complètent l’armure. À
son côté gauche, le personnage porte une grande épée, à quillons droits,
qui passe derrière lui et dont la pointe atteint la tête du lévrier. À son
côté droit est suspendu un poignard à coquille (miséricorde ou main gauche
?), dont le fourreau se termine par une bouterolle ovale. À la colonne gauche
et sous le poignard, le gantelet du défunt est pendu à un anneau. Enfin,
derrière lui, posé à terre, apparaît son heaume à panache de plumes.
À la gauche du seigneur de Bonnevaux, mais un peu
en arrière, est figurée sa femme. Les mains sont jointes ; elle est vêtue
d’une longue robe à plis, à petits revers au col et à manches très larges. Cette
robe découvre l’extrémité des pieds, chaussés de pantoufles ou mules légères,
noires, à bouts arrondis, selon la mode qui avait remplacé, à la fin du quinzième
siècle, les souliers à poulaine. La ceinture se termine par un large nœud
et deux petits pans où sont attachées les patenôtres. Entre les revers de
la robe et aux poignets, on aperçoit les festons qui garnissent l’encolure
et l’extrémité des manches de la cotte. La tête est couverte d’un chaperon
froncé seulement en arrière et terminé par un long pan. Tout ce costume rappelle
celui avec lequel la reine Anne de Bretagne est souvent représentée188 . À l’angle supérieur
gauche de la pierre est gravé un écusson aux armes |136 des La
Mothe ; d’or à la
fasce de gueules accompagnée de trois têtes d’ours de sable muselées de gueules
2 et 1189. Le même écu se répète à l’angle inférieur
gauche ; aux deux angles de droite, l’écu des La Mothe est parti de Voysines
: d’azur au chevron d’argent
accompagné de trois étoiles de même.
Un double trait régulièrement semé de ponctuations
encadre l’inscription en lettres gothiques : Cy gist Noble hôme Regne de lamote escuier qui
trespassa le XXUUe jour du moys de mars mil VcXXXV. Et damoyselle
jehanne de Voysine.s sa femme et son aypouse qui trespassa le XXe jo de may
mil. Vc l troys. en leurs vivant Signeurs de Bonnevau en plie et des signeurie
de Chansepoix Moquepoix et de Souppes en ptie : Priez dieu pour eulx.
À la partie supérieure droite de la pierre, au-dessus
de l’inscription et à l’envers, sont gravés ces mots : Faict p. E. Legault tubier à paris190. Il s’agit d’Étienne Legault, maitre tombier,
bourgeois de Paris, établi rue Saint-Jacques, connu par quelques actes et
un marché pour la fourniture d’une tombe. On a de lui son contrat de mariage
du 29 décembre 1529, avec Jacquette Piré, fille de Julien Piré, tombier,
bourgeois de Paris, veuve de Salmon Le Court, imprimeur de livres191. Il était mort en
1583, car sa veuve, à cette date, fait donation à leur fils Nicolas de «
la moitié d’un ouvroir, deux chambres et un grenier, dépendant d’une maison
à Paris, rue Saint-Jacques, aboutissant par derrière à l’hôtel de Langres
»192. Il
passa un marché, le 9 |137 juin 1545, avec Geneviève Lucas, veuve
de Denis Pinson, boucher et bourgeois de Paris, pour la fourniture d’une
tombe en pierre de liais, de 8 pieds de long sur 4 de large, sur laquelle devaient
être gravés « deux personnages avec treize enfants, quatre évangélistes et
écritures à l’entour, de la mode antique ou moderne au choix de l’exécuteresse,
rempli de ciment de telle couleur qu’il appartiendra »193.
Cette pierre, qui comportait en outre « une épitaphe
de cuivre avec une N.-D. de Pitié et deux priants », plus la mention d’une fondation
à l’église Saint-Étienne-du-Mont, devait être exécutée dans le délai de six
semaines, pour la somme de vingt et une livres tournois. Nous pouvons en
conclure que notre pierre, plus simple, dut être payée un peu moins de vingt
livres, ce qui équivaudrait approximativement, à cause des incertitudes que comportent
toujours ces comparaisons de valeurs monétaires, à 2 500 francs de notre
monnaie.
Cette belle pierre tombale offre un exemple intéressant
de style de transition. La décoration est du meilleur goût de la
Renaissance française, avec ses ornements fleuris
et la richesse de ses détails. C’est ainsi que les vases de l’entablement
semblent inspirés du vase brisé qui décore les compositions de Geoffroy Tory.
Mais l’épitaphe est encore « à l’antique » ; les traits et le costume des
personnages rappellent encore le quinzième siècle. Il n’est pas probable
que les effigies des tombes fussent des portraits ; il semble plutôt que
les tombiers possédaient un certain nombre de modèles, parfois assez anciens,
qu’ils proposaient à leurs clients194. C’est peut-être pour cette raison que
le visage de René de La Mothe retarde sur son époque : avec sa face rasée
et ses longs cheveux ondés, il évoque bien plus les traits du roi Louis XII
que ceux du vainqueur de Marignan, |138 de même que le costume
de Jehanne de Voysines rappelle celui de la reine Anne de Bretagne.
L’état de la conservation de la pierre est remarquable
et l’on pouvait se demander comment la gravure de cette tombe avait résisté
depuis 400 ans à l’usure des pas des fidèles, même dans l’église d’une paroisse
peu importante, comme celle de Bonnevaux. Mais un document précis nous apporte
l’explication de ce fait, en montrant que la pierre tombale ne fut jamais piétinée
depuis l’époque de sa mise en place. En effet. un procès-verbal d’une visite
de l’église de Bonnevaux, faite en février 1658 par le sergent royal de Milly
pour régler une contestation entre le seigneur d’Arcy et le seigneur de Milly
au sujet de la justice de Bonnevaux, nous apprend qu’il existait alors «
une tombe au milieu du chœur, élevée d’environ un pied de terre, sur laquelle tombe est empreint les figures portraits desdits
feu René de La Mothe et Jehanne de Voysines, sa femme, vivants seigneurs
de La Mothe-Bonnevaux et du dit Bonnevaux en partie195 ». La description
très détaillée qui suit montre bien qu’il s’agit de notre pierre dont l’emplacement
au-dessus du sol explique l’intégrité actuelle. II est probable qu’elle ne
dut quitter sa place qu’en 1861, lors de la réfection par le docteur Trousseau de
l’ancienne église de Bonnevaux.
***
La famille de La Mothe est originaire, d’après Hubert196, de La Mothe-en-Parisis,
près de Gonesse, d’où elle vint s’établir en Beauce gâtinaise au quatorzième
siècle. Guillaume, seigneur de La Mothe et de Bonnevaux, était premier échanson
et premier gentilhomme du duc d’Orléans. Nous laisserons de côté ses descendants,
énumérés par MM. Quesvers et Stein (op. cit.) jusqu’au
René de notre pierre tombale, qui était l’arrière-petit-fils de ce Guillaume.
|139
René était fils d’Edmond, seigneur de la Brosse197, de Bonnevaux
et de Villiers198,
et d’Étiennette de Dillois. Il épousa, à une date que nous ignorons, Jehanne
de Voysines, sans doute fille de Jean, seigneur de Mocquepois199, Chancepois200 et Souppes201, et de Catherine
de Vontouse. Nous renverrons à l’ouvrage de MM. Quesvers et Stein pour la
généalogie des Voysines. Un membre de cette famille, Edmond, seigneur de Chancepois
et des Grands-Carneaux, neveu de Jehanne, est appelé en 1544 avec le ban
et l’arrière-ban du bailliage d’Étampes202 et cité pour la rédaction de la coutume
d’Étampes, en 1556203.
Nous n’avons malheureusement aucune pièce relative à René de La Mothe de
son vivant. Nous savons seulement, par son censier204, établi après
sa mort, en 1546, qu’il possédait le cens sur 131 arpents et 4 perches, plus
16 fermes et une masure, cens qui s’élevait, par an, à 2 livres, 11 sols,
6 deniers, 7 oboles, et deux chapons 1/6e. Cette pièce nous montre combien
la propriété était morcelée dès lors à Bonnevaux ; elle nous apprend aussi
que la culture de la vigne s’y pratiquait, car René de La Mothe possédait
le cens sur près de deux arpents de vigne.
Nous ignorons si René de La Mothe prit part aux guerres
de son temps ; il vivait, à Bonnevaux, dans un manoir du fief de La Mothe
« qui .joignait l’église », elle-même construite dans l’étendue de ce fief.
Au-dessus de 1a principale porte de ce manoir et sur les cheminées de la
salle, |140 on voyait encore, en 1658, les armes de René de La
Mothe et celles de sa femme205.
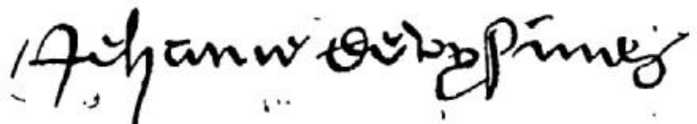
Fig. 2. — Signature de Jehanne de Voysines (Acte de 1537.
Arch. du chât. de Bonnevaux).
Jehanne de Voysines lui survécut dix-sept ans : nous
connaissons plusieurs pièces qui portent sa signature, que nous figurons
ci-dessus (fig. 2). L’une de ces pièces, datée du 16 janvier 1537206, est relative
à une contestation entre elle, en son nom et en celui de ses enfants, et
son neveu, Guillaume de La Mothe, seigneur du Boulay et de Bonnevaux en partie,
au sujet des « honneurs et prééminences de l’église paroissiale Monseigneur
Saint-Sulpice de Bonnevaux ». La sentence fut rendue par François de Lachasserie,
seigneur de la Court-desBoys, et de Buno en partie, Charles de Tournebœuf,
seigneur d’Oncy207,
Guillaume Guignellet, seigneur de Montbonnain, et Richard Vénard, seigneur
d’Arville208
« choisis comme arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs des parties
», les deux premiers pour Guillaume de La Mothe, les deux autres pour Jehanne
de Voysines. Ces arbitres « appointèrent que les sièges desdites parties
demeureront en leur état et dû, savoir : est le siège de haut premier pour
les hoirs mâles et quant à la prééminence demeurera entre aînés et plus anciens
de degré en degré, tant de la maison de Boulay, seigneurs de Bonnevaux en partie
que de la maison de La Mothe, seigneurs aussi dudit Bonnevaux en partie et
|141 quant à présent, ledit Guillaume de La Mothe, écuyer, seigneur
dudit Boulay, heurera de la prééminence et en suivant heurera Andry de La
Mothe, fils aîné dudit défunt Regné de La Mothe, écuyer et consécutivement
en heureront les plus anciens des dites autres maisons desdits honneurs et
prééminences dorénavant de degré en degré. Et quant au siège de dessous,
qui est celui des femmes, demeurera aussi en son lieu, état et dû et autres
semblables honneurs et prééminences dont sera persérée à présent Jehanne
de Voysines
.... et après elle la femme dudit Guillaume de La
Mothe et
ensuivant celle d’Andry de La Mothe et autres, pourvu
qu’ils fassiont résidence au lieu et paroissse de Bonnevaux ». Cet accord
ne devait être qu’éphémère, car nous verrons, par la suite, que les prééminences
d’églises entraînèrent, à Bonnevaux, des contestations successives entre
les descendants de Guillaume de La Mothe et de Jehanne de Voysines.
René de La Mothe laissa plusieurs enfants : Andry
ou André de La Mothe, l’aîné, était en 1537 « au service et ordonnance du Roy
notre sire »209.
Il épousa Geoffrine de Blois ou de Blaire, fille d’André de Blois, seigneur
d’Inville210,
et n’eut point de descendants, non plus que ses frères René et Charles.
Leur sœur Odette épousa Jean de Dampont, seigneur
d’Ableiges211.
Devenu seigneur de Bonnevaux en partie par sa femme, il rend hommage, en
1548, à Étienne Lapitte, seigneur de Courances212, d’une « maison, cour, grange, étable,
bergere, volière et vignes assis près de l’église de Bonnevaux, plus soixante
arpents de terre, bois, prés, taillis »213. Il était mort en 1570. Il laissait deux-enfants
: un fils |142 Gabriel, dont nous ne connaissons pas l’alliance
et une fille Suzanne, qui épousa Jean du Bois, seigneur de Gruge214.
Gabriel eut un fils, François, et un petit-fils,
Charles : celui-ci vendit son fief de La Mothe-Bonnevaux, le 24 novembre
1653, à François de Bienvenu, qui appartenait à une famille italienne, établie
depuis peu dans la région et dont nous parlerons plus loin.
Les petits-enfants de Suzanne de Dampont, Joachim
et Suzanne du Bois, vendirent de leur côté ce qu’ils possédaient du fief
de La Mothe à cette même famille italienne, en la personne de
Charles de Bienvenu, fils de François, en 1668. C’est
ainsi que le fief de René de La Mothe sortit de sa descendance un siècle après
sa mort.
Cependant, une autre branche des La Mothe conserva
des fiefs à Bonnevaux, jusqu’à une époque toute proche de nous. Un frère de
notre René, Guyot, qui avait épousé Jeanne de Pichol, était seigneur du Boulay215, d’Arcy216, de Bonnevaux
en partie et du Fessart217. Il eut pour fils Guillaume qui eut dix
enfants : deux, Antoine et Marie, de sa première femme, Louise de Loingtien,
et huit de la seconde, Marguerite de Lhumery, fille de Jean, seigneur de
Bagneaux218,
et de Catherine de Voysines. Guillaume possédait à Bonnevaux 166 arpents,
67 perches de terre, un moulin et un manoir, plus un autre manoir à Chevrainville219. Il mourut en
1554 et le partage de sa succession fut l’occasion de nombreux actes que
nous possédons encore220. Trois de ses enfants du second lit, Louis,
Jeanne et Françoise, vendirent, en 1597, la terre de Chevrainville et le
tiers des fiefs du Boulay et d’Arcy à Charles de Bienvenu, |143
père de François de Bienvenu, dont nous avons déjà parlé. Lorsque Louis,
Jeanne et Françoise font cette vente, les six autres filles de Guillaume étaient
mortes sans enfants et c’est ainsi que les deux tiers des fiefs du Boulay
et d’Arcy revinrent à Antoine de La Mothe, leur frère aîné, dont nous parlerons
plus loin.
Le seul autre héritier mâle de Guillaume, Louis,
épousa le 12 mai 1576, Gabrielle de Selve, fille de Lazare de Selve, seigneur de
Villiers, et de Catherine Pignard. On sait que les Selve étaient une très
ancienne famille de la région, à laquelle appartenait Jean, premier président
au Parlement de Paris, qui participa aux négociations du traité de Madrid
sous François Ier.
Louis était seigneur de Bagneaux par sa mère et il
vécut dans cette terre, abandonnant Bonnevaux. Il mourut en 1583, et sa postérité,
que nous ne suivrons pas, subsistait encore au dix-huitième siècle221.
Nous voyons donc, à la fin du seizième siècle, les
Bienvenu remplacer les La Mothe dans une partie de leurs fiefs à Bonnevaux.
Ces Bienvenu ou Benvenuti étaient d’origine italienne ; s’il en faut croire
une généalogie manuscrite du dix-septième siècle, conservée dans les archives
du château de Bonnevaux, ils tiraient leur origine de Francisco Benvenuti, conseiller
et préfet de la cité de Saint-Sépulcre, dans le duché de Florence, en 1200.
Ses descendants, chanceliers, commandants, gonfalonniers, maîtres des comptes
et gouverneurs de cette même ville, vécurent en Toscane jusqu’à ce qu’un
certain Charles, né en la cité de Saint-Sépulcre en 1559, fut amené en France
par André Hurault, seigneur de Maisse222, ambassadeur à Venise, qui avait épousé
Isabelle Nini, fille d’André Nini, gentilhomme siennois. Marie Hurault, fille
d’André et d’Isabelle Nini épousa le 19 novembre 1597, Charles Benvenuti,
qui |144 se fit naturaliser français et reconnaître de noble extraction,
par lettres- patentes du Roi du 14 décembre 1599, et prit alors le nom de
Charles de Bienvenu. C’est l’année même de son mariage, nous l’avons vu,
qu’il achetait les fiefs sis à Bonnevaux, dans le pays de son beau-père.
Il mourut dès l’an 1600 et fut inhumé dans l’église Saint-Sulpice de Bonnevaux223. Nous avons
vu que son fils François acquit à Bonnevaux le fief de René de La Mothe et de
Jehanne de Voysines. Il épousa le 30 août 1635, Anne du Fresnay, d’une famille
orléanaise, et ses descendants demeurèrent à Bonnevaux jusqu’après la Révolution.
Louis-Marc-Antoine d’Averton épousa, en 1767, la dernière des Bienvenu, Jeanne-Catherine,
et devint, par sa femme, seigneur d’Arcy, du Boulay, de La Mothe et de Chevrainville.
Parti pour l’armée à quinze ans, en 1733, comme cadet gentilhomme dans le
régiment de Cambrésis, il avait servi durant trente années et s’était trouvé
au siège de Philippsbourg, à Fontenoy, à Rocoux, à Laufeld, à Minden. Blessé
plusieurs fois, chevalier de Saint-Louis en 1758, il se retira comme major
de brigade, d’abord à Chevrainville, « où il ne subsistait que par une grande
économie, n’ayant d’autre ressource qu’une pension de 1 200 livres accordée
par le Roi »224.
Pendant la Révolution, il se retira à Cramant, au bailliage d’Epernay, d’où
était originaire une partie de sa famille. Il eut sept fils, qui tous étaient
au service du Roi en 1791, et une fille. Il mourut à Bonnevaux âgé de 86
ans le 3 août 1804225.
Sa fille, Anne-Victoire-Catherine-Louise, ne se maria pas et |145
conserva le château de Chevrainville où elle mourut le 21 juillet 1825. Ses
fils laissèrent des descendants que nous ne retrouvons plus à Bonnevaux après
la mort de Mlle d’Averton.
Cependant la lignée des La Mothe avait encore des
représentants à Bonnevaux. Antoine, fils aîné de Guillaume226, possédait,
nous l’avons vu, les deux tiers du Boulay et d’Arcy. Dans le partage de 1554
avec la seconde femme de son père, Marguerite de Lhumery, il obtint le manoir
du Boulay avec « grange, logis, colombier, aisances, clos de vigne, jardin
et courtils ». Il avait épousé Renée de Bizemont, fille de Jean, seigneur
de Chalambier227
et de Barbe Parent.
Il n’eut de descendants que par sa fille Gudette.
Elle épousa le 10 novembre 1599, Jacques de Poilloüe, seigneur de Jubert228, quatrième fils
d’Urban, seigneur de Jubert et de Saclas, et de Marie Le Vassor. Les Poilloüe
étaient originaires de la Guyenne, où ils seraient venus d’Écosse ; ils s’établirent
ensuite à Saclas, près d’Étampes, au quatorzième siècle. Le contrat de mariage, par
devant Liger Bourdelot, notaire royal à Maisse, stipule que Renée de Bizemont
jouira sa vie durant des biens laissés par Antoine de La Mothe229.
Il n’y avait donc plus, au début du dix-septième
siècle, d’héritiers mâles des La Mothe, à Bonnevaux, ce qui faisait dire, en
1627, au chevalier de Plessis, fils de Madeleine de La Mothe, de la branche
de Bagneaux, « que la maison de La Mothe était tombée en quenouille et passée
à des gendres qui étaient les seigneurs de Dampont et de Jubert230 ». |146
Jacques de Poilloüe et ses descendants ne résidèrent
plus que passagèrement à Bonnevaux, mais ils y conservèrent longtemps leurs
fiefs. Primitivement, la seigneurie de Bonnevaux était composée des fiefs
de La Mothe, du Boulay et d’Arcy qui s’étendaient « depuis le dessus du moulin
de Bonnevaux jusqu’à la rivière du prieuré de Saint-Médard de Maisse ». Tous
trois relevaient de Courances, mais la haute justice revenait au seigneur
de Milly231.
Ces trois fiefs étaient d’abord réunis sous la domination d’un seul seigneur,
appelé le seigneur de Bonnevaux. Le dernier fut Edmond, père de notre René
et de Guyot. Après sa mort, la seigneurie fut divisée : l’aîné, René, eut le
fief de La Mothe, avec le nom de La Mothe-Bonnevaux, « le fief de La Mothe
étant le plus considérable et constituant à lui seul la moitié de la paroisse
»232. Les
autres fiefs, le Baulay et Arcy, revinrent au cadet Guyot, avec les titres
de seigneur de Bonnevaux en partie, du Boulay et d’Arcy. Mais les fiefs du Boulay
et d’Arcy devaient, à leur tour, être divisés : deux tiers restèrent aux
La Mothe et furent transmis, par mariage, aux Poilloüe avec le titre de seigneurs
du Boulay et de Bonnevaux. C’est ainsi que se forma la branche des Poilloüe
de Bonnevaux et que l’un d’eux fut créé comte de Bonnevaux au dix-huitième siècle.
L’autre tiers du Boulay et d’Arcy passa d’abord aux cadets des La Mothe,
puis, par acquisition, comme nous l’avons vu, aux Bienvenu, qui prirent le
titre de seigneurs d’Arcy. Par ailleurs, nous savons qu’ils avaient acquis
la totalité du fief de La Mothe-Bonnevaux, mais ils n’en prirent jamais le
titre.
Cette division des fiefs devait fatalement entraîner
entre leurs possesseurs des conflits, qui naissaient, tantôt au sujet |147
des censives, tantôt à propos des droits honorifiques et des prééminences
d’église, tantôt à l’occasion du droit de pêche dans la rivière d’Essonne.
Nous résumerons seulement quelques-unes de ces contestations.
Ce sont les prééminences d’église, dont les gentilshommes
de cette époque se montraient si jaloux, qui suscitèrent les plus graves
difficultés. Le 30 août 1657, François de Bienvenu, fait une demande aux
Requêtes de l’Hôtel à ce qu’il fût maintenu et gardé dans la possession des
dits droits honorifiques « avec défense à Guy de Poilloüe de l’y troubler
à l’avenir ». Guy de Poilloüe, seigneur de Jubert, fils de Jacques et d’Oudette
de La Mothe, fut condamné. Malgré cela, en 1658, François Huet, le marguillier
de l’église de Bonnevaux, manque de présenter d’abord à François de Bienvenu
le pain bénit, ainsi qu’il avait accoutumé. Aussitôt, le 3 août 1658, François
de Bienvenu l’assigne en la cour du Parlement ainsi que Guy de Poilloüe «
comme étant en possession de ce droit, à l’exclusion de tous autres, à l’exception
toutefois du seigneur de Milly seulement, à cause de sa haute justice ».
Huet dit pour sa défense que « ce qu’il en a fait est à la suscitation de
Guy de Poilloüe, seigneur de Jubert, lequel l’a battu, excédé et violenté,
pour l’obliger à lui distribuer le premier le pain bénit et non au dit suppliant
». Le 29 mars 1659, un compromis entre François de Bienvenu et Guy de Poilloüe
« habitant alors à Paris rue de la Huchette, en la maison où pend pour enseigne
l’image de Saint-André » donne pouvoir à deux avocats au Parlement de juger
« le différend mû entre eux ». Les avocats estimèrent que François de Bienvenu
devait être conservé dans l’exercice de ses droits honorifiques, « pour en
jouir préférablement audit de Poilloüe tant et si longuement que ledit de
Bienvenu continuera sa résidence audit Bonnevaux et que ledit de Poilloüe
n’y fera point la sienne et au cas où le dit de Poilloüe y viendrait ci-après
demeurer, les dites parties sont réservées chacune en ses droits qui |148
demeurent sur ce de part et d’autre tous entiers ». Nous retrouvons ici une
sentence arbitrale tout à fait conforme à celle qui avait été rendue plus d’un
siècle auparavant pour une contestation analogue entre Jehanne de Voysines
et son neveu Guillaume de La Mothe. François de Bienvenu obtint gain de cause
parce qu’il habitait Bonnevaux. Cependant, Guy de Poilloüe avait produit
des témoignages établissant que son père avait joui dans l’église de Bonnevaux
de toutes les prééminences qu’il réclamait pour lui-même. « Un marchand de
Maisse, âgé de 84 ans, dit par serment qu’il y a quarante ans, demeurant
à Bonnevaux, il a vu les curés, à la grand’ messe et aux vêpres, faire les
honneurs à M. de Jubert, l’asperger, donner de l’encens, le pain bénit, aller
à la procession le premier après les curés, le tout au vu et au su de MM.
de Dampont, sans avoir eu animosité de ceux-ci audit Jubert. » Nous savons
que les Bienvenu avaient succédé aux Dampont. Deux autres témoins déposent
dans le même sens. Il semble d’ailleurs que la décision des deux avocats
n’ait point paru assez conciliante aux adversaires eux-mêmes, car le même
jour, intervint une transaction « pour prévenir, terminer et assoupir tous
différends entre eux, pour raison des droits, rangs et prérogatives d’honneurs
par eux prétendus l’un sur l’autre dans l’église de Bonnevaux et régler dès
à présent iceux pour se maintenir en paix et amitié. Ils ont de leur bon
gré et par l’avis de René de Villezan233 et Henry de Longeau, leurs amis communs,
convenu que chacun jouira alternativement desdits droits par chacun an, à
commencer par ledit seigneur de Bienvenu, comme plus âgé, du jour de Pâques
fleuries de la présente année 1659. » Le détail des droits honorifiques est donné
ensuite : celui qui est en année de jouissance doit avoir la droite en la
procession et l’autre, la gauche, et de même |149 pour leurs femmes
et enfants ; il aura le premier pas pour aller à l’offrande ; c’est à lui
que sera présenté d’abord le pain bénit. ainsi qu’à sa femme, à ses enfants
et à ses amis. Il en sera de même pour l’aspersion de l’eau et de l’encensement.
La même jouissance est accordée aux « veuves et enfants desdits comparants
et de leurs successeurs alternativement ». Ainsi se terminait ce procès,
qui avait duré deux ans, par un règlement plus pacifique que ne permettait
de l’espérer le geste vif de Guy de Poilloüe à l’égard du marguillier.
La génération suivante se montra plus tolérante.
Jacques de Poilloüe, fils de Guy, et Charles de Bienvenu, fils de François, décident
« pour éviter les contestations et différends qui étaient près de naître
entre eux, de jouir alternativement, d’année en année, comme l’avaient fait
leurs pères, des droits honorifiques de l’église ». En outre, il est laissé
à Jacques de Poilloüe le droit de se faire enterrer dans l’église comme René
de La Mothe, « sous une tombe pareille dans le chœur ». Mais il n’en usa
point et fut inhumé, avec ses ancêtres. dans l’ église de Saclas, le 26 janvier
1691234.
Il habitait le plus souvent à Saclas ou à Paris, rue de la Huchette, comme
son père ; nous avons plusieurs baux concernant sa ferme du Boulay à Bonnevaux,
dont il surélève les bâtiments, en mars 1665, pour le prix de 50 sols la
toise235.
Le fils de Jacques, qui lui succéda comme seigneur
de Bonnevaux, Louis, garde du corps du Roi, mourut jeune et ne paraît pas
avoir résidé à Bonnevaux, mais son fils, Jacques-Auguste, ancien capitaine
au régiment d’Artagnan, devait au contraire y venir fréquemment, car il s’était
réservé dans la ferme du Boulay « une chambre, antichambre, cabinet avec
une petite écurie ». Le fermier devait |150 lui fournir « vingt
pintes de vin du meilleur qui sera recueilli, tout le bois qu’il jugera bon
d’y brûler pendant tout le temps qu’il jugera bon d’y rester, ainsi que les foins,
paille, avoine nécessaires à la nourriture de ses chevaux ». Il avait un
garde chargé de lui fournir du gibier, dont il lui payait chaque pièce cinq
sols. C’est ainsi qu’il reçoit, en 1755, 87 pièces, parmi lesquels figurent
des perdreaux rouges et gris, des lapins, des lièvres, des bécassines, des
cailles et même un héron butor236. La pêche dans la rivière d’Essonne lui
attira des contestations, non plus avec les Bienvenu, mais avec le seigneur de
Gironville237,
qui avait droit de pêche, du moulin de la Bonde jusqu’au-dessus du moulin
de Bonnevaux, à cause de son fief de la Brière. Ce fief, que nous trouvons
mentionné en 1510, appartenant alors à Claude de Monslart, passe ensuite
à Gaspard de la Chapelle, qui le vend, en 1584, à Charles de Laumoy. C’était
un simple fief qui n’avait aucune justice et relevait de Saint-Cyr238.
Le fils de Jacques-Auguste, Jean-Baptiste de Poilloüe,
comte de Bonnevaux, garde du corps, chevalier de Saint-Louis et son petit-fils
Auguste-Jean-Baptiste, furent les derniers Poilloüe possesseurs de la terre
de Bonnevaux. Auguste-Jean-Baptiste mourut à Étampes en 1863 ; en lui s’éteignit
la branche ainée des Poilloüe qui furent seigneurs de Bonnevaux. Il avait
vendu, en 1852, à Mlle de Laborde, sa cousine, la ferme du Boulay239, demeurée près
de trois siècles dans la famille des Poilloüe. Les loyers successifs de la
ferme du Boulay permettent de suivre les variations de la valeur de l’argent.
En 1644, elle est louée 400 livres, plus deux douzaines de pigeonneaux. En
1691, |151 elle ne vaut plus que 270 livres, plus une poule ou
coq d’Inde. Au dix-
huitième siècle, le loyer s’élève constamment de
300 livres en 1719, à 600 livres, en 1755, et à 700 en 1792.
***
Nous venons de passer rapidement en revue l’histoire
de Bonnevaux et de ses fiefs d’après les documents écrits. Il nous reste
à examiner les documents archéologiques relatifs à ce lointain passé. Il
ne subsiste rien du manoir de La Mothe, où vécurent René de La Mothe et Jehanne
de Voysines. Nous avons vu qu’il était situé tout près de l’église de Bonnevaux.
Ses ruines étaient visibles au dix-huitième siècle240 et l’on devine
encore leur emplacement à l’est de la chapelle.
La ferme du Boulay, propriété de M. Peuvrier, est
entièrement moderne, mais elle a été reconstruite à la place même de l’ancienne
ferme.
Le château actuel de Bonnevaux a remplacé l’ancien
manoir de Chevrainville où vécurent au seizième siècle, Guillaume de La Mothe,
puis les Bienvenu et les d’Averton. Quelques parties du château actuel remontent
à la fin du dix-huitième siècle et furent probablement l’œuvre d’un membre
de la famille d’Averton. La tradition veut que les matériaux en aient été
empruntés aux ruines du château de La Mothe241. La plus grande partie du bâtiment actuel
est une restauration du professeur Trousseau. Le nom de Chevrainville n’existe
plus ; on lui a substitué le nom de Bonnevaux, sans doute parce que toutes
les maisons qui composaient la paroisse de Bonnevaux ont peu à peu disparu.
L’église Saint-Sulpice, bâtie, comme nous l’avons
vu, dans l’étendue du fief de La Mothe était déjà |152 délaissée
au dix-septième siècle, Charles de Bienvenu faisant à cette époque une supplique
à l’archevêque de Sens pour y faire nommer un prêtre242. Cependant,
en 1744, le maître-autel fut surmonté d’un tableau dû au sieur Voltigeur,
moyennant la somme de soixante livres243. Ce tableau disparut pendant la Révolution.
En 1794, pour éviter des réparations coûteuses, la commune de Buno fut autorisée
à faire démolir la nef et le clocher et les deux paroisses furent réunies
sous le nom de Buno-Bonnevaux. Enfin, en 1816, Mlle d’Averton,
qui avait acquis déjà les matériaux de la démolition d’une partie de l’église,
acheta le chœur et le cimetière « dans l’intention de conserver l’édifice
et dépendances pour le service du culte244. Nous avons vu que le professeur Trousseau
fit restaurer ce chœur en son état actuel.
Nous n’avons donc plus que des liasses d’archives,
qui nous ont fourni les éléments de ce travail, pour évoquer l’histoire de cette
petite paroisse du Gâtinais. Qu’il nous soit permis, en terminant, d’émettre
le vœu que ces seuls témoins du passé de Bonnevaux ne connaissent point le
sort des témoins lapidaires et qu’ils soient déposés un jour aux Archives
de notre département, à Versailles.
Cte de Poilloüe de Saint-Périer.

12. Une nouvelle donation
au Musée d’Étampes
Nous signalions, il y a quelques semaines, l’entrée
au Musée d’un fragment de pierre tombale du XIIIe siècle, qui
avait été utilisé à Boissy-le-Cuté comme pierre d’évier.
Une autre pierre tombale vient d’être offerte au
Musée d’Étampes par notre cousin, le comte de Rilly, qui l’avait conservée
jusqu’ici à Oysonville. Moins ancienne, mais beaucoup mieux conservée que
la première, cette importante dalle funéraire mesure 2 m. 30 de hauteur sur
1 m. 10 de largeur. Elle porte, dans un cartouche surmonté de deux anges
et flanqué des armoiries des défunts, l’épitaphe latine de René Choppin, jurisconsulte
célèbre, et de sa femme Marie Baron.
René Choppin était né près de la Flèche en 1537.
Dès l’âge de 17 ans, adonné aux études de droit, il plaidait avec succès
à Angers. Plus tard, à Paris, il connut de brillants succès, écrivit un traité
du Domaine de la
Couronne, qui le fit anoblir par Henri III en
1578. Il avait épousé, en 1563, Marie Baron, fille de Pierre Baron, procureur
au Parlement, puis receveur de la ville de Paris, et de Marguerite Le Bossu.
Elle avait un frère, qui était seigneur de Cottainville, près de Châtenay-en-Beauce.
René Choppin et sa femme, très attachés au duc de Mayenne, étaient ligueurs déterminés
et la passion politique de cette époque troublée était
242 L'Abeille d’Étampes 40 (19 août 1933), p. 1.
si vive chez Mme Choppin qu’elle perdit la raison
à l’entrée du roi Henri IV à Paris, en 1594, et se jeta par la fenêtre, à
l’annonce de cette nouvelle. René Choppin lui survécut jusqu’en 1606 ; il mourut
au cours de l’opération de la pierre, fort dangereuse à cette époque. Il
laissait six volumes in-folio de traités juridiques en latin, qu’on ne lit
plus aujourd’hui, mais qui faisaient autorité au cours des discussions judiciaires
si complexes de l’époque.
René Choppin et sa femme furent enterrées à Paris
dans l’église de Saint-Benoît-le-Bétourné. Leur fils leur fit élever un mausolée dont
il ne demeure que la pierre portant l’épitaphe.
Cette église fut démolie après la Révolution. La
pierre tombale fut alors rachetée par un membre de la famille d’Arnouville, descendant
de René Choppin, et transportée au château d’Arnouville (Eure-et-Loir). Lorsqu’un
acquéreur de ce château la mit en vente, la Ctesse de Rilly, petite-nièce
du dernier baron d’Arnouville, l’acquit et la fit transporter à Oysonville.
Elle a terminé enfin, espérons-le, ses nombreuses
pérégrinations, difficile à accomplir sans dommage pour une pierre dont le
poids atteint presque 2.000 kilos.
On voit que ce monument est d’un grand intérêt pour
notre Musée par les souvenirs qu’il évoque, d’une part, du côté de René Choppin,
dont les descendants vécurent trois siècles dans le bailliage d’Étampes,
d’autre part, par sa femme originaire de Beauce étampoise et qui prétendait
se rattacher, comme tant de familles de nobles de notre région, à la lignée
d’Eudes de Chalo-Saint-Mars.
Aussi devons-nous être très reconnaissants au donateur
de cet intéressant monument, ainsi qu’à la municipalité d’Étampes, qui a
bien voulu concourir à l’installation au Musée de ce précieux souvenir local.
R. de Saint-Périer.
193
194
195
196
197
198
199
162
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES
Logo du Corpus Étampois dessiné par Gaëtan Ader.
— Ex-libris du comte de Saint-Périer, p. 1. — Archives des Saint-Périer aux
AD91, cote 76J 17 (cliché de Bernard Métivier), p. 6 — Gravure de Jules Lepoint-Duclos
(1938), pp. 8 et 30. — Gravures de René Ravault (1897), p. 45. — Cliché emprunté
au site généalogique de Benoît Maury, p. 48. — Dessin de René Guitton (Abeille d’Étampes du 8 juin 1929), p. 49. — Figures empruntées aux éditions
originales : pp. 8, 30, 49, 56, 60, 65, 67, 70, 74, 88, 90, 91, 96, 99, 100,
110, 116, 119, 133. — Dessin emprunté à l’ouvrage d’Armand Caillet (Puiselet-le-Marais,
1951, p. 74), p. 78. — Osterreichische Nationalbibliothek, p. 158.
164
Table des Matières
|
Préface
|
3
|
|
Bibliographie
|
4-7
|
|
01
|
La Renaissance (1938)
|
8-30
|
|
02
|
Les Guerres de Religion (1938)
|
30-46
|
|
03
|
Le privilège de Chalo-Saint-Mard (1929)
|
48-54
|
|
04
|
L’écu des Hurault à Morigny (1951)
|
56-59
|
|
05
|
Les Villezan, seigneurs de la Tour de Guillerval
(1929)
|
60-68
|
|
06
|
Un petit manoir disparu à Souzy-la-Briche (1929)
|
70-73
|
|
07
|
Carreaux de la Renaissance au Musée
|
|
|
d’Étampes (1929)
|
74-77
|
|
08
|
Quelques bornes armoriées de Seine-et-Oise
(1944)
|
78-86
|
|
09
|
Borne armoriée des Bréviaires (1934)
|
88-94
|
|
10
|
La porte Bressault (1965)
|
96-99
|
|
11
|
Les Saint-Périer, ancienne famille des confins
du Gâtinais (1931)
|
100-134
|
|
12
|
La pierre tombale et la seigneurie de Bonnevaux
(1931)
|
136-157
|
|
13
|
Une nouvelle donation au musée
|
|
|
d’Étampes (1933)
|
158-162
|
|
Crédits
|
163
|
|
Table
|
165
|
Le monde des Saint-Périer — tome 4
LE SUD-ESSONNE RENAISSANT
Préface. — Bibliographie. — 01. La Renaissance.—02.
Les Guerres de Religion. —
03. Le privilège de Chalo-Saint-Mard. —
04. L’écu des Hurault à Morigny. — 05. Les Villezan,
seigneurs de la Tour de Guillerval. —
06. Un petit manoir disparu à Souzy-la-Briche.
—
07. Carreaux de la Renaissance au Musée d’Étampes.—08.
Quelques bornes armoriées de Seine-et-Oise. — 09. Borne armoriée des Bréviaires.
— 10. La porte Bressault. — 11. Les Saint-Périer, ancienne famille des confins
du Gâtinais. — 12. La pierre tombale et la seigneurie de Bonnevaux. — 13.
Une nouvelle donation au musée d’Étampes.
1
On reproduit ici le chapitre II d’un
important ouvrage du comte de Saint-Périer, La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du
2
Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 23-37,
en notant les variantes du remaniement posthume de 1964, in Étampes. Bulletin Officiel Municipal
3
(2e semestre 1964), pp. 24-29.
4
La réédition de 1964 porte ici : « pour
une raison qui n’est pas précisée, sans doute des dettes. »
5
La comtesse modifie profondément tout
ce paragraphe dans la réédition de 1964 pour y intégrer ce qui lui a été
signalé depuis la mort de son mari : « L’existence à Étampes d’une Commanderie
de l’ordre de Saint-Jacques de l’Epée, maison d’accueil, tout particulièrement
ouverte aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, est attestée en 1490
par le droit de port que Jean de Foix accorde au commandeur. Mais on ignorait
jusqu’à ces dernières années la date de fondation de cette Commanderie à
Étampes. Nous avons eu la bonne fortune de l’apprendre par un érudit français
qui découvrit, au cours de ses recherches dans les archives espagnoles de
l’Ordre de Saint-Jacques, que notre roi Philippe-Auguste fit don en 1184
à l’ordre militaire espagnol d’un domaine près d’Étampes : Donatio Villænovæprope Stampas
sub colle Montis Falconis. Il s’agit du lieu-dit
Villeneuve-sous-Montfaucon, situé tout près de Morigny. La donation de Philippe-Auguste,
authentifiée par une bulle apostolique du pape Lucius III n’autorise pas
à conclure que la Commanderie a d’abord été édifiée en ce lieu, puisqu’il
n’en reste aucune trace, mais elle permet d’affirmer que la fondation remonte
au XIIe siècle, à l’époque où fut créé l’ordre en Espagne. Il
est possible que les chevaliers de Saint-Jacques aient préféré au domaine
de Villeneuve, proche de la Maladrerie de Saint-Lazare, voisinage peu souhaitable,
le terrain près du port où nous les trouvons établis en 1480, où leur souvenir
demeure sous le nom de la petite rue du Chevalier de l’Epée. En 1580, etc. »
6
La réédition de 1964 corrige ici : «
c’est-à-dire à l’emplacement du collège jusqu’en 1963 », parce que le collège-lycée
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire vient alors d’émigrer sur le plateau de Guinette
et que ses anciens locaux ne sont pas encore investis par l’actuel collège
Jean-Étienne Guettard.
7
La reeédition de ce chapitre dans le
bulletin municipal de 1964 supprime les mots « en face du collège actuel.
» (B. G.)
8
On reproduit ici le chapitre III de La grande histoire d’une petite
ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire
de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 39-50 ; dont une réédition posthume, in
Étampes. Bulletin
Officiel Municipal 3 (2e semestre
1964), pp. 24-29, audacieusement signée : « Comtesse de Saint-Périer ».
9
La réédition de 1964 porte : « pour le
roi. Aussi Catherine... ».
10
88 La suite de ce paragraphe est supprimé
dans la réédition de 1964, ainsi que le premier mot du suivant.
11
Tout ce paragraphe est supprimé dans la
réédition de 1964.
12
L’Abeille d’Étampes 118/23 (8 juin 1929), p. 1, article précédé de la date de
sa rédaction, « Étampes, le 7 juin 1929. » et de la rubrique : « Vieille chronique...
d’actualité ».
13
Alors instituteur à Chalo-Saint-Mars
(B.G.).
14
Henri IV n’eût pris le souci de supprimer aux descendants
d’ Eudes les avantages dont ils jouissaient, la Révolution eût fait
15
Bulletin de la Société des Amis d’Etampes et
de sa région 7 (janvier 1951), pp. 123-125.
16
Le texte porte ici « enterrée », comme
si c’était la fille de Michel de L’Hospital qui était enterrée à Champmotteux
: il s’agit ici évidemment d’une coquille due au typographe ou à l’éditeur
posthume (B.G.).
17
Bulletin de la Société des amis du musée d’Étampes 7 (1925-1929), pp. 50-57.
18
Ch. Forteau, Registres paroissiaux du canton
de Méreville, p. 268.
19
Maxime Legrand, Étampes pittoresque, l’arrondissement, p. 451.
20
Canton de Méréville, à 7 kil. de Monnerville.
21
A. Longnon, Étude biographique sur François
Villon, Paris, 1877, p. 118.
22
Bibl. nat., d’Hozier, Armorial général,
Paris IV, p. 594.
23
La Maladrerie est un hameau de la
commune d’Orgères (Eure-et-Loir) où l’on voit encore aujourd’hui une assez
jolie maison du XVe siècle à fenêtres à meneaux, qui aurait été
l’ancienne léproserie.
24
Bibl. nat., ms. franç., Carrés d’Hozier,
639.
25
H. Stein, Ann. de- la Société hist. et arch. du Gâtinais, XII, p. 36.
26
Id.
27
Marc-Antoine Lamy, Coutume d’Étampes, p. 493.
28
Bibl. nat., ms. franç., d’Hozier,
pièces origin., 3078.
29
Maxime Legrand, loc. cit., p. 350.
30
Archives personnelles à Morigny.
31
Bulletin de la Société des amis du musée d’Étampes 7 (1925-1929), pp. 58-61.
32
Max. Legrand, Étampes pittoresque. L arrondissement, p. 135.
33
Archives personnelles à Morigny.
34
Bulletin de la Société des amis du musée d’Étampes 7 (1925-1929), pp. 58-61.
35
Bulletin de la Société historique et archéologique
de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix 21 (1944),
pp. 119-124.
36
Bull. de la Comm. des Antiq. et des Arts de
S. et O., XLI et XLII, p. 133.
37
Max. Legrand, Étampes pittoresque, l’arrondissement, p. 125.
38
Cet espace laissé ici en blanc par
Saint-Périer (et plus loin) signifie qu’on ignore l’émail ou le métal du
champ de ce blason (B. G.).
39
Bull. de la Soc. des Antiquaires de France, 1934.
40
Dr Olivier, Manuel de l ’amateur de reliures
armoriées françaises, Paris, Bosse, 1933, t.
XXV, pl. 2492, n°4.
41
Bulletin de la Commission des Antiquités et
des Arts de S.-et-O., Le vol., 1943,p.
112
42
Bulletin de la Société nationale des antiquaires
de France (1934), pp. 175-181 (séance du 15 juin
1934), avec le chapeau suivant : « M. le comte de Saint-Périer, associé correspondant
national, étudie en ces termes une borne armoriée du milieu du XVIe
siècle découverte aux Bréviaires (Seine-et-Oise) ».
43
Bulletin de la Commission des antiquités et
des arts de Seine-et-Oise, t. XLIII-XLIV, 1924,
p. 133.
44
Cf. Émile Rousse, La Roche Guyon. Paris, Hachette, 1892 ; Une famille féodale auxXVe etXVIe
siècle : les Silly, seigneurs de la Roche-Guyon, Paris, Hachette, 1898.
45
Cant. de Magny-en-Vexin, arr. de Mantes.
46
Arr. d’Yvetot.
47
Cant. de Gavray, arr. de Coutances.
48
Arr. de Chartres.
49
Cant. de Montmorency, arr. de Pontoise.
50
Cant. de Buchy, arr. de Rouen.
51
Arr. de Valognes.
52
Arr. d’Alençon.
53
Cant. de Dourdan, arr. de Rambouillet.
54
Bulletin des Amis d’Étampes 12 (1965), pp. 31-32.
55
Dom Basile Fleureau, Les Antiquités d ’Étampes, Paris 1683, p. 463.
56
Bull. de la Sté. des Amis du Musée d’Étampes, n° l, 1913, p. 23.
57
Annales de la Société historique et archéologique
du Gâtinais 40 (1931),
pp. 60-88.
58
Archives du château de Merlemont (Oise).
Indication de M. le comte des Courtils de Merlemont.
59
Cant. et arr. de Coulommiers.
60
Meaux : ancienne maison de Brie qui
portait d’abord pour armes: de sable à une jumelle d’argent; elles devinrent : d’argent à cinq couronnes d’épines de sable
2, 2 et 1, « en mémoire de ce que le chef de
cette maison étant avec saint Louis dans la Palestine, apporta en France,
par ordre de ce prince, la couronne d’épines de N.-S. en 1248, laquelle fut
déposée dans la Sainte Chapelle de Paris où elle est depuis ce temps ». (La
Chesnaye-Desbois et Badier, 1878, t. XIII, p. 574).
61
Preuves de Saint-Cyr pour Gabrielle
de Saint-Périer. Certificat de d’Hozier du 5 mai 1686. Archives personnelles
à Morigny (Seine-et-Oise).
62
Ibid.
63
Nobiliaire manuscrit du comté de Clermont-en-Beauvaisis
dressé, sur titres authentiques de 1750 à 1754, par M. Bosquillon, lieutenant
général du bailliage de Clermont. Bibliothèque du château de Merlemont (Oise).
64
Chevilly : de sable à la croix d’or.
65
Cant. de Rozoy, arr. de Coulommiers.
66
Comm. et cant. de Villiers-Saint-Georges,
arr. de Provins.
67
Comm. de La Croix-en-Brie, cant. de
Nangis, arr. de Provins.
68
Cant. de Rozoy.
69
Bibl. nat., ms.
franç., Cabinet d’Hozier 193
70
Sans doute Chevry-Cossigny, cant.
de Brie-Comte-Robert, arr. de Melun.
71
Comm. d’Obsonville, cant. de Château-Landon,
arr. de Fontainebleau.
72
Cab. d’Hozier 193.
73
Bibl. nat., ms.
franç., d’Hozier, pièces origin., 2272. de La Croix-en-Brie.
74
Ibid.
75
B. de Broussillon, La Maison de Laval (Paris, Picard, 1902), t. IV, p. 59.
76
Cant. de Fleury sur-Andelle, arr.
des Andelys.
77
Montgarny : d’azur au lion d’or au lambel
de gueules.
78
Preuves de Saint-Cyr déjà citées.
79
Pièces origin. 2272.
80
Chef-lieu de cant. de l’arr. de-Saint-Omer.
81
Bibl. nat., ms.
franç., coll. Clairambault , vol. 271, fol. 3377.
82
Cab. d’Hozier 233 et Doss. bleus 439.
83
Cant. de Bray-sur-Seine, arr. de Provins.
84
Comm. de Balloy, cant. de Bray-sur-Seine.
85
Op. cit., coll.
Clairambault, vol. 271, fol. 3374 .
86
Louis Michelin, Essais historiques sur le département
de Seine-et-Marne (Melun, 1829-1843), p. 1495.
87
Challemaison : d’argent à une fasce d’azur chargée
d’une rose et de deux molettes d’éperon.
88
P. Quesvers et H. Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse
de Sens, t. IV (Paris, Picard, 1900), p. 147.
89
Arch. de l’Yonne, H 762.
90
Cant. de Bray, arr. de Provins.
91
Cant. de Villiers-Saint-Georges, arr.
de Provins.
92
Cant. de Bray.
93
Quesvers et Stein , loc. cit.
94
Cab. d’Hozier 331.
95
Verdelot : d’or à la croix ancrée de sable.
96
Louis Michelin, op . cit., p. 1637.
97
Maillé, Bull. de la Soc. d’hist. et d’arch.
de Provins, 1896-97, p. 12, L’auteur dit à tort
que Louise de Challemaison était veuve de Louis de Melun, qui était, comme
nous le verrons plus loin, le père de son gendre.
98
V. Carrière, Rôle et taxe des fiefs de l’arrière-ban
du bailliage de Provins en 1587. (Bull. Conf d’hist. et d’archéol. du diocèse
de Meaux, t. III, p. 3).
99
Louis Michelin, op. cit., p. 1638.
100
Claude Haton, Mémoires, p. 937.
101
Id., p. 947.
102
Id., p. 957.
103
Id., p. 1055.
104
Classée comme monument historique
en 1905.
105
Quesvers et Stein, op. cit., t. IV, p. 131.
106
Cf. Maindron, Les armes, p. 220 et suivantes.
107
La cotice de gueules n’est plus figurée
à partir du XVIIe siècle sur les écus des Saint-Périer.
108
Fromageot, Commiss. des antiq. et des arts
de Seine-et-Oise XXI (1901), p. 63.
109
Beaufils, Étude sur les effigies des pierres tombales (Paris, 1909).
110
Pièces origin. 2272.
111
Beaufils, op. cit.
112
Cant. et arr. de Clermont (Oise).
113
Cant. et arr. de Clermont (Oise).
114
Arr. de Péronne.
115
Wignacourt : d’argent à trois fleurs de lis
au pied coupé de gueules surmontées d’un lambel de même. Le lambel est la brisure de la branche cadette.
116
V. Carrière, op. cit.
117
Pièces origin. 2993.
118
Quesvers et Stein, op. cit., p. 147.
119
Musée du Louvre, grande galerie, n°1124.
Ce portrait fut acheté par Louis XIV en 1670.
120
Abbé de Vertot, Histoire des Chevaliers hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem (Paris, 1726), t.
IV, p. 130.
121
Ibid.
122
Cab. d’Hozier, 333.
123
Cant. et arr. de Clermont.
124
Debeauve et Roussel, Histoire et description du département
de l ’Oise (Paris, 1890), p. 133.
125
Étouy, ses origines et ses anciens seigneurs (Paris, Lahure, 1894), p. 31.
126
In extenso en latin
et français dans Étouy,
ses origines, etc., p. 32.
127
Carrés d’Hozier, 634.
Viefville : fascé d’or et d’azur et huit pièces et trois
annelets de gueules posés en chef brochant sur les deux premières fasces.
128
Sans doute, Orvillers-Sorel, cant.
de Ressons, arr. de Compiègne.
129
Quesvers et Stein, op. cit., t. IV, p. 253, n°1022.
130
Melun : d’azur à sept besans d’or, au
chef un demi-lion de gueules rampant.
131
Le Bignon-Mirabeau. cant. de Ferrières,
arr. de Montargis.
132
Dom Morin, Histoire du Gastinois (Pithiviers, 1883), t . II, p. 832.
133
Ibid.
134
Louis Michelin, op. cit., p. 1495.
135
Comm. de Rémauville, cant. de Lorrez-le-Bocage,
arr. de Fontainebleau.
136
Cant. de Neuilly-St-Front, arr. de
Château-Thierry.
137
Louis Michelin, op. cit., p. 1495.
138
Louis Barthou, Mirabeau (Paris, 1913), p. 9.
139
L’Impôt du Sang
(Paris, 1875), t. II, p. 230.
140
Courcelles, Histoire généalogique des pairs
de France, t. V, p. 53. Michelin, op. cit., p. 1300.
141
Nouveau d’Hozier, 233. J. François
d’Hozier, dans l’impôt
du sang (p. 220 et 230) semble avoir cru qu’il
s’agissait de deux personnages, tués l’un à Circq, l’autre à Ypres, alors
qu’il s’agit certainement du même.
142
M. d’Aspect, Histoire de l ’ordre royal et
militaire de saint Louis (Paris, 1780), t. I,
p. 235.
143
Procès-verbal des preuves faites pour
réception en l’ordre de Malte de Louis de Saint-Périer, que nous verrons
plus loin. (Arch. personnelles à Morigny).
144
Sabrevois : d’argent à la fasce de gueules accompagnée de six roses de même.
145
Comm. de Saint-Symphorien, cant. de
Maintenon, arr. de Chartres. Nous trouvons, dans les registres paroissiaux
de Saint-Symphorien, un Chartes de Sabrevois, seigneur de Bouchemont en 1668.
Il y a un autre Bouchernont en Eure-et-Loir, dans la commune de Boutigny
(cant. de Nogent-le-Roi, arr. de Chartres), où l’on trouve encore des Sabrevois
en 1646, 1682, 1701, mais ce Bouchemont était une possession de l’abbaye
de Coulombs, ce qui nous fait penser que c’est au premier de ces deux hameaux qu’était
situé le fief des Sabrevois de Bouchemont.
146
Maxime Legrand, Étampes pittoresque, p. 403.
147
E. Z. Massicotte. Les Sabrevois. Bulletin des recherches
historiques (Lévis, 1925), XXXI, p. 7.
148
Preuves de Malte pour Louis de Saint-Périer.
149
Ce fief était « sis au lieu de Corbreuse
(cant. de Dourdan, arr. de Rambouillet) d’après les preuves de Malte de Louis
de Saint Périer (1622). (Arch. pers.). Il ne s’agit donc pas du lieudit Bandeville,
comm. de Saint-Cyr-sous-Dourdan, qui appartint successivement aux Rapouet
(1530), aux du Drac, puis aux Sevin, pour lesquels il fut érigé en marquisat
et qui firent construire au XVIIe siècle le château actuel de Bandeville
(Cf. Oysonville, son
château, ses seigneurs, Chartres, 1892 p. 27).
150
Preuves de Saint-Cyr pour Gabrielle
de Saint-Périer.
151
Languedoue : d’azur à trois serpents d’argent
couronnés d’or.
152
Cant. de Méréville, arr. d’Étampes.
Cf., sur la famille de Languedoüe, Annales de la Soc. du Gâtinais, t. XVII, p. 262 et suiv.
153
Preuves de Malte pour Louis de Saint-Périer.
154
lbid.
155
Le prieur de Mondonville (Bibl. nat., ms. Fr. 24126, t. III, fol. 140) donne comme fils aîné de
Claude et d’Élisabeth de Languedoüe « Étienne, prêtre de 1a congrégation
des Pères de l’Oratoire, envoyé à Rome avec un archevêque pour y établir
leur ordre en la maison de Saint-Louis, décédé le 28 juillet 1626 ». Nous
n’avons pu recueilli aucune autre indication sur ce personnage.
156
Lettres et entretiens sur l ’éducation, Lavallée (Paris, 1861), t. I, p. 215217 et t. II, p. 251-252.
157
Abbé de Verlot, op. cit., t. IV, p . 131.
158
Martyrologe des chevaliers de Saint-Jean
de Hierusalem (Paris, 1643), in-f°, t. II, fol. 168. Il dut y avoir deux
tirages au moins des figures de cet ouvrage, car les armes des Saint-Périer
sont timbrées, dans l’un des deux exemplaires que nous possédons, d’un casque
à lambrequins taré de front et, dans l’autre, d’une couronne fantaisiste,
qui n’est ni la couronne de marquis, ni celle de comte. D’ailleurs, le nombre
des barreaux du heaume, dans le premier tirage, n’est pas non plus conforme
aux règles de l’art héraldique.
159
Cabinet d’Hozier, 265.
160
L’expédition originale de cet acte
de donation (7 juillet 1669) ex iste encore à la mairie de Corbreuse.
161
Registres paroissiaux de Bleury, cant.
de Maintenon, arr. de Chartres.
162
Registres paroissiaux et archives
municipales de Corbreuse.
163
Comm. de Corbreuse.
164
Foudrier : de gueules à la fasce d’argent
chargée de trois feuilles de chêne de sinople.
165
Ce fief était situé à Corbreuse. Il
ne faut pas le confondre avec la commune du canton de Chevreuse, où Simon
de Sabrevois vendit un fief en 1414. (Soc. arch. de Rambouillet, V, 1879-80, p. 415.)
166
Cant. et arr. d’Étampes.
167
Ann. de la Soc. hist. et arch. du Gâtinais, t. XXVII, p. 118.
168
Coll. Clairambault, 867, fol. 442.
169
Extrait de baptême délivré à César
de Saint-Périer en 1713. (Arch. pers. à Morigny). Le registre paroissial
d’où cet acte a été extrait n’existe plus à la mairie de Corbreuse.
170
Cf. Pinard, Chronologie historique et militaire (Paris, 1760-1778), t. V, p. 148.
Mémoires de Louis-Auguste Le Pelletier (Paris, 1896),
passim. Ministère de la Guerre, dossier 614.
171
Cette figure manque au moins dans
l’exemplaire de ce bulletin conservé aux Archives départementales de l’Essonne
(B.G., 2013)
172
Minutes des lettres du marquis de
Saint-Périer au duc du Maine et à M. d’Angervilliers (Arch. pers. à Morigny).
173
Arch. personn. à Morigny et arch .
de la mairie de Corbreuse.
174
Gaulier : d’azur au chevron d’or accompagné
de trois croissants de même.
175
Cant. et arr. de Coulommiers.
176
Comm. de Coulommiers.
177
Cant. de Maintenon, arr. de Chartres.
178
Reg. par. de Corbreuse, et Mercure de France, 1757.
179
Poilloüe : d’argent à trois chevrons party
de sinople et de sable.
180
Comm. d’Étampes.
181
Comm. d’Étampes.
182
Buno-Bonnevaux, canton de Milly, arr.
d’Étampes.
183
Canton de Méréville, arr. d’Étampes.
184
Bulletin de la Commission départementale des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 45-46
(1931), pp. 133-152.
185
Commune de Buno-Bonnevaux, canton
de Milly, arr. de Corbeil.
186
Paul Quesvers et Henri Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse
de Sens, t. IV, p. 131.
187
Commiss. des Antiq. et des Arts de S.-et-O.,
vol. XXXIX-XL, p. 24 et vol. XLIII-XLIV, p. 47.
188
Cf. J. Quicherat, Histoire du costume en France, 1877.
189
Ce sont bien des têtes d’ours et non
des têtes de loups, comme le dit le chanoine Hubert (Bibl. d’Orléans, ms.),
erreur qu’avaient déjà signalée MM. Quesvers et Stein (loc. cit.).
190
Le mot faict de cette inscription n’a pas été lu par MM. Quesvers et Stein
(loc. cit.), sans doute parce qu’il était dissimulé dans la chapelle
de Bonnevaux par l’encadrement en bois sculpté dont nous avons parlé.
191
Ernest Coyecque, Recueil relatif à l histoire
de Paris et de ses environs au seizième siècle, Paris, Imp. nat., 1905, n° 1143.
192
Campardon et Tuetey, Inventaire des registres des
insinuations du Châtelet, Paris, Impr. nat.,
1996, n° 4576.
193
Coyecque, op. cit., n° 3510.
194
Beaufils, Étude sur les effigies des pierres
tombales, Pion, 1909, in-8.
195
Archiv. du chât. de Bonnevaux.
196
Loc. cit.
197
Com. de Buno-Bonnevaux.
198
Commune de la Ferté-Alais, arrondissement de Corbeil.
199
Commune de Château-Landon, arrondissement de Fontainebleau.
200
Commune de Château-Landon.
201
Canton de Château-Landon.
202
Stein, Ann. de la Soc. Hist et Arch. du Gâtinais, XII, 1894, p. 28.
203
Marc-Antoine Lamy, Coutume d’Étampes, p. 502.
204
Archiv. du chât. de Bonnevaux.
205
Procès-verbal de visite du sergent
royal de Milly, déjà cité. Archiv. du chât. de Bonnevaux.
206
Arch. du chât. de Bonnevaux.
207
Canton de La Ferté-Alais.
208
Canton de Château-Landon.
209
Sentence arbitrale déjà citée.
210
Bibl. Nat. Cabinet d’Hozier, 260.
— Inville, sans doute Intville-la-Guettard, canton de Malesherbes, arrondissement
de Pithiviers.
211
Canton de Marines, arrondissement
de Pontoise.
212
Canton de Milly, arrondissement de
Corbeil.
213
Archiv. du chât. de Bonnevaux.
214
Nous n’avons pu retrouver ce fief
dans les environs de Bonnevaux.
215
Commune de Buno-Bonnevaux.
216
Commune de Buno-Bonnevaux.
217
Commune de Rumont, canton de La Chapelle-la-Reine,
arrondissement de Fontainebleau.
218
Près de Janville-en-Beauce, d’après
d’Hozier.
219
Commune de Buno-Bonnevaux.
220
Archiv. du chât. de Bonnevaux.
221
Bibl. Nat, Cabinet d’Hozier, 250.
222
Canton de Milly, arrondissement de
Corbeil.
223
Sa femme, Marie Hurault, morte le
5 février 1650, fut enterrée dans l’église de Maisse, à côté de son second
mari, Jean de Pradines, gentilhomme de Gaston d’Orléans, qui était mort en
1632. Son fils du premier lit, François de Bienvenu, mort en 1665 à Paris
et la femme de celui-ci, Anne du Fresnay, morte en 1678, furent également
inhumés dans cette église.
224
Certificat du curé de Milly. Archiv.
du chât. de Bonnevaux.
225
Registre de l’état civil. Mairie de
Buno-Bonnevaux.
226
Et non fils de René de La Mothe et
de Jehanne de Voysines, comme l’ont supposé MM. Quesvers et Stein.
227
Commune de Mondeville, canton de La
Ferté-Alais.
228
Commune de Saclas, canton de Méréville,
arrondissement de Rambouillet.
229
Arch. person. à Morigny.
230
Bibl. Nat. Cabinet d’Hozier, 250.
231
Contestation entre MM. de Bizemont
et d’Averton en 1707. Arch. du chât. de Bonnevaux.
232
Contestation entre François de Bienvenu
et Me Guillaume Languet, conseiller au Parlement, acquéreur de
la baronnie de Milly (1658) (Arch. du chât. de Bonnevaux).
233
Cf. R. de Saint-Périer, Les Villezan,
seigneurs de la Tour de Guillerval.
Bull. de la Soc. des
Amis du Musée d’Étampes, n° 7, 1929, p. 50.
234
Ch. Forteau, Registres paroissiaux du canton
de Méréville, p. 324.
235
Arch. personn. à Morigny et archiv.
du chât. de Bonnevaux.
236
Livre de comptes de M. Bonnevaux.
Archiv. personn. à Morigny.
237
Canton de Milly.
238
St-Cyr-la-Rivière, canton de Méréville,
arrondissement de Rambouillet.
239
Archiv. personn. à Morigny et archiv.
du chât. de Bonnevaux.
240
Histoire de la commune de Buno-Bonnevaux,
par l’instituteur, en réponse au questionnaire du préfet de S.-et-O., 1882,
ms., Mairie de Buno-Bonnevaux.
241
Louis André, Buno-Bonnevaux, Ann. de la Soc. hist. et arch.
du Gâtinais, III, 1885, p. 181.
242
Archiv. du chât. de Bonnevaux.
243
Id.
244
Id.
|
BHASE n°34
(novembre 2016)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase034w.pdf
|
|
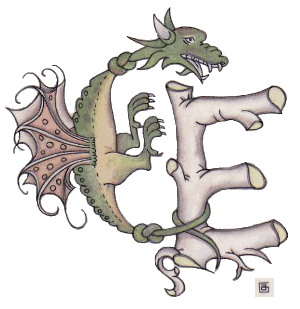
|