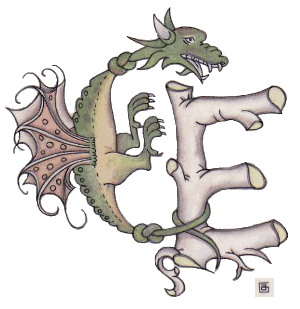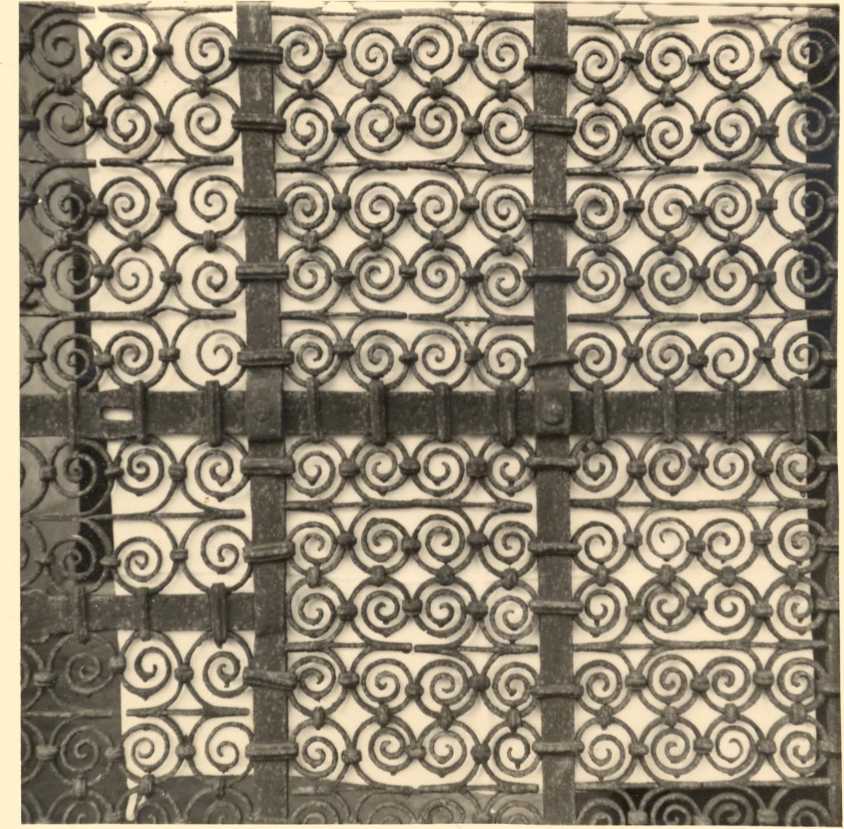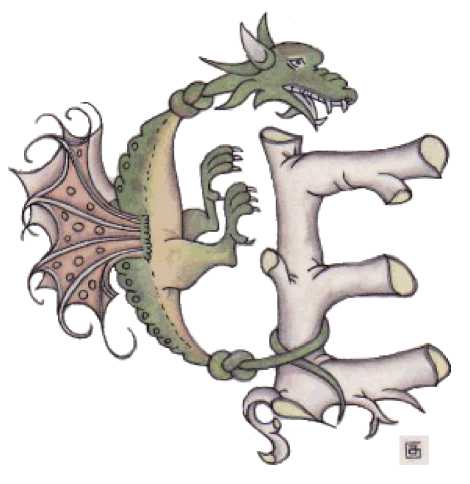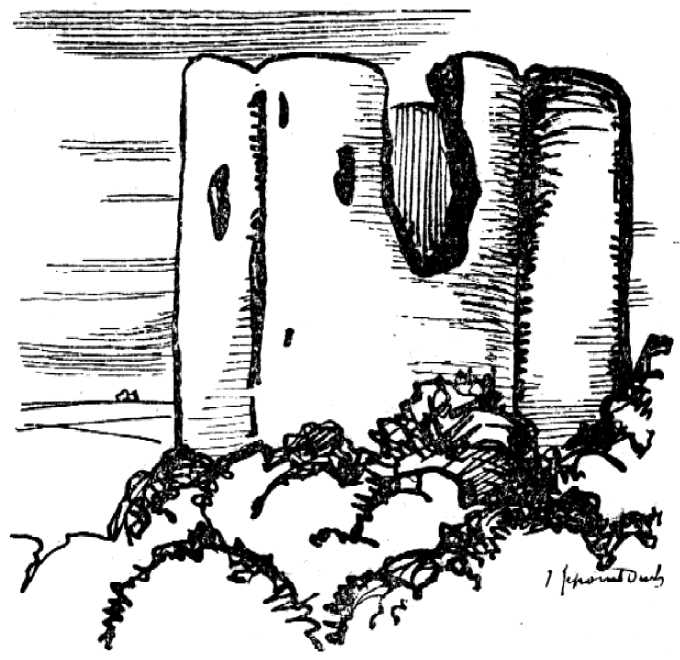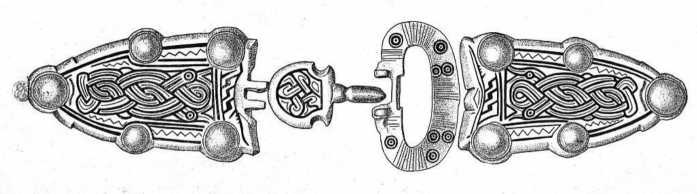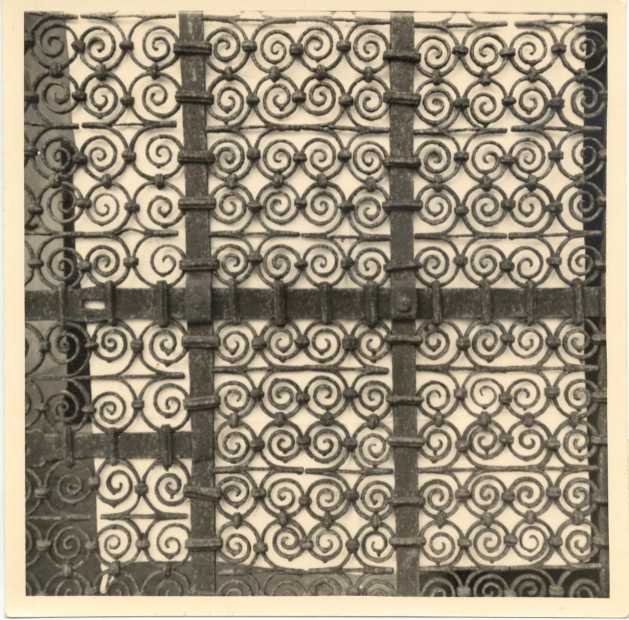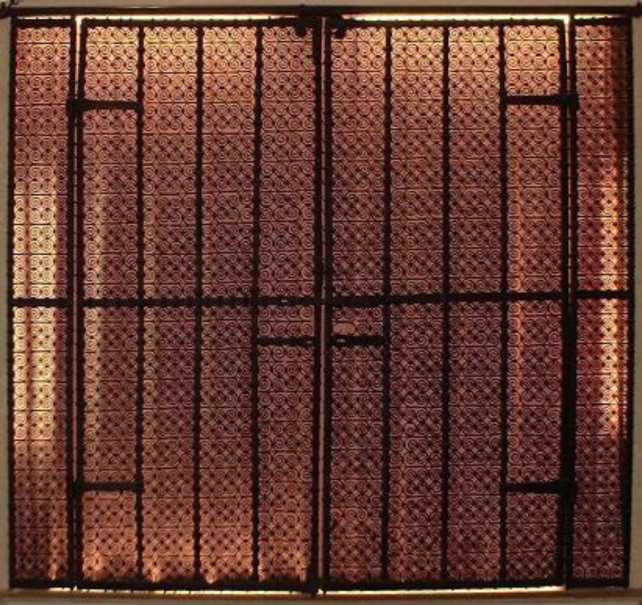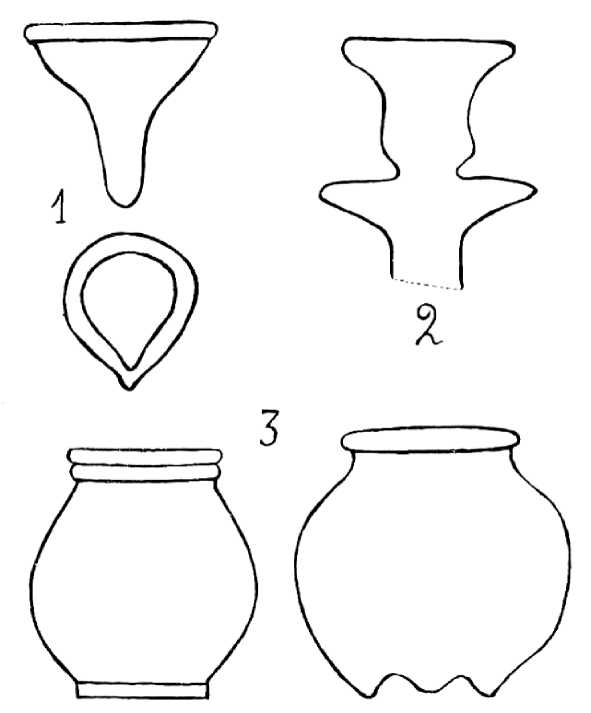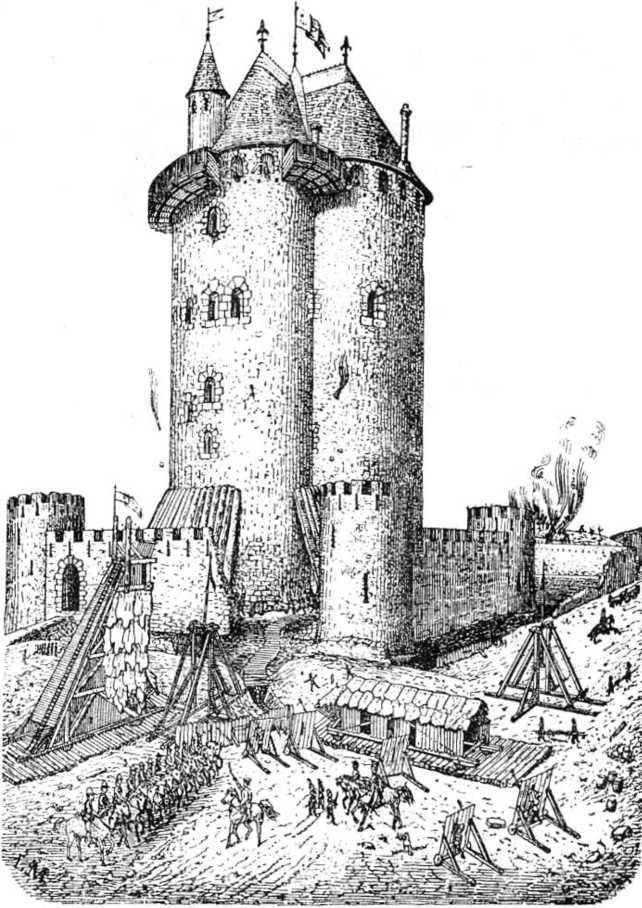|
BHASE n°33
(octobre 2016)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase033w.pdf
|
|
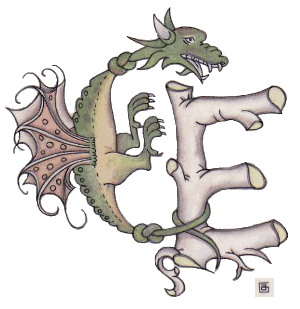
|
Le monde des Saint-Périer
— tome 3 LE SUD-ESSONNE MÉDIÉVAL
Préface.—Bibliographie.—01. Les origines et le Moyen-âge.
— 02. Une plaque de ceinturon mérovingienne. — 03. Une découverte dans le passé
de Morigny. — 04. Découverte d’un fond de cabane ancienne à Morigny. — 05.
Le Jugement dernier du portail de Saint-Basile. —
06. La grille romane de l’ancienne abbaye de Morigny.
— 07. Une grille romane conservée au Musée d’Étampes.—08. Donation d’un domaine prés
d’Étampes par Philippe-Auguste a l’Ordre de Saint-Jacques en 1184. — 09.
Le bel envers d’un évier.—10. Sépultures anciennes à Saclas.
— 11. Le cimetière de Champigny. — 12. Objets du
Moyen-Age découverts à Étampes en 1923. — 13. Un meurtre à Étréchy en 1395.
— 14. Une prisonnière au château d’Étampes au XVe siècle.
— 15. Le duc de Berry.
BHASE n° 33 — octobre 2016
LE SUD-ESSONNE MÉDIÉVAL
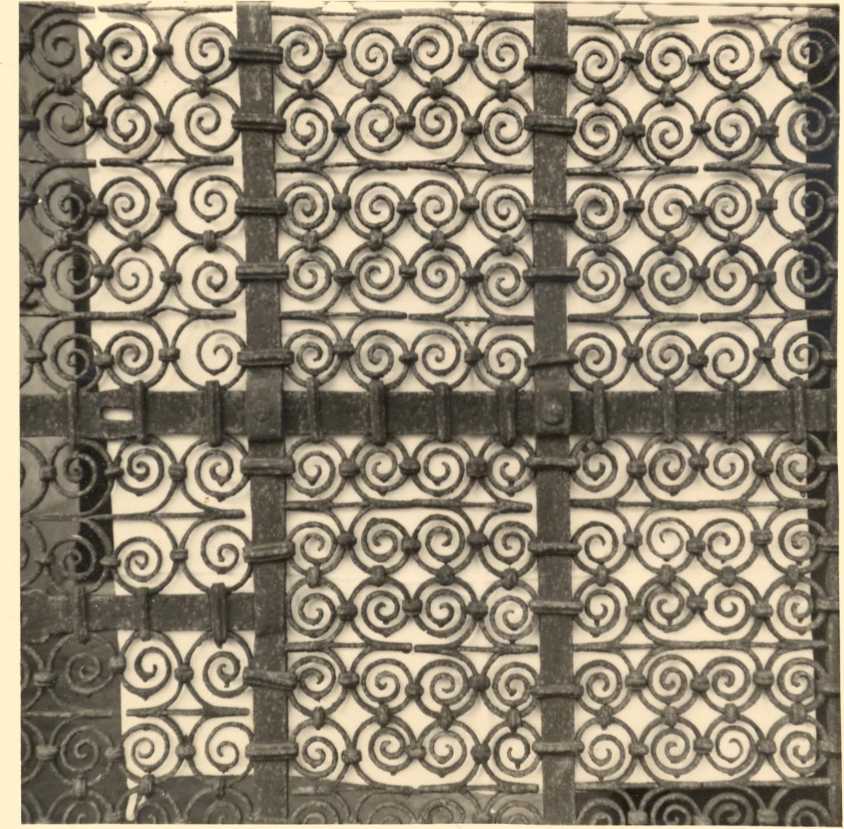
Le monde des Saint-Périer - tome 3
ISSN 2272-0685
Publication du Corpus Étampois Directeur de publication
: Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois. com
BHASE n°33
Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne
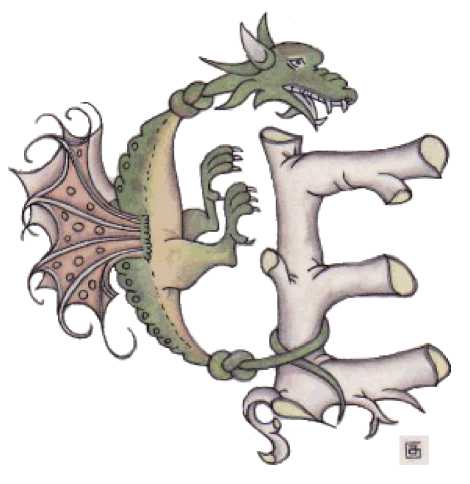
publié par le Corpus Étampois
octobre 2016
Le monde des Saint-Périer. Tome 3
Le Sud-Essonne

Edité par le Corpus Etampois
médiéval
COMITÉ DE LECTURE
Bernard Gineste Bernard Métivier Bernard Minet f
Bernard Paillasson
Préface
Voici le troisième volume des Œuvres Locales Complètes
du comte de Saint-Périer. Il regroupe toutes les études qu’il a consacrées,
de 1913 à 1950 à l’histoire médiévale de l’ancien arrondissement d’Étampes,
qui correspond grosso
modo à la partie méridionale de l’actuel département
de l’Essonne ; plus trois articles publiés par sa veuve de 1953 à 1960.
On trouvera donc ci-après, tout d’abord, une présentation
générale de cette période dans la région d’Étampes, qui constitue le début
de son histoire générale et synthétique de la ville d’Étampes, dont la première
édition date de 1938.
On lira ensuite les quatorze études d’histoire locale
publiées par les époux Saint-Périer qui sont relatives au millénaire médiéval. Nous
les rangeons par ordre chronologique des périodes traitées : trois concernent
le haut moyen âge ; huit le moyen âge central ; et trois le bas moyen âge.

René de Saint-Périer
(1877-1950)
Bibliographie des articles
ici réédités
A. — Présentation générale
01. René de Saint-Périer, « Les origines et le
Moyen-âge » et « La Renaissance » [début], in Id., La grande histoire d’une petite
ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire
de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 9-25. — Réédition posthume légèrement remaniée,
in Étampes. Bulletin
Officiel Municipal 2 (janvier 1964), pp. 23-27.
B. — Haut Moyen-Age
02. « Une plaque de ceinturon mérovingienne »,
in Bulletin de la
Commission départementale des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 45-46 (1931), pp. 125-126. — Tiré à part (4 p. ; illustration),
sans nom de lieu ni d’éditeur, 1931.
03. « Une découverte dans le passé de Morigny
», in Bulletin de
la Société des Amis d’Étampes 6 (avril 1950),
pp. 98-99.
04. « Découverte d’un fond de cabane ancienne
à Morigny », in L’Abeille
d’Étampes 109/17 (24 avril 1920), p. 1.
/y
C. —Moyen-Age central
05. « Le Jugement dernier du portail de Saint-Basile
», in
Bulletin de la Société
des Amis d’Étampes et de sa région 4 (février
1948), pp. 60-61.
06. Raymonde-Suzanne de Saint-Périer, « La grille
romane de l’ancienne abbaye de Morigny (S.-et-O.) », in Bulletin archéologique du Comité
des Travaux historiques et scientifiques (1953),
pp. 86-89. — La comtesse
a recyclé indéfiniment cette conférence : « La grille de l’abbaye de Morigny
au Musée d’Étampes », in Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise.
XVIIIe congrès. Mantes. 16 et 17 octobre 1953. — « La grille de l’abbaye de
Morigny », in Bulletin
de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise LV (1953-1954), pp. 7-8.
07. « Une grille romane conservée au Musée d’Étampes
», in
Bulletin de La Montagne
Sainte Geneviève et ses abords 45/1 (mars 1954),
pp. 2-10, sous le chapeau suivant : « Conférence faite par madame de Saint-Périer
le 20 février 1954 » [in-4°; 10 p.; polytypé ; Paris, Roy, 1954 ; exemplaire
conservé à la BnF].
— Cette conférence aussi
semble avoir été indéfiniment recyclée ou remaniée : « La grille romane de
l’abbaye de Morigny », in Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise.
XXe congrès. Mantes. 31 mai et 1er juin 1957 (simple mention par la « Liste
des travaux » des « seizième à vingt-quatrième sessions : 1949-1966 », Versailles,
1967). — « Quelques indications complémentaires sur l’abbaye et le village
de Morigny », in Conférence
des sociétés savantes de Seine-et-Oise. XXIIIe congrès. Pontoise. 13
et 14 juin 1964 (simple
mention, ibid). — « Notes archéologiques », in Conférence des sociétés savantes
de Seine-et-Oise. XXIVe congrès. Corbeil. 3 et 4 juin 1966 (simple mention, ibid.). — Sa matière a été reprise de
plus en partie dans un article que nous publierons dans un tome ultérieur
du BHASE : « Morigny et son abbaye », in Pays d ’Yveline, de Hurepoix et de Beauce 9 (1965), pp. 14-16.
08. « Donation d’un domaine près d’Étampes par
Philippe-Auguste à l’Ordre de Saint-Jacques (1184) », in Bulletin des Amis d’Étampes et
de sa Région 10 (1960), pp. 8-9.
09. René de Saint-Périer, « Le bel envers d’un
évier », in L’Abeille
d’Étampes 122/30 (29 juillet 1933), p. 1.
10. « Sépultures anciennes à Saclas », in L Abeille d’Étampes 102/41 (11 octobre 1913), p. 2.
11. « Le cimetière de Champigny », in Bulletin de la Société des Amis
du Musée d’Étampes et de sa région 1 (août 1946),
pp. 6-7.
12. « Objets du Moyen-Age découverts à Étampes
en 1923 »,
in Bulletin de la Société des Amis du Musée d’Étampes 6 (19231924), pp. 29-32.
D. —Bas Moyen-Age
13. « Notes d’histoire locale. Un meurtre à Étréchy
en 1395 », in L’Abeille
d’Étampes 113/23 (31 mai 1924), p. 1. — Tiré
à part : Notes d’histoire
locale. Un meurtre à Étréchy en 1395 [in-16;
6 p.], Étampes, Terrier frères, 1924.
14. « Une prisonnière au château d’Étampes au
XVe siècle »,
in Almanach Annuaire de la ville et de l’arrondissement
d’Étampes 1925, Étampes, Terrier frères et Cie,
1924, pp. 15-18.
15. « Le duc de Berry », in L’Annuaire de la ville et de l’[ancien]
arrondissement d’Étampes 1948, Étampes, Havas, 1947,
pp. 4-27 (avec une illustration de Léonce Balas).
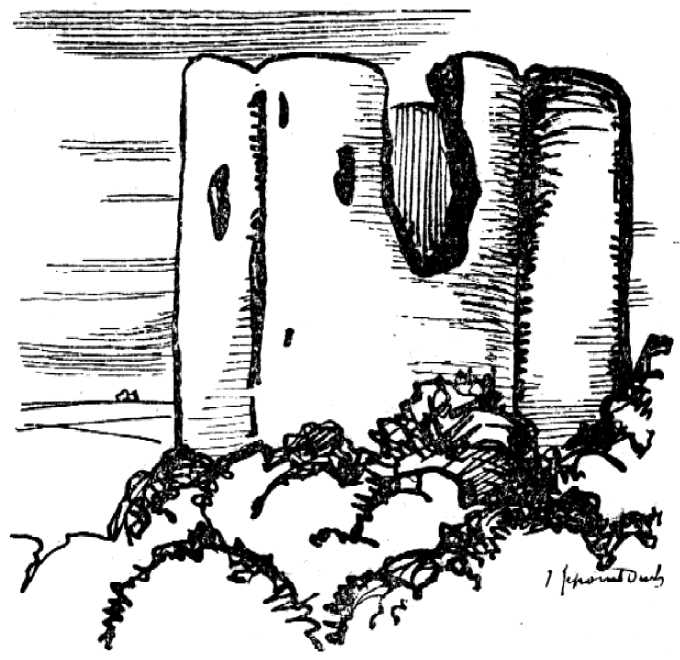
01. Les origines et le Moyen
Age 1
Situation favorable et
fertilité du sol. — Stampæ. — Campements préhistoriques et stations gallo-romaines. — La ville mérovingienne. — Première bataille à Étampes. — Premières destructions. — Relèvement et fondations
nouvelles. — Vieille ville, ville forte et ville-marché.
La malheureuse Ingeburge. — Étampes apanage et comté. — Les ravages de la Guerre de Cent ans. — Un fastueux comte d’Étampes, Jean de Berry. — La guerre civile. — Étampes port fluvial.
À mi-chemin entre Paris et Orléans, la ville d’Étampes
s’étend sur la grande route qui relie ces deux villes et qui fut la route
des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, autour de trois rivières, divisées
elles-mêmes en de nombreux bras, au pied du grand plateau de Beauce. Son
territoire confine aux anciens pays de Chartres, d’Orléans, du Hurepoix et
du Gâtinais, de longtemps riches et peuplés. Le sol en est très fertile,
on y a cultivé dès une haute époque le blé dans la plaine, la vigne sur les
pentes des collines et plus tard, les plantes maraîchères dans la vallée.
La rivière de Juine, alors navigable, offrait ainsi une communication directe
avec Paris par l’ Essonne et la Seine. Ces diverses conditions particulièrement
favorables à la vie sociale ont
1 On reproduit
ici le chapitre premier et les premiers paragraphes du suivant d’un important
ouvrage du comte de Saint-Périer, La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire
de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 9-25, en notant les variantes du remaniement
posthume de 1964, in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 2 (janvier 1964), pp. 23-27 (B.
G).
déterminé sans doute la fondation en ce lieu de la
première bourgade, entraîné son développement dès ses débuts et lui valurent
peut-être son nom. L’étymologie du nom d’Étampes, que portent quatre localités
françaises, demeure, en effet, incertaine ; mais, entre les diverses hypothèses
dont elle a fait l’objet, l’une des plus satisfaisantes la rattache au bas
latin stapula, dérivé du mot germanique stapel, amas, d’où
entrepôt, place publique, que l’on retrouve modifié sous la forme 10 Stampæ, dans les plus anciens textes. Lieu de réunion sur un passage
fréquenté, où l’on assemble les marchandises venues par route et par eau,
telle est l’ origine vraisemblable de notre ville ; mais nous n’avons aucune
preuve de son existence, en tant que cité, avant le VIe siècle
de notre ère. Aux âges préhistoriques, son emplacement n’a pas été occupé
par des groupements humains. Non loin d’Étampes, nous avons bien relevé la
trace de campements remontant à l’époque paléolithique, mais ces témoins
sont fort peu nombreux et n’indiquent pas une occupation de quelque importance.
II en est de même pour l’âge de la pierre polie, pour les âges du bronze
et du fer. On connaît des stations de ces époques aux environs d’Étampes,
mais leur dispersion et leur faible densité ne permettent pas de les considérer
comme un ancien centre d’habitation.
À l’époque gallo-romaine, notre région, comprise
dans le pays des Senones, près de la frontière des Carnutes, était traversée
par des voies importantes, notamment celle de Lutetia à Genabum, c’est-à-dire
de Paris à Gien, Orléans ou Châteauneuf-sur-Loire, car la position de Genabum donne encore lieu à de nombreuses controverses. Dans l’itinéraire
d’Antonin, cette voie passe à Salioclita, que
l’on a voulu à tort identifier avec Étampes et qui doit être Saclas, à 10
kilomètres au sud, où l’on reconnaît encore le dallage de la voie antique.
Mais cette route ne semble pas avoir traversé l’emplacement actuel d’Étampes
; elle passait au nord de la ville, au lieu-dit Brunehaut, où l’ on a retrouvé
des monnaies, une statuette de Mercure en bronze, des substructions et un
Priape en pierre, qui témoignent d’établissements romains en ce point ; quelques
autres découvertes isolées dans les environs d’Étampes prouvent que la région
était fréquentée, mais sans qu’une ville fût encore établie aux bords de
la Juine.
Ce sont les divisions entre les rois mérovingiens,
successeurs de Clovis, et les guerres si fréquentes entre ces chefs de bandes encore
à demi barbares, qui nous apportent la première mention historique de l’existence
d’Étampes à cette époque. Grégoire de Tours nous dit, en effet, dans sa précieuse
Historia, qu’en 587, une transaction passée entre Childebert, roi
d’Austrasie, et son oncle Gontran, roi de Bourgogne, attribuait à Gontran
une partie de Paris, Châteaudun, Vendôme et le territoire d’Étampes Pagus Stampensis. Peu après, suivant le même chroniqueur, Étampes était ravagée
par les troupes du roi Childebert, puis, en 612, Clotaire, roi de Neustrie,
et Thierry, roi d’Austrasie, se livrent une sanglante bataille sous les murs
mêmes d’Étampes. Un récit de Frédégaire précise que la lutte eut lieu à Stampas per fluvium Loa, ce qui correspond au débouché de la vallée de la Louette. Plusieurs
noms de lieux dits aux alentours de cet emplacement, la Croix de Vaux-Mille-Cent ou Vomit-le-Sang, |11
le Meurger de la
Bataille, le Champ des Morts, montrent que le souvenir et le lieu même de ce combat n’ont
pas été oubliés. Il est vrai qu’aucune découverte d’armes n’est venue confirmer
cette tradition, mais l’emplacement des anciennes batailles, si singulier
que cela puisse paraître, est le plus souvent très difficile à déterminer.
En effet, les corps n’étaient inhumés qu’après avoir été entièrement dépouillés
de leurs armes et les squelettes que l’on pourrait découvrir, n’étant accompagnés
d’aucun mobilier funéraire, ne peuvent être datés.
Ces mentions d’Étampes, si modestes qu’elles soient,
nous font connaître, outre son existence certaine au VIe siècle, l’emplacement
de la première bourgade qui porta ce nom c’est celui du quartier Saint-Martin
actuel. La tradition attribue la fondation de l’église Saint-Martin au roi
Clovis : aucun texte ne le confirme, mais ce vocable indique, en général,
une origine ancienne et il fut sans doute appliqué à la première église d’Étampes.
Une autre tradition rapporte que des religieux bénédictins
seraient venus de l’abbaye de Fleury-sur-Loire, vers le milieu du VIIIe
siècle, bâtir, en dehors de la ville, une église et un monastère dédiés à
Saint-Pierre. Quelques restes de murs qui présentent le vieux mode de construction
dit opus spicatum confirment l’origine mérovingienne de ces édifices, dont
notre faubourg actuel conserve encore le nom.
Si les documents nous manquent au sujet de ces fondations,
comme les traces matérielles de la bataille d’Étampes en 612, nous ignorons
également si la reine Brunehaut, comme le veut une autre tradition locale,
vécut à Étampes et si elle subit, près de la ville, dans la vallée de Brières,
l’affreux supplice qui lui fut infligé par le fils de sa rivale Frédégonde.
Son mari Sigebert eut bien Étampes dans son domaine, mais rien ne prouve
que sa veuve y fit sa résidence. Le nom de Brunehaut ayant été conservé dans
tout le nord de la France, sous la forme de « chaussée ou chemin Brunehaut
» pour désigner d’anciennes voies romaines qui furent réparées et améliorées
sur les ordres de cette reine d’Austrasie, il serait imprudent d’affirmer
que Brunehaut elle-même vécut au lieu qui porte encore son nom près d’Étampes. Nous
avons dit déjà que les vestiges antiques trouvés en ce point sont gallo-romains
et non pas mérovingiens.
Des rapports de ces rois de la première race avec
Étampes, il nous reste donc peu de chose. Les Carolingiens n’ont pas laissé non
plus d’actes importants de leur règne où figure notre ville.
Nous savons seulement que, dans le partage qui suivit
la mort de Charlemagne, Étampes fut attribué à Louis le Débonnaire, puis
à son fils, Charles le Chauve, et que l’un et l’autre de ces princes donnèrent
à des monastères, en particulier à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, |12
à Paris, et à un « fidèle sujet », des terres aux environs d’Étampes.
Mais après ces règnes pendant lesquels le calme régnait
sans doute à Étampes, puisque les monastères y pouvaient recevoir des donations,
les invasions normandes vinrent apporter de nouveaux désordres. Rollon lui-même,
au dire du chroniqueur Guillaume de Jumièges, entra dans Étampes, détruisit
la ville, emmena comme prisonniers un grand nombre de ses habitants. Il est
probable, bien que nous n’ayons pas d’autres détails sur ces événements,
que les monuments d’Étampes furent alors démolis, puisque nous n’avons malheureusement
aucun fragment d’ architecture de cette haute époque, car rien ne demeurait derrière
le passage des Normands. Et, pendant près de cent ans, les chroniques ne
parlent plus d’Étampes.
Mais les premiers rois capétiens devaient relever
notre ville et lui donner une importance et même un lustre qu’elle n’avait jamais
encore connus et qu’elle ne retrouvera plus aux époques modernes. Issus des
ducs d’entre Seine et Loire, vassaux révoltés contre l’autorité défaillante
des derniers Carolingiens, ces rois ne possédaient lors de leur ascension
à la dignité royale qu’un bien petit domaine. Rois d’Île de France, plutôt
que de France, ils s’appuyaient sur Dourdan et sur Étampes pour lutter contre
leurs puissants voisins et affermir leur domination. Étampes leur demeura
toujours fidèle et ne cessa pas de faire partie du domaine royal. Dans le
cours des siècles, lorsque les descendants de Hugues le Grand, père de Hugues
Capet, qui possédait déjà Étampes au Xe siècle, eurent agrandi
leur domaine et constitué la France de nos jours, notre ville devint un apanage
accordé tantôt à des princes du sang, tantôt à de fidèles vassaux ou à des favorites
du roi, mais revenant toujours à la couronne, dont elle était un des plus
beaux fleurons.
Dès le règne de Robert le Pieux (970-1031), les chroniques
citent Étampes comme l’un des séjours fréquents et préférés de ce prince.
C’est lui qui aurait fait édifier, sur le bord septentrional du plateau,
une forteresse dont la tour de Guinette marque l’emplacement, mais non pas
un vestige de cette haute époque, puisque sa construction ne peut être datée
que du milieu du XIIe siècle. En outre, la troisième femme du
roi Robert, Constance, fit construire, pour leur résidence, un palais dit
du Séjour ou des Quatre-Tours, à cause des tourelles d’angle, qui subsistaient encore
au XVIIe siècle. Il comprenait de nombreux bâtiments, des écuries,
un oratoire, et des jardins, qui occupaient le lieu actuel du tribunal et
le terrain compris entre la rue de la Juiverie et la rue de la Roche-Plate.
Autour du château fort et du palais, une nouvelle ville se constitua, que
les documents du XIe siècle désignent sous le nom de Stampæ castrum ou Stampæ novæ : Étampes-le-Châtel
ou Étampes-les-Nouvelles. Cette dernière appellation confirme que la plus
ancienne ville, Étampes-les-Vieilles, |13 fondée vers le VIe
siècle, ne s’étendait pas là. Nous avons vu qu’elle s’était établie plus
au sud et que sans doute la première église de cette petite cité mérovingienne
avait été dédiée à Saint-Martin. Mais la nouvelle ville en était trop éloignée
pour que le roi qui avait assuré sa défense par des fortifications et pourvu
à l’agrément de sa propre résidence ne songeât pas à y fonder des églises.
Ailleurs déjà, Robert le Pieux avait encouragé le grand élan religieux suscité
à la fois par les approches de l’an 1000, qui, dans l’esprit des peuples
devait amener la fin du monde, et par la coïncidence des calamités, famines,
épidémies, brigandages, qui marquèrent les dernières années du Xe
siècle. Selon le joli mot de l’humble moine chroniqueur, le monde se parait
alors « d’une blanche robe d’églises neuves ». Dans le nouvel Étampes, le
roi fit édifier Notre-Dame, sur les ruines d’une chapelle, et Saint-Basile
au pied de la forteresse. Pour donner plus de lustre à l’une de ses nouvelles
églises, il fit apporter à Notre-Dame des reliques qu’il avait obtenues du
pape Benoît VIII, sans doute lors de son voyage en Italie en 1020. C’est
ainsi que les trois martyrs, Can, Cantien et Cantienne, deux frères et leur
sœur, morts pour leur foi, à Aquilée, en Vénétie, au IIIe siècle,
devinrent les patrons d’Étampes. Ces reliques furent l’objet pendant des
siècles d’une grande vénération ; elles attirèrent à Étampes, pour la fête
des « corps saints », le 31 mai, pour les processions dans la ville, à Pâques
et à la Pentecôte, et lors des grandes sécheresses ou des disettes, une foule
de fidèles et de curieux qui contribuèrent jadis à sa prospérité. Le cimetière
commun aux deux paroisses de Notre-Dame et de Saint-Basile, dit le Grand
Cimetière, fut établi hors des murs, dans le hameau de Bédégond, qui s’étendait
entre le faubourg Saint-Jacques et le faubourg Évezard. Le roi Philippe Ier
fit don de ce hameau aux chanoines de Notre-Dame pour qu’ils élèvent une
chapelle dans le cimetière. Elle fut construite le long de la rue actuelle
qui a pris son nom Saint-Jacques-de-Bédégond. Le petit bâtiment, orné d’une
jolie porte du XVe siècle, qui est aujourd’hui non loin de là,
du côté du Port, ne représente pas un reste de cette chapelle du XIIe
siècle, puisqu’elle fut détruite au moment de la Fronde.
C’est encore sous le règne des premiers rois capétiens,
sans doute dès Robert le Pieux, que les eaux de la Louette et de la Chalouette,
qui serpentaient auparavant dans la partie la plus déclive de la vallée,
furent canalisées dans la ville en formation. Ce canal, qui passe toujours
derrière les maisons des rues basses, devait servir non seulement aux usages
ordinaires, mais permettre l’établissement des moulins à farine et favoriser l’industrie
des foulons.
Ainsi, vers le milieu du XIe siècle, Étampes
se composait de deux villes, l’une, ouverte, ancienne et de quelque importance puisque
des actes de Philippe Ier (1060-1108) nous apprennent qu’elle
ne comprenait pas moins de trois églises, Saint-Martin, Saint-Alban |14
et Saint-Mard, l’autre, véritable place forte, comme nous le confirme la
légende d’ une monnaie de Philippe Ier frappée à Étampes, Castellum Stampis, à la fois ville militaire et résidence royale, qui avait
pris, de ce fait, un rapide développement. Entre les deux agglomérations,
s’étendait un vaste espace inhabité, qui le demeura seulement jusqu’au jour
où le roi Louis VI eut l’idée d’y établir un marché, en 1123. Il accordait
en même temps des privilèges aux marchands pour assurer leur sécurité et
faciliter le transport et la vente de leurs marchandises. En outre, il cherche
à donner une rapide activité à ce nouveau marché en peuplant ses abords.
Pour cela, il y attire des hôtes, c’est-à-dire
des sujets presque entièrement affranchis du servage, auxquels il concède
une maison et quelques arpents de terre, avec l’exemption de l’impôt de la
taille et du service de guerre pour dix ans et la réduction du taux des amendes
et du droit de mesurage des grains, le minage, qui était
dû au roi. Cette politique, qui accentuait celle de ses prédécesseurs, intéressée, sans
doute, les rois ayant besoin des ressources et de l’appui que leur offrait
Étampes, mais évidemment favorable à son développement, donna des résultats
rapides. Une vraie ville ne tarda pas à se constituer comme un trait d’union
entre les deux autres, autour du marché et d’une nouvelle église, bientôt
édifiée, Saint-Gilles. D’autre part, Louis VI prend Étampes comme base stratégique
dans sa lutte contre ses redoutables vassaux, Hugues du Puiset, le sire de
Montlhéry, les comtes de Corbeil, de la Ferté-Alais, de Rochefort. Plusieurs
conciles s’y tiennent et celui de 1130, qui réunit à Étampes tous les prélats
du royaume, y confirme l’élection d’un pape, Innocent II. Les fondations
se multiplient et les monuments s’élèvent ou s’agrandissent : la maladrerie
de Saint-Lazare, l’hospice de Saint-Jean, l’Hôtel-Dieu, le couvent des Mathurins.
Le roi Louis VII, dès son avènement, s’engage à ne
pas altérer durant tout son règne la monnaie frappée à Étampes ; il encourage
par plusieurs ordonnances les divers métiers, le commerce du vin et de la
boucherie ; il s’efforce d’enrayer les abus des duels judiciaires, d’adoucir
le sort des vilains en les autorisant à acheter des terres. En 1147, il institue
la foire de la Saint-Michel en abandonnant ses droits de marché à la léproserie de
Saint-Lazare, près de laquelle la foire devait se tenir. Comme son père,
il apporte aussi tous ses soins au remaniement et à l’extension de la forteresse
dont le donjon — notre tour de Guinette — dut être achevé vers 1150. Ces
diverses mesures nous apportent de précieuses indications sur le développement qu’avait
pris notre ville. Nous savons ainsi qu’il y avait à Étampes, en 1179, de
nombreux moulins, des bouchers, des mégissiers, des ciriers, des vendeurs
d’arc ; le défrichement des terres et la production agricole ne cessaient
de croître, avec le nombre des habitants. À la fin du XIIe siècle,
Étampes avait pris à peu près son étendue |15 actuelle, ajoutant
la prospérité commerciale à l’importance de ses ouvrages militaires.
Philippe-Auguste, qui l’appelle « une de ses meilleures
villes », fonde une nouvelle et grande église, Sainte-Croix, dotée d’un chapitre,
à l’emplacement de la synagogue — rue de la Juiverie — dont l’expulsion des
Juifs hors du royaume, en 1182, avait entraîné la destruction. Ce roi montre
encore l’intérêt qu’il porte aux habitants d’Étampes en octroyant aux foulons
ou tisserands d’importants privilèges, qui favorisent en même temps les producteurs
de laine de la région, puis, en faisant construire place Dauphine un grand
bâtiment, qui comprenait au rez-de-chaussée une halle pour les bouchers,
avec de nouveaux étaux, et peut-être aussi une dépendance, de l’autre côté
de la rue sur la rivière, des règlements rédigés bien plus tard, mais qui
peuvent avoir été imposés dès lors, obligeant à tuer les animaux « sur les
rivières et non en les maisons ». De ce fait, d’ailleurs, le roi touchait directement
des droits, ce qui n’ était pas négligeable ; en même temps son autorité
en était assurée et la ville y gagnait quelque avantage. Au-dessus de la
halle, une vaste salle fut aménagée pour les « plaids », c’est-à-dire le
tribunal civil, dont les audiences se tinrent là jusqu’au début du XVIe
siècle.
Une question qui demeure obscure à cette époque est
celle de l’administration municipale. Le droit de commune, accordé par Louis
VI à bien d’autres villes, n’est l’objet d’aucune des chartes qui subsistent
en faveur de la nôtre. Elle dut cependant l’obtenir puisqu’un acte de 1188,
qui fut d’ailleurs ignoré des premiers historiens d’Étampes, nous apprend
qu’elle avait un maire. Mais, dès 1199, les franchises communales lui sont
enlevées, par Philippe-Auguste, en raison des abus commis au détriment des intérêts
de l’Église et des seigneurs, que le roi avait à ménager. Elles lui seront
restituées au XIIIe siècle et la ville, au surplus, ne semble
pas y avoir perdu ses avantages, qu’elle tenait avant tout du roi.
La vie privée de Philippe-Auguste le rattache au
moins autant à Étampes que ses actes publics. Il avait épousé en secondes noces
une princesse venue d’un pays lointain, comme son aïeul Henri Ier
qui avait pris alliance dans la maison des ducs de Kiev, en Russie. Philippe-Auguste
avait demandé et obtenu la main d’ Ingeburge, fille de Waldemar, roi de Danemark,
et la jeune fille avait reçu en France un accueil triomphal que justifiaient
sa beauté et sa bonne grâce, encore qu’elle ignorât notre langue. Le mariage
fut célébré à Amiens, la veille de l’Assomption, en l’an 1193. Que se passa-t-il
entre les époux ? Nul ne le saura jamais. Toujours est-il que le lendemain
des noces, le roi, saisi d’une étrange aversion pour sa femme, déclara qu’il
la répudierait.
Aussitôt, en effet, il commença des démarches pour
obtenir l’annulation de son mariage, invoquant une parenté d’Ingeburge tantôt
avec sa première femme, Isabeau de |16 Hainaut, tantôt avec sa
trisaïeule, Anne de Russie. Ces parentés, qui constituaient alors des obstacles
au mariage, étaient établies sur de faux actes généalogiques, mais sous la
pression du roi, une assemblée des évêques de France prononça le divorce.
La malheureuse reine refusa cependant de quitter la France et chercha d’abord
asile en divers monastères, réduite même, dit-on, à demander l’aumône, tandis
que Philippe-Auguste se hâtait d’épouser une autre princesse étrangère, Agnès
de Méranie. Mais le pape ayant d’abord cassé la sentence du divorce et ce
nouveau mariage, puis, jeté l’interdit sur tout le royaume, le roi fit enfermer
Ingeburge dans le donjon d’Étampes, où elle devait demeurer des années prisonnière.
Elle ne recouvra véritablement sa liberté et ses prérogatives d’épouse et
de reine qu’en 1213, après maintes vicissitudes, des retours du roi vers
elle sans lendemain et suivis de nouvelles périodes de captivité. Mais les durs
effets de l’ excommunication, qui menaçait de ruine à cette époque un pays
tout entier, la réprobation de plus en plus vive du clergé et du peuple,
sans doute aussi la mort d’Agnès de Méranie, amenèrent enfin le roi à se
soumettre définitivement. Bien des points de cette lutte singulière demeurent
obscurs d’ailleurs, les textes étant souvent en désaccord sur ce sujet. Nous
citerons cependant une mention manuscrite peu connue, retrouvée sur le psautier
d’Ingeburge, qui met comme un terme à cette dramatique histoire, en donnant
à penser que la malheureuse reine avait pardonné au roi sa longue injure
et conservé du dévouement pour ses intérêts et ceux de la France. Elle a
fait écrire, en effet, sur le calendrier de son psautier à la date de la victoire
de Bouvines, le 27 juillet 1214, cette courte note : Sexto kalendas augusti, anno
Domini M° CC° quarto decimo, veinqui Phelippe, li rois de France, en bataille,
le roi Othon et le conte de Flandres et le conte de Boloigrie etplusors autres
barons.
C’est le petit-fils de Philippe-Auguste, Saint Louis,
qui le premier détacha provisoirement du domaine royal Étampes et son territoire
pour le donner à sa mère Blanche de Castille en échange de son douaire en
Berry qu’elle avait abandonné à son troisième fils, Robert d’Artois, pour
faciliter son mariage. La régence de Blanche de Castille avait été traversée
de nouvelles luttes contre les vassaux de la couronne, rebelles à l’autorité d’une
femme. Mais on sait que celle-ci était d’une vertu peu commune. Son courage
eut raison de tous les ennemis du jeune roi, auxquels, s’il faut en croire
Joinville, ne s’étaient pas joints les seigneurs du pays d’Étampes : ayant,
au contraire, averti leur souverain, ils lui permirent ainsi de triompher
à Montlhéry et de rentrer à Paris. La paix revenue, Blanche de Castille fit
construire à Étampes un monastère et une église pour des Pères cordeliers. Les
huguenots devaient incendier ces bâtiments en 1567, ainsi que les archives
de la communauté, ce qui fit disparaître toutes les chartes de cette fondation.
Elle fut rétablie par Henri III |17 et détruite encore à la Révolution,
mais le souvenir du moins en subsiste dans le nom actuel de la rue, où s’élevait
sans doute le couvent du XIIIe siècle.
Par la mort de la reine Blanche, la seigneurie d’Étampes
avait fait retour à la couronne comme il se devait et elle fut donnée en 1272
à la veuve de Saint Louis, Marguerite de Provence, également en échange de
son douaire, au comté du Mans, qui lui avait été repris pour accroître l’
apanage de Charles d’ Anjou, le frère de Louis IX. Cette donation n’était
faite qu’à la reine et s’éteignit avec elle. Celle que le roi Philippe le
Bel accorde en 1307 à son frère Louis d’Évreux est plus large elle ne représente pas
un simple échange et il reçoit la châtellenie d’Étampes pour lui et ses enfants
mâles et légitimes, ce qui en fait un apanage. Une curieuse peinture murale,
malheureusement très altérée, dont on voit encore les vestiges dans un grenier
du palais de justice, l’ancien palais du Séjour, parait bien représenter
la cérémonie de cette donation du roi Philippe IV à son frère, au dé but
du XIVe siècle. Le nouveau seigneur d’Étampes se signala par la
vente qu’il consentit en 1309 aux habitants d’Étampes et de Brières, moyennant
2.000 livres tournois, d’une « belle garenne » qui s’étendait alors sur toute
la plaine des Sablons, jusque près de la ville et du château. Le gibier abondait
dans cette chasse gardée, cette « garenne jurée » comme on disait alors,
et causait de si grands dégâts aux cultures voisines que Louis d’Évreux céda
aux plaintes de ses sujets. C’est donc à cette époque que dut commencer le
défrichement des bois de la vallée d’Étampes.
À la mort de Louis, son fils aîné recevant le comté
d’Évreux, Étampes fut attribué au cadet, Charles, de par la volonté de son père.
C’est pour lui que le roi Charles IV le Bel, son cousin, érigea en 1327 la
baronnie d’Étampes en comté, « nom plus élégant », dit le titre d’ érection,
conservé aux Archives nationales, « et que justifient le charme du lieu,
l’abondance et la richesse de ses fruits ». En dépit de ces agréments reconnus
à notre ville, les premiers comtes d’Étampes, Charles et son fils Louis II,
n’y ont pas laissé de grands souvenirs de leur passage. Ils semblent lui
avoir préféré le séjour de Dourdan, si l’on s’en réfère du moins au témoignage,
peut-être partial, du vieil historien de Dourdan, Delescornay. En tout cas,
aucun monument ne fut élevé par leurs soins, mais la guerre apportait alors
ses ravages qu’il fallait d’abord réparer. En 1367, des troupes anglaises
parties de Troyes, sous la conduite du prince de Galles, étaient venues jusqu’à
Étampes et Étréchy, dévastant tout sur leur passage. D’autres, en 1370, refoulées
des abords de Paris, prirent Étampes, la saccagèrent, et poursuivirent leurs destructions
à travers toute la Beauce et jusqu’en Anjou. L’église Sainte-Croix avait
été pillée, un grand nombre des habitants ruinés, la collégiale de Notre-Dame,
qui possédait de nombreux biens dans les pays d’alentour, si appauvrie, |18
qu’une partie de
ses chanoines et de ses clercs étaient réduits à
la mendicité. Pour compenser ces ruines, Louis II, comte d’Étampes fit une importante
donation de fiefs et de rentes à l’église Notre- Dame, à condition « qu’il
sera chanté tous les jours à perpétuité, avant le soleil levé ou environ,
une messe à notes et plainchant », qui fut appelée la Messe au Comte. D’autre part, il fit remise aux habitants de la paroisse
Saint-Gilles, contre une rente annuelle de dix livres parisis, d’une charge
singulière et fort onéreuse qu’ils supportaient depuis plus de deux siècles,
celle de fournir aux rois, puis, aux comtes d’Étampes, lorsqu’ils séjournaient
dans la ville, tout le linge, « tant pour lits comme pour table », et toute
la vaisselle nécessaires pour eux et leur suite.
Le troisième comte d’Étampes fut Jean, duc de Berry
et d’ Auvergne, le frère de Charles V, qui dut ce titre à une grâce spéciale
du roi, car Louis II n’ayant pas d’enfants mâles, le comté d’Étampes eût
dû revenir à la couronne, suivant les stipulations ordinaires des apanages.
Déjà Louis II l’avait irrégulièrement cédé, avec réserve de jouissance sa
vie durant, à Louis d’Anjou, le second fils du roi Jean, mais Louis d’Anjou
étant mort avant son donateur, ses enfants transportèrent la donation du
comté d’Étampes à leur oncle, Jean de Berry, qui sut obtenir l’assentiment
du roi Charles VI, en 1384.1
Si le duc Jean était un homme habile, il fut aussi
une puissante personnalité et un prince magnifique. Comme son frère Charles V,
qui le premier des rois de France ne combattait pas lui-même à la tête de
ses armées, il n’aimait pas la guerre, en un temps où ses pairs ne concevaient
guère d’autre idéal de leur activité. Instruit, curieux de tout, collectionneur
passionné de beaux manuscrits à peintures, d’objets d’art et d’orfèvrerie,
de bijoux, de curiosités de toutes sortes, ce dilettante préférait à la politique
et aux chocs des armes les loisirs qu’il goûtait
dans ses douze châteaux, en compagnie des artistes et des lettrés. Il lui
fallut cependant choisir entre les factions qui déchiraient la France. Armagnacs
et Bourguignons se disputaient sa faveur et il inclinait tantôt pour les
uns, tantôt pour les autres. Le résultat inévitable de cette sceptique modération
fut de le rendre suspect à tous et de le faire rejeter des deux camps. Appauvri
par ses libéralités et ses dépenses de collectionneur, malgré les sommes énormes
qu’il extorquait de ses provinces, il mourut endetté et maudit d’une partie
de ses sujets. Mais sa mémoire est chère à bien des amateurs d’ art pour
ce qui demeure encore de tout ce que ses goûts raffinés ont suscité, dans
les ordres les plus divers. Si ses innombrables bijoux et ses précieuses
vaisselles ont disparu, il nous reste les beaux monuments de Bourges et d’Auvergne,
dus aux grands architectes qu’il protégeait, les somptueux manuscrits à peintures,
comme son Livre d’Heures, et d’autres œuvres moins connues : la Vierge charmante,
en pierre blanche du |19 Berry, qui sourit au seuil de la sombre
église de Riom ; dans notre région, une autre statue de Vierge, donnée par
lui aux célestins de Marcoussis, d’un admirable réalisme, qui en fait un
des plus intéressants spécimens de la sculpture française du XIVe
siècle. Et nul Étampois ne devrait ignorer le nom de Jean duc de Berry, puisque
c’est à lui que nous devons la grosse cloche de Notre-Dame, dont la voix
si grave et si pure résonne, bien au-delà de la ville, chaque jour, depuis
l’an 1401.
On aurait cependant une idée incomplète de notre
comte d’Étampes si l’on ne voyait en lui que cette captivante figure de mécène
pacifique. Il offrait d’ étranges contrastes : despote et cupide autant que
libéral et généreux, il était dénué de tout scrupule pour satisfaire ses
désirs ou même des fantaisies parfois bizarres. C’est ainsi qu’il utilisa
le donjon d’Étampes pour y séquestrer une fillette de huit ans, Gillette
la Mercière, qu’il avait résolu de marier, malgré son jeune âge et l’opposition
légitime de ses parents, à un peintre allemand qui « besoignait » pour lui. Furieux
de la résistance qu’il rencontrait, il fit enlever la malheureuse enfant
et la retint prisonnière pendant près d’un an. Le Parlement et le Conseil
du Roi furent saisis et le duc ne céda qu’après maintes interventions.2
Le comté d’Étampes devait revenir à la couronne,
si Jean de Berry mourait sans enfants mâles, selon l’engagement qu’il avait pris
et qu’il avait fait largement payer, d’ailleurs, au roi, par des dons à ses
filles. Mais abusant de la faiblesse de Charles VI, le duc, n’ayant pas de
fils, obtint encore la grâce de disposer de son comté, ce qu’il fit dès 1387,
en faveur de son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Cette nouvelle
dérogation aux prudentes règles des apanages eut, contrairement à la précédente, de
funestes conséquences elle allait faire le malheur de notre région pendant
près d’un siècle. Entre les mains des ducs de Bourgogne, elle devait, en
effet, être entraînée dans la guerre sans merci que ces princes puissants,
ambitieux et âpres menèrent alors contre la couronne. Bien plus, elle eut
le triste privilège d’être un enjeu de ces luttes ni les rois, ni les ducs
ne voulaient y renoncer, marquant ainsi l’importance qu’ils attachaient à
sa possession. Mais déjà ravagée par la guerre de Cent ans, elle sortira
ruinée des guerres civiles. Philippe de Bourgogne mourut avant son donateur,
Jean de Berry. Si l’usufruit du comté d’Étampes demeurait à ce dernier, la
nue- propriété passait au fils aîné de Philippe, Jean, dit Jean sans Peur.
À ce moment, la démence du roi Charles VI laissait libre cours à toutes les rivalités
qui s’agitaient autour de lui. Jean sans Peur, pris de haine contre le duc
d’Orléans, frère du roi, le fit assassiner dans la rue Barbette, à Paris.
Indigné de ce crime, le duc de Berry révoqua sa donation du comté d’Étampes,
et prit enfin le parti des Armagnacs, formé autour de Charles d’Orléans,
le charmant poète, fils de la victime de Jean sans Peur, qui |20
avait épousé la fille du comte d’Armagnac. Une véritable guerre commença.
Les Armagnacs ayant rassemblé dans Étampes et la région des troupes qui s’avançaient
jusqu’à Paris et désolaient le pays, Jean sans Peur, que soutenait le pauvre
roi, vint mettre le siège devant Étampes en 1411, avec le dauphin Louis,
duc de Guyenne. Dès la première sommation, les Étampois, peu belliqueux,
ouvrirent les portes et implorèrent la clémence du dauphin et de ses alliés pour
éviter le pillage, qui d’ ailleurs n’ en eut pas moins lieu. La garnison
d’Étampes était commandée par un gentilhomme d’Auvergne, fidèle serviteur
du duc de Berry, Louis de Bosredon. Plus vaillant que les habitants de la
ville, il s’enferma dans le château avec ses troupes, s’y fortifia et soutint
une résistance désespérée, comme il l’avait promis à son prince. Les entrées
du château ayant été forcées, une tour écroulée par le choc d’énormes pierres
que lançaient les assaillants, il dut se retirer dans le donjon — la tour
de Guinette — où il tint encore plusieurs jours. Les historiens de l’époque
rapportent que les dames de la ville s’y étaient réfugiées et, du haut des
murs, pour narguer les assiégeants, tendaient leurs tabliers vers les pierres
projetées par les machines, qui ne réussissaient pas à les atteindre. Bosredon ne
capitula que sous la menace de la sape et de l’incendie. Sa bravoure lui
valut au moins la grâce du dauphin : il fut emmené prisonnier à Paris, avec
quelques chefs de la ligue des Armagnacs, tandis que d’autres étaient mis
à mort. L’héroïque défenseur du château d’Étampes n’en eut pas moins une
fin lamentable. Après la mort de Jean de Berry, il changea de camp, puisqu’on
le retrouve en 1416 dans l’entourage de la reine Isabeau de Bavière, commandant
la 4e compagnie de ses gardes du corps. Il fut accusé d’être son
amant, sans doute à tort, la reine étant alors si atteinte par l’âge, l’obésité
et la goutte qu’elle ne se déplaçait plus qu’en chaise roulante. Mais il
n’en était pas de même de ses dames d’honneur, dont les mœurs étaient fort dissolues.
Toujours est-il que les Armagnacs et le nouveau dauphin Charles, acquis à
leur parti, voulaient faire exiler la reine favorable aux Bourguignons et
pour cela faire disparaître d’abord son vigilant défenseur Bosredon. Ils
dénoncèrent au roi ses mœurs scandaleuses, en l’accusant d’être l’amant de
la reine. Bosredon fut arrêté, mis à la torture, enfermé à Montlhéry et finalement
jeté dans la Seine, pendant la nuit, en un sac de cuir sur lequel on avait
écrit : « Laissez passer la justice du roi ». Nous avons du siège de 1411
un très modeste, mais curieux témoignage, au musée d’Étampes. Il s’agit d’une
vervelle, petit écusson de bronze qu’on fixait au collier des chiens pour
indiquer leur maître : elle porte les armes des Mailly : d’or à trois maillets de gueules, avec une brisure de la branche des Mailly-l’Orsignol, et
fut découverte au pied de la tour de Guinette en 1897. Or un membre de cette
famille, Robert de Mailly, seigneur de l’Orsignol, était précisément |21
chambellan de Jean sans Peur à l’époque du siège d’Étampes. Il est donc probable
qu’il y prit part et c’est ainsi qu’un de ses chiens dut perdre sa vervelle
sous les murs de la forteresse.
Le duc Jean de Berry mourut en 1415 et son comté
d’Étampes, bien qu’il en eût révoqué la donation à son neveu Jean sans Peur, fut
revendiqué par ce prince. Mais il n’ avait plus pour lui l’ appui du dauphin
Louis, son gendre, mort dès l’année 1415, et le nouveau dauphin, le futur
Charles VII, appartenait, nous l’ avons vu, au parti des Armagnacs. Le résultat
de ces funestes guerres intérieures qui renaissaient constamment, malgré
des conventions que nul ne respectait, fut que notre malheureuse ville fut
encore assiégée et prise en 1417. Ainsi, en moins de six ans, elle avait
subi deux sièges et pour comble de désordre, le premier avait été soutenu
contre le fils aîné du roi et le second, au contraire, en faveur d’ un autre
fils du roi. Et ce ne fut pas la fin des vicissitudes du comté d’Étampes
: pendant plus de cinquante ans, les ducs de Bourgogne le revendiqueront
obstinément, tantôt par les armes, tantôt au cours de conférences qui exaspéraient
le différend, tantôt, enfin, devant le Parlement.
Le roi, bien faible en face de ces puissants adversaires,
essayait de maintenir les droits de la couronne en donnant le comté d’Étampes
à des vassaux fidèles, comme Richard de Bretagne, qui avait sauvé la dauphine
à l’entrée des Anglais à Paris en 1421, en confirmant ensuite à sa veuve,
puis à son fils, cette donation qui demeurait fictive, puisque les donataires
mouraient sans avoir pu prendre possession de son objet3.
Enfin, dans les dernières années du règne de Louis
XI, en 1478, un arrêt du Parlement rendait le comté à la couronne, comme
il était juste et comme il aurait dû en être dès 1400 à la mort de Louis
II, qui était sans enfants. François de Bretagne et même le duc de Bourgogne,
Jean, comte de Nevers, s’inclinèrent : Charles le Téméraire était mort et
Louis XI était puissant.
Le fait le plus mémorable de cette longue période
de troubles fut le séjour que fit à Étampes, en 1465, Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne, et ses alliés, après avoir livré contre Louis XI la bataille
de Montlhéry. Ils venaient y rafraîchir leurs troupes, qui comptaient un
grand nombre de blessés et de malades. Malgré ces circonstances favorables,
le défenseur de la ville, Robinet du Ruth ne s’inspira pas de l’héroïque
exemple de Bosredon en 1411 : il rendit le château sans coup férir. Il est
vrai qu’il n’avait avec lui qu’une faible garnison. Il fut cependant châtié
de sa lâcheté et emprisonné à Bourges. Mais il obtint sa liberté dès 1467
« étant chargé de femme et de plusieurs petits enfants et n’ ayant jamais
été convaincu d’ aucun autre vilain
dans la réédition de 1964
(B. G.).
cas », par une lettre de rémission de Louis XI, petite
preuve de la justice d’un roi fort calomnié.
Les habitants d’Étampes et des villages voisins subirent
la charge d’héberger et de soigner les soldats des ennemis du roi. Beaucoup
|22 moururent, qui appartenaient à l’ armée du duc de Bretagne,
que les intrigues de Charles le Téméraire avaient réussi à détacher du parti
royal. On les enterra au-delà de l’église Saint-Pierre en un lieu qui prit
le nom de cimetière
des Bretons, d’où vint celui de Bretagne au hameau environnant.
Une légende attribue à un Breton de cette armée,
pendant son séjour à Étampes, l’invention des fusées, parce qu’il en avait
jeté, par mégarde, quelques-unes contre le meneau d’une fenêtre où se tenaient
appuyés le duc de Berry et Charles le Téméraire. II est impossible de faire
d’Étampes le berceau de cette découverte, attendu que les fusées, connues
de temps immémorial en Chine, avaient depuis longtemps pénétré en Europe.
|23
L’autorité4 et l’adresse de Louis XI avaient enfin ramené
la paix et l’ordre dans le royaume. Mais il y avait bien des ruines à relever,
en particulier dans notre région. La belle énergie de notre race y sera déployée
avec une telle vigueur que la prospérité ne tardera pas à renaître. Redevenu
libre de disposer du comté d’Étampes, Louis XI en fit don presque aussitôt
à Jean de Foix, comte de Narbonne, qui était digne de cette faveur. Il s’attacha ses
nouveaux sujets en leur accordant un important privilège, qui devait contribuer
au relèvement économique du pays, le droit de port. La navigation existait
depuis longtemps sur quelques rivières d’Étampes et les chevaliers de Saint-Jacques
de l’Épée avaient construit un port, derrière leur commanderie qui occupait l’emplacement
de l’abattoir actuel et dont la rivière, non détournée alors, était toute
proche ; mais il appartenait au commandeur, qui, bien entendu, percevait
des droits élevés. Déjà Louis XI, sur le conseil du prévôt des marchands
de Paris, avait ordonné aux habitants d’Étampes de rendre navigable la rivière d’Étampes,
afin d’assurer par eau le transport des blés de Beauce jusqu’à Paris. De
grands travaux furent entrepris ; on détourna les ruisseaux qui se perdaient
dans les prairies pour les réunir à la rivière d’Étampes qu’on canalisa et
le nouveau port, |24 autorisé par Jean de Foix, fut construit
près des murailles.
Mais de longues années passèrent avant qu’il pût
fonctionner régulièrement, car de nombreuses difficultés surgirent, d’abord l’opposition
du commandeur de Saint-Jacques qui ne voulait pas être dessaisi de ses droits,
puis, les frais considérables d’entretien dus aux risques d’assèchement et
à la nécessité de curages fréquents, surtout en deux points, improprement
appelés alors des gouris, où s’accumulaient des amas détritiques amenés par ruissellement.
Il s’ensuivit des requêtes sans nombre auprès du roi ou devant le Parlement.
Mais ces difficultés vaincues ou au moins aplanies, la navigation connut
un succès grandissant ; elle était lente, certes, le halage ne pouvant guère
se faire qu’à bras d’hommes et les écluses étant nombreuses à cause des moulins, mais
elle était beaucoup plus sûre que la route terrestre, infestée de brigands.
Ce fut pour notre ville, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, un précieux
élément de vie et de richesse. Il n’en reste aujourd’hui qu’un nom, celui
du beau mail ombragé qui occupe l’emplacement du port du XVIe
siècle.
Les marchés d’Étampes augmentèrent d’importance avec
la création du port. Pendant la guerre de Cent Ans, le marché Saint-Gilles
avait été transféré place Notre-Dame pour des raisons de sécurité, l’église
Notre-Dame ayant été en partie entourée de fossés. La paix revenue, les habitants
du quartier Saint-Gilles soucieux de retrouver les avantages de leur marché,
obtinrent du roi en 1478 qu’il fût tenu de nouveau place Saint-Gilles et
bientôt après, un arrêt du Parlement interdisait aux habitants des quartiers
Notre-Dame et Saint-Basile d’acheter ou de vendre du blé, du vin, des draps,
du bétail, en dehors du jeudi place Saint-Gilles. Ces restrictions soulevèrent
de vives protestations, des ventes s’organisèrent place Notre-Dame malgré
l’arrêt, un huissier envoyé par le Parlement, pour en assurer l’exécution,
fut battu, blessé « d’une plaie en la teste et lui fut osté un anneau d’or
» et des procès furent entamés, dont nous ignorons l’issue. Une transaction
dut intervenir, puisqu’au XVIe siècle, on sait qu’il se tenait
deux marchés par semaine, le samedi, place Notre-Dame, pour « les menues
victuailles, beurre, œufs, fromages, fruits et autres choses », le jeudi,
place Saint-Gilles, pour le blé, le vin et le bétail. Ce dernier marché fut
reporté un peu plus tard au samedi, sans doute parce que les bateaux du port
d’Étampes partaient ce jour-là, pour arriver à Paris le mercredi, et ainsi
le blé, comme les autres marchandises, pouvait être embarqué aussitôt. On
voit que la répartition actuelle de nos marchés est restée sensiblement la
même.
C’est également Jean de Foix qui permit aux boulangers
d’Étampes ainsi qu’aux « brenassiers », c’est-à-dire ceux qui fabriquaient
du pain de son ou de « bren », d’avoir chez eux « des fours pour cuire le
petit pain et d’ autres pour cuire le gros », moyennant une taxe |25
annuelle de 6 sols parisis, alors qu’auparavant ils étaient obligés d’aller
cuire au four banal.
Jean de Foix mourut à Étampes en 1500, après avoir
combattu en Italie avec Charles VIII et Louis XII, et fut enterré en grande pompe
dans le chœur de l’église Notre-Dame.

02. Une plaque de ceinturon mérovingienne
«
La découverte dont nous venons entretenir la Commission,
n’est pas récente : elle remonte à 1908 et a été signalée dans le Bulletin
de la Commission5
6. Mais il n’a pas
été publié de figure de l’objet et nous avons pensé qu’il était de quelque
intérêt de la faire connaître, tant à cause de son lieu d’origine que de
la beauté de sa décoration.
Cette plaque a été découverte au mois d’octobre 1908
par un terrassier, qui travaillait dans un champ de la ferme des Carneaux,
à Boigneville7,
appartenant à M. Citron. Elle se trouvait au niveau de la ceinture sur un
squelette qui gisait dans un sarcophage de pierre tendre ; aucun autre objet
n’a été signalé dans cette sépulture. La plaque fut donnée par M. Citron
au cimetière de Pithiviers (n°1614). C’est là que nous l’avons fait dessiner
pour notre Bulletin.
Il s’agit d’une agraphe de ceinture complète, avec
plaque, contre-plaque, boucle et ardillon, le tout en bronze, damasquiné d’or.
La figure nous dispense d’une description ; on remarquera la belle conservation
de la pièce et l’élégance des entrelacs, empruntés au style byzantin dont
s’inspiraient, on le sait, les orfèvres mérovingiens. On connaît un grand
nombre d’objets de ce genre à cette époque8, mais peu d’entre eux présentent un dessin
aussi |126 harmonieux ; nous en rapprocherons deux plaques de
la collection Caranda très voisines de la nôtre9 10.
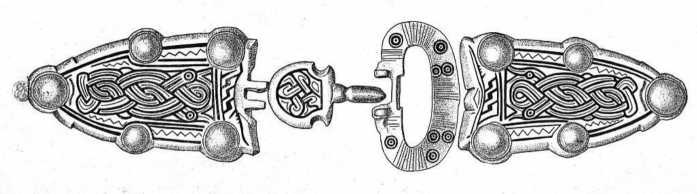
Boucle de ceinture mérovingienne
découverte à Boigneville Musée de Pithiviers11
Il peut s’agir ici d’une plaque de ceinturon ayant
appartenu à une femme, car ces plaques sont souvent décorées avec plus de richesse
que celles des hommes et elles n’en diffèrent point par leurs dimensions11. Mais nous n’en
avons pas de preuve, puisque la tombe ne contenait pas d’ autre objet mobilier.
Si les ossements avaient été conservés par le terrassier qui découvrit la
sépulture, leur examen eût permis de découvrir le sexe du sujet.
Les découvertes mérovingiennes sont rares dans la
région d’Étampes, où nous ne connaissons pas de plaque comparable à celle
de Boigneville. Aussi croyons-nous que cet objet méritait une figure, malgré
l’ opinion de notre collègue qui signala la découverte en 191212 et qui estimait
que la décoration de cette plaque « était tout à fait commune à l’époque
mérovingienne ».
Cte de Poilloüe de Saint-Périer.

Lectionnaire de Luxeuil (AN, manuscrit latin 9427,
folio 24)
03. Une découverte dans
le passé de Morigny 4
Par le comte de Saint-Périer
Le 1er mars 1948, nous recevions du Conservateur
des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, M. Masai, une lettre
bien curieuse, intéressant grandement à la fois notre amour-propre d’Étampois
et notre désir toujours renouvelé de mieux connaître tout ce qui concerne
notre histoire locale. En effet, ce savant belge, que nous n’avions pas l’honneur
de connaître, ne nous disait-il pas « qu’il nourrissait l’espoir de restituer
à un monastère de notre ville ou de notre région un véritable joyau, un des
manuscrits les plus célèbres du haut moyen-âge ». Il y avait certes là de
quoi nous émouvoir et piquer notre curiosité. Aussi je m’ empressai de fournir
à M. Masai tous les renseignements dont je pouvais disposer pour l’aider
à découvrir la vérité.
Il s’agissait d’un Lectionnaire, c’est-à-dire d’un
recueil contenant les différentes « leçons » de l’office qui se dit à matines
dans les monastères, plus un certain nombre de messes. Ce lectionnaire a
été écrit au VIIe siècle, luxueusement décoré et enluminé. Il
appartint longtemps à l’importante abbaye de Luxeuil, dans la Haute-Saône,
et il est aujourd’hui conservé à la 13
Bibliothèque nationale à Paris (Manuscrits latins,
n°9724). Parmi les manuscrits de cette haute époque, il est particulièrement admiré
et connu des spécialistes, non seulement du fait de sa beauté, mais encore
parce que sa calligraphie el sa décoration ont inspiré tout un groupe de
manuscrits du VIIe et du VIIIe siècles. Or notre savant
correspondant, après de patientes recherches et un examen très approfondi
du manuscrit en question, eut des raisons de penser qu’il n’avait pas été
composé pour l’abbaye de Luxeuil, comme le veut la tradition. D’après les
saints qui sont honorés dans ce lectionnaire, la nature particulière des
offices, le caractère de la liturgie, il a dû être exécuté pour un monastère
de femmes situé dans la région parisienne, objet de faveurs princières, étant
donné le luxe des enluminures, monastère dont l’église était dédiée à Saint
Julien d’Antioche, martyr du IVe siècle, et qui contenait sans
doute des reliques insignes de ce saint, puisque, au jour de sa fête, on
célébrait une vigile solennelle (veille de toute la nuit).
Ainsi M. Masai fut amené à nous demander si ce monastère
de femmes dont il recherchait l’existence au VIIe siècle n’avait
pas appartenu à notre région. Par bonheur, nous fûmes en mesure de lui donner
des éclaircissements propres à confirmer ses ingénieuses déductions.
En effet, la chronique de notre abbaye de Morigny,
rédigée entre 1095 et 1152, mentionne expressément qu’il existait « anciennement
» à Morigny, près de la Tour de Brunehaut, une petite abbaye de religieuses
dont il ne restait, à l’époque où écrivent nos moines, qu’une chapelle dédiée
précisément à Saint Julien d’Antioche. En outre, dom Basile Fleureau, notre
historien d’Étampes, nous apporte des renseignements au moins aussi satisfaisants
puisqu’il nous apprend qu’en 1648, c’est-à-dire de son vivant même, ce qui
prouve qu’il ne s’agit pas d’une tradition contestable, des reliques de Saint
Julien d’Antioche furent découvertes dans cette chapelle, à l’occasion de
travaux exécutés au maître-autel : elles étaient enfermées dans un coffret
de plomb, qui ne fut ouvert qu’en présence du curé de Notre-Dame d’Étampes,
assisté du curé de Saint-Basile et « d’autres personnes de toutes conditions
». On trouva dans le coffre « la partie postérieure d’un crâne, un os de
bras en trois pièces, une vertèbre, de la poudre d’os et une pièce antique
», sur laquelle était gravée une inscription qui authentifiait les reliques
: « Hic jacet caput
S. Juliani martiris, quod Severius attulit de Antiochia civitate, temporibus
Brunegildis reginæ » (Ici repose la tête de Saint
Julien martyr, que Severinus apporta de la ville d’Antioche, au temps de
la reine Brunehaut). Ces reliques furent transportées dans l’abbaye |99
de Morigny et déposées « avec beaucoup d’honneur et de vénération dans la
sacristie où elles ont été depuis toujours gardées », nous dit notre bon
Fleureau. Il n’en reste plus trace aujourd’hui. L’archevêché de Sens, dont dépendait
l’abbaye, n’en possède aucune mention dans ses archives. Sans doute ont-elles
subi le sort des reliques conservées à Notre-Dame d’Étampes, qui furent brûlées
à la Révolution devant la porte de l’église, ce dont il reste un procès-verbal,
ainsi que nous l’a appris dans une de nos séances notre éminent collègue,
M. le Chanoine Guibourgé.
Heureusement, le texte de Fleureau ne permet pas
de conserver le moindre doute sur l’existence de ces reliques. Ainsi, toutes
les hypothèses de M. Masai se sont vérifiées une à une, avec une frappante
exactitude.
Il en a conclu que le luxueux manuscrit connu sous
le nom de Lectionnaire
de Luxeuil devrait bien plus opportunément s’appeler
le Lectionnaire de
Morigny. Cette savante étude a fait l’objet d’une
publication de M. Masai dans une revue spéciale14.
Si ce manuscrit fut écrit et décoré pour le monastère
de religieuses établi à Morigny au VII^ siècle, il ne dut pas être exécuté
à Morigny même. On ne possède pas d’indication sur son lieu d’origine, mais
les caractères de son écriture (minuscule des diplômes mérovingiens) donnent
à penser qu’il a pu être fait par les scribes de la chancellerie des princes
mérovingiens.
D’autre part, nous restons dans l’ignorance des raisons
de son transfert de Morigny jusqu’à Luxeuil. Mais on sait que dès cette haute
époque, les échanges entre monastères, même fort éloignés les uns des autres,
étaient fréquents.
Nous avons cru devoir informer « Les Amis d’Étampes
» des recherches si ingénieuses poursuivies par M. Masai parce qu’elles ont
abouti à un résultat qui jette un nouveau lustre sur notre région. Nous savons
maintenant que l’un des plus beaux manuscrits mérovingiens de la Bibliothèque
nationale a été exécuté pour des religieuses de chez nous, il y a treize
siècles.
04. Découverte d’un fond de
cabane ancien à Morigny 6
L’ exploitation du gravier, dans un champ à Morigny,
au lieu-dit « Saint-Germain », en face du cimetière de la commune, a mis
à jour récemment un fond de cabane qu’il me paraît intéressant de signaler.
Rappelons d’abord la constitution du sol en ce point.
L’ extraction du gravier a produit une coupe qui permet de reconnaître :
une couche de terre végétale d’environ 0m 60 d’épaisseur, au-dessous
de laquelle s’étend une couche d’alluvions anciennes de la Juine, composée
de graviers, de galets siliceux roulés et de fragments rocheux divers de dimensions
inégales. Tous ces éléments mélangés et disposés en lits ou strates, forment une couche très reconnaissable à sa couleur grise
ou rougeâtre par endroits, qui mesure 2 mètres à 3 mètres d’épaisseur. Au-dessous,
on trouve les sables de Fontainebleau qui affleurent en un point seulement
de la coupe.
C’est à la partie supérieure des alluvions qu’est
creusée la cavité qui nous intéresse. Mesurant un mètre environ de hauteur sur
1 m 50 environ de diamètre, cette cavité circulaire était emplie, lors de
la première visite, par une terre noire, mélangée de charbons et de cendres,
humus riche en débris organiques. La 15 coupe du banc de graviers l’ avait ouverte
latéralement et sa partie supérieure était comblée par la terre végétale
du champ. On voyait qu’elle avait été évidée dans les alluvions et remplie
peu à peu par des débris et des restes de foyers, puis que la terre, remuée
par les labours, avait fini par remplir entièrement son ouverture, ne laissant
plus de traces de dépression à la surface du sol.
Les fouilles de cette poche, ainsi ouverte par la
carrière, était facile. Elle m’a permis de recueillir un grand nombre de fragments
de poterie, tessons et bords de vases brisés, qui gisaient épars dans la
terre noire de la cavité. Aucun de ces vases n’a pu être reconstitué; ils
avaient été brisés avant leur dépôt dans la dépression creusée dans les graviers.
Cette poterie, faite au tour, bien cuite, d’une pâte assez fine et peu épaisse
est grise, noire ou jaunâtre suivant les fragments. Quelques tessons montrent
des traces de décoration, consistant en lignes rouges ou noires qui s’entrecroisent
pour former des carrés, en manière de damiers. Quelques ouvertures de vases
montrent une moulure circulaire faite au tour et un goulot rappelle la forme
des pégaus, vases communs dans les sépultures anciennes du midi de la France.
J’ai recueilli, mélangés à ces poteries, des os provenant
de débris de cuisine : un canon et une dent de chèvre, un os de lapin de
garenne, des côtes d’ animaux indéterminables à cause de leur fragmentation
et plusieurs os de poules.
Enfin, une pointe de lance en fer et un anneau de
fer brisé complètent le contenu de la cavité.
Tous ces objets étaient disposés, sans ordre, au
milieu des traces de foyers (cendres et charbons) et de l’humus noir qui comblait
la dépression. Sur les bords de celle-ci, une rangée de pierres étagées,
posées à sec, sans traces de ciment, limitait l’emplacement de la poche.
Que signifie cette trouvaille et à quelle époque
faut-il rapporter les objets découverts dans cette cavité ? Je crois que
nous avons affaire à un fond de cabane,
ainsi que l’on nomme ces restes d’habitations anciennes dont la partie supérieure
a disparu et dont les fouilles ne permettent de retrouver que les parties
profondes. Il est probable, étant donné l’exiguïté même de la cavité, qu’il s’agit
seulement du foyer du fond de cabane, dont les autres vestiges ont disparu,
entraînés par les eaux de pluie et mélangés à la terre du champ par la culture.
Le foyer seul a été respecté, à cause de sa profondeur, qui le mettait à
l’abri du soc des charrues. Sans doute, autour de la dépression creusée au
centre de l’ habitation, les hommes qui avaient édifié cette hutte ou cabane se
réunissaient auprès du foyer, qui se remplissait peu à peu des débris de
leurs poteries et des os de leurs repas.
Mais quels étaient ces hommes ? Il est plus difficile
de répondre à cette question. Tous les archéologues savent combien la poterie fournit
peu d’indications précises sur la date des niveaux où elle est découverte.
On trouve des poteries grossières à côté de vases aux formes élégantes et
à pâte fine, et cependant ces deux industries sont contemporaines. Bien mieux,
on trouve encore maintenant dans certains pays reculés de France, des poteries modernes
qui rappellent par leur pâte grossière et leurs formes massives les vases
de nos plus anciens potiers de Gaule. En l’absence de tout objet donnant
une date précise (monnaie, par exemple) nous devons cependant nous contenter
de ces tessons pour établir l’âge approximatif de ce fond de cabane.
Cette poterie n’est certainement pas antérieure à
la fin de l’époque gallo-romaine ;
sa cuisson, la solidité de la pâte ne permettant pas de lui attribuer une
date plus ancienne. Mais sa décoration peinte peut nous faire penser qu’elle
est même plus récente. C’est, en effet, cette peinture des poteries qui a
précédé l’émail, que l’on voit apparaître au XIIe siècle. Sans
doute, la cuisson des vases peints ayant vitrifié quelques peintures de ces vases,
on eut l’idée de rechercher les enduits les plus propres à fondre au feu,
afin d’ obtenir cette glaçure que donne l’ émail.
Nos tessons n’ayant aucune trace d’émaillage, nous
les croyons antérieurs au XIIe siècle et sans pouvoir préciser
davantage, nous les attribuons aux époques carolingienne ou du haut moyen-âge. Le
fer de lance ne peut nous fournir aucun moyen de contrôle, sa forme n’ayant,
isolément, rien de caractéristique.
Il s’agit donc, en résumé, d’un foyer de fond de
cabane postérieur à l’époque gallo-romaine. Si modeste que soit cette découverte,
il m’a paru cependant intéressant d’en conserver le souvenir, en la signalant
à l’attention des lecteurs de l’Abeille d’Étampes.
R. de Saint-Périer.

05. Le jugement dernier du
portail de Saint-Basile 7
par le comte de Saint-Périer
On sait que la fondation de l’église de Saint-Basile,
ainsi que celle de Notre-Dame, remontent au roi Robert le Pieux, c’est-à-dire
au début du XIe siècle. Mais l’édifice qui nous a été conservé est
postérieur et ne peut être daté dans ses parties les plus anciennes antérieurement
au milieu du XIIe siècle. C’est à cette époque qu’il faut attribuer
le grand portail en plein cintre, orné de chevrons et d’une décoration dans
les voussures que nous allons examiner. Ce portail, qui montre une influence bourguignonne,
peut être comparé sans trop de désavantage au portail de Saint-Lazare d’Avallon,
avec lequel il présente quoique avec moins de richesse, beaucoup d’analogies.
Il a subi malheureusement trop de restaurations modernes.
La deuxième voussure montre un Jugement dernier :
au centre, la balance symbolise le pèsement des âmes, sujet emprunté à l’Égypte
ancienne où il fut représenté durant des millénaires et qui parvint à l’
Occident chrétien par la Méditerranée méridionale. Un des plateaux, sur lequel
un petit ange assis représente l’âme des élus, s’incline sous la pression
d’un autre ange, tandis qu’un démon s’efforce de faire basculer l’autre 16 plateau de son
côté. De part et d’autre de la balance, deux scènes représentent, l’une les
élus assis à une table, les bras levés vers le Ciel et la face extasiée,
l’ autre, les damnés piétinés par des monstres inspirés de l’Apocalypse.
Ces figurations du jugement dernier n’apparaissent
guère sur les tympans ou les voussures des portails avant le XIIe
siècle. Avant cette époque il était interdit de représenter la figure humaine
en ronde-bosse ou en haut-relief, afin d’éviter un rappel de l’idolâtrie
du paganisme, symbolisé par la statuaire, que l’Église avait peut-être lieu
de redouter encore. Mais les jugements derniers étaient fréquents dans les
manuscrits à miniatures dès la seconde moitié du XIe siècle. Il
est probable qu’après la grande épouvante de l’an 1000, où chacun craignait la
fin du monde, il y eut un fléchissement de la foi déterminé par la faillite
de cette prophétie. On dut alors rappeler aux fidèles par des figurations
concrètes que, si la vie du monde continuait, chaque individu était |61
soumis après sa mort à un jugement non moins terrible que le jugement collectif
qui eût embrassé le monde entier. On voit alors, c’est-à-dire au milieu du
XIe siècle, les jugements derniers se répéter, à l’abbaye de Beaulieu (Corrèze),
où il paraît être le premier en date, à Moissac, à l’abbaye de Conques, à
Autun, etc..., et plus près de notre région, à l’abbaye de Saint-Denis, où
il a pu être restitué malgré les dégradations qu’il a subies à l’époque révolutionnaire,
à Notre-Dame de Corbeil, église démolie vers 1820, mais dont quelques croquis
nous ont conservé des détails. Au XIIIe siècle, ces jugements
derniers deviennent des scènes beaucoup plus étendues qui occupent toute
la surface des grands tympans des façades, comme à Bourges, ou des portails
latéraux, comme à Chartres, Notre-Dame de Paris, etc. Les scènes comprennent alors
tout l’ appareil du jugement de la fin du monde, avec les anges sonnant la
trompette, la vallée de Josaphat, la cour céleste au sommet, grandes compositions
qui dépassent le cadre modeste des jugements derniers du XIIe
siècle.
Un détail singulier que l’ on observe ici doit retenir
notre attention, car il est fort rare. Dans presque tous les jugements derniers
du XIIe siècle et dans tous ceux du XIIIe et des époques postérieures,
les élus sont placés à droite de la figure centrale, Christ ou archange tenant
la balance, et les damnés à sa gauche. Cette situation est conforme à la
vieille coutume de considérer la droite comme la place d’honneur, sans doute
parce que les droitiers sont beaucoup plus répandus que les gauchers, et qu’ainsi
la main droite est le symbole de la force, de l’adresse, de la réussite.
On sait que la gauche, à l’époque romaine, était considérée comme néfaste
et que c’est de son nom même, sinistra, qu’est
venu notre mot sinistre, qui n’indique pas un événement heureux. Cette place
des élus, d’ailleurs, est conforme aux Écritures : le psalmiste dit : « Sede a dextris meis » « Assieds-toi à ma droite ». Et dans les chapitres 24
et 25 de l’Évangile selon Saint Mathieu, il est dit : « Le Fils de l’homme séparera
les boucs d’avec les brebis. Il placera celles-ci à sa droite et rejettera
les boucs à sa gauche. » Or, à Saint-Basile, les damnés sont placés à droite
du centre, les élus à gauche ; à Saint-Denis également, les réprouvés sont
à droite, c’est-à-dire à gauche du spectateur.
Comment pouvons-nous expliquer cette anomalie ? Il
faut d’abord remarquer que les jugements derniers du XIIe siècle n’ont
pas la rigueur de composition de ceux du XIIIe, que l’artiste y
déploie plus de fantaisie, sinon dans le choix des tortures infligées aux
damnés, du moins dans l’ordonnance générale de la scène. Il est inspiré plutôt
de l’Apocalypse avec ses monstres étranges et son symbolisme compliqué que
de la simple description de la scène du jugement dernier de Saint Mathieu, par
exemple. Il est donc probable que l’autorité ecclésiastique qui surveillait
les travaux des églises et en acceptait la figuration, attachait moins d’importance
à l’exactitude des scènes représentées qu’elle ne le fit à une époque postérieure.
On peut citer le jugement dernier d’Autun qui, à le bien considérer, est
à peine acceptable au point de vue théologique. L’artiste a divisé les morts
comme s’il croyait à une sorte de prédestination en élus et en réprouvés,
au moment même où ils enlèvent la pierre de leur tombeau avant d’être soumis
au jugement ? Il y a là une contradiction entre la pensée religieuse de l’époque
et son expression sculpturale qui n’a pas embarrassé l’artiste et que les chanoines
d’ Autun ont cependant acceptée.
Le sculpteur qui tailla la balance au portail de
Saint-Basile plaça à sa droite à lui l’ange qui représente les élus, c’est-à-dire dans
le plateau gauche de la balance, ce qui entraînait en conséquence la position
respective des élus et des damnés. L’absence, dans la composition, d’ une
figure centrale, le Christ ou l’Archange, a sans doute aussi contribué à
cette interversion. On n’y attacha, semble-t-il, aucune importance, car on
ne peut admettre que le maître ès arts qui dirigeait les travaux ne se soit pas
aperçu de l’ erreur.
Ainsi s’expliquerait, d’après nous, cette disposition
certainement rare et qui constitue un détail assez intéressant de notre vieille
église.
MORIGNY-CHAMPIGNY (S.-et-O.)- - Le Château - Grille
en fer forgé du XIII* siecle
Guillotsaux. éditeur
06. La grille romane de
l’antienne abbaye de Morigny (S.-et-O.)
Mme de Saint-Périer, Secrétaire général
de la Société des Amis d’Étampes
L’abbaye de Morigny fut fondée environ vers les années
10921095, à 3 kilomètres au Nord d’Étampes, par un groupe de moines |87
qui appartenaient à la célèbre communauté bénédictine de Saint-Germer-de-Fly,
dans le Beauvaisis. Ils y construisirent d’abord une grande église, dont
il ne reste qu’une travée intéressante par ses chapiteaux archaïques, puis
un monastère propre à recevoir un nombre considérable de religieux. L’église
fut consacrée en 1119 par le pape Calixte II. La protection et les faveurs
du roi Louis VI assurèrent rapidement la fortune de la nouvelle abbaye, mais
elle se maintint avec peine jusqu’aux guerres de religion. Réédifiée au XIIIe siècle
sur un plan plus vaste encore, qui ne fut pas entièrement réalisé, l’église
tombait partiellement en ruines dès le début du XVe siècle. Elle
fut réduite, au siècle suivant, à un chœur et deux travées qui seuls subsistent
aujourd’hui, avec un beau clocher gothique, qui témoigne d’un grand passé.
C’est à l’époque la plus prospère de l’abbaye, au
XIIe siècle, que remonte une grille en fer forgé qui devait clôturer
soit une 17 partie
du chœur, soit une chapelle de reliques, et qui est restée dans un état de
conservation exceptionnel. Elle fut transportée sans doute à la Révolution,
lors de la vente de l’abbaye comme bien national, dans les dépendances du
monastère. Elle y demeura scellée sous un porche à l’entrée du jardin jusqu’en 1961,
date à laquelle nous en avons fait don au Musée d’Étampes, où nous l’avons
installée sur un fond lumineux. Elle mesure 2 m. 80 de largeur sur 2 m. 50
de hauteur et se compose de brindilles de fer à faible section carrée, 3
millimètres sur 5, présentées de champ, procédé habile parce qu’il en résulte
à la fois plus de légèreté et plus de lumière. La porte est à deux battants,
de quatre petits panneaux chacun, reliés à des montants verticaux par des embrasses
non soudées, mais fermées à chaud. Chaque panneau comprend dix-huit éléments
à peu près semblables, composés chacun de huit volutes, la plupart à trois
tours de spire, et jointes par un collier également rabattu à chaud.
Les dormants latéraux sont d’ exécution moderne ;
ils ont été faits sur le modèle de la porte, probablement lorsque la grille
a été scellée sous le porche. Ils sont d’une régularité absolue, infiniment
moins agréable aux yeux que les variantes légères de la partie ancienne.
Cette grille doit remonter à la .première moitié
du XIIe siècle, par son style, par la simplicité de ses motifs
décoratifs et par sa technique. Cette date se confirme par les comparaisons
avec d’autres clôtures. |88 Il n’en reste qu’un très petit nombre
du XIIe siècle, aucune même dans le Nord de la France, qui soient entières,
à notre connaissance. On y trouve des fragments, dont le décor en volutes
se rattache étroitement à celui de Morigny, à Paris au Musée de Cluny et
au Musée des Arts décoratifs, à Rouen au Musée Le Secq des Tournelles. Mais
au Sud de la Loire, il nous reste dans les églises mêmes plusieurs grilles entières
qui offrent avec la nôtre une analogie frappante. Celle de
Conques, dans l’Aveyron, est la plus connue et la
plus remarquable. Elle occupe, huit intervalles de colonnes et présente çà
et là quelque variété dans ses motifs, mais son élément fondamental est toujours
la volute à trois tours de spire, comme à Morigny. Ce somptueux ensemble
appartient sans doute à une époque moins ancienne que la grille de Morigny,
la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle.
Le cloître de la cathédrale du Puy, le chœur de l’église
Saint-Cerneuf, à Billom (Puy-de-Dôme), la petite église de Saint-Aventin-de-Larboust,
près de Luchon, possèdent également des grilles à volutes du même style.
Hors de France, les grilles du cloître de la cathédrale de Pampelune offrent
une telle analogie avec celle de Conques qu’on peut se demander si elles
ne furent pas l’œuvre du même artiste.
À Jérusalem, la grille posée par les Croisés autour
de la rotonde du Dôme de La Roche, avant 1187, est faite encore de volutes, mais
qui présentent, peut-être sous une influence orientale, une recherche très
marquée.
La grille de Morigny n’a pas ce caractère. Son décor
simple, uniforme, ne montre que les irrégularités propres aux œuvres faites
à la main, que l’artiste n’a pas cru devoir corriger et qui sont loin d’être
sans charme. Par là même et par sa technique également simple, elle est peut-être
une des plus anciennes grilles qui subsistent à peu près dans leur intégrité.
La volute, qui est l’élément essentiel de ces belles
ferronneries du XIIe et du XIIIe siècle, est sans doute
une des premières formes décoratives de la nature dont l’homme ait senti
la beauté et qu’il ait cherché à reproduire. L’on sait, en effet, que la
volute apparaît dans l’art et dans l’industrie des plus anciennes civilisations
et qu’elle a connu une extraordinaire fortune, aussi bien dans l’espace que
dans le temps, puisqu’on la retrouve depuis l’époque paléolithique, sculptée
sur des baguettes en bois de renne, jusqu’à nos |89 jours, dans
la ferronnerie et les décors de pierre de nos églises, dans les bas-reliefs
mayas du Yucatan, dans des sculptures sur bois du Népal, pour n’en citer
qu’un petit nombre.
Ainsi l’ origine de ce motif ornemental se confond
avec l’origine même de l’art et il est apparu sous des formes variées, dans
les milieux les plus divers, soit par diffusion, soit par le hasard des convergences.
Mais c’est peut-être dans la ferronnerie du XIIe siècle qu’il
a trouvé sa plus séduisante expression.
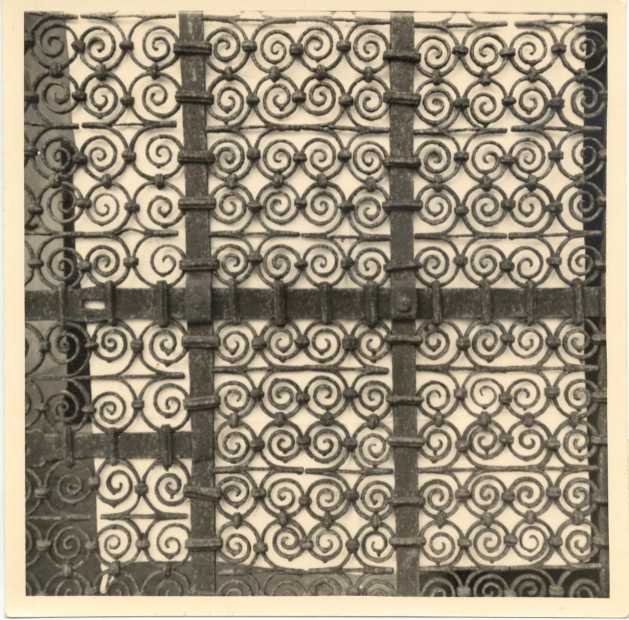
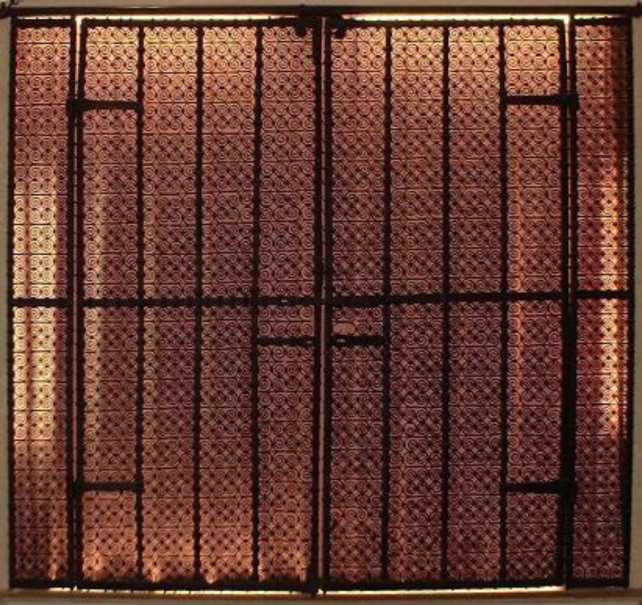
07. une grille romane conservée
au Musée 9
Mes chers collègues,
J’ai d’abord à m’excuser de vous présenter ici, sinon
dans une conférence, au moins dans une simple causerie, un sujet qui paraît
fort étranger à notre Montagne Sainte Geneviève, même si je ne le limite
pas, comme c’est mon propos, à l’étude d’une grille romane d’une petite paroisse
de l’Île de France. Je transgresse ici la règle et l’usage de notre société.
Ce scrupule m’avait certes retenue tout d’abord et fait hésiter devant l’aimable
demande de notre dévouée secrétaire générale, madame Lepotre Oster.
Si je l’ai cependant acceptée, c’est d’abord parce
qu’un certain nombre de nos membres ont fait, il y a deux ans, une excursion à
Étampes et à Morigny, qui leur a permis de voir l’ancienne abbaye et la grille
dont je vais vous entretenir et qu’ainsi je réveillerai pour eux le souvenir
de choses vues au lieu de leur apporter seulement un exposé sec et abstrait.
En outre, il s’agit d’Étampes, Morigny n’en étant
pour ainsi dire qu’un faubourg. Or, vous savez que notre regretté président, monsieur
Nourry18 19, a vécu plusieurs
années dans sa petite ville,
où personne de ceux qui l’ont connu ne l’ont oublié.
Il a beaucoup aimé Étampes, il en a senti le charme et connu tout le grand
passé, puisqu’il était tout ensemble un artiste, un archéologue et un historien.
C’est lui qui a organisé pour vous cette excursion d’Étampes. Il m’a donc
semblé que c’était à la fois répondre au vœu posthume de notre ancien président
et honorer en quelque sorte une mémoire qui nous est chère à tous que d’évoquer
devant vous l’histoire de l’abbaye de Morigny et du seul objet d’art mobilier
qu’elle nous a laissé, qui est aujourd’hui le joyau du musée d’Étampes.
Enfin, le hasard ou peut-être le caractère un peu
spécial de la partie populaire de notre quartier jusqu’à l’époque de Louis
XIV, a fait qu’une expédition criminelle, dirigée contre l’abbaye de Morigny
et qui eut son tragique épilogue à Étampes, a été conçue et décidée au pied
de la Montagne Sainte-Geneviève par douze malandrins rassemblés dans une
auberge de la place Maubert. Ce drame, dont les conséquences furent désastreuses
pour notre abbaye, lui donne un léger lien historique avec notre quartier
et vous permettre, je l’espère, de la considérer comme un peu moins étrangère
à nous. Vous y verrez aussi une preuve nouvelle que le passé de notre quartier
a de si multiples aspects, est si riche d’histoire, d’événements, d’activités
humaines de tous les ordres qu’il se rattache parfois de la manière la plus
imprévue à des faits ou à des hommes de toute la France |3 et
souvent même du monde entier. C’est ce qui fait la grandeur et l’intérêt
passionnant de ce cœur de Paris.
La fondation de l’abbaye de Morigny remonte à la
fin du XIème siècle. Environ les années 1092-1095, dans un lieu-dit
Morigny, qui avait été habité à l’époque gallo-romaine, comme l’indiquent son
nom et quelques découvertes de poteries, de monnaies, de statuettes de bronze,
mais qui n’était au XIème siècle ni une paroisse, ni un hameau,
vint s’établir un groupe de religieux détachés de la célèbre abbaye bénédictine
de Saint Germer de Fly, dans le Beauvaisis. Cette abbaye avait été fondée
par saint Germer au VIIème siècle. Ruinée de fond en comble par
les Normands, elle avait dû se transférer à Beauvais avec le corps de son
fondateur, qui y aurait opéré alors de si nombreux miracles que l’abbaye
retrouva rapidement une prospérité qui lui permit de se réédifier sur les
ruines de son premier emplacement et, plus tard, d’élever une chapelle qui
est un des plus purs et des plus jolis spécimens de l’architecture de la
fin du XIIIème siècle. C’est une réduction de la Sainte-Chapelle
de Paris, que les moines de Saint-Germer n’ont pas craint de prendre pour
prototype.
Dès le XIe siècle, la renommée de cette
abbaye s’était étendue bien au-delà des frontières du Beauvaisis. C’est ainsi
qu’un seigneur de la région d’Étampes, connu seulement sous le nom d’Anseau,
avait été si touché de la sainteté des bénédictins de Saint-Germer qu’il
leur fit don de toutes les terres qu’il possédait près d’Étampes pour qu’une
colonie d’entre eux s’y installât et que l’odeur de leurs vertus se répandît
au loin.
Parmi ces terres d’Anseau, la beauté et la commodité
du lieu de Morigny déterminèrent, paraît-il, le choix des moines et là furent bâtis
en peu de temps une église et un monastère propre à recevoir un nombre considérable
de religieux. Les habitants d’Étampes et des environs y contribuèrent, non
seulement par leurs dons, mais encore, comme c’était l’usage des fidèles
du Moyen-Âge, par leur participation aux travaux et au transport des matériaux.
Cette église devait être sensiblement plus grande
que celle qui nous reste, après bien des remaniements et des réductions, puisque
les quelques fouilles que nous avons pratiquées, dans la mesure où nous le
permettait le maintien des arbres du parc, nous ont donné des traces de fondations
au-delà du chevet actuel.
Cette église fut dédiée à la Sainte Trinité, un des
vocables de l’abbaye-mère, par le pape Calixte II lui-même, le 3 octobre 1119,
en présence du roi Louis VI, dont la protection et les nombreuses faveurs
assurèrent rapidement la fortune de la nouvelle abbaye.
Il ne reste de cette église primitive qu’une travée
|4 de la nef, d’une belle ligne architecturale et fort intéressante
par ses chapiteaux archaïques à têtes humaines et à dents de loup. Les autres
parties de l’édifice furent reconstruites au XIIIème siècle, sans
doute sur un plan plus vaste encore, mais qui ne fut pas entièrement réalisé,
car de nombreuses pierres en attente et des départs de voûtes qui se trouvent
à l’extérieur ne peuvent s’expliquer que s’ils étaient destinés à l’intérieur
d’un transept qui ne fut jamais édifié.
On peut y voir la preuve que la prospérité de l’abbaye
commençait déjà à décliner. Sa grande époque fut le XIIème siècle,
dont un reflet nous demeure sous la forme de la belle grille, qui fut certainement
exécutée dès cette période romane, pour clôturer, soit une partie du chœur,
soit une chapelle de reliques.
Dès le début du XVème siècle, l’église
est dans un état déplorable. Le 23ème abbé, Simon Le Gras, envoie
ses moines dans tout le pays d’alentour présenter les reliques de l’abbaye afin
de recueillir des aumônes. Mais elles durent être bien insuffisantes pour
effectuer les réparations nécessaires, étant donné que les bâtiments tombent
encore en ruines en 1525.
Le 36ème, Jean de Salazar, d’une famille
illustre à l’époque, dispose sans doute par ce fait de ressources plus grandes
et il entreprend enfin des travaux considérables, aussi bien au monastère
qu’à l’église. Il commence la reconstruction du chœur qui est achevée en
1542 par son successeur, l’abbé Hurault, de la famille des Hurault de Vibraye
: l’une des chapelles de notre église porte, à sa clef de voûte, les armes
de cette famille, qui compte aujourd’hui encore de nombreux descendants :
d’azur à la croix d’or accompagnée de quatre ombres de soleil de gueules.
Mais alors que l’abbaye semble se relever de ses
ruines, un autre désastre vient la frapper. Un seigneur des environs, Joachim
du Ruth, prend l’étrange et diabolique résolution de la dépouiller de ses
reliques et de son trésor, ensemble très précieux d’après l’inventaire qui
nous en a été conservé, avec un récit détaillé de l’événement dont je vous
citerai quelques passages, en raison du charme de son style naïf et pittoresque.
Pour exécuter son dessein, ce singulier gentilhomme
s’associe à douze brigands, réunis à cet effet le 6 mai 1557, dans l’hôtellerie
de l’Écu de France, place Maubert, où ils complotent leur crime, moyennant
400 écus que Joachim de Ruth leur promet. Ils partent au galop vers Étampes,
escaladent avec des échelles volées en route les murs de l’abbaye, pénètrent
dans l’église par les fenêtres et s’emparent de tous les reliquaires enrichis
d’émeraudes, de saphirs et autres pierreries, des livres saints couverts
de lames d’argent, « avec de très belles figures », de toute l’orfèvrerie
de la crosse de l’abbé chargée de pierre s précieuses et de maints autres
objets |5 de choix. Après avoir brûlé les ossements sacrés dans
le chœur sur le marchepied de l’autel, ils se retirent sans aucun empêchement
dans la maison de Joachim du Ruth, au hameau de Venant, à dix kilomètres
de Morigny.
Après leur départ, l’alarme est donnée dans l’abbaye
par le moine qui venait sonner matines à l’église. « Il s’écria de toute sa
force et à son cri, tous les religieux se levèrent promptement aussi bien
que l’abbé Hurault qui était couché dans sa chambre au dortoir ». Saisi d’étonnement
et de douleur, ce bon abbé eut cependant une bien heureuse idée dans un accident
aussi fâcheux : « au lieu de célébrer la messe du Saint-Sacrement, comme
il était de coutume le jeudi, il fit chanter celle du Saint-Esprit, qui fit
connaître incontinent les auteurs du sacrilège » car à peine la messe fut-elle
achevée que l’abbé reçut une lettre d’un seigneur voisin de Joachim du Ruth,
Charles de Paviot, un bon et vrai gentilhomme celui-ci, qui avait découvert
les voleurs et le lieu de leur refuge.
Tout ce qu’on put rassembler d’hommes à Morigny et
à Étampes vinrent investir la maison de Venant, où les bandits s’apprêtaient
à faite bonne chère Quatre ou cinq d’entre eux purent s’enfuir, sans doute
avec leur butin, puisqu’il ne fut jamais retrouvé. Les autres, emmenés prisonniers
à Étampes, furent tous condamnés à mort, mais exécutés par diverses formes
de supplices, précise notre récit : Joachim du Ruth et son gendre furent
décapités, leurs corps et leurs têtes jetés au bûcher et réduits en cendre,
huit jours après leur crime ; la justice était alors expéditive ! D’autres
furent roués vifs quelques jours après et d’autres « seulement pendus et
étranglés », faible commutation de peine !
Ces châtiments exemplaires et variés, qui sont intéressants
à noter, ne rendirent pas son trésor à notre malheureuse abbaye et jamais
elle ne se releva de cette épreuve.
L’importance des reliques, et celles de Morigny étaient
insignes, la beauté des reliquaires et des objets du culte étaient une source
de grands profits pour les abbayes Le pauvre abbé Hurault qui mourut peu
après « ces déplaisirs », dit encore notre joli récit, fut le dernier abbé
régulier. L’abbaye, mise après lui en commende, ne fit plus que décliner.
Les procès-verbaux de visites ordonnés par l’archevêque de Sens, dont elle
dépendait, mentionnent un nombre décroissant de moines — qui finissent par
n’être plus que quatre ou cinq dans ce grand monastère — et une misère grandissante.
En 1575, la voûte de la nef s’étant effondrée, on
la répare en opérant une pénible réduction de l’église. C’est alors qu’elle
prit l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui, qui offre au moins, par
la diversité de ses styles selon les époques, une vivante leçon d’archéologie
: un chœur peu profond du XVIème siècle, dont nous avons la date
exacte, 1542, une nef réduite à deux travées, l’une qui est la belle travée
romane du |6 XIème siècle, l’autre du XIIIème,
clôturée par une façade grossière, aussi grossièrement remaniée au XIXème
siècle, mais heureusement dominée par un beau et majestueux clocher du XIIIème
qui s’élève dans le ciel comme un témoin du grand passé de ce modeste village.
En 1743, les religieux sont dispersés, mais un abbé
commendataire est toujours nommé. L’un d’eux, l’abbé Drouas de Boussey, devenu
plus tard évêque de Toul, décide de faire un nouvel usage, plus avantageux,
espère-t-il, de son abbaye. L’habitation des moines était détruite, mais
il restait un très beau jardin, un parc et une maison abbatiale « assez jolie
», nous dit-il. Il l’entoura d’une cour et d’un parterre, fit des aménagements intérieurs,
y mit pour plus de 8.000 livres de beaux meubles et la loua pendant plusieurs
années, à partir de 1755, au marquis de Custine d’abord, puis au marquis
de Villefort, à raison de 100 pistoles, mais il ne fut payé, à sa grande
amertume, qu’une seule fois...
Ainsi, la vénérable abbaye bénédictine était devenue
une manière de « folie », à la mode du XVIIIème siècle. Ce qui explique
l’ingénieuse idée de l’abbé de Boussey, c’est la brillante vie mondaine qu’on
menait alors à Étampes autour du marquis de Valori, qui recevait tant de
monde dans son château du Bourgneuf, à 1500 m. seulement de Morigny, que
la cour, disent les mémorialistes du temps, « en devint inerte. »
Le marquis de Custine et le marquis de Villefort
devaient être des familiers du château du Bourgneuf.
Ainsi s’acheva, dans l’absence des moines et dans
la vie profane, dans la misère et dans les ruines, l’histoire d’une grande abbaye
qui avait eu, aux époques de foi, une importance, une prospérité, une influence
considérables. Dans les conflits très nombreux et très fréquents qui l’opposent,
au XIIème et au XIEème siècles, aux communautés voisines,
aux églises, aux chanoines d’Étampes, elle triomphe toujours auprès du pape,
auprès des rois, auprès de l’archevêque.
Son histoire est fort intéressante à étudier, non
seulement pour l’histoire religieuse de la France, mais encore au point de
vue économique, car l’abbaye de Morigny possédait des terres en Beauce, qui
sont aujourd’hui d’un rapport extrêmement fructueux, mais qui, durant des
siècles, par suite d’une exploitation défectueuse, ne lui permirent pas d’échapper
à la misère.
En 1791, le domaine abbatial fut vendu comme bien
national, mais l’église fut distraite de la vente sur la réclamation des habitants,
afin qu’elle pût devenir l’église paroissiale. Celle-ci existait dans l’ancien
village de Saint-Germain-lès Étampes, plus proche d’Étampes, mais il avait
été peu à peu abandonné à mesure que se constituait une agglomération autour
de l’abbaye, qui seule a subsisté. Il ne demeure |7 du village
primitif que le cimetière, qui entourait l’ancienne église de Saint-Germain, volontairement
détruite à la Révolution. Les maisons ont entièrement disparu. À leur emplacement,
des fouilles superficielles nous ont donné des poteries intéressantes du moyen-âge.
Le nom même de Saint-Germain-lès-Étampes a disparu des mémoires, tant l’oubli
total du passé se fait rapidement.
C’est sans doute à cette époque de la vente de l’abbaye,
ou bien un peu plus tôt, lors des aménagements de la maison abbatiale en «
folie », que la grille installée dans l’église depuis le XIIème siècle
fut transportée dans les dépendances de l’ancien monastère. Nos arrière-grands-parents
qui ont acquis le domaine au milieu du XIXème siècle ont trouvé
la grille scellée sous la voûte de l’entrée du jardin, où elle est demeurée
jusqu’à l’an dernier. Nous l’avons fait transporter au musée d’Étampes, l’ayant
donnée aux Musées Nationaux à la condition qu’elle resterait déposée à Étampes
tant qu’il y existerait un musée. Elle est installée sur un fond lumineux
obtenu par des rampes électriques, ce qui nous a été inspiré par la valeur
que prenait ce beau dessin de ferronnerie lorsque le soleil levant venait
la frapper, sous la voûte où nous l’avons connue durant de si longues années.
C’est une grille du 2 m 50 de hauteur faite de brindilles
de fer à faible section carrée, 5 millimètres sur 5, présentées sur champ, procédé
habile parce qu’il en résulte à la fois plus de légèreté et plus de lumière.
La porte est à deux battants, composés chacun de quatre petits panneaux,
dont la largeur varie entre 0 et 25 cm, reliés à des montants verticaux par
des embrasses non soudées, mais fermées à chaud. Deux traverses les encadrent
et une traverse médiane, malheureusement un peu trop large, est posée à mi-hauteur.
Il n’y a pas de couronnement ; sans doute a-t-il disparu au cours des vicissitudes
de l’abbaye. Chaque panneau comprend dix-huit éléments à peu près semblables,
composés chacun de huit volutes, la plupart à trois tours de spire affrontées deux
à deux, s’enroulant presque toute l’une à l’inverse de l’autre et jointes
par un collier également rabattu à chaud. L’espace vide entre les volutes
forme lui-même une figure décorative, sublosangique, soulignée par les quatre
colliers. Les deux dormants latéraux sont d’exécution moderne ; ils ont été
faits sur le modèle de la porte, probablement lorsque la grille a été scellée sous
la voûte d’entrée du jardin, afin de donner à l’ensemble la largeur nécessaire.
Ils offrent une régularité absolue, infiniment moins agréable aux yeux que
les variantes très légères de la partie ancienne.
Cette grille doit remonter au XIIème siècle
et même à la première moitié du XIIème siècle par son style, par
la simplicité de ses motifs décoratifs et par sa technique.
Ce que nous savons de la prospérité de l’abbaye dès
les premières années qui suivirent sa fondation confirme cette |8 attribution
de date, comme les comparaisons avec d’autres clôtures.
Il n’en reste qu’un très petit nombre du XIIème,
et aucune dans le Nord de la France, qui soit entière, à notre connaissance.
Celle qui existe encore à Saint Germer de Fly est
sensiblement plus récente que celle de Morigny : les volutes qui en sont l’élément
essentiel, sont grandes, peu enroulées, toutes semblables, groupées avec
une parfaite symétrie et surtout terminées à l’extrémité de l’enroulement
par des ornements qui ne pouvaient être qu’étampés. Or, ce procédé de l’étampe,
au moyen d’un moule d’acier, n’apparaît qu’au XIIIème siècle.
Mais l’ancienneté et la prospérité de l’abbaye de Saint Germer nous permettent
de supposer qu’il dut exister avant celle-ci, dès le XIème ou
le XIIème siècle, une grille qui a pu inspirer aux moines de Morigny
le désir d’en avoir une semblable à celle de leur abbaye-mère.
L’abbaye d’Ourscamps, en Normandie, en possédait
un magnifique exemplaire, mais certainement aussi moins ancien que Morigny,
qui est aujourd’hui au musée du Secq des Tournelles à Rouen. Au même musée,
ainsi qu’au musée de Cluny, au musée des Arts Décoratifs à Paris, se trouvent
des fragments de petite dimension, sans provenance, mais qui appartiennent
très probablement à des clôtures plus anciennes, d’une époque très voisine
de celle de Morigny, car leur décor en volutes s’y rattache étroitement,
et leur présence dans les musées de Paris et de Rouen permet de croire qu’elles
appartenaient à des églises de la région. Mais au Sud de la Loire, il nous
reste dans les églises mêmes plusieurs grilles entières, qui offrent avec la
nôtre des analogies frappantes. Celle de Conques, dans l’Aveyron, est la
plus connue et la plus remarquable. C’est un ensemble aussi gracieux qu’imposant
qui occupe huit intervalles de colonnes, composé de parties ouvrantes et
de parties dormantes. Il présente çà et là quelque variété dans ses motifs, mais
son élément fondamental est toujours la volute à trois tours de spire, comme
à Morigny. Elles sont groupées par quatre et reliées le plus souvent par
de simples colliers, mais aussi par des nœuds saillants d’où partent des
tiges contournées en sens inverse à leur extrémité : nous avons ici une recherche
dans le décor qui ne se rencontre pas dans les autres grilles. En outre,
les montants se terminent, eux aussi, par des volutes qui viennent rejoindre
celles du réseau de la porte. Les éléments autres que les volutes, au-dessus
desquelles s’élève un rang serré de fleurs de lis, de têtes de dragons, de
pointes aiguës, dont le rôle était de s’opposer à l’escalade, mais qui ont
en même temps un effet décoratif. Cet ensemble est d’une somptueuse élégance,
qui ne surprend point dans la riche abbaye de Conques. Il appartient sans
doute à une époque moins ancienne que la grille de Morigny, la fin du XIIème
ou le début du XIIIème siècle. |9
Le cloître de la cathédrale du Puy possède aussi
une très belle grille, qui offre une recherche de variété dans les dimensions
des volutes, à tours de spire plus ou moins nombreux et reliées par des embrasses
saillantes, ce qui nous la ferait dater d’une époque encore un peu moins
ancienne.
La grille de l’église Saint-Cerneuf à Billom dans
le Puy-de-Dôme est d’une exécution beaucoup moins habile, sans doute l’œuvre
d’un artisan local. Mais elle est faite de motifs très voisins de ceux de
Conques, ses volutes superposées couronnées par un rang de palmettes.
Une autre petite église tout à fait méridionale,
Saint Aventin de Larboust, près de Luchon, possède une belle grille de 3
m. de hauteur, à 2 panneaux ouvrants, composés encore de volutes à trois
tours de spire, mais avec des irrégularités et des dissymétries sans doute
voulues.
Hors de France, les grilles de la chapelle de Santa
Cruz, dans le cloître de la cathédrale de Pampelune, offrent une telle analogie
avec celles de Conques qu’on peut se demander si elles ne furent pas l’œuvre
du même artiste ou au moins d’un même atelier. La tradition, à Pampelune,
les fait remonter à 1212, parce qu’elles auraient été faites avec la chaîne
que le roi de Navarre Sanche VII enleva à la tente de Muramolin lors de la
bataille de Las Naves de Tolosa. Si le fait est exact, c’est la grille de Conques,
certainement un peu antérieure, qui aurait inspiré ou même servi de modèle
à celle de Pampelune.
Enfin, beaucoup plus loin de nous, la grille de Jérusalem,
posée par les Croisés avant 1187, autour de la Rotonde du Dôme de la Roche,
est faite encore de volutes. Mais, peut-être sous une influence orientale,
nous y trouvons une recherche très marquée, en particulier dans les dimensions
inégales des volutes, ce qui est digne d’attention, étant donné son époque
ancienne.
La grille de Morigny n’a pas ce caractère. Son décor
simple, uniforme, ne montre que les irrégularités propres aux œuvres faites
à la main que l’artiste n’a pas cru devoir corriger, qu’on ne perçoit qu’après
un examen attentif et qui sont loin d’être sans charme Par la même et par
sa technique également simple, elle est peut-être une des plus anciennes
grilles entières qui subsistent.
La volute est l’élément essentiel de ces belles ferronneries
du XIIème et du XIIIème siècles. Et c’est sans doute
une des premières formes décoratives de la nature dont l’homme ait senti
la beauté ou plus exactement dont il ait cherché et réussi à reproduire la beauté,
car la sentir n’est pas hélas ! la réaliser.
Vous savez, en effet, que la volute apparaît dans
|10 l’art et dans l’industrie des plus anciennes civilisations
et qu’elle a connu une extraordinaire fortune, aussi bien dans l’espace que
dans le temps puisqu’on la retrouve depuis l’âge des dolmens jusqu’à nos
jours, dans la ferronnerie et les décors de pierre de nos églises, dans les bas-reliefs
mayas du Yucatan, dans des sculptures sur bois du Népal dans l’Inde, pour
n’en citer qu’un très petit nombre.
Nous en signalerons de plus anciennes encore et peut-être
moins connues, qui remontent à l’âge de la pierre taillée, bien antérieur
à celui des dolmens, que nous avons trouvées dans deux grottes magdaléniennes
des Pyrénées. Ce sont de très belles volutes gravées ou sculptées en fort
relief sur plus de trente baguettes en bois de renne. On a rencontré ces
étonnants objets en France seulement et seulement dans les Pyrénées.
L’homme qui a conçu l’idée de les exécuter, dans
des conditions de vie si précaires, n’était qu’un simple chasseur, qui avait
dû observer et admirer ces gracieux enroulements dans la nature, sur des
tiges volubiles, des crosses de fougères, ou encore des coquilles de gastéropodes
ou des galeries d’insectes xylophages à l’intérieur des branches d’arbres.
Et par le seul moyen d’un burin de silex, il a su déjà en reproduire la grâce, comme
des milliers d’années plus tard, avec des moyens moins rudimentaires, les
artistes romans.
Ainsi, l’origine de ce motif ornemental se confond
avec l’origine même de l’art. Mais c’est dans la ferronnerie du XIIème siècle
qu’il a peut-être trouvé sa plus séduisante expression.
Ai-je besoin de vous dire en terminant, mes chers
collègues, que ce sera pour moi un honneur et une joie que de vous en faire admirer
un si beau spécimen au musée d’Étampes.
Cette conférence si documentée
complète très heureusement la visite du château de Morigny, de l’église,
du musée et de la ville d’Étampes que madame de Saint Périer a fait faire
à la Société il y a quelques années.

08. Donation d'un domaine
près d'Étampes par Philippe Auguste à l'Ordre de Saint-Jacques (1184) 21
Par la Comtesse de Saint-Périer (1960)
Nous avons la bonne fortune de pouvoir apporter à
l’intéressante étude de M. le chanoine Guibourgé sur la Commanderie de Saint-Jacques20 21 un complément inattendu, qui jette une lumière
sur l’époque de sa fondation.
La façon dont nous avons eu cette précieuse information
nous paraît digne d’être signalée parce qu’elle montre l’esprit de curiosité
et de solidarité tout ensemble qui anime les chercheurs. Un ingénieur français,
doublé d’un érudit, M. Francis Gutton, qui occupe une haute situation industrielle
à Penarroya, en Espagne, consacre depuis longtemps ses loisirs à l’histoire
des ordres militaires et religieux de Calatrava et de Saint-Jacques de l’Epée, fondés
en Espagne au XIIe siècle, mais dont firent partie un grand nombre
de chevaliers français. Il découvrit ainsi, au cours de ses recherches dans
les archives espagnoles de l’Ordre de Saint-Jacques, que le roi de France
Philippe-Auguste fit, en 1184, une donation à l’ordre militaire espagnol
d’un domaine situé près d’Étampes — Donatio Villœnovœ prope Stampas sub colle Montis
Falconis — et de dîmes à Étampes.
M. Gutton eut l’excellente idée de venir à Étampes
pour s’informer de la connaissance qu’on y pouvait avoir de cette donation
et de ses conséquences pour l’Ordre de Saint-Jacques. C’est ainsi que nous
entrâmes en relations et que j’ai pu lui confirmer l’existence d’abord d’un
lieu-dit Villeneuve-sous-Montfaucon (traduction exacte du nom latin porté
dans la donation), situé tout près de Morigny, puis, d’une ancienne Commanderie
de Saint-Jacques à Étampes, attestée par des actes à partir tout au moins
de 1490 jusqu’en 1580, mais dont l’époque de fondation restait obscure pour
tous nos historiens, comme nous l’avions signalé dans notre Histoire d’Étampes.
La donation que Philippe-Auguste fit en 1184, certainement
authentique, confirmée par une bulle apostolique du pape Lucius III, n’autorise
pas, bien entendu, à conclure que la fondation de la Commanderie d’Étampes
remonte à cette même date, ni qu’elle ait été primitivement édifiée sur le
terrain de la donation, ce dont il ne reste aucune trace. Mais il est permis
maintenant d’affirmer ce qu’on ne faisait que supposer, que la Commanderie dut
être fondée bien longtemps avant l’époque où elle est pour la première fois
signalée, par la contestation, en 1490, du droit de port possédé par le Commandeur.
Grâce à la donation royale, la Commanderie fut très probablement instituée
dès la fin du XIIe siècle, en raison de l’activité bien connue
des chevaliers de Saint-Jacques et de l’affluence considérable des pèlerins
sur la longue route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Où s’établit-elle alors ? Rien ne nous éclaire à
ce sujet. Mais il faut noter que le lieu de la donation, Villeneuve-sous-Montfaucon,
est proche de l’ancienne maladrerie de Saint-
Lazare, qui se trouvait sur la route de Paris, en
face de l’hôtel Saint-Michel actuel. Son existence est connue dès 1120 par
des bienfaits du roi Louis VI ; elle comprenait, outre une chapelle dédiée
à Saint-Michel (d’où le nom du hameau) plusieurs bâtiments, de chaque côté
de la route, dont nous avons encore connu quelques beaux vestiges du XVIIe
siècle, aujourd’hui totalement disparus. Ce voisinage, peu souhaitable, de
la maladrerie, détermina peut-être dès l’époque de la donation les chevaliers
de Saint-Jacques de l’Épée à s’établir autre part, après un échange de terres
par exemple. Rien ne s’oppose, dans les seuls documents que nous possédions,
à ce que fût déjà dans le lieu qu’ils durent abandonner trois siècles plus
tard en faveur des Capucins. Les uns et les autres ont laissé, dans la mémoire
des Étampois une certaine trace, que nous souhaitons de raviver, puisqu’une
petite rue, longeant le mur de l’ancienne Commanderie, porte le nom du Chevalier de l ’Epée et que le joli chemin qui suit la rivière est encore appelé,
par les fidèles au passé, La Sente des Capucins.
Il nous paraît juste d’adresser une pensée de sympathie
et de reconnaissance à M. Gutton qui est venu spécialement à Étampes pour
vivifier en quelque sorte sa documentation et, en même temps, nous faire
bénéficier du fruit de ses recherches.
PIÈCE JUSTIFICATIVE
(Du Bullarium Ordinis Militiæ Jacobi — M.DCC.XIX — page 28) :
Ann. 1183 - Script 1.
Donatio Villænovæ de Vvarena propè Stampas et quarundum
Decimarum in Stampis a Philippo II Aug. Galliæ Rege facta Ordini et Fratribus
in illis partibus D. Roderico Presbytero et D. Ioanni Fernandez cum alijs
degentibus, ut alibi constat.
Vide anno 1184, script. 5.
In nomine Sanctæ et Individuæ Trinitatis. Amen. Philippus
Dei gratia Rex. Noverint universi præsentes pariter et futuri, quod Dei intuitu,
et ob remedium animæ Patris nostri, et meæ, donamus in elemosinam Fratribus
Ordinis Militiæ S. Jacobi quidquid habemus apud Villamnovam de Warenna sub
Colle Montis Falconis sitam, et totam Decimam molendinorum nostrorum (nostro Fuleret) quæ nunc facimus ; et quæ etiam faciemus in Stampis, et
Castro Nantonis. Quæ omnia, ut perpetuam obtineant firmitatem, nec aliqua
posterorum malitia possint convelli, præsentem paginam sigilli nostri auctoritate,
et Regis nominis caractere inferius annotato communimus. Actum Stampis anno
ab Incarnatione Domini M.C.LXXXIII. Regni nostri anno quarto. Astantibus
in Palatio nostro quorum nomina sunt, et signa. Signum Mathi, Camerarij.
Signum Radulphi Constabularij. Data per manum Hugonis Cancellarij.

09. Le bel envers d’un évier
»
Albert Gaudry, dont les fouilles à Pikermi, en Grèce,
amenèrent la découverte de tant de vestiges d’animaux fossiles précieux, avait
coutume de dire que la misère de la paléontologie, science si grande par
la portée philosophique de ses résultats, était d’être subordonnée à l’imprévu
des découvertes, que le savant ne peut non provoquer, ni prévoir. Alors que
le biologiste, le physicien ou le chimiste réalise dans son laboratoire les
conditions mêmes du phénomène dont il étudie les lois, le paléontologiste
attend du seul hasard la mise au jour du fossile qui éclairera un point obscur de
sa science.
L’archéologue, bien souvent, peut s’exprimer de même
et, à côté de monuments dont l’ examen lui est facile, il doit attendre des
circonstances imprévues la révélation de documents ignorés. C’est à quoi
nous songions devant la singulière pierre d’évier qui vient de faire son
entrée au Musée d’Étampes grâce à la générosité de M. et Mme Charles
Debuly, demeurant à Boissy-le-Cuté.
Nous étions avisés, il y a quelques semaines, par
M. Jamet, qu’à l’occasion du changement d’une pierre d’évier, à Boissy-le-Cuté, il
avait remarqué dans la cour de M. et Mme Debuly, l’ ancienne pierre
de cet évier dont l’envers portait des gravures et des lettres. 22
Nous nous rendîmes aussitôt à Boissy-le-Cuté et nous
reconnûmes qu’il s’agissait d’un fragment d’une pierre tombale sectionnée
au-dessous du tiers supérieur environ, privée de sa bordure supérieure, mais
dont une partie de la gravure était fort bien conservée. On y voit sous un
bagle trilobé orné de crochets, accosté de deux petits pinacles, une gracieuse
figure de femme jeune, dont les yeux semblent encore refléter une mélancolie résignée.
Elle est coiffée d’ un bonnet plat, retenue par une mentonnière et porte
en arrière un voile qui tombe jusqu’aux épaules. Un manteau fermé en avant
par une cordelière, s’ouvre sur une robe, dont le col est échancré circulairement.
La main gauche est engagée sous la cordelière, dans un geste que l’on retrouve
sur certaines tombes de Saint-Denis. Malheureusement le visage est déshonoré
par la perforation du tuyau d’échappement de l’évier, qui a détruit la bouche
et le menton de la figure.

L’inscription est très incomplète, non seulement
à cause de la fragmentation de la pierre, mais encore parce que la bordure
a été martelée sur la plus grande partie. On peut lire, en belles onciales, à
gauche : iez, fame et à droite : Chevreu.
Le style de l’encadrement, le costume et les caractères
de l’inscription, permettent d’ attribuer sans hésitation cette belle pierre
tombale au XIIIe siècle. La rareté des documents de cet âge n’en
rend que plus déplorable l’état de mutilation dans lequel elle nous parvient.
Il est bien difficile, en effet, de reconnaître le
personnage représenté. Il semble que les mots inez, fame, puissent indiquer un nom de jeune fille tel que N. de Villez
par exemple, car on sait que l’orthographe ancienne est tout à fait fantaisiste.
Le mot Chevreu, peut avoir fait partie du nom de Chevreuse et l’on aurait alors
la pierre tombale d’une femme d’un seigneur de Chevreuse, famille féodale,
qui possédait au XIIIe siècle, les seigneuries de Chevreuse, de
Dampierre, etc., dans une région éloignée de quarante à cinquante kilomètres
seulement de la nôtre. Mais cette hypothèse est fragile et nous manquons
d’éléments pour l’étayer. Peut-être des recherches plus approfondies dans
les auteurs anciens qui, comme l’abbé Lebeuf au XVIIIe siècle,
ont décrit avec soin les monuments qui existaient encore de leur temps, nous
apporteront-elles quelque lumière. Nous nous réservons alors de les faire
connaître, dans un prochain numéro du Bulletin des Amis du Musée d’Étampes, seule et trop modeste publication archéologique consacrée
à l’histoire de notre ville.
Mais une question reste troublante. Comment cette
pierre, d’un poids assez élevé et d’un transport difficile, arriva-t-elle
à Boissy-le-Cuté ? Il y aurait une centaine d’années, d’après M. et Mme
Charles Debuly, que l’ évier aurait été mis en place, sans que personne eût
soupçonné la gravure que portait son envers. Où trouva-t-on à cette époque,
la pierre qui fut sciée ? Question jusqu’ici sans réponse.
Rappelons, pour terminer, que ce n’est pas la première
fois qu’un fragment archéologique important a servi de pierre d’évier. Gabriel
de Mortillet a retrouvé ainsi, dans une maison, un fragment d’autel chrétien
des premiers siècles, dont l’autre partie était conservée au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Rapprochés,
les deux fragments ont reconstitué l’autel, que l’on peut admirer aujourd’hui
dans la chapelle du château de Saint-Germain.
Aurons-nous la chance de retrouver les deux tiers
qui manquent à notre pierre ? Nous n’osons l’espérer, mais si incomplet qu’il soit,
ce fragment n’en mérite pas moins d’être conservé et admiré, comme spécimen
de la belle gravure des pierres tombales du temps du bon roi Saint-Louis.
Et c’est pourquoi nous ne saurions trop remercier les possesseurs de cette
pierre, d’avoir bien voulu en faire hommage à notre Musée municipal.
R. de Saint-Périer.

Le cimetière de Saclas
sur le plan Mappy de 2016.
10. Sépultures anciennes
a Saclas 4
Les travaux d’agrandissement du cimetière de Saclas,
exécutés au printemps de cette année, ont amené la découverte de sépultures
anciennes, qui font l’objet de cette petite note et qui présentent un certain
intérêt pour notre histoire locale.
À l’ouest du cimetière actuel, au lieu-dit Sous le Cimetière et parallèlement à la route, qui suit la ligne de chemin
de fer de Beaune-la-Rolande, une tranchée pratiquée sur une longueur d’une
vingtaine de mètres, dans la pente du coteau, a mis au jour, au-dessus de
roches de grès éboulées, de nombreux squelettes humains. Ceux-ci, enterrés
à une profondeur de 0m 80 à un mètre environ, avaient, pour la
plupart, les pieds orientés vers le nord-est ; quelques-uns étaient encore
complets et en place au moment de la découverte, mais beaucoup d’ossements
épars indiquaient qu’il y avait eu des relèvements anciens de corps, ainsi
que cela se pratique encore aujourd’hui dans les cimetières. Les squelettes étaient
superposés, mais on n’a trouvé aucune trace de cercueils.
D’après l’ouvrier qui pratiquait les fouilles et
que nous avons interrogé lors de notre visite, une grosse pierre, en forme
de borne, indiquait l’emplacement de chaque squelette complet ; nous n’avons
pu voir aucune de ces pierres, celles-ci n’ayant pas été conservées. Enfin,
sur quelques emplacements de sépultures, 23 on aurait trouvé un certain nombre de pierres
calcaires brutes, sans inscriptions, ni traces de décoration.
Le mobilier funéraire, extrêmement pauvre, ne comprenait
ni monnaies ni objets métalliques, mais seulement des vases en terre cuite,
placés tantôt sur la poitrine, tantôt aux pieds des corps.
Il nous a été possible, grâce à l’obligeance de M.
Auclère, maire de Saclas, d’examiner quelques-uns de ces vases, qui contenaient,
au moment de leur trouvaille, des cendres et des charbons et qui nous permettent
de fixer approximativement la date de ces inhumations.
Les vases complets que nous avons pu voir sont en
terre cuite non vernissée, d’un rouge terne, d’une pâte assez fine et assez mince
; leur forme est celle d’un pichet à large goulot, sans bec ; ils sont munis
d’une anse et mesurent environ 20 centimètres de hauteur. Leur panse porte
une série de perforations, irrégulières, disposées circulairement autour
du vase, mais ces perforations ont été pratiquées après la cuisson de la pièce, au moyen d’une tige métallique ou
d’un objet pointu quelconque. Ils contenaient, nous l’avons dit, des cendres
et des charbons. D’autres fragments de poteries provenant du même lieu, sont
en terre grise, noire ou blanche ; leur fragmentation ne permet pas de reconstituer
la forme primitive du vase dont ils ont fait partie.
L’usage de placer des vases perforés dans les tombes,
ainsi que des vases sans perforation, est fort ancien. Les premiers contenaient
de l’encens, dont la combustion sur les charbons dont on garnissait le fond
du vase était assurée par la ventilation due aux perforations ; les seconds
étaient destinés à recevoir de l’eau bénite. Ces vases étaient placés soit
près de la tête du défunt, soit aux pieds, parfois aux quatre coins de la
sépulture. Tertullien, docteur de l’Église, qui vivait à la fin du IIe
et au commencement du IIIe siècle, se plaint déjà, dans son Apologétique, que les chrétiens de son temps employaient plus de parfums
pour cet usage que les païens n’en consacraient à leurs idoles. Cependant cette
coutume a persisté fort longtemps, nous la retrouvons au XIIe
siècle et jusqu’à la fin du Moyen Âge.
Les vases usités pour cet emploi funéraire n’appartenaient
pas à un type spécial ; on utilisait une poterie d’usage courant dans la
maison, qui était perforée irrégulièrement pour permettre aux vapeurs d’encens
de s’échapper. Aussi les formes des vases sont-elles très variables ; on
retrouve la plupart des types usuels à cette époque, et cette circonstance
a jeté quelque lumière sur l’histoire, encore si obscure, de la poterie au
Moyen Âge. Quant au but de cette coutume, il s’explique par l’usage de n’enterrer
les morts que le troisième jour et par la nécessité de dissiper les odeurs
se dégageant du cadavre dans la chambre mortuaire. Aux yeux de l’Église,
cette tradition rappelle, en outre, que le défunt offre à Dieu ses bonnes
œuvres, qui montent au ciel comme un parfum24.
Si, le plus souvent, les perforations de ces vases
sont faites après cuisson, sur une poterie commune, il existe néanmoins des récipients
destinés à cet usage funéraire, dont les perforations étaient préparées avant
la cuisson de la poterie, au moment de la fabrication du vase. Le Musée d’Étampes
possède un de ces spécimens en terre blanche, pot à large ouverture, provenant d’Eure-et-Loir
et dont la forme rappelle celle des vases employés au XIIe siècle.
Nous pouvons donc attribuer au Moyen Âge les sépultures
découvertes à Saclas et, d’après la qualité de la Poterie, les placer vers
les XIIIe ou XIVe siècle. Il est difficile de préciser davantage,
car la poterie de cette époque est mal connue, beaucoup moins bien représentée
dans les musées que la céramique gallo-romaine et généralement datée avec
une extrême incertitude. Cependant, nous pouvons affirmer que le cimetière
ancien, qui vient d’être découvert est très postérieur à l’occupation romaine,
qui a laissé à Saclas de nombreux témoins et à laquelle on pense tout d’abord,
quand on découvre un objet ancien dans ce pays. Il est probable que les inhumations
ont été pratiquées depuis fort longtemps dans les environs du cimetière actuel
de Saclas et que les sépultures qui viennent d’être mises à jour constituent
une partie du cimetière de Saclas depuis le haut Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Ajoutons, pour terminer, que le Musée d’Étampes possède
un vase, provenant de Saclas, en tous points semblable à ceux que nous avons
examinés et qui a dû être trouvé dans une sépulture du même âge.
R. de Saint-Périer.
Le château de Champigny
vers le milieu des années 1950
11. Le cimetière de Champigny
-
par le comte de Saint-Périer, auxiliaire de l’Institut
de France.
Nous avons été informé par M. le Maire de Morigny,
le 17 décembre 1943, qu’on venait de découvrir, à Champigny, un certain nombre
d’ossements paraissant anciens. Nous nous sommes rendu le jour même à Champigny
où M. Georget, propriétaire du château de Champigny, nous a montré, dans
une tranchée qu’il avait fait pratiquer pour établir une canalisation d’eau
à l’entrée du parc de Champigny, des ossements humains en assez grand nombre.
Nous avons reconnu, sur les terres rejetées de la tranchée, des fragments
de calottes crâniennes, des maxillaires et des mandibules avec leur denture
et des os des membres. Ces os sont anciens, mais non fossiles. On les trouve à
50 centimètres environ de profondeur sur les parois de la tranchée ; ils
ne sont pas en connexion anatomique et semblent provenir de sépultures bouleversées.
Lors de notre visite, il n’avait été découvert encore
aucun mobilier funéraire ; nous avons attiré l’attention de M. Georget sur
l’intérêt qu’il y aurait à recueillir les fragments de poteries qui pourraient
se trouver dans le sol avec les ossements. Et 25 quelques jours après, M. Georget nous a
fait parvenir un fragment de vase dont la destination n’est pas douteuse.
Il s’agit d’un pichet de terre rougeâtre, d’une pâte
bien cuite et fine, épaisse seulement de quelques millimètres, dont l’anse
et la moitié de la circonférence sont conservées. Plusieurs perforations
faites après cuisson forment une ligne à peu près horizontale sur la panse.
Ce vase est certainement d’usage funéraire et se rapporte à ces poteries
courantes qu’on plaçait au moyen-âge dans les tombes aux pieds des morts,
après introduction de charbon allumé et d’encens. Pour faciliter la combustion,
on avait soin de perforer le vase en plusieurs points avec un objet métallique
quelconque.
Nous avons recueilli en 1913, dans le cimetière de
Saclas, dans une tombe non bouleversée, un vase absolument comparable au vase
fragmenté de Champigny.
Il est assez difficile de dater exactement ces poteries
et, par suite, de déterminer l’âge exact des sépultures où on les rencontre.
Leur forme et leur pâte ne sont pas caractéristiques, car ces vases, destinés
aux besoins journaliers, étaient faits sur les mêmes modèles et avec la même
matière depuis le haut moyen-âge presque jusqu’à nos jours.
Quant à l’usage de les placer aux pieds des morts,
il existait depuis une très ancienne époque, car Tertullien, à la fin du
Ier siècle26,
se plaint déjà que les Chrétiens de son temps dépensent plus d’argent pour
donner de l’ encens à leurs morts, que les païens pour les sacrifices à leurs
dieux. Rien ne nous renseigne exactement sur l’époque à laquelle cet ancien
usage, d’origine païenne, fut abandonné dans les campagnes, mais il est douteux qu’il
ait dépassé le XVIIe siècle.
On sait que Champigny, qui ne compte plus aujourd’hui
que quelques maisons, était autrefois une paroisse d’une certaine étendue,
puisque Villemartin en faisait partie ainsi que la Grange des Noyers. En
1434, nous apprennent les Archives de l’Yonne, le curé de Champigny devait
quatre setiers de blé comme contribution pour le synode de Saint-Loup |7
à Sens. Les registres paroissiaux de la paroisse de Champigny, conservés
à la Mairie de Morigny, débutent en 1561, par une liste des obits dressée
par le curé de la paroisse. Enfin, nous savons qu’en 1793, il y avait encore
un curé à Champigny, l’abbé Salmon. La paroisse de Champigny fut supprimée
et réunie à celle de Morigny lorsque la paroisse de Saint-Germain-lès-Étampes
fut transportée à Morigny, après la vente de l’ abbaye de Morigny comme bien national.
Nous savons que l’ église de Champigny était dédiée à Saint-Martin, qu’elle
était vraisemblablement au milieu du cimetière dont l’emplacement vient d’être
déterminé par la découverte que nous venons d’exposer. La tradition locale
le plaçait au même lieu. Une porte murée et dont on retrouve la trace dans
le mur de clôture du parc de Champigny passait pour l’ancienne porte du cimetière,
mais ce n’était là qu’une tradition locale. Nous avons la preuve certaine
maintenant que le cimetière qui entourait l’église Saint-Martin de Champigny
se trouvait bien à l’ entrée du parc actuel du Château.

Le Crédit Lyonnais, aujourd’hui
22-24 rue Louis-Moreau
12. Objets du Moyen Age
découverts à Étampes en 1923 »
Les travaux de construction de l’immeuble occupé
par le Crédit Lyonnais, aux numéros 22 et 24 de la rue Saint-Jacques, à Étampes,
ont amené la découverte, au printemps de l’année 1923, de quelques objets
du moyen-âge, qu’il me paraît intéressant de signaler.
Pour établir les fondations du nouvel édifice, les
ouvriers de l’entreprise Léauté durent creuser le sol jusqu’à une profondeur d’environ
4 mètres. Ils remarquèrent alors, dans le terrain, des zones noires qui contenaient
des poteries et d’autres objets qu’ils recueillirent.
J’ai pu, grâce à l’obligeance de M. Léauté, examiner
le produit de ces fouilles improvisées.
Les poteries comprenaient : un vase en terre grise,
fait au tour, à pâte fine et bien cuite, mesurant 13 centimètres de hauteur,
dont le fond plat et les parois, jusqu’à la moitié de leur hauteur environ,
sont noircis par le feu ; deux autres vases d’une forme analogue, à pâte
blanche, l’ un plus petit, l’ autre un peu plus grand que le premier. Deux
fonds de vases brisés devant appartenir à des récipients d’une forme assez
voisine. Un vase plus grand, muni de trois mamelons servant de supports et
qui portait des traces d’un vernis brunâtre encore bien conservé, rappelait
la forme de nos marmites actuelles. 27
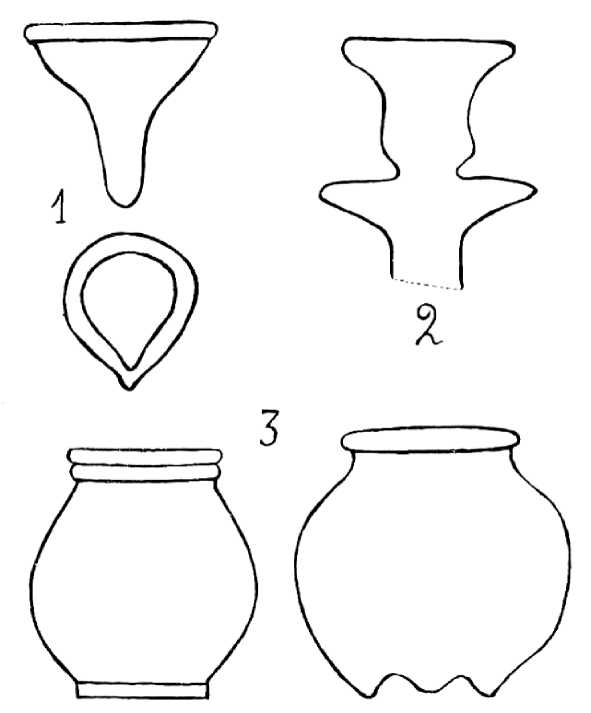
1. Lampe en terre cuite. — 2. Chandelier. — 3. Vases.
Ces objets doivent être rapportés au moyen-âge. Les
vases |30 ne permettraient guère, s’ils étaient isolés, cette
attribution, car la poterie commune a conservé le plus souvent des formes archaïques
et telle marmite en usage dans nos campagnes il y a un demi-siècle à peine,
pourrait être confondue avec le vase vernissé à trois pieds, découvert rue
Saint-Jacques. |31 Mais les lampes, le chandelier et la monnaie
ne permettent pas le doute.
Avec ces poteries, on recueillit un pressoir en pierre
calcaire, composé d’un récipient cylindrique, muni d’une rigole, dans lequel
pouvait se mouvoir une meule également en pierre calcaire, qui portait sur
sa face supérieure deux entailles carrées : une centrale et une latérale,
plus petite.
Enfin, deux lampes et deux chandeliers incomplets,
en terre cuite, ainsi qu’une monnaie en argent, complétaient ce petit lot.
Ces lampes, en forme de petit godet, munie d’un bec
et prolongé par un pied se terminant en pointe, mesurent 5 à 6 centimètres
de longueur sur une largeur à peu près identique.
Elles ont été en usage de la fin du XIIe
siècle au XVe. Elles servaient à l’éclairage des églises et aussi des
habitations privées et se plaçaient dans des « couronnes de lumières » suspendues ou
dans des chandeliers en bronze28. Dans notre région, on en a découvert à
Saint-Martin-de-Bréthencourt29, et à Étampes même, dans les ruines de l’église
Sainte-Croix30.
Les chandeliers en terre cuite blanche, à tige creuse,
sont également des objets mobiliers qui remontent au Moyen-Âge. Ils forment
la partie supérieure de bougeoirs dont la base était en cuvette. Il en existe
des spécimens complets, notamment au Musée
de Reims31.
La monnaie en argent, trouvée avec les objets, fixe
d’ailleurs leur âge. Il s’agit d’un demi-gros ou blanc de dix deniers, dit «
guénar »de Charles VI (1380-1422).

C’est donc à la fin du XIVe siècle ou
au début du XVe qu’il faut attribuer les objets de la rue Saint-Jacques.
Il est probable que ces poteries se trouvaient dans des démolitions de maisons
de cette époque, sur lesquelles furent construites les demeures postérieures.
Les zones de terre noire remarquées par les ouvriers proviennent de la décomposition
de matières organiques (bois, débris ménagers, etc...) dans le sol. Il faut,
à mon sens, éliminer l’hypothèse de l’existence en ce lieu, d’un cimetière
: aucun objet de destination funéraire n’y a été recueilli et le cimetière
de Saint-Basile se trouvait derrière l’église, sur l’emplacement actuel de la
place Romanet. 32
sous une maison, des creusets en terre cuite, également
du
33
moyen-âge33.
Qu’il me soit permis, en terminant, d’exprimer le
regret que les administrateurs du Crédit Lyonnais n’aient pas cru devoir, comme
il le leur avait été demandé, faire hommage à notre Musée, de ces objets
qui n’avaient aucune valeur vénale. Conservés à Étampes, ils eussent constitué
un souvenir intéressant du passé de notre antique cité.
R. de Saint-Périer.

13. Un meurtre a Etréchy
en 1395 »
À l’occasion de recherches que nous poursuivions
sur l’histoire de notre région, nous avons trouvé un document dont il nous paraît
intéressant de publier une analyse, bien qu’il s’agisse d’un fait de médiocre
importance, parce qu’il s’est déroulé aux environs d’Étampes.
Il s’agit d’une lettre de rémission34 35 accordée par Charles VI, à la suite d’un
meurtre près d’Étréchy. Ces lettres qui suspendaient l’effet des poursuites
contre un meurtrier, étaient données en cas de légitime défense, lorsque
le demandeur possédait quelque crédit et parvenait à exposer sa requête devant
le Conseil du Roi.
Il ne s’agit pourtant, dans l’espèce, que d’un serviteur
de Pierre Paviot, seigneur de Jeurres, du Roussay et de Boissy-le-Sec. Mais
ce Pierre Paviot était un personnage assez considérable. Il était en 1395
échanson de Louis, duc d’Orléans, frère du roi, qui fut assassiné à Paris
par les hommes du duc de Bourgogne, Jean Sans Peur, en 1407, et dont le fils,
Charles d’Orléans, fut un des poètes les plus gracieux du XVe
siècle.
Pierre Paviot possédait, outre sa charge et des fiefs
en Beauce, des terres en Normandie, dans la paroisse de Perriers-sur-Andelle (Eure),
au Mesnil-Paviot. C’est de cette paroisse qu’était originaire son serviteur
Raoulin Fouet, dit Paviot, comme son maître, qui avait accompagné Pierre
Paviot au Roussay.

Blason des Paviot
Or donc, le samedi avant la fête de Saint-Laurent
(10 août) de l’année 1395, Raoulin Fouet sortait « environ l ’heure du soleil couchant
» de la « ville » d’ Étréchy,
où il avait été «
besogner » « s ’en retournant, dit notre lettre,
en l ’ostel de son maître
qui est à moins d’un quart de lieu36 d’icelle ville ». Il s’agit donc, très vraisemblablement, du Roussay, qui
est moins éloigné d’Etréchy que Jeurres. Raoulin Fouet
cheminait sans penser à mal lorsqu’il rencontra un
« poulailler » (marchand de volailles), qui conduisait des « chevaux de poulaille » et qui apostropha rudement notre homme : « Qui es-tu là ? », lui demanda-t-il. Raoulin Fouet jugea bon de montrer des
dispositions pacifiques et il répondit : « Ce sont bonnes gens ». Mais fort irascible, le poulailler ajouta : « Qu’est-ce que tu portes ? » Raoulin Fouet, toujours patient, répondit : « Ce sont mes chausses. » « Qu’en
as-tu à faire ? » « Tu le pourrais demander à tel qui ne te diroit mie (qui ne te répondrait pas), mais te donneroit une buffe (un coup.) »
La discussion en serait peut-être restée là s’il
n’était survenu deux autres « poulaillers ». L’un d’eux saisit l’infortuné
Raoulin Fouet « aux
poings » et le secoua fortement en lui demandant
:
« Qui es-tu ? Que demandes-tu
? » Raoulin, toujours plein de sens, répondit
: « Je ne demande
rien ; je m’en vais coucher en notre maison que je vois illec (là-bas). » Mais les « poulaillers
» ne désarmaient pas et l’un d’eux dit à Raoulin « Tu as menti, tu es espie (espion) et un larron. »
Ces paroles convainquirent ses compagnons et tous
« se esmurent en
chaleur » et commencèrent à accabler le malheureux
serviteur des Paviot, de coups « des verges de leurs fouets » si bien qu’ils le « navrèrent en plusieurs parties de son corps
». Et, parvenu au comble de la fureur, un de
ces terribles marchands de poules « sacha (sortit) un grand coustel et le mit contre
le ventre de Raoulin en lui disant : Larron, si tu te meuz (si tu bouges) tu es mort ».
Épouvanté à juste titre, Raoulin Fouet criait « Pour Dieu, qu’ils eussent mercy
de lui et qu’ils ne le batissent pas. » Alors l’homme
au grand couteau le frappa sur le bras du plat de son arme si violemment
que Raoulin chut à terre, cependant que son assaillant, lui accordant la
vie sauve, lui disait en manière de grâce : « Passez, ribaud. »
Profitant de cette clémence imprévue, Fouet se releva,
« se bouta en un
champ, là où il y avait eu blé » et montrant
enfin sa valeur « sacha », lui aussi
un « coustel » et cria aux poulaillers qu’ils eussent à le respecter, car
ils ne savaient à qui ils avaient osé s’attaquer. Mais cette allusion à sa
vaillance ou à ses puissantes protections n’intimida point ces hommes et
ils coururent vers Raoulin en criant : « À lui, à lui, à ce larron ; il a sachié (tiré)
son coustel. »
Alors le serviteur des Paviot perdit tout courage
et s’enfuit « droit
à la ville d’Étréchi dont il venoit » pendant
que les poulaillers, emmenant leurs chevaux, s’en venaient également à Étréchy.
Ils se retrouvèrent bientôt dans ce paisible village,
car Raoulin Fouet était à peine en sûreté dans ses murs qu’il entendit les poulaillers
arriver à leur tour. Celui qui avait tiré son grand couteau s’adressait à
la femme de Oudin Bonmarché et lui disait qu’ils avaient rencontré au bout
de la ville un larron qui les avait assaillis. Raoulin se montra alors et
lui dit : « Tu mens,
je ne suis pas larron, mais tu m’as battu sans cause. » À ces mots, le poulailler tira derechef son fameux couteau
et la lutte recommença. Mais le pauvre Raoulin était décidément le moins adroit
; il reçut un coup sur le bras et la main qui fit choir son arme. Se contentant
d’avoir ainsi désarmé son adversaire, le poulailler l’abandonna et se rendit
là où il pensait loger.
Raoulin ramassa son couteau, mais, fort inquiet des
suites de son aventure, ne reprit pas le chemin du Roussay. Il se rendit
en « l ’ostel du
Poinlasne, boucher » où il pensait trouver Jehannin Rayer,
beau-fils du boucher d’Étréchy, à qui il voulait demander de lui prêter main-forte
« pour battre lesdiz
poulaillers ». Mais alors, comme aujourd’hui,
les nouvelles se répandaient vite dans les villages et Rayer était déjà au
courant de l’aventure. Il avait quitté sa demeure, « s’était garny d’un baston » et rencontrant les poulaillers, leur avait crié « A ribauds, vous faut-il battre
les gentizhommes ? » Puis sans attendre de réponse,
il frappa « par les
épaules », de son bâton, le premier poulailler
qui était à sa portée. L’homme s’enfuit, remonta la rue vers l’église et
tomba sur Raoulin Fouet qui s’en revenait de l’ostel de Poinlasne où il avait
été chercher Rayer. Raoulin voulut arrêter le poulailler, mais, toujours
malchanceux, n’y pu parvenir. Il retarda cependant sa course et Rayer, qui
continuait la poursuite, atteignit le poulailler et lui donna deux coups
de son bâton, l’un sur la tête et l’autre sur les épaules, « de laquelle bateure mort s’en
est ensuivie dedans trois jours après, en la personne d’iceluy poulailler
nommé Jehan le Texier, dit Poulailler, dit le Page. »
Voici donc Raoulet Fouet débarrassé de son ennemi,
grâce au secours de Rayer. Mais notre homme ne connaissait plus le repos. «
Doubtant rigueur
de justice », il quitta le pays, erra sans ressources
quelque temps « en
voye de finir misérablement ses jours ou au moins de perdre la paix et ses
biens », il s’adressa au Conseil du Roi, aidé
sans doute du crédit de son maître Pierre Paviot, qui devait posséder, comme
échanson du Duc d’Orléans, quelque influence à la cour.
Il se présenta donc au Conseil et argua « qu’il avoit toujours été homme
de bonne renommée et conversation honneste sans avoir été repris d’aucun
autre villain reprouche ». Il montra qu’il n’avait
pas « flétri (porté) lesditz coups dont la mort s ’en ensuy ».
Le Conseil écouta sa défense et rendit son jugement.
« En
considération aux choses
avant dites, voulant en cette partie pitié et miséricorde être préférées
à rigueur de justice, inclinons à la supplication dudit exposant, avons quitté,
remis et pardonné le dictfait. »
Raoulin Fouet était donc acquitté, mais le jugement
du Conseil lui rendait aussi l’honneur. Déjà en 1395, il n’était pas bon
de comparaître devant la justice de son pays : on en souffrait par la suite
dans sa réputation. Aussi le Conseil a-t-il soin d’ajouter « le
restituons et mettons
à plain à sa bonne fame (réputation), renommée au païs et à ses biens
non confisqués ». Puis, il défend Raoulin Fouet
contre le zèle intempestif des magistrats « et imposons sur cela silence perpétuel à notre
procureur ». C’était un jugement sans appel,
dont l’exécution était confiée au prévôt de Montlhéry qui devait « laisser jouir pleinement et paisiblement
ledit exposant de notre présente grâce et rémission ».
Que devint Jehannin Rayer, le véritable meurtrier
? Nous l’ignorons. Il est probable qu’il connut un sort moins favorable que
Raoulin Fouet. Celui-ci dut bénéficier de son état de gentilhomme, s’il est
vrai qu’il le fût, comme l’avait dit Rayer au poulailler.
Il dut aussi sa grâce à Pierre Paviot, dont il portait
le nom en sobriquet, et dont il était peut-être un bâtard, car à cette époque, ces
filiations illégitimes n’entraînaient pas le discrédit qu’elles ont encouru
depuis.
R. de Saint-Périer.
109

14. Une Prisonnière au Château
d'Étampes au XVe siècle ^
On sait que notre vieille tour de Guinette, donjon
mutilé du château fort d’Étampes, abrita sous Philippe-Auguste une prisonnière
célèbre, Isburge, fille de Waldemar Ier, roi de Danemark, que
le roi de France avait épousée le 14 août 1193. Le lendemain de son mariage,
Philippe-Auguste déclara que la jeune reine lui faisait horreur : vingt-huit
jours après, il la répudia et la fit enfermer au monastère de Césoris, près
de Lille, puis à Étampes, où elle demeura douze ans.
La forteresse devait recevoir, deux cents ans plus
tard, une prisonnière d’un rang moins élevé, dont l’histoire est assez peu connue
pour qu’il nous paraisse intéressant de la rappeler.
À cette époque (1408), le comté d’Étampes faisait
partie des domaines de Jean de France, duc de Berri, frère du roi Charles
V. Ce Jean de Berri était un prince opulent : duc d’Auvergne et de Berri,
comte de Poitiers et d’Étampes, etc., il possédait une immense fortune, singulièrement
accrue, dit-on, par la rapacité avec laquelle il avait exercé pendant huit
ans, de 1380 à 1388, le gouvernement du Languedoc. Il n’aimait pas la guerre
à une époque où tous les princes ne songeaient qu’à se battre et si les cruautés
qu’il commit en Languedoc jettent une ombre sur sa
37 Almanach-Annuaire de la ville
et de l ’arrondissement d’Étampes (1925), pp. 15-18.
mémoire, son goût éclairé et les services qu’ il
rendit aux artistes de son temps doivent lui faire pardonner l’origine souvent
un peu suspecte de ses richesses considérables. Car Jean de Berri était un
amateur et un collectionneur passionné : livres, tapisseries, tableaux, |16
ivoires, émaux, objets d’histoire naturelle, d’archéologie, documents historiques,
tout sollicitait son insatiable curiosité. Il manquait de critique, certes,
comme tous les hommes de son époque, et l’on sourit aujourd’hui en lisant dans
ses inventaires qu’il possédait l’anneau nuptial de Saint-Joseph, mais on
admire sans réserves les manuscrits qu’il fit peindre par les artistes à
ses gages. On sait que les Très riches Heures, faites pour lui par Pol de Limbourg et ses frères, contiennent
les miniatures de ses douze résidences et qu’Étampes y montre son château
aux murs crénelés, que domine fièrement la tour de Guinette, accostée d’une
tour de guet et coiffée d’une haute toiture en poivrière.
Le compte de « l’ostel » de ce prince, comme on disait
alors pour désigner l’ensemble des serviteurs, ne comprenait pas moins de
249 personnes, en 1398. Nous y voyons figurer l7 chambellans, 2 phisiciens (médecins), un nombre imposant de maîtres d’hôtels, d’écuyers,
de valets de toutes sortes, de cuisiniers fort hiérarchisés, depuis les «
écuyers » de cuisine jusqu’aux « sauciers », « potagiers » et « petits galoppins
de cuisine ». Il est vrai que la division du travail dans un si nombreux
personnel était poussée à l’extrême et que, par exemple, un des 30 « varlès
et aides de fourrère », Héliot Pélicon, n’ avait pour office que de « gouverner
le grant lévrier ». À cet état de l’ostel, il faut ajouter tous les peintres,
sculpteurs, architectes, émailleurs, etc., qui travaillaient pour le Duc
dans ses nombreux châteaux. Jean de Berri gouvernait tout ce monde avec despotisme,
mais aussi avec largesse. On connaît encore, dans le Berri, des familles
issues de ses serviteurs, qu’il faisait anoblir avec 1ibéralité.
Mais ses fantaisies étaient parfois singulières.
En 1408, un peintre allemand, dont le nom ne nous est pas parvenu, « besoignait
» pour lui dans son château de Wincestre-lès-Paris (Bicêtre). Le Duc de Berri
.entreprit de le marier et il jeta son dévolu sur une |17 petite
fille de bonne bourgeoisie, habitant Bourges et nommée Gillette La Mercière.
Or, la pauvre enfant n’avait que huit ans ! Sa mère et toute sa famille s’opposèrent naturellement
au mariage. Alors, furieux qu’on osât lui résister, le Duc de Berri fit saisir
la jeune Gillette et la fit interner dans son château d’Étampes.
Cependant, les parents ne s’inclinèrent pas et en
appelèrent au Parlement : un huissier fut envoyé à Étampes avec mission de délivrer
la prisonnière, mais il dut revenir sans avoir rempli sa mission, car les
gens du Duc ne se laissèrent pas intimider par un robin et ne rendirent pas
celle dont la garde leur avait été confiée. Le Parlement non plus ne voulut
pas céder dans ce conflit avec un prince tout puissant qu’il fût, et fit
citer les gens du Duc à comparaître devant lui. Jean de Berri perdit toute
mesure : il écrivit à Henri de Marles, premier Président de la Cour de Parlement,
« qu’il s’en prendroit à sa personne et à ses biens si la chose prenoit autre
conclusion qu’il ne ne l’avoit ordonné. »
Cette lettre causa un grand émoi. Le mardi 20 novembre
1408, « assez tost après neuf heures du matin, les seigneurs de la Cour de
Parlement s’assemblent, renvoient les avocats, les procureurs et autres gens
de robe qui occupaient les salles du Palais et, dans le calme, tiennent conseil.
On lit la lettre du Duc de Berri. Fort courageusement, le premier Président
Henri de Marles propose de se rendre auprès du Duc pour s’expliquer avec
lui. Mais cette suggestion est écartée et l’on décide qu’un certain nombre
des seigneurs présents iront en délégation, au nom du Parlement, « desmouvoir
(apaiser) ledit Duc. » Qu’advint-il de cette explication entre les magistrats
et le despotique Comte d’Étampes ? Nous ne le savons pas positivement, mais
nous voyons peu après que Marie du Brueil, veuve de Giles Le Mercier et mère
de Gillette, s’ adresse au Roi, ou plutôt à son Conseil, car le pauvre Charles
VI, atteint de démence, était incapable de prendre une décision. Gillette
est mise |18 entre les mains de la Cour de Parlement, puis confiée
en garde à Maistre Guillaume Le Clerc, conseiller du Roi. Le 11 février 1409,
« le grant maistre d’ostel du Roy » prend la charge de l’enfant, après avoir
promis à sa mère « en bonne foy par sa loyauté et conscience, qu’il fera
tout son pouvoir et diligence » pour épargner à la malheureuse Gillette un
nouvel emprisonnement.
Nous ignorons si la petite captive d’Étampes épousa
le peintre allemand : il semble que, cette fois, le Duc de Berri n’ait pu disposer
de cette enfant « comme il l’avait ordonné ». À cette époque, il avait 69
ans et son crédit baissait à la cour. Indécis

entre les deux partis qui se divisaient le royaume,
favorable tantôt aux Armagnacs et tantôt aux Bourguignons, il devait mourir impopulaire
quelques années plus tard, en 1416, à demi ruiné par les folles dépenses
qu’il avait engagées.
Cet épisode de la vie de Jean de Berri nous montre
avec quelle autorité il traitait les gens qui dépendaient de lui. Cette séquestration
d’enfant, bien qu’assez brève, puisque Gillette La Mercière ne demeura qu’une
année environ dans le château d’Étampes paraît monstrueuse à notre époque.
Mais il faut tenir compte de la rudesse des mœurs au XVe siècle
et pardonner beaucoup à un prince qui fut, en son temps, le plus généreux protecteur
des artistes et des lettrés.
R. de Saint-Périer.

15. Le Duc de Berry «
Étampes appartint au roi de France dès l’avènement
de la dynastie capétienne, à la fin du Xe siècle, et ne fut jamais
la propriété d’un seigneur féodal. Les rois firent de notre ville et d’un
vaste territoire autour d’elle un apanage, c’est-à-dire qu’ils en accordèrent
la donation tantôt à des princes du sang, tantôt à des favorites particulièrement
honorées. Mais l’apanage ne constituait qu’une sorte d’usufruit et devait
revenir au domaine royal à 1’extinction des héritiers mâles. La couronne
en conservait la propriété suprême, se réservait la garde des églises de
fondation royale, la connaissance des cas royaux, l’institution des magistrats
de tous les tribunaux, qui s’appelaient alors présidiaux, bailliages, élections.
Le prince apanagé percevait les revenus, nommait les officiers d’ordre inférieur
: au cours |6 des âges, ces pouvoirs furent de plus en plus limités.
Mais au XIVe siècle, nous voyons le roi Charles IV le Bel ériger,
pour son cousin Charles d’Évreux, la baronnie d’Étampes en comté, « nom plus
élégant et que justifient le charme du lieu, l’abondance et la richesse de
ses fruits », nous dit le titre d’ érection.
Après Charles d’Évreux et son fils Louis, le comté
d’Étampes passe aux mains de Jean de France, duc de Berry, comte
38 Annuaire d’Étampes pour 1948, pp. 4-27.
d’ Auvergne, dont nous voudrions évoquer, en ces
quelques pages, la physionomie intéressante à plus d’un titre.
Troisième fils du roi Jean II, dit le Bon, et de
Bonne de Luxembourg, fille du roi Jean de Bohême, il était né au château de
Vincennes, le 30 novembre 1340. Nous savons peu de chose de ses premières
années. Élevé dans une cour brillante où tout le luxe et toutes les formes
de l’art de l’époque se trouvaient réunis, le jeune prince dut recevoir une
éducation sérieuse, car il savait bien les langues anciennes et sa curiosité
de collectionneur averti montre que, dès sa jeunesse, il vécut dans un milieu
intelligent et raffiné. Cette race des Valois, issue des Capétiens directs,
éteints avec Charles le Bel, se distinguait par son amour des occupations de
l’esprit, son culte pour les lettres et les arts, un goût du luxe, |7
que les événements ne semblent pas avoir entravé. Les défaites de Crécy et
de Poitiers paraissent n’avoir été que des malheurs militaires, le désordre
et le pillage des campagnes, qui en furent la conséquence, ne durent guère
atteindre la cour, car malgré la dépréciation de l’argent, la misère publique,
les émeutes et l’occupation, par l’ennemi, d’une partie du royaume, on voit
les princes constituer des collections de joyaux et d’œuvres d’art, protéger
les artistes et les lettres comme en pleine Renaissance italienne. Cependant,
à 16 ans, ce fils de roi dut songer à faire ses premières armes. Mais ses
débuts à la malheureuse journée de Poitiers ne furent pas glorieux. L’armée
française, sous la conduite du roi Jean II en personne, vint attaquer l’armée anglaise,
bien moins nombreuse, mais mieux placée, soumise à une discipline de fer,
se servant judicieusement de son infanterie, dotée enfin d’un armement très
supérieur par la qualité de ses archers et de ses coustilliers (soldats armés
d’ un long poignard, la coustille). L’armée française comprenait des chevaliers
d’une bravoure incomparable, mais elle était indisciplinée, sans commandement
centralisé, cherchant surtout à exécuter de hauts faits d’armes individuels,
méprisant la piétaille, comme on appelait l’infanterie ; elle ne put triompher
|8 d’un adversaire inférieur en nombre, mais très supérieur en
technique militaire.
Dès le début de l’ action, le corps commandé par
le prince Charles, futur Charles V, et sous la conduite de celui-ci, par
notre jeune prince Jean, lâcha pied et ne put être rallié. Le roi, comprenant
que tout était perdu, eut du moins la présence d’esprit d’ordonner aux deux
princes de se retirer sur la ville de Poitiers et resta seul à lutter vaillamment
avec son 4e fils, Philippe, dit le Hardi, qui, malgré sa jeunesse,
ne l’abandonna pas. Couverts de poussière, la face sanglante, donnant de
grands coups d’épée comme les preux de jadis, le roi et son fils furent faits
prisonniers. Les pertes étaient considérables : si Crécy avait été une défaite,
Poitiers fut un désastre.
Jean II avait été emmené en Angleterre et, suivant
l’usage du temps, on discuta sa rançon. Les Anglais demandaient, outre la cession
de nombreuses provinces de France, quatre millions d’écus d’or, somme qui,
à cette époque, semblait fabuleuse. Elle fut réduite à trois millions et
ne put jamais être payée. Le traité de Brétigny avait permis au roi de revenir
en France en 1360, mais son fils, Louis d’Anjou, laissé en otage en Angleterre, s’étant
évadé, le roi chevaleresque repassa le détroit et revint se constituer prisonnier
à Londres.
Il y mourut après un an de cette nouvelle captivité,
qui avait été singulièrement adoucie par les égards dont il était l’objet
et aussi par les fêtes et les banquets qu’on offrait en son honneur.
Son fils Jean avait été également retenu en otage,
par deux fois, en Angleterre, mais il ne s’était point évadé comme son aîné.
De retour en France, il s’était vu constituer par son frère Charles, devenu
roi sous le nom de Charles V, de sérieux apanages en dédommagement du comté
de Poitiers qui lui avait été enlevé par les Anglais. Il obtint ainsi le
duché de Berry, le comté d’Auvergne, la lieutenance générale du Languedoc,
enfin en 1384, le comté d’Étampes. Par son mariage en 1360 avec Jeanne d’Armagnac,
il était devenu le chef de cette puissante maison du Midi, qui, ralliant
autour d’elle toute la noblesse de la région, joua un rôle si important dans
les guerres civiles de cette douloureuse époque. Veuf en 1388, il se remariait
en 1389, à Riom. à Jeanne, fille de Jean VI d’ Auvergne et d’ Eléonore de Comminges.
De ces deux mariages naquirent trois fils, morts avant leur père, et deux
filles, qui se partagèrent sa succession : la duchesse de Bourbon et la comtesse
d’Armagnac, mariée à un de ses cousins.
Notre comte d’Étampes fut mêlé à tous les |10
événements de l’époque si troublée où il vécut. On le voit à son retour d’Angleterre
diriger la guerre contre les Anglais, mais avec moins de fougue que ne l’avaient
fait son père et son grand-père. C’est de ses nombreuses résidences qu’il
surveillait l’ennemi, envoyait des ordres et des messages pour informer les
nôtres de ses mouvements, agissant plutôt en chef d’état-major qu’en combattant.
Son caractère était voisin de celui de son frère Charles V : studieux, curieux
de toutes les manifestations de l’art et de l’esprit, on ne les voyait pas
marcher à l’ennemi bassinet en tête et l’ épée à la main. Charles V fut le
premier roi de France qui ne chargea pas fougueusement sur le champ de bataille
à la tête de sa chevalerie. Il recherchait, dit un contemporain, la compagnie
de ceux qui « parlaient bel latin et estaient argumentatifs » et préférait
à la vie des camps le séjour au Louvre, dans sa librairie, comme on appelait alors la belle bibliothèque qu’il avait
formée. Le duc de Berry partageait ces goûts et rassembler des objets d’
art lui paraissait plus digne de ses soins, et sans doute aussi plus attrayant,
que de courir les hasards de la guerre.
Son mariage l’avait placé à la tête du parti armagnac,
qui était aussi celui du roi. Il entretenait en même temps de bons rapports avec
|11 son frère Philippe le Hardi, chef de la maison de Bourgogne,
et même avec son terrible neveu et filleul, Jean sans Peur, qui, malgré «
sa petite taille, sa grosse tête, ses yeux de grenouille et son bégayement
», était d’une violence redoutable et d’un commerce peu facile. Entre ces
deux partis, Armagnacs et Bourguignons, il semble que le duc de Berry sut
se maintenir assez habilement, non cependant sans être parfois blâmé par
les uns et par les autres, comme ceux qui ne savent ou ne veulent prendre
un parti entre deux camps opposés. Mais il est juste de reconnaître, maintenant
que les passions de l’époque sont loin de nous, que, comme homme politique
et comme chef militaire, il soutint toujours les Armagnacs, qui tenaient
le parti du roi, et par là le parti national. Si ses sympathies personnelles
étaient acquises à son frère et à son neveu de Bourgogne, il ne les suivit jamais
dans leurs attaques contre le pouvoir royal et ne s’allia jamais aux Anglais,
ennemis de la France. Au contraire, Jean sans Peur ne le ménageait pas, puisqu’il
assiégea sans scrupules le château de Bourges et celui de Bicêtre, qui appartenaient
à son oncle.
En 1406, le comte d’Étampes était arrivé à l’apogée
de sa puissance. Il dota cette année-là la Sainte-Chapelle de Bourges et
offrit à |12 cette occasion des fêtes somptueuses. Son rang à
la cour de France, son immense fortune le plaçaient tout à côté et peut-être
au-dessus du roi Charles VI qui, atteint de démence, ne gouvernait plus qu’en
ses rares instants de lucidité, et dont la femme, Isabeau de Bavière, pactisait
avec les ennemis du royaume.
Jean de Berry ne fut pas sans abuser d’ailleurs de
la faiblesse du roi, dont il obtint pour lui ou ses filles de nombreux dons
et, d’autre part, une dérogation aux règles ordinaires des apanages.
Il fut autorisé à disposer après lui du comté d’Étampes,
qui eût dû revenir à la couronne puisqu’ il avait perdu ses fils. Il le légua par
avance, en 1387, à son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, ce qui
entraîna pour notre ville et notre région les plus funestes conséquences.
Pendant près d’un siècle, en effet, les rois et les ducs de Bourgogne s’en
disputèrent la possession. Après la mort de Philippe le Hardi, le comté d’Étampes
allait passer entre les mains de son fils Jean sans Peur, quand celui-ci fit
assassiner son propre cousin, Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI. Indigné,
Jean de Berry révoqua sa donation et Jean sans Peur vint mettre le siège
devant Étampes, en 1411. Les habitants ouvrirent les portes de la ville aux
Bourguignons, dans l’espoir d’échapper au pillage, |13 mais il
ne leur fut pas épargné. Un fidèle officier du duc de Berry, Louis de Bosrédon, commandait
la garnison : il s’enferma d’abord dans le château puis dans le donjon —
la tour de Guinette — où il soutint encore pendant plusieurs jours une résistance
désespérée. Une fois de plus, la malheureuse ville servait d’enjeu aux passions déchaînées
qui ravageaient le pays.
La vieillesse de notre comte d’Étampes fut encore
assombrie par le désastre d’Azincourt, qui dut lui rappeler la fatale journée de
Poitiers où, peut-être pour la seule fois de sa vie, il avait connu le choc
de la bataille et la honte de la défaite. Il eut aussi la douleur de voir
le jeune dauphin Charles VII, qui gouvernait à la place de son père, s’enfuir
de Paris sous l’émeute de la population révoltée. L’année suivante, le 15
juin 1416, Jean de France expirait à Paris, en son hôtel de Nesle, laissant
à ses filles, à ses serviteurs et à ses créanciers une fortune encore très considérable
malgré ses prodigalités et le luxe de sa maison. Ses créanciers, qui étaient
nombreux, ne reçurent pas satisfaction, car le pouvoir royal fit saisir toutes
les matières précieuses d’or et d’argent qui leur étaient destinées pour
les faire fondre et solder les troupes armées contre les Anglais. Ce fait
explique sans doute les malédictions |14 dont parfois la mémoire
de Jean de France fut injustement l’objet.
Nous venons de voir ce qu’était le prince, voyons
maintenant ce qu’était l’homme.
Nous avons de lui un grand nombre de portraits, car
il aimait à se faire représenter, dans les miniatures de ses manuscrits,
sur les vitraux qu’il donnait aux églises, sur des pierres gravées. Enfin, d’après
son monument funéraire, qu’il avait fait édifier à Bourges, Holbein a fait
le beau dessin, conservé aujourd’hui au Musée de Bâle, que nous reproduisons
ici : face massive, large et courte, petits yeux malicieux, nez frémissant,
bouche aux lèvres épaisses et sensuelles, le duc de Berry n’évoque pas l’image
d’un prince de haute distinction, mais plutôt celle d’un paysan madré et
retors. Physionomie singulièrement attachante, cependant, par tout ce qu’elle
exprime d’intelligence, de force, de vie et de plaisir à vivre.
La puissante personnalité qu’elle révèle fut très
différemment appréciée par les contemporains et elle demeure difficile à
juger tant elle présentait de contrastes. Il n’est pas douteux que, pour satisfaire
son goût du luxe et des collections, il ait pressuré ses sujets, commis dans
ses domaines et dans son gouvernement du Languedoc des exactions nombreuses.
|15 C’était là les mœurs du temps, mais sa cupidité semble avoir
dépassé ce qui semblait naturel alors chez un prince de son importance. Il
avait en outre des fantaisies de despote parfois bien étranges. C’est ainsi
qu’il fit enfermer, en 1408, dans le donjon d’Étampes, une fillette de huit
ans, d’une bonne famille de Bourges, Gillette La Mercière, qu’il voulait
marier, en dépit de son jeune âge, à un peintre allemand qui travaillait
pour lui dans son château de Bicêtre. Il ne céda qu’aux injonctions du Parlement
et du Conseil du Roi, saisis par les parents de la fillette. Furieux d’être
contrecarré dans
ses projets, il avait écrit au premier président
de la Cour du Parlement, Henri de Marle, « qu’il s’en prendrait à sa personne et
à ses biens si la chose prenait autre conclusion qu’il ne l’avait ordonné
», menace qui dépeint bien la violence et l’autoritarisme du personnage.
On ne doit voir aucune perversité en cette singulière affaire, car rien de
sa vie ne permet d’attribuer des mœurs coupables à notre comte d’Étampes.
Il mena toujours une existence régulière, contrairement à tant de princes
qui donnèrent l’ exemple de la débauche.
À côté de ce despotisme, de ces injustices, de cette
âpreté, il y avait chez lui une incontestable générosité qui se manifestait
à l’égard |16 de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui faisaient partie
de sa maison. Il distribuait de larges aumônes aux pauvres, des étrennes
magnifiques à ses artistes préférés, anoblissait fréquemment ses officiers
et il était fort prodigue de cadeaux. De même, ses violences de caractère
ne faisaient pas obstacle en lui à une cordialité joviale et simple, qui
lui faisait accepter des plaisanteries qu’un prince susceptible et hautain
n’eût pas admises. C’est ainsi que Pol de Limbourg et ses deux frères, peintres
de miniatures au service du duc, lui offre « un livre contrefait d’une pièce
de bois paincte en semblance d’un livre, où il n’a nul feuillet ni rien escript
». Cette facétie, qui manque peut-être de finesse, dut faire bien rire notre
prince.
Son intelligence était vaste et sa culture fort étendue.
Son éloquence et la souplesse de sa dialectique lui permettaient de mener
à bien des négociations diplomatiques où il rendit plus de services qu’il
ne l’eût fait en menant des armées en campagne. Son rôle dans la politique
de son temps fut considérable. Il soutint l’autorité royale contre les princes
ambitieux alliés aux ennemis de la France et contribua à faire triompher
l’ ordre et la paix.
Notre prince mena toujours une vie fastueuse conforme
à ses goûts. Il était en possession |17 d’immenses domaines et
fit élever ou reconstruire dix-sept châteaux ou hôtels. Outre son hôtel de Nesle
à Paris et son palais à Bourges, il possédait le château de Mehun-sur-Yèvre,
dont une tour, avec une pièce assez bien conservée, existe encore, la maison
royale de Vaux-la-Reine, près de Combs-la-Ville (S.-et-M.), le château de
Bicêtre, un hôtel à Saint-Marcel-lez-Paris, les châteaux de Dourdan et d’Étampes, le
château de Nonette, en Auvergne, un des plus puissamment fortifiés de la
province, en Poitou, le château de Lusignan et celui de Poitiers, un hôtel
à Rouen, un château encore à La Grange, qui n’a pu être identifié en raison
de ce nom très répandu en France, etc... Ces diverses résidences étaient
ornées et embellies par les soins des artistes, principalement les « imagiers
» (sculpteurs), que le duc entretenait dans chacune d’elles, et toutes étaient meublées
avec somptuosité. On voit encore dans la seule salle conservée du château
de Mehun-sur-Yèvre des crochets en fer scellés dans les murailles, où l’
on suspendait des tapisseries pendant les séjours du prince. Il passait de
l’une à l’autre de ces habitations, suivant ses occupations, ses fantaisies
ou les besoins de son gouvernement. Étampes et Dourdan lui servaient sans doute
de gîte d’étape lorsqu’il se rendait de Paris à Bourges. |18
Un pareil luxe de bâtiments impliquait une domesticité
nombreuse. La maison du duc de Berry ne comportait pas moins de 250 personnes,
dont 17 chambellans, 4 maîtres d’hôtel, 2 physiciens ou médecins, 9 secrétaires,
9 pannetiers, 13 échansons, 8 « varlets tranchans », 120 domestiques employés
à la cuisine, à l’office, aux chambres, 31 clercs d’écuries et pages, 30
fourriers, 3 chevaucheurs pour les commissions et le courrier. Ce nombreux
personnel était fort spécialisé et chacun n’accomplissait qu’une tâche bien
déterminée. C’est ainsi qu’Hélion Pélicot avait pour fonction « de gouverner
le grand lévrier ». En effet, Jean de France aimait beaucoup les chiens et il
en faisait élever un grand nombre, de races diverses, dans ses chenils :
chiens courants du Berry, fort estimés à l’époque, dogues, mâtins, épagneuls.
Il les faisait venir parfois d’une de ses résidences à une autre ; ainsi
le 29 mai 1400, il fait conduire ses épagneuls, qui étaient en pension à
Étampes, chez la dame Jehan Paris, dans un de ses châteaux, sans doute assez
éloigné, car le voyage coûte 4 livres 10 sols.
Il entretenait bien d’autres animaux, des oiseaux
de toutes espèces, même une autruche, des cygnes qui ornaient les pièces d’eau
de ses propriétés, un dromadaire, auquel est affecté, |19 comme
à l’autruche, un gardien spécial. Mais sa prédilection allait aux ours, peut-être
parce que le nom de l’ours en anglais, en allemand et dans les langues scandinaves
est très voisin de Berry. Il en fait représenter sur des objets d’art, sur
ses pièces d’orfèvrerie, dans les peintures de ses manuscrits. Un ours et
un cygne tiennent souvent l’écusson de ses armes avec sa devise : « Le Temps viendra ». Il possédait quelques ours vivants, dont il se plaisait
à suivre les ébats dans leur enclos, et lors de ses déplacements, il les
emmenait parfois avec lui, dans une charrette, sous la conduite de leurs
gardiens. Mais les ours ne sont pas toujours d’humeur accommodante et, malgré
la surveillance dont ils étaient l’objet, il se produisait quelquefois des
accidents, puisque nous voyons l’archer Lorin recevoir, en 1398, 45 sols
tournois « pour se faire guérir de la blessure qu’il a reçue de l’ours de
Monseigneur ».
La maison de Jean de France comprenait encore un
certain nombre de bouffons, ménestrels et acrobates, auxquels venaient souvent
se joindre les jongleurs ambulants, afin de le divertir par leurs jeux et
leurs tours à l’issue de ses repas plantureux. Une des plus belles miniatures
de l’un de ses manuscrits nous le montre à table, le dos au feu d’une vaste
cheminée, protégé cependant par un grand écran |20 de jonc, vêtu
d’une longue robe bleue brodée d’ or, coiffé d’ un bonnet de fourrure, abrité
par un dais rouge qu’ornent ses écussons environnés d’ours et de cygnes.
Le duc est entouré de ses serviteurs, écuyers tranchants et panetiers, qui coupent
les parts, échansons qui versent les vins, et de ses hôtes, qui se chauffent
les mains au feu ; des petits chiens familiers se promènent avec une singulière
liberté sur la table, au milieu des plats et de la riche orfèvrerie, tandis
qu’un grand lévrier (sans doute celui que gouverne Hélion Pélicot) est couché
à terre. De splendides tapisseries à personnages décorent la salle. Nous saisissons
ici notre prince dans sa vie même et sa majestueuse bonhomie est aussi frappante
que la riche élégance de son milieu.
Mais c’est surtout l’amateur éclairé et enthousiaste
de toutes les belles choses qu’il faut admirer en Jean de Berry. Il avait
la passion de tout ce qui est beau et rare : pierres précieuses, joyaux, orfèvrerie,
camées, pierres gravées, ivoires, porcelaines, médailles, tapisseries, broderies,
objets d’histoire naturelle, reliques, bibelots légendaires, livres, tableaux,
sculptures. Il recherchait partout ce qui lui plaisait, en France, dans les
pays étrangers et surtout en Orient. Il aimait interroger les voyageurs qui
revenaient de cette région, encore quelque |21 peu mystérieuse,
et payait fort cher les objets qu’ils en rapportaient. Il était en relation
avec les marchands vénitiens et florentins qui lui procuraient des objets
d’art byzantins et des pierres précieuses, les uns provenant de Constantinople,
les autres de l’Inde. C’est de là que lui vinrent les rubis incomparables
de sa collection. Cette pierre était déjà au moyen âge plus estimée que le
diamant, et le duc de Berry possédait les vingt plus gros rubis connus à
cette époque. Il possédait aussi des diamants et des saphirs, peu d’émeraudes,
qu’il ne semblait point apprécier, mais des perles admirables. Ces pierres,
ainsi que les joyaux, étaient confiés à un garde du trésor, un de nos compatriotes,
Robinet d’Étampes, à qui nous devons un inventaire détaillé et minutieux de
ces collections. Cet important document nous apprend qu’une partie des joyaux
étaient destinés à orner les robes, les bonnets, les ceintures du comte d’Étampes,
mais que les joyaux d’église, vases sacrés, ostensoirs, patènes, reliquaires
en or, incrustés de pierreries, quelques-uns même des précieux rubis, étaient beaucoup
plus nombreux encore, la piété du duc étant fort grande. C’est ainsi qu’il
recherchait vivement les reliques et avait acquis celles d’un grand nombre
de saints. Quelques-unes, insignes, comme des morceaux de la |22
vraie croix, avaient été prises par lui à la Sainte-Chapelle de Paris, qui
les réclama et en obtint la restitution après sa mort ; on reconnaît ici
la manière forte de notre prince. D’autres reliques nous font sourire par
leur naïveté, comme le lait et une dent de la Vierge, l’ anneau nuptial de
saint Joseph ; mais le duc n’y croyait peut-être qu’à demi lui-même, puisque
la mention de ces objets exceptionnels est précédée des mots prudents : «
qu’on dit être ».
Sa croyance en la vertu thérapeutique d’une autre
série d’objets rares était certainement très ferme : il s’agit des antidotes
contre les poisons. À toutes les époques, les personnages de quelque importance
ont redouté d’être empoisonnés. Jean de France n’échappait pas à la règle,
et suivant l’usage de son temps, il possédait contre les toxiques des armes
qu’il estimait puissantes : quatre cornes de licorne (sans doute des défenses
de narval), des langues de serpents dont on garnissait les salières au cas
où le sel serait mélangé de poison, des crapaudines, des pierres de chapon, des
bézoards. Il attachait une telle importance à ces antidotes qu’il laissa
par testament à chacune de ses filles une corne de licorne pour les défendre
elles-mêmes contre le poison.
Son cabinet d’histoire naturelle comprenait les pièces
les plus diverses : noix d’Inde, |23 coquilles de mer, pierres
de cristal, de jaspe, d’aimant, d’autres, appelées « paviots », de couleur
verte devenant vermeille quand on les regarde par transparence, autres pierres
encore qui préservaient de la soif, œufs d’autruche, mâchoires de serpent,
défenses de sanglier, hérissons de mer, aiguillons de porc-épic, une « machelière
de géant » (sans doute une molaire d’éléphant), une dent de baleine, une
peau d’ours blanc.
Nous ne connaissons malheureusement que par leur
inventaire les nombreuses tapisseries à sujets religieux, allégoriques, militaires,
que le duc avait acquises ou fait exécuter pour orner les murs des vastes
salles de ses résidences. Il nous reste cependant au Musée des Tapisseries
d’Angers une grande tapisserie, dite de l’Apocalypse, faite
pour son frère, le duc d’Anjou, entre 1377 et 1380, qui nous donne une idée
de ce que devaient être celles du duc Jean, de l’éclat de leur coloris, de l’expression
vivante des personnages.
L’ intérêt des monnaies et des médailles antiques
n’ échappait pas à notre collectionneur si particulièrement averti. Il fut
le premier à constituer une collection numismatique à cette époque. Deux
de ses monnaies d’or sont conservées encore aujourd’hui au Cabinet des Médailles,
et l’on a pu vérifier ainsi l’exactitude |24 de leur description
et de leur légende, donnée par Robinet d’Étampes dans son inventaire.
Le plus haut titre de gloire de notre prince est
d’avoir aimé les beaux livres et les œuvres d’art et passionnément encouragé
les artistes qui les exécutaient pour lui. Il fut un véritable bibliophile, au
sens moderne du mot, s’ attachant au texte de ses ouvrages comme à leur beauté
matérielle, calligraphie et miniatures. Il ne possédait pas moins de trois
cents manuscrits, quelques-uns en plusieurs volumes, traitant des sujets
fort divers : philosophie, religion, chroniques, romans de chevalerie, romans contemporains,
qui représentaient une encyclopédie des connaissances de son époque. Beaucoup
de ces ouvrages étaient décorés par les plus grands artistes de son temps,
qu’il faisait venir d’Italie ou des Flandres et qu’il entretenait à ses frais.
Nous avons conservé heureusement soixante-dix-huit de ces manuscrits, et
sans doute le plus magnifique, orné par Pol de Limbourg et ses frères : un
livre de prières, dit Les très riches Heures de Jean de France. Outre sa beauté exceptionnelle, il est d’un intérêt particulier
pour les Étampois parce qu’il contient une miniature du château d’Étampes,
tel qu’il existait au début du XVe siècle. On reconnaît aisément
|25 notre tour de Guinette à sa forme très spéciale, mais elle
était alors beaucoup plus élevée, surmontée d’un toit pointu en tuiles rouges
et terminée par une tourelle de guetteur. Le château comprend, autour du
donjon, une série de bâtiments, une chapelle et deux enceintes, dont une
à créneaux : notre Guinette mutilée est tout ce qui subsiste de ce majestueux
ensemble.
Des sculptures, des tableaux, des vitraux qui décoraient
les riches demeures du comte d’Étampes ou qu’il offrait en don, il reste
malheureusement peu de chose. Mais nous citerons deux statues de la Vierge,
qui proviennent de ses libéralités, et qui nous ont été conservées. L’une
à Riom, dite : «
La Vierge à l ’Oiseau », orne le trumeau de la
porte principale de l’église de N.-D.-du-Marthuret, jeune vierge d’une grâce
inimitable, qui sourit avec une tendre extase à l’Enfant Jésus, dont la main
gauche tient un oiseau. En belle pierre blanche du Berry, elle éclaire tout
le seuil de cette sombre église, construite en lave de la région. Et non
loin d’Étampes, à Marcoussis, nous avons une statue toute différente, en
marbre blanc, donnée par Jean de France aux religieux Célestins, dont l’ancienne
chapelle est aujourd’hui l’église paroissiale. La Vierge nous apparaît ici
comme une solide paysanne |26 de chez nous, fière de son robuste
enfant. Le vigoureux réalisme de cette belle œuvre en fait un des spécimens les
plus intéressants de la sculpture française du XIVe siècle.
Enfin tous nos compatriotes reçoivent encore chaque
jour, beaucoup peut-être sans le savoir, une marque directe de la munificence
du comte d’Étampes pour sa ville. Nous voulons parler de la grosse cloche
de Notre-Dame, donnée par lui à la Collégiale en 1401.

Marie la Grosse descendue
à l’occasion de sa restauration en 2010-2011
Elle a heureusement échappé, sans doute en raison
de son poids qui en rendait la descente extrêmement difficile, à la fonte
systématique des cloches pour la fabrication des canons, qui fut ordonné
en 1793 par le citoyen Couturier, délégué
de la Convention auprès du district d’Étampes. La
cloche de Notre-Dame porte cette inscription : « Marie ay nom la Grosse, engroissie
et nommée par Jehan de Berry, d’Estampes-la-Vallée comte, en l ’an mil quatre
cent et ung, fu coulée pour Dieu céans louer et sa mère honorée ».
C’est le seul témoignage qui nous reste de l’attachement
pour notre ville d'un prince qui ne manquait jamais de faire figurer parmi
ses titres celui de comte d’Étampes. On sait combien après lui notre malheureuse
cité connut de sièges, de pillages, de destructions. Le château a disparu,
les remparts qui s’appuyaient |27 sur lui pour descendre jusqu’à
la rivière n’existent plus. De la tour si vaillamment défendue en 1411 par
Louis de Boresdon, si haute, alors, qu'aucun projectile n'en atteignait le
faîte et que les dames d’Étampes qui s’y étaient réfugiées tendaient, dit-on,
leur tablier pour narguer l'impuissance des assaillants, il ne reste qu’un
donjon découronné et béant. Là comme partout, le temps efface et ruine l’œuvre
des hommes. Pourtant celle de Jean de France échappe pour une large part
à cette action destructrice. Si ses collections sont ou détruites ou dispersées,
il en demeure des spécimens et des traces précises qui nous permettent d’apprécier leur
beauté et leur importance, le rayonnement qu’elles exercèrent en ces temps
si troublés et la contribution qu’apporta au développement de l’art français
l’amateur éclairé et généreux qui sut les réunir. Quand la belle voix de
Marie-la-Grosse, la vieille cloche que nous lui devons, emplit notre vallée
de sa musique profonde, pensons à lui avec gratitude, parce qu’il sut faire
un usage judicieux et magnifique de sa richesse, parce qu’il aima et encouragea
ce qu’il y a de meilleur dans l’homme : le goût de la recherche, de la beauté
et de la réalisation artistique.
René de Saint-Périer.
Morigny, le 1er mars 1947.
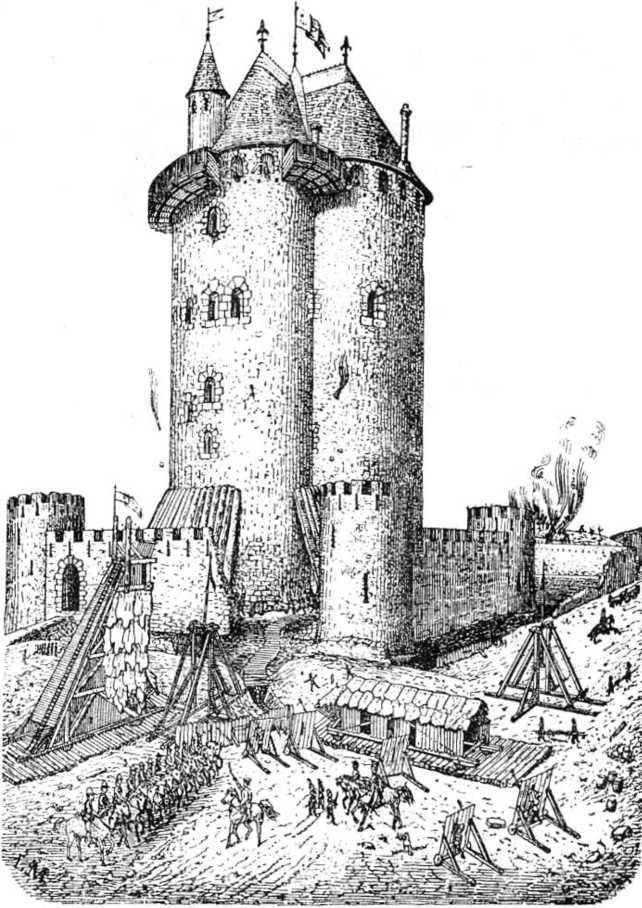
SIÈGE DU CHATEAU D’ÉTAMPES EN 1411.
134
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES
Logo du Corpus Étampois dessiné par Gaëtan Ader.
— Ex-libris du comte de Saint-Périer, p. 1. — Archives des Saint-Périer aux
AD91, cote 76J 17 (cliché de Bernard Métivier), p. 6 — Archives des Saint-Périer
aux AD91, cote 76J 5 (scan d’Yves Morel), p. 11. — Gravure de Jules Lepoint-Duclos,
1938, p. 8.
— Figures empruntées aux éditions originales de
ces articles, pp. 8, 32, 34, 80, 82, 98, 116. — Site internet des Archives nationales,
p. 36. — Clichés de Bernard Gineste (2003-2016), pp. 46, 58, 96 et 131. —
Clichés Rameau, pp. 52 (c.p.a. Guilloteaux), 92 (c.p.m. Rameau, vers 1955)
et 102 (c.p.a. Houet-Veston). — Détail du plan Mappy (© Tomtom) — Bulletin Monumental de 1909 (p. 62, figure 26), p. 99. — Site internet de la
CGB, p. 100. — Wikicommons, pp. 104, 110, 114.
— Dessin de Léonce Balas (1947) d’après Holbein,
p. 116. — Dessin de Léon Marquis (1873), p. 133.
136
Table
des Matières
Préface
3
Bibliographie
4-7
01
Les origines et le Moyen-âge (1938) 8-30
02 Une plaque de ceinturon
mérovingienne
(1931)
32-35
03 Une découverte dans
le passé de Morigny
(1950)
36-40
04 Découverte d’un
fond de cabane ancienne à
Morigny (1920) 41 -44
05 Le Jugement dernier
du portail de Saint-
Basile
(1948) 46-50
06 La grille romane
de l’ancienne abbaye de
Morigny
(1953) 52-56
07 Une grille romane
conservée au Musée
d’Étampes
(1954) 58-72
08 Donation d’un domaine
près d’Étampes par Philippe-Auguste à l’Ordre de Saint-Jacques en
1184
(1960) 74-78
09
Le bel envers d’un évier (1933) 80-84
10
Sépultures anciennes à Saclas (1913) 86-90
11
Le cimetière de Champigny (1946) 92-95
12 Objets du Moyen-Age
découverts à Étampes
en 1923 (1924) 96-101
13 Un meurtre à Étréchy
en 1395 (1924) 102-108
14 Une prisonnière
au château d’Étampes au
XVe siècle
(1924) 110-115
15 Le duc de Berry
(1947) 116-133
Crédits photographiques
135
Table des matières 137
Le monde des Saint-Périer
— tome 3 LE SUD-ESSONNE MÉDIÉVAL
Préface.—Bibliographie.—01. Les origines et le Moyen-âge.
— 02. Une plaque de ceinturon mérovingienne. — 03. Une découverte dans le passé
de Morigny. — 04. Découverte d’un fond de cabane ancienne à Morigny. — 05.
Le Jugement dernier du portail de Saint-Basile. — 06. La grille romane de
l’ancienne abbaye de Morigny. — 07. Une grille romane conservée au Musée
d’Étampes.—08. Donation d’un domaine prés d’Étampes par Philippe-Auguste
a l’Ordre de Saint-Jacques en 1184. — 09. Le bel envers d’un évier.—10. Sépultures
anciennes à Saclas.
— 11. Le cimetière de Champigny. — 12. Objets du
Moyen-Age découverts à Étampes en 1923. — 13. Un meurtre à Étréchy en 1395.
— 14. Une prisonnière au château d’Étampes au XVe siècle.
— 15. Le duc de Berry.
1
Cette dernière
phrase est supprimée dans la réédition de 1964 (B. G.).
22
2
Ce paragraphe
est censuré par la réédition de 1964 (B. G.).
3
Ce paragraphe
est supprimé
4
Ici commence
le chapitre II de la Grande Histoire d’une petite ville (B. G.)
5
Bulletin de la Commission départementale
des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 45-46 (1931), pp. 125-126.
6
L.-Eug.
Lefèvre, Commission
des antiquités et des arts de Seine-et-Oise XXXI, 1911, p. 185.
7
Canton
de Milly, arr. de Corbeil.
8
F. M. Album
Caranda, pl. (nouvelle série) 17, 21, 26, 27, 41, 46, 145, 146, etc.
9
Id. pl.
26, n°2 et pl. 41, n°1.
10
Saint-Périer
ajoute ici « 2/3 grand. nat. », ce qui n’est plus vrai dans cette réédition
(B. G. 2013).
11
J. Quicherat,
Histoire du costume
en France, Paris,
1877, p. 86. Cf. Album Caranda, pl. 60.
12
L.-Eug. Lefèvre,
loc cit.
13
Bulletin de la Société des Amis
d’Étampes et de sa région 6 (avril 1950), pp.98-99 (B. G. 2013).
14
Scriptorium II, 1 (1948), p. 37.
15
L ’Abeille d’Étampes 6 (24 avril 1920), p. 1.
16
Bulletin de la Société des Amis
d’Étampes et de sa région 4 (février 1948), pp. 60-61.
17
Bulletin archéologique du Comité
des Travaux historiques et scientifiques (1953), pp. 86-89.
18
Bulletin de La Montagne Sainte
Geneviève et ses abords 45/1 (mars 1954), pp. 2-10, sous le chapeau
suivant : « Conférence faite par madame de Saint-Périer le 20 février 1954
».
19
Victor
Nourry (B. G.)
20
Bulletin des Amis d’Étampes et
de sa région 10 (1960),
pp. 8-9.
21
« La commanderie
de Saint-Jacques à Étampes », in Bulletin des Amis d’Étampes et de sa région 10 (1960), pp. 3-7.
22
L’Abeille d’Étampes 122/30 (29 juillet 1933), p.
1.
23
L’Abeille d’Étampes 102/41 (11 octobre 1913), p.
2.
24
Lieutenant-Colonel
Dervieu, Bulletin
Monumental, 1909.
25
Bulletin de la Société Les Amis
du Musée d’Étampes et de sa région 1 (août 1946), pp. 6-7.
26
Légère erreur
de l’auteur puisqu’on fait vivre Tertullien à Carthage des environs de 155
à ceux de 220 (B.G.).
27
Bulletin de la Société des Amis
du Musée d’Étampes
6 (19231924), 1925, pp. 29-32.
28
H. d’Allemagne.
— Rapport sur le Musée Rétrospectif de l’Éclairage à l’Exposition de 1900,
in-8°, p. 11 et 22.
29
Communication
de M. Joseph Guyot, de Dourdan.
30
Collection
de M. Maxime Legrand.
31
Lieutenant-Colonel
Dervieu. — La Poterie au Moyen-Âge. — Bulletin Monumental, 1909, fig. 26 [reproduite ci-dessus
(B.G.)].
32
est intéressant d’observer l’exhaussement du sol
depuis |32 le XVe siècle, puisque les objets ont été
recueillis à plus de 4 mètres de profondeur, et aussi de rappeler que c’est
non loin de là, au n° 4 de la rue du Château, qu’ont été récoltés en grand
nombre,
33
Maxime Legrand.
— Bulletin de la
Société des amis du musée d’Étampes, n° 5, 1922, p. 24.
34
L’Abeille d’Étampes 113/23 (31 mai 1924), p. 1, sous
la rubrique « Notes d’histoire locale » (saisie de Bernard Gineste, 2004).
35
Archives
nationales JJ 148, fol. 74, pièce 132.
36
Sic (B.G.
2013)
|
BHASE n°33
(octobre 2016)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page
est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique
et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes
et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase033w.pdf
|
|
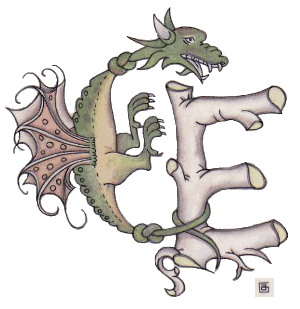
|