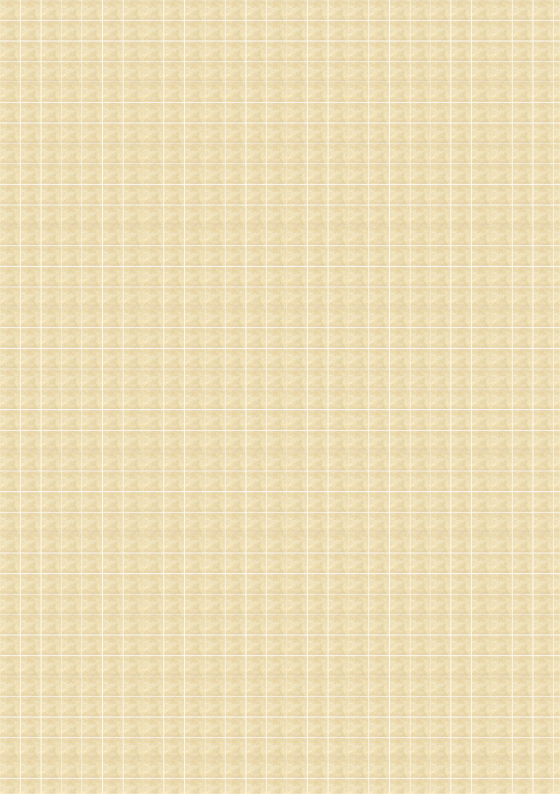
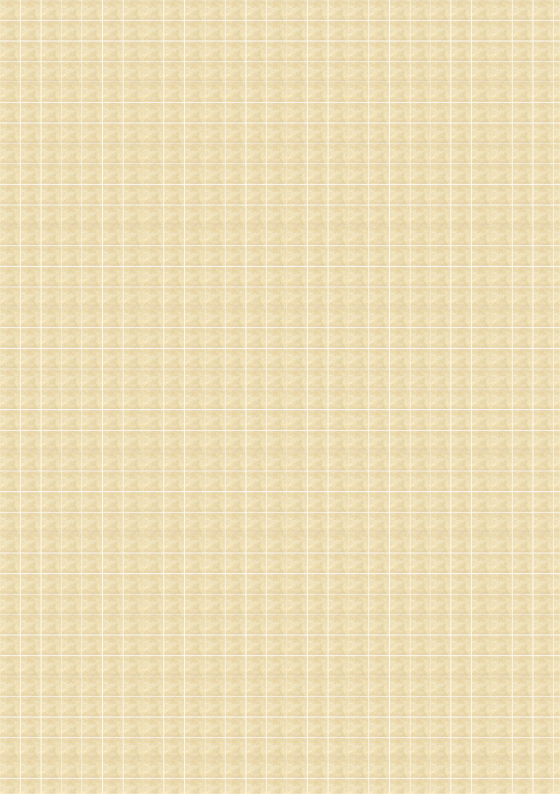
BHASE n°18 (juillet 2015)
Préface | 3-4 |
01. Acte de naissance (1881) | 5-6 |
02. Acte de mariage (1905) | 7-9 |
03. Foire Saint-Michel (1912) | 10-17 |
04. Étampes en ballon (1912) | 18-34 |
05. Dossier photo (1906-1914) | 35-63 |
06. Foire Saint-Michel (1913) | 64-72 |
07. La nuit en ballon (1913) | 74-85 |
08. 1650 km en ballon (1913-1914) | 87-178 |
09. Fiche matricule | 179-182 |
10. Départ pour le front (1914) | 183 |
11. In memoriam (1914) | 185-188 |
12. Premier reportage (1915) | 189-192 |
13. Deuxième reportage (1915) | 193-196 |
14. Troisième reportage (1915) | 197-205 |
15. Quatrième reportage (1915) | 207-218 |
16. Première blessure (1915) | 219 |
17. Cinquième reportage (1915) | 221-228 |
18. Promotion (1916) | 229 |
19. Seconde blessure (1916) | 231 |
20. Légion d’honneur (1917) | 233-234 |
21. Au Journal Officiel (1917) | 235 |
22. Au Livre d’Or (1919) | 237-238 |
Crédits et Table des matières | 239-241 |

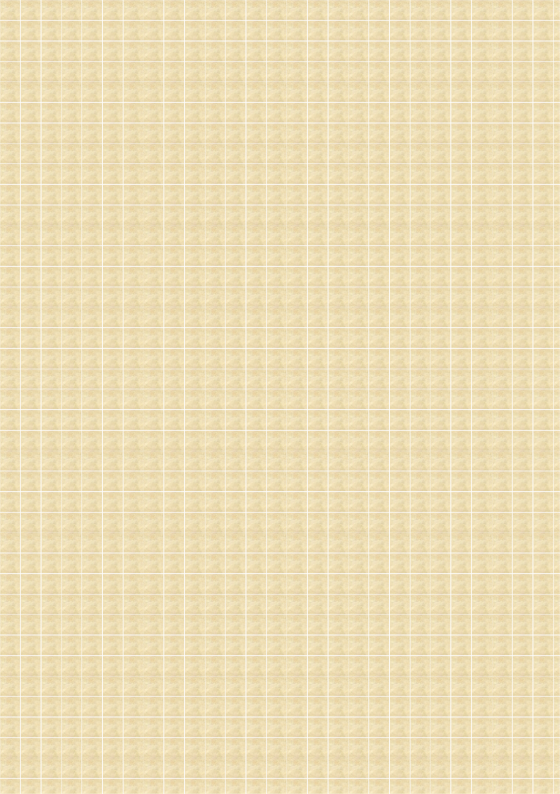
Publication du Corpus Étampois,
Directeur de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE n°18
Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne
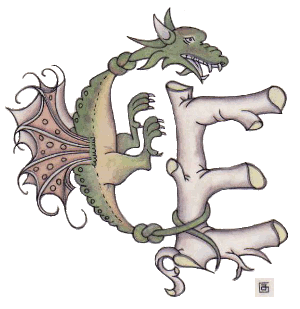
Publié par le Corpus Étampois
juillet 2015
Préface
Ce numéro 18 du BHASE est consacré à un personnage important du pays étampois, à savoir Maurice Dormann. Personnage à multiples facettes, sur lequel nous avons déjà donné deux documents dans le BHASE n°1, notamment son Autojustification inédite sur son comportement pendant la période de l’Occupation.
En lui sont intéressants et l’autodidacte et le nouvelliste, et le poète et le journaliste, et le chef d’entreprise et l’acteur social, et le grand mutilé de guerre et l’homme politique, et qui d’autre encore ? Mais ce numéro du BHASE se contentera de livrer quelques documents attestant le courage physique de notre personnage tant dans sa vie civile que militaire.
D’où le titre de ce numéro : Les aventures de Maurice Dormann, numéro dont le sujet nous a été inspiré par la découverte et l’acquisition d’un ouvrage fort rare et même apparemment jusqu’ici inconnu de Dormann. Il s’agit du récit autobiographique et pittoresque de son troisième voyage en ballon, voyage qui le mena d’une traite de Paris en Russie, quelques jours avant 19141.
1 Cet ouvrage dont aucun exemplaire n’est conservé à la BNF reprend en fait le texte de trois articles successifs du Réveil d’Étampes, qui, eux- mêmes sont très difficiles d’accès puisque les numéros en question
Partant de là nous y avons joint les récits par Dormann lui- même de deux autres voyages en ballon effectués depuis Étampes en 1912 et 1913, également difficiles d’accès2, complétés de quelques extraits de journaux et de quelques illustrations éclairant le contexte de ces trois événements pittoresques d’avant-guerre.
Cette même année 1914, au début de laquelle Maurice Dormann revient de Russie, voit éclater la guerre où il perdra une jambe, après avoir donné plusieurs reportages des plus intéressants. Nous en donnons la teneur extraite du journal L’Abeille d’Étampes et le Réveil d’Étampes3, et nous arrêtons cette compilation au moment où, blessé pour la deuxième fois, mais cette fois plus gravement, il commence une nouvelle
période de sa vie, sur laquelle nous espérons publier quelque jour un autre numéro du BHASE.
Nous n’essayons pas d’être exhaustifs, mais de faire connaître d’une manière aussi consistante que possible, à ceux qui l’ignoreraient, ou qui l’auraient oublié, une figure considérable de l’histoire du pays d’Étampes.
Bernard Gineste et Bernard Métivier, été 2015
manquent dans les collections des archives communales et départementales, et ne sont consultables que depuis peu à la BnF, moyennant une autorisation spéciale.
2 Le numéro du Réveil d’Étampes qui raconte le voyage de 1912 a été consulté aux Archives municipales, n’étant pas présent dans la collection
départementale ni consultable à la BNF. Celui qui raconte le voaye de 1913 a été consulté à la BNF où ne sont consultables à ce jour, dans toute la série du Réveil d’Étampes, que les années 1913 et 1914.
3 Ces deux journaux avaient alors fusionné pour la durée de la guerre dans le cadre de l’Union sacrée.
Acte de naissance (1881)
N°15 naissance de Maurice Dormann – L’an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-un avril, à huit heures du matin, par devant nous Louis Antoine Gardien, maire et officier de l’état civil de la commune d’Étréchy, a comparu le sieur Joseph Louis Dormann, cordonnier-bottier, âgé vingt-cinq ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, qu’il nous a dit être né hier, à trois heures du soir, en son domicile, de lui et de Marie Célestine Grelet, son épouse, sans profession, âgé de vingt-deux ans, avec laquelle il demeure, et auquel enfant il a donné le prénom de Maurice. Les dites déclarations et présentation ont été faites en présence de Joseph Ignace Dormann, cordonnier, âgé de soixante-cinq ans et de Jules Clipet, journalier, âgé de vingt-cinq ans, tous deux demeurant en cette commune. Et ont le déclarant et les témoins signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite. – [Signé :] Dormann – J. Clipet – Dormann – Gardien.
Trois mentions marginales :
Marié le vingt février 1905 à Étampes avec Renée Laure Humbert-Droz. Pour mention, le greffier [paraphe].
Marié à Paris VII le vingt huit mai mil neuf cent trente avec Geoffroy Alice Marguerite. Le 4 juillet mil neuf cent trente. Le Greffier [Paraphe].
Décédé à Paris 16e, le 17-12-47 [Paraphe].
Acte de mariage (1905)
L’an mil neuf cent cinq, le lundi vingt février, à dix heures du matin, par devant nous Charles Auguste Dujoncquoy, officier d’académie, premier adjoint, officier de l’état civil spécialement délégué par monsieur le maire de la ville d’Étampes, département de Seine-et-Oise, sont comparus Maurice Dormann, compositeur-typographe, âgé de vingt-trois ans, domicilié avec ses père et mère ci-après nommés, né à Étréchy (Seine-et-Oise), le vingt avril mil huit cent quatre-vingt-un, faisant partie de la réserve de l’armée active ainsi que le constate son livret militaire qu’il nous a représenté et qui lui a été rendu, fils mineur, quant au mariage, de Joseph Louis Dormann, cordonnier, âgé de quarante-neuf ans et de Marie Célestine Grelet, son épouse, sans profession, âgée de quarante- six ans, demeurant ensemble à Étréchy, ici présents et consentants au mariage de leur fils. Et demoiselle Renée Laure Humbert-Droz, sans profession, âgée de vingt ans, domiciliée avec son père ci-après nommé, née à Essonnes (Seine-et-Oise), le seize septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, fille mineure de Louis Nicolas Félix Humbert-Droz, imprimeur, âgé de quarante-six ans, demeurant à Étampes, rue Saint-Mars, numéro 16, ici présent et consentant au mariage de sa fille et de Marguerite Clotilde Clarisse, son épouse, décédée en cette ville le huit août mil neuf cent. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les publications ont été
faites en cette mairie ainsi que le constate l’acte annexé et en celle d’Étréchy les deux dimanches cinq et douze de ce mois sans opposition, et nous ont présenté leurs actes de naissance délivré les vingt-neuf et trente-un janvier mil neuf cent cinq, un certificat délivré par maître Masson, notaire à Étampes, constatant qu’ils ont fait un contrat de mariage devant lui le vingt-huit janvier dernier et le certificat de publications et de non opposition délivré par monsieur le maire d’Étréchy après l’expiration des délais prescrits par la loi. Et après avoir vérifié sur nos registres de l’état civil l’acte de décès de la mère de la future, nous avons visé, pour être annexées, les autres pièces énoncées ci-dessus et avons donné lecture du tout aux parties comparantes assistées des quatre témoins ci-après nommés et qualifiés ainsi que du chapitre six du titre du mariage sur les droits et devoirs respectifs des époux. Ensuite nous avons reçu la déclaration de Maurice Dormann qu’il prend pour son épouse mademoiselle Renée Laure Humbert-Droz et celle de mademoiselle Renée Laure Humbert-Droz qu’elle prend pour son époux Maurice Dormann. En conséquence, nous avons déclaré, au nom de la loi, que Maurice Dormann et Renée Laure Humbert-Droz sont unis par le mariage. Tout ce que dessus fait publiquement à Étampes en l’hôtel de la mairie, les dits jour, mois et an, en présence des témoins ci-après nommés, primo, du côté de l’épouse, Eugène Louis Antoine Clausse, rentier, âgé de soixante-treize ans, grand-père, demeurant à Étampes, rue de l’Hôtel de Ville, numéro 13, Alphonse Louis Édouard Flizot, libraire, âgé de trente-cinq ans, oncle, demeurant aussi à Étampes, même rue, numéro 10 ; secundo, du côté de l’époux, Louis Paul Lesprit, typographe, officier d’académie, âgé de trente-quatre ans, oncle, demeurant à Paris, rue Maubeuge, numéro 13 et Gaston Désiré Dormann, peintre, âgé de vingt-cinq ans, frère, demeurant à Saint-Chéron (Seine- et-Oise) qui ont signé avec les époux, les père et mère de l’époux, le père de l’épouse et nous adjoint sus-nommé, après
lecture faite – [Signé :] Humbert Droz – M. Dormann – Clausse
– C. Grelet – Dormann – Lesprit – Aug. Dujoncquoy – Flizot –
G. Dormann.


La foire Saint-Michel d’Étampes vers 1906 (cliché Paul Royer)
Foire Saint-Michel de 1912
03a. Abeille du 21 septembre4
L’ouverture de la foire Saint-Michel aura lieu samedi prochain 28 septembre ; le beau temps paraît vouloir favoriser les préparatifs de la grande Kermesse étampoise. (…)
Nous sommes heureux d’annoncer une surprise à l’occasion de la Saint-Michel ; cette nouvelle sera d’autant mieux accueillie par la population qu’elle touche à la question de l’aéronautique qui est toute d’actualité. En effet l’administration du Petit Journal vient de charger son dépositaire, M. Brière5, notre concitoyen de traiter avec la municipalité pour l’enlèvement du ballon monté « Le Petit Journal », cubant 900 mètres de gaz.
Cette ascension aura lieu le beau lundi 7 octobre vers 4 heures de l’après-midi ; des affiches donneront de plus amples détails ; ce spectacle ne nous a pas été offert depuis fort longtemps et nul doute qu’il obtienne ici le résultat qu’il mérite. Ce sera une
4 L’Abeille d’Étampes 101/38 (21 septembre 1912), p. 2.
5 Lucien Brière (1865-1931), libraire à Étampes.
attraction sensationnelle pour la Saint-Michel et nous remercions Le Petit Journal de sa gracieuse participation à notre fête annuelle.
03b. Réveil du 21 septembre6
(…) Mais le clou de la foire Saint-Michel sera certainement l’enlèvement d’un ballon offert par l’administration du Petit Journal à la municipalité qui s’est mis d’accord avec l’usine à gaz pour cela. Nous en félicitons autant nos édiles que M. Richard, le sympathique directeur de l’usine à gaz qui a promis son concours. Ce ballon cubant 900 mètres cubes sera monté par un aéronaure et sera lancé soir le 7, soit le 8, l’un des beaux jours de la foire.
Voilà qui va exciter la curiosité et qui nous amènera sans aucun doute une foule de visiteurs.
Nous adressons donc nos plus sincères félicitations à notre grannd confrère le Petit Journal qui se prodigue toujours et qui ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire tout le monde. (…)
6 Le Réveil d’Étampes 30/37 (21 septembre 1912), p. 2.
03c. Abeille du 28 septembre7
Le beau temps semble vouloir favoriser d’une façon heureuse cette année, la foire Saint-Michel qui s’ouvrira dimanche 29 septembre. (…)
Le programme officiel de la foire est ainsi établi. (…)
Lundi 7 octobre. (…) A 3 heures, Grande Fête aérostatique, offerte gracieusement par le Petit Journal. (…)
La grande fête aérostatique offerte gracieusement par le Petit Journal se fera le 7 octobre, beau lundi de la Saint-Michel. Mardi dernier [24 septembre 1912], l’aéronaute M. Leprince, accompagné des membres de la commission des fêtes et du Directeur de l’usine à gaz, s’est rendu sur les différents emplacements aptes au lancement du ballon ; son choix s’est arrêté sur le terre-plein du Jeu de Paume, en face de la Salle des ventes ; la Compagnie du tramway a bien voulu se prêter à la circonstance en laissant la plus grande étendue possible de terrain libre. Le ballon cube exactement 930 mètres ; le gonflement commencera vers 7 heures du matin ; l’ascension se fera vers 3 heures.
03d. Réveil du 28 septembre8
(…) Nous voici à la veille de l’ouverture de notre foire annuelle dont le programme vient d’être affiché sur nos murs et que voici : (…)
Lundi 7 octobre (…), à 3 heures, grande fête aérostatique, offeste gracieusement par le Petit Journal, ascension d’un ballon le Petit Journal, piloté par M. Paul Leprince, aéronaute breveté de l’Aéronautique Club de France, officier d’académie. (…)
Comme on le voit les distractions ne manqueront pas et pour peu que le beau temps soit de la partie nous sommes assuré du succès de notre fête.
Le clou, nous l’avons déjà dit la semaine dernière, sera assurément le départ du ballon que le Petit Journal a mis gracieusement à la disposition de la municipalité, grâce, on peut le dire, à M. Lucien Brière, libraire et dépositaire du Petit Journal, qui s’est beaucoup employé à la réussite.
Le pilote qui doit monter le ballon M. Paul Leprince est un de nos plus hardis hommes de l’air, breveté de l’Aéronautique Club de France.
Le gonflement aura lieu à partir de 7 heures du matin et le lâcher aura probablement lieu près de la gare du tramway en face de la Salle des ventes vers deux heures et demie. Au cas où il y aurait des complications pour le service des trains le lâcher
03e. Réveil du 4 octobre9
(…)
L’emplacement pour le départ du ballon offert si généreusement par le Petit Journal est défintivement fixé. Ce sera bien comme nous l’avons dit la semaine dernière en face de la salle des ventes, près de la gare du tramway que le
« lâchez tout » sera prononce.
Il y aura sûrement beaucoup de monde pour assister à ce départ, clou sensationnel de notre foire et par avance nous devons en être reconnaissant au Petit Journal, notre grand cofrère parisien, le plus répandu de nos régions, qui ne sait quels sacrifices faire pour donner du plaisir.
Rappelons que l’enlèvement du ballon aura lieu vers 2 heures et demie lundi prochain.
Le pilote de ce ballon M. Paul Leprince n’est pas un simple aéronaute qui s’estˑdans les ascensions en sphérique. Nous sommes heureux d’apprendre à nos lecteurs que c’est aussi un
aviateur remarquable qui ibtint un des premiers son brevet. Ce fut lui qui le 5 juin 1911, sur son appareil Nieuport 50 H-P, établit le record de vitesse sur le parcours Nice-Gênes après avoir effectuéce parcours de 200 kilomètres au-dessus de la mer en 1 h 44 minutes. Il fut du reste acclamé come il convenait à la suite de cette prouese qui le classa parmi les meilleurs de nos conquérants de l’air.
Si on sera heureux de voir s’enlever le ballon du Petit Journal on le sera également |2 de le voir monté par un aéronaute de valeur tel que M. Paul Leprince.
03f. Abeille du 12 octobre10
Un temps merveilleux, bien que froid, a favorisé cette année la Saint-Michel qui, d’une façon générale, a eu un regain de succès ; le nombre de nos visiteurs pendant les trois beaux jours s’est élevé en effet à près de 10.000, car il a été délivré sur le P.O. à destination d’Étampes 2.384 billets samedi, 3.400 dimanche et 657 lundi ; sur le C.G.B. environ 500 samedi, 7000 dimanche et 300 lundi. (…)
Une foule qu’on a évaluée à 3.000 personnes s’était massée lundi11 après déjeuner sur l’avenue de Paris, la pointe de Dourdan et la descente Saint-Jacques pour assister au départ du
10 L’Abeille d’Étampes 101/41 (12 octobre 1912), p. 2.
11 Lundi 7 octobre 1912.
ballon le Petit Journal, dont le gonflement s’opérait depuis le matin. Tout étant paré pour le départ, l’aéronaute, M. Leprince,
Dormann, notre confrère, et le président de l’Aé. C. d’Algérie prenaient place dans la nacelle, et à 3 h. 21 le ballon s’envolait superbement aux acclamations de la foule pour disparaître bientôt dans la direction du sud, poussé par une assez forte brise ; l’atterrissage s’est effectué le soir même à Patay (Loiret), sans incident. (…)

La gare du tramway et le ballon au matin du 7 octobre 1912 (cliché de la collection de Jean Minier)
Les Passagers !
Voilà !
Le pilote du Petit Journal, — ballon qui doit nous emmener dans les airs, — n’a pas besoin de répéter. Déjà nous sommes là, nous enjambons les bords de la nacelle en nous hissant au moyen des cordes qui rattachent cette dernière au filet du ballon.
Ma foi nous n’avons pas trop de place mais nous n’y faisons pas du tout attention, pour ma part du moins, car j’étais tellement heureux, je dois le dire, de l’ascension que j’allais faire, que j’aurais consenti à me gêner encore davantage s’il l’avait fallu, et je rendais grâce à ce moment au Petit Journal qui avait consenti à offrir cet attrait nouveau pour notre ville et à notre municipalité qui fit de son côté les sacrifices nécessaires pour faire plaisir à toute la population et attirer les curieux à notre foire Saint-Michel.
Que je vous présente toutefois avant d’aller plus loin mes aimables compagnons de voyage. Tout d’abord parlons du pilote : M. Paul Leprince, constructeur aéronautique, breveté de l’Aéro-club, ne compte plus les ascensions qu’il a faites en sphérique et je crois même qu’on pourrait en moyenne les
12 Le Réveil d’Étampes 30/40 (12 octobre 1912), pp. 1-2.
estimer à une centaine par an et cela depuis de nombreuses années. Le Réveil a dit la semaine dernière que M. Leprince n’est pas seulement le pilote remarquable du Petit Journal, mais qu’il est de plus un aviateur et, ce qui est tout à son mérite, un des pionniers de l’aviation, puisqu’il fut le premier breveté sur cet appareil Nieuport qui a déjà accompli tant de prouesses et qui, de haute main, a conquis une des premières places au milieu des marques françaises. On se rappelle les difficultés de ce sport aujourd’hui tant en faveur et on se souvient de la volonté tenace et du courage inlassable de ceux qui furent les premiers à tâter le nouveau mode de locomotion. Paul Leprince fut de ceux-là : il mit au service de la science nouvelle, sans hésitation, toutes ses qualités de véritable homme de l’air et à cause de cela il fut un auxiliaire précieux de ce regretté Charles Nieuport au succès duquel il contribua.

Je sais que je vais blesser la modestie de M. Paul Leprince mais tant pis pour lui et nous ne terminerons pas sa présentation
sans dire qu’il est, comme au premier jour, passionné des choses de l’air, qu’il connaît si bien. Une ascension est toujours pour lui un nouveau plaisir et il nous l’a démontré clairement au cours de notre voyage de lundi.
M. Casimir Bougenier13, passager avec moi, est une des personnalités sportives les plus en vue de notre belle Algérie. Il est président de la Société Algérienne d’Aéronautique pratique d’Alger et fut l’organisateur de ce meeting d’aviation d’Alger qui fut un véritable triomphe récemment. M. Bougenier a déjà à son actif de nombreuses ascensions en sphérique ; élève de M. Leprince, il est lui-même pilote et je comprends combien il aime le ballon maintenant que j’y ai goûté.
Notre 900 mètres cubes, dont le gonflement a commencé ce matin vers 7 heures, a son « plein » de gaz depuis quelque temps déjà, car tout le monde à notre usine, depuis le sympathique directeur M. Richard, jusqu’à ses collaborateurs, a voulu faire preuve de bonne volonté et personne n’a voulu bouder au travail, malgré le jour de fête.
L’endroit du départ a été bien choisi, à côté de la gare du tramway, dont les lignes de garage ont été déblayées par les soins du chef de gare ; aucune crainte d’accrocher les arbres en s’enlevant.
La foule qui grossit toujours s’écrase autour du double fil de fer qui a été établi, mais elle est tout de même fort raisonnable et les agents chargés de la police n’ont pas à intervenir. Tout le
13 Casimir Bougenier (1869-1939), comptable, né et mort à Alger, avait déjà fait deux ascensions en ballon avec Leprince à Alger les 19 mai et 6 juin 1912 cette dernière fois déjà dans un ballon du Petit Journal (Écho d’Alger des 20 mai 1912, p. 1 et 7 juin, p. 1).
.
monde a voulu voir le départ du ballon. Pensez donc ! c’est le premier qui va partir d’Étampes ! Et comme nous sommes loin de ces foires Saint-Michel où s’enlevait une montgolfière gonflée avec la fumée de paille ou de sarments de vigne, montée par un hardi pilote n’ayant qu’une sorte de trapèze come nacelle et qui allait atterrir triomphalement à 3 kilomètres de là, à Morigny !
On patient sagement en attendant l’heure du départ et un murmure de satisfaction a couru quand on a demandé des hommes de bonne volonté pour remplacer les sacs de sable retenant l’aérostat pour le maintenir : c’est que celui-ci allait partir.
Un dernier salut à M. Bouilloux-Lafont, maire d’Étampes, accompagné de presque tous les membres du Conseil municipal.
Nous sommes dans la nacelle. Le pilote explique la manœuvre qu’il va faire faire à ses aides volontaires, pour s’assurer si le ballon est bien équilibré comme poids.
Sacrebleu, quel bon gaz ! — ne peut s’empêcher d’exprimer M. Leprince, en ajoutant sacs sur sacs de ce lest qui nous permettra de régulariser notre marche tout à l’heure. Chaque fois que le ballon s’élève, se sentant libre, quand les hommes tiennent le bord de la nacelle, un cri part de la foule des curieux.
Enfin, à son tour, M. Leprince saute avec nous. Cette fois ce sera pour de bon la manœuvre. Il est 3 heures un quart. Attention !
Lâchez tout !
Sommes-nous partis ?
Ma foi on ne s’en aperçoit pas. Mais si, la terre s’enfonce pendant que les bravos éclatent. Qu’on est loin de cette sensation de suffocation dont on a voulu me parler depuis quelques jours. Rien de tout cela, aucune secousse, une douceur infinie, même pas cette surprise qui fait raidir les jambes quand un ascenseur vous enlève.
J’avoue n’avoir pu, comme mon compagnon de passage, saluer la foule mais j’espère qu’on me le pardonnera quand on saura que j’étais assez occupé, non pas par un sentiment de frayeur, que je n’ai pas eu une seconde, mais avec mon appareil photographique que l’ami Rameau14 m’a prêté tout à l’heure. J’ai voulu conserver et permettre de conserver le souvenir de
cette première ascension de sphérique à Étampes et faire profiter le Réveil d’Étampes de vues que j’ai été assez heureux de réussir par le beau temps.
Il appartenait bien à ce journal de mes publier ces vues, car ce fut lui toujours, qui, le premier, offrit à ses lecteurs la primeur des choses nouvelles : le premier journal non seulement d’Étampes mais de France s’il vous plaît, il publia les vues du premier voyage en campagne sur aéroplane, lorsque Blériot, qui devint rapidement célèbre par la suite, put voler de Mondésir à Toury ; lui qui publia aussi le premier vol de Henry Farman à l’aérodrome de Villesauvage chez nous ; le premier passage sur notre ville du dirigeable Le Patrie qui quelques jours plus tard allait s’abîmer en Islande ; et, plus récemment la première photo prise de la ville en aéroplane par M. Rameau au cours d’un vol de Maurice Chevillard.
14 Eugène Rameau (1871-1961), photographe à Étampes depuis 1909.
Je n’ai que le temps de viser avec mon objectif, d’appuyer sur le déclic et d’escamoter ma plaque pour en prendre une nouvelle, car M. Bougenier, les yeux fixés sur l’altimètre qui nous indiquent les hauteurs, me lance cruellement : « 100 mètres, 200, 400, 600, 800 mètres ! » À ce moment seulement je désarmai. Nous gagnons du reste le brouillard auquel pourtant l’objectif Berthiot dont était muni mon appareil fit la nique comme on s’en rendra compte sur la vue d’Étampes prise à 800 mètres.
À la vérité je voulais voir aussi et je pus me régaler tout à mon aise. À nos pieds la ville s’étendait, noyée dans le beau soleil d’automne qui nous favorisait et nous nous en allons majestueusement dans la direction de la route nationale allant à Orléans.
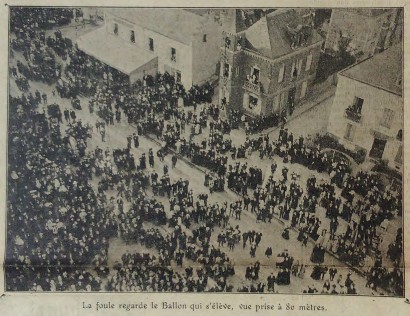


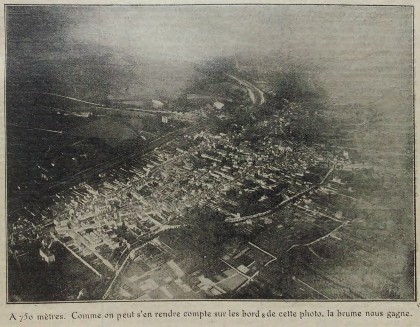
Quelle différence avec l’aéroplane ! ce fut un plaisir pour moi de l’apprécier. En aéroplane je n’étais occupé qu’à me cramponner — un peu nerveusement, c’est vrai, — aux haubans de l’appareil à cause de la vitesse ; pour se parler avec le pilote, on est obligé de se crier dans les oreilles, les trois quarts du temps en langage télégraphique et puis le vent ! ce diable de vent qui vous prend par côté ou en pleine figure, le bruit du moteur qui vous assourdit, l’hélice qui vous renvoie encore le vent…
En ballon rien de tout cela. Le calme, le calme d’une douceur indéfinissable, sans heurt, sans à-coup ; aucune parcelle d’air,
— ne faisons-nous pas partie du vent qui nous emporte ? — c’est encore plus doux que la barque qui glisse au fil de l’eau d’une rivière. Et puis on s’entend, on peut se causer, ce qui est appréciable. Je suis même frappé de la façon dont on entend
distinctement les bruits qui montent de la terre. L’aboiement des chiens, les cris des poules et des coques sont peut-être ce qu’on perçoit le mieux aux grandes hauteurs.
Déjà le vent nous emporte doucement au-dessus des Prés et du Petit-Saint-Mars, les maisons petit à petit diminuent. Étampes s’éloigne… De quelle jolie vue on jouit alors de tous côtés. Au fond d’une cuvette Étampes tout en long avec son faubourg Saint-Pierre qui se détache nettement et avec sa ceinture de bois aux teintes violettes et or d’automne, la tour de Guinette minuscule au milieu de la tache sombre de son bois, la ligne du chemin de fer où courent les trains-jouets empanachés de fumée, au fond Morigny et la route qui s’enfuit vers Étréchy, celles de Malesherbes, de l’autre côté celle de Dourdan, l’Humery, puis la route nationale que nous suivons comme si elle nous attirait, et le damier géométrique des champs aux lignes de division frappantes.
Voici le champ d’aviation de Villesauvage au-dessus duquel nous passons exactement. Les toitures des hangars minuscules luisent au soleil. Devant l’école Blériot six monoplans sont alignés. Un ronflement persistant appelle notre attention et nous finissons par découvrir le biplan Farman qui fait le tour du bois de sapins situé en face l’école et qui nous semble une grosse mouche dorée qui bourdonne en courant sur la terre, car, bien au-dessous de nous, m’appareil semble courir plutôt que voler.
Nous montons toujours, quoique plus lentement, et plus nous nous élevons, plus le vent nous pousse de l’autre côté de la ligne du chemin de fer vers Pussay.
Nous traversons la route nationale même, juste au-dessus de Mondésir à 900 mètres d’altitude.
À ce moment il fait chaud, bien plus chaud que sur terre et M. Leprince ne peut même plus supporter son pardessus. Pourtant nous avons l’impression d’avoir au-dessus de nous une cuvette fort épaisse de brume dont la ligne passe tout au-dessus de nos têtes. Une comparaison à cette hauteur. Un troupeau de moutons ; une boîte d’asticots qui grouillent.
Nous descendons maintenant et alors nous revenons à gauche, restant stationnaires entre la ligne de chemin de fer et la route. À 4 h. nous passons au-dessus de Monnerville à 600 mètres et nous repassons à gauche au-dessus de la route nationale. Nous descendons encore un peu et bientôt le guide-rope traîne sur la terre. Pour prolonger notre voyage notre pilote veut se servir ainsi du guide-rope. Dans les champs les gens se figurent que nous voulons atterrir et lâchent la charrue pour courir essayer de prendre la corde. Un charretier qui a voulu s’y aviser et serrer trop fort secoue les mains : il a été brûlé par la corde qui glissait.
Voici Angerville à gauche duquel nous passons à peu de hauteur. Une ligne téléphonique barre la route de Méréville. Attention au guide-rope ! Tout va bien, une petite secousse à la nacelle et nous passons.
Maintenant nous pouvons entretenir des conversations avec les gens qui nous regardent curieusement. Ce qu’on entend des fois le cri : « Un ballon ! un ballon ! », poussé aussitôt qu’on nous aperçoit ; on s’amuse à causer en passant et nous percevons même distinctement les conversations.
Autre diversion : un lièvre effrayé non par le ballon lui-même mais par son ombre, détale à toute vitesse, il se terre dans une raie ; mais l’autre le poursuit et le rattrape, il démarre à nouveau ; l’ombre le harcèle et finalement il quitte la luzerne où
il s’était réfugié pour détaler à toute vitesse et passe tout près d’un chasseur qui a le tort de lever le nez en l’air pour nous regarde passer et manque ainsi à bonne portée un bon coup de fusil. Nous lui en faisons part du reste de façon un peu taquine.
Dans les couverts de betteraves les canepetières sont en plus grande quantité que les perdreaux ; il est vrai que ces derniers,
et nous les voyons, — se cachent très bien sous les feuilles et ne s’envolent que lorsque nous sommes tout à fait au-dessus d’eux.
Il nous faut remonter, car nous allons vers la ligne du chemin de fer d’Orléans, dont les fils télégraphiques sont toujours une menace pour notre corde de guide-rope. Un peu de lest et nous voyons l’aiguille de l’altimètre remonter tout doucement. Il était temps car l’extrémité de notre corde touche les fils. Le vent semble se faire un jeu de nous maintenir en plein milieu au-dessus des voies qui s’en vont en belle ligne droite et longue vers Orléans. Un train de marchandises qui passe en dessous semble vouloir nous cracher sa fumée au visage mais il en est pour ses frais et nous lui faisons un pied de nez car sa fumée est loin de nous atteindre.
Comme nous remontons nous reprenons notre direction nettement à droite et nous repassons enfin l’autre côté dangereux des lignes télégraphiques au-dessus de la gare de Boisseaux, puis, peu après, la route nationale. Toury, que nous voyons très bien ne nous aura pas.
1.000 mètres exactement à 4 h. 40 au-dessus de Janville-au- Sel. Nous rattrapons la brume qui s’épaissit et nous atteignons notre plus grande altitude du voyage : 1.100 mètres au-dessus de Tilleux-le-Peneux. Nous redescendons au moment où nous
admirons le château de Cambray, la belle ferme qui est à proximité et le domaine boisé qui l’entoure.
C’est effrayant, revient à dire notre pilote M. Leprince, ce que le gaz d’Étampes est bon. Il nous reste encore 180 kilos de lest environ, ajoute-t-il, en faisant le recensement des sacs, puis à brûle-pourpoint :
Voulez-vous que nous passions la nuit ? |2
À cette demande M. Bougenier et moi, écarquillons les yeux et tous deux à la fois nous approuvons vivement.
Les plans sont pris sans plus tarder et déjà je e vois atterrir dans le Midi de la France. Nous sommes contents tous les trois et c’est en fredonnant un air qu’après le court conciliabule nous reprenons nos places à bord du panier qui nous emporte.
Hélas ! nous nous réjouissions trop vite !
Comme je suis chargé de la carte, je veux ne point me tromper dans l’itinéraire et en redescendant vers terre je demande où nous sommes ? « Orgères », est-il répondu, confirmation de ce que je pensais.
Le vent du nord se rétablit franchement au moment où nous redescendons vers le hameau de Nonneville. La corde du guide-rope traîne encore et cela toujours par économie pour notre gaz, puisque nous voulons tenir l’air jusqu’au lendemain
15 Nous dirions aujourd’hui : du Massif Central.
midi. Nous nous amusons à voir les gens courir sur nous et regarder la corde traîner dans la mare.
Cet instant d’inattention devait nous être fatal. Derrière nous, à une centaine de mètres de la ligne de chemin de fer de Chartres à Orléans était là, avec les traîtres lignes télégraphiques. Vivement notre pilote s’empare d’un sac de lest et le jette à terre. Nous montons de suite mais pas assez vite encore. L’extrémité de notre guide-rope glisse sur les fils jusqu’à un poteau et notre élan imprime à la corde un tel mouvement que celle-ci s’accroche au poteau dans les fils et les potelets en porcelaine. Une secousse : c’est le poteau qui vient de craquer, comme une allumette qu’on casserait entre deux doigts.
Si nous pouvions l’entraîner ? Mais non, il est chargé d’une quinzaine de fils qui résistent.
Détachez-nous ! crie M. Leprince à quelques paysans qui sont accourus. Mais ils ne comprennent ou ne peuvent.
Le poteau ou les fils qui se sont détendus font ressort et nous ramènent brusquement à terre.
Boum ! la nacelle tape sur le sol.
Ne craignez rien, crie M. Leprince.
Sa recommandation est superflue, car nous avions confiance en lui. D’un bond nous remontons, le vent fait pencher le ballon. Attention nous allons encore descendre. Nouveau coup sur le sol, plus violent cette fois et nous aurions été vidés de la nacelle qui culbute si nous ne tenions ferme aux cordages.
Si on se détache nous allons faire un tour à 3.000 ou 4.000 mètres, lâche notre pilote, avec le lest que j’ai jeté.
C’est ce que j’espère, mais les fils sont solides malheureusement et nous sommes toujours captifs. Nous remontons encore et M. Leprince s’exclame :
Cette fois il n’y a plus à espérer nous détacher ; il faut atterrir.
Fini déjà notre beau voyage ! Malgré soi on ne peut s’empêcher de pester contre cet incident stupide, inattendu, qu’on aurait pu si facilement éviter… Toutes les récriminations seraient vaines.
Notre pilote ne pense pas aux à-côtés actuellement ; il indique aux hommes accourus, — tout le village est là, — qu’ils ne doivent pas avoir peur mais saisir franchement la nacelle quand celle-ci touchera terre encore.
La manœuvre réussit parfaitement. M. Leprince saute pendant que nous nous cramponnons à la corde de déchirure.
Mais voilà bien une autre histoire : nous barrons la voie du chemin de fer avec notre corde de guide-rope et son poteau : un train vient.
Qu’il attende ! il n’est pas plus pressé que nous !
Et les opérations continuent. Non seulement les gens de Nonneville mais ceux des hameaux des alentours sont accourus et les bonnes volontés pour nous aider ne manquent pas et sont même trop nombreuses.
Il est exactement 5 h. 25. Notre voyage a duré 2 heures 10, et nous avons parcouru environ 55 à 60 kilomètres à vol d’oiseau. L’endroit où nous sommes se trouve sur le territoire de la commune de Loigny-la-Bataille entre ce pays et Patay, en pleine Beauce.
Tout le monde peut voir et s’approcher, toucher notre pauvre ballon qui se dégonfle peu à peu pendant que nous le regardons tristement en maudissant la guigne.
Nous sommes déridés un moment par les braves femmes accourues qui se disputent les 150 kilos de sable blanc, — le lest qui nous reste, — que nus nous apprêtions à vider dans le champ. Ce sable semble rare par ici et les ménagères l’achètent ordinairement.
On démonte les agrès, on plie le ballon et le filet et déjà la nuit est descendue.
Nous n’avons plus qu’à réquisitionner une voiture qu’on trouve facilement pour transporter le matériel à la petite gare de Gommiers à 3 kilomètres de là.
La bonne humeur reprend le dessus quand nous sommes attablés devant une bonne omelette que nous estimons heureux de trouver dans une petite auberge bien modeste et peut-être aussi quand M. Leprince, notre si charmant pilote auquel je ne puis que rendre hommage de reconnaissance pour le plaisir qu’il m’a procuré me lance :
— Nous recommencerons n’est-ce pas ? Et nous ferons mieux…
Maurice DORMANN

Une photo manque à la collection que nous publions et je le regrette sincèrement : c’est celle de notre pilote
M. Paul Leprince que je me réservais de prendre à l’atterrissage… le lendemain ! Je n’ai pas pu mettre mon projet à exécution car l’heure à laquelle nous avons touché terre ne me le permettait
plus et cela sera le point noir au milieu des remerciements que je tiens à adresser chaleureusement à ce valeureux et hardi homme de l’air.
M. D.
Petit dossier photographique (1905-1914)

Paul Leprince

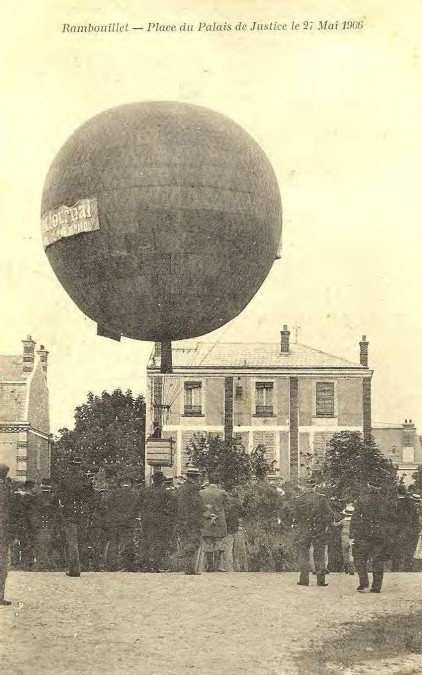

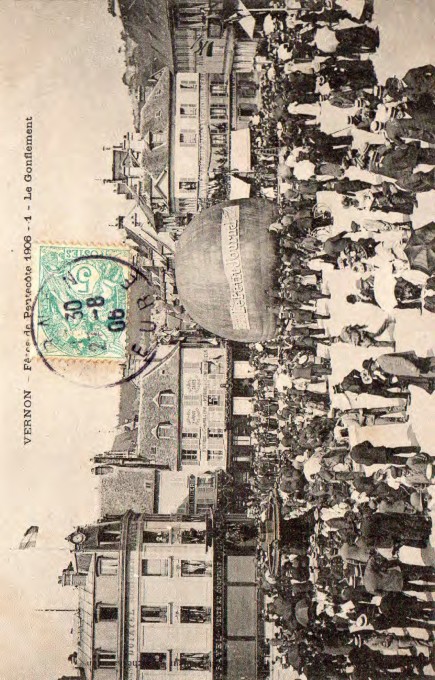
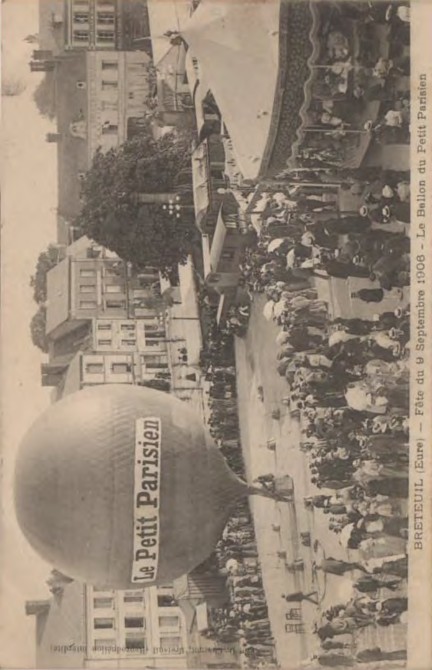


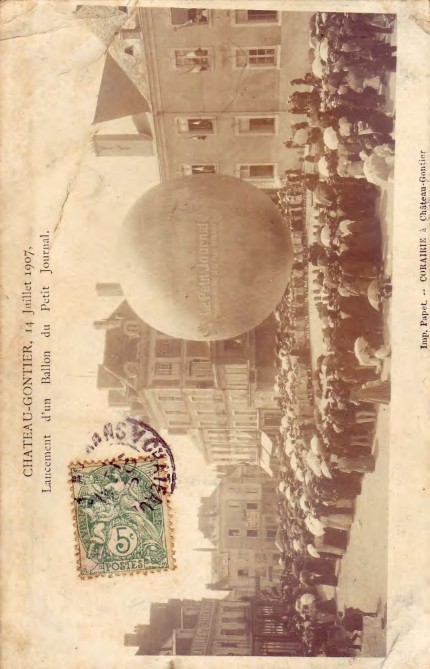







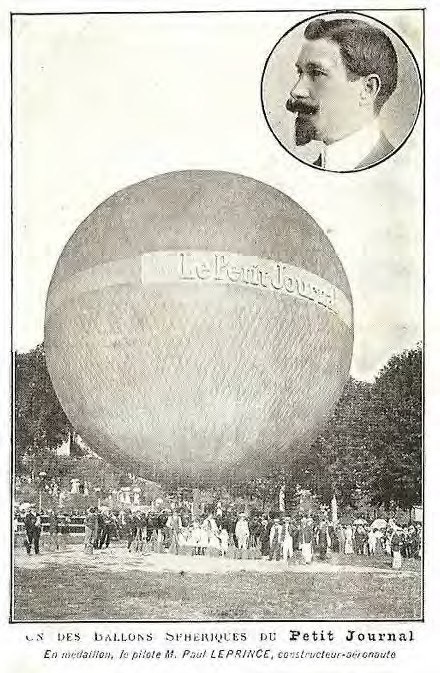

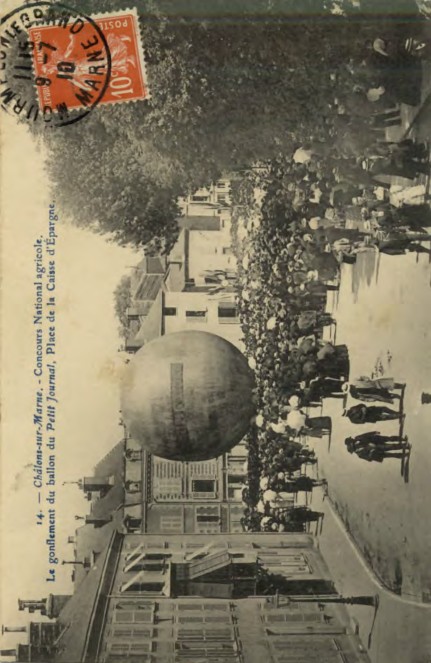
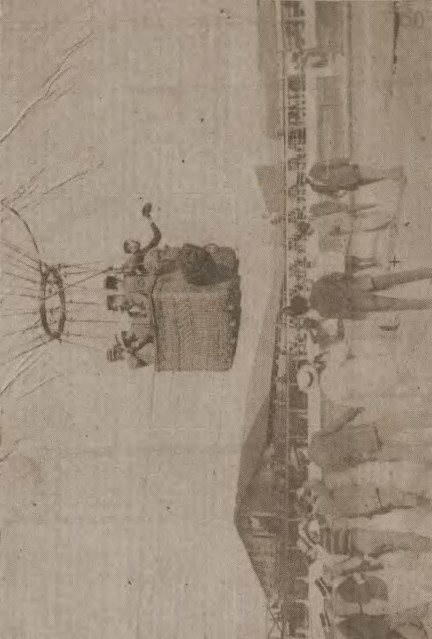
Leprince à Alger le 4 juin 1912 pour le Petit Journal (Écho d’Alger du 5 juin)



Étampes, 7 octobre 1912, 2e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

Étampes, 7 octobre 1912, 1e photo (Collection Jean Minier)
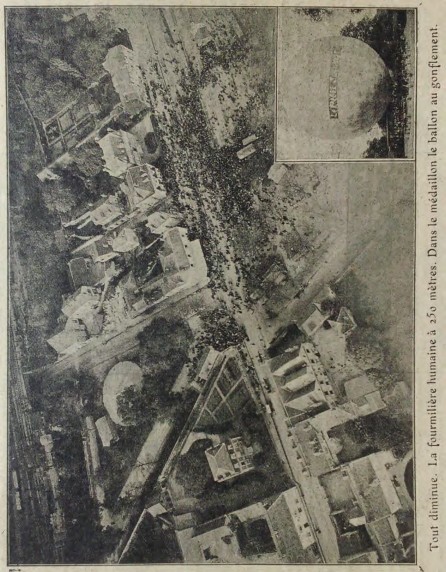
Étampes, 7 octobre 1912, 3e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

Étampes, 7 octobre 1912, 3e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

Étampes, 7 octobre 1912, 4e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)
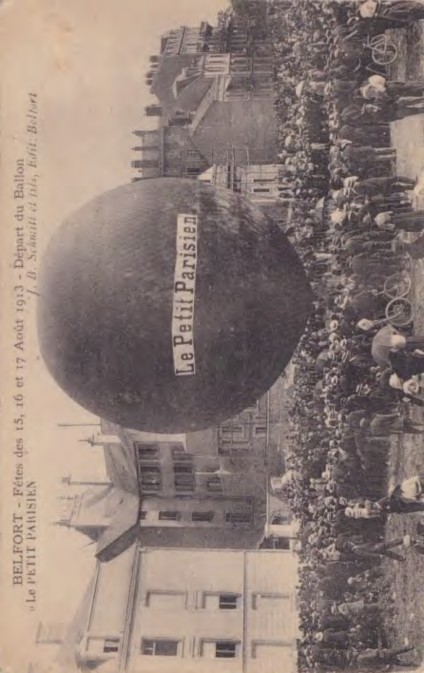
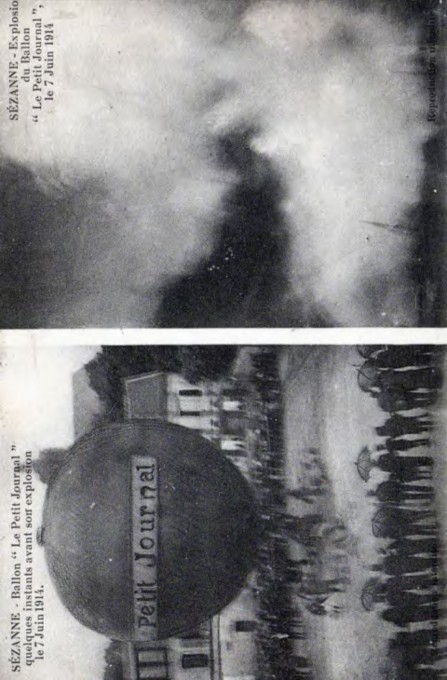
Foire Saint-Michel de 1913
04a. Abeille du 19 septembre16
Si on en croit le « père Berthot », le météorologue de l’Abeille, le temps, après une série de variations, va se remettre au beau vers la fin du mois. On peut donc espérer que la Saint- Michel sera très brillante. (…)
Voici d’ailleurs le programme officiel de la fête. (…)
Lundi 6 octobre (…) A 3 heures, sur la place du Jeu-de- Paume, Grande Fête aérostatique, offert gracieusement par le Petit-Journal. – Lancement de ballons grotesques. (…)
16 L’Abeille d’Étampes 102/38 (19 septembre 1913), p. 2.
04c. Réveil du 27 septembre17.
(…) Nous prenons plaisir à informer nos lecteurs que la fête aérostatique organisée par la municipalité avec le précieux concours de notre confrère parisien Le Petit Journal, comprendra notamment le départ d’un ballon cubant 1.200 mètres cubes au lieu de 900 que cubait celui de l’an dernier et qui est offert par Le Petit Journal auquel on ne saurait trop savoir gré de son désir d’être agréable.
Ce ballon dont le départ constituera le clou de la fête sera piloté par M. Paul Leprince, un des pilotes les plus réputés de l’Aéro-Club, aviateur de la première heure, qui sut, dans cette science nouvelle, témoigner ses précieuses qualités de sang- froid et d’audace réfléchie.
En qualité de consructeur, revenu à ses premières amours, le ballon libre, il saura nous faire apprécier comme du reste l’an passé, lors de cette ascension, le spectacle toujours impressionnant du départ d’un sphérique.
C’est dire que l’intérêt de cette fête en sera lui-même
« grossi ».
04c. Réveil du 4 octobre18.
(…) Nous rappelons à nos concitoyens que la fête aérostatique offerte gracieusement par notre excellent confrère Le Petit Journal aura cette année un éclat tout particulier en raison de l’importance du ballon qui y prendra son essor. L’adroit et réputé pilote M. Paul Leprince, breveté de l’Aéro-Club, saura comme l’an dernier faire apprécier sa maîtrise.
Nul doute que cette partie de la fête officielle constitue le clou de la journée. (…)
04b. Abeille du 11 octobre19
Bien que nous soyons plutôt gâtés à Étampes sous le rapport des engins volants, une foule considérable se portait dès deux heures et demie sur le Jeu de Paume où devait se faire le départ du ballon Le Petit Journal, monté par M. Leprince, aéronaute, notre confère M. Dormann et M. Morel, administrateur du journal parisien.
À l’heure fixée pour le départ, une averse, malencontreuse pour les spectateurs, mais au contraire très favorable aux forains
– qu’il est difficile de contenter tout le monde ! – dispersait un instant les groupes qui revenaient bientôt plus nombreux autour de l’aérostat. L’opération, à laquelle présidaient les conseillers municipaux, était assez longue en raison de l’insuffisance de la pression du gaz d’éclairage employé pour le gonflement, mais à quatre heures et demie, le départ s’effectuait dans d’excellentes conditions par un vent de sud-est très faible. Pendant longtemps on pouvait suivre les évolutions du ballon qui disparaissait bientôt dans la direction de Boutervilliers.
On apprenait bientôt que les aéronautes avaient atterri sur le territoire de cette commune et qu’après s’être approvisionnés de vivres, ils avaient repris la route des airs.
Qu’étaient-ils devenus ensuite ? un vent sud-est assez fort s’étant levé, l’aérostat était poussé vers les côtes de la Manche et, pour éviter de descendre en mer, M. Leprince et ses compagnons avaient tenté de descendre à proximité d’une ville qu’ils surent depuis être Elbeuf. Malheureusement l’obscurité
étant venue, les aéronautes descendirent au-dessus d’une forêt et il leur était impossible de remonter quand ils s’aperçurent, au toucher, qu’ils avaient « atterri »… sur des arbres.
Prenant leur parti de cette situation assez périlleuse, ils attendirent patiemment dans la nacelle le lever du jour qui mit un terme à leur odyssée aérienne. Ils se trouvaient alors à 15 kilomètres de Rouen dans la forêt de la Londre [sic] qui s’étend entre cette ville et Elbeuf.
04c. Réveil du 11 octobre20.
Le soleil n’a pas daigné exaucer la prière du Réveil et la pluie irritante, durant les grandes journées de notre foire, en a compromis le succès.
Boudant le soleil et pestant contre la pluie, nos concitoyens joints aux populations de l’arrondissement, ont tenu quand même à manifester l’intérêt qu’ils témoignant à la foire Saint- Michel et de l’aveu des forains, la recette n’a pas été inférieure à celle des années ensoleillées.
Samedi soir, les abords du Casino présentaient une animation particulière bien connue des amateurs et des fidèles habitués du bal fermier. Les toilettes claires des danseuses jetaient une note gracieuse qui allégeait sensiblement le caractère de sévérité des habits noirs, et vers dix heures (pardon, vingt-deux heures !) au son d’une musique tour à tour guillerette, sautillante, tendre,
20 Réveil d’Étampes 31/41 (11 octobre 1913), p. 1.
langoureuse, toujours expressive, des couples tournèrent des rondes que la valse enjolivait de courbes et d’inclinations gracieuses.
Au dehors, dans la grande allée bordée de boutique aux étalages séducteurs, sous les guirlandes électriques multicolores, le public noctambulait gaiement, s’arrêtant de temps à autre pour « croquer » une « bouche » chocolatée et doucement fondant ou mordre une gaufre légère qu’on bock de bière blonde accompagnait.
Sous l’impulsion des moteurs grondants, enivrés par leurs orgues qui tonitruaient des aires en vogue, les différents manèges tournaient follement.
Dans les grands établissements, séduit par le programme copieux, le public affluait ; et sur les gradins du cirque Bureau grouillant de spectateurs, sur les banquettes du cinéma Stevens, dans les fauteuils du théâtre Chabot et ses fils, la joie fusait sous des causes multiples et diverses, toutes d’un réel intérêt.
Si le « beau samedi » fut une sorte de répétition générale des spectacles forains, le dimanche qui suivit fut une grande première représentation de tout premier ordre.
En dépit de la pluie qui s’obstinait inutilement à vouloir tout contrarier, les toilettes somptueuses firent des apparitions sensationnelles sous la protection des parapluies tirés de leurs fourreaux, et tel qui vint le samedi déambuler au milieu des attractions, y revint le dimanche sans souci du mauvais temps âprement critiqué.
Le lundi, particulièrement chargé, sur l’emplacement du Jeu de Paume avait lieu le gonflement du ballon « Le Petit
Journal », qui constituait la partie la plus intéressante de la fête aérostatique offerte gracieusement par notre grand confrère parisien.
L’énorme aérostat, cubant 1.200 mètres cubes se trouva, pendant plus de cinq heures être le point de mire du public qui ne se lassa pas au spectacle des opérations du gonflement, spectacle qui parut intéresser vivement nos conseillers.
Sous la pluie rageuse qui tombait par intermittences, semblant jeter un défi au départ tant attendu, l’enveloppe du plus léger que l’air, sous la poussée du gaz, s’arrondissait grassement. Bientôt, avec l’aide de quelques spectateurs de bonne volonté et alors que le jour baissait menacé par de gros nuages, on put néanmoins approcher la nacelle qui devait emporter loin d’Étampes, en compagnie de M. Paul Leprince, le distingué et adroit pilote, M. Morel, inspecteur au Petit Journal, et notre directeur M. Maurice Dormann.
L’attente, si longue fût-elle, ne demeura point vaine.
Suffisamment gonflé, indiquant par quelques gestes inclinés son désir de grimper vers les nues, tendant les mailles du filet, le ballon donna des signes d’impatience. L’empressement redouble autour de ce personnage de ronde importance. La nacelle est fixée, solidement. Les sacs de lest qui le retenaient à terre, sont détachés du filet, trente mains retiennent la nacelle alors que s’embarquent nos trois voyageurs. Sur un signe du pilote, le ballon monte… Oh ! d’un mètre environ pour s’assurer de son équilibre. Seconde tentative, tout va bien. Des mains se tendent empressées et comme si le millier de poitrines qui depuis quatre longues heures attend cette seconde émouvante du départ se dilatait brusquement, une exclamation
formidable, un ah ! immense de soulagement salue la lente ascension.
Toutes les têtes se lèvent vers le sphérique qui prend la direction nord-ouest emportant vers un but imprévu les trois vies qui lui sont confiées.
Quelques mouchoirs s’agitent auxquels les voyageurs aériens répondent par un jet de petits papiers qui tourbillonnent longuement avant de de poser à terre, et s’estompant tout là-bas, se fondant dans la grisaille de l’horizon, trouant le silence qu’il frôle délicatement, le sphérique s’efface.
Le lendemain, coup de téléphone ! « Avons atterri aux environs de Rouen ! » — Non ? — Si ! »
Et ce voyage des plus pittoresques se trouve d’autre part conté par notre directeur, un de ceux qui vécurent des minutes émouvantes au fond d’une nacelle qui, durant une nuit, demeura juchée à la cime des arbres.
Le soir, pour assister au feu d’artifice tiré par M. Hoyau, la foule se canalisait dans la rue Élias-Robert, débordait place de la Gare et envahissait le boulevard Henri IV.
Malgré la pluie qui avait abondamment douché les différentes
« pièces » du feu d’artifice, celui-ci réussit merveilleusement, multipliant sous la coupole céleste les paraboles des fusées. Et les « soleils » (qui l’eût cru !) se montrèrent éblouissants, ironisant délicatement l’absence de leur père à tous, ce Phœbus gaga et maussade.
Alors que la « pièce » de résistance se montra légèrement confuse, le « bouquet » fut particulièrement goûté. Il eut, cette
année, la gracieuse apparence d’une gerbe délicatement composée et nuancée.
Et cruellement blessée, toutes cicatrices béantes, élargissant ses horrifiantes crevasses ensanglantées, notre vieille tour de Guinette, donjon vénéré, muraille caduque qui suinte l’histoire du passé, s’offrait bénévolement au traditionnel embrasement, paraphe indispensable de notre feu artifice.
*
* *

La Pluie… — L’attente du départ. — Lâchez tout ! — Étampes d’en haut. — Une escale à Boutervilliers. — Vers les étoiles. — Dîner aérien. — Une demi-heure d’émotion. — Sur la branche. — Réveil. — La Pluie…
….. Enfin, le sacramentel ; « Lâchez tout ! » Et le ballon du Petit Journal s’élève tout doucement dans les airs, à 4 h. et ½ du soir, presque à la nuit, dans la pluie…
Nous sommes trois à bord : d’abord M. Paul Leprince, le pilote plein de science, que nous connaissons, professeur à l’École supérieure d’aéronautique, dont les 25 ans de pratique et les nombreuses ascensions sont un brevet de garantie ; — puis
M. Morel, très aimable inspecteur principal du Petit Journal. — et votre serviteur.
La compagne du gaz a beau vouloir mettre à l’épreuve la patience de la foule accourue pour voir ce départ, en faisant durer le gonflement du 1.200 mètres qui nous emporte : l’intérêt n’a pas faibli et la pluie elle-même impuissante à lasser l’attention, n’a réussi qu’à faire ouvrir les parapluies qui se ferment lorsque nous partons pour mieux nous voir.
21 Réveil d’Étampes 31/41 (11 octobre 1913), p. 1.
Quelle montée délicieuse dans sa douceur ! majestueusement, comme pour récompenser l’attente de tous ceux qui sont là, le ballon met un temps infini à l’élever et s’en va lentement. Très lentement, ce qui nous permet de faire les adieux plus prolongés pour répondre aux acclamations.
Bien que je connaisse déjà le spectacle offert par la vue de la ville, de haut, je ne puis m’empêcher d’admirer, de remarquer mieux qu’on ne peut le faire en aéroplane, tout le décor qui se déroule à nos pieds, de cette ville qui s’allonge indéfiniment. Le nouveau petit jardin du Port paraît encore bien plus joli que du bas, ses couleurs se détachent mieux. Déjà nous sommes au- dessus de la vieille tour de Guinette sur laquelle la mousse cercle une couronne verte. Le dépôt des machines du P.-O. apparaît nettement et les trains qui courent sont déjà bien petits.
Peu à peu Étampes diminue…
À 350 mètres, avant que nous ne perdions la ville de vue, une éclaircie nous permet de jouir d’une vue admirable ; de tous côtés nous apercevons des pays : Morigny, Brières, derrières les buttes Saint-Martin, un coin d’Étréchy, Chauffour, Boissy-le- Sec, Boutervilliers… Les bois, verts encore, semblent des tapis de mousse, et les champs de betteraves de véritables tapisseries. A perte de vue l’échiquier des champs aux divisions géométriques tant irrégulières.
Dans le silence si calme on entend parfaitement les perdrix qui « rappellent ». Près de nous des vols de canepetières nous prouvent que les fusils des chasseurs ont beaucoup épargné ce gibier difficile à approcher.
Nous passons tout à fait au-dessus de la ferme de Champdoux après avoir traversé la route de Dourdan. Des poules s’enfuient
en poussant des cris, des canards qui s’ébattent tranquillement dans une cuvette, — pardon, une mare, — battent des ailles en poussant des coins-coins épouvantés ; les chiens hurlent. C’est curieux comme tous ces animaux « sentent » les ballons et en sont effrayés.
Hélas ! la nuit descend déjà. Notre voyage sera-t-il donc si court ? Au moment où je me pose in petto cette interrogation notre pilote pense tout haut :
La compagnie d’Étampes qui mesure son gaz avec un dé à coudre, comme je l’ai remarqué l’an passé nous donne un gaz merveilleux qu’on trouve bien rarement. Ce n’est vraiment pas de chance de partir si tard !
Et comme complément M. Leprince ajoute : « Voyons, messieurs, n’êtes-vous pas d’avis de passer la nuit ? » Ma réponse ne se fait pas attendre et notre troisième compagnon accepte avec plaisir.
Comme nous n’avons aucune provision on décide alors d’atterrir au premier pays : Boutervilliers, qui se trouve en plein sur notre route. Un signe aux gens qui lèvent le nez en nous voyant et bientôt nous sommes à terre, sur laquelle nous nous posons mollement.
Je vous l’avais bien dit qu’il tombait ! s’exclament pleins de conviction les gens accourus et leur étonnement est grand quand on leur dit que nous allons repartir, c’est à peine même s’ils nous croient.
En hâte et quelque peu difficilement nous nous procurons les éléments d’un très frugal… dîner et en route !... ou plutôt en l’air ! Nous prenons un peu de hauteur pour éviter que notre
guide-rope ne cause des dégâts dans les toitures, ce qui aurait gâté le plaisir des habitants qui se sont montrés pleins d’empressement à nous aider.
Notre allure jusqu’à présent a été bien lente car nous avons mis une heure pour parcourir les quelque 6 kilomètres qui séparent à vol d’oiseau Étampes et Boutervilliers. Ainsi on pourra voyager toutes la nuit sans crainte et cela d’autant plus que le vent semble nous pousser vers l’ouest. Comme on le verra tout à l’heure, cette prévision sera sérieusement réfutée par les événements eux-mêmes.
La nuit est maintenant tout à fait venue, une nuit noire qui ne promet rien de bon : heureusement encore nous avons eu la chance de nous trouver dans le ciel, au milieu d’une sorte de cuvette de clarté où ma foi brillent timidement quelques étoiles ; derrière nous les nuages noirs s’amoncellent.
Si nous n’avons pu profiter du joli spectacle dont nous aurions pu jouir en plein jour, bien que tout à fait différent, le panorama qui défile sous nos yeux, a sa particularité vraiment attrayante. De tous côtés les lumières se sont allumées et trouent la nuit, indiquant les lieux habités. Là on devine dans une habitation isolée une petite lampe à la lueur tremblotante ; plus loin c’est une agglomération où les feux se multiplient ; plus loin encore, dans la direction d’Auneau la fée électricité brille d’un éclat sans pareil.
Nous laissons Dourdan sur notre droite et passons au-dessus de sa forêt, glissant dans la nuit au milieu du silence déchiré seulement par les aboiements des chiens, qui décidément nous en veulent, et qui attirent l’attention des gens qui lèvent le nez et s’exclament : « Un ballon ! » en voyant la masse sombre de notre sphérique.
Il n’est nous est plus possible de nous rendre compte où nous sommes, — n’ayant même pas eu la précaution de nous munir d’une lampe électrique, — et nous en sommes réduits à interpeler les « terriens » qui surpris, hésitent à nous répondre, ne s’apercevant pas tout de suite d’où vient l’interpellation. Saint-Arnoult, Orcemont, Hermeray, La Boissière, nous crie- ton et nous sommes encore au milieu de forêts où de petits étangs font des taches légèrement brillantes. Brou, Roncourt, Anet, Ézy ! Décidément nous remontons vers le Nord et le vent a changé.
Toujours pour éviter d’accrocher nous nous élevons à 900 et
1.000 mètres et là, bien tranquilles, nous cassons la croûte. Dîner amusant dont le souvenir restera longtemps dans notre mémoire. Il ne manque que le café et… le cigare que nous interdit le gaz à qui nous devons cette promenade.
À partir de ce moment nous ne pouvons obtenir de renseignements sur notre situation et nous ne nous rendons que difficilement compte de l’heure. Les pays apparaissent les uns après les autres ; d’abord on aperçoit une lueur qui ressemble un peu au lever de l’aurore, puis les lumières apparaissent et semblent se balance dans la nuit ; ces lueurs s’aperçoivent tellement de loin que la lueur de Paris elle-même nous est apparue toute cuivrée, au loin. Un rien prend de l’intérêt : les phares d’une auto dont le bruit du moteur nous parvient très distinctement, les trains qui courent et dont les lumières se projettent en forme d’éventail…
Quelle est cette ville assez importante à notre gauche ? Et ensuite à notre droite ? impossible de répondre et surtout en raison de ce que nous nous croyons bien moins loin que nous le sommes. Une lueur plus grande se précise droit devant nous. Encore quelque temps et nous nous apercevons que nous nous
trouvons au-dessus d’une très grande ville, car des trains y circulent. U pouvons-nous bien être ? Nous nous interrogeons sans pouvoir donner de réponse. Nous sommes alors si bas, pour appeler, que la corde de notre guide-rope touche les toits. En vain les appels ! les bruits de la ville étouffent nos cris et nous ne pouvons nous défendre d’une certaine inquiétude en voyant des entrepôts, des bassins, de l’eau, des biefs, encore de l’eau…
Les cuivres d’un bal tonitruent et les airs du quadrille de la
Fille de Madame Angot viennent vers nous.
Qu’elle paraît grande cette ville à traverser ! Enfin voici les dernières maisons. Nous appelons encore et tout de même on nous entend. Un habitant fait taire son chien pour mieux nous causer :
Quelle commune ?
La réponse est indistincte.
Quel canton ?
Impossible encore de comprendre.
Quel département ?
Alors là, nous comprenons stupéfaits :
Seine-Inférieure !
Seine-Inférieure ! Comment, déjà ? Ces deux mots produisent un effet magique et provoquent une nouvelle question :
La mer ?
Nous n’avons plus de réponse, nous sommes déjà loin, car ayant jeté du lest pour éviter d’accrocher nous sommes remontés à 900 mètres. Mais alors notre inquiétude devient angoissante. Au-dessous de nous, nous voyons encore de l’eau, puis une véritable mer de brouillard à travers laquelle tremblent quelques lumignons. Un bruit monotone et régulier comme le bruit des vagues monte vers nous.
Est-ce la mer au-dessous de nous ?
Nous n’osons pas nous poser cette question qui pourtant nous étreint et nous brûle les lèvres. À cheval sur le bordage de la nacelle notre pilote qui ne perd pas son sang-froid, essaie de voir à travers la nuit en se penchant. Il ne peut s’empêcher de nous demander :
Qu’est-ce que c’est que ces petites lumières ?
Nous comprenons le sens de cette question que nous traduisons tout de suite : N’est-ce pas les feux de petits bateaux ? Mais aussitôt M. Leprince corrige l’effet de sa demande :
— N’ayez pas peur, nous crie-t-il, n’ayez pas peur, il n’y a pas de danger !
Un coup sec éclate et nous fait lever la tête. C’est que notre pilote a déclenché la soupape. Nous descendons assez vite et l’illusion qui nous tenaille d’être au-dessus de la mer devient de plus en plus vivante…
Comment revivre des moments tellement émotionnants ? Impossible de traduite tout ce qui se passe alors dans l’esprit, quand n’osant à peine respirer on écarte les yeux pour essayer de se rendre compte.
Enfin cette inquiétude, — car enfin il n’y a eu nullement de peur, — prend fin.
Le guide-rope accroche, m’écriai-je en constatant en effet que la corde traîne.
Nous respirons et nous nous apercevons alors, étant passés au- dessous du brouillard, que nous sommes au-dessus d’une forêt… Nous comprenons que ce bruit qui nous inquiétait était celui du vent dans les branches et il souffle ce vent ! à 60 ou 70 kilomètres à l’heure, ce qui nous a trompé puisque nous allions au départ à 6 kilomètres.
Une colline se dresse devant nous, toute boisée.
Couchez-vous dans le fond de la nacelle, nous crie encore
M. Leprince, et n’ayez pas peur.
Cette dernière recommandation est superflue car nous avons grande confiance en lui et nous pouvons nous donner une idée encore de son sang-froid en le voyant, assis sur le bordage, la corde de soupape d’une main, à l’autre main un sac de lest, dans une habile manœuvre nous faisant monter, l’extrémité inférieure de la nacelle caressant pour ainsi dire la cime des arbres. Il craint toutefois toujours de trouver la mer derrière cette haute colline et nous dit qu’il va aborder. À 50 mètres du sommet de ce coteau il fait poser le ballon alors tout doucement, sans un à-coup.
Nous sommes arrêtés mais nous n’avons aucune idée de notre situation, car il fait un noir « de poix » comme on dit dans nos campagnes. Sommes-vous niché dans le haut de grands arbres ? ou bien dans une petite futaie ? Prudemment, M. Leprince sort et en courant dans les branches, amarre notre pauvre ballon qui porte comme nous le verrons le lendemain, une blessure insignifiante d’où le gaz s’échappe lentement et qui sous la pluie qui vient de se mettre à tomber s’affaisse tout doucement.
Il est onze heures.
Ma fois, il n’y a qu’à passer le reste de la nuit ici et tout de suite nous prenons nos dispositions en nous couvrant avec les bâches devant servir à l’atterrissage à emballer le ballon. Celui- ci forme un grand parapluie au-dessus de nos têtes et puisque ce voyage est tout rempli d’imprévu, nous acceptons avec entrain la situation. Dire que nous nous endormons de suite serait inexact car nous ne pouvons arriver à déchiffrer l’énigme : Où sommes-nous ? Quelle est la ville que nous venons de passer ? Rouen, évidemment, croyons-nous. On le verra bien demain !
Notre situation ne nous empêche pas de plaisanter : « — Jugez de l’étonnement des oiseaux, demain matin, en nous voyant, car ils n’auront pas souvent vu de nid comme celui-là. »
Et là-dessus nous nous endormons.
A l’aube, c’est avec assez de curiosité que nous mettons le nez… à a fenêtre et nous nous apercevons que nous sommes sur la terre et non pas comme nous le croyions au faîte des branches. Vite nous sortons de notre dortoir où le froid ne s’est nullement fait sentir et où nous avons été bercés par le bruit de la pluie tombant dans les feuilles. C’est tout de même avec satisfaction que nous nous dégourdissons et que nous sautons à
terre. Il s’agit maintenant de savoir où nous sommes. Faut-il aller à droite, ou à gauche ?
Le hasard offre un chemin de « débardage22 » à notre vue et nous le suivons. Voici bientôt une route sur laquelle nous nous engageons après avoir repéré l’endroit où se trouve le ballon. Ne sommes-nous pas dans un décor de féérie ? C’est vraiment à le croire car voici un vieux château en ruine de grande allure…
Une plaque enfin : Château de Robert-le-Diable ! Moulineaux à 850 mètres ; Elbeuf à 8 kilomètres ½ ; Rouen à 15 kilomètres ! Nous étions en pleine forêt de la Londe. Vite un coup d’œil sur la carte et nous voyons que nous avons traversé trop fois la Seine dans les bouches qu’elle fait) cet endroit, ce qui nous explique pourquoi nous avons vu tant d’eau. Elbeuf, sur qui nous étions passés, nous avait paru si grand à cause des pays qui l’environnent, Caudebec et autres. Ces pays importants que nous avions aperçus à droite et à gauche c’étaient tout simplement Évreux et Louviers.
Nous étions donc encore assez loin de la mer au moment où nous avons atterri, mais pourtant nous ne pouvions mieux faire car à la vitesse où nous allions, une heure de plus et nous étions tout à fait au-dessus des flots, sans espoir même de rencontrer terre puisque la direction que nous suivions nous faisait passer entre les côtes françaises et anglaises ! Et quand on pense qu’il nous restait près de 200 kilos de lest, de quoi marcher 10 ou 12 heures encore !
Un tournant de la route que nous descendons et devant le château de Robert-le-Diable, à côté d’un monument aux
22 Le débardage consiste à transporter les arbres abattus sur leur lieu de coupe (B.G.).
Combattants de 1870 nous jouissons de la vue du plus joli panorama qu’il soit possible de rêver : une vallée de Seine de toute beauté, admirable, où malheureusement manque le soleil.
Un bon café pour nous réchauffer et nous réquisitionnerons une voiture et deux hommes pour venir à notre secours et déloger notre « véhicule ». Deux hommes ! pour dire la vérité, avouons que bientôt il y a 6 ou 8 car les bonnes volontés sont toujours fréquentes dans ces cas-là.
Revenus à l’endroit de notre atterrissage grâce aux fiches de papier que nous avons accrochées aux arbres, — nouveaux Petits Poucets, — en peu de temps les baliveaux qui supportent notre pauvre ballon, qui pend d’un aspect lamentable, sont abattus ; la toile et le filet sont roulés ; les différents agrès rangés dans la nacelle et en route jusqu’à la gare de la Londe. Peu après un train nous emmène à Rouen d’où nous revenons en commentant encore notre équipée et les péripéties mouvementées de ce voyage.
Je ne saurais mieux terminer ces lignes jetées sur le papier un peu rapidement, sans rendre hommage aux qualités vraiment remarquables de notre pilote, M. Paul Leprince, qui une fois de plus nous a prouvé comme il dit que « la peur n’existe pas plus que le danger en sphérique. »
Maurice Dormann.

23 Le Réveil d’Étampes 32/2 (10 janvier 1914), pp. 1-2 (avec une photo p.
2) ; 32/3 (17 janvier 191), pp. 1-2 (avec une photo p. 1) ; 32/4 (23 janvier 1914), pp. 1-2 (avec une carte p. 2). – Tiré à part : Maurice Dormann, 1.650 kilomètres en ballon du parc de Saint-Cloud à Bouckschtow (Russie). Impressions et souvenir (130 p.), Étampes, Réveil d’Étampes, 1914.
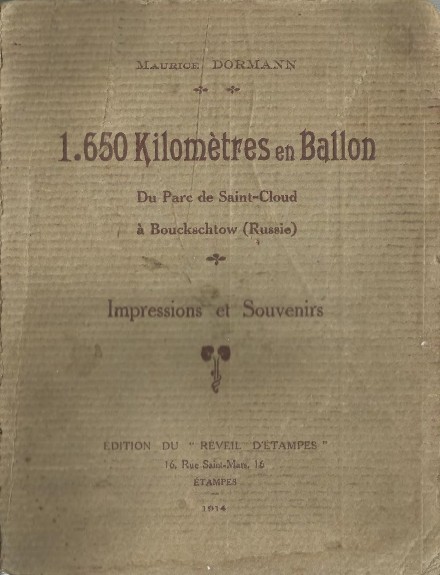
Maurice Dormann
1.650 Kilomètres en Ballon
*
Du Parc de Saint-Cloud à Bouckachtow (Russie)
*
Impressions et Souvenirs
ÉDITION DU « RÉVEIL D’ÉTAMPES »
16, Rue Saint-Mars, 1 6 ÉTAMPES
1914
À l’Ami Paul LEPRINCE Au vaillant Pilote,
En témoignage de sympathique reconnaissance.

— Venez-vous avec moi, je dois partir incessamment pour tenter la Coupe de la Ville de Paris des sphériques. Il faut faire
1.000 kilomètres en l’air au minimum ?
Ainsi me parlait, tout à fait incidemment, M. Paul Leprince, le renommé pilote habituel du ballon du Petit Journal — bien connu maintenant à Etampes, où il vint faire deux ascensions — et je dois avouer, sans forfanterie, que, de suite, je fus séduit par cette proposition. Comment du reste ne l’aurais-je pas été ? N’avais-je pas déjà avec ce charmant compagnon, fait deux voyages en ballon qui m’avaient laissé le souvenir le meilleur qu’on puisse imaginer ? N’était-ce pas lui qui m’avait fait
aimer ce sport tant intéressant, que je dois dire plus passionnant pour moi, que l’aviation |10 goûtée auparavant et à plusieurs reprises ?
Plus de mille kilomètres en sphérique ! Que d’émotions cela nous promettait et comment résister à une offre semblable ?
Sans hésiter, je répondis à Paul Leprince :
— Quand partons-nous ?
J’allais déjà un peu vite, car j’oubliais que pour un semblable voyage il était nécessaire de s’assurer de toutes les chances de réussite possibles et on s’imagine facilement combien surgissent, nombreuses, les difficultés. Il y a d’abord le vent qu’il faut observer en raison de la direction qu’il doit donner à un aéronat et à ses passagers, et cela n’est pas peu de chose car si dans notre jeunesse, il était de coutume d’envoyer, au 1er avril, chercher aux naïfs « la ficelle à faire tourner le vent », on s’aperçoit un peu plus tard, combien il est
difficile de se procurer cette ficelle merveilleuse.
Et pourtant il n’y avait pas de temps à perdre car cette Coupe de la Ville de Paris devait être courue avant le 31 décembre.
Un mot en passant sur ce prix. Cette épreuve pour la plus grande distance, est ouverte à tous les ballons sphériques, |11 cubant au maximum 2.200 mètres, gonflés au gaz d’éclairage. Le départ doit avoir lieu du parc de l’Aéro-Club de France, aux coteaux de Saint-Cloud, et la Coupe ne peut être disputée en
même temps qu’un autre prix.
La date fatale d’échéance était proche, on touchait la fin de l’année. Pourrait-on ravir le prix à M. Bogain, qui en était détenteur avec un parcours de 966 kilomètres ?
Tout de suite j’avais dit à mon ami Paul Leprince combien j’étais heureux de sa proposition que j’acceptais avec enthousiasme et déjà je rêvais de voyage extraordinaire, sans me douter, il faut bien le dire, combien mes rêves allaient être dépassés, bien au-delà, par la réalité qui laissera dans mon esprit un souvenir impérissable.
Je connus toutes les transes d’une attente fiévreuse. Pendant près de quinze jours, après que j’eus accepté l’offre de mon
pilote habituel, — comme je pourrais presque dire, — je ne cessai de m’intéresser à l’état du temps. Jamais je n’inspectai le ciel avec autant d’intérêt, le matin la première préoccupation était de lever |12 les yeux sur les coqs qui grincent au faîte de nos vieux clochers et que j’aurais tant voulu voir le nez vers l’ouest, ce qui aurait signifié que le bon vent répondait présent !
Un ami même — abusant de mon impatience, — m’apprit un moyen nouveau pour moi de connaître la direction du vent :
On mouille un doigt, — me dit-il narquoisement, — et on le lève en l’air. Ça pique aussitôt du côté d’où vient le vent !
C’était trop simple ; je n’y crus pas.
Tout à coup, ô ironie ! le vent qui était à l’est se tournait subitement au sud puis brusquement remontait au nord. Cette mauvaise volonté devenait vraiment exaspérante et cela d’autant plus que le vent remonté, semblait vouloir persister à nous annoncer, du nord, les gelées et les neiges.
Bah ! me dit un jour un bon vieux, — quelque peu interloqué à ma demande sur l’état du temps, car il connaissait ma quasi indifférence sur ce point, — ça va changer ; hier il a gelé « sec » mais ce matin il y avait « du blanc ».
Et que prouve ce « blanc » ?
Un regard plein de mépris fut la réponse |13 à ma question qui parut sans doute bien naïve…
Mais le bon vieux avait raison et je ne voudrais plus nier son expérience. Le froid cessa de persister et bientôt le vent était
« du bas » et tournait franchement vers l’ouest. Mon impatience
alors redoubla et chaque fois que j’entendais la sonnerie du téléphone, il me semblait, en prenant le récepteur, entendre la voix de Leprince :
— Allons, en route ! c’est pour aujourd’hui.
Ce coup de téléphone retentit enfin. Le bureau central de météorologie avait donné des renseignements favorables. Jusqu’à la frontière d’Allemagne le vent était assez propice. Après la frontière, hum ! c’était assez délicat à dire, mais enfin, la tentative pouvait être faite...
Il était temps. Ce jour-là était le 26 décembre, lendemain de Noël. |14
*
* *
Quand j’arrive au parc de l’Aéro-Club, aux Coteaux de Saint- Cloud, je suis en avance. Le ballon qui doit nous emporter n’est pas encore gonflé et cela me chagrine, car je m’imagine que ce gonflement doit être long. Mais ma crainte est vaine, en trois quarts d’heure — l’Astrolabe n°15 — notre «véhicule » a absorbé ses 1600 mètres cubes de gaz et se balance dans l’air, impatient lui aussi de s’envoler. La nacelle est amarrée. On y jette dedans une botte de paille, qui doit empêcher l’air de pénétrer à travers le panier. Les instruments, les
victuailles, sont embarqués et bientôt |15 nous-mêmes prenons place après avoir rangé les banquettes seize sacs de
lest qui nous permettront d’équilibrer le ballon et de lui permettre, un peu plus tard, de franchir les montagnes, de traverser les tourmentes de neige et de tenir tête à la tempête.
— Lâchez tout !
Il est exactement 4 h. 25 du soir.
Majestueusement nous nous envolons et comme la première fois que je pus jouir de cc spectacle, je ne peux détacher mes yeux de la terre que nous quittons, de cette terre qui en cet endroit est pour ainsi dire presque entièrement cachée par les maisons dont les lumières sont déjà allumées.
Au-dessous de nous la Seine. Comme effrayé par notre apparition un bateau mouche, — oh combien mouche vu d’en haut — glisse rapidement sur le fleuve. Le bois de Boulogne n’est déjà plus qu’une petite touffe noirâtre où brillent quelques gros vers luisants...
On voudrait voir tout cela en plein jour. Pourtant le charme ne serait pas le même, car on subit l’influence de l’heure. Toutes ces lumières qui semblent réagir contre la |16 nuit drapant la terre entière de son sombre manteau, n’empêchent pas une douce mélancolie de se dégager
de ce moment où l’intensité de la vie se ralentit avant le sommeil. Les bruits du jour sont déjà bien apaisés en ce soir d’hiver et la clarté factice des becs de gaz et de l’électricité lutte vainement contre l’engourdissement où la terre sombre, malgré les humains.
Et pourtant quel splendide panorama ! Quel magnifique coup d’hui ! D’un côté la ligne droite de l’avenue de la Grande Armée avec un polit rond baigné de lumière : la place de
!’Etoile, au fond la tour Eiffel dont le sommet paraît être dans les nuages. De l’autre côté l’avenue de Neuilly... Neuilly...
Comme cette fourmilière a de vastes proportions.
Malgré les multiples bruits d’en bas nous entendons distinctement ce cri qu’on perçoit dans toutes les ascensions :
— Un ballon !
Déjà nous sommes loin et le vent de terre, — nous ne sommes qu’à 400 mètres — nous pousse vers le nord-ouest.
Bientôt nous sautons la Seine et nous nous trouvons dans la boucle de Gennevilliers |17 d’où nous voyons émerger de hautes cheminées d’usine.
Mauvaise direction ! murmure Leprince qui prend vivement un sac de lest et le lance par-dessus bord.
Comme il l’avait bien supposé les vents de hauteur n’ont pas la même direction que ceux de terre. Le ballon obéit tellement rapidement à l’allégement du sac de lest jeté, qu’il se précipite en avance d’au-moins un mètre cinquante de la nacelle, nous faisant franchir l’autre côté de la boucle de Seine en grande vitesse.
Un coup de couteau dans la corde qui retient le guide-rope roulé à la nacelle et le grand serpent descend d’un seul coup en nous donnant quelques petites secousses.
Nous sommes toujours relativement bas. À ce point même que des gens qui sont dans les champs quand nous leur demandons sur quelle commune nous sommes, nous répondent :
Comment ? il faut tirer la corde ?
Eh la ! pas encore ! Et de crainte de voir mettre ce projet à exécution, nous nous faisons remonter après toutefois avoir fait crier le nom du pays, enfin compris :
Pierrefitte ! |18
— Toujours mauvaise direction, s’inquiète Leprince. Puisque les vents d’en haut sont meilleurs, allons-y.
De fait, après avoir installé la boussole reposant sur un plateau carré suspendu par quatre cordelettes attachées aux coins, nous pouvons commencer à repérer le sens de notre marche, suivant les points cardinaux. J’avoue que ce n’est pas du premier coup qu’on peut arriver la nuit à reconnaître en sphérique sa marche à la boussole. Il y a ce diable de mouvement de rotation qui nous fait continuellement perdre de vue le point de repère choisi et il faut regarder fixement ce point sans s’inquiéter des cordages retenant la nacelle qui parviennent à troubler la vue en passant devant les yeux.
Le ciel lui-même est sombre et d’en bas on ne doit apercevoir comme étoile que notre lampe électrique toute petite étoile... filante !
Distinctement, nous apercevons un fleuve que nous venons de passer. L’eau a des reflets d’acier qui se précisent malgré la nuit. Est-ce Meaux ? Est-ce la Ferté-sous-Jouarre qui se trouvent sur notre route ? |19
Déjà le petit jeu des suppositions commence. Combien seront inexactes malgré le soin qu’on prend de se donner des raisons pour appuyer l’avis qu’on vient d’émettre. Là ces agglomérations importantes, on calcule cette importance
d’après l’étendue des lumières, — ne sont-elles pas telles ou telles villes qui figurent bien sur la carte dans cette disposition. Et c’est probablement ainsi que nous passons au- dessus de Château-Thierry et de Reims.
Nous ne pouvons nous rendre compte de la vitesse exacte à laquelle nous allons et cependant les villages, les villes, tout cela apparaît, fuit, disparaît pour nous laisser entrevoir sur la ligne d’horizon de nouvelles lueurs qui bientôt se préciseront pour disparaître à leur tour.
La température est tout à fait supportable. Il ne fait pas froid peut-on même dire. En effet, comme nous sommes dans le vent nous ne le sentons pas et nous n’avons à subir que l’ambiance de l’air. |20
*
* *
Il ne faudrait pourtant pas oublier de dîner, l’air ne suffit pas. Un coup d’œil donc au baromètre enregistreur, à la boussole, et à table.
Assurément cela ne vaut pas le confortable des chaises moelleuses d’un grand restaurant, mais vraiment nous ne sommes pas trop mal sur nos banquettes, face à face.
Le panier à provisions est ouvert et nous reconnaissons avec plaisir que Mme Leprince n’a rien oublié.
De bon appétit, nous attaquons le menu et plaignons les pauvres terriens qui |21 sont obligés de dîner dans des salles à manger où les poêles donnent une mauvaise odeur.
Allons bon ! qu’est-ce qui se passe maintenant ? Nous sommes terriblement secoués. Le brouillard dans lequel nous venons d’entrer nous a empêché de distinguer des dénivellements de terrain assez accentués et quoique nous sommes à plus de 700 mètres de hauteur la corde de notre guide-rope qui n’a que 100 mètres de longueur, vient d’accrocher dans des arbres.
Nouvelles secousses plus brutales encore.
Cette fois le panier à provisions est jeté au fond de la nacelle et il faut vite se servir du lest pour passer cet endroit.
C’est fait, mais maintenant voici autre chose. Tout autour de nous de gros flocons de neige voltigent, très épais ; on ne voit plus rien que cette sarabande.
Eh bien tant pis ! prenons-en notre parti, et moquons-nous de la neige et de tout ce sale temps !
À peine avions-nous pris cette résolution et nous étions-nous réinstallés pour continuer notre repas que nous avions à subir de nouvelles secousses. |22
Encore ! Pas moyen de manger tranquillement alors !
Il y a des remous très violents qui font claquer le ballon. Ce bruit est impressionnant au milieu du plein silence de la nuit, dans cette sourde tempête que nous n’entendons pas, mais qui nous chahute terriblement.
Nous devons être au-dessus de la forêt de l’Argonne, pas possible autrement, — avance Leprince.
Cette version était sans aucun doute la bonne. A ce moment nous devions passer à l’extrémité nord de cette forêt et entrer dans la forêt de Woëvre. Ces deux villes que nous venions de passer étaient probablement Vouziers et Montmédy.
Le voyage dans la neige continue, bien que nous soyons remontés et à chaque instant il nous faut enlever les flocons qui, tombés sur la boussole gèlent immédiatement.
Un moment de calme et croyons-nous c’est au moment où nous passons la frontière pour entrer dans la pointe sud de la Belgique pour passer au-dessus de Arlel — cette supposition comme toutes celles que nous ferons par la suite étant basée sur le |23 tracé du trajet parcouru suivant les points
de départ et d’atterrissage.
Nous ne voyons rien car nous sommes au-dessus des nuages et les douaniers ne peuvent nous en vouloir de leur avoir brûlé la politesse : nous ne les avons pas vus.
Tout de suite nous sommes dans le Luxembourg que nous traverserons entièrement en passant au nord de Luxembourg pour entrer en Allemagne par la province Rhénane probablement à Trêves.
La neige qui décidément s’acharne après nous, nous a rattrapés et ne nous lâchera pas pendant près de deux heures.
Tout à coup, éclaircie. Le rideau qui nous cachait la terre semble se déchirer brusquement et des mille mètres de hauteur où nous sommes, nous apercevons très distinctement des agglomérations importantes, très rapprochées les unes des autres.
Au-dessus de nous brillent des étoiles. Que cela est réjouissant ! Et si nous pouvions profiter de ce ciel jusqu’au lever du jour ! Hélas, cette éclaircie devait être de bien peu de durée !
Les suppositions recommencent. Et c’est d’autant plus amusant que rien de ce que nous avançons n’est exact. Un point |24 de repère nous permet tout de même de savoir où nous sommes. Alors que nous voulions être passé sur Bar-le- Duc et Nancy en apercevant Metz à notre droite, nous sommes indiscutablement fixés sur notre position et c’est le Rhin, ce fleuve qu’on ne peut confondre avec aucun autre, qui nous permet de savoir que nous passons sur Coblentz, en
ayant à notre droite Mayence et Francfort el plus loin Darmstadt.
Il est alors 10 heures 20 du soir.
Nous sommes donc en pleine zone interdite, mais nous nous en moquons pas mal de l’interdiction stupide qui empêche aux aérostats de passer au-dessus de certaines contrées. Il faut vraiment que ceux qui prennent de telles initiatives sachent bien peu ce que peut être une ascension.
Est-ce qu’en passant au-dessus d’un fort, même lentement, on pourrait recueillir des renseignements intéressants ?
Non pas. Et quels seraient au fait, ces renseignements intéressants ? Ah ! si on pouvait dire, après l’avoir vu, dans tel fort il y a une garnison de tant d’hommes ; ce fort est protégé par des canons de tel et tel modèle ; il y a des approvisionnements |25 pour tant de jours, etc..., alors oui, ce serait un espionnage dont on pourrait tirer quelque fruit, mais comment voir cela ?
Ainsi parle Leprince et je sens toute la logique de son raisonnement simple. Il poursuit encore :
Qu’on empêche aux avions mus mécaniquement de passer au-dessus des points stratégiques, cela je l’admets encore car on pourrait voir dans le vol d’un aéroplane passant sans cesse au-dessus d’une place forte ou dans un dirigeable planant au-dessus de celte môme place, une sorte de provocation narquoise, — mais pourquoi étendre cette interdiction au sphérique qui s’en va tout bêtement dans le vent qui l’emporte ?
Tout cela est vrai et un peu de réflexion amène à penser combien ces susceptibilités sont mesquines.
Ma foi toutes les interdictions du monde, — en ce qui nous concerne, — ne nous empêcheraient pas de continuer notre voyage et nous ne pouvons nous défendre d’un pied de nez gavroche à l’adresse de ces bons allemands qui craignent tant des aéronautes français. |26
*
* *
Nous sommes à peine une demi-heure dans la clarté qui nous a permis de voir toutes ces grandes villes allemandes, resplendissantes de lumières où l’on distingue des feux vert pâle et d’autres d’un rouge violent qui, si je ne me trompe, sont les feux des lignes de chemins de fer ou des gares dont les halls transparents font une tâche lumineuse.
Déjà tous ces feux s’enfuient. Les quelques étoiles qui timidement se montraient se sont dérobées en coquettes à nos yeux. Comme nous connaissons bien maintenant les nuages de neige, nous voyons que nous |26 allons encore pénétrer dans un très épais.
Cette fois, c’est la grande danse. Chahut sur toute la ligne. La nacelle suit obliquement le ballon qui par instant revient en arrière lorsqu’il rencontre des remous qui nous font virevolter comme une toupie. Il faut se tenir aux cordages pour ne pas être jeté au fond de la nacelle à tout instant. Impossible de tenir la boussole pour voir notre direction. L’aiguille semble affolée. Le baromètre nous indique que nous sommes à 750 mètres d’altitude.
Un choc brutal.
Notre lampe électrique est éteinte au coup. Nous avons
« cogné » contre une montagne qu’il était impossible de voir.
Rapidement Leprince saisit un sac de lest et le jette par- dessus bord.
Attention ! tenez-vous bien, me crie-t-il. N’ayez pas peur!
Peur ? Très sincèrement, sans forfanterie je n’éprouve aucune crainte. N’ai-je pas déjà connu avec ce même pilote des émotions presqu’aussi angoissantes lors de notre atterrissage dans la forêt de la Londe, entre Elbeuf et Rouen, au mois d’octobre dernier ? Non, je n’ai pas peur, et Leprince le sait bien, le sent bien... |28
Sacrebleu ! Qu’est-ce qu’il y a là ?
Notre guide-rope est accroché, pas de doute possible. Le ballon claque, semblant faire des efforts, pour se dégager. Allons, il faut sacrifier un autre sac de lest.
Cette fois le ballon fait un bond formidable.
Couchez-vous dans le fond de la nacelle, me crie Leprince, en se tapissant lui-même.
Nous escaladons cette montagne à une folle allure en glissant sur la cime des arbres. Les branches font un bruit violent de froissement sur notre panier d’osier et notre guide- rope qui rabote lui aussi les arbres, nous donne des secousses violentes qui font faire aux cordes entre le ballon et la nacelle des angles presque droits.
Tout cela ne dure que quelques secondes, mais il est impossible de décrire tout ce qui se passe dans ces moments- là, où, à la merci d’une si violente tempête on ne sait ce qui pourrait advenir.
Enfin nous sortons de cette situation critique et nous pouvons être assurés de l’exactitude de ce que nous pensions : au bout de notre guide-rope est accroché, en |29 manière de breloque, un souvenir de cet à-coup formidable.
Qu’est-ce que ça peut bien être ? En tout c’est bien lourd et nous constatons que l’incident nous a coûté 40 kilos de lest et conséquemment quelques centaines de kilomètres.
Ne nous plaignons pas toutefois. Lorsque sur le chemin du retour, à Varsovie, nous aurons vu les journaux français, nous apprendrons qu’un des champions les plus en vue du sphérique actuellement, Rumpelmayer, hier encore recordman
du monde de distance, était parti quelques heures après nous des coteaux de Saint-Cloud pour tenter lui aussi la même Coupe de la Ville de Paris, à bord d’un ballon cubant
2.200 mètres et accompagné de deux passagers. Nous saurons que très probablement au même endroit dont nous venons à grand peine de nous tirer il a dû laisser son ballon, qu’il ne put arriver à sauver et qui fut complètement détruit.
Leprince a donc droit à tous les éloges pour la façon dont il sortit victorieux de ce passage difficile, grâce à ses qualités de pilote consommé dont le sang-froid et la rapide résolution sont les plus beaux apanages. |30
En passant, il faut bien dire en blessant sa modestie que s’il ne s’est pas fait connaître d’une façon plus retentissante, comme pilote, c’est parce qu’ingénieur aéronaute, constructeur de ballons, il lui est toujours difficile de se mettre en ligne pour des épreuves où il se trouverait être le concurrent de ses propres clients. Sa délicatesse naturelle du reste met bien souvent un frein à ses désirs.
Mais vienne l’occasion de révéler toutes ses qualités, il le fait simplement, comme une chose tout à fait normale, sans le crier sur les toits ; il n’a que faire de la Renommée à coups de tam-tam, il sait ce qu’il peut faire, il a confiance en lui et c’est ce qui le fait aimer et considérer par tous ceux qui le connaissent et l’apprécient... |31
*
* *
Revenons à notre voyage.
Il est hors de doute que nous aurons du mal à nous en aller tranquillement : toujours devant nous l’obscurité. C’est à peine si nous voyons en passant Iéna, à gauche Leipzig, puis plus au loin les lueurs de Berlin ; à droite Dresde.
La nuit paraît bien longue et malgré soi on se laisse aller à de longs instants de silence, seulement troublés par les battements réguliers du chronomètre du baromètre enregistreur, dont la bobine portant le diagramme tourne régulièrement malgré les multiples à coups reçus en cours de route. |32
On regarde par-dessus le bordage d’une façon machinale et vague et on semble tout surpris quand trouant la brume on aperçoit quelques lumières vivement disparues.
Une émotion encore assez vive.
Le ballon file à une allure qui certainement approche 120 kilomètres à l’heure.
Au-dessous de nous, nous avons l’impression très nette qu’il y a une forêt. Le bruit du vent dans les branches nous parvient très distinctement, ressemblant étrangement au bruit des vagues de la mer...
Tout à coup dans la nuit une lumière, une seule, très vive qui apparaît et disparaît avec régularité.
Sans rien nous dire nous nous regardons, Leprince et moi. La même question est sur nos lèvres :
— Un phare ?
Et pourtant nous ne prononçons pas le mot, nous nous penchons sur le bordage, la tête en avant, cherchant à plonger nos regards dans la nuit noire...
Nous ne voyons rien autre que cette lumière : un, deux, trois feux réguliers, puis plus rien ; quelques secondes et les feux ayant tourné reviennent : un, deux, trois ... |33
Ne sommes-nous pas le jouet d’une illusion ? Impossible car nous n’en subirions pas ensemble le même effet.
On regarde la boussole ; celle-ci est redevenue tranquille et nous permet de contrôler que nous allons toujours bien en plein Est.
C’est avec satisfaction que nous voyons ce petit point lumineux perdu au milieu de la nuit s’en aller, fuir... et c’est avec un plaisir non moins vif que nous apercevons d’autres timides petites lueurs.
Et nous filons toujours.
Vers cinq heures du matin, un phénomène curieux se produit. Un éclair rapide zèbre toute la nuit de sa clarté soudaine. C’est comme un éclair d’orage mais sans coup de tonnerre.
Encore une fois nous nous regardons. Encore une fois nous craignons d’être le jouet d’une illusion. Et nous attendons presque le retour de ce phénomène qui ne se reproduira pas.
Nous passons silencieusement au-dessus de vastes plaines recouvertes de neige.
Que le temps nous semble long ! Que le jour tarde à paraître ! Toutes les dix minutes nous regardons nos montres dont les |34 aiguilles semblent ne pas marcher. On préférerait être toujours secoué mais voir clair, savoir où l’on va, pouvoir se renseigner sur notre situation.
Vers six heures du matin nous apercevons encore les lumières de deux grandes villes, une de chaque côté de nous, et qui sont probablement, — nous l’ignorions à ce moment, — Posen à gauche et Breslau à droite.
Une demi-heure après nous ne voyons plus rien, nous avons à nouveau escaladé un nuage de neige et tout doucement le jour se lève.
Après l’avoir tant désiré, sa venue nous laisse presque indifférents. En effet nous ne voyons rien, nous voguons dans le blanc, un blanc immaculé, en haut, en bas, devant, derrière.
— Blanc partout, ne puis-je m’empêcher de m’écrier, comme au domino !
Nous descendons un peu cependant et nous pouvons jouir d’un spectacle nouveau pour moi et très curieux. Il y a plusieurs couches de nuages superposées et tous ne vont pas dans la même direction. Ceux qui sont les plus près de la terre vont vers le nord, dans une direction autre que |35 la nôtre. Rien de plus bizarre que ces nuages courant les uns après les
autres, semblant jouer à un saute-mouton gigantesque, toujours dans le plus grand silence.
Le voile se déchire. À perte de vue une plaine immense, mais une plaine tout inondée. De l’eau partout. On se trouve cependant dans une région cultivée car il y a une mosaïque assez prononcée quoique dans une nuance terne, grisâtre.
À l’intérieur des quelques habitations que nous apercevons, de grandes mares d’eau. Dans les champs des cuvettes sans nombre. Comme ce décor est loin de nos paysages de France !
À 7 heures 5 du matin, nous passons un cours d’eau assez large. Est-ce la Warta, affluent de l’Oder qui se jette dans la mer Baltique près de Stettin ?
C’est probable.
Nous prenons encore de l’altitude, puis descendons à 800 mètres.
Toujours le même paysage. Toujours de l’eau.
Mais presque aussitôt nous remontons naturellement, car nous n’avons pas jeté de lest depuis 5 heures du matin. Du reste nous n’en jetterons plus du tout. Nous sommes |36 bien obligés à la vérité d’être un peu chiches de ce lest dont nous n’avons plus que deux sacs et nous ne voudrions pas atterrir ici.
La terre s’enfonce donc encore une fois sous nos pieds et nous ne la verrons plus qu’à l’atterrissage. Nous avons atteint les 2.000 mètres d’altitude à 9 h. 12 et nous continuons toujours à monter car l’appendice du ballon nous lance à la figure l’odeur caractéristique du gaz.
À 9 h. 40 nous atteignons 2.400 mètres et à 10 heures 2.650 mètres.
À ce moment nous percevons encore distinctement les bruits de la terre, les aboiements des chiens, le vent dans les branches d’arbres et même des coups de fusil qui crépitent comme dans un feu de salve.
Nous n’attachons aucune importance à tout cela.
A 10 h. 10 nous sommes à 2.800 mètres et là, au-dessus des nuages, on aperçoit une ligne d’horizon bleu clair ... Tout là- bas, n’est-ce pas un reflet de soleil qui met comme une frange d’argent brillante au sommet des nuages ? |37
Pourvu que nous ne soyons pas « chipés » par le soleil, dit Leprince.
En effet, si le soleil nous attrapait nous pourrions monter jusqu’à 5 ou 6.000 mètres. Pour redescendre ensuite, il nous faudrait traverser à nouveau la couche des nuages de neige et à cause de la brusque condensation, notre descente pourrait prendre les proportions d’une chute, puisque nous ne pourrions l’enrayer avec les quarante kilos de lest dont nous disposons.
Il est vrai que, comme dit Leprince :
En cas de malheur, un coup de couteau dans les cordes qui retiennent la bâche où le ballon doit être roulé, ou dans le guide-rope. Nous serions allégés d’autant.
À 10 h. 40 nous sommes à 3.000 mètres, et nous entrons dans une seconde couche de nuage. La ligne d’horizon disparaît et encore une fois c’est blanc partout.
Quelle direction suivons-nous ? À quelle vitesse allons- nous ? Où sommes-nous ? Il faut avoir vécu ces heures pour se faire une idée de ce que ces questions qui paraissent si simples, prennent une proportion considérable. |38
Je donnerais beaucoup pour y répondre, ne cache pas mon ami Leprince.
11 heures. 3.150 mètres !
Le soleil menace de nous « chiper ».
Dans le silence, — car depuis quelque temps nous n’entendons plus aucun bruit, même plus d’aboiements de chiens, — un bruit bien caractéristique monte jusqu’à nous. C’est le cri prolongé des sirènes de bateaux.
Sans dire un mot, nous nous dressons et nous fixons cette masse uniformément blanche et éblouissante qui nous faisait cligner les yeux une seconde avant et devant laquelle nous avions peine à garder les paupières ouvertes.
Deux ou trois fois, ce bruit de sirènes nous parvient. Il semble s’amplifier, prendre des sonorités d’une puissance extraordinaire en montant dans l’air.
— Tant pis si l’eau est dessous, dit tout à coup Leprince prenant une résolution énergique.
Et ploc ! il actionne la corde de soupape à trois reprises différentes de trois secondes chacune.
C’est suffisant. Aussitôt notre véhicule obéit et se met à descendre. Nous quittons |39 la couche de nuages supérieur et bientôt entrons dans la seconde. C’est avec une certaine anxiété que nous cherchons à entrevoir le sol et les secondes sont interminablement longues.
Enfin le paysage apparaît. |40
*
* *
À perte de vue au lieu des vagues que nous nous attendions à voir, s’étend une plaine immense couverte d’un blanc manteau de neige duquel par ci par là émergent quelques bouquets sombres de bois de sapins.
Enfin des habitations, mais des habitations toutes basses, toutes noires, de rares habitants qui nous semblent accoutrés de bizarre façon... Des moulins à vent...
Le doute n’est pas permis, nous sommes bien en Russie... mais à quel endroit de la Russie ?
Nous ne sommes plus qu’à 100 mètres du sol et nous sommes poussés par un vent furieux qui nous emmène à toute allure. |41 Le guide-rope traîne sur le sol et nous pouvons voir que ce qui s’y trouve attaché est un pieu en fer de
dimension fort respectable auquel pend un long morceau de fil de fer.
Faut-il continuer de marcher ainsi au guide-rope. La chose serait possible, mais deux raisons viennent se dresser en travers de nos projets.
Devant nous, d’abord, suivant probablement un chemin qui disparaît sous la neige, une ligne unique de fil téléphonique qui pourrait bien nous être très utile car elles sont plutôt rares dans cet immense territoire de la Russie.
Nous passons cette ligne à proximité d’un petit village. Notre guide-rope ne va-t-il pas la rompre en passant dessus avec son pieu ? Cela nous ennuierait. Mais non ; il se produit même une chose incroyable, ce pieu qui nous a tant tracassé et que nous promenons depuis 6 ou 700 kilomètres, se détache en passant sur le fil si fragile, qu’il ne casse pas.
Nous n’avons pas le temps de nous arrêter sur cet incident : dans le sens de notre marche, à quelques cents mètres des marais gelés nous apparaissent et c’est là la deuxième raison qui peut militer en faveur |42 d’un atterrissage. Ces marais en Russie ne ménagent pas souvent quelque chose de bon et on ne saurait trop prendre de précautions.
Près de ce marais, un autre village, pas d’hésitation donc, il faut toucher terre, et entre ces deux villages, — à perte de vue nous n’apercevons aucune autre habitation humaine, — nous trouverons bien de l’aide.
Déjà rapidement le diagramme enregistreur, qui permettra à Leprince de justifier de sa randonnée et qui devient tant précieux, a été rapidement mis à l’abri d’un choc.
Attention! me crie Leprince. Vous y êtes ?
Oui.
Et je me cramponne aux cordages pendant que Leprince poursuit très vite, ponctuant énergiquement chaque mot :
Attention ! Attention ! Je vais tirer la corde de déchirure. Ça va cogner dur... dur...
Allez-y !
Il n’y a pas d’autre moyen d’atterrir ; nous ne sommes plus qu’à cent cinquante mètres de l’extrémité des marais et il fait
|43 un vent de tempête qui certainement doit atteindre 120 à 130 kilomètres à l’heure.
Attention, ça cogne !
En effet « ça cogne » et dur. Comme me l’avait si bien crié Leprince en appuyant sur ce mot pour que je m’attende à tout. Heureusement ce n’est pas mon premier atterrissage et je me souviens qu’à mes deux ascensions précédentes, j’ai déjà touché terre dans des circonstances particulièrement mouvementées. Décidément moi qui aime les émotions, je suis toujours servi à souhait.
On rebondit après ce premier choc.
— Ça va cogner encore... dur...
Un craquement de toile déchirée. D’un seul coup vigoureux, sans hésitation, Leprince a décollé le panneau de déchirure.
Au même instant nous touchons encore brutalement mais cette fois notre pauvre ballon, qui s’est si bien comporté durant tout ce long et dur: voyage, est éventré, et le gaz s’échappe à grands flots. Nous ne remontons pas, mais la nacelle qui avait touché le sol sur sa base est violemment culbutée sur le côté et le vent ·qui s’engouffre dans le ballon nous traîne sur environ quatre-vingts mètres. |44
Naturellement nous sommes couchés sur le côté. Instinctivement je mets mon coude au-dessus de ma tête pour me préserver de la neige qui s’amoncelle sur le bord de notre panier et fait frein.
Est-ce bien terminé ? Au moment où nous allons nous lever pour nous en assurer, comme dans un dernier soubresaut, le ballon s’élève, gonflé par le vent dans lequel il claque, se débattant dans le filet qui l’enserre cl l’emprisonne. On croirait que c’est un dernier mouvement de rage qui l’actionne, qu’il ne veut pas s’abattre.
Dans un effort suprême, il nous traîne encore une dizaine de mètres puis s’abat comme une bête qui a tout fait pour se défendre contre la mort et qui ne pouvant plus résister rend le dernier souffle.
Le croiriez-vous ? Ce moment est impressionnant au possible, malgré soi on se sent ému...
...Nous saurons plus tard que les sirènes que nous avions entendu appartenaient aux chemins de fer russes pour lesquels elles remplacent le sifflet, comme nous apprendrons aussi que nous avons atterri au commencement des marais du Pripet qui s’étendent sur près de 400 kilomètres... |45
*
* *
Tout le monde descend !
C’est ce cri qui échappe le premier à mon ami Leprince, quand enfin, après notre atterrissage mouvementé, nous nous décidons à sortir de la nacelle où nous sommes plutôt mal, couchés sur le côté, avec devant nous une barricade de neige que le bordage a amoncelée pendant que le ballon, poussé par le vent, était traîné.
En prenant des précautions, Leprince veut sortir, mais nous sommes arrivés sur le bord extrême du marais que nous avions aperçu et que nous voulions éviter à tout |45 prix. Il y a peu de profondeur à cet endroit mais sous l’épaisse couche de neige les pieds s’enfoncent dans une gadoue infecte qui ressemble au purin des cours de nos fermes.
Attendons !
Et nous nous juchons sur la nacelle renversée en contemplant le paysage, le bout du nez réchauffé par une cigarette.
Il est 11 heures 25 du matin. Comme notre voyage a duré exactement dix-neuf heures il a fallu que nous allions à un train d’enfer pour nous retrouver en Russie.
Mais en quel coin de Russie ? Voilà la question que nous nous posons et qui revient comme un leit-motiv dans notre conversation.
Ma foi, où que ce soit, l’essentiel est que, sans aucun doute possible, la Coupe de distance de la Ville de Paris est ravie à Bogain, et haut la main. Je ne puis m’empêcher, à ce moment de serrer les mains de mon brave pilote en le félicitant ; — voulant être le premier, — pour la magistrale façon dont il devenait recordman.
Nous sommes presque surpris de ne pas sentir le froid. Est- ce l’habitude de l’air ? Est-ce la satisfaction ? Je ne saurais le
|47 dire. Il est vrai que nous n’avons que 12 à 15 degrés au- dessous de zéro.
Un vent de tempête souffle sans discontinuer et fait murmurer à Leprince :
— Jusqu’où serions-nous allés avec ce vent ! |48
*
* *
De loin on nous a aperçus et nous voyons les premiers êtres vivants perdus dans ce désert de désolation.
Ils accourent vers nous et nous n’avons nulle peine à reconnaître en eux les fameux moujicks, ou paysans russes, que nous ne connaissions que par les lectures.
Ils sont d’abord deux qui marchent avec précaution car ils connaissent bien, eux, les marais qui ne s’indiquaient à nous que par des surfaces de glace. Puis en voici qui accourent de
tous côtés du village le plus proche — Bouckschtow, comme nous pourrons l’identifier plus tard. |49
Mais hélas ! impossible de se comprendre. Nous ne parlons pas plus russe que les pauvres ne parlent français et quand nous leur disons que nous venons de France, leur ahurissement est certes plus grand que si nous leur apprenions que nous descendons de la lune.
Qu’ils paraissent misérables tous ces pauvres moujicks ! Hâves, les joues creuses, le teint terreux, ils sont vêtus de la plus bizarre façon. Presque tous portent des peaux de moutons brutes dont le cuir a été tanné et qui sont grossièrement ajustées. Dessous quelquefois une blouse attachée sur le côté. Des bonnets d’astrakan sur la tête ou de ces casquettes à toute petite visière avec la coiffe relevée par devant. Aux pieds presque tous des bottes ; les autres ont des sortes de semelles ajustées avec des ficelles qui entourent le pied et dont les extrémités sont nouées au genou.
La misère se lit sur tous les visages en même temps que de tous leurs gestes se dégagent une indifférence très marquée, une nonchalance, qui rappellent un peu la race arabe. Plusieurs fois du reste nous remarquerons de nombreux points de ressemblance |50 de ce peuple de moujicks avec le peuple arabe.
Nous tentons tout d’abord de demander où nous sommes, le nom du pays. Vainement. Nos interlocuteurs nous regardent en ouvrant de grands yeux étonnés et c’est tout.
Moscou ? demandons-nous.
Ils connaissent Moscou, — tout au moins de nom. L’un d’eux se tourne dans la direction où nous allions et montre du doigt en semblant nous dire ; « Là ! »
Loin ?
Il nous faut une mimique très compliquée pour traduire ce simple mot et il est vrai de dire que nous ne pouvons nous- mêmes saisir leur réponse. Tant pis, on verra cela plus tard.
Nous essayons alors de demander des voitures et nous courons le risque d’être longtemps sans pouvoir nous entendre, quand du côté du village que nous avons passé, près d’une ligne téléphonique, — Milewitchi, — survient un attelage, mais un attelage bizarre, un des plus rudimentaires traîneaux qu’on puisse rêver ; deux poutres équarries, aux
extrémités avant relevées en cintre et reliées par deux traverse. |51 Tirant dessus un cheval nerveux, attelé de quelques traits avec au-dessus de la tête un demi-cercle en bois dans lequel une sonnette tintinnabule... Un autre attelage encore...
Dans ces moments-là on ne choisit pas et ce traîneau nous semble le salut pour notre matériel.
Voici encore des moujicks venant des deux villages ; certains sont montés à cheval, sans selle ni couverture, n’ayant pour conduire qu’une simple corde passée dans la bouche de leur monture.
Les nouveaux venus, — les conducteurs de traîneaux, — semblent plus « dégourdis » que les premiers arrivés ; ils nous comprennent mieux et obligeamment se mettent à notre disposition pour rouler le ballon, ce qui n’est pas facile en
raison du terrain car la surface gelée cède sous les pas et on marche dans un véritable cloaque. Enfin tant bien que mal le ballon est ficelé dans sa bâche et chargé sur un traîneau.
À la nacelle maintenant. Précieusement nous en tirons les ustensiles qui ont quelque peu souffert du choc et en fouillant dans la neige, nous retrouvons nos sacs, |52 notre panier à provisions, — qui sait si nous trouverons de quoi nous sustenter ici ?
Une scène amusante. Nous avions emporté des journaux pour mettre entre nos vêtements au cas où nous aurions souffert du froid et comme nous n’en avons pas eu besoin, nous les abandonnons. Alors, les moujicks, voyant cela, se bousculent pour se les approprier.
Est-ce la curiosité qui les pousse ainsi, afin de pouvoir admirer des caractères d’imprimerie autres que les caractères russes, — qu’ils ne connaissent peut-être pas mieux pour la plupart, — est-ce pour avoir un souvenir de ces visiteurs qui leur sont tombés du ciel ?
Nous ne tardons pas à titre fixés et nous en rions franchement.
Prenant le précieux papier, les moujicks en coupent des petits carrés puis sortant un paquet de leur poche ils jettent quelques grains de tabac dans cette feuille, roulant des cigarettes qu’ils allument avec satisfaction.
Nous les verrons plusieurs fois ainsi faire des cigarettes et chaque fois la scène nous paraîtra aussi amusante. Il est vrai,
|53 — nous le saurons le lendemain, — que le papier à cigarette coûte en Russie, plus cher que le tabac et encore les moujicks
fument-ils des déchets, les côtes de tabac, réduites presque en poussière.
Il en faut des estomacs pour résister à ce régime !
Tout le matériel est maintenant rangé sur les traîneaux. Aimablement les moujicks nous font signe de rendre place à notre tour sur un troisième véhicule et en route.
Avouons qu’on n’est pas trop mal. Cependant ça manque de dossier et aussi... d’habitude. Nous nous crispons sur une traverse du traîneau car lorsqu’on rencontre une motte gelée, un heurt brutal en résulte et fait rompre l’équilibre.
— No ! no ! crie sans discontinuer le conducteur au cheval pour l’exciter.
Derrière nous toute la bande de curieux suit en courant dans la neige pourtant épaisse.
Je me souviens avoir appris, autrefois, à l’école, l’hymne national russe, — en russe s’ il vous plaît, — souvenir curieux les paroles reviennent brusquement à ma mémoire et j’entonne : |54
Borjé Tsaria khrani Silnyi derjavnyi…
Cette fois les russes sont stupéfaits. Leurs visages se dérident et ils se regardent, exprimant une surprise non dissimulée. |55
*
* *
Enfin nous arrivons à Milewitchi et nous pouvons voir de près ces petites maisons noires, basses, construites en planches et couvertes de chaume, que nous avons tout à l’heure aperçues de haut.
Les femmes sont là, en rang, et nous contemplent avec curiosité.
Même teint que les hommes, mêmes yeux gris ; sur leurs têtes un mouchoir noué et sur leurs épaules des châles d’un gris terne... et sale...
C’est avec satisfaction que nous quittons le traîneau pour marcher un peu, histoire seulement de nous dégourdir les |56 jambes, car le sol n’est pas précisément favorable au footing.
Une grande potence attire notre attention : c’est une pompe pour puiser l’eau ; un grand pieu fiché en terre avec à l’extrémité un balancier pour faire un contrepoids qui remonte le seau. Près de chaque maison des meules de paille juchées sur des sortes d’estrade à quatre pieds et protégées par une couverture de bois.
Près de nous de gros corbeaux ne s’effarouchent nullement de notre présence. En ce désert on croirait qu’ils sont heureux de se trouver près des habitants et on les prendrait plutôt pour des oiseaux domestiques. Sur le seuil de plusieurs portes, couchés comme des chiens, des porcs énormes, d’autres plus
loin circulent au milieu des gens, comme chez eux, et pénètrent même dans les habitations où ils rôdent à leur aise.
— Cela ne me dit rien de rester ici, dit mon compagnon de route.
J’avoue que je partage cet avis.
Immédiatement, donc, nous entamons les pourparlers. C’est une véritable pantomime alors qu’il nous faut jouer, agrémentant notre mimique de dessins grossiers |57 que nous traçons sur un morceau de papier.
Savent-ils seulement ce qu’est le chemin de fer que nous leur réclamons ?
L’un d’eux a compris : sur ses doigts il compte d’une façon que nous ne parvenons pas à débrouiller, mais ce que nous comprenons bien c’est quand il met sa tête sur sa main en fermant les yeux, nous exprimant qu’il faut dormir avant d’aller au : « Tchof, tchof ».
— Hein ? dormir ? ici ? Ça n’a rien de charmant.
Leprince s’énerve ; il prend &on sac, fait mine de partir, à pied. Mais où aller, dans quelle direction ? Il n’y a aucun chemin.
Nous nous laissons faire et nous laissons conduire chez
« André » le moujick qui nous a amenés jusqu’ ici en traîneau.
|58
*
* *
Nous devons nous y reprendre à deux fois pour entrer dans l’habitation. De celle-ci en effet se dégage une telle odeur qu’il nous faut tout notre courage pour aller en avant. Cette maison est séparée en deux : d’abord le logis des porcs qui ne cèdent la place que sous les coups de pieds, puis l’autre pièce.
Le jour pénètre à peine par des carreaux minuscules et il faut que nos yeux soient habitués pendant quelques secondes à cette demi-obscurité pour distinguer ce qui s’y trouve.
Dans le fond, une table grossière de bois |59 avec des bancs. Sur un côté des bat-flancs24 de corps de garde : c’est le lit des paysans qui ne se déshabillent jamais et qui portent sur eux tout le linge — si on peut appeler cela du linge, — qu’ils possèdent.
Au milieu de la pièce, un panier d’osier, — qu’on pourrait plus justement dénommer bourriche, — suspendu au plafond par trois cordes : c’est un berceau dans lequel dort un petit enfant. De temps à autre, on lui donne un coup de poing pour imprimer un mouvement de balancement...
Une grande cheminée dans le coin.
Estimons-nous heureux de cet abri. La tempête est maintenant complètement déchaînée.
24 Dormann écrit : bas-flancs.
À notre suite, tous les habitants du village sont entrés. On peut à peine respirer. Nous sommes les bêtes curieuses, il n’y a pas de doute. Prenons-en notre parti.
Nous nous rappelons que nous n’avons pas déjeuné et nous sortons nos provisions. Voyant cela, aimablement, André, le propriétaire de la maison, nous apporte un gros pain dont la forme rappelle celle des pains qu’on faisait il y a quelques années encore dans nos campagnes. Celui-ci est tout noir. |60
J’en prends une bonne bouchée pour y goûter, espérant y trouver le goût de ce pain bis dont je viens de parler, mais j’ai de la peine à cacher une grimace : celui-ci est amer et contient de la terre en quantité. Que c’est désagréable ! Le blé qui sert à faire ce pain, — apprendrons-nous puisque les voyages instruisent... la jeunesse, — est écrasé avec des meules rudimentaires qui laissent tomber dans la farine un peu d’elles-mêmes... Cela ne fait rien, le pain est fabriqué et cuit, entouré de feuilles, dans la terre. Et il nous semblera si curieux que nous en rapporterons un échantillon dans nos familles.
On nous apporte aussi du fromage de chèvre dont le goût aigre monte aux narines, et du lait, de chèvre également.
À tout cela, nous préférons encore un morceau de notre pâté de perdreau que nous voulons faire goûter à André.
L’homme flaire le morceau puis le repousse, en faisant un signe de croix et en nous démontrant clairement que c’est le Carême de Noël. En effet, l’année russe retarde de 12 jours sur la nôtre.
Mais le maître de la maison veut faire assaut de politesse. Il apporte une fiole |61 cachetée contenant un liquide clair comme de l’eau. Sur un coin de la table il frotte le cachet de cire, tenant la bouteille à l’envers puis d’un coup de paume de main, fait sauter le bouchon. Un unique petit verre est apporté ; il l’emplit, le prend, l’élève à la hauteur de ses yeux
et d’un seul coup en jette le contenu au fond de son gosier. Puis il emplit à nouveau le même verre et me le tend.
— Allez-y, me conseille mon compagnon de voyage ; si nous n’acceptions, nous les fâcherions.
Bravement alors, je veux essayer d’ingurgiter le liquide mais malgré moi je fais une grimace car je me sens les entrailles brûlées.
C’est de l’alcool et depuis nous avons appris combien le peuple russe aime cet alcool. On se plaint de celui-ci en France, hélas ! ce n’est rien.
Par exemple, ce qui me plaît infiniment, c’est une tasse de thé bien chaud, servi à la Russe : un peu d’extrait liquide de thé, puis l’eau bouillante jetée dessus, dans le verre même.
Comme une bouteille de vin blanc a été épargnée à l’atterrissage nous voulons faire |62 goûter ce vin aux moujicks, mais comme moi pour leur alcool ils ont un geste de dégoût. Ils trouvent sans doute ce liquide bien fade.
La nuit tombe très vite. À 3 heures et demie il fait noir. Et nous sommes toujours là au milieu de ces paysans.
L’air est irrespirable. Autour de nous tous les moujicks fument, crachent, parlent très fort, de cette voix qui chante et qui pourtant nous scie les oreilles. On est tout étourdi. A ce point que Leprince me dit plusieurs fois :
— Ne sentez-vous la maison qui balance sous le vent ? Peut-être cela était tout de même.
Tentons une explication.
Impossible et même nous voyons le moment où les gestes d’André, qui nous reçut pourtant avec franchise, deviennent menaçants. Tout cela parce que nous ne le comprenons pas.
Nous arrangeons l’affaire en lui offrant des confitures qu’il semble fort aimer. Les femmes, les enfants se disputent des pastilles pour le rhume que leur dispense Leprince qui voyage avec un éternel rhume.
Un nouvel arrivant. Cette fois celui-ci a |63 l’air cossu. Il porte une pelisse de riche aspect ; son bonnet d’astrakan atteint une hauteur démesurée ; il a des bagues plein les doigts et joue avec une canne portant une main comme pomme. On sent le fat au milieu de braves gens.
Peut-être une notabilité, enfin ! pensons-nous.
Non, c’est un curieux encore. Et pourtant un curieux qui a un mot qui nous fait dresser l’oreille :
Policeman ? nous demande-t-il.
Oui, oui, policeman, soupirons-nous, vite, pour nous ce sera la délivrance.
L’homme a un air de satisfaction et cligne de l’œil.
Ah ! mes gaillards semble-t-il dire, vous allez la voir la police et elle va vous boucler !
Il est franchement drôle.
Enfin, vers 7 heures du soir, un mouvement se fait dans le fond de la pièce. Nous voyons rapidement le rang des moujicks s’écarter. Qu’est-ce qui se passe ?
Une lampe électrique, — diable, voilà quelqu’un de plus civilisé, — un uniforme.
La main au bonnet saluant militairement : |64
— Commissaire !
Et cette main est tendue vers nous. Nous saluons celui qui d’un seul mot se présente à nous de façon aussi cordiale. Il tire un étui de sa poche, nous offre une cigarette, — de ces cigarettes à long tube de carton, imaginées dit-on pour éviter de brûler les fourrures dont on est toujours couvert dans ce pays, et bourrées seulement d’un peu de tabac.
Tout de suite nous avons l’impression que nous pourrons mieux nous entendre avec ce fonctionnaire.
Gravement, au milieu du silence profond, car les conversations se sont tues subitement, il retire un grand manteau d’ordonnance gris. L’uniforme, dessous, est gris
aussi et barré par le baudrier du sabre qui est porté en sautoir. Deux agents de police qui le suivent sont aussi vêtus d’un uniforme gris avec le sabre également en sautoir.
Le commissaire s’assied, demande nos papiers sur lesquels il promène sa lampe électrique et s’arrête sur le mot
« France » qu’il prononce tout haut, porté sur le certificat d’atterrissage de l’Aéro-Club de France que nous avons déjà fait signer |65 par un paysan quelque peu lettré. C’est vraisemblablement le seul mot qu’a compris ce brave homme.
Ensuite il s’informe près des moujicks, près d’André, qui nous a recueillis. La conversation est assez longue. A la fin André raconte, — nous le comprenons à sa mimique, — que j’ai chanté le Bojé Tsaria Khrani.
La figure du commissaire s’illumine d’un bon sourire. Il me regarde, me tend la main.
Décidément nous ne devenons pas trop mauvais amis. Et ce qui nous fait plaisir, c’est que la figure du commissaire est très sympathique et très ouverte.
Plus ouverte certes que celles des moujicks dont nous comprenons maintenant la façon de procéder : sans rien nous dire, l’un d’eux a pris son traîneau et a été prévenir la police à Deretchin, village situé à près de 6 verstes (la verste vaut 1067 mètres).
Enfin, le commissaire se lève ; il nous fait signe de prendre nos manteaux, nos sacs et de le suivre.
— Quel soulagement, soupire Leprince, qui s’inquiète de son ballon, lequel va nous suivre, nous dit-on. |66
Dehors, la rafale a encore augmenté ; la neige atteint une belle hauteur. Deux véhicules attendent : une voiture à roues et un traîneau.
Je prends place dans la voiture avec le commissaire pendant que mon ami Leprince, accompagné des agents de police, monte sur le traîneau.
Comme je l’ai envié, ce brave ami, pendant l’heure que dura le voyage. Notre voiture sans ressorts, montée sur deux grandes roues en bois culbutait tellement sur le sol que j’avais peine à maintenir mon équilibre et que plusieurs fois je faillis verser.
Voilà les lueurs d’un village. C’est Deretchin, terme de notre voyage de ce soir. |67
*
* *
Comme il nous semble bon de pénétrer dans le logis, confortable celui-là, et meublé même avec un certain goût, où la bonne chaleur est répandue par un de ces poêles en faïence blanche que nous rencontrerons partout en Russie et qui sont des mieux compris ; chauffage central en quelque sorte ; il suffit le matin d’y jeter quelques bûches et en voilà pour toute la journée et même toute la nuit.
Nous sommes dans le bureau du commissaire. À la place d’honneur, un portrait en chromo du tsar Nicolas II et de la
tsarine. Des photos sur les murs, quelques |68 fauteuils, un grand bureau et au-dessus le téléphone.
Ah ! ce téléphone ! Nous nous plaignons en France de la difficulté pour obtenir la communication. Il faudrait voir cela ici et se rendre compte des multiples combinaisons d’appels et de signaux à faire pour pouvoir parler.
Nous ne comprenons rien à la longue conversation tenue par le commissaire, si ce n’est les mots qui reviennent assez fréquemment :
— Aéroplane… Deux Frantçous !... C’est de nous qu’il s’agit.
Par une porte grande ouverte nous voyons la salle à manger. Sur un coin de la table le national Samovar fume et est attentivement surveillé par une domestique, Héléna, malheureuse disgraciée de la nature qui semble toute dévouée à son maître.
Un jeune étudiant en médecine qui connaît un peu le français a été appelé. Tant bien que mal enfin nous pouvons nous faire comprendre et c’est ainsi que nous pouvons repérer exactement sur la carte le lieu de notre atterrissage et connaître les noms des pays où nous avons été et où nous sommes. |69 Nous apprenons que nous sommes dans le gouvernement de Grodno et à six heures de traîneau de Slonim, un nom de pays que nous ne pouvons nous-même prononcer que vingt-quatre heures plus tard, tellement on nous le disait mal, ou plutôt de façon incompréhensible.
À minuit seulement les coups de téléphone cessent. De façon charmante le commissaire nous prie de nous mettre à table avec lui. C’est à vrai dire le premier dîner russe que nous faisons.
Comme je me souviendrai longtemps de ce repas ! Voici le menu : Poisson fumé (sorte de rollmoops) avec des ronds d’oignons crus et œufs durs, — ça c’était le meilleur !
Comme pain, une tranche coupée presque aussi mince que les tranches de saucisson qu’on donne dans les assortiments de charcuterie, et nous n’avons pas besoin de dire combien nous étions privés de ce pain qui est la base de la nourriture des Français.
Et la boisson ! Encore de l’alcool, rien autre chose. A chaque instant il nous faut boire à une santé quelconque !
Je regarde Leprince avec des yeux de martyr : |70
— Il faut faire honneur à notre hôte, me répond-il avec un air résigné.
Faisons donc honneur ! mais c’est un peu trop vraiment.
Thé ensuite, tiré au samovar et plusieurs fois de suite. Toujours un peu de liquide concentré puis l’eau bouillante jetée dans le verre et avec ce thé on nous sert — suivant la coutume — des confitures aux fraises, qui ma foi, sont excellentes.
Mais ce n’est pas fini : voici encore des bouteilles cherchées dans le bon coin.
À la France ! À vos familles ! À votre exploit ! — nous traduit le jeune étudiant à chaque lampée.
On sent combien, après avoir accompli strictement son devoir, tout son devoir, le brave commissaire est heureux de nous avoir à sa table.
Enfin, on se lève ; 2 heures du matin sont passées. Le jeune étudiant nous fait ses adieux.
Vous allez partir tout à l’heure, nous dit-il, à cinq heures… |71
*
* *
À cinq heures du matin, en effet, le commissaire de police, qui nous a cédé pour ces quelques heures de repos sa propre chambre, — nous saurons plus tard qu’il ne s’est pas couché et a rédigé de longs rapports, — vient nous frapper légèrement à l’épaule et nous fait signe que nous allons partir.
— En route !
La toilette est vite faite. Un, deux, trois... verres de thé avant de partir.
Dehors deux traîneaux nous attendent. La neige a tombé toute la nuit et dans la demi-obscurité nous ne voyons rien que le blanc manteau. |72
Je regrette d’être séparé encore de mon camarade : le commissaire me fait signe de monter avec lui. Le moujick qui nous conduit fait claquer son fouet. Nous voilà partis.
Pendant six· heures ainsi, nous glisserons sur le sol, à une belle allure au milieu de ce vaste désert où nous verrons le jour poindre.
Jamais, je le remarque, un cheval ne glisse et pourtant il n’y a pas de route, seulement d’invisibles pistes où par moment les chevaux faisant craquer la glace entrent dans des bourbiers où ils enfoncent.
De temps à autre, une grande croix de bois étend ses bras sur le paysage ; un corbeau, traverse le ciel, c’est tout, et fatalement nous succomberions au sommeil si les chevaux ne nous lançaient continuellement à la figure, avec leurs sabots ferrés à crampons, des paquets de neige qui nous ramènent vite aux sens de la réalité.
Pourtant vers dix heures et demie nous dépassons des traîneaux et plus loin quelques piétons. On sent une agglomération proche ; bientôt on l’aperçoit. Étendant la |73 main le commissaire me dit ce seul mot :
— Slonim !
Ma surprise est grande en voyant des cheminées d’usine. Le commissaire lit cette stupéfaction sur mon visage.
— Fabrique ! me lance-t-il.
Voici la ligne de chemin de fer que nous traversons. Nous sommes arrivés.
Il faut avouer que c’est avec une satisfaction assez vive que nous pouvons dégourdir nos membres endoloris par cette course matinale où le vent froid nous fouettait la figure : nous avons failli du reste avoir froid. |74

*
* *
Slonim est une ville d’une importance assez grande puisqu’on lui attribue une quinzaine de mille d’habitants, et est bâtie de façon très pittoresque sur le passage de la Char, rivière qui en temps ordinaire sert beaucoup pour le transport des bois mais qui actuellement est complètement gelée et sur laquelle des enfants s’amusent à patiner.
Rien que des maisons à un rez-de-chaussée ou seulement surélevée d’un sous-sol. Une infinité de petites boutiques noires sans devanture et peu engageantes. Sur la Place du Marché, pourtant, des étalages |75 coquets. Le marché lui- même est un vaste bâtiment mais au lieu d’être une halle comme en France, ce bâtiment est divisé en une grande
quantité de cases avec des cloisons plâtrées jusqu’en haut.
C’est précisément jour de marché ; la population se déverse, grouille, dans tous les coins. Nous nous amusons en voyant arriver, ficelés sur des traîneaux, d’énormes porcs.
Sur un bout de la place, des traîneaux, remplaçant nos taxi- autos, attendent le client.
Nous sommes alors conduits au bureau de police où nous sommes reçus avec la plus parfaite courtoisie par le commissaire central, M. Matchinsky, qui entend lecture des longs rapports du commissaire de Deretchin et qui reçoit de ce dernier les cartes et papiers saisis sur nous.
Un signe et nous repartons. Où ? Nous n’en savons rien. Voici une belle demeure. Dans la salle à manger une grande table est dressée :
— Prenez place ! nous dit-on simplement.

Les pompiers de Slonim vers 1914 (carte postale)

Vue de Slonim vers 1914 (carte postale)
Le commissaire central, sans même nous demander notre avis, nous recevait chez |76 lui et quelques minutes après nous présentait à Mme Matchinsky, qui nous accueillait de la façon la plus aimable qu’on puisse imaginer.
Nouveau déjeuner à la Russe avec alcool en guise de boisson suivant l’habitude du pays... et peu de pain.
À la fin du repas, des dames et des demoiselles, prévenues sans aucun doute, viennent en visite et, — surprise agréable, — deux d’entre elles parlent correctement le français, — nous apprendrons du reste que l’une d’elles est professeur de français au gymnase (pension) de jeunes filles de Slonim, où notre langue est tenue en honneur.
Alors il nous faut raconter par le menu notre voyage ; causer de Paris, de ce qui s’y fait, parler musique, chiffons... expliquer la mode féminine du moment, raconter — et là on croit certainement que nous exagérons ou nous moquons, — que les dames en France portent ou des jupes ouvertes presque jusqu’au genou ou des jupes entravées ne leur permettant pas de monter une marche d’escalier, ce qui fit rire nos gracieuses auditrices qui ignorent la tyrannie du
corset et qui pourtant sont |77 élégantes et en tout cas fort aimables et très gaies.
Tout à coup une des dames, Mme Sophie Kridner, manifeste le désir de voir notre « boule ». Aussitôt tout le monde se lève et veut aller voir notre ballon, gardé par quelques soldats et qui, encore sur le traîneau qui l’a amené, attend qu’on ait décidé de son sort.
Un photographe est même prié de venir opérer, les dames voulant être photographiées avec nous, dans la nacelle et c’est
ce qui nous permettra de rapporter de ce voyage un souvenir précieux à plus d’un titre.
C’est avec peine qu’on nous octroie quelques minutes pour aller télégraphier à nos familles, à l’Aéro-Club de France et au Petit Journal, la nouvelle de notre atterrissage. Pour celle simple opération diverses difficultés surgissent. D’abord il nous faut nous procurer de l’argent russe et les banques, ce jour de dimanche, sont fermées ! Tout de même à une banque où nous trouvons un employé on nous changera un billet de cent francs en gardant une petite commission supplémentaire
de deux roubles. |78

*
* *
À peine avons-nous le temps de nous passer un peu d’eau sur la figure dans la chambre d’hôtel, où on nous a assigné logement, — le plus bel hôtel de l’endroit, très confortable à la vérité. Déjà M. Matchinsky vient nous chercher pour nous offrir à dîner à 5 heures du soir.
Toujours la même cordialité, le même accueil aimable, touchant.
On nous explique que nous ne pourrons repartir que lorsque le gouverneur de Grodno, — qui a été avisé par télégramme,
— en aura donné l’ordre.
Phonographe après dîner. La Marseillaise |79 fait partie du programme ainsi que des airs et des danses russes très pittoresques.
Lorsque nous quittons cette hospitalière demeure, on nous donne rendez-vous pour une heure après, au théâtre, où on tient à nous emmener.
Cette soirée au théâtre de Slonim restera un souvenir inoubliable. Dans une pièce assez grande où des chaises sont disposées, une scène est dressée à une extrémité. Six musiciens sont à l’orchestre : deux violons, une contrebasse à corde, une flûte, un trombone et un piston. Ils sont éclairés avec des bougies fichées sur les pupitres, et nous rirons quand au cours de la représentation, lorsqu’il y aura des dialogues assez longs sans musique, le chef d’orchestre éteindra ces bougies entre deux doigts !
On joue La Vie du Moujick et nous comprenons bien la pièce, en raison surtout de ce que nous avons vécu quelques côtés de cette vie pendant près d’une journée.
Des scènes pleines de naïveté charmante se succèdent, rappelant un peu le théâtre moyenâgeux. Mais ce qui est surtout amusant et nous plaît beaucoup, ce sont les danses russes. Pendant que la femme fait |80 une infinité de petits pas, gracieux, malgré les bottes qui enserrent ses pieds, l’homme virevolte avec une agilité extraordinaire, bondissant,
tournant, sautant d’un pied sur l’autre étant accroupi, de la façon la plus drôle, donnant l’impression d’un personnage en caoutchouc qui rebondirait sans s’arrêter.
Nous applaudissons enthousiasmés et grâce au colonel intendant Osinski dont j’aurais le plaisir de causer tout à l’heure, ces danses sont bissées et obtiennent encore auprès de nous le même succès.
Au buffet, pendant l’entr’acte, — car il y a un buffet s’il vous plaît, où on boit le thé en mangeant des gâteaux, — on nous présente encore une dame et une jeune fille parlant très correctement le français et avec qui nous nous entretenons avec plaisir.
Cette nuit-là encore nous ne nous coucherons qu’à deux heures du matin... |81
*
* *
De bonne heure on frappe encore à notre porte. Déjà ? ne pouvons-nous nous empêcher de protester en allant ouvrir. Cette fois nous sommes salués par un vigoureux :
Bonjour, messieurs ! Comment allez-vous ?
Nous nous secouons encore les oreilles, que notre interlocuteur poursuit :
Pardonnez-moi de vous déranger ainsi. Mais j’ai appris votre voyage, votre présence, et j’ai tenu à venir vous voir pour vous demander si vous n’avez besoin de rien. Je suis M. Ongetta, italien d’origine, |82 mais fondé de pouvoir d’une maison bien française, la maison Bonnefoy, de Lyon, — ce nom sonne bien, n’est-ce pas? — qui possède à quelques
kilomètres d’ici, à Albertyn, — et vous avez pu en voir les cheminées — une usine de moulinage de soie. Le directeur technique de cette usine est un de vos compatriotes et tout à l’heure il va venir vous saluer.
Ma foi cela est réjouissant et malgré tout le grand plaisir que nous avons d’être avec nos amis les Russes, nous sommes enchantés de cette circonstance. Aussi après être allés voir au bureau de police si le gouverneur de Grodno avait décidé de notre sort, M. Terras, notre compatriote annoncé par M. Ongetta, obtient la permission de nous emmener déjeuner chez lui à Albertyn, à 15 kilomètres de Slonim. Nous y parlons bientôt, après quelques courses en ville : change de monnaie, achat de cartes postales (qui sont rares ici), profitant des interprètes si agréables que nous avons ainsi inopinément trouvés.
Après une demi-heure de traîneau, dans les véhicules qui dépendent du service de l’usine, nous sommes à Albertyn où nous faisons connaissance avec Mme Terras, |83 qui ne nous cache pas son plaisir de voir des Français après cinq ans de séjour en Russie.
— Les premiers temps m’ont semblés durs, nous dit-elle, mais maintenant j’y suis habituée. A force de parler russe — et ce fut pourtant long à apprendre, — j’ai presque oublié le français, n’ayant plus l’occasion de le parler.
On cause de la France, de ce beau pays dont on sent mieux toute la valeur lorsqu’on en est éloigné. Nous voyons les yeux de nos hôtes partis au voyage du souvenir, vers ces chères contrées où ils seront si heureux de retourner retrouver les leurs...
Un peu de musique encore après le déjeuner à la française. Et de la musique française aussi : Mayol, Polin, Mercadier... au phonographe.
On s’attarde à ce déjeuner. Cependant il faut bien visiter l’usine confiée à de si bons soins.
Et nous allons de surprise en surprise en parcourant cet établissement de bas en haut, tenu d’une façon si méticuleusement propre, par ce peuple de moujicks que nous avons vu si négligent, mais combien |84 stylé ici, avec les machines bourdonnantes et pleines d’activité, où la soie est travaillée de si curieuse façon.
Vues de loin les jeunes filles rattachant les fils rompus ont l’air de jouer aux grâces car on ne voit pas ce qu’elles touchent.
Près de trois cents personnes, toutes russes, sont employées dans cette usine, hommes, femmes, enfants...
— Voulez-vous visiter une fabrique d’allumettes ? nous demande à brûle-pourpoint M. Terras.
C’est avec joie que nous acceptons.
Cette fabrique est contiguë à celle de moulinage de soie et nous remporterons de la visite que nous y ferons un enseignement nouveau.
Nous allons partout, depuis le début de la fabrication où nous voyons les troncs d’arbres posés sur une sorte de tour, portant une lame en dessous, qui coupe le bois, préalablement humidifié, en minces tranches qui sont elles-mêmes débitées par un « massicot » qui marche automatiquement. Plus loin c’est le séchage, travail curieux. Dans toutes les diverses
manipulations, nous remarquons qu’il y a au moins 50 % de matières premières perdues. |85
Plus loin encore le soufrage, la confection des boîtes qui sont recouvertes de papier d’ingénieuse façon.
Puis la mise en boites. Il y a dans cet atelier des enfants qui n’ont certainement pas dix ans et la plus âgée n’en a pas quinze. Tout ce petit monde, — qui travaille à la tâche, — se dépêche à tel point qu’on ne voit pas les doigts agir. Le paquet d’allumettes est enlevé des grilles qui les supportent, mis en boîtes, celles-ci recouvertes de leur étui sans même qu’on ait le temps de voir quelque chose.
Un chant timide vient de naître dans un coin de cette salle. Il monte, s’enfle, grandit, et bientôt toutes les jeunes ouvrières prennent part à ce chœur, sorte de mélopée aux intonations naïves et charmantes qui fait oublier la longueur du temps, le travail... Notre présence ne gêne aucunement les chanteuses et nous en sommes tout heureux, car je crois que s’il en avait été autrement nous n’aurions jamais osé le troubler et nous
aurions certes préféré passer sur la pointe des pieds devant cette porte...
Voici les petites boîtes d’allumettes terminées ; elles portent sur les côtés les |86 couches qui forment frottoir, mais avant d’être emballées, pour s’en aller dans toutes les directions, elles doivent être recouvertes de la bande de contrôle du Gouvernement.
L’état Russe ne perd pas ses droits sur cette fabrication : un fonctionnaire est même à demeure dans l’usine pour contrôler le collage des bandes de garantie, et la sortie.
— La fabrication, nous explique le directeur de l’usine, par l’intermédiaire de MM. Terras et Ongetta, revient par boîte à 4/10e de kopeck, l’Etat perçoit 5/10e et le revendeur 1/10e, de sorte que la boîte coûte un kopeck.
Le kopeck vaut environ 3 centimes de notre monnaie.
Nous sommes enchantés de cette visite et des nouvelles connaissances acquises. |87
*
* *
À peine rentrés chez nos hôtes de ce jour, au moment où nous allons nous laisser aller à accepter une invitation à dîner le même soir, un coup de téléphone se fait entendre :
— Un officier supérieur, envoyé par le gouverneur de Vilna voudrait vous voir et vous attend au bureau de police de Slonim, nous apprend M. Terras d’un air tout attristé. Le commissaire de police d’Albertyn met ses deux chevaux à votre disposition; je vais faire atteler par notre cocher.
Fâcheux contretemps. Nous n’avons |88 pas à récriminer : puisque prisonniers nous sommes, il faut subir notre sort et nous ne pouvons résister à une demande faite avec autant de courtoisie.
Nous faisons donc nos adieux à cette demeure et à ces braves gens si hospitaliers, que nous quittons à regret, et de nouveau nous voici sur la route recouverte de neige, en pleine nuit.
Un heurt brutal : nous avons failli être culbutés et notre moujick s’arrête. Les attelages, dans ce pays ne sont pas éclairés et de plus suivent leur droite ou leur gauche, au petit bonheur ; aucun règlement sur le roulage. Nous venons donc tout simplement d’« emboutir » un autre traîneau qui porte un tronc d’arbre volumineux, ayant son conducteur endormi. Celui-ci, réveillé brusquement, ne desserre pas plus les lèvres que notre cocher, qui ne regarde même pas si ses chevaux sont blessés ou si son véhicule — ou même ses passagers — ont souffert. Rien, pas un mot ; il fouette ses chevaux et repart.
Nouvelle collision à l’entrée de la ville. Cette fois plus violente. Un timon me donne dans le bras. Silence encore, aussi indifférent, de la part des deux moujicks... |89 Quand on pense aux vociférations que fait naître le plus petit accrochage, entre cochers, dans les rues de Paris...
Nous voici enfin au bureau de police. Le colonel Zalf, envoyé « par ordre du commandant des troupes de l’arrondissement de Vilna » et qui est accompagné d’un officier d’ordonnance, est en conférence avec M. Matchinsky, commissaire central, à notre sujet. Lorsque nous lui sommes présentés, il nous salue en français qu’il se défend de bien parler, — comme d’ailleurs tous ses compatriotes, — alors qu’il s’exprime très correctement.
Il nous félicite tout d’abord pour le gouverneur et pour lui- même et nous dit qu’il a pour mission de faciliter de toutes les façons possibles notre rapatriement. Il nous entretient très amicalement de notre voyage, nous priant de l’aider à tracer notre itinéraire sur une carte. Pendant plus de deux heures nous parlons de l’aérostation, de l’aviation, de la France, de l’amitié qui l’unit à la Russie et de la joie réciproque des deux peuples de cette alliance.
De notre côté nous lui disons notre plaisir d’avoir atterri dans cette région si hospitalière et nous sommes heureux de le
|90 prier de transmettre nos remerciements les plus chaleureux
aux deux commissaires qui nous ont accueillis avec tant de tact, d’amabilité, de franchise.
— Nous n’avons fait que notre devoir, nous est-il répondu. Si nous allions en France, nous sommes persuadés que nous serions encore mieux reçus.
Ces braves gens regrettent de ne pas en avoir fait assez, certainement.
Les conditions de notre retour sont réglées de façon que nous n’ayons aucune inquiétude. Notre passage va être signalé à Varsovie et de là à Alexandrowo, gare frontière
d’Allemagne, car en Russie les pouvoirs d’un gouvernement ne s’étendent pas sur un gouvernement voisin et il faut que ce soit la ville du gouvernement frontière qui nous facilite notre sortie du territoire. Il n’est pas facile de sortir de Russie, nous en saurons quelque chose plus tard.
De cordiales poignées de main sont échangées : nous sommes libres maintenant mais comme il n’y a un train que le lendemain soir, mardi, on nous emmène finir la soirée au Kinéma, — lisez Cinéma, — théâtre d’illusions, comme on l’appelle là-bas. |91
À la fin de la représentation nous quittons M. Novich, le brave commissaire de Deretchin, qui nous amena à Slonim.
Spontanément, au moment où nous lui serrons les mains avec effusion, il nous attire sur sa poitrine et nous embrasse sur les lèvres, à la russe, les larmes dans les yeux. Puis, brusquement il s’en va rapidement, sans se retourner, craignant sans doute d’être tenté de revenir. |92
*
* *
Dans le vestibule d’entrée du bureau de police, notre ballon est resté abandonné, répandant dans la pièce une odeur de gaz inconnue jusqu’ici à cet endroit.
Nous venons le délivrer le mardi matin, pour en faire l’expédition, dont les formalités sont aplanies par l’expérience et l’obligeance de M. Ongetta.
À peine cette expédition terminée, gros souci en moins pour l’ami Leprince, nous sommes assaillis par le colonel d’intendance Osinski. Celui-ci nous a vus passer devant sa demeure, il a cru que nous partions incognito et il est accouru. Il nous oblige à |93 nous asseoir avec lui au buffet de la gare de Slonim et à déjeuner avec lui.
Comme toutes les villes russes, stations du chemin de fer, — du moins pour celles que nous avons vues, — Slonim possède une gare de grande proportion, vaste, bien comprise, avec, comme salle d’attente, un buffet très bien aménagé.
En vain essayons-nous d’expliquer — et de faire expliquer par M. Ongetta, — que nous avons promis d’aller déjeuner chez Mme Kridner, femme d’un officier de police, rien n’y fait, le colonel veut que nous restions avec lui et nous force à prendre place à ses côtés.
Quel homme que ce colonel ! De haute taille, figure agréable, il est vraiment ce qu’on peut appeler un bel homme. Sa bonté se lit sur son visage en même temps que la gaieté. On devine en lui celui qui connaît la vie, qui sait la prendre par son bon côté, en jouir, et essaie d’en faire jouir ceux qui l’approchent. Quel cœur d’or on devine dans ce colosse ! Nous ne savons pas plus de russe que lui de français mais nous nous comprenons tout de même, car la communication
s’établit parfaitement, naturellement, avec lui. |94
— À la France !
Il se lève en tenant son verre plein d’un alcool de choix qu’il a fait chercher dans les bonnes bouteilles.
Hélas ! les petits verres se suivent et nous pensons combien nous serons incorrects vis à vis de M. et Mme Kridner qui nous ont invités...
Enfin ce premier repas est terminé. Nous frétons un traîneau et nous arrivons pour... déjeuner à nouveau chez cette dame qui s’est employée, connaissant notre langue, durant tout notre séjour, à nous faire plaisir.
Intérieur coquet et meublé à la française. Le goût et l’amour du « chez soi » se dévoile chez la maîtresse de maison.
Le colonel Osinski nous retrouve et ce sera lui le boute-en- train de la réunion, mieux que cela, l’entraîneur pour ce second déjeuner, difficile à caser pour nos estomacs.
Réception charmante et pleine de délicates attentions. Nous ne saurons jamais assez remercier nos hôtes.
À la France ! À Poincaré ! propose le colonel Osinski.
Hou ! Poincaré ! ajoute-t-il en mettant une main sur ses lèvres. |95
Et nous comprenons à sa mimique :
« Combien vous devez être fiers d’avoir un homme semblable à la tête de votre pays, de la belle France ! » On sent l’admiration pour notre aimé chef d’Etat et cela nous fait réellement plaisir. Nous répondons :
À la Russie ! À Nicolas !
Comment quitter un milieu semblable ?
C’est bien difficile et déjà nous sentons la peine de la séparation. Quand nous embrassons les bébés de Mme Kridner, l’un d’eux, qui compte à peine trois ans, imite gravement
« Napoléon », les bras croisés sur sa poitrine, les yeux en dessous, comme cherchant la solution d’un grave problème.
Nous ne pouvons à ce propos, nous empêcher de remarquer combien le souvenir de Napoléon est resté vivace en Russie et contrairement à ce qu’on pourrait croire, combien ce souvenir est aimé. Souvent nous avons vu, dans les demeures, de nombreux bibelots représentant le grand capitaine, toujours placés à la place d’honneur. Notons aussi que nous n’avons jamais vu le Napoléon légendaire, la main dans le gilet mais toujours les bras croisés. |96
Nous sortons, accompagnés encore du colonel Osinski et de Mme Kridner pour aller ... dîner chez M. et Mme Matchinsky où nous étions invités. Il était seulement 4 heures de l’après- midi.
— Trois repas en quatre heures, remarque Leprince, voilà un record !
En effet, mais combien difficile à établir, du moins pour nos estomacs, car pour nous-mêmes nous ne pouvions vraiment nous plaindre de trop être fêtés...
Pour la dernière fois nous sommes dans cette demeure si franchement ouverte, où nous sommes reçus avec tant de cœur. Les conversations se ralentissent ; on se regarde avec
attention comme pour mieux graver dans la mémoire les traits de ceux qui sont devenus l’un à l’autre on le sent, aussi chers ; déjà la tristesse du départ s’appesantit sur la réunion. Il faut que l’entrain du brave colonel déride tout le monde ; il faut ses éclats de voix, sa gaieté, sa bonne humeur pour donner, disons le mot, un peu de courage.
C’est la dernière fois que nous nous asseyons à celte table, au milieu de cette vaste salle à manger, par la porte de laquelle nous voyons le salon avec, dans un |97 coin, l’icône devant laquelle brûle l’éternelle flamme de la veilleuse, suivant l’usage...
Dois-je dire que là encore nous buvons à nos familles, à ceux qui nous attendent, à la France, à la Russie ?... On le devine. |98
*
* *
L’heure du train approche. Nous partons, accompagnés de tous les convives de ce dernier repas. Lorsque nous passons à l’hôtel prendre nos sacs de voyage et que nous voulons régler notre compte, on nous répond qu’on a reçu la consigne — du commissaire central, sans aucun doute — de ne rien recevoir de nous, même pas le moindre kopeck.
En traîneau nous sommes conduits à la gare de Slonim. Là nous retrouvons presque tous les officiers de police. Nous avons aussi l’agréable surprise de voir les dames et les |99
demoiselles que nous avons rencontrées pendant notre séjour, avec lesquelles nous avons pu parler français et nous sommes d’autant plus touchés que l’une d’elles nous apprend :
— Craignant que vous ne partiez hier, nous sommes déjà venues à la gare hier avec ma sœur. Nous sommes heureuses aujourd’hui de vous voir avant le départ.
Comment remercier de ces mots si charmants. Notre compatriote M. Terras est accouru lui aussi.
On sable le champagne et nous répondons tant bien que mal, très émus, au speech qui nous est adressé et où les mots France, Poincaré, reviennent, prononcés avec un sentiment qui nous est facile à traduire. Nous essayons de faire dire à notre tour ce que nous éprouvons, combien nous devons remercier de l’accueil qui nous a été fait, combien nous emporterons un souvenir inoubliable de ce voyage et combien en France on aime par réciprocité la Russie et son empereur Nicolas.
Tous les voyageurs se pressent autour de nous et dans les conversations nous entendons toujours les mots :
« Frantçous ». |100
La « peau de bique » que je porte excite toujours la même curiosité que nous avons rencontrée ici : les russes n’ont jamais compris pourquoi le poil de cette pelisse était au dehors du vêtement, ils n’ont jamais vu cela et pour eux c’est une hérésie, d’où ce succès que j’aurais presque été tenté de m’attribuer avec fatuité ! succès que je dois à l’ami Etampois qui, soucieux de me préserver du froid, m’a jeté sa
propre « peau de bique » sur les épaules au départ de notre voyage.
Le train est signalé. Il faut passer sur le quai. Là nous trouvons deux cadets, dans une impeccable position militaire. En l’un d’eux le colonel Osinski nous présente son fils, futur officier comme lui.
Le moment d’adieu est venu. Un silence plein d’émotion. Les yeux sont rouges. Les mouchoirs sortent.
Les hommes nous prennent sur leur poitrine et nous donnent le baiser d’adieu, à la Russe, lèvres contre lèvres. Nous baisons les mains des dames...
Il faut avoir vécu ces instants pour savoir tout ce qu’ils ont de poignants. Je suis incapable de les traduire, de décrire tout ce qu’on ressent. |101
— Vive la France ! nous crie-t-on.
Les larmes ne cherchent plus à se cacher.
Ces larmes-là on ne les verse jamais assez, il faut se montrer fier de les sentir brûler le visage.
Les mouchoirs s’agitent. Nous avons de la peine à répondre :
Vive la Russie !
Comme on comprend les bienfaits de cette alliance franco- russe !
Dans notre compartiment, seuls maintenant, face à face, nous nous regardons, Leprince et moi, pris tous deux de la même émotion intense :
Quels braves gens ! ne pouvons-nous nous empêcher de laisser tomber.
À ce moment seulement nous osons regarder par la portière : Slonim disparaît. Nous pensons à ceux qui r entrent chez eux maintenant, qui parlent sans doute de nous, qui pensent à nous... comme nous pensons à eux...
Et nous nous taisons, comme hébétés par cette brusque séparation à laquelle pourtant nous devions nous attendre, mais que nous ne supposions pas aussi dure. |102
*
* *
Les trains sont confortables en Russie... mais ne vont pas bien vite. Nous ne pouvons dormir, de plus, encore sous l’impression profonde que nous a laissée ce départ.
À Bielostock, gare assez importante, nous devons changer de ligne et pour cela attendre en pleine nuit presque deux heures dans le grand buffet salle d’attente. Parmi les voyageurs on voit les types se diversifier : on sent qu’on change déjà de réglons et qu’on approche de la Pologne, tant il y a de juifs faciles à reconnaître.
Nous sommes à Varsovie — Warshawa en polonais — à 8 heures du matin le mercredi 31 décembre. |103
La place de la gare est envahie par de nombreuses voitures,
à roues celles-là, — et même par quelques automobiles dont les chauffeurs ne craignent pas de rouler dans la neige.
Un grand brouhaha à cette sortie de gare. Les cochers appellent les clients. Nous remarquons que ces cochers portent dans le dos une médaille de contrôle portant un numéro et le millésime de l’année.
Hôtel de France ! lisons-nous sur un omnibus.
Nous ne pouvons mieux tomber, pensons-nous, et puisque nous devons rester à Varsovie toute la journée, à cause des formalités auxquelles nous devons nous soumettre, il serait bon d’aller à l’hôtel pour quelques soins d’hygiène. À l’Hôtel de France nous rencontrerons sûrement des Français. Hélas ! combien nous devions être déçus !
La gare dite de Saint-Pétersbourg par laquelle nous arrivons est assez loin du centre de la ville que nous pouvons voir en passant.
Ici, c’est bien la ville, la vraie ville et si ce n’était quelques détails tout à fait couleur locale on pourrait, par moments, se croire dans une ville quelconque de France. |104
Nous passons le fameux pont établi sur la Vistule, très large fleuve. Ce pont a ceci de particulier qu’il forme un caisson de fer parallélépipède dont la base est la chaussée. Mais celle-ci est peu large, de sorte que malgré les agents de police qui
réglementent la marche des voitures, en raison de la circulation très intense, les accrochages sont nombreux et le passage dangereux.
Nous admirons les monuments, souvent très beaux, les églises des divers cultes, les larges avenues, les « gratte-ciel » car il y a à Varsovie des maisons de 13 et 15 étages... et nous arrivons à l’Hôtel de France.
Pas l’ombre d’un français à cet hôtel, ni patron, ni employés, ni clients. Quelle désillusion ! Seul un portier à favoris et à lunettes, franchement désagréable d’aspect, qui baragouine quelques mots de notre langue et qu’on a quelque difficulté à comprendre.
Passe-ports ? nous demande-t-il tout de suite.
C’est la question adressée à tous les voyageurs étrangers dans les hôtels de Pologne. |105
Seule de tous les grands états, la Russie exige des voyageurs un passe-port en règle et pour sortir du territoire celui qui ne s’est pas muni de cette pièce indispensable, — ou si celle-ci n’est pas revêtue des visas voulus — doit rester à la frontière ou retourner pour faire établir ce papier. La surveillance est extrêmement sévère et il est difficile d’échapper à la règle.
Nous n’avons pas de passe-ports, répondons-nous au portier.
Celui-ci ne peut réprimer un geste d’étonnement.
Tant bien que mal nous lui expliquons qui nous sommes, d’où nous venons et la raison pour laquelle nous n’avons pas
de passe-ports ; nous sommes signalés de gouvernement en gouvernement à l’autorité militaire et tout à l’heure, du reste, après le petit déjeuner nous allons nous rendre au bureau militaire.
Le portier ne nous cache pas que cette situation lui semble assez louche, mais toutefois il n’insiste pas et va chercher pour le mettre à notre disposition un commissionnaire parlant français, qui nous accompagnera dans nos courses.
Au Bureau Militaire, où nous devions |106 nous présenter, nous sommes reçus très cordialement par un officier dont nous ne pouvons savoir le grade, les insignes de ceux-ci ne figurant que sur les épaulettes d’une façon difficile à comprendre. Cet officier nous informe qu’en effet notre passage est annoncé et que déjà la veille au soir un télégramme a été expédié au colonel de gendarmerie commandant le poste de la frontière à Alexandrowo, lui donnant ordre de faciliter notre sortie de Russie.
— Vous n’avez pas besoin de passe-port, nous dit-il, la route est libre pour vous et vous n’aurez aucun ennui.
Après avoir reçu encore des félicitations et parlé assez longuement de notre voyage, de la France, de l’aérostation et de l’aviation, — l’officier qui nous parle a fait lui-même comme passager un voyage sur appareil Farman, — nous prenons congé.
Quelques courses en ville, cartes postales inévitables, achat de place-cartes à l’agence des chemins de fer, pour être sûrs d’avoir nos places dans le train de 11 heures 15 ce soir.
Nous trouvons enfin des journaux français. Le Petit Journal
porte en première page le récit de notre randonnée, le portrait
|107 du pilote... Succès ! Gloire ! Nous apprenons par un numéro précédent de ce journal, que Rumpelmayer, partant
lui aussi pour la Coupe de la Ville de Paris a eu son ballon détruit en Allemagne, dans une forêt qu’il ne put éviter.
Enfin, nous nous sentons, avec ces journaux, quelque peu en contact avec les nôtres.
Déjeuner qui laissera un mauvais souvenir. Mets épouvantablement mauvais, pain exécrable avec ses grains d’anis, — ou quelque chose dont le goût est approchant. Nous avons davantage faim en sortant...
Visite au Consulat de France, où nous tenons à dire, avant de quitter le territoire Russe, combien nous avons été accueillis avec cœur.
Nous sommes reçus par M. le Consul lui-même qui nous entretient très aimablement et longuement :
— Vous serez les premiers étrangers qui passerez la frontière sans passe-port, nous dit-il. Jamais cela ne s’est vu. Il faut donc y tenir, rien que pour le précédent. Si malgré cela vous connaissez des ennuis à Alexandrowo, télégraphiez-moi, je ferai tout de suite le nécessaire. |108
En sortant nous ne pouvons nous empêcher de remarquer combien il est heureux d’être reçus de cette façon dans un consulat de France.
Jusqu’à cinq heures nous flânons dans les rues puis nous rentrons à l’hôtel.
Nous ne remarquons pas l’air énigmatique du portier et, dans notre chambre nous nous apprêtons à boucler nos sacs pour essayer de trouver un restaurant où nous pourrons mieux dîner que nous n’avons déjeuné.
On frappe à notre porte.
— Entrez !
Un officier de police, — nous les connaissons maintenant,
entre. Il nous salue et articule en mauvais français :
Pardon, messieurs, police, obligé enquête, pas vous ennuyer...
Les yeux du portier qui suit le policier, brillent.
Ah ! mes gaillards, semblent-ils dire, vous n’avez pas de passe-ports !
Nous ne comprenons que trop. Celui-ci a été nous
« vendre » à la police qui vient faire une enquête.
Alors, avec comme interprète, le commissionnaire qui nous a accompagnés toute |109 la journée, nous subissons un interrogatoire en règle, absolument comme à notre atterrissage.
Il nous faut dire d’où nous venons, comment, pourquoi en ballon, pourquoi avoir atterri là plutôt qu’ailleurs, pourquoi nous sommes à Varsovie, pourquoi... un tas de choses ! Ça devient fatigant.
Le commissaire de police arrive lui-même à son tour, et pendant plus de deux heures nous sommes sur la sellette.
J’essaie en vain d’expliquer à ce fonctionnaire, qui après tout fait son devoir, que nous avons été au gouvernement militaire.
Venez avec nous, nous retrouverons bien un officier de service au courant de notre situation ?
Rien à faire.
La police et le bureau militaire n’ont rien à voir ensemble !
Comment ne pas s’énerver.
Hôtel de France ! nous nous méfierons maintenant de cette étiquette, car enfin, ce portier aurait pu agir d’autre façon avec nous, d’autant plus qu’il devait être au courant de notre visite au bureau militaire par le commissionnaire qu’il nous |110 avait lui-même procuré et qui nous accompagna partout.
Les policiers sortent. Vite nous prenons nos sacs et nous réglons notre dépense.
Le portier a le toupet de nous demander son pourboire ! Ça c’est du culot ! Un pied de nez comme pourboire, c’est suffisant, à notre avis.
Dans la rue nous nous demandons où nous allons aller. Au hasard nous pénétrons dans une sorte de grande brasserie où il
y a de la musique, — qui calmera nos nerfs surexcités par la scène de tout à l’heure.
Nous trouvons à manger ici, et ma foi, assez bien.
À 11 heures 15 du soir nous reprenons le train à Varsovie.
Le hasard des placecartes nous a placés à côté d’un jeune russe d’Odessa qui, ayant terminé ses études de droit, va faire un tour dans les principales villes d’Europe. Il parle assez bien le français et jusqu’à Berlin il nous sera un agréable compagnon de voyage.
Nous appréhendons, malgré tout, le moment de notre passage à la gare-frontière d’Alexandrowo. |111
Si la police avait donné notre signalement ? Nous pistait ?
Au moment où nous entrons dans cette gare, — à 4 heures du matin, — les gendarmes russes pénètrent par chaque portière dans les wagons.
Passe-ports ? demandent-ils.
Nous expliquons que nous n’en avons pas, que nous sommes des aéronautes qui doivent être signalés ici. Notre compagnon de voyage en la circonstance nous est très utile.
Noms de familles ? nous fait demander le gendarme.
Leprince et Dormann.
La figure du représentant de l’autorité s’éclaire d’un sourire.
Da, da, répond-il.
Nous connaissons suffisamment de russe pour comprendre que cela va bien. Avant même que nous ayons pu nous-même faire une visite à l’officier commandant le poste, celui-ci, un capitaine, vient nous « saluer à notre sortie de Russie », et nous présenter les excuses du colonel, qui dort à cette heure.
Un soupir de soulagement s’échappe de nos poitrines. Nous sommes libres ! |112
*
* *
Une demi-heure après nous sommes dans le train qui part pour Berlin et nous voyons le premier casque pointu...
Les wagons sont toujours très confortables et bien chauffés. Rien ne manque dans les cabinets de toilette agencés pour le mieux.
Tout à coup, je me souviens que nous sommes au premier janvier et je souhaite la bonne année à mon ami Leprince. Nous ne pouvons nous empêcher d’évoquer les réunions de famille de ce jour de fête... où nous ne serons pas...
Au jour, le paysage que nous entrevoyons |113 présente a un aspect désolé. De la neige partout et nous constatons qu’il y
en a beaucoup plus encore qu’en Russie. La marche des trains en est retardée, apprendrons-nous plus tard.
À Berlin changement de trains. Pendant l’heure que nous attendons ici, nous pouvons, après avoir expédié des télégrammes, donnant l’heure de notre arrivée à Paris, voir un peu de la ville et de ce peu que nous apercevons nous pouvons comprendre combien était juste l’expression que nous répétait d’après son professeur de français, sur Berlin, le jeune Russe notre compagnon de voyage :
— Berlin ? c’est comme une grosse paysanne qui voudrait s’attifer d’un chapeau de parisienne !
Départ. Déjeuner en wagon-restaurant, — le premier que nous faisons vraiment quelque peu à la française, — après avoir redemandé maintes fois du pain à l’ahurissement du garçon de restaurant.
Passage à Hanovre à 3 h. 30, — pardon à 15 h. 50. Remarqué en passant les « Kolossales » usines, — avec un k,
nombreuses, et en particulier celles du pneu |114
d’automobiles Continental, située près de la ligne du chemin de fer.
À 20 h. 35 nous sommes à Cologne, — Côln comme on écrit en allemand. — Avant d’entrer en gare nous passons sur le Rhin, très large vraiment.
Dîner au buffet ; encore là, un « kolossal » buffet, où les garçons parlent couramment français. Puis nouveau départ, — le dernier celui-là, — à 22 h. 50.
Entrée en Belgique, visite de la douane, Liège, Namur, Charleroi.
Nouvelle douane. Jeumont. La France !
À partir de ce moment le temps nous semble terriblement long. Au jour, nous pouvons voir que la neige n’a pas épargné notre pays. Il y en a partout ; moins toutefois qu’en Russie et surtout en Allemagne.
Maubeuge, Saint-Quentin, Compiègne, Creil... Toutes ces villes passent, mais pas assez vite à notre gré.
Enfin, avec deux heures de retard — la neige en est cause,
nous arrivons à Paris et c’est avec un grand plaisir que nous foulons l’asphalte de la gare du Nord.
Nous sommes tout surpris de n’entendre, autour de nous, que le français. Il y avait si longtemps que cela nous était arrivé ! |115
*
* *
« Tout compte fait, comme disait mon ami Leprince, en terminant un récit qu’il fit à l’Aéro, nous nous dévêtîmes quatorze heures en huit jours, mais malgré ce léger ennui, notre séjour en Russie restera parmi nos meilleurs souvenirs de voyage ; il est impossible de recevoir un accueil plus
cordial que celui qui nous fut fait dans la nation amie et alliée ! »
Certes ce voyage restera un des meilleurs souvenirs de ma vie et c’est pourquoi, en en écrivant le récit, — cédant un peu aux sollicitations de nombreux amis, |116 — j’ai trouvé un nouveau plaisir, une grande joie, à en revivre les péripéties, m’attachant à être exact, et à ne rien amplifier.
Ce récit m’a aussi permis de penser encore à tous ceux qui nous reçurent avec tant de cœur et cela ne sera pas la plus mince satisfaction que j’en aurai tirée.
Avant de conclure, un nouveau merci chaleureux, à l’ami, au vaillant pilote Paul Leprince qui me permit d’accomplir cette formidable randonnée, et aussi de vivre des heures inoubliables. |117
*
* *
À titre de curiosité, il nous a semblé intéressant, sur un schéma de la carte d’Europe, de faire le tracé de notre voyage en ballon, puis avec le rayon ainsi obtenu, de tracer une circonférence.
On peut sur ce schéma se rendre compte, en prenant Paris pour centre et suivant les directions, où la distance parcourue aurait pu nous mener.
Vers le Sud-Ouest, c’est le Maroc ; vers le sud les Lacs intérieurs de l’Algérie après avoir franchi la Méditerranée ; au sud-ouest... la mer, derrière la Sicile ; les états Balkaniques, Turquie, Bulgarie, Roumanie ; |118 à l’est notre vrai voyage ; au nord-est la Suède et la Norwège et enfin au nord la mer encore, avec, au-dessus de l’Écosse, une
distance égalant la moitié des Îles Britanniques...
De plus, l’examen de la carte physique de l’Europe ne laisse aucun doute sur les lieux que nous avons traversés et particulièrement à propos de la montagne où nous avons accroché en Allemagne : le massif Rhénan, puis les montagnes Hercyniennes, dont les crêtes atteignent jusqu’à
1.200 mètres ont failli marquer la fin de notre voyage.
Le feu à ellipse qui nous a tant intrigué un peu plus loin est, pensons-nous, un feu de signalisation du modèle de ceux que l’Allemagne a établis pour le jalonnement des futures routes aériennes nocturnes. Il était placé sur un point haut et visible à longue distance. Contrairement aux foyers des phares maritimes il ne projetait aucun rayon lumineux. |119

|120-121
*
* *
Il m’a paru intéressant à titre documentaire, de noter en fin du récit qu’on vient de lire l’appréciation de la presse à propos de ce voyage.
*
* *
C’est d’abord — le premier des journaux de Paris, — le
Petit Journal (29 décembre 1913) qui écrivait :
C’est l’aéronaute Paul Leprince qui a accompli, dans la tempête, cette belle randonnée en allant de Paris à Grodno (Russie), gagnant ainsi la coupe de la Ville de Paris.
L’aéronaute Paul Leprince, le pilote habituel du ballon du Petit Journal, qui s’est déjà fait connaître par tant d’exploits sportifs, vient |122 d’ajouter à son glorieux bilan une merveilleuse performance.
Il était parti vendredi du parc aéronautique des coteaux de Saint-Cloud, à 4 heures 25 du soir, à bord du ballon Astrolabe n°15, cubant 1.500 mètres. Il était accompagné de M. Dormann, passager, directeur du Réveil d’Étampes. M.
Leprince courait pour la coupe de la Ville de Paris, dont le tenant actuel est M. Bogain, avec un parcours de 966 kilomètres après atterrissage en Bohême.
Or, hier, nous recevions le télégramme suivant :
Slonim (Russie), 28 Décembre.
L’aéronaute Paul Leprince a atterri en Russie après avoir parcouru 1.600 kilomètres en ballon. Le voyage a été très dur et c’est une violente tempête de neige qui a arrêté l’aéronaute, à Grodno, hier, à 11 heures.
L’aéronaute, qui était accompagné de M. Dormann, a été retenu par les autorités, mais celles-ci ont fait preuve de beaucoup de prévenances.
La ville de Slonim d’où est datée cette dépêche, est un chef- lieu de district du gouvernement de Grodno. Elle compte
15.000 habitants.
Le parcours de Bogain est donc largement battu et la coupe de la Ville de Paris revient à M. Leprince. |123
Le Temps, (30 décembre 1913) reproduisant cette information ajoutait :
Nous avons obtenu de l’Aéro-Club de France confirmation du succès de M. Leprince dont le point d’atterrissage exact serait Deretchin, près de Grodno, où l’aéronaute descendit samedi à 11 heures.
La coupe de la Ville de Paris — épreuve pour la plus grande distance — que vient de gagner M. Leprince est ouverte à tous les ballons sphériques cubant au maximum
2.200 mètres, gonflés au gaz d’éclairage. Le départ doit avoir
lieu du parc de Saint-Cloud et la coupe ne peut être disputée en même temps qu’un autre prix. Ces diverses conditions du règlement font que M. Leprince gagne la coupe sans être détenteur du record de la plus grande distance, qui appartient à M. Rumpelmayer par 2.420 kilomètres.
*
* *
Cette information se trouvait également dans : L’Aéro, L’Auto, L’Écho de Paris, L’Éclair, L’Éclaireur du Ve (Paris), Le Figaro, La Gazette de France, Le Gil Blas, L’Humanité, Le Journal, Le Matin, Les Nouvelles, La Patrie, Le Petit Parisien, La Presse, Le Radical, Le Mortagnais, etc., etc… |124
*
* *
The New-York Herald :
AERONAUT MAKES TRIP FROM PARIS TO RUSSIA
M. Leprince, Covering a Distance of 1.600 kilomètres, Wins Balloon Cup Competition.
M. Paul Leprince, the French aeronaut, landed in Russia on Saturday after a remarkable trip of 1.600 kilomètres, under very adverse conditions, in the competilion for the City of Paris Cup, open to spherical balloons of less than 2.200 cubic mètres capacity. The aeronaut, who was accompanied by M. Dormann, director of the Réveil d’Etampes, started at 4.25 p.m. on Friday from the aeronautic park at Saint-Cloud, piloting the balloon Astrolabe, of 1.500 cubic mètres capacity. News of the successful termination of
his trip came to Paris in the form of a telegramm from Slonim, in Russia.
The despath stated that M. Paul Leprince had landed near Grodno at eleven o’clock on Saturday morning. The journey was an extremely difficult one, and the aeronaut was finally obliged to land owing to a heavy snowstorm. M. Leprince and
M. Dormann were detained by the Russian authorities until the usual formalities were complied with.
Confirmation of M. Leprince’s landing was forthcoming in a message to the Aéro-club de |125 France, and il was added that the exact spot where he came down was Deretchin, near Grodno.
The City of Paris Cup, thus won by M. Leprince, was previously held by M. Bogain with a voyage of 966 kilomètres.
*
* *
L’Aérophile (Bulletin officiel de l’Aéro-Club de France) du 15 janvier 1914 :
LE PRIX DE LA VILLE DE PARIS
M. Paul Leprince le gagne.
De Saint-Cloud en Russie dans un 1.600 m. cubes 1.600 kilomètres en 18 h. 35
Presque en fin d’année, par un très beau voyage extrêmement rapide, M. Paul Leprince, un des plus anciens aéronautes français, du moins par l’époque de ses débuts, et assurément l’un de nos plus distingués praticiens, vient de conquérir le Prix de la Ville de Paris pour les ballons libres.
Cette épreuve de distance réservée aux pilotes membres de l’Aé.-C. F. comportait un prix de 2.000 francs offert par le Conseil municipal de Paris, au concurrent régulièrement inscrit qui effectuerait en 1913 le plus long parcours sans escale, les départs pouvant avoir lieu du département de la Seine jusqu’au 31 décembre à minuit, dernier délai.
M. Paul Leprince s’éleva le 26 décembre, à 16 h. 25, du Parc de l’Aéro-Club de France aux |126 coteaux de Saint- Cloud, à bord de l’Astrolabe (1.600 m. cubes), ayant pour aide et passager M. Maurice Dormann, directeur du Réveil d’Etampes.
Emportés par un vent violent, les aéronautes atteignent bientôt la forêt d’Argonne, qu’ils dépassent à 22 h. 20, sous une tempête de neige. Le Rhin est franchi par 950 mètres au- dessus de Coblentz, le ballon pénètre à nouveau dans des nuages de neige, le guide-rope s’accroche un instant dans une forêt, mais l’Astrolabe poursuit sa route dans la tourmente de neige jusqu’à 6 h. 45 du matin. Une éclaircie se produit alors, le ballon monte sans jet de lest à 3.000 mètres à 10 h. 40, et bientôt 3.150 mètres (altitude maxima du voyage). De nouveau, les nuages de neige. Le pilote décide d’atterrir et soupape. La terre reparaît, la descente continue et l’atterrissage s’effectuait le 27 décembre à 11 heures, à Boucksthow, district de Slonim, gouvernement de Grodno.
Les aéronautes avaient franchi 1.600 kilomètres environ en 18 h. 35 ; c’est un des plus beaux voyages effectués de France avec un ballon de 1.600 mètres cubes seulement entièrement gonflé au gaz d’éclairage ; c’est aussi, comme on peut le constater, l’un de ceux qui présentent la plus grande vitesse moyenne, bien rarement soutenue sur de si longs parcours.
Cette magnifique performance clôt dignement la saison aérostatique 1913 en France. |127
Elle vaut à M. Paul Leprince le Prix de la Ville de Paris, succès qui ne pouvait récompenser un aéronaute plus méritant et plus sympathique.
*
* *
L’Aéro, du 5 janvier, publiait le journal de bord de Paul Leprince :
Départ des coteaux de Saint-Cloud à 16 h. 25 vendredi 26 décembre 1913, à bord de l’Astrolabe, 1.600 mètres cubes, avec M. Maurice Dormann, directeur du Réveil d’Etampes. Passage au-dessus Neuilly, pris par tempête neige au-dessus de la forêt d’Argonne, en sortons à 22 h. 20. Passons le Rhin à 950 mètres au-dessus de Coblentz. Rentrons à nouveau dans des nuages de neige et accrochons le guide-rope dans la forêt.
Nous pensons que c’est le même endroit où s’est accroché Rumpelmayer quelques heures plus tard en disputant la même épreuve.
Nous restons dans la tempête de neige jusqu’au jour. À 6 h. 45 du matin, une éclaircie : à partir de ce moment le ballon monte sans jet de lest. Nous atteignons les 2.000 mètres à 9 h. 12, les 3.000 à 10 h. 40.
Altitude maximum 3.150 mètres.
Encore dans les nuages de neige et décidons d’atterrir ; coup de soupape et le paysage apparaît.
Atterrissage au panneau de déchirure au bord d’un marais.
|128
Atterrissage à Bouckschtow, aidé par les paysans russes du district de Slonim, gouvernement de Grodno, à 1.650 kilomètres de Paris.
Nous avons été arrêtés par le commissaire de police et conduits le lendemain en traîneau au commissariat de police de Slonim, M. Matchinsky.
Nous n’avons qu’à nous louer de la réception très aimable que nous ont faite les autorités russes.
*
* *
C’est avec un plaisir tout particulier que j’ajoute l’appréciation de mes aimables confrères Etampois.

*
* *
L’Abeille d’Étampes, du 3 janvier 1914 :
Signalons également l’intéressant voyage de 1.650 kilomètres en ballon, accompli par notre confrère, M. Maurice Dormann, à bord d’un ballon piloté par l’aéronaute Leprince, auquel fut confié à l’occasion des « Saint-Michel » 1912 et 1913, l’enlèvement du ballon Le Petit Journal. L’aéronaute Leprince, concourant pour la Coupe de la Ville de Paris, partit vendredi du parc de l’Aéro-Club, aux coteaux de Saint-Cloud, et atterrit samedi, à 11 heures 26, à Deretchin, près de Grodno
(Russie). Le voyage fut très dur, |129 et une violente tempête de neige les ayant arrêtés, les aéronautes ne purent qu’après quelques jours donner de leurs nouvelles...
*
* *
Le Gâtinais, (3 janvier 1914) :
L’aéronaute Paul Leprince qui, depuis deux ans, le lundi de Saint-Michel, monte à Etampes le ballon du Petit Journal et s’est déjà fait connaître par de nombreux exploits sportifs, vient d’ajouter à son glorieux bilan une merveilleuse performance.
Il était parti vendredi du parc aéronautique des coteaux de Saint-Cloud à 4 h. 25 du soir à bord du ballon Astrolabe n°15, cubant 1.600 mètres.
Il avait pour passager notre confrère Maurice Dormann, directeur du Réveil d’Étampes, dont c’était la troisième ascension.
M. Leprince courait pour la Coupe de la Ville de Paris dont le tenant actuel est M. Bogain, avec un parcours de 966 kilomètres après atterrissage en Bohême.
L’Astrolabe a atterri en Russie après avoir parcouru 1.650 kilomètres.
Le voyage a été très dur et c’est une violente tempête de neige qui a arrêté l’aéronaute, à Grodno, samedi à 11 heures 25 du matin.
L’aéronaute et notre confrère ont été retenus par les autorités mais celles-ci ont fait preuve de beaucoup de prévenances...
|130
*
* *
Le bureau du Conseil municipal de la ville de Paris, dans sa séance du 19 janvier, — à la demande de l’ami Paul Fleurot, l’actif conseiller municipal du quartier du Jardin des Plantes,
— a accordé deux médailles de vermeil destinées à être remises aux vainqueurs de la course de ballons libres pour la Coupe de la Ville de Paris, MM. Paul Leprince, pilote, et Maurice Dormann, directeur du Réveil d’Étampes, passager.
Ces médailles ont été accordées en raison des difficultés du voyage accompli25 et furent remises aux lauréats, lors de la distribution solennelle des récompenses de l’Aéro-Club de France, qui eut lieu à la Sorbonne, le 7 février 1914.
25 Jusqu’ici Dormann reprend le texte du Réveil d’Étampes 32/5 (31 janvier 1914), p. 1, moins les mots « actif et infatigable ».
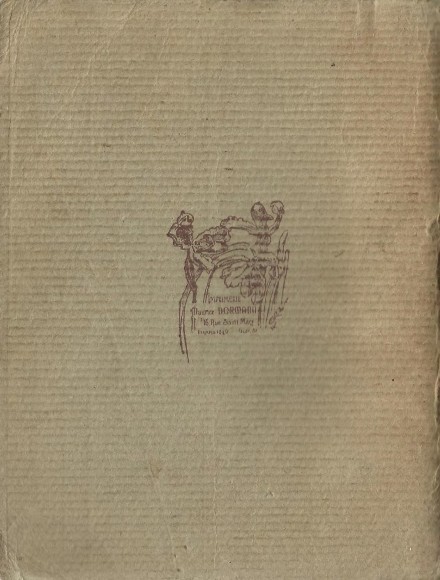
Fiche matricule (1901-1932) 26
Nom : Dormann. – Prénoms : Maurice. – Numéro matricule du recrutement : 4708. – Classe de mobilisation : 1900 [sic (1901)].
État civil : né le 20 avril 1881 à Étréchy, canton d’Étampes, département de Seine-et-Oise, résidant à Étréchy, canton d’Étampes, département de Seine-et-Oise, profession de compositeur-typographe, fils de Joseph Louis et de Grelet Célestine Marie, domiciliés à Étréchy, canton d’Étampes, département de Seine-et-Oise.
Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux foncés, front et nez moyens, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille : 1 m. 63 ; marques particulières : néant. Degré d’instruction générale : 3 ; degré d’instruction militaire : exercé.
N°26 de tirage dans le canton d’Étampes. Décision du conseil de révision et motifs : Engagé volontaire. Compris dans la 4e partie de la liste du recrutement cantonal.
![]()
26 Archives départementales des Yvelines 1R/RM 326 (vues 334-335).
Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés : dans l’armée active : 3e régiment de zouaves ; dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : 14e régiment de zouaves au fort de Rosny (Seine) 012341 ; 19e escadron du train des équipages militaires (cr convois automobiles) 03546 ; 5e escadron du train 0659 ; 1er régiment de zouaves 015767 ; 4e zouaves ; 3e zouaves ; dans l’armée territoriale et dans la réserve : Rayé des cadres.
Localités successives habitées : 11 janvier 1910 : Étampes, 16 rue Saint-Mars, Versailles R. ; 26 juillet 1919 : se retire à Paris 21 rue Rochechouart ; (sans date : 16 rue St Mars, Étampes (S.
& O.)
Époque à laquelle l’homme doit passer dans : la disponibilité de l’armée active : (néant) ; la réserve de l’armée active : 6 novembre 1904 ; l’armée territoriale : 6 novembre 1914 ; la réserve de l’armée territoriale : 6 novembre 1920 ; date de la libération du service militaire : 6 novembre 1926.
Numéro au contrôle spécial du recrutement : 31 ; 100 ; 30 ; 28.
Détail des services et mutations diverses (Campagnes, blessures, actions d’éclat, décorations, etc.) : Engagé volontaire pour trois ans le 6 novembre 1901 à la mairie de Constantine au titre du 3e régiment de zouaves ; arrivé au corps et soldat de 2e classe le 8 novembre 1901, n° matricule 7632 ; zouave 2e classe ; soldat musicien le 21 octobre 1902 ; libéré du service actif le 6 novembre 1904 ; certificat de bonne conduite :
« accordé » ; passé dans la réserve de l’armée active le 6 novembre 1904 ; dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : affecté au 1e régiment de zouaves au fort de Rosny, zouaves de 2e classe ; 1re période d’exercices : dispensé,
article 64 de la loi du 21 mars 1905 ; a accompli une 2e période d’exercices dans le 14e régiment de zouaves (ET 107) du 14 au
30 novembre 1910 ; rappelé à l’activité par suite de mobilisation générale (décret présidentiel du 1er août 1914) ; arrivé le 10 août 1914 au 1er régiment de zouaves ; caporal le 14 août 1915 ; promu sous-lieutenant à titre temporaire, le 5 juillet 1916 et affecté au 5e régiment de zouaves ; affecté au 3e régiment de zouaves (aux armées) le 23 août 1916 ; promu lieutenant à titre temporaire le 28 juillet 1918, J. O. du 31 décembre 1918 ; proposé pour une pension de retraite de 6e classe, invalidité 90% par la commission de vérification du centre spécial de Faidherbe du 26 juillet 1919 pour : « 1° amputation de la cuisse droite ; 2° ankylose complète du genou gauche. » Blessé à Tilloloy ( ?) le 16 ( ?) septembre1915 ; blessé le 17 novembre 1916 à Douaumont (E. O. genou droit, amputation cuisse droite), décoration : chevalier de la légion d’honneur, J. O. du 15 mai 1917), pour prendre rang du 20 novembre 1916 ( ?) et croix de guerre avec palme ; citation : à l’ordre de l’armée : « Officier modèle blessé au début de la campagne. Rejoint le front à peine guéri. A été atteint à nouveau d’une très grave blessure le 17.11.16 alors que sous un
bombardement il veillait à ce que tous ses hommes soient à l’abri. »
Déjà rayé des cadres ; pension permanente ; invalidité de 100% article 10 (décision de la 6e commission de réforme de la Seine du 18 mars 1921), pour 1° amputation de la cuisse au tiers supérieur ; 2° ankylose complète et définitive du genou avec 14 cm de raccourcissement ; marche en varus ; mis hors cadre par décret en date du 8.7.1921 et par application de l’article 5 paragraphe 4 du décret du 31.8.1915, et placé dans la position d’officier honoraire par décision ministérielle du 8 juillet 1921.
Déjà rayé des cadres 100% + 10. Degré article 62, article 10, acquis décembre (lisez : décision) de la 1re commission de réforme de la Seine du 17.2.37 sur pièces : 1° amputation sous trochantérienne de la cuisse droite assimilable à une désarticulation de la hanche suite de blessure de guerre ; 2° ankylose du genou gauche, recurvation suite de blessure de
guerre ; 3° raccourcissement du membre inférieur gauche pouvant être évalué à 14 cm par calcul du rapport de la taille du mutilé avant sa blessure à la longueur actuelle, suite de 2 résection à la région du genou gauche, font musculaire de la cuisse et de la jambe ; est reconnu à la suite des propositions de la commission de réforme de la Seine du 17.2.37 avoir droit du
17.2.37 à une allocation de grand mutilé de guerre aux taux annuel de 6.400 f. pour : amputation sous trochantérienne. En conséquence l’allocation de 6.400 f. accordée par décision ministérielle du 22.2.1932 ne sera pas modifiée.
Dans la marge : État signalétique au ministre de la défense nationale, 7.4.1932 (légion d’honneur).
Départ pour le Front (sept. 1914) 27
Après quelques jours de congé, notre directeur, M. Maurice Dormann a été appelé à rejoindre à nouveau le régiment de zouaves auquel il est affecté. De son courage, de sa bravoure, aucun de nos concitoyens n’en doute ; qu’il leur soit permis ici de faire des vœux pour qu’il échappe aux multiples dangers auxquels la troupe d’élite dont il fait partie va être exposée.
27 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N°11 (12 septembre 1914), p. 2.
L’ « Abeille-Réveil » sur le front 29

— Allons, une dernière fois Au revoir et bonne chance !
C’est sur ces mots accompagnés d’un long serrement de main, que je quittai, un matin de septembre — un matin gris — ce pauvre Fernand Quérard, ce cher compagnon d’armes, dont je viens d’apprendre la mort glorieuse sur le champ de bataille, dans ce coin de
Belgique où nos soldats luttent si héroïquement.
Et je ne puis m’empêcher d’évoquer la figure de ce brave garçon le jour de ce départ « pour le front ». Je le revois encore,
28 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 27, vendredi 1er janvier 1915, p. 2.
29 Cette rubrique était précédement tenue par le dit Fernard Quérard (1889-1914), instituteur à l’école du Centre à Étampes.
en tête de la première section, les deux mains appuyées sur le canon de son fusil, donnant un coup d’épaule pour maintenir son sac en tenue de campagne et me disant :
Mais c’est lourd tout ce barda !
Car il ne connaissait pas le sac du zouave, mais c’était un énergique et rien qu’à le voir on sentait qu’il ne voudrait pas, celui-là, caler. Il semblait qu’on avait voulu réparer un oubli en le versant dans ce corps d’élite des zouaves — je cause sans aucune idée d’esprit de corps — et dans ses yeux, derrière les verres de ses lunettes — le lorgnon est si mal commode pour aller à la guerre — on lisait le désir d’égaler, pour le moins, les vieux chacals qui presque tous portaient la médaille du Maroc.
Je le revois encore dans cette vaste cour de la grande caserne de Saint-Denis où les hommes arrivaient se ranger pour la formation du renfort qui s’en allait sur la ligne.
Cette fois, me disait-il, vous ne venez pas avec nous. Peut- être nous retrouverons-nous ?
Peut-être…
C’est qu’en effet deux fois déjà nous étions « partis » ensemble. La première c’était pour donner la chasse à des pillards allemands qui se livraient à leurs actes « ordinaires » aux environs de Creil, Chantilly, Senlis… C’était un hardi coup de main qui avait été projeté à la barbe du gros des Boches — il y en avait encore plus de 4 000 à Creil, — et mené à bien par 400 zouaves, en pleine nuit, dans les rues, dans les bois…
Quérard avait trouvé « amusant » ce hors-d’œuvre et tout naturel sa brave conduite. Il avait vu le feu et échappé à la mort en montant à l’attaque d’une maison dans un escalier où les
balles venaient sans qu’on puisse voir d’où. Je n’étais pas à côté de lui à ce moment et certes ce n’est pas lui qui s’en vantait, mais un camarade commun me raconta la chose au retour.
Un peu après nous faisions ensemble partie d’un bataillon de marche qui gagna à pied la gare régulatrice du Bourget où nous devions embarquer pour aller au front. Mais avant l’heure, une alerte en pleine nuit nous réveillait et nous apprenions que nous devions nous rendre à pied, à Penchard, petit village au nord- ouest de Meaux.
L’étape fut dure car beaucoup n’étaient pas entraînés. Comme ils semblèrent longs les 40 kilomètres du parcours avec la charge du sac, du fusil, des cartouchières pleines. La pluie vint à son tour ajouter à nos fatigues.
Et j’évoque encore ce souvenir : Quérard et moi nous regardant pendant les pauses, trempés, crottés… Sa bonne humeur pourtant n’était pas entamée. Au contraire, car c’était un entraîneur et il savait communiquer aux autres la vaillance qui soutient.
Hélas ! cette fois nous n’allions pas combattre, notre mission était plus ingrate et certes nous ne l’avions pas supposée ce qu’elle était, ignorée par les officiers eux-mêmes : on avait besoin de nous pour enterrer les morts sur ce coin du champ de bataille de la Marne, dans tous ces villages qui ont vu passer le fléau : Chambry, Barcy, — où le fils de notre sympathique concitoyen M. Lagouanelle trouva une mort glorieuse — Etrépilly, Vincy, Plessis-Pacy, Trocy, etc…
La tristesse nous avait envahi et le soir quand nous nous retrouvions nous cherchions à parler d’autre chose que des occupations journalières, pour distraire la pensée, chasser
l’obsession. Plus tard aurai-je peut-être le courage de donner mes impressions sur ces moments, dire les horreurs qu’il nous fut donné de voir, combien la guerre, lorsqu’on s’en sent si près pour la première fois, apparaît horrible…
Nous revînmes à Saint-Denis. Peu de temps après, Quérard repartait, toujours d’humeur aussi égale, vibrant d’enthou- siasme, et je suis heureux d’avoir été le dernier à lui donner la main au moment de ce départ.
— Ce qui doit arriver, personne ne peut l’empêcher, répétait- il. Il faut vivre avec l’espoir d’un prochain retour — après la victoire.
La victoire, mon pauvre ami, tu ne l’auras pas connue. Mais au moins tu auras avec ton sang contribué à l’assurer. On ne pouvait pas attendre moins de toi.
Je sais que le soir de ta mort, après la bataille, à l’appel de ton nom — heure combien cruelle — je sais que des larmes mouillèrent les yeux de tes compagnons d’armes, de ces vaillants zouaves qui tous t’aimaient.
Et c’est moi-même les larmes aux yeux que je t’adresse ce souvenir, en pensant à tes chers parents dont tu étais la joie, toute la vie, et qui, j’en suis persuadé, supporteront leur douleur avec fierté, car tu es tombé sur le champ d’honneur après avoir vécu une vie toute d’honneur et de bonté.
Si ton nom restera gravé dans le Livre d’or des Héros de la Patrie, comme il le mérite, je puis t’assurer au nom de tous tes amis que ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Maurice DORMANN.
Premier reportage (mai 1915) 30
L’ « Abeille-Réveil » sur le front
Depuis ce matin, les Boches se sont montrés « excités ». Et cela tout simplement à cause de deux malheureuses bombes à ailettes qu’on leur a envoyées dans leurs tranchées et qui semblent avoir bouleversé leurs lignes de défense. Aussi les obus de 105 nous arrivent dessus sans interruption, éclatant avec un bruit formidable et l’accompagnement du « flac » en coup de fouet des balles qui passent de tous côtés.
— Ah ! ah ! Joseph, tu t’excites ! répètent les zouaves que cette colère amuse.
Vers le soir pourtant le calme revient. Plus librement, nous pouvons circuler dans nos boyaux, aller à travers les sacs de sable qui forment nos tranchées — tout à fait spéciales comme construction — rendre visite aux camarades de garde aux créneaux, jeter un coup d’œil sur le périscope pour essayer de
30 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, n° 48, samedi 29 mai 1915, pp. 1-2.
voir ce que font « ces messieurs ». Amusant ce périscope d’une simplicité curieuse ; mais si les Boches en voient le bout émerger par-dessus la crête, pan ! tout de suite les balles sifflent.
On sort des « guitounes », histoire de se dégourdir les jambes, sans souci de la mitraille qui passe de tous côtés.
Scène touchante à noter au passage : dans une sorte de cuvette, au milieu des dunes, qui forme un carrefour de boyaux de communication, des camarades tués dans les tranchées ont été inhumés. Des mains pieuses ont donné des sépultures à ces victimes de la guerre ; une petite croix en bois porte leurs noms ; deux soldats sont agenouillés sur une de ces tombes où probablement repose un ami cher…
Cependant, au loin, les obus plus espacés, tombent du côté de l’Yser.
Dans la soirée, un coup de téléphone nous apprend la déclaration de guerre à l’Autriche par l’Italie ; aussitôt la nouvelle court avec rapidité.
Enfin ! ne peut-on s’empêcher de s’exclamer.
Tout le monde est heureux. L’esprit se dégage d’une inquiétude qui a vraiment trop duré, et spontanément un cri monte dans le ciel de Belgique sous lequel nous vivons, cri qui se répète d’un bout de la ligne — de la mer — et qui certainement se répercute pour aller rouler en tonnerre jusqu’à l’autre bout — en Alsace :
Vive l’Italie !
Ce cri a le don d’exaspérer ces messieurs les Boches qui, sans doute intentionnellement moins tenus au courant des événements que nous, n’en comprennent pas la signification. Une salve de coups de fusil répond aux cris des zouaves et des fusiliers marins — qui voisinent — et naturellement la réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre.
Salve d’honneur ! s’écrie, réjoui, notre sergent bombardier qui déjà installe un de ses engins à ailettes sur son appareil.
Vacarme épouvantable alors. Les yeux brillent. Ah ! ah ! les Boches vont-ils se laisser aller à une attaque ? Il y a une huitaine pourtant le goût leur en avait été enlevé, car ils ont pris une fameuse « piquette ». On est heureux.
Canonnade sur toute la ligne. Les éclairs se succèdent dans la nuit qui tombe. Les projectiles de toute sorte déchirent l’air.
Mais instantanément la voix de nos 75 se met de la partie. Comme ils tonnent, nos bons canons ! Leur bruit bien connu domine le charivari. Et aussitôt — comme toujours, du reste — ils imposent le silence le plus complet à l’artillerie et à la mousqueterie allemandes. C’est comme un effet magique.
Guérison garantie instantanée de tous accès de mauvaise humeur ! s’écrie un loustic. |2
Dans le silence, dans le calme revenu, zouaves et marins rejettent leur cri, maintenant répété seulement pas l’écho :
Vive l’Italie !
Et le lendemain, au petit jour, sur un point de nos lignes distant seulement de quelques mètres des lignes allemandes, les
zouaves se chargent d’expliquer aux Boches en mettant les points sur les i que de nouveaux ennemis se sont dressés contre eux, contre leur barbarisme, contre leur kultur !...
Maurice Dormann, Soldat au .. zouaves.
Dans les tranchées (Belgique). 20 mai 1915.
Deuxième reportage (juin 1915) 31
L’ « Abeille-Réveil » sur le front
En deuxième ligne. L’arrosage permanent. — Que faire en un gîte ? Le théâtre des « zouzous ». Un chef-machiniste improvisé. L’indispensable piano. Brillante assistance. Un sourire de femme. Le tableau de la troupe. Des artistes des principaux théâtres de Paris. — Mille regrets, la salle est pleine. — En scène pour le premier ! Accompagnement de marmites, non prévu par le programme. — Et puis vous savez,
« ils » peuvent « y » venir !
Pendant trois jours les zouaves sont restés aux tranchées de première ligne, à quelques mètres seulement des Allemands, dans ce pays de Belgique où nos troupes font actuellement des prodiges de valeur.
Maintenant les zouaves sont en deuxième ligne, oh ! ne croyez pas qu’ils soient bien loin, quelques centaines de mètres seulement les séparent des tranchées creusées dans les dunes.
31 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, n° 49, samedi 5 juin 1915, p. 1.
Les balles arrivent encore ici. Et les pièces boches qui cherchent notre artillerie arrosent de telle façon qu’il faut, souvent, pour ne pas être tué stupidement, se garer en vitesse dans les cantonnements.
Que faire alors pendant toute une journée ? Dormir, puisque la nuit il y a toujours du travail ? Non pas ! L’esprit et le caractère français reprennent tous leurs droits. C’est fête aujourd’hui : c’est lundi de la Pentecôte. Profitons-en donc !
Dans une vaste cave, une scène a été vivement aménagée et décotée par un artiste tapissier parisien, — ne trouve-t-on pas des hommes de tous les métiers dans un régiment ? Le bon goût français de révèle tout de suite. Des banquettes sont faites avec des madriers qui reposent sur les chaises qu’on a pu trouver dans les villas en ruines, et qui, par hasard, ne sont pas boiteuses.
Un piano découvert dans les décombres, — comment le pauvre a-t-il pu conserver sa carcasse presque indemne ? — piano encore assez juste pour accompagner les chanteurs et dissimulé dans la verdure.
Et voilà le théâtre des zouaves constitué. Des invitations ont été lancées, s’il vous plaît. Voici le lieutenant P… qui commande la compagnie d’où l’initiative est sorte, qui fait les honneurs au commandant B… du bataillon, au commandant R… du secteur, aux officiers des corps cantonnés à côté : génie, artillerie, médecins, territoriaux, qui sont venus en voisins. Derrière, les zouzous et les soldats du génie s’entassent avec la meilleure bonne humeur.
Tout à l’heure même, une gracieuse miss, une ambulancière anglaise qui, volontairement, est au front pour prodiguer ses
soins aux blessés et qui est venue en curieuse — pardonnons-lui cette curiosité, elle nous a fait tant plaisir ! — nous apporta le sourire féminin qui, à lui seul, suffira à jeter dans cette salle un éclair de gaîté.
Des artistes ? mais ils foisonnent ! Il n’y a que l’embarras du choix et le programme, copieux et varié, pourrait avantageusement, choix et valeur, supporter la comparaison avec bien des spectacles. N’avons-nous pas, en dehors du pianiste accompagnateur, M. Figon, premier prix du Conservatoire, un violon et un violoncelle ; — comme diseur exquis Raoul Henry, de l’Odéon, qui d’angoissante façon nous dit Le Drapeau de Clovis Hugues ; — comme chanteurs Montis, de l’Opéra-Comique, ténor de haute valeur qui s’est fait aimer de tous les zouaves tellement il prodigue avec plaisir sa jolie vois ; Mamo, du théâtre d’Alger ; Roux, des concerts Parisiens ; les sergents Semelet et Menzis, qui détaille les chansons rosses avec esprit ; Turpyn, Pons, etc. — La partie comique est brillamment tenue par Fix-Hem, du Petit Casino, toujours rappelé et toujours amusant ; Derval, prestidigitateur ; Mallet, etc., etc… car les administrateurs Menzis, Planès, Laluyaud et Lemoindre ont été obligés de refuser des artistes…
Le concert, naturellement, a débuté par la Marseillaise, reprise en chœur par tous les assistants debout. C’était vraiment beau. Et le programme se déroule plein d’entrain, de gaîté vraiment française, que ne parviendront pas à troubler ni les grondements des canons qui tonnent tout à côté, ni les obus qui, au-dessus de la salle de spectacle, achèvent de mettre en pièces la partie supérieure de l’immeuble pourtant suffisamment délabré, où s’acharne la fureur des Boches.
Qui pourrait prétendre que « nos poilus » s’ennuient au front ? qu’ils sont moroses ? Non pas ! ils s’en défendent bien au
contraire. Et pourtant, soyez-en persuadés, si un mot d’alerte était venu les surprendre, on peut se porter garant que tous auraient couru aux armes avec le même entrain, le refrain inachevé aux lèvres, dans le même désir de faire payer cher aux Boches d’avoir troublé leur récréation, heureux aussi, comme ils sont toujours, de l’occasion de faire sentir à l’ennemi abhorré que la France peut être fière de ses enfants.
Maurice Dormann.
Troisième reportage (juin 1915) 32
L’ « Abeille-Réveil » sur le front
Comme sous l’impulsion d’un déclic, à l’heure prévue, — six heures du soir — la canonnade éclate brusquement. Le roulement de tonnerre gronde, répercuté par un écho sourd, dans ces dunes de sable du littoral de la Belgique où nous sommes. Nos artilleurs s’acharnent à la besogne, rivalisant de rapidité pour charger les pièces qui vomissent la mitraille.
On distingue bien les coups. Voici le claquement sec, impératif, du 75, qui crache des obus de toutes parts ; puis les gros calibres à la voix majestueuse et terrible, dont les projectiles s’échappent avec un bruissement impressionnant et un formidable déplacement d’air. Il n’y a pas une minute de répit. D’un bout de la ligne à l’autre, partout le concert infernal emplit l’espace de son tumulte.
32 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, n° 52, samedi 26 juin 1915, p. 1.
Une fumée tantôt noirâtre, tantôt jaune, quelquefois bleue se répand partout, de cette fumée qui fait dilater les narines, qui grise si rapidement en semant son odeur de poudre.
Et toutes ces gueules de fer s’en vont là-bas, vers les lignes allemandes, semer la destruction, le feu, la mort !
Surpris, l’ennemi ne s’est pas rendu compte tout de suite de ce qui se passait, mais peu à peu ses batteries ont ouvert le feu à leur tour. Le bruit redouble de violence. On sent pourtant que notre artillerie, la vaillante artillerie française, domine son adversaire dont la réponse n’est pas franche.
A la nuit, le bombardement revêt un aspect plus grandiose encore, — car il faut le dire, cette lutte a quelque chose de farouchement beau, hélas ! On voit maintenant très nettement, dans la demi-obscurité, l’éclair qui précède le coup de départ et de partout ces éclairs jaillissent, rapides, fulgurants.
Au-dessus des tranchées, des deux côtés les fusées s’élèvent, traçant une ligne sanglante dans le ciel de deuil, puis retombent en gerbes de feu, éblouissantes, éclairant tout à l’entour, et faisant apparaître, comme dans un décor de féerie, fantasmagorique, les crêtes des dunes, surmontées de rangées des sacs de sable, avec les réseaux de fils de fer barbelés — gigantesques toiles d’araignée — les chevaux de frise…
Les adversaires s’observent.
Des faisceaux de rayons lumineux courent dans le ciel, se jouant à travers les nuages sombres dans lesquels ils perdent leur clarté qui s’étale plus loin, plus claire, car le ronflement des moteurs d’avions a percé malgré le tumulte, par intermittences, et les projecteurs fouillent la nuit pour les découvrir, s’abattant
par instants sur la mer qui roule ses vagues toujours avec la même régularité.
Des étoiles apparaissent subitement dans le firmament, mais elles n’ont pas la teinte des étoiles du Bon Dieu. On les croit d’or tout de suite mais leur éclat s’atténue, elles deviennent plus rouges, comme pour rappeler la couleur du sang vermeil qui coule au-dessous. Ce sont les obus éclairants qui semblent rivés au ciel, et qui, brusquement, tombent, comme si le génie humain était puni de cette rivalité ridicule.
Et pendant tout ce temps, les « éclaireurs volontaires » qui tout à l’heure vont tenter l’audacieux coup de main qui leur a été confié, attendent impatients, piétinant sur place, serrant le fusil nerveusement. Leur mission ? Reconnaître les positions des Boches, en face ; monter à l’assaut de leur petit poste d’écoute, distant du nôtre de huit mètres seulement, et s’assurer des forces qui peuvent exister dans leurs tranchées, puisque dans cette guerre les ennemis ne se vient jamais, qu’ils s’ignorent.
Hé quoi ! ce sera seulement ces petits groupes — une centaine à peine — qui vont assurer une aussi lourde tâche ? Pour toute réponse, demandez-leur donc s’ils voudraient céder leur place ; regardez leurs yeux briller… Ne comptent-ils pas sur leurs camarades prêts à bondir à leur secours, à leur prêter main- forte ?
Si la distance est courte, elle est périlleuse et aucun d’eux n’ignore le danger. Tout à l’heure, en serrant la main des camarades, graves, mais pourtant presque joyeux, ils ont échangé encore les boutades qui font du troupier français le plus merveilleux soldat.
Vous allez chercher la croix de guerre ?
Pourvu que ce ne soit pas la croix de bois !
Et les rires fusent, rires nerveux peut-être, mais sincères. Le croiriez-vous-même, on sent |2 que ces « éclaireurs volontaires », à qui sont confiées toutes les missions difficiles, sont enviés par leurs camarades à cette heure ; pour un peu, tous se joindraient à eux.
On est étourdi maintenant. Car non seulement on entend le bruit de départ des pièces d’artillerie, mais il y a encore l’éclatement d’arrivée des projectiles et cet éclatement est plus violent encore.
Les coups se précisent. Le 75 tape admirablement, avec une précision remarquable. Ses fusants tant craints des Boches, et à juste titre, arrivent en plein dans le parapet de sacs de leurs tranchées, après avoir débarrassé leurs abords des fils de fer barbelés qui les protégeaient. Les obus tombent si près de nos propres lignes que les nôtres sont obligés de s’aplatir sur le sol pour ne pas être atteints eux-mêmes. On sent le déplacement d’air au-dessus des têtes.
Laissez passer l’enfant !
Et les zouaves ne peuvent réprimer un sourire presque mauvais en jetant un regard furtif devant eux. Les sacs de sable volent sous les obus et ils aperçoivent, lueur de cauchemar, des membres jaillir en l’air, membres appartenant aux Allemands qui sont accourus derrière les créneaux.
8 heures 45 ! Tout d’un coup le vacarme a cessé de notre côté. C’est l’heure de l’attaque prévue.
Se détendant comme des ressorts, les éclaireurs ont bondi par- dessus notre parapet. A peine a-r-on le temps de les voir dévaler dans la cuvette qui sépare les deux petits postes. Ce sont de véritables démons qui courent ainsi. A la tête de leurs hommes on distingue les deux chefs qui les conduisent, le sous- lieutenant P… et l’adjudant C… — deux braves qui ont gagné tous leurs grades sur les champs de bataille qu’ils n’ont jamais quittés depuis la mobilisation.
A peine si les Boches ont vu la vaillante phalange se précipiter sur eux : elle n’a fait qu’un bond.
A moi les zouaves ! s’écrie l’adjudant qui le premier est arrivé et escalade déjà ce qui reste de leur ligne de défense, revolver au poing.
Les zouaves sont là. Avec une agilité de chat ils courent toujours, baïonnette haute. Avec fureur ils sautent sur les Boches qui n’en reviennent pas, tellement l’attaque a été soudaine.
A coups de revolver, en pleine figure, l’adjudant abat les trois premiers qui se présentent. Les baïonnettes se dressent, les crosses s’agitent en l’air, et la mort fauche… on n’entend aucune parole, seuls des halètements, des geins furieux… des râles d’agonie…
Les zouaves foncent encore en avant, ils arrivent aux portes des « guitounes » profondes, où sont terrés les boches. Ceux-ci maintenant, sortent ahuris. D’un geste brusque ils débouclent leur équipement, lèvent les bras en l’air, la figure contractée par la frayeur :
— Kamerades, zouaf’s, kamerades !
Ils suivent une chaîne organisée aussitôt et rapidement sont déversés de l’autre côté, vers nos lignes.
Quelques-uns ont voulu se défendre, tout de même. C’est le corps à corps. Un zouave abat d’un coup de fusil, à bout portant, un tout jeune garçon qui paraît un véritable enfant, mais un Prussien barbu vient de le prendre lui-même à la gorge, par derrière. A son tour il va mourir. Non. Juste à temps, l’adjudant,
lui, encore ! — arrive au secours de son « poilu », il braque son revolver e une balle dans la bouche, l’Allemand s’effondre comme une masse. La scène est d’une rapidité effrayante.
Comme hébété, le zouave ainsi sauvé miraculeusement passe la main sur son cou dégagé si fort à propos des gros doigts noueux er velus qui l’enserraient comme dans un étau, puis essuie les gouttes de sueur qui perlent sur son front.
— Merci, mon adjudant, dit-il simplement en tendant la main à son sauveur. Geste touchant quoique le moment ne soit pas aux effusions.
… Combien de temps dure ce corps à corps ? qui pourrait le dire ? A-r-on la notion des choses, du temps, en pareils moments ?
Anxieux, les camarades qui sont aux tranchées tendent le cou, écartent les yeux, les oreilles, pour essayer de voir, d’entendre. Leur cœur bat certes plus fort que celui des combattants, leurs frères d’armes, qui, maintenant débarrassés des premiers Allemands, courent dans les lignes adverses, inspectent partout.
Au loin pourtant voici un nouveau groupe de Boches. Ils marchent par quatre ceux-là. A leur tête un grand diable d’officier agite une latte d’une longueur démesurée. Pauvres
zouzous, qu’allez-vous faire, petite poignée, contre cette horde ? Ah ! vous ne les connaissez pas ! Vite ils se sont ressaisis. Ils attendent de pied ferme ceux qui s’avancent, médusés par leur sang-froid.
A cinq pas, l’officier au grand sabre est tué et s’affale. Et ceux qui le suivent, pris d’une terreur irraisonnée, tournent les talons brusquement et s’enfuient.
Le 75 a allongé son tir. Comme attirés, les malheureux ont l’air de courir sous son feu. La boucherie recommence dans toute son horreur.
— Vite ! en retraite maintenant !
C’est un officier du génie, le lieutenant K…, qui donne cet ordre. Avec quelques sapeurs, il a eu le temps de creuser un trou de mine sous le petit poste assailli. La boîte d’explosifs est à sa place.
A regret les zouaves s’en vont, profitant du désarroi de l’ennemi, défilant un à un devant l’officier qui tient à quitter la place le dernier et à allumer la mèche du fourneau.
C’est fait.
Mais les Allemands accourent de toutes parts et tirent des feux de salve.
Parmi ceux qui sont atteints on voit l’officier de génie qui tombe, frappé mortellement. Deux zouaves reviennent sur leurs pas, veulent l’emmener. Mais généreusement il s’est relevé sur les coudes et dans un effort désespéré il rassemble toute son énergie pour leur crier :
— Sauvez-vous… vite… la mine !... A peine il achève ces mots qu’une explosion retentit. Instinctivement, les zouaves se sont retirés vers leurs lignes. Le coup a réussi : le petit poste allemand n’existe plus.
Dans le sable le corps du lieutenant K… est étendu à côté de celui d’un zouave qui a voulu, malgré sa défense, porter secours à l’officier ; son camarade W…, blessé lui-même, a été obligé de se retirer sous la fusillade. Et ce n’est que la nuit suivante que des braves gens, décidés, pourront aller rechercher les cadavres.
La canonnade a cessé. Des deux côtés des lignes l’attention redouble. Un silence effrayant a succédé au vacarme d’ouragan de tout à l’heure et n’est troublé seulement que par le sifflement d’une balle tirée au hasard par un des veilleurs.
La mission confiée aux petits groupes d’éclaireurs a pleinement réussi. Les renseignements recueillis, forts précieux, sont consignés dans des rapports au style sobre, militaire, sec comme un compte-rendu de manœuvres.
Les héros de cette soirée sont félicités comme il convient par leurs camarades, — au fond un peu jaloux…
Le lendemain l’adjudant C… se frottait encore les yeux, après un repos bien gagné, quand un zouave qu’il ne connaissait pas et qui guettait son réveil, se précipitait sur lui pour l’emmener devant le commandant de sa compagnie.
Mon Capitaine, disait-il avec un accent de sincérité émue, je tiens à remercier devant vous l’adjudant qui, hier, a empêché un Boche de me « buter ». C’est un brave, vous savez ! Et non
pas seulement parce qu’il « m’a sauvé la mise ». Si vous l’aviez vu courir, monter à l’assaut, se démener !...
Et l’autre, visiblement gêné, de répondre en se dégageant :
Ça va, oui, ça va…
Des propositions ont été faites : une croix de chevalier de la Légion d’honneur est demandée pour le sous-lieutenant P… ; la médaille militaire est sollicitée pour l’adjudant C…, le caporal B… qui aussi s’est particulièrement distingué et le zouave W…, celui-là qui ne voulait pas abandonner le lieutenant du génie et qui, blessé lui-même, fit tout pour le sauver ; d’autres sont proposés pour une citation à l’ordre du jour…
Dans les Tranchées, juin 1915.
Maurice Dormann.
Quatrième reportage (juillet 1915) 33
L’Abeille-Réveil en Belgique
À la mémoire des zouaves du 1er régiment, tombés au champ d’honneur
Notre bataillon était depuis la veille en seconde ligne, à N…

Les dunes en Belgique (dessin de Louis Dauphin, Les Annales)
33 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 55, samedi 17 juillet 1915.
Cette coquette cité balnéaire de Belgique, à la vérité, n’existe plus guère qu’à l’état de ruines qui s’accumulent un peu plus chaque jour, car la fureur des Teutons s’acharne sur ce coin. Il ne se passe pas vingt-quatre heures sans que le pays soit
« marmité » et souvent de belle façon. Tous les calibres sont bons pour jeter à bas une muraille, défoncer un plafond et nous avons vu des 380 et des 420 tomber sur des amas de décombres, de matériaux de toutes sortes, creusant des entonnoirs larges et profonds. Au loin on les entend venir ces
« wagonnets » qui semblent glisser sur des rails, — c’est du moins le bruit qu’on perçoit, — et qui tombent, énormes, comme des barriques, répandant une fumée noire qui forme un petit nuage à chaque explosion.
C’est donc dans les caves de quelques maisons qui subsistent éventrées, laissant entrevoir à nu, des intimités violées, que les zouaves se réfugient.
Pour se coucher le plus commodément possible, — car il n’y a pas à insister, le confort est inconnu, — les débrouillards se sont ingéniés à réunir tout ce qu’ils ont pu trouver dans les habitations désertes : sommiers, matelas, canapés, fauteuils, chaises longues, tout a été « mobilisé » et déposé un peu au hasard. Du reste, les bataillons se succèdent dans ces baraquements de fortune, les hommes changent, mais il est rare que les lieux soient dérangés.
C’est assez compréhensible en somme. Les relèves s’effectuent naturellement de nuit. À leur arrivée, les troupiers sont fatigués ; non pas par la durée de l’étape, — il n’y a que quelques cents mètres à faire, — mais par la marche difficile dans les boyaux remplis de sable où l’air manque et où le sac avec tout le fourniment pèse aux épaules. Et puis en « première ligne » on ne dort pas à son aise, tout équipés, chaussés, dans
les « guitounes » où il est assez difficile de s’étendre. La perspective d’un repos de plusieurs heures sans avoir à craindre d’être réveillé par le caporal pour la garde aux créneaux, active le désir de goûter au sommeil réparateur. Chacun déboucle son sac où il se trouve, au petit bonheur. Tout naturellement les camarades, les amis, se sont trouvés rassemblés. On prépare son… coin. Et c’est avec rite que certains étendent leur toile de tente, disposent leur sac qui sert d’oreiller, avec quelque vêtement dessus pour éviter d’avoir la tête trop au dur, arrangent leur couvre-pieds, leur capote aussi, puisque maintenant les zouaves ont troqué leur capuchon légendaire pour prendre la capote du « biffin », ce qui, à la vérité, leur faisait faire la grimace au début, — pensez-donc, ressembler à un fantassin ! — mais dont ils ont pu apprécier la commodité en maintes occasions.
Le lendemain on est déjà habitué à « son coin » et on y reste sans chercher mieux, jusqu’au moment où il faut partir ailleurs. On déménage si souvent !
Dans la journée on prend l’air : la vie de taupes qui nous a été imposée n’est pas dans notre tempérament !
Les marmites boches viennent alors, inopinément, à pleuvoir. Croyez-vous qu’aussitôt tout le monde a rejoint son trou ? Pas du tout : l’insouciance règne en maîtresse ; on regarde en l’air pour savoir « d’où ça vient ».
— Peuh ! un 77 seulement ! Ah ! ah ! voilà du 105 maintenant, du 210 ! à la bonne heure !

À quinze mètres des Boches. Le périscope de tranchée (cliché Maurice Dormann)
Le plus souvent les obus tombent sur les amas de pierres ; quelquefois un pan de mur qui ne tient plus que par un miracle d’équilibre, |2 troué déjà, s’effondre. On « s’amuse » à juger les coups ; et c’est à grand’peine que les officiers font rentrer les imprudents.
Hélas ! des accidents sont parfois à déplorer ! surpris, des hommes en train de jouer comme des enfants, sont atteints, soit par des éclats de projectiles, soit par les matériaux qui volent sous les coups.
Et c’est ainsi qu’un brave camarade a été tué stupidement… Dans la cour du poste de secours, la mise en bière a eu lieu.
Maintenant, les vaillants tués à l’ennemi ont les honneurs du
cercueil… On ne trouve même plus étranges les « réserves » des sinistres boîtes au couvercle verni avec la croix noire peinte dessus.
Baïonnette au canon, les camarades de l’escouade rendent les honneurs. Derrière, presque toute la compagnie.

L’entrée d’un boyau (cliché Maurice Dormann).
Comme elle est impressionnante cette scène, simple et cruelle, sans apparat ! Les rudes figures ont des tics nerveux qui cachent difficilement l’émotion ; les yeux sont gonflés, les poitrines sont haletantes… Tous sont pourtant des braves qui chaque jour défient la mort, ricanent à sa menace et volontiers lui font la nique. Que voulez-vous, il n’y a plus le feu de l’action, on redevient humain et la vue de ce corps sur le
brancard qui sert de catafalque, — ce brancard où tant de vaillants ont déjà été couchés, — émeut à un suprême degré.
Sous la robe noire, couverte de l’aube blanche de l’officiant, on distingue la forme du pantalon de zouave, dont on aperçoit devant, la tente verdâtre. A sa main, sous le livre de messe, se balance une chéchia… Prêtre-soldat !... A côté, un autre zouave, portant d’une main un petit seau d’eau bénite et de l’autre une croix rustique, sur laquelle un sapeur s’est appliqué pour inscrire en gothique irrégulière : Requiescat in Pace !
Silence impressionnant pendant la prière des Morts ! Et bientôt le convoi se forme pour aller au cimetière.
Car il y a maintenant un cimetière, dans les dunes nivelées pour la circonstance, nettoyées, propres. Des lignes ont été tracées, derrière la grande croix de bois qui a été érigée et sur laquelle une inscription se détache fièrement :
Dieu et Patrie
Morts au Champ d’honneur qu’ils dorment en paix Priez pour Eux !
Une à une les fosses se sont alignées, — trop vite, hélas !... — les rangs se sont formés… Comme elles sont nombreuses maintenant les petites croix de bois uniformes qui se dressent à la tête des tombeaux et portent des inscriptions qui permettront aux familles, plus tard, de retrouver les corps de leurs chers disparus !
Les pieuses mains d’amis, des frères d’armes, soignent ces tombes. Des fleurs, — pourtant fort rares dans cette région actuellement, — achèvent de se faner sur les tertres encore tout
frais. Des couronnes, fruit de collectes, portent un adieu s’effaçant lentement, sous l’action du temps, du ruban jadis tricolore dont les vives couleurs s’éteignent peu à peu :
La …e compagnie du …e zouaves à son camarade X… mort en brave !
La plaque d’identité est clouée à la croix et cette identité est de plus contrôlée p r l’état-civil méticuleusement inscrit et enfermé dans une bouteille dont le goulot est fiché en terre.
Dans les villas détruites, les carreaux de mosaïque, des plaques de marbre de cheminée, ont été recueillis et forment des croix. Des entourages sont parfois élevés avec des bois de lit… des berceaux… Les ornements les plus hétéroclites, les plus bizarres, n’y semblent pas déplacés car on sent l’intention qui les a amenés là.
Quelques tombes n’ont pas de croix. Elles ont droit à notre respect néanmoins, comme les autres, car la bravoure n’a pas de religion et dans les troupes d’Afrique les races sont si mêlées ! Une certaine ombre pourtant. Une question monte tout naturellement à l’esprit. Pourquoi les officiers tombés si vaillamment au feu, ne sont-ils pas avec leurs hommes, ici, unis aussi étroitement dans la mort qu’ils le furent au cours de leur vie de combats ? Pénible constatation : plus loin à l’arrière, à quelques kilomètres, un cimetière spécial a été réservé pour les corps des officiers… Et nous sommes persuadés que l’âme de certains doit en souffrir !...
… Devant la tombe ouverte et dans laquelle, aujourd’hui, nous allons coucher notre camarade, l’aumônier dit les dernières prières et d’un geste large jette quelques gouttes d’eau bénite.
Un jeune officier de section du regretté disparu, s’avance et parle. D’une voix étranglée par l’émotion, — c’est la même pourtant qui ne tremble pas quand devant la mitraille elle crie :
« En avant ! » et entraîne magnifiquement les poilus, — il dit un dernier adieu, touchant, plein de sincérité. Certes, remarque- t-il, ce héros n’a pas eu la mort qu’il aurait souhaitée, face à l’ennemi, bien droit, et qui, ironie du sort, a été fauché aussi stupidement… Il évoque la douleur de la jeune veuve et le malheur navrant de sa fillette qui n’aura jamais, — jamais ! — connu son cher papa…
Les yeux sont rouges.
Pleurez librement, braves soldats, pleurez… Ces larmes-là sont nobles, elles peuvent rouler sans honte sur vos rudes visages, dans le poil de vos moustaches ! Dans votre âme vient de passer un grand frisson. Vous avez vu aussi, vous, en écoutant ces paroles, comme dans ma chère et douce vision, un visage éploré de femme, des yeux bleus, des boucles blondes… Vous avez vu cela rapidement, pendant que vous perceviez un pincement au cœur… vous en avez été profondément remués, et vous avez senti… vous avez compris la douleur des êtres chers, de tous ceux qui là-bas, — comme cela semble loin ! — toujours en éveil, redoutent à chaque minute l’annonce d’une mauvaise nouvelle et tremblent toujours…
Pleurez, braves gens ! Cette minute vous appartient pour cela. Tout à l’heure, après avoir jeté une poignée de sable sur la bière de votre camarade, vous allez reprendre votre rude vie, vous allez reprendre votre indifférence en même temps que votre fusil, votre courage en même temps que votre place dans le rang.
Pleurez, braves gens !... ça fait du bien… ça soulage…
Dans la petite église de briques, presque neuve, toute pimpante, le soleil entre à flot. C’est que ses vitraux n’existent plus. Si les murs, — par quel hasard ou quel miracle, — sont encore debout, tout ce qui était fragile a sauté. Les verres ont volé en éclats sous les explosions. Quelques marmites seulement ont frappé la maison de Dieu.
Des chaises sont encore groupées devant l’autel où le dimanche la messe est dite. La chaire a été enlevée ; les niches sont vides de leurs saints et seul un grand Christ descend du plafond, devant le chœur aux enluminures naïves et crûment coloriées.
Passons vite devant la dalle… souillée… où trop de corps sont amenés avant d’être conduits au champ de repos…
Autour de cette église, encore deux cimetières. Ceux-là, sont moins réguliers que celui nouveau des zouaves, sont plus émotionnants encore. On sent la hâte apportée pour donner aux morts une sépulture digne d’eux.
Disons, en passant, qu’au début de la campagne en tranchées on ne pensait pas à tout, on n’avait pas le temps du reste et les corps étaient inhumés où ils tombaient ; des croix en marquent les emplacements et ces sépultures, qui sont entretenues avec soin, inspirent le plus grand respect aux combattants.
L’esprit méthodique adopté maintenant n’avait pas encore présidé dans l’établissement de ces premiers cimetières. Nous voyons qu’ici toutes les armes ont été réunies : zouaves, tirailleurs, territoriaux, marins, artilleurs, fragons, cuirassiers, hussards… Il y a de tous les corps de troupe. Au-dessus s’élève encore une grande croix en bois sur laquelle des drapeaux qui cachent à demi l’inscription :
Pro Patria
sont décolorés et déchiquetés peu à peu par les rafales.
On retrouve les mêmes attentions touchantes sur les tombes sont les arrangements sont plus bizarres encore que dans le nouveau cimetière où l’ordre s’est en quelque sorte imposé. Tout a été bon aux mains des camarades pour orner les chers tombeaux, tout ce qui a été trouvé dans les maisons de la ville. Voici des statuettes de Vierge, des Christ, des gravures encadrées, des vases, des tulipes et des verroteries de lustres électriques, des porte-parapluies, des boules de rampes d’escalier et de cuivre de lit, etc., etc… Pourtant rien ne choque, une poésie troublante se dégage de l’ensemble disparate. On évoque l’image du soldat penché sur le tumulus, disposant les carreaux de mosaïque, et souvent on est étonné, surpris, de l’ingéniosité de cette ornementation, naïve et pleine de cœur. Malgré soi on se sent étreint d’une tristesse immense…
Comment ne se sentirait-on pas bouleversé devant cette croix où le mot :
Inconnu
se détache à la place du nom ! Hélas ! elles sont trop nombreuses celles-là ! Et pourtant elles ne sont pas abandonnées, ces tombes, des fleurs y ont été piquées, elles ont, elles aussi, leurs ornements.
Combien d’attentions délicates !
Regardez cette inscription : Soldat belge inconnu… et le drapeau national de ce pays qui a fait l’honneur du monde est déployé sur la terre nue, résistant aux intempéries.
Et plus loin cette autre : Marin anglais inconnu !
Celle-là rappelle des souvenirs effrayants qu’on n’évoque pas sans frissonner…
Une nuit du printemps dernier, les zouaves en sentinelles au bord de la mer perçurent avec angoisse des cris étouffés semblant venir du large. Puis ces cris, ces plaintes, se précisèrent, dominant le bruit des flots :
— France… an… ce… France !...
C’était un râle affolant, sourd, désespéré, horrifiant…
Tous les hommes du poste étaient accourus. Le cou tendu, les oreilles rabattues pour mieux entendre, les yeux cherchaient à percer les ténèbres. Impossible d’aller voir, impossible d’essayer de porter secours à ces appels douloureux et le désespoir au cœur, haletants, nos zouaves restaient figés, glacés d’épouvante, n’osant se parler, emplis d’une immense pitié, impuissants devant le drame qui se déroulait en face d’eux, à quelques mètres peut-être…
Et lendemain sur la plage, la mer, cette mangeuse d’hommes, avait rejeté sur le sable des corps raidis par la mort… des cadavres de matelots anglais, échappés d’un combat naval dans le Nord, et qui étaient venus échouer là, si près du salut, après des efforts sans nul doute surhumains, une lutte effroyable contre la mort…
Et depuis ils dorment leur dernier sommeil, les marins alliés, au milieu de ceux avec lesquels ils luttaient contre le Barbare, l’ennemi commun…
Femmes de France ! Epouses, filles, sœurs, mères et vous tous, parents aimés ! pleurez vos morts chéris !...
Les héros glorieux dorment au milieu de nous. Leurs dépouilles sont à l’abri dans cette terre qu’ils ont vaillamment défendue, arrosée de leur sang. Avec un soin jaloux nous veillons sur eux. Chaque fois que nous passons à côté d’eux, instinctivement nous tournons les yeux : du fond du cœur nous les saluons… Chaque fois que nous le pouvons nous allons les voir, leur rendre hommage…
Et cette visite revivifie notre courage, avive notre désir de vaincre, fait contracter nos poings, stimule nos énergies, réveille nos cœurs…
Nous sentons que leurs âmes tressaillent à ce contact immatériel, pur et réconfortant dans cette vie d’enfer et que le souffle qui passe dans nos âmes est plus puissant encore que la voix tonnante de la mitraille qui hurle autour de nous.
Dormez en paix, les morts !
Pleurez, parents chéris ! La dépouille sacrée de vos enfants, de vos maris, de vos pères, de vos fiancés, de vos frères, est honorée et vous pourrez un jour, — prochain nous l’espérons,
— aller vous-mêmes vous agenouiller sur leurs tombes. Pleurez… jusque-là nous saurons vous les garder…
Maurice DORMANN.
Dans les Tranchées (Belgique), juillet 1915.
Première blessure (octobre 1915) 34
Nos Blessés
Chacun de nous a tressailli en apprenant le brillant succès qui vient couronner nos armes en Artois et surtout en Champagne, où nos ennemis ont subi des pertes évaluées officiellement à trois corps d’armée. Malheureusement toute médaille a son revers, il faut nous attendre à voir s’allonger la liste des vaillants de notre région qui ont acheté de leur sang cette victoire.
L’Abeille-Réveil d’Etampes vient d’être éprouvé une fois de plus en la personne d’un de ses directeurs, M. Maurice Dormann, caporal au 1er zouaves, qui a subi une violente commotion par suite de la chute d’un obus tombé près de lui. Après être resté plusieurs heures sans connaissance, notre ami a été relevé, le bras paralysé et il a dû être évacué d’urgence sur l’hôpital d’une formation sanitaire à Valognes (Manche).
Nos lecteurs, qui ont pu apprécier dans les récits vécus que Maurice Dormann nous écrivait sur le front de Belgique, le talent de notre directeur, feront comme nous des vœux pour son prompt rétablissement.
34 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 66, samedi 2 octobre 1915, p. 3.
Cinquième reportage (oct. 1915) 35
L’« Abeille-Réveil » sur le front
Plusieurs de nos lecteurs nous ont fait le plaisir de nous demander des nouvelles de M. Maurice Dormann, que, dans notre dernier numéro, nous signalions comme évacué.
Notre ami a bien voulu se charger de dire lui-même à nos lecteurs qu’il espère pouvoir bientôt reprendre son poste de combat.
*
Une sensation de bien-être… Le silence… Le grand jour… Maintenant je suis tout à fait éveillé. Mes yeux étonnés sont
éblouis dans cette salle toute blanche, si gaie. Je suis couché dans un de ces bons lits qui sont alignés. Que c’est bon de se sentir dans des draps blancs !
35 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 67, samedi 9 octobre 1915, p. 1.
Ce n’est donc pas un rêve : je me souviens de tout parfaitement et me plais à revivre tous ces jours derniers si bouleversés.
Evacué !
Eh oui, évacué. Jamais ce mot n’a sonné à mes oreilles de cette façon.
Là-bas, dans la Somme, entre deux pauvres pays tout dévastés qui, tous ces jours derniers, ont eu les honneurs du communiqué, nous étions occupés à faire des travaux, en vue, sans aucun doute, d’une attaque prochaine. Devant les premières lignes nous avions ouvert des sapes qu’on réunissait pour faire une parallèle de départ.
Tout allait bien le premier jour, ou plutôt la première nuit où ces travaux furent commencés. Les voisins d’en face étaient sans doute loin de soupçonner cette audace. Mais bien vite leurs patrouilles nous ont éventés. Une grande route nationale que nous avions coupée était un point de repère merveilleux et bientôt les rafales de fusants nous arrivaient à tout moment.
Pourtant le courage ne se ralentissait pas un instant. Autant pour lutter contre la fraîcheur des nuits qui déjà commence à se faire sentir, que dans l’espoir d’une prochaine marche en avant qui semble à tout préférable à la vie que nous menons depuis si longtemps, tout le monde travaillait de bon cœur. Quand les obus arrivaient, instinctivement on courbait la tête, vite pourtant les plaisanteries reprenaient. Il y avait bien aussi, disons-le, quelques mouvements d’impatience, de lassitude, de
« grognements » ; mais le caractère français pourrait-il se manifester autrement ? N’est-ce pas là encore une preuve de
« tempérament » ? Si on pouvait les tenir ces sales Boches ! Ils
paieraient cher, aux autres, tous les mouvements de mauvaise humeur !
Comme on était heureux quand nos amis les artilleurs leur envoyaient de ces bordées de 75 ou de 90, ainsi qu’il est de coutume maintenant chaque jour ! Ah ! on n’est plus au temps où les munitions rares, on comptait avec parcimonie les projectiles. Les rôles ont changé et ce n’est que faiblement que répondent les batteries boches aux nôtres. C’est réconfortant, croyez-le, ça donne de l’espoir.
On comptait les jours. Les travaux sont pénibles et c’est avec satisfaction qu’on en voyait la fin prochaine. Des régiments arrivaient et se massaient derrière et de chaque côté de nous. Pour avoir de la place dans les « guitounes », ceux qui partaient au travail ou comme sentinelles étaient obligés de laisser leur place à ceux qui en revenaient ; il fallait donc, à chaque relève, transporter tout son « barda » et ce n’était pas là, la moindre raison de rouspétance.
L’activité était calme malgré tout. Le canon tonnait sans interruption, la fusillade crépitait continuellement, les mitrailleuses faisaient entendre leurs « ta, ta, ta, ta » réguliers. Rien n’émotionnait. Tout cela semblait normal. Pourtant, des dialogues significatifs s’engageaient :
Ça sent le brûlé par ici !
Ah oui ! c’est bientôt qu’on va en mettre un coup !
… Et j’ai dû quitter tout cela brusquement pour une malheureuse petite anicroche au poignet droit. Pendant huit jours j’ai refusé de me laisser évacuer, espérant que « cela » s’arrangerait. Finalement j’ai dû me laisser faire.
Sans forfanterie, c’est à regret que je suis parti de ces tranchées inondées par la pluie, où on patauge dans la boue sans faire autrement attention : il n’y a que le premier pas qui coûte.
Je me considère comme un spectateur qui arrive au théâtre, supporte patiemment l’agacement de l’attente, cette chose horripilante qu’est l’accord des violons, et qu’on expulse de la salle au moment où le rideau va se lever !
Court séjour à l’hôpital de Montdidier où nous avons été amenés — cinq — dans une automobile anglaise. Là se fait le tri des évacués. Les blessés d’un côté, les malades de l’autre. Je suis de la première catégorie.
Rapidement nous sommes identifiés. Un petit carton est accroché à notre boutonnière.
Débarrassé de tout notre fourniment nous voici dans une autre automobile. Arrêt dans un hôpital-annexe. Dans un jardin ravissant une tente est montée, spacieuse, gaie, propre. Des lits de repos attendent. On nous sert un repas qui est, ma foi, fort apprécié : potage, veau rôti, pommes sautées, chocolat… C’est bon tout ça !
On est gâté vraiment. Déjà l’entr’aide mutuelle se manifeste. Plus de malades parmi nous, tous blessés aux mines, ma foi, plutôt réjouies ; les boiteux coupent la viande de ceux qui ont un bras immobilisé.
On rit, un peu nerveusement peut-être encore.
— C’est calme ici, dit l’un.
C’est vrai. On sent bien qu’il y a quelque chose d’anormal mais on ne se rend pas compte que c’est le bruit du canon, les
coups de fusil, le crépitement de la mitrailleuse qui manquent à nos oreilles. Et ça semble tout drôle de ne plus rien entendre.
Nous voici à la gare. Là, dans des hangars aménagés assez confortablement, nous passons la nuit et nous attendons le train sanitaire qui doit nous emmener on ne sait où.
A 2 heures de l’après-midi, appel. Chacun reçoit un carré de papier sur lequel est inscrit le numéro de son compartiment. L’embarquement se fait d’une façon calme. Ce qui est plus long c’est le transbordement de ceux qui sont couchés et qu’on amène sur des brancards.
Nous partons. Le grand train — aux drapeaux de la Croix- Rouge et tricolores et qui porte la mention « Train B. Ephrussi », — le grand train s’ébranle lentement.
Arrêt à Compiègne où de nouveaux blessés et malades sont recueillis.
Dîner. Tout le monde est gai, — ou s’efforce de l’être. Ne croyez pas que c’est un gémissement perpétuel dans ces wagons. Non. On cause, on se connaît déjà. Lignards, artilleurs, zouaves, sapeurs du génie, territoriaux, tous fraternisent. Chacun connaît l’histoire de l’autre, sa blessure, l’endroit où il a été blessé — « Ah ! oui, c’était moche là ! » —, son pays d’origine.
A Aubervilliers ! Les dames de la Croix-Rouge courent le long du train. Se seraient elles cru si fortes ces vaillantes femmes qui transportent de lourdes marmites de bouillon ou de grands paniers de blanchisseuses remplis de pain ou de friandises ! Elles vont, la bonne humeur aux lèvres et, certes, nous sommes plus heureux encore de leurs bonnes paroles, de
leurs gracieux sourires, que de ce qu’elles nous apportent. Tous ceux qui ont vécu ces heures ne les oublieront jamais. Malgré soi on est ému profondément, à tel point qu’on ne sait remercier. Mais les yeux de ces bonnes fées ont lu dans nos yeux : c’est à qui semblera le plus heureux de celui qui reçoit ou de celle qui donne ! On est si peu habitué à être ainsi gâté, cajolé. Il y a si longtemps qu’on n’a vu un sourire de femme !
Au Bourget, où nous stationnons pour être finalement aiguillés sur la bonne voie, même accueil, et pourtant il fait nuit. À Achères, les mêmes braves femmes, au voile blanc, — ou leurs sœurs, elles doivent routes être sœurs, — sont désolées. Pensez donc, on ne les a pas prévenues du passage de ce train de blessés et elles sont prises au dépourvu. Elles se hâtent néanmoins, mais elles ne cessent de répéter :
— Pourquoi ne nous a-t-on pas prévenues ?
Mantes ! Maintenant nous savons que nous allons dans la direction de Cherbourg.
Evreux. Si nous dormions un peu. Chacun s’arrange dans son coin. Le silence se fait. Mais personne ne peut s’endormir. Les éléments précipités des dernières quarante-huit heures reviennent aux esprits.
Au petit jour tout le monde est aux portières après un léger sommeil. On veut voir. Il y a si longtemps qu’on n’a vu de pays dont les maisons sont toutes intactes. Et puis c’est dimanche, aux portes, aux fenêtres, de la moindre maison, les femmes, les enfants, les vieillards, — les jeunes hommes ne sont-ils pas tous là-bas ? — nous font des signes d’amitié. Quelles minutes d’émotion encore !
Que de spectacles touchants !
Dans les faubourgs de Lisieux, une petite fille d’une dizaine d’années est sortie vite de son cher dodo. Elle est accourue pour
« voir les blessés », pieds nus, dans sa grande chemise de nuit, ses pauvres petons sont tout roses dans la rosée, ses cheveux flottent sur son dos. Elle agite sa petite main, puis envoie des baisers… à deux mains. A côté d’elle la maman est accourue, tout de noir vêtue. On a le temps de voir que des larmes brillent dans ses yeux. Peut-être cette vision rapide que nous emportons, cache-t-elle un de ces drames comme il y en a tant actuellement…
Que de gestes émouvants sur tout le parcours. Machinalement un garde-voie aux cheveux blancs a porté les armes et tient la position pendant tout le passage du train.
Lisieux ! Caen ! Valognes ! Me voici arrivé à destination dans cette dernière ville.
Je m’entends appeler. Et j’ai ta joie de serrer la main d’un poilu de mon escouade évacué quelques jours avant moi, qui, un soir que nous étions au travail, a reçu un éclat d’obus dans l’épaule ; ce soir-là quatre zouaves avaient été atteints par le même projectile. Ce brave continue jusqu’à Cherbourg. J’aurais été content de l’avoir avec moi pourtant.
Par deux nous sommes amenés à l’hôpital où nous allons être soignés — l’hôpital 24 — installé dans un pensionnat. J’ai le plaisir d’y retrouver un sergent de mon régiment connu au dépôt à Saint-Denis, et un zouave de ma compagnie, blessé il y a quelques jours. Il sera donc plus facile de faire connaissance avec les autres camarades.
Maintenant, nous nous laissons dorloter par tous ceux qui nous soignent avec tant de bonté et de dévouement : le docteur médecin-chef a dans chacune de ses visites un mot réconfortant pour chacun ; on a confiance dans sa science mise tant de fois à épreuve depuis le début de la guerre ; quant aux infirmières, aux mille prévenances, aux mille petits soins, faut-il répéter ce qu’elles sont ? Femmes admirables, tout simplement ! Impossible d’en dire davantage.
Souvent nous parlons de ceux qui « là-bas » sont toujours sur le qui-vive. Nous pensons à eux à toute minute et lorsque la pluie vient attrister un peu plus la triste petite ville de Valognes, nous les voyons couverts de terre, trempés, toujours |2 vaillants… Alors on a la nostalgie de cette vie de tranchées où on rouspète tant et contre tout.
Pendant les quelques heures de liberté qui nous sont accordées, nous allons voir manœuvrer les soldats belges qui depuis l’invasion de leur pays viennent faire leur instruction ici.
Nous rencontrons aussi souvent dans les rues des enfants qui, jouent aux soldats, avec comme sac des boîtes de carton ondulé avec un petit seau à confitures en guise de gamelle. Les gosses s’arrêtent à notre vue et gravement nous présentent les armes avec leurs fusils et leurs sabres de bois. Aussi gravement nous rendons le salut, le cœur étreint malgré soi.
Ceux-là vaudront bien leurs aînés, on peut en être assuré. Plus tard… on verra, pour le moment, jouez braves gosses… nous travaillons pour vous !
Maurice DORMANN
Valognes, septembre 1915.
*
Les lecteurs de l’Abeille-Réveil apprendront avec plaisir que, par décision ministérielle en date du 5 juillet, publiée au Journal officiel du 9 juillet, notre directeur, M. Maurice Dormann, après un stage au centre d’instruction du camp de la Valbonne, est nommé sous-lieutenant au 4e régiment de zouaves.
La rédaction de l’Abeille-Réveil présente, à cette occasion, au nouvel officier ses sincères compliments.
*
36 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 107, vendredi 14 juillet 1916, p. 2.
Seconde blessure (décembre 1916) 37
*
La rédaction de l’Abeille-Réveil vient d’être de nouveau éprouvée. L’un de ses directeurs, M. Maurice Dormann, sous- lieutenant au e zouaves, a été blessé, à Douaumont, d’éclats d’obus aux deux genoux. Il est actuellement soigné dans une ambulance du front où il a été transporté.
Malgré certains bruits pessimistes qui circulent en ville et une réelle gravité de ses blessures, les nouvelles que M. Dormann a lui-même adressées à Mme Dormann, font espérer qu’elles n’auront pas de suites fâcheuses quoique la guérison en sera probablement assez longue.
On se rappelle qu’en septembre 1915, M. Maurice Dormann, alors caporal au 1er zouaves, avait subi une si violente commotion par suite de la chute d’un obus tombé près de lui, qu’il avait dû être évacué dans un hôpital.
En attendant d’avoir des nouvelles plus précises sur la santé de M. Maurice Dormann, que nous espérons satisfaisantes, tous nos lecteurs se joindront à nous, pour lui souhaiter un prompt rétablissement et la récompense qu’il a si vaillamment méritée.
37 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 127, samedi 2 décembre 1916, p. 2.
Légion d’honneur (mai 1917) 38
*
A plusieurs reprises, nombre de nos lecteurs nous ont fait l’honneur de nous demander des nouvelles de notre directeur,
M. Maurice Dormann, sous-lieutenant au 3e régiment de
zouaves, qui fut blessé si grièvement le 17 novembre dernier au cours de la défense de Verdun. Nous sommes heureux d’apprendre que notre ami s’achemine peu à peu vers la guérison et que depuis une huitaine de jours il se véhicule lui- même dans une petite voiture en attendant de pouvoir se servir d’une jambe artificielle ; mais ce que nous avons encore plus grand plaisir à annoncer, c’est que ce vaillant garçon vient de recevoir l’avis officiel de sa nomination de chevalier de la Légion d’honneur.
Cette distinction lui fut conférée le 20 novembre comme récompense de sa brillante conduite pendant l’attaque au cours de laquelle il fut blessé. Son état s’étant aggravé, il devait être amputé d’une jambe le 13 décembre et ce n’est qu’à son énergie peu commune qu’il put être sauvé d’une mort affreuse.
38 L’Abeille d’Étampes et Le Réveil d’Étampes, N° 149, samedi 5 mai 1917, p. 2.
Que Maurice Dormann fût brave, personne à Etampes n’en a jamais douté ; avant cette maudite guerre, il nous en a donné maints exemples : mais le texte de la citation suivante montrera que si notre ami fut atteint, c’est que conscient du rôle de l’officier, il veillait avant sa sécurité propre à la sécurité de ses hommes. On comprendra — les poilus surtout — que nous n’ayons pas à insister sur ce point, et nous pouvons dire que jamais croix d’honneur ne fut mieux méritée.
Voici le texte de la citation conférant à Maurice Dormann la Légion d’honneur et la croix de guerre avec palme :
Légion d’honneur Maurice DORMANN Ordre général n° 4736 – D
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Décision ministérielle n° 12285 K du 8 août 1914, le Général commandant en chef a fait, à la date du 20 novembre 1916, sans l’ordre de la Légion d’honneur, la nomination suivante :
Chevalier
DORMANN (Maurice), sous-lieutenant au 3e régiment de zouaves de marche, 18e compagnie.
« Officier modèle. Blessé au cours de la campagne ; a rejoint le front à peine guéri. A été atteint de nouveau d’une grave blessure le 19 novembre 1916, alors que, sous un violent bombardement, il veillait à ce que ses hommes soient à l’abri. »
La nomination ci-dessus comporte l’attribution de la croix de guerre avec palme.
Au G. Q. G. le 3 avril 1917.
Le Général commandant en chef.
Journal Officiel (mai 1917) 39
Le ministre de la guerre,
Vu le décret du 13 août 1914,
Arrête : Article unique. — Sont inscrits aux tableaux spéciaux de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, les militaires
dont les noms suivent : LÉGION D’HONNEUR […]
Pour chevalier.
(Pour prendre rang du 20 novembre 1916.)
DORMANN (Maurice), sous-lieutenant (territorial) à titre temporaire à la 18e compagnie du 3e rég. de marche de zouaves : officier modèle. Blessé au début de la campagne, a rejoint le front à peine guéri. A été atteint à nouveau d’une très
grave blessure, le 18 novembre 1916, alors que, sous un violent bombardement, il veillait à ce que tous ses hommes soient à l’abri. […]
39 Journal officiel de la République française. Lois et décrets 49/132 (15 mai 1917), p. 3891. Le dossier de Maurice Dormann n’était pas consultable en été 2015 sur la base Léonor en application de l’article 213-2 du Code du Patrimoine.
Ordre du régiment n° 377 du 15 septembre 1916 Citation à l’ordre du régiment
Dormann Maurice sous-lieutenant à la 19e compagnie
A fait preuve d’énergie et de sang-froid en opposant la plus vive résistance à une attaque de l’ennemi faite dans nos lignes avancées le 8 septembre 1916 ».
Aux armées, le 15 septembre 1916, le colonel commandant le 3e zouaves. Signé : Philippe |97 Ordre n° 4736 « D » (extrait)
Monsieur Dormann Maurice, sous-lieutenant territorial à T. T. à la 18e compagnie du 3e régt de marche de zouaves a été nommé dans l’ordre de la Légion d’honneur au grade de chevalier, avec la citation suivante :
40 Ville d’Étampes, Livre d’Or des combattants. Guerre de 1914-1918 (2 cahiers manuscrits ; 324 p.), ouvert en 1919 et clôturé le 7 décembre 1924, conservé aux Archives Municipales d’Étampes sous les cotes 4H66 et 4H67, t. 1, pp. 96-97 (saisie de Bernard Métivier, 2012).
« Officier modèle. Blessé au début la campagne, a rejoint le front à peine guéri. A été atteint à nouveau d’une très grave blessure, le 18 novembre 1916, alors que, sous un violent bombardement, il veillait à ce que tous ses hommes soient à l’abri ».
Pour prendre rang du 20 novembre 1916.
La présente nomination comporte l’attribution de la croix de guerre avec palme.
Au G. Q. G. le 3 avril 1917, le général commandant en chef.
p. o le major général. Signé : Pont
Nommé officier de la Légion d’honneur par décret du 8 novembre 1921.
Crédits photographiques
Page 1 de couverture : création de Bernard Gineste à partir d’un cliché de l’agence Meurisse de 1929 : Le député Maurice Dormann (BnF). – p. 1 : logo du Corpus Étampois dessiné par Gaëtan Ader. –
p. 10 : cliché Paul Royer de 1905 ou 1906. – pp. 18, 58 : cliché anonyme du 7 octobre 1912, sans doute dû à Eugène Rameau, de la collection Jean Minier. – pp. 20, 34-53, 55-56, 62-63, 90, 137 : scans de cartes postales anciennes d’éditeurs variés et le plus souvent non précisés, collectés par B.G. sur le site d’enchères en ligne Delcampe.
pp. 24-26, 57, 59-61 : quatre clichés pris par Maurice Dormann le 7 octobre et publiés le Réveil d’Étampes du 12 octobre (le troisième a été aussi publié comme carte postale par Eugène Rameau pendant plusieurs années), rephotographié sur l’exemplaire des Archives municipales d’Étampes. – p. 54 : cliché du 4 juin 1912 extrait de l’Écho d’Alger du 5 juin. – p. 74 : détail de la p. 1 du Réveil d’Étampes du 11 octobre 1913 (B.G. à la BnF). - p. 87 : détail de la
p. 1 du Réveil d’Étampes du 17 janvier 1914 (cliché B.G. à la BnF).
pp. 88, 178 : Scans de la couverture de 1.650 kilomètres en ballon (coll. B.G.) – pp. 135, 139, 168 : clichés et carte publiés d’abord dans le Réveil d’Étampes en janvier 1914 puis repris dans 1.650 kilomètres en ballon. – p. 175 : scan d’un entrefilet de l’Abeille d’Étampes du 4 janvier 1914 (site des AD91). – p. 185 : cliché mis en ligne par Bernard Métivier sur le site GenWeb – pp. 207, 210- 211 : Abeille-Réveil d’Étampes de 17 juillet 1915 (dont deux cliché de Dormann).
TABLE DES MATIÈRES | |
Préface | 3-4 |
01. Acte de naissance (1881) | 5-6 |
02. Acte de mariage (1905) | 7-9 |
03. Foire Saint-Michel (1912) | 10-17 |
04. Étampes en ballon (1912) | 18-34 |
05. Dossier photo (1906-1914) | 35-63 |
06. Foire Saint-Michel (1913) | 64-72 |
07. La nuit en ballon (1913) | 74-85 |
08. 1650 km en ballon (1913-1914) | 87-178 |
09. Fiche matricule | 179-182 |
10. Départ pour le front (1914) | 183 |
11. In memoriam (1914) | 185-188 |
12. Premier reportage (1915) | 189-192 |
13. Deuxième reportage (1915) | 193-196 |
14. Troisième reportage (1915) | 197-205 |
15. Quatrième reportage (1915) | 207-218 |
16. Première blessure (1915) | 219 |
17. Cinquième reportage (1915) | 221-228 |
18. Promotion (1916) | 229 |
19. Seconde blessure (1916) | 231 |
20. Légion d’honneur (1917) | 233-234 |
21. Au Journal Officiel (1917) | 235 |
22. Au Livre d’Or (1919) | 237-238 |
Crédits et Table des matières | 239-241 |
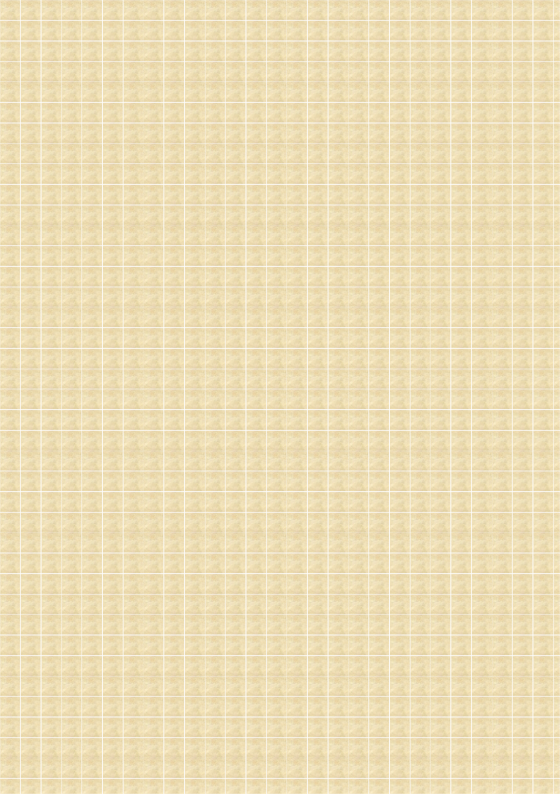
Publication du Corpus Étampois,
Directeur de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
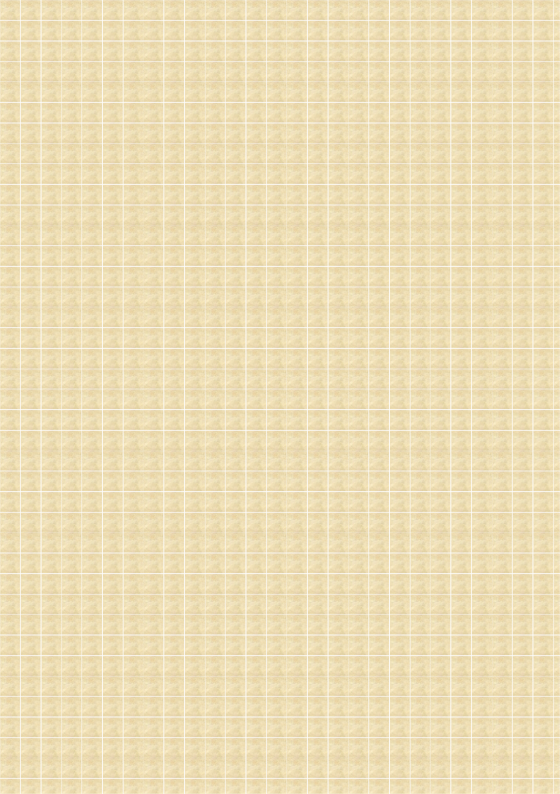
BHASE n°18 (juillet 2015)
Préface | 3-4 |
01. Acte de naissance (1881) | 5-6 |
02. Acte de mariage (1905) | 7-9 |
03. Foire Saint-Michel (1912) | 10-17 |
04. Étampes en ballon (1912) | 18-34 |
05. Dossier photo (1906-1914) | 35-63 |
06. Foire Saint-Michel (1913) | 64-72 |
07. La nuit en ballon (1913) | 74-85 |
08. 1650 km en ballon (1913-1914) | 87-178 |
09. Fiche matricule | 179-182 |
10. Départ pour le front (1914) | 183 |
11. In memoriam (1914) | 185-188 |
12. Premier reportage (1915) | 189-192 |
13. Deuxième reportage (1915) | 193-196 |
14. Troisième reportage (1915) | 197-205 |
15. Quatrième reportage (1915) | 207-218 |
16. Première blessure (1915) | 219 |
17. Cinquième reportage (1915) | 221-228 |
18. Promotion (1916) | 229 |
19. Seconde blessure (1916) | 231 |
20. Légion d’honneur (1917) | 233-234 |
21. Au Journal Officiel (1917) | 235 |
22. Au Livre d’Or (1919) | 237-238 |
Crédits et Table des matières | 239-241 |