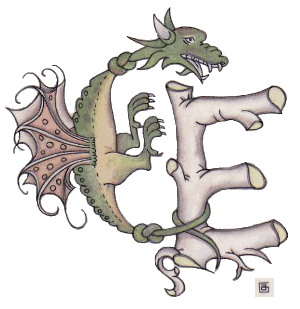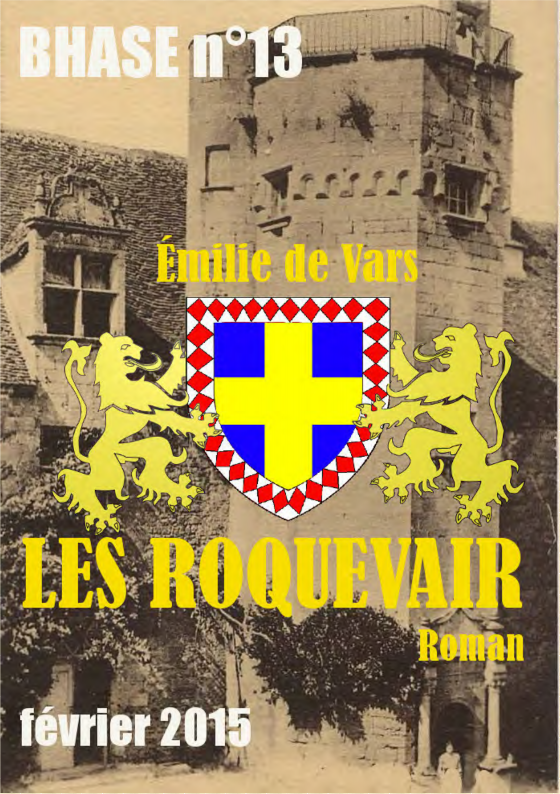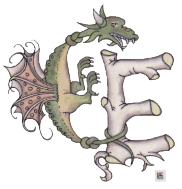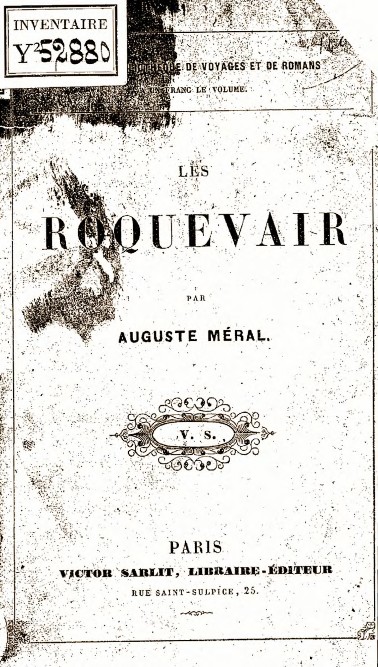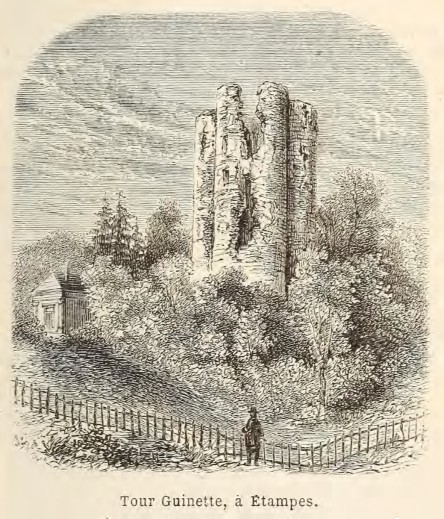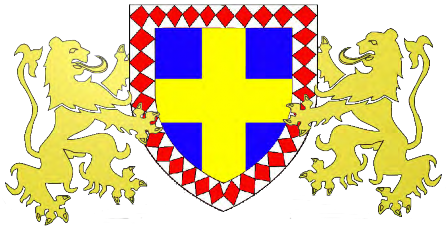|
BHASE n°13
(février 2015)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page est une simple
reversion automatique et inélégante au format html
d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne),
pour la commodité de certains internautes et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de
ce numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase013w.pdf
|
|
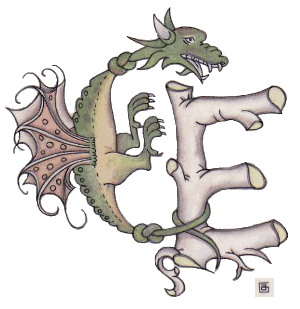
|
|
Préface
|
5-6
|
|
CH.
I. Quel agréable souvenir je conserverai...
10-17
|
|
CH.
II. Madame de Berthonville avait entrepris…
18-21
|
|
CH.
III. Un soir la fille de madame Prémian….
22-29
|
|
CH.
IV Le dimanche suivant l’abbé vint seul…
30-34
|
|
CH.
V Transportez-vous sur les confins de la Hte-Vienne…
35-46
|
|
CH.
VI. C’était le 21 février 1814…
47-56
|
|
CH.
VII. Au commencement des guerres de religion…
57-62
|
|
CH.
VIII. Dans les dernières années du règne de Louis XIV… 63-69
|
|
CH.
IX. Louise avait trop de pénétration…
70-77
|
|
CH.
X. Nous avons laissé les deux enfans…
78-89
|
|
CH.
XI. Une des phases de la destinée de l’Empire…
90-99
|
|
CH.
XII. Vraiment, Paul, les sept ans qui se sont écoulés…
100-108
|
|
CH.
XIII. Ma mère, mon ami, a fort mal accueilli…
109-122
|
|
CH.
XIV. C’est M. Jacques qui veut acheter Roquevair… 123-129
|
|
CH.
XV. Mon douloureux sacrifice est accompli…
130-131
|
|
CH.
XVI. Paul était à la fois une nature énergique et faible…
132-141
|
|
CH.
XVII Ma destinée est irrévocablement fixée…
142-153
|
|
CH.
XVIII. Le lendemain de ce jour si douloureux…
154-158
|
|
CH.
XIX. Louis sortit de l’hôtel : Paul monta…
159-185
|
|
CH.
XX. Quelques années se sont écoulées…
186-193
|
|
CH.
XXI. Depuis plusieurs années, Alger était…
194-211
|
|
CH.
XXII. La vicomtesse de Roquevair à madame…
212-215
|
|
CH.
XXIII. Le vicomte de Roquevair avait reçu…
216-220
|
|
Annexe
Émilie de Vars
222-231
|
|
Crédits
232
|
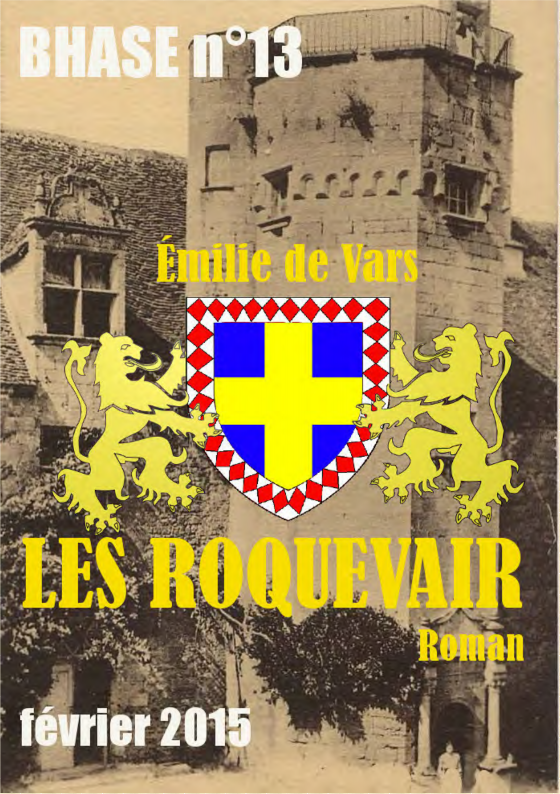
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE
n°13
Bulletin
historique et archéologique du Sud-Essonne
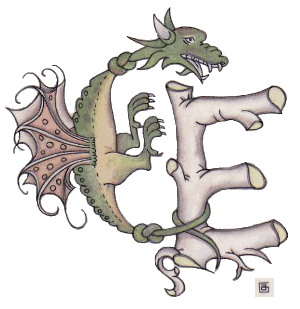
Publié par le
Corpus Étampois
février
2015
Émilie
de Vars
LES
ROQUEVAIR
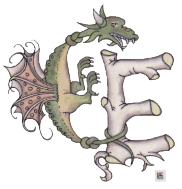
Corpus
Étampois
1860-2015
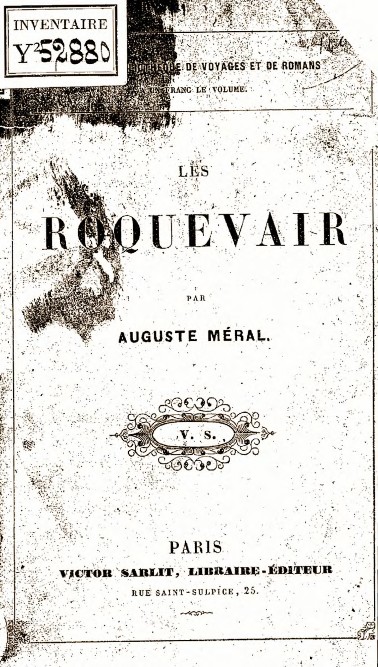
Préface
On
donne ici un roman publié en 1860, sous le pseudonyme d’Auguste Méral, et
qu’on doit en réalité à une certaine Émiile de Vars, personnage tout à fait
atypique et des plus pittoresque, alors âgée d’une cinquantaine d’années.
Ce
qui donne le droit à ce roman d’être publié dans le Corpus Étampois,
c’est que le narrateur prétend avoir eu vent de ce qu’il raconte à l’occasion
de soirées passées dans un salon étampois, celui d’une certaine madame
de Berthonville. Il y rencontre à plusieurs reprises le personnage principal
du roman, Paul Sardan de Roquevair.
Madame
de Berthonville, et certains de ses familiers, sont certainement calqués
pour une part sur un cercle bien réel du pays d’Étampes, qui reste à identifier,
mais avec lequel l’auteur aura eu quelque relation effective vers ce temps-là.
Mademoiselle
Émilie de Vars, qui s’appelait en fait Émilie Dévars, ne s’est pas mariée.
Née en 1810 dans le département la Charente, elle y a rencontré dès 1832
un prêtre catholique tout à fait remarquable, auquel elle s’est attachée
pour tout le reste de sa vie, de manière parfaitement platonique.
Jean-Hippolyte
Michon, prêtre atypique, fondateur d’une congrégation, libéral, républicain,
gallican impénitent, ouvertement hostile au dogme de l’infaillibilité papale,
archéologue patenté, prédicateur distingué, romancier et, pour finir, inventeur
de la graphologie, a dominé toute la vie d’Émilie de Vars.
Après
l’éviction de l’encombrant énergumène par son évêque charentais, Michon s’installe
à Paris où il partage le logement d’Émilie de Vars en tout bien tout honneur.
Elle partage quant à elle sa piété éclairée, ses goûts littéraires et archéologiques,
ses combats théologiques et politiques, et ses recherches graphologiques.
Elle écrit comme lui des romans, des pamphlets, et des articles savants.
Nous
livrons à l’attention du public et aux recherches des historiens locaux ce
roman curieusement lié au pays étampois. On y trouve deux prêtres bons et
doués, curieux et savants, aimables et diserts, que tout le monde aime et
admire. Faut-il dire qui en est l’archétype ? Même le jeune héros est un
avatar évident de Jean-Hippolyte Michon, avec son vaste front, son front
« très-bombé », et son origine corrézienne.
Il
reste à établir quel lien exact entretenaient Jean-Hippolyte Michon et Émilie
de Vars avec le pays d’Étampes, en ce milieu du XIXe siècle. L’enquête est ouverte.
Bernard
Gineste, mars 2015
MÊME
LIBRAIRIE.
NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE DES FAMILLES
CHAQUE
OUVRAGE EN UN VOLUME IN-12.
L’art
de la conversation au point de vue littéraire et chrétien,
par le R.
P.
Huguet, deuxième édition.
De
la charité dans la conversation, par le même auteur, deuxième
édition.
Du
bon langage et des locutions à éviter, par madame
la comtesse
Drohojowska, née Symon de Latreiche.
Du
luxe au point de vue de la religion, de la famille et des
pauvres, par le
R.
P. Huguet.
Politesse
et bon ton, Devoirs des jeunes femmes chrétiennes dans le monde, par
madame la comtesse Drohojowska, née Symon de Latreiche, deuxième
édition.
Les
soirées de charité, par madame la comtesse Drohojowska.
La
famille Dumonteil, ou Explication des sept sacrements,
par madame
Marie
de Bray, deuxième édition.
Cours
de lectures morales composés des plus beaux traits tirés des auteurs
sacrés et profanes, et propres à mettre en relief les vertus chrétiennes,
par M. Alp. Fresse-Montval ; quatrième édition, approuvée par Mgr
l’archevêque de Paris.
La
morale au coin du feu, ou Simples Récits et Conseils appliqués au Décalogue,
suivis d’un choix de Poésies, par Caron.
Le
pouvoir de la charité, ou Blanche et Mathilde, par madame Marie de
Bray, seconde édition.
La
religion, ou l’Aveugle de la vallée de Brunoy, par madame Marie de
Bray.
Vacances
en famille, récits historiques, anecdotiques et légendaires, pour édifier,
instruire et récréer la jeunesse, par M. Buron, sous-bibliothécaire
à Sainte-Geneviève, deuxième édition.
L’Ange
du pardon, ou Henriette de Tezan, épisode de la maison de Saint-Cyr,
par madame Marie de Bray.
CORBEIL,
typ. et stéréot. de CRÉTÉ.
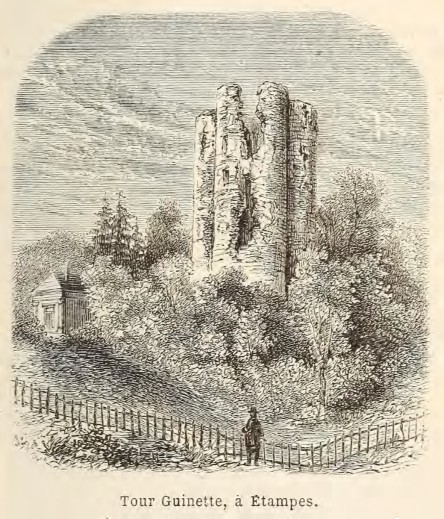
LES
ROQUEVAIR
I
Quel
agréable souvenir je conserverai de la jolie ville d’Étampes, toute coquettement
assise dans une fraîche et riante vallée, montrant ses nombreux clochers
que domine la colossale masure d’un vieux donjon féodal !
Dans
le cours de ma vie errante, je n’ai rencontré nulle part un accueil plus
sympathique.
Une
lettre de recommandation de mon ami Charles Rébel1
m’ouvrit
le salon de madame de Berthonville, où se réunissent

1 Il s’agit
peut-être d’Abel Dufresne (1788-1862), magistrat, peinte et homme de lettres
né à Étampes et possesseur du château de Jeurre (B.G.).
presque
tous les soirs une douzaine de personnes, formant le cercle le plus aimable.
Madame
de Berthonville a près de quarante ans ; elle est encore belle, mais ne paraît
nullement s’en douter. Je ne crois pas que même dans tout l’éclat de sa jeunesse
elle ait jamais attaché un grand prix à s’entendre citer comme la plus jolie
femme d’Étampes.
Elle
est veuve depuis dix ans ; son mari ne l’avait point rendue heureuse ; elle
n’afficha pas une douleur |2 qu’elle ne pouvait éprouver,
mais elle se montra sensible au repentir, qu’il lui témoigna avant de mourir,
d’avoir méconnu le noble cœur de la compagne que Dieu lui avait donnée. Elle
profita des
heureuses
dispositions que ses soins dévoués et la maladie lui avaient inspirés, pour
lui faire terminer sa vie en honnête homme et surtout en chrétien ; et elle
y réussit.
Les deux
premières années du veuvage écoulées, on s’aperçut que madame de Berthonville
semblait avoir renoncé au monde. Mais tout ce qu’il y avait dans Étampes
de distingué par la fortune, par la position sociale, par l’esprit, par la
délicatesse des sentiments, se rapprocha d’elle. Elle ne paraissait plus
dans les salons ; mais tous les soirs, assise auprès d’une table à ouvrage,
elle voyait se grouper autour d’elle l’élite de la société.
Dans
les premiers temps, il avait été de mode de se faire admettre chez elle.
On pensait que peu à peu ses salons deviendraient ce qu’ils avaient été jadis,
un centre de plaisirs bruyants. On comprit bientôt qu’on s’était trompé.
Alors il se fit un triage. Les femmes pour lesquelles le bruit et l’agitation
sont devenus une nécessité, les hommes qui ne se plaisent dans un salon qu’autant
qu’ils y trouvent plusieurs tables de jeu, ne
vinrent
plus que rarement chez madame de Berthonville : on entretint avec elle des
relations flatteuses pour l’amour-propre, mais éloignées. C’était précisément
ce qu’elle désirait.
Décidée
à prendre la vie par le côté sérieux que sa position semblait exiger, elle
vit avec plaisir son cercle se |3 restreindre : tout ce qu’elle
avait conservé composait une si délicieuse réunion ! Tout ce monde-là savait
si bien causer ! Il est vrai que madame de Berthonville possédait l’art de
faire valoir ses amis les uns par les autres. Certainement les gens médiocres
formaient là, comme partout la majorité ; et il en était beaucoup
auxquels
j’aurais supposé une valeur réelle si je ne les avais pas rencontrés dans
d’autres réunions où, livrés à leurs seules forces, ils retombaient dans
les banalités et les lieux communs ; mais madame de Berthonville savait relever
à propos les moindres saillies, et leur donnait souvent par un adroit commentaire
un prix qu’elles n’auraient jamais eu sans cela. On était émerveillé d’avoir
eu tant d’esprit sans s’en douter : et l’on aimait d’autant cette femme qui
ne cherchait jamais à briller elle-même.
Quelquefois
des visites de Paris venaient jeter une nouvelle animation dans nos soirées.
Presque tous les dimanches arrivaient l’abbé Romilly et son neveu M. Paul
Sardan.
L’abbé
était, je crois, cousin germain du mari de madame de Berthonville, et l’affection
la plus sincère existait entre eux.
Nous
aimions tous l’abbé Romilly. Il réunissait à la gravité exigée par sa position,
les manières d’un homme du monde parfaitement élevé ; et tout cela dans une
si juste mesure, avec un tact si parfait des convenances que personne ne
songeait à dire de lui : Il est trop homme du monde pour un prêtre.
C’était
le plus agréable causeur qu’il fût possible de rencontrer. Il possédait une
grande connaissance du cœur humain, autant que des besoins et des tendances
de son époque. Son extrême tolérance ne dégénérait jamais en faiblesse ;
c’était de la charité. Il épuisait tellement ce que son cœur pouvait renfermer
de haine pour le péché, qu’il n’y restait plus que de la pitié et de l’indulgence
pour le pécheur. Aussi dans les villes où il allait prêcher (l’abbé Romilly
était un prédicateur fort distingué), il ramenait toujours un grand nombre
de brebis égarées. Il leur tendait si paternellement les bras, il paraissait
si disposé à les porter sur ses épaules avec tout le fardeau de leurs iniquités,
qu’il était rare qu’elles résistassent à son appel.
L’abbé
croyait que pour remplir avec fruit sa mission de pêcheur d’hommes, il ne
devait rester étranger à aucune des questions qui s’agitent dans la société.
Politique, économie sociale, beaux-arts, littérature, tout lui était familier.
Nul courant d’idées ne s’établissait sans que l’abbé Romilly ne le prît à
sa source et ne le suivît soit avec anxiété, soit avec joie, dans la route
qu’il parcourait.
Il en
résultait que sa conversation était singulièrement intéressante, et quand
il était là nous ne pensions guère qu’à l’écouter. On se bornait à lui donner
la réplique ; et sa parole facile et brillante nous tenait constamment sous
le charme.
Au fond
je crois que le bon abbé Romilly aimait à |5 parler. Bien que sa tête fût couverte de cheveux blancs,
il avait conservé tout l’enthousiasme, tout le besoin d’expansion que les
âmes ardentes éprouvent dans leur jeunesse.
Il sentait
le plaisir qu’il nous donnait, et éprouvait en cela une vive satisfaction.
Seulement cette satisfaction était tempérée par
une
modestie qui avait quelque chose de naïf et de gracieux. Le salon ne devenait
pas une chaire ; il ne professait pas ; il cherchait avec nous et son doux
regard semblait nous dire : Est- ce bien cela ? comprenez-vous cette question
comme moi ?
Il était
rare que nous ne fussions pas de son avis, parce qu’il était fort rare que
son sens droit le trompât. Si quelquefois nous nous trouvions d’une opinion
contraire à la sienne, il souffrait la contradiction avec une douceur charmante,
et se rendait à l’évidence avec la simplicité d’un enfant.
Quant
à son neveu, M. Paul Sardan, sa présence n’ajoutait rien au plaisir que nous
éprouvions dans nos réunions.
C’était
un homme de petite taille, excessivement mince. Il me paraissait avoir quarante
ou quarante-cinq ans : il était aussi fort possible qu’il fût beaucoup plus
ou beaucoup moins âgé ; ce petit visage maigre et couleur de cire jaune pouvait
être réclamé par la vieillesse comme par l’âge mûr.
Au total,
Paul n’avait rien de séduisant. Son front très-bombé était sillonné de ces
rides perpendiculaires |6 annonçant le travail de la
pensée ; mais Paul, employé dans un bureau du ministère de la guerre, ne
pensait qu’à aligner des chiffres ; et encore ce noble travail ne lui avait
pas parfaitement réussi, car il n’avait jamais pu arriver à un autre poste
que celui de simple expéditionnaire à douze ou quinze cents francs d’appoin-
tements.
Ses
yeux d’un bleu très-foncé eussent paru grands s’ils n’eussent pas été enfouis
sous son vaste front. L’ombre projetée par leurs longs cils noirs donnait
à son regard un caractère étrange ; mais ce regard était extrêmement doux.
Je l’ai vu
quelquefois
s’illuminer d’une flamme rapide ; mais ce n’était qu’un éclair; et ses paupières
baissées, voilant sa prunelle, redonnaient bientôt aux traits de son visage
leur placidité habituelle.
Sa bouche,
aux lèvres un peu épaisses, annonçait la bonté : ses dents étaient blanches,
mais irrégulières : son menton trop fortement accusé aurait indiqué de l’énergie
; mais ce sentiment ne pouvait s’allier avec l’ensemble de cette physionomie
douce et un peu craintive.
Ses
mains étaient parfaitement belles : une femme aurait pu en être jalouse ;
elles étaient très-soignées. Paul probablement attachait du prix à ce petit
avantage.
Il y
avait pourtant en lui un charme qui attirait vers sa chétive personne. Le
son de sa voix était une véritable harmonie. Quand Paul se décidait à prononcer
quelques paroles, on l’écoutait parler sans se préoccuper de ce qu’il disait
parce qu’au fait cela ne semblait guère en valoir la peine. |7
Paul
était d’une insurmontable timidité : il comprenait sans doute combien il
était inférieur à tout ce qui l’entourait, et, assis dans un coin de l’appartement,
semblait toujours un peu embarrassé de sa personne. Rougissant quand on le
regardait, il restait là des heures entières, immobile, les mains sur les
genoux, rêvant ou écoutant, on ne savait trop lequel : parfois un vague sourire
se dessinait sur ses lèvres. Souriait-il à ses propres pensées ou bien à
quelque saillie heureuse de l’un de nous, on ne pouvait le dire.

L’abbé
Jean-Hippolyte Michon (1806-1881) type de l’abbé de Romilly, et de Paul Sardan
II
Madame
de Berthonville avait entrepris d’animer ce tranquille personnage et de le
placer dans un jour qui lui fût favorable.
Tout
homme, disait-elle, ayant reçu une bonne éducation et n’étant pas absolument
inepte, possède une spécialité plus ou moins complète : il s’agit de la trouver,
et souvent celui qu’on a jugé avec légèreté peut vous donner, sur une question
qu’il possède, ou des notions essentielles que vous ignoriez ou des aperçus
nouveaux, et vous intéresser véritablement.
Madame
de Berthonville possédait une rare habileté pour découvrir dans les personnes
qui fréquentaient son salon le côté par lequel ils pouvaient briller. Toutefois
elle échoua complétement avec Paul. Elle chercha avec une grande persévérance
le moyen de le faire sortir de son |8 apathie, et de lui trouver
un sujet de conversation dans lequel il pût placer à propos quelques phrases
et se reposer ensuite dans la douce joie d’un petit succès de salon.
Elle
savait que Paul avait passé une grande partie de sa jeunesse à la campagne
; elle supposa que se sentant peu fait pour le monde, il regrettait la vie
libre et calme des champs et que, peut-être, la science de l’agriculture
avait pour lui quelque attrait. Elle se plaça avec lui sur ce terrain. Paul
répondit avec beaucoup de froideur qu’il aimait la campagne, et que l’air
de
Paris
le rendait malade ; mais quant aux progrès de l’agriculture appliqués au
pays qu’il avait habité, rien dans ses paroles n’annonça qu’il s’en fût occupé
le moins du monde ; et sur les engrais, le marnage et les charrues, il nous
parut tout aussi ignorant qu’un Parisien ayant étudié la nature au bois de
Boulogne.
La voix
mélodieuse de Paul semblait annoncer une organisation musicale. Madame Berthonville
l’attaqua de ce côté. Après avoir nommé quelques compositeurs pour lesquels
il avoua, en rougissant beaucoup, avoir une grande prédilection, il s’embarrassa
tellement en voulant donner les motifs de cette préférence que madame de
Berthonville comprit bien que s’il aimait la musique, c’était par instinct,
mais qu’il n’avait aucune connaissance de cet art.
Il en
fut de même de la peinture, de la sculpture, de la statistique, etc. ; la
spécialité de Paul était introuvable. |9 Madame de Berthonville, de
guerre lasse, lança sur lui un mathématicien. Qui sait, me disait-elle, si,
dans son large front, il ne s’agite pas une foule de problèmes, et si la
tension de son esprit à les poser et à les résoudre ne l’absorbe pas entièrement.
Ici on ne se jette pas souvent dans les équations algébriques,
nous
ne parlons guère A + B. Mais enfin, s’il n’est bon qu’à cela, on pourra de
temps en temps lui fournir l’occasion d’être aimable à sa manière, et il
sera d’autant plus satisfait de l’être ainsi, qu’il aura la conscience de
son immense supériorité sur nous.
Hélas
! le mathématicien vint dire à madame de Berthonville que ce jeune homme
pouvait être capable, bien que cela lui parût douteux, de faire correctement
une addition ; mais que ses
connaissances
dans les sciences exactes, ne lui paraissaient pas devoir aller au delà.
Madame
de Berthonville essaya, en tremblant, de faire causer Paul sur la littérature.
Sur cette question, il fut encore plus obscur, plus embarrassé que sur les
autres : il déclara aimer beaucoup les classiques. Et quand on lui demanda
la raison de la préférence qu’il leur accordait sur les romantiques, il leva
les yeux sur nous, avec une expression de surprise ; mais se hâtant de les
voiler de ses longs cils, et fort étonné, je crois, de sa hardiesse, il répondit
avec un sang-froid qui pensa nous faire rire, qu’il aimait extrêmement les
romantiques.
-
Eh quoi ! lui dis-je, vous aimez deux genres
si opposés ; |10 cela me paraît difficile,
il faut être dans un camp ou dans l’autre.
-
J’aime le beau, me répondit Paul de sa voix
la plus harmonieuse. Mais ayant voulu ajouter quelques paroles, elles se
perdirent dans un murmure confus.
Après
quelques autres essais aussi infructueux madame de Berthonville renonça à
chercher la spécialité de Paul.
-
Il ne s’ennuie pas ici, disait-elle, puisque
tous les dimanches il accompagne régulièrement son oncle. Il écoute ou il
rêve, je ne sais trop lequel des deux ; laissons-le dans son repos.
On l’y
laissa si bien que, pendant deux ans de visites hebdomadaires, Paul sans
compter les salutations d’usage qu’il faisait tant bien que mal, n’avait
peut-être pas prononcé vingt phrases de dix mots chacune. Nous avions fini
par ne plus faire
attention
à lui ; il y avait une chaise de plus occupée dans le salon, et voilà tout.
III
Un soir
la fille de madame Prémian, jeune personne de dix ans, annonçant des dispositions,
nous jouait sur le piano une interminable fantaisie.
Notre
supplice était d’autant moins près de finir que l’heureuse mère de ce petit
prodige l’arrêtait de temps en temps dans sa course désordonnée, en lui disant
: |11
-
Lucie, ordinairement tu rends beaucoup mieux
ce passage, répète-le, ma fille.
La
docile enfant obéissait.
-
Lucie, Lucie, reprenait madame Prémian, recommence
tout le morceau ; ce passage, isolé du reste, perd trop de sa valeur.
Et le
morceau recommençait pour la plus grande joie de la mère et notre désespoir
à tous. Mais en vivant avec madame de Berthonville, nous avions pris plus
ou moins l’habitude de chercher à nous plaire mutuellement, et la faiblesse
maternelle de madame Prémian trouvait en nous de l’indulgence. Aussi lorsque
la maîtresse de la maison n’avait pu réussir, à force de savantes manœuvres,
à empêcher Lucie de se mettre au piano, nous faisions tous nos efforts pour
avoir l’air de l’écouter, étudier avec intérêt.
Lucie
jouait donc à tour de bras. Madame de Berthonville se promettait bien que
dans le cas où par bonheur quelques cordes de l’instrument casseraient, elle
ne les ferait pas replacer de longtemps.
Paul
bâillait un peu, et l’abbé Romilly feuilletait les albums, les revues et
les journaux qui se trouvaient sur la table.
Comme
tout finit, même ce qui nous ennuie, la fantaisie se termina, et la conversation
redevint plus générale.
-
Avez-vous trouvé dans ce que vous avez lu
quelque chose d’intéressant ? demanda madame de Berthonville à l’abbé Romilly.
|12
—Oui,
Madame, j’ai lu quelques critiques littéraires très-bien faites, quelques-unes
sévères, mais en même temps polies, ce qui est rare. Mais je vois que décidément
le roman-feuilleton envahit les journaux ; il y a conquis une position importante,
et tout porte à croire qu’il la conservera.
-
Cette conquête, monsieur l’abbé, dit avec
emphase un jeune avocat, doit beaucoup vous affliger, vous devez souffrir
en voyant des feuilles politiques destinées aux esprits sérieux, donner place
dans leurs colonnes aux faiseurs de romans. Je vous assure, monsieur l’abbé,
que ce genre de littérature ne me déplaît pas moins qu’à vous.
—Vous
vous trompez, mon cher Raveau, les romans ne me déplaisent pas. Je serais
même disposé à les aimer beaucoup.
-
À les aimer ! s’écria l’avocat, un peu stupéfait
de la déclaration de principes de l’abbé Romilly à l’endroit des romans.
-
Oui, à les aimer, reprit l’abbé. Le roman
est une forme littéraire ; c’est un poëme en prose. Si le poëme est bon,
pourquoi ne l’aimerais-je pas ? Pourquoi ne lui saurais-je pas gré de m’avoir
procuré une distraction agréable ?
Si le roman est mauvais, ce n’est pas la faute du genre, c’est
celle de l’auteur. On peut faire, et on fait souvent aux poëtes tous les
reproches que l’on adresse aux romanciers ; la poésie n’est pas toujours
chaste : la fille du ciel |13 descend
souvent sur la terre pour y traîner son vêtement céleste dans la fange. Cependant
personne n’a songé et ne songera jamais à proscrire la poésie. Le Platon
qui, de nos jours, proposerait d’exiler les poëtes2,
serait envoyé aux Petites-Maisons3 ou
tout au moins perdrait l’espoir d’être pour un quatre cent cinquante-neuvième
dans l’œuvre de notre législation4. Je ne vois pas davantage
la nécessité de proscrire la forme littéraire appelée roman.
Je
conviens, poursuivit l’abbé, que le roman, au lieu d’être un élément de moralisation,
est presque toujours le contraire. Il a la prétention de fouiller dans le
cœur humain, de nous en retracer les vertus et les vices ; mais je ne sais
par quelle malheureuse fatalité il donne souvent au vice les couleurs de
la vertu, et, surchargeant celle-ci d’ornements qui lui sont étrangers, il
lui fait perdre tout son charme ; et elle passe au milieu des lecteurs de
romans inconnue et méprisée.

2 Platon,
République, livre III, § 397 (B.G.).
3 Asile
d’aliénés du VIe arrondissement
(B..).
4 Le Parlement
compte alors 459 députés du peuple (B.G.).
-
Il
résulte de ceci, dit l’avocat, que vous me donnez raison et que la vogue
inconcevable des romans-feuilletons est une véritable plaie de la société
actuelle5.
-
Je vous l’accorde, répondit l’abbé, je vous
avouerai même que je ne connais pas assez de bons romans pour vous les présenter
comme une atténuation aux dangers des mauvais. Seulement, Monsieur, croyez-le
bien, les plaies de la société sont toujours guérissables. Le remède pour
celle qui nous occupe est très-facile, il ne s’agit que de l’employer. |14
-
Et ce remède, quel est-il ? demanda madame
de Berthonville.
-
Il
est très-simple, Madame ; il faut faire de bons romans6.
Le
roman est devenu un des besoins de notre époque, lutter contre ce courant
serait insensé. Au lieu de s’épuiser en efforts stériles pour changer la
nature de ce qui ne peut être changé, il faut que les moralistes entrent
dans la voie nouvelle, portent leurs tentes jusque sur le camp de l’ennemi,
se servent de ses armes et luttent avec lui d’habileté et de talent.
-
Ces idées sont nouvelles, dit l’avocat, mais
leur réalisation est-elle possible ?
-
D’abord, reprit l’abbé, ces idées ne sont
pas nouvelles ; est-ce qu’il y a quelque chose de nouveau sous le soleil
? et

5 Ce personnage
caricature le parti ultra (ultramontain, ultracatholique), bête noire de
l’auteur, catholique de tendance gallicane (B.G.).
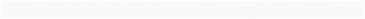
6 Voyez
à la fin de cette édition comment rebondit ironiquement sur cette phrase
William O’Gornam, dans sa recension de notre roman, Revue
critique
des livres nouveaux 27 (1859), p. 411 (B.G.).
quant
à leur réalisation l’expérience est faite. Je pourrais vous citer des saints,
des religieux, des prélats qui n’ont pas dédaigné d’écrire des romans. Camus,
évêque de Belley7, ami de l’aimable saint François de
Sales, en a publié un nombre prodigieux, jugeant avec raison ce genre de
travail utile, en raison des ouvrages licencieux qu’on publiait de son temps.
Plus
près de nous Fénelon a caché sous la force du roman les instructions qu’il
voulait donner à son élève8. Le Comte de Valmont ou les Egarements de la raison de
l’abbé Gérard, est un roman9.
De nos
jours Chateaubriand a publié les Martyrs ; quelques écrivains dont
les travaux semblent exclusivement |15 consacrés
à la politique, ont cependant fait quelques pas dans la carrière que j’indique10. Elle est ouverte depuis longtemps ; mais le nombre
des moralistes sérieux qui la parcourent est malheureusement trop restreint.

7 Jean-Pierre
Camus (1584-1652), fils de Jean Camus
de Saint-Bonnet bailli d’Étampes, lui-même évêque, romancier et biographe
de saint François de Salles (B.G.).
8 Les Aventures
de Télémaque, fils d’Ulysse, roman éducatif d’aventures
et de voyage, l’un des plus gros succès de librairie de tous les temps, ont
été composées en 1694-1696 par François de Salignac de La Mothe-Fénelon
dit Fénelon
(1651-1715), homme d’Église, théologien et écrivain français (B. G.).
9 Le Comte
de Valmont, ou les égarements de la raison, roman
édifiant et anti-philosophique publié en 1774 par Philippe-Louis Gérard (1737-1813)
(B.G.)
10 Plus
récemment deux évêques anglais, le cardinal Newman et le cardinal Wiseman,
ont publié des romans fort remarquables, Fabiola et
Calixte
(note de l’auteur).
-
J’avoue, M. l’abbé, dit l’avocat, que j’adopterais
avec peine l’idée de voir des hommes graves abandonner des travaux sérieux
et vraiment utiles pour composer des romans.
-
Mon cher Raveau, un travail tendant à moraliser
les masses est toujours un travail sérieux et utile, et je crois qu’on pourrait
d’autant mieux entrer dans la lice avec avantage que jusqu’à présent, sauf
quelques exceptions, le roman n’a jamais représenté la vie réelle. Presque
toujours le poëme, car le roman n’est pas autre chose, pivote sur la peinture
d’un sentiment unique, comme si le cœur humain n’en contenait pas une infinité
d’autres.
-
Ah ! dit madame de Berthonville, en souriant,
croyez-vous donc qu’il soit possible de faire un roman intéressant sans y
placer comme moteur principal ce sentiment unique que vous ne voulez pas
nommer ? J’ai bien peur, si vous réussissez à le proscrire, que le roman
ne devienne fade et sans couleur.
-
D’abord, Madame, je ne crains pas du tout
de le |16 nommer et je ne veux pas le proscrire. Je reconnais
que l’amour a droit de bourgeoisie dans le roman.
Soit
qu’on le représente dans ce qu’il a de grand et de sublime, soit qu’on en
retrace les erreurs et même les crimes ; si la plume est chaste, si le cœur
qui la conduit est chrétien, on pourra trouver dans ces tableaux des enseignements
utiles.
Mais
si l’artiste, quel qu’il soit, vient me dire : Je ne puis peindre qu’un seul
côté de la vie du cœur, — je serai parfaitement en droit de l’accuser d’impuissance
; de lui reprocher de suivre toujours la route battue par tous les manœuvres
littéraires, d’ignorer qu’il y a des sentiers où les
lecteurs
seraient heureux d’être conduits, ou de ne savoir pas les trouver.
-
Vous jugez votre siècle trop favorablement,
reprit maître Raveau. Des romans comme vous les comprenez, ne réussiraient
pas. Il faut à nos esprits blasés quelque chose d’acre, de mordant ; cela
empoisonne, on le sait, mais on a pris la funeste habitude de ce poison,
on refuse tout autre aliment.
-
Parce que l’aliment est mal préparé, s’écria
l’abbé. Mais que des hommes d’un véritable talent entrent dans la voie que
j’indique, et vous verrez avec quel bonheur on se reposera, en les lisant,
de ces émotions factices dont on est peut-être plus fatigué que vous ne le
pensez.
Messieurs
les moralistes, au lieu de déclamer contre les romans, de leur jeter l’anathème,
faites des romans. |17 Le feuilleton règne. Au lieu
de chercher à détrôner le feuilleton, servez-vous de lui pour commencer un
nouveau genre d’apostolat ; l’art et la morale y gagneront également.
-
Eh bien ! monsieur l’abbé, lui dis-je, prêchez
d’exemple, faites-nous un bon roman.
-
Je suis trop vieux pour entrer dans cette
voie, me répondit l’abbé, je ne puis que désigner la route que, dans les
circonstances actuelles, il me semble urgent de suivre.
On se
rendit à l’avis de l’abbé Romilly. Le jeune avocat résista quelque peu :
il convoitait une place dans la magistrature et se préparait à son rôle d’homme
sérieux, en posant devant nous, ce qui nous amusait assez.
Il
fulmina quelques réquisitoires sur les romanciers et les romancières
11: il assura, malgré nos vives réclamations,
que le talent manquait à toutes les productions nouvelles, et finit par concéder
que puisque le roman était dans nos mœurs, il était à désirer qu’on le moralisât.
Mais
il n’espérait pas voir arriver cette heureuse révolution ; la société continuerait
à être minée par ce dissolvant fatal qui s’introduit chaque jour, dans les
familles, dans le sanctuaire du foyer domestique, et qui, etc.... Et l’avocat
de gesticuler, de s’enivrer de sa propre parole ; il la croyait d’une irrésistible
puissance.
Paul
arrêta Raveau dans une de ses plus ronflantes périodes. Il s’approcha de
son oncle et lui rappela que l’heure du dernier convoi allait sonner. |18
— Eh
bien ! me dit à demi-voix la sœur de Lucie Prémian : on prétendait que M.
Sardan était une inutilité ; il vient de nous prouver le contraire ; si je
l’osais, j’irais le remercier.
Je souris
à la malicieuse jeune fille, et je me dis en regardant l’avocat : — Pauvre
garçon, tu prodiguais l’ampleur de tes plus beaux gestes, les plus riches
inflexions de ta voix, surtout à l’intention de cette Louise Prémian dont
tu convoites la dot. Je te voyais épier du coin de l’œil l’effet que tu produisais
sur elle, et tu ne te doutais pas qu’elle te trouvait parfaitement ridicule.
Faites donc des frais pour des êtres si frivoles.

11 L’auteure
fait ici une allusion à elle-même, bien qu’elle se soit dégisée sous un pseudonyme
masculin (B.G.).
IV
Le dimanche
suivant l’abbé vint seul à Étampes. Madame de Berthonville lui demanda des
nouvelles de son neveu.
-
Paul est souffrant, Madame, son état auquel
je me reproche de n’avoir pas donné toute l’attention qu’il méritait m’inspire
quelque inquiétude. Paul ne se plaint jamais ; le mal s’établit dans les
organisations débiles sans y imprimer sa trace, et quand on s’aperçoit de
ses ravages, il est quelquefois bien tard pour les arrêter.
Le
bon abbé aimait tendrement son neveu ; il n’avait pas, je crois, plus que
nous une haute idée de son intelligence, bien que quelquefois il nous eût
donné à entendre |20 que Paul n’était pas tout
à fait aussi nul qu’il en avait l’air.
-
Faiblesse d’oncle, disions-nous, quand ils
étaient partis.
L’abbé
de Romilly fut ce jour-là préoccupé, silencieux. Assis à la place qu’occupait
ordinairement son neveu, immobile comme lui, il semblait vouloir le rappeler
à notre souvenir.
Plusieurs
dimanches se passèrent ainsi. Nous ne reconnaissions plus notre bon abbé,
il y avait en lui quelque chose d’extraordinaire.
L’abbé
de Romilly nous parut enfin un peu moins inquiet de la santé de son neveu.
— Je commence à espérer, nous dit-il. Pauvre enfant ! je le nomme encore
ainsi, bien qu’il ait près de trente-huit ans. Son organisation est si frêle
! Je ne sais vraiment, ajouta l’abbé, comme en se parlant à lui-même, comment
il a pu y résister.
-
Je ne crois pas, me dit l’avocat, en se penchant
vers moi, que chez le neveu de l’abbé Romilly, ce soit la lame qui use le
fourreau. Chez lui la pensée ne bouillonne pas comme un flot impétueux renversant
tout ce qui gêne son essor : c’est alors, ajouta-t-il, avec un soupir que
l’organisation physique s’affaisse brisée par les efforts de l’être moral.
Je
jetai un regard sur Raveau : sa figure fraîche, rosée, largement épanouie
dans un air de satisfaction intime me rassura sur les inconvénients que pouvait
avoir pour |20 lui le travail de la pensée. Évidemment l’être moral
avait beaucoup à faire pour détruire l’organisation physique de maître Raveau,
et je me demandais s’il était une lame capable d’user un fourreau si robuste.
-
M. Sardan n’a pas renoncé à Étampes, dit
madame de Berthonville à l’abbé, sachant très-bien que l’intérêt qu’on témoignait
à son neveu était la seule flatterie à laquelle il fût sensible.
-
Paul viendra avec moi dimanche prochain,
Madame, répondit l’abbé, puis il retomba dans la distraction qui semblait
lui être devenue habituelle.
Enfin
Paul revint avec son oncle. Son visage nous parut plus pâle encore ; ses
mains avaient maigri : il était plus taciturne que jamais.
Quand
il arriva, madame de Berthonville lui adressa quelques paroles d’un affectueux
intérêt. Paul voulut répondre. Mais, après avoir ouvert plusieurs fois la
bouche sans pouvoir en faire sortir un son, fatigué de ses impuissants efforts,
il se contenta de dire brusquement en saluant d’une manière assez gauche
:
-
Madame, je vous remercie.
L’abbé
Romilly entendit cette éloquente réponse. Il regarda Paul avec des yeux charmés
: — Cher enfant ! murmura-t-il. Puis, tout le reste de la soirée, l’abbé
fut d’une gaieté charmante. Nous remarquâmes qu’il s’occupait beaucoup plus
de son neveu qu’à l’ordinaire. Il allait se mettre auprès de lui, serrant
entre ses mains les petites mains amaigries de Paul, lui
disant
tout bas quelques |21 mots. Paul souriait doucement
:
l’abbé
revenait à nous et causait. Jamais ses récits n’avaient été plus piquants,
sa conversation plus intéressante. Il y avait en lui une exubérance de bonheur
intime qui rayonnait autour de lui, animait ses moindres gestes et donnait
un cachet particulier à ses paroles les plus simples.
Quand
il fut parti, nous nous demandâmes tous : — Qu’avait donc aujourd’hui l’abbé
de Romilly ? Il semblait heureux et fier comme un lycéen obtenant son premier
prix d’honneur.
-
Ou comme celui qui vient de gagner par son
éloquence, la première de toutes les forces humaines, la cause de la veuve
et de l’orphelin, dit l’avocat.
-
Je crois que pour M. Raveau ce bonheur-là
est tout à fait inconnu, me dit tout bas Louise Prémian.
Le
lendemain à midi madame de Berthonville me fit prier de passer chez elle.
-
Tenez, me dit-elle, lisez la lettre que je
viens de recevoir de l’abbé Romilly ; lisez tout haut, car j’ai peine à en
croire mes yeux.
Je pris
la lettre et je lus.
« Vous
souvient-il, Madame, qu’il y a à peu près six semaines, je soutenais dans
votre salon qu’il serait facile de faire un roman dont l’intérêt n’eût pas
l’amour pour principal moteur. Eh bien, Madame, nous avions là sous nos yeux
le type du héros d’un semblable roman et nous ne le connaissions pas. Moi,
je l’aimais d’une affection protectrice. Mon cœur
pressentait
qu’il y avait là quelque |22 chose que je ne devinais
pas,
mais un voile me séparait de cet inconnu. Ce voile est déchiré pour moi,
il le sera bientôt pour le monde. Je pars pour aller prêcher à Tulle. Je
serai près de deux mois sans vous voir, mais dans deux jours vous recevrez
une lettre de moi contenant une histoire qui ressemble beaucoup à un roman
et le héros, Madame, c’est Paul Sardan. »
Le jour
indiqué par l’abbé Romilly, je courus chez madame de Berthonville ; elle
avait reçu la lettre annoncée.
— Je
n’ai pas voulu la lire sans vous, me dit-elle, voyez, l’enveloppe est intacte.
Sachez-moi gré du plus grand sacrifice que puisse s’imposer une curiosité
féminine en faveur de l’amitié.
Nous
avons lu et nous avons aimé Paul. Madame de Berthonville me donna la permission
de copier le récit de l’abbé Romilly : de plus elle me donna sur la famille
Sardan des détails qui le complétèrent.
Tout
cela me fut en partie raconté sous le sceau du secret. Mais on connaît les
romanciers : ce sont bien les gens les plus indiscrets de la terre, et tout
ce qui m’étonne, c’est qu’on puisse jamais leur confier quelque chose ; malheur
à vous, surtout si vous leur dévoilez quelques-uns des mystères de votre
cœur. Qui dans la vie n’a pas eu son petit roman intime ? Si vous le laissez
lire à un ami, ou mieux à une amie appartenant à la gent écrivain, ne soyez
pas stupéfait en le retrouvant au |23 bas
de votre journal12, délayé dans une suite d’interminables
feuilletons.
Je fais
donc comme tous mes confrères, j’ai lu un récit plein d’intérêt et je le
transmets à mes lecteurs. Le hasard m’a fourni des renseignements inconnus
même à l’abbé Romilly. J’ai visité les lieux habités par mes héros ; les
descriptions que j’en donnerai seront exactes. J’ai dû changer les noms de
mes personnages, et je l’ai fait. C’est tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de la délicatesse d’un romancier.

12 Les
romans sont alors distillés en feuilleton généralement placés en bas de la
première page des journaux.

Maison
natale de l’abbé Michon à Laroche-près-Feyt
en Corrèze
V
Transportez-vous
donc sur les confins de la Haute-Vienne et de la Corrèze13,
au moment où la première Restauration allait s’accomplir14.
À deux
lieues de Treignac, dans une position des plus agrestes, s’élevait un petit
castel, ayant eu la prétention d’avoir joué un rôle à l’époque de la féodalité.
Il était
entouré de larges fossés sur lesquels s’abaissait jadis avec un grand fracas
de gonds rouillés et de chaînes le pont- levis obligé. Mais depuis longtemps
les murailles qui bordaient les fossés entourant le château avaient disparu,
et le pont-levis avait été remplacé par un pont ordinaire grossièrement travaillé,
mais assez solide pour supporter le poids des lourdes charrettes
chargées
de blé et de fourrages entrant dans la grande cour du manoir. |24
Les
fossés n’avaient plus d’eau : les éboulements de terrain les avaient comblés
en partie ; le reste était rempli de ronces, d’aubépines et de houx.

13 On notera
que l’abbé Jean-Hippolyte Michon était né précisément
en Corrèze, à Laroche-près-Feyt, le 21 novembre 1806.
14 C’est-à-dire
peu avant 1814.
En
entrant, à la gauche du pont, se trouvait une vieille tour lézardée dans
toute sa hauteur. Autrefois couronnée de créneaux, elle avait perdu une partie
de ce glorieux ornement ; mais elle conservait encore quelques meurtrières,
des machicoulis, et, quand il pleuvait deux énormes gargouilles laissaient
échapper des torrents d’eau par leurs gueules grimaçantes et démesurément
ouvertes, que les pâtres de ce pays un peu sauvage ne considéraient qu’avec
un étonnement mêlé de frayeur.
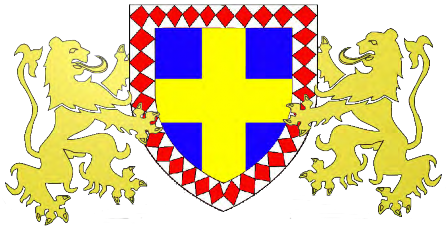
Un large
écusson, supporté par deux lions affrontés, présentait les armes des Roquevair.
Elles étaient d’azur, à la croix d’or, à la bordure d’argent losangée de
gueules. Le marteau révolutionnaire avait brisé les deux lions, abattu la
bordure, excepté à l’angle intérieur, et coupé la croix avec des hachures
qui la laissaient cependant deviner sur le fond de l’écu. Avec quelques connaissances
du blason, il était facile de reconstruire ces armes, mais pour le vulgaire
ce n’était qu’un hiéroglyphe dont le sens était à jamais perdu.
La
tour complétement abandonnée ne renfermait que quelques instruments de jardinage.
Cependant
si l’on se hasardait à gravir l’escalier en colimaçon qui conduisait jusqu’à
la plate-forme ; si l’on ne s’arrêtait pas effrayé des solutions de continuité
occasionnées par les degrés disparus ; si l’on n’était pas ému |25 en sentant la pierre sur laquelle on venait de poser
le pied crouler sous sa pression et descendre avec bruit au bas de la tour,
on était, après avoir
terminé
son ascension, amplement dédommagé par l’admirable vue qu’on découvrait autour
de soi.
Dominant
alors les bois qui entouraient le château, on suivait la pente d’une colline,
jusqu’à la jolie rivière de la Vézère dont le cours à travers de magnifiques
prairies dessinait les sinuosités les plus gracieuses. De petits villages
composés d’un groupe de trois ou quatre maisons à demi cachées par des châtaigniers
étaient parsemés dans la plaine. Des moulins, des chutes d’eau destinées
à les alimenter, des îlots de verdure bordés de bouleaux, de peupliers et
d’aunes, dont le pied se baignait dans les eaux ; à l’horizon de petites
montagnes arrondies, montrant sur le ciel bleu leurs courbes gracieuses.Tout
contribuait à rendre ce paysage ravissant : partout la variété la fertilité
et la vie.
On écoutait
avec ravissement et le bruit des cascades et le bêlement des troupeaux et
les chants du laboureur toujours sur un rhythme lent, dont la monotonie n’est
pas sans charmes par cela même que la mesure semble suivre le pas des animaux
qui lui aident à ouvrir les entrailles de la terre.
Quand
on est sous le charme des impressions que provoque toujours le spectacle
de la nature, on ne comprend plus
comment
on peut se renfermer dans les villes. Ce fut sans doute une grande instruction
donnée à l’homme |26 que celle qui plaça le paradis
terrestre dans un jardin.
Dieu
ne fit pas jaillir du sein de la terre les marbres précieux, l’or et les
pierreries pour en élever à sa créature privilégiée un somptueux palais ;
il lui donna les fleurs et les fruits et le doux murmure des eaux.
Aussi
quand l’homme, dégoûté des chimères de gloire et d’ambition qu’il a longtemps
poursuivies veut revenir à une vie calme, son instinct le porte à abandonner
les cités et à chercher ses derniers bonheurs au sein de la nature.
On entrait
dans le château par une vaste cour entourée de bâtiments d’exploitation,
la plupart en ruines. Partout on avait laissé se former des excavations où
les fumiers égouttaient leurs eaux noirâtres. Là barbotaient les oies domestiques
et les canards bruyants, souvent troublés dans leurs ébats par de plus laids
animaux qui venaient leur disputer le plaisir du bain. Deux servantes, reines
de cette basse-cour, se livraient à leurs travaux habituels, poursuivant
leurs bêtes indociles, jetant du grain, ou portant aux bestiaux leur nourriture.
Les chiens aboyaient, et les éclats de voix des servantes à la fois rauques
et aigus déchiraient encore plus les oreilles que les cris des oies et des
pintades et les aboiements des chiens. C’était, il faut l’avouer, un fort
laid tableau de la vie pastorale. Un peu de goût de la part des habitants
du château eût pu en rendre la vue moins choquante. La cour aplanie et plantée
d’arbres qui eussent dissimulé le désordre des bâtiments d’exploitation ;
les toits des
animaux
|27 rejetés derrière ces bâtiments avec les fumiers si
chers
à l’œil de l’agriculteur, mais moins agréables à celui des habitants des
villes et à celui des poëtes ; quelques massifs de
verdure
et de fleurs, et l’aspect eût totalement changé. On fût arrivé à la porte
de la maison sans avoir sali ses chaussures et vu zébrer ses vêtements, grâce
aux éclaboussures envoyées par toute cette population grouillante, nageante,
criante et aboyante.
Qu’on
ne me dise pas que c’est là une des conséquences de cette vie des champs
dont j’ai vanté les charmes. Quand je parle d’aimer, d’étudier la nature,
je veux parler de cette nature telle que Dieu l’a créée ; pour ce qui tient
à la présence de l’homme, à ses habitudes, à ses animaux réduits à la domesticité,
tout cela peut être quelquefois très-laid.
L’homme
s’empare d’un petit coin de la création pour y bâtir son nid, c’est bien
; mais qu’il ne défigure pas ce petit espace qu’il lui est donné d’occuper.
Après avoir respiré l’air embaumé des prairies, je n’aime pas en rentrant
dans la maison où je dois prendre mon repos à me sentir suffoqué par l’odeur
âcre des engrais ou par celle plus fétide encore des mares agitées par de
lourds et sots volatiles.
Ce n’est
pas là ce que j’appelle la nature : cela sans doute est utile, mais il faut
mettre chaque chose à sa place. Cette loi du goût est mieux comprise aujourd’hui
dans l’agencement de nos habitations ; mais à l’époque où commence cette
histoire, le confortable à la campagne |28 était partout presque inconnu, et même de nos jours
dans nos provinces du centre il serait très- facile de trouver des maisons
semblables à celle que je viens de décrire.
N’eût
été sa tour démantelée, ses antiques fossés et un petit colombier, le manoir
de Roquevair eût été assez embarrassé de justifier sa prétention au titre
de château.
C’était
un carré long avec deux bâtiments en retour, composés d’un rez-de-chaussée
et d’un étage au-dessus percé de fenêtres de forme irrégulière. Tout cela
avait été bâti à trois époques différentes, et les deux derniers architectes
s’étaient peu souciés de mettre la partie des travaux qu’ils exécutaient
en harmonie avec ce qui était déjà fait.
On entrait
dans une espèce de vestibule où se trouvait l’escalier conduisant à l’étage
supérieur. Cet escalier était en bois grossièrement travaillé et éclairé
par une fenêtre dans laquelle on avait établi une volière, et c’était, certes,
l’idée la plus heureuse de celles qui avaient présidé, soit à la construction,
soit à l’arrangement des diverses pièces.
À gauche
et à droite du vestibule s’ouvraient deux portes basses et étroites : l’une
était celle de la salle à manger par où l’on arrivait dans le salon, par
l’autre on entrait dans les cuisines et les servitudes de la maison : tout
cela sombre, humide et enfumé.
Le salon
n’était pas non plus d’un aspect très-gai. Pour tout ameublement, des chaises
de paille et deux fauteuils de forme antique qui devaient avoir figuré avec
|29 honneur à l’époque de la gloire de la vieille tour.
Sans doute ils avaient été brodés par les châtelaines de Roquevair, du temps
que Roquevair avait des châtelaines, ce qu’on ne savait plus guère que par
tradition.
Des
vieillards se rappelaient avoir entendu dire aux anciens que dans un temps
qu’ils n’avaient pas connu eux-mêmes, Roquevair avait été habité par de riches
et vaillants seigneurs. On rencontrait souvent l’épouse de l’un d’eux, la
belle Macy chevauchant dans la forêt.
Cette
belle Macy était l’héroïne de la légende de Roquevair. Dans sa jeunesse elle
avait habité la vieille tour, et avant d’avoir accompli sa vingtième année,
elle était morte par un sinistre accident après avoir donné le jour à un
fils. On assurait qu’elle revenait la nuit hanter le vieux donjon.
Souvent
quand le temps était chargé d’électricité, quand la tempête agitait les grands
arbres de la forêt et leur faisait chanter de douloureuses plaintes, on entendait
le galop effréné du cheval de Macy. Le bruit sec et métallique de ses fers
d’argent dominait les bruits de la nature bouleversée. On voyait bientôt
une forme blanche paraître sur le haut des vieux créneaux ; on entendait
des gémissements….. Malheur à celui qui s’arrêtait au bas de la tour ! car,
si l’ombre de Macy descendait et passait près de lui, l’année ne s’écoulait
pas sans que le cimetière ne vît une croix sur la tombe de l’imprudent qui
s’était attardé loin de sa demeure.
Peut-être
les vénérables fauteuils placés auprès de la |30 cheminée avaient-ils été brodés par la belle Macy elle-même.
C’étaient des pavots et des roses dont les couleurs avaient encore quelque
éclat. Seulement la laine usée en plusieurs endroits laissait apercevoir
le canevas ; et les nombreuses réparations faites d’année en année par des
aiguilles souvent peu habiles ne pouvaient dissimuler des ans l’irréparable
outrage.
Le bois
était en ébène ; les montants du dossier, les bras et les pieds étaient tournés
en spirales ; des feuilles de chêne artistement sculptées en suivaient les
contours et en faisaient deux morceaux de sculpture sur bois sans prix pour
les amateurs d’antiquités. Mais cette variété de l’espèce humaine était alors
peu connue, et parmi les nombreux visiteurs nul ne
songeait
à examiner la délicatesse de ce travail dû à quelque artiste inconnu de la
Renaissance.
La légèreté
des spirales, les délicates nervures des feuilles n’excitaient point des
transports d’admiration, et le pied d’un de ces meubles précieux ayant été
brisé par quelque maladresse, un pied en bois de chêne taillé carrément par
le charpentier du village fut accolé au chef-d’œuvre sans que personne s’avisât
de crier à la profanation. Comme le charpentier était un homme de goût, il
badigeonna en noir son travail, et l’on trouva que la réparation était heureusement
opérée : il est vrai qu’elle était solide.
Une
verdure tapissait le salon; elle était aussi fort ancienne : peut-être sortait-elle
de la boutique de M. Guillaume |31 et
était- ce celle qu’il conseillait au bonhomme Gérante d’acheter pour guérir
sa fille en lui réjouissant l’esprit et la vue15.
On y voyait de belles charmilles, des allées conduisant à de superbes jets
d’eau retombant dans de vastes bassins où s’ébattaient des cygnes un peu
fantastiques.
Le fait
est que ce genre de tapisserie, même médiocrement exécuté, était beaucoup
plus agréable à la vue que nos tentures de papier, au dessin monotone, ne
donnant jamais à un appartement une physionomie qui lui soit propre et dont
les détails soient un de nos souvenirs.
Je suis
persuadé que le héros de mon histoire n’a jamais oublié et ces vieux fauteuils
et cette belle verdure, dont son œil

15 Allusion
à un personnage marchand drapier dans la Farce de maître Pathelin,
comédie du XVe siècle
remise au goût du jour par plusieurs auteurs du XIXe siècle (B.G.).
enfantin
avait si souvent suivi les allées et tâché de pénétrer les charmilles.
Cette
belle tapisserie est d’autant mieux restée dans les souvenirs de mon héros
que, rongée par le temps, elle avait été rapiécée avec des lambeaux d’une
tapisserie à personnages, ce qui produisait les effets les plus bizarres.
Une tête de femme à la riche chevelure blonde, le cou orné d’un collier de
perles, semblait sortir du haut des charmilles ; un des jets d’eau était
surmonté d’un casque, et le premier arbre de la plus belle allée était planté
dans un bouclier; des pieds, des mains, des fleurs voltigeaient avec les
biseaux dans l’azur du ciel, et l’un des cygnes avait une magnifique tête
de chien avec un collier à grelots.
Au milieu
de la vaste salle était une table ronde recouverte |32 d’un tapis. Quelques tableaux se voyaient çà et là :
ils représentaient de beaux messieurs et de belles dames habillés à la manière
des bergères de Wateau ou portant des costumes mythologiques.
Au milieu
de toutes ces peintures maniérées et ne rachetant pas le mauvais goût du
temps où elles avaient été faites par la perfection de la peinture, on voyait
le portrait d’un jeune abbé qui aurait dû sembler surpris de se trouver en
si étrange compagnie. Le fait est qu’il ne paraissait pas s’apercevoir de
la présence des beautés grimacières qui l’entouraient.
La peinture
était bonne. Le peintre avait surpris la pensée dans son modèle et l’avait
reproduite avec assez de bonheur. Ce vaste front révélait l’intelligence,
le regard était empreint d’une mansuétude infinie. Il y avait dans la coupe
de cette bouche fine et gracieuse, dans un mouvement imperceptible
des lèvres,
admirablement
saisi par le peintre, une légère nuance de malicieuse ironie ; mais c’était
une grâce de plus, et dans l’ensemble de cette belle physionomie respirait
une loyauté si entraînante qu’on se disait en le regardant : Voilà l’homme
dont je voudrais être l’ami.
L’abbé
était représenté debout ; dans sa main, d’une beauté de forme irréprochable,
se voyait un manuscrit roulé à demi; on y lisait ces mots : DEUS EST CHARITAS16.
Ce jeune
abbé est celui que nous avons vu dans le salon de madame de Berthonville.
C’est le bon abbé Romilly ; pendant sa longue carrière, il n’a jamais oublié
le |33 sens des mots tracés sur son manuscrit : Dieu est
charité.
Le salon
avait deux croisées, l’une s’ouvrait sur la cour dont nous avons déjà parlé
et dans laquelle nous ne tenons pas à ramener nos lecteurs ; l’autre donnait
sur un immense jardin tenu avec la même incurie que le reste de la maison.
L’herbe envahissait les allées ; les buis avaient perdu les formes rondes
et pyramidales qui les avaient rendus jadis l’admiration de la contrée ;
et leurs branches croissant en liberté, venaient fouetter rudement le visage
des promeneurs distraits.
On y
voyait des statues ou plutôt des fragments de statues. Étaient-ce les excès
populaires, était-ce le temps qui les avaient réduites à un si piteux état
? Hébé n’avait plus de menton, et ses mains étaient brisées. Un Amour privé
de ses ailes et de son carquois, de plus, horriblement barbouillé, semblait
gémir de se voir condamné à la fidélité. Mercure tombé de son socle n’avait
plus de jambes et ne possédait plus que la moitié de son

16 Première
épitre de Jean, IV, 16 (B.G.).
chapeau
et de son caducée. Vénus était horriblement mutilée, et ce qui restait de
tous ces chefs-d’œuvre n’était pas fait pour inspirer le désir de trouver
ce qui leur manquait.
La seule
chose qui flattât agréablement le regard dans ce jardin presque entièrement
inculte, était un parterre disposé devant la croisée du salon : là les buis
étaient taillés, les allées recouvertes de sable, et une quantité de fleurs
assez communes à la vérité, mais massées avec goût. On voyait qu’une main
intelligente
avait présidé à l’arrangement de ce petit coin de terre. |34
Nous
ne promènerons pas davantage nos lecteurs dans ce jardin, nous ne lui
ferons pas admirer les appartements du château. Peut-être dans leur antique
mobilier y aurait-il quelques objets dignes d’être remarqués. Ici une magnifique
glace de Venise, là une belle toilette garnie de ces dentelles guipures auxquelles
plus tard la mode a donné des prix si élevés, des meubles de bois de rose
avec des marqueteries en ivoire ; mais tout cela se perdait au milieu de
vieilleries sans valeur, et il fallait encore à ces trésors inconnus quelques
années pour les faire exhumer de leur noble et antique poussière.
Rentrons
donc dans le salon, et après avoir jeté un coup d’œil sur une belle pendule
du temps de Louis XV, examinons les personnes qui se trouvent dans l’appartement.
VI
C’était
le 21 février 1814. Des souches d’arbres, des éclats de bois fendu remplissaient
l’immense cheminée ; la flamme s’en échappait vive et brillante. À la campagne,
un bon feu est un luxe que les fortunes les plus médiocres se permettent
facilement. Il est vrai que la manière dont les maisons de la Corrèze sont
bâties font de ce luxe une véritable nécessité.
Les
portes et les fenêtres des maisons de campagne de la province du Limousin
n’ont jamais été posées, je crois, dans une autre intention que celle d’empêcher
les |35 chiens et les autres animaux domestiques de faire dans
les appartements de trop fréquentes invasions ; quant à préserver des intempéries
des saisons, elles en sont absolument incapables. Elles laissent le vent
d’autant plus libre de siffler sur vos épaules qu’il peut s’introduire traîtreusement
par tous les interstices qui lui sont
amplement
ménagés par ces ouvertures malencontreuses, et il vous arrive froid et aigu
comme une lame d’acier, vous gratifiant en temps et lieu de quelque rhumatisme,
fidèle compagnon de vos dernières années.
Dans
un de ces antiques fauteuils dont j’ai parlé, était assise une femme de soixante-cinq
à soixante-dix ans, vêtue de deuil. Elle tenait à la main un tricot de laine
paraissant plutôt lui servir de contenance que d’occupation, car triste et
pensive, elle le laissait souvent échapper de ses mains d’une maigreur qui
les
rendait
presque diaphanes. On voyait pourtant que ces mains avaient dû être belles
; elles étaient encore d’une blancheur mate comme de l’ivoire, et les fines
rayures de leurs ongles allongés avaient conservé la teinte rosée qui les
embellissait jadis.
Sur
le visage on ne voyait aucune trace de beauté ; les tons bruns et jaunes
de la peau, l’irrégularité des traits attestaient que jamais cette femme
n’avait pu être belle. En jetant les yeux sur les portraits qui se trouvaient
dans le salon, il était facile de la reconnaître dans un costume de Diane.
Et bien que le peintre eût sans doute essayé d’embellir son modèle, il était
évident que si la Diane |36 chasseresse
avait eu un semblable visage, Actéon eût évité son malheureux sort17.
On était
frappé au premier regard par la froideur de la physionomie grave et austère
de la vieille dame de Roquevair, mais bientôt on trouvait dans ses petits
yeux, une touchante expression de bonté qui vous attirait vers elle ; et
le mouvement par lequel elle vous tendait sa main toujours si parfaitement
soignée, et dont une mitaine de soie noire dissimulait la maigreur, avait
une grâce si charmante qu’il était impossible de ne pas porter ses lèvres
sur cette main avec autant d’affection que de respect.
Devant
elle, sur un tabouret en bois, aux pieds bizarrement contournés, probablement
contemporain des vieux fauteuils, était assis un enfant paraissant âgé de
six à sept ans.

17 On se
rappelle que le chasseur Actéon surprit un jour Artémis, ou Diane, qui prenait
son bain, et, furieuse, le changea en cerf. Il fut déchiré par ses propres
chiens, enragés par la déesse.
Il
avait pose sur les genoux de la vieille dame des violettes et des primevères,
et ses petits doigts étaient fort occupés à en faire un bouquet. Il mettait
dans ce travail autant d’adresse que de goût, et l’accomplissait avec un
sérieux prouvant la grande importance qu’il attachait à sa parfaite exécution.
De temps
en temps il s’arrêtait pour jeter à la vieille dame un doux regard, et toujours
ce regard en rencontrait un autre attaché sur lui avec une indicible tendresse.
Alors il penchait sa tête sur les genoux de madame de Roquevair, imprimait
sur ses mains de doux baisers et reprenait son travail. |37
Il y
avait évidemment entre ces deux êtres dont l’un touchait à la tombe et l’autre
à son berceau une affection profonde. La ressemblance entre eux était frappante,
et cette ressemblance faisait du pauvre enfant, il faut en convenir, une
petite créature fort laide.
Nous
avons déjà fait le portrait de Paul, nous n’avons pas à y revenir : seulement
nous ajouterons que l’enfant était beaucoup plus laid que l’homme. Sa maigreur,
son cou brun et long sortant de son col rabattu sur sa petite veste de drap
noir ; sa figure tellement bistrée que le hâle était impuissant à la noircir,
faisaient de Paul un enfant absolument dépourvu de grâce et de fraîcheur.
En face
de madame Sardan de Roquevair, sa belle-fille, madame Louise de Roquevair,
comme on la nommait dans le pays, était presque couchée dans son vaste fauteuil,
elle travaillait à une broderie. Sur un petit guéridon placé auprès d’elle
se trouvaient quelques livres successivement ouverts et abandonnés.
L’ennui
le plus profond se peignait dans les beaux traits de la jeune femme.
Tout
à coup elle posa son ouvrage sur le guéridon et porta son mouchoir à la bouche
pour dissimuler ses bâillements.
-
Vous vous ennuyez, ma fille, lui dit sa belle-mère.
-
Mais non, Madame, je souffre, voilà tout
: c’est assez mon état habituel.
-
Oui, quand vous êtes seule avec moi et avec
vos enfants, murmura la vieille dame. |38
Sortie
de son apathie par l’interpellation de sa belle-mère, madame Louise de Roquevair
reprit avec humeur :
-
Ce sont ces fleurs qui me font mal ; comment
Paul avez- vous oublié que l’odeur pénétrante de ces violettes, m’irrite
horriblement les nerfs, et prenant des mains de l’enfant le bouquet presque
terminé, elle le jeta dans le feu.
Une
larme roula dans les yeux de Paul : il pencha sa tête sur les genoux de la
grand’mère et lui dit à voix basse :
-
C’étaient les premières que j’avais cueillies,
et elles étaient pour vous, bonne maman.
L’aïeule
pressa avec tendresse la tête de son petit-fils, sans répondre.
L’enfant
alors prit les primevères et dit à sa mère avec sa voix d’un timbre d’une
douceur infinie :
-
Maman, ces fleurs n’ont pas d’odeur, elles
ne pourront vous incommoder.
-
Non, sans doute, Paul : mais ne sauriez-vous
passer votre temps à faire autre chose que des bouquets ? Ma mère, vous oubliez
que cet enfant a douze ans ; il est si petit, si chétif, ajouta-t-elle avec
un geste de pitié dédaigneuse, que je conçois que vous vous fassiez cette
illusion ; mais enfin il a deux ans de plus que Louis, et il ne sait rien.
-
Paul, ma fille, a étudié toute la matinée
; il m’a récité toutes ses leçons ; je vous assure qu’il les sait parfaitement.
C’est moi qui l’ai engagé à se reposer quelques |39 instants que ce cher enfant a employés à travailler
à mon parterre et à me cueillir des fleurs.
-
Oh ! je sais que Paul est un excellent jardinier,
mais enfin comme il n’est pas destiné à exercer cet état, je désirerais qu’il
sût autre chose que planter des jacinthes et des tulipes, et faire des bouquets.
Pendant
cette petite altercation qui probablement devait se renouveler souvent entre
les deux femmes, Paul s’était levé pour prendre ses livres, et, revenu auprès
de sa grand’mère, il repassait ses leçons avec une ardeur qui colorait légèrement
ses joues.
Tout
à coup la porte du salon s’ouvrit bruyamment ; un bel enfant entra en courant
: il tenait à la main un bouquet de violettes semblables à celles que
madame de Roquevair avait jetées au feu il n’y avait pas dix minutes. C’était
son second fils, il se précipita dans ses bras, et le visage de sa mère resplendit
d’une orgueilleuse joie en le serrant dans ses bras.
-
Tenez, maman, dit Louis, voyez ces belles
violettes, je vous les apporte.
Madame
de Roquevair oubliant que l’odeur de ces fleurs lui faisait mal aux nerfs,
embrassa tendrement son fils et mit le bouquet dans son sein.
Paul
et son aïeule échangèrent furtivement et presque malgré eux un regard. Madame
de Roquevair toute au bonheur de caresser son fils ne s’en aperçut pas.
-
Ton précepteur va venir, mon cher Louis,
tu sais sans doute tes leçons. |40
-
Oui, maman, M. Duval sera content, vous savez
qu’il l’est toujours.
Et l’enfant,
s’asseyant sur un des bras du fauteuil, passa ses mains autour du cou de
sa mère, offrant aux baisers maternels son joli front ombragé d’une forêt
de cheveux bien bouclés.
C’était,
il faut en convenir, un bien bel enfant que Louis de Roquevair : il était
très-grand pour son âge, son teint était d’une fraîcheur éblouissante : il
ressemblait extrêmement à sa mère ; ses traits étaient plus régulièrement
beaux que ceux de madame Louise de Roquevair. Mais, comme ceux de sa mère,
ses pieds étaient trop grands et trop gros, et ses mains rouges et courtes,
aux ongles plats et carrés, dénonçaient la vulgarité de race.
Mais
la jeune dame de Roquevair aimait dans son fils jusqu’à ses défauts, il était
facile de voir que cet enfant régnait dans son cœur comme une idole unique.
Orgueilleuse de sa propre beauté, elle attachait aux avantages extérieurs
un prix extrême.
Elle
ne pouvait pardonner à Paul sa ressemblance avec son père et avec son aïeule.
Louis était son image à elle, il lui semblait que seul il était son fils.
L’instinct
de l’amour maternel s’était pourtant fait sentir auprès du berceau de son
premier-né, et peut-être que, s’il fût resté fils unique, elle eût été pour
lui une tendre mère. Quand on lui présenta l’enfant qu’elle venait de mettre
au monde, elle éprouva un véritable effroi. Louise n’avait jamais vu d’enfants
naissants ; et ces pauvres créatures |41 encore presque informes sont
plus propres à inspirer un tendre intérêt qu’une grande admiration. Paul
surtout noir et chétif était vraiment hideux.
Madame
de Roquevair crut avoir donné naissance à un monstre. On la rassura, mais
il fut peu difficile de lui persuader de renoncer à nourrir cet enfant.
Une
robuste paysanne vint allaiter Paul au château. Madame Louise de Roquevair
ne suivit pas sans intérêt le développement de la vie et de la forme chez
son fils. Cette petite figure était toujours très-laide ; mais enfin elle
avait l’apparence d’une figure humaine. La mère commençait à le trouver joli
; elle avait vu avec ivresse son premier sourire, elle l’aimait.
Au milieu
de ces heureuses dispositions, une nouvelle grossesse se déclara ; elle
fut excessivement pénible, la souffrance éloigna davantage madame de Roquevair
du berceau de Paul, et quinze mois après la naissance de cet enfant Louise
donna le jour à un second fils.
Quel
fût le ravissement de madame de Roquevair quand, après avoir jeté un regard
inquiet sur son enfant, elle vit le plus charmant nouveau-né. Sa petite
figure au lieu d’être d’un affreux rouge vif, couleur habituelle de ceux
qui font leur entrée
dans
la vie, était blanche et rosée, et de jolis cheveux noirs paraissaient sous
la dentelle dont on entoura pour la première fois son petit front.
Madame
Louise voulut nourrir cette délicieuse créature. Elle prétendit qu’on avait
fait violence à son cœur et à sa volonté en l’empêchant de nourrir Paul,
mais que |42 pour cette fois rien ne l’empêcherait de remplir le
plus sacré de tous les devoirs.
Comme
après tout, madame de Roquevair était d’une constitution robuste et très-capable
de supporter la fatigue des fonctions de nourrice, bien qu’elle eût l’habitude
de se plaindre de ses migraines et de ses nerfs, on céda à ses désirs : seulement,
sa belle-mère se pencha vers elle et lui dit :
-
Ma fille, prenez garde !
-
Pourquoi ? demanda Louise.
-
On s’attache à ses enfants, surtout par les
soins qu’on leur prodigue, par les sacrifices qu’on leur fait, vous serez
deux fois la mère de celui-ci et vous l’aimerez plus que son frère.
-
Il n’a pas dépendu de moi, répliqua Louise,
de remplir envers mon fils aîné mes devoirs de mère ; mon inexpérience m’a
fait cédera vos désirs et à ceux de mon mari : tranquillisez- vous, Madame,
Paul m’est excessivement cher, et si j’étais capable d’une préférence, elle
serait sans doute acquise à celui qui m’a le premier fait éprouver les douceurs
de l’amour maternel.
Madame
Sardan de Roquevair ne fut pas rassurée et elle avait raison. Louise se passionna
pour l’enfant qui était sa vivante
image
; elle lui donna le nom de Louis, le garda seul dans sa chambre. Sa belle-mère
offrit de prendre Paul dans la sienne, cette offre fut acceptée avec empressement.
La beauté de Louis rendait la laideur de Paul encore plus frappante et lorsqu’on
l’apportait |43 à sa mère souvent sans qu’elle l’eût demandé, elle disait
:
-
Ce malheureux enfant enlaidit tous les jours
: et, sans lui faire une caresse, elle le renvoyait à sa grand’mère.
Les
enfants grandirent, et avec eux le fol amour de la mère pour son second fils
et son éloignement pour l’aîné.
Paul
jamais caressé, souvent grondé aimait cependant sa mère avec une extrême
tendresse ; la douceur de son caractère, ses instincts affectueux le rendaient
incapable de jalousie. Il se faisait l’esclave de son frère avec un dévouement
sans égal : quelquefois celui-ci jetait ses bras autour de son cou en lui
disant : Mon petit Paul, tu es un bon frère, je t’aime bien.
Paul
lui rendait ses caresses en jetant sur sa mère un regard craintif ; quelquefois
il la voyait lui sourire, et touchée de sa soumission aux fantaisies de Louis,
elle lui donnait un baiser.
Pour
ce baiser, pour ce sourire, Paul eût consenti à voir ses plus beaux joujoux
brisés par son frère, bien que tous fussent un don de son aïeule, car cette
excellente femme, avait fini de son côté par accorder à Paul une affection
exclusive. Le caractère doux et timide de l’aîné de ses petits-fils convenait
mieux à son âge que la vivacité de Louis. Celui-ci toujours bruyant, exigeant
avec des cris que tout cédât à sa volonté, était le type parfait d’un enfant
gâté et il n’aimait que sa mère et son frère, parce
que
seuls ils supportaient sans murmure ses caprices sans cesse renaissants.
Mais
pendant que Louis, alors âgé de onze ans, court |44 dans le jardin en attendant M. Duval et que Paul étudie
avec ardeur, donnons quelques détails généalogiques et biographiques sur
les Roquevair et sur la famille Sardan ; ils sont nécessaires à l’intelligence
de cette histoire.
VII
Au commencement
des guerres de religion, la famille de Roquevair, une des plus illustres
du pays, embrassa le parti de la Réforme.
Les
Roquevair guerroyèrent à outrance, les frères d’abord, les enfants ensuite
; ils ne s’arrêtèrent que lorsque l’avénement de Henri IV au trône vint pour
un temps mettre un terme aux discordes civiles.
On sait
que ce prince aimait tendrement ses amis et ses partisans, mais il mettait
la politique avant le sentiment et, parvenu au trône, ses faveurs appartinrent
plus à ses ennemis qu’à ses amis. Il fallait s’attacher irrévocablement ceux-ci,
il savait qu’il pourrait toujours compter sur ceux-là.
C’est
à tort que ce calcul des prétendants arrivés au trône est traité de calcul
égoïste. Les rois ne régnent pas pour eux mais pour les peuples : en ralliant
leurs ennemis à leur pouvoir, ils assurent la tranquillité du pays; il est
donc sage d’immoler les sentiments du cœur, l’élan même de la reconnaissance
à l’intérêt général.
Les
amis des princes comprennent peu cette nécessité, ils ne sont pas eux-mêmes
assez dépourvus du sentiment |45 de l’intérêt personnel pour
faire le généreux sacrifice des faveurs
du
roi qu’ils ont contribué à élever sur le trône. Volontiers ils lui sacrifieraient
(je parle du temps des dévouements héroïques) leur fortune, leur vie et celle
de leurs enfants si besoin en était, mais ils ne peuvent sans colère sacrifier
à la consolidation de leur pouvoir l’honneur de jouer un rôle dans le nouveau
gouvernement et surtout celui de ne pas être seuls appelés à former l’entourage
du maître.
Il en
fut ainsi des seigneurs de Roquevair. Henri IV les remercia beaucoup, leur
prodigua avec une éloquence toute méridionale et un peu gasconne les éloges
les plus flatteurs ; il éleva très-haut les services qu’ils lui avaient rendus,
mais enfin la conclusion fut que n’ayant plus besoin d’eux, il leur laissait
toute liberté pour réparer les désastres de leur maison et leur donnait à
regret la permission de vivre dans leurs terres qui, plusieurs fois confisquées
et reprises selon les revers ou les succès, leur étaient enfin définitivement
rendues.
Il n’existait
alors que deux Roquevair, le père et le fils. Ils quittèrent Paris en maugréant
contre le roi : il leur avait fait don de son portrait ; ne sachant point
faire de vers ils répétaient ceux que d’Aubigné avait faits contre ce prince
au sujet d’un semblable présent.
Ce
prince est d’étrange nature, etc.18
Et ils
ajoutaient que le satirique avait bien raison en disant que le Béarnais était
le plus ingrat des mortels.

18 Voici
ce fameux quatrain d’Agrippa d’Aubigné (1552-1630) :
Ce Prince
est d’étrange nature, Je ne sais qui diable l’a fait : Mais il récompense
en peintre
Ceux qui
le servent en effet. (B.G.)
Mais
le bon Henri n’était pas là pour les entendre et |46 les eût- ils entendus qu’il ne s’en fût pas plus fâché
pour cela. Il savait bien que malgré tout on l’aimait et les seigneurs de
Roquevair dans le fort de leur ressentiment eussent tiré vingt fois l’épée
contre tout gentilhomme discourtois qui se fût avisé d’attaquer l’honneur
de leur maître, surtout s’ils l’eussent soupçonné d’être un ancien ligueur.
Ils
s’acheminèrent donc vers Roquevair parfaitement libres de chanter des psaumes
en français19 et de remettre
en culture les terres laissées longtemps en friche par suite des désastres
de la guerre.
Pour
cela il eût fallu de l’argent et messieurs de Roquevair n’en avaient point.
Ce n’était pas qu’ils eussent été plus sévères en fait de pillage et de rapines
que les mœurs d’alors ne le comportaient et qu’ils n’eussent usé largement
de ce qu’on appelait alors les droits de la guerre. L’usage avait force
de loi ; et si cette loi ne se trouvait point dans les in-folio latins renfermant
les éléments hétérogènes des droits et des coutumes, qui régissaient les
différentes contrées de la France, elle était reconnue de tous et tous mettaient
de la conscience à ne pas la laisser tomber en désuétude.
Mais
c’est surtout des biens acquis pendant la guerre qu’on pouvait dire que ce
qui arrivait au son de la flûte s’en allait au son du tambour20. Il ne restait aux Roquevair que quelques

19 La liturgie
protestante était en langue vernaculaire et les pasaumes le plus souvent
chantés dans leur traduction par Clément Marot (B.G.)
20 Le proverbe,
attesté depuis au moins 1664 par Furetière, porte plus précisément : « Ce
qui vient au son de la flûte / S’en retourne au son du
tambour.
» (B.G.))
bijoux
dont le prix fut à peine suffisant pour rendre habitable une partie du manoir
qu’ils avaient retrouvé dans le plus piteux état. |45
Ils
achetèrent quelques vaches et des troupeaux de moutons qui trouvaient dans
les terrains incultes et couverts d’ajoncs et de bruyère, une nourriture
suffisante. Leur grande occupation était la chasse. Du reste ils boudaient
leurs voisins catholiques ; ceux-ci de leur côté ne les regardaient pas d’un
très-bon œil. Le vicomte Jacques de Roquevair et son fils attendaient tous
les jours une lettre du roi qui les rappelât à Paris. Henri n’ayant que cela
à leur donner leur avait laissé cet espoir ; ils ne croyaient pas qu’il lui
fût possible de gouverner sans eux, et le soir, assis auprès de leur vaste
foyer, ils faisaient des plans admirables de réformes gouvernementales qu’ils
se promettaient bien de faire adopter.
Le temps
se passait ainsi : les lettres de rappel n’arrivaient pas. Pour prendre patience
le jeune de Roquevair se maria. La fortune de sa femme apporta un peu d’aisance
dans cette demeure délabrée.
L’irritation
du vicomte Jacques contre ce qu’il appelait l’ingratitude du roi avait atteint
son apogée : il ne comprenait pas comment à la cour on avait pu se passer
de lui ; mais il apprit tout à coup la désastreuse nouvelle de l’assassinat
de Henri, les froissements de l’orgueil furent oubliés ; l’ancienne affection,
telle que jamais roi n’en inspira de semblable, se réveilla vivace dans le
cœur du vieux Roquevair, et huit jours après, le vieillard expirait, tenant
entre les mains le portrait de
Henri
mouillé de ses dernières larmes. |48
Sous
Louis XIII, la fortune des Roquevair se maintint obscure. Ce fut en vain
que leurs coreligionnaires voulurent les entraîner dans le parti de la révolte.
Le vicomte Jacques, dans un voyage qu’il fit à Paris, avait vu Richelieu
; il comprit qu’un homme pouvait dans sa main puissante broyer un parti,
quand cet homme avait le génie de l’évêque de Luçon ; et puis il n’était
plus convaincu de la justice de sa cause ; il penchait vers un retour au
catholicisme. Son fils le plus jeune partageait ce sentiment et tout à coup
on apprit dans la province que le vicomte de Roquevair et un de ses fils
abjuraient le protestantisme.
Selon
l’usage, on méconnut les véritables motifs de cette conversion. On prétendit
que le désir d’obtenir la main de la fille du baron de Serres, connu par
l’ardeur de ses opinions catholiques, avait été pour beaucoup dans la décision
du jeune Roquevair. On ajoutait que le père avait été gagné par la promesse
de reparaître à la cour et d’obtenir un commandement dans l’armée.
Tout
cela était faux, le jeune Roquevair n’épousa point la fille du baron de Serres
à laquelle il n’avait jamais pensé, et son père resta tranquille dans le
manoir, restaurant ce qui était susceptible de restauration.
Le fils
aîné, zélé calviniste, abandonna le toit paternel et la France, il emmena
avec lui sa femme Sara de Bréhan et un fils en bas âge. Ils se retirèrent
en Hollande et s’y établirent. Dans l’espace de dix années |49 ils envoyèrent six lettres froidement respectueuses
au château de Roquevair ; elles annonçaient toutes la naissance d’un fils.
Le
vicomte de Roquevair resté en France fut moins heureux que son frère. Il
n’eut que quatre filles ; deux descendirent enfants dans la tombe, deux
se firent religieuses et le nom de Roquevair se trouva éteint en France.
Je ne
raconterai pas comment à la mort du dernier Roquevair, sa fortune avait subi
de tels échecs que la vente du château et des terres environnantes ne suffit
point pour payer les dettes.
Roquevair
passa en différentes mains, le vieux château fut entièrement abattu à l’exception
du donjon, le temps avait laissé peu de chose à faire aux démolisseurs, on
bâtit une maison moderne et fort laide, on y ajouta successivement, et le
château de Roquevair arriva à être enfin tel que nous l’avons dépeint au
commencement de cette histoire.
VIII
Dans
les dernières années du règne de Louis XIV, un nommé Pierre Sardan, après
trente ans de travaux dans le commerce, réalisa une de ces fortunes que les
habiles font aujourd’hui dans l’espace de cinq ou de dix ans, selon qu’ils
sont plus ou moins heureux ou plus ou moins honnêtes. |50
L’ambition
de Pierre Sardan satisfaite du côté de la fortune, il en sentit une autre
se glisser dans son cœur.
Il avait
un fils unique. Il le trouvait beau, spirituel, digne d’arriver à tout. Malheureusement,
pour arriver à tout dans ce temps-là, il fallait ou appartenir à une classe
privilégiée, ou posséder une de ces capacités hors ligne qui font sortir
un homme de la foule en dépit de tous les obstacles et le placent au premier
rang sans que personne ait le droit de s’en étonner.
Pierre
Sardan s’abusait bien un peu sur le mérite transcendant de son fils ; la
fable du hibou et ses petits trouvera éternellement son application. La progéniture
de Pierre Sardan n’était pas sans mérite, mais enfin la société ne perdait
pas grand’chose à ce que les lois du pays ne permissent pas au jeune Sardan
d’arriver à tout, et son père jugea prudent de ne pas trop attendre des qualités
éminentes de son fils.
Il
était assez riche pour acheter des titres de noblesse, il en acheta, et fit
partie des cinq cents bons bourgeois, dont en 1702 les lettres de noblesse
furent enregistrées, moyennant finance et qui tout d’un coup se trouvèrent
exempts de tailles, surtailles, taillons, guet, douanes, péages, pontonages,
etc., et eurent le droit de port d’armes, de chasse, de garenne, de colombier,
etc. Grâce à ces heureux priviléges, ils purent se persuader qu’ils étaient
les égaux des Crillon et des Montmorency.
En 1701,
une ordonnance avait permis à la noblesse de se livrer aux entreprises commerciales
sans déroger. II va |51 sans dire que la noblesse
de fraîche date se garda bien d’user de ce droit, et il n’y avait pas dix
ans que les Sardan étaient anoblis que MM. Sardan père et fils disaient avec
la bonne foi la plus candide :
— Nous
autres gentilshommes nous ne croyons pas pouvoir faire le commerce, sans
déroger : la loi de 1701 est une loi fatale à la noblesse, et qu’elle doit
considérer comme non avenue. M. Sardan fils acheta une compagnie : il eut
deux ou trois duels à propos de quelques plaisanteries que les officiers
du corps où il servait se permirent sur l’illustration de la race des Sardan.
Comme il était brave et assez instruit on finit par l’estimer et on ne s’occupa
plus de ses prétentions.
Vers
1728, M. Sardan acheta le château de Roquevair, se promettant de
lui rendre sa première splendeur. Il venait de marier son fils à une
demoiselle d’assez bonne maison, mais sans fortune ; il pensait que son petit-fils
prendrait le nom de la terre, et serait la souche d’une autre famille
de Roquevair.
Mais
Law vint en France ; M. Sardan faisait de fréquents voyages à Paris, il s’engoua
plus que personne de la fameuse banque, sa fortune y sombra, et il ne resta
aux Sardan que le pauvre manoir de Roquevair. Il ne fut plus question de
le restaurer, on se trouva trop heureux de pouvoir y vivre tant bien que
mal.
Par
suite de mariages avec des filles de financiers, la fortune des Sardan avait
repris son éclat. Ils ajoutaient |52 à leur nom celui de Roquevair,
et l’unique descendant de M. Pierre vivait depuis quelques années à Paris
avec sa femme quand la révolution éclata, il émigra et mourut quelques mois
après.
Les
dépenses qu’il avait faites à Paris pour soutenir ce qu’il appelait son nom,
avaient mis sa fortune dans le plus grand désordre et la révolution lui en
enlevait une grande partie par la suppression des droits seigneuriaux attachés
à la terre de Roquevair.
Sa veuve
après avoir réglé ses affaires, se retira à Roquevair avec son fils unique
âgé de seize ans dont elle avait elle-même dirigé l’éducation.
La fortune
de madame Sardan de Roquevair n’était plus assez considérable pour attirer
l’attention sur elle et devenir un titre à la proscription. La tempête révolutionnaire
passa auprès d’elle sans la toucher.
Quand
le calme fut rétabli, elle songea à marier son fils. Elle avait fait des
plans à ce sujet, mais au moment où ils allaient être couronnés de succès,
au moment où l’union qu’elle désirait devenait encore une chance de restauration
financière pour les
Sardan,
Paul déclara à sa mère qu’il avait fait un choix et qu’il aimait mademoiselle
Louise Rouvray.
Louise
Rouvray n’avait pas de fortune. Elle avait fondé sur sa beauté la réalisation
de ses rêves de mariage ; mais la petite ville de province dans laquelle
elle était contrainte de végéter, ne lui offrait qu’un petit nombre de |53 prétendants qui lui parussent dignes sinon d’obtenir
sa main au moins d’y aspirer.
Louise
lisait beaucoup de romans. Dans ceux qui avaient alors la vogue elle voyait
des effets merveilleux du pouvoir de la beauté sur les cœurs. En se regardant
dans son miroir, elle se disait, il faut en convenir avec raison, que la
beauté de ces illustres héroïnes n’était certainement pas plus parfaite que
la sienne. Tous les jours elle attendait que quelque grand personnage passant
par hasard dans la ville d’Uzerches tombât épris de ses charmes et déposât
à ses pieds, sans coup férir, sa fortune et sa main. Mais il passait peu
de voyageurs à Uzerches. Cette ville éloignée des grands centres de population
ne possédait rien pouvant attirer l’attention des touristes ; d’ailleurs
à cette époque ils étaient peu nombreux en France, tout ce qui pouvait porter
les armes étant touriste en Europe à la suite du grand voyageur qui rêvait,
comme Alexandre, l’empire
du
monde21.
Cette
circonstance d’une guerre européenne ôtait encore à mademoiselle Rouvray
la chance d’allumer les flambeaux de l’hymen, comme on disait alors.
Après
avoir attendu longtemps ce merveilleux inconnu qui n’arrivait pas et rejeté
avec dédain quelques bons et honnêtes

21 Allusion
à Napoléon Bonaparte, empereur des Français (1804-1815).
Limousins
qui s’étaient figurés que de cette femme aux airs de reine ils pourraient
faire une bonne ménagère, mademoiselle Rouvray s’aperçut qu’elle avait atteint
sa majorité. Ne voulant pas avoir le tort de certaine
fille un peu trop fière22, elle pensa sérieusement
à |54 se marier et se promit de ne pas refuser le premier
parti un peu sortable qui se présenterait.
Elle
était depuis près de quatre ans dans ces sages dispositions, lorsque M. Paul
Sardan vint passer quelques jours à Uzerches. Il se rencontra avec Louise.
Pour cette fois les romans eurent raison. Cette beauté parfaitement régulière
fit une profonde impression sur le jeune homme, la froideur de glace de la
physionomie de mademoiselle Rouvray lui parut de la modestie, et la hauteur
de ses manières de la dignité.
Il arriva
au jeune Sardan ce qui arrive à tous ceux qui se laissent dominer par une
première impression : ils voient dans ce qu’ils aiment non ce qui existe,
mais ce qu’ils désirent, et voilà pourquoi d’ordinaire les affections sont
si peu durables.
Louise
s’aperçut, peut-être avant M. Sardan lui-même, du sentiment qu’elle avait
inspiré. Elle pesa le pour et le contre de cette affaire, car Louise n’était
qu’à demi romanesque : elle s’abusait un peu sur les passions qu’elle croyait
devoir inspirer, mais fort peu sur son propre cœur.
M. Sardan
de Roquevair n’était pas très-riche, mais il était fils unique, et si cette
fortune ne pouvait donner l’espoir d’aller jouer un rôle dans une grande
ville, elle était suffisante pour la province.

22 Fable
de Jean de la Fontaine (1621-1695) : La Fille (Fables VII, 5, premier
vers).
M.
Sardan était très-laid, mais il n’en admirerait que davantage la beauté de
sa femme et lui saurait gré de l’affection qu’elle voudrait bien avoir pour
lui. Ce n’était |55 pas là ce qu’on avait rêvé,
mais on avait vingt-quatre ans !
Enfin
ce qui emporta la balance, ce fut le nom de Roquevair, on lui trouvait un
air de chevalerie. À la vérité quelques mauvaises langues disaient bien que
M. de Roquevair, car il n’était presque plus question du nom de Sardan, dont
on ne se servait guère que dans les actes publics, n’était pas un vrai Roquevair.
Mais qui pouvait prouver cela ? l’antique manoir lui appartenait : c’était
essentiel. Mademoiselle Rouvray décida qu’elle consentirait à porter le nom
de Roquevair.
Madame
Sardan ne sortait presque jamais du château ; elle recevait peu de visites
et la famille Rouvray n’avait avec elle aucune espèce de relations.
Deux
ou trois fois seulement madame Sardan avait aperçu Louise, elle avait rendu
justice à sa beauté, mais l’expression hautaine et dédaigneuse de la physionomie
de cette jeune personne l’avait également frappée et le souvenir de l’impression
qu’elle en avait reçue, suffit pour lui rendre infiniment pénible la déclaration
que lui fit Paul de ses sentiments pour Louise.
Madame
de Roquevair aimait tendrement son fils ; elle savait qu’il tenait à ses
idées avec une opiniâtreté qui n’était pas toujours justifiable aux yeux
de la raison. Elle s’avouait que dans cette circonstance elle n’avait pas
un motif raisonnable à faire valoir pour s’opposer à ce désir. Elle avait
des préventions, voilà tout. Son instinct maternel lui disait que cette union
ne ferait ni le bonheur de son fils ni le sien ; mais on ne combat
pas
les |56 résolutions d’un homme épris, par des préventions et
des instincts.
Madame
Sardan de Roquevair le comprit et après quelques observations, quelques avis
sur le danger des résolutions trop précipitées, sentant bien qu’elle tombait
dans les lieux communs et que le respect avec lequel on les écoutait n’était
pas sans un mélange d’impatience, elle donna son consentement.
Un mois
après, mademoiselle. Louise Rouvray entrait dans le vieux château comme dame
de Roquevair.
IX
Louise
avait trop de pénétration pour ne pas s’apercevoir que sa belle-mère n’éprouvait
pour elle aucune sympathie ; comme elle se sentait à son égard des dispositions
complétement identiques, elle se promit, non de gagner l’affection de madame
de Roquevair et de dissiper ses préventions, mais de se conduire constamment
avec elle de telle sorte qu’elle ne pût articuler un seul sujet de plainte
et qu’elle fût forcée de convenir que sa belle-fille ne manquait jamais aux
égards exigés par sa position et par son âge. C’est ce que Louise appelait
son devoir, elle était parfaitement décidée à le remplir. Or, pour Louise,
former une résolution et l’exécuter était une seule et même chose.
Louise
s’était fait sur le devoir des notions à elle ; il était difficile, quand
elle les expliquait, de ne pas les |57 trouver excellentes ; plus
difficile encore de la trouver dans la pratique en contradiction avec ses
théories ; mais tout en elle était si froid qu’il était impossible au bout
de quelques semaines passées avec elle de ne pas la trouver insupportable
; d’autant
plus
que tout en se sentant froissé par les angles aigus de ce caractère, on comprenait
qu’on ne pouvait le manifester sans paraître exigeant et injuste.
Louise
vous aurait dit de la voix la plus calme : De quoi vous plaignez-vous ? Aurais-je
manqué sans le vouloir à quelques- uns de mes devoirs envers vous ?
Le
fait est qu’on eût été fort embarrassé de répondre à cette question. Louise
ne se trouvait jamais en défaut : c’était chez elle une étude ayant pour
but non le bonheur de ceux qui l’entouraient, mais de satisfaire son orgueil
et de se faire une réputation dans le monde.
La mère
de Paul Sardan était non-seulement une femme d’esprit, mais encore une femme
de cœur. Elle se fût trouvée heureuse de reporter sur une belle-fille une
partie de l’affection qu’elle avait pour son fils. Elle eût été remplie d’indulgence
pour des défauts de caractère, pour des manquements d’usage de la vie sérieuse,
auxquels les femmes ont souvent de la peine à se plier jusqu’à ce que la
maternité ait complétement transformé la nouvelle épouse et lui ait fait
comprendre la sainteté de la vocation de la mère de famille.
Mais
tous ces beaux rêves de trouver une fille dans la femme de son fils s’étaient
évanouis. Madame de Roquevair se hâta de remettre à sa belle-fille les rênes
du gouvernement, |58 et celle-ci ne s’écarta jamais
du code de politesse et de convenances qu’elle s’était tracé et dont tous
les articles parfaitement prévus
et réglés
étaient observés avec une exactitude presque mathématique.
La douairière
de Roquevair savait à quelle heure sa belle-fille se présenterait chez elle
le matin, quelle formule respectueuse elle emploierait pour lui souhaiter
le bonjour : rien ne variait, pas même le jeu de la physionomie. Chaque heure
de la journée avait son exigence d’égards, pour madame de Roquevair. C’était
une machine bien montée dont le mouvement ne se dérangeait jamais, et madame
Louise ne paraissait pas se douter que le cœur pût inspirer quelque chose
de mieux.
Sa
conduite envers son mari était tout aussi froide, tout aussi compassée ;
jamais d’abandon, jamais d’épanchements ; pourtant l’empire qu’elle exerçait
sur lui était sans bornes, elle lui était très-supérieure, il le sentait
sans en être humilié ; tout son orgueil, toute sa personnalité s’anéantissaient
devant une femme dont il admirait la beauté et dont il s’exagérait l’intelligence.
La jeune
madame de Roquevair eût désiré restaurer et embellir le vieux manoir, mais
cette ambition était combattue chez elle par un esprit d’ordre qu’elle possédait
à un degré très- prononcé.
Elle
eut bientôt calculé, supputé les ressources dont la maison pouvait disposer
et les dépenses nécessaires pour les embellissements qu’elle eût désiré faire.
Ces dernières excédaient de beaucoup les premières. Réduire ses |59 plans à des proportions plus en rapport avec sa fortune
ne pouvait convenir à la jeune femme : cela l’eût mise tout au plus sur un
pied d’égalité avec quelques maisons bourgeoises des environs, mais ne rendrait
point au château de Roquevair sa très-antique splendeur, et n’en ferait pas
le roi de la contrée. — Elle trouva un compromis qui sauvait à la fois les
intérêts de son orgueil et
ceux de
ses instincts d’ordre.
Parlant
un jour devant sa belle-mère de la restauration de Roquevair, elle lui laissa
entendre qu’il faudrait détruire tout ce qui existait, sauf la vieille tour
dont l’ancienneté était un titre glorieux à conserver. Madame Sardan montra
peu d’enthousiasme pour des plans dont elle ne trouvait pas d’ailleurs la
réalisation possible ; elle dit qu’elle ne verrait pas sans regret disparaître
tous ces souvenirs ; qu’à la vérité cette
maison
avait peu l’air d’une châtellenie, mais que son fils y était né, et y avait
passé sa jeunesse avec elle.
Elle
convenait qu’un jardin anglais offrirait un aspect beaucoup plus riant et
plus pittoresque que le vieux jardin symétriquement dessiné : mais ses regards
y étaient habitués, et elle ne pourrait le voir disparaître sans regret.
La jeune
madame de Roquevair s’empara de cette donnée, elle déclara que les désirs
de sa belle-mère étaient une loi pour elle, que son devoir était de s’y conformer
en tout, qu’on ne toucherait pas à une pierre de la maison, que pas un arbre
ne serait arraché, que rien enfin ne serait changé. |60
Louise
dessinait assez bien, elle ne manquait pas de montrer à ses connaissances
des plans très-beaux sur le papier de tout ce qu’elle aurait fait si elle
n’avait pas dû respecter le désir manifesté par sa belle-mère de ne rien
voir changer autour d’elle. Son mari surtout fut dupe de cette déférence.
Il se serait jeté sans calculer dans les plus folles dépenses pour satisfaire
les désirs de sa femme : il lui sut gré de sa modération, de son respect
pour les exigences de sa belle-mère, et il ne douta jamais qu’une femme
si soumise, si polie, dévouée jusqu’au sacrifice, ne rendît sa mère parfaitement
heureuse.
M. de
Roquevair mourut peu de temps après la naissance de Louis.
La douairière,
à l’époque du mariage de son fils, s’était dépouillée en sa faveur de presque
tout ce qu’elle possédait et des droits qu’elle pouvait avoir à recouvrer
sur Roquevair.
Les
clauses du contrat de mariage de mademoiselle Rouvray dictées par le cœur
généreux et passionné de son mari étaient telles qu’à la mort de celui-ci
presque toute la fortune appartînt à Louise : elle se trouva le seul arbitre
du sort de ses enfants.
Des
religieuses chassées de leur couvent par la tempête révolutionnaire s’étaient,
après le calme, réunies de nouveau. Le nid où les saintes colombes avaient
autrefois abrité leurs ailes avait disparu dans la tourmente : elles en reconstruisirent
un autre à Uzerches. La supérieure avait trouvé pendant la proscription un
refuge au |61 château
de Roquevair, et une douce intimité s’était établie entre elle et la châtelaine23. Quand la mère Thérèse apprit que son amie était frappée
au cœur par la perte de son fils unique, sachant qu’il n’existait
aucune
sympathie
entre elle et sa belle-fille, elle lui demanda de venir chercher dans sa
maison la paix et le repos, dernier besoin qu’on éprouve au déclin de la
vie.
La douairière
de Roquevair refusa ; elle comprit qu’elle était encore utile dans cette
maison où elle avait tant souffert : il y avait là un pauvre enfant qu’elle
seule protégeait et aimait ; elle

23 Il y a là sans doute une réminiscence autobiographique.
L’auteure connaissait déjà, depuis 1832, l’abbé Michon, lorsque celui-ci
cré, en 1836, une nouvelle congrégation religieuse qu’il installa
dans les ruines de l’abbatiale Saint-Gilles de Puypéroux en Charente. Cette
abbatiale était une ruine dont le caractère l’avait frappé d’emblée quelques
années auparavant comme i le raconte lui-même dans sa Statistique monumentale
de la Charente : « Je n’oublierai jamais la profonde impression que me
firent ces ruines, la première fois que je les visitais. (…) Saintes et poétiques
ruines, vous eûtes alors sur moi ce charme des grandes choses dont le cœur
ne se défend pas je m’attachai à vous, je vous aimai »
ne
voulut pas s’en séparer. Il ressemblait extrêmement à son père et toute la
tendresse que le cœur de madame Sardan de Roquevair pouvait ressentir fut
portée sur cet enfant.
Ce fut
une nouvelle occasion de luttes entre elle et sa belle- fille. Celle-ci était
au fond très-satisfaite de voir sa belle-mère s’occuper exclusivement de
cet enfant qu’elle n’aimait plus. Mais l’abdication franche de ses droits
de mère en faveur d’une autre ne pouvait lui convenir. Son devoir était d’aimer
ses enfants et de s’en occuper. Il lui importait trop, non de remplir ce
devoir sacré, mais de faire croire qu’elle le remplissait, pour ne pas paraître
aux yeux du monde excessivement contrariée de l’ascendant de sa belle-mère
sur son fils aîné. Elle se plaignait sans cesse de la fausse direction donnée,
selon elle, à cet enfant, accusant la grand’mère de le gâter excessivement,
et, se posant en victime de la déférence qu’elle avait vouée à la mère de
son
mari,
finissait |62 par persuader au public qu’elle était la plus tyrannisée
des belles-filles et la plus tendre des mères.
Il faut
aussi constater que l’affection de madame Sardan pour son petit-fils, les
soins qu’elle lui prodiguait étaient pour la jeune femme un reproche incessant
de son indifférence pour son fils ; elle le sentait et s’en irritait. De
là de petites tracasseries mesquines, de petites guerres à coups d’épingle,
toujours dissimulées sous les marques du respect, car Louise ne se départait
jamais de son rôle. Au bout d’un certain temps elle se l’était tellement
assimilé qu’il lui était devenu naturel, et c’était de la meilleure foi du
monde qu’elle accusait sa belle- mère de vouloir lui enlever toute direction
sur son fils aîné et de chercher même à lui ravir l’affection de cet enfant.
Cette
dernière assertion était, certes, la moins fondée de toutes : madame Sardan
était une sainte femme. Elle ne parlait
pas
de ses devoirs comme sa belle-fille, mais elle les accomplissait sans orgueil,
quelque pénibles qu’ils lui parussent.
Elle
ne cherchait donc pas à contrarier Louise dans les plans d’éducation qu’elle
avait adoptés, bien qu’ils ne lui parussent pas toujours très-raisonnables
; elle se contentait de les modifier pour Paul sans que la mère, jalouse
de son autorité, pût s’en apercevoir.
C’était
pendant les longues matinées que madame de Roquevair passait seule avec son
petit-fils, qu’après les devoirs exigés par la mère et par le précepteur
elle jetait |63 dans l’âme de cet enfant les germes puissants de la
morale religieuse et initiait cette jeune intelligence aux éléments du vrai,
du bien et du beau.
Madame
de Roquevair avait une de ces organisations intellectuelles tellement puissantes
qu’elles se développent d’elles-mêmes et ne perdent rien à cet écueil d’une
solitude absolue où s’affaissent et se brisent tant d’intelligences qui ont
besoin du contact d’autres intelligences, pour recevoir tout leur épanouissement.
Une
bibliothèque où se trouvaient les immortels ouvrages du grand siècle et un
petit nombre d’auteurs modernes, l’étude de la nature et surtout celle des
plantes pour laquelle madame de Roquevair avait une prédilection particulière,
avait suffi pour conserver en elle le sentiment de ce qui est véritablement
beau et grand, et pour la mettre fort en état de donner à son petit-fils
cette éducation de l’esprit et du cœur, sans laquelle les études imposées
à la jeunesse deviennent une fatigue et ne lui inspirent que trop souvent
un dégoût profond.
Peut-être
y eut-il dans ces études particulières de Paul avec son aïeule quelque chose
de trop sérieux. L’enfance a besoin de mouvement, de rires bruyants, de joyeuses
folies. Paul ne jouait jamais qu’avec son frère, car sa mère réclamait seulement
sa présence quand elle lui était indispensable pour distraire et amuser Louis.
Mais comme elle faisait de fréquentes visites dans le voisinage, surtout
les dimanches, alors elle emmenait Louis avec |64 elle. Paul restait seul avec sa grand’mère et se trouvait
trop heureux auprès d’elle pour regretter de ne pas aller
comme Louis
dans les châteaux voisins jouer avec des enfants de son âge.
X
Nous
avons laissé les deux enfants, l’un assis aux pieds de sa grand’mère, l’autre
courant dans le jardin ou jouant bruyamment dans le salon.
M. Duval,
le précepteur des enfants, entra. C’était un homme d’environ quarante-cinq
ans. Depuis sa jeunesse il se livrait à la pénible carrière de l’enseignement
; l’ayant embrassée sans goût il la parcourait sans intelligence.
Il avait
essayé d’établir une maison d’éducation à Uzerches : il échoua dans cette
entreprise. Les mœurs de M. Duval étaient irréprochables ; mais il avait
la funeste passion du jeu ; il lui consacrait de trop longues heures ; son
établissement tomba, et, presque ruiné, M. Duval vint à Treignac, il y établit
une petite école.
Ce fut
dans ce moment que madame Roquevair voulut avoir un précepteur. On lui présenta
M. Duval ; son maintien humble, sa voix mielleuse la prévinrent en sa faveur;
elle vit qu’elle le dominerait facilement.
On l’avait
assurée qu’il était très-capable d’enseigner, et dans un sens on avait dit
vrai. M. Duval savait assez bien le français : il était fort bon latiniste
; ne sortant jamais des sentiers de la routine, il possédait parfaitement
|65 sa méthode. Personne plus
que
lui n’était capable de mettre des mots dans la tête d’un enfant ; pour des
idées c’était autre chose. M. Duval était un véritable pédant ; il était
persuadé qu’un homme possédant bien les règles de la syntaxe et expliquant
avec facilité les auteurs latins avait reçu la meilleure éducation possible.
Il fut
convenu que M. Duval se rendrait tous les jours au château pour y donner
aux enfants trois heures de leçons.
Désirant
garder un emploi très-lucratif pour lui, M. Duval flattait constamment la
prédilection de madame de Roquevair pour Louis. Il avait pour louer les heureuses
dispositions, la précoce intelligence de l’enfant, une éloquence ampoulée
dont l’effet était toujours certain sur le cœur de la mère.
Quant
à Paul, des reproches ou l’expression d’une dédaigneuse pitié pour son esprit
si peu développé étaient tout ce qu’il obtenait de M. Duval.
Le pauvre
enfant ainsi dirigé, ne recevant jamais une parole d’encouragement, faisait
peu de progrès dans la langue latine. Il était pourtant doué d’une mémoire
extraordinaire, mais quand il récitait ses leçons, le regard sévère de sa
mère, l’air dédaigneux du maître le troublaient tellement qu’il ne pouvait
retrouver dans sa mémoire bouleversée la moindre trace de ces mots qui quelques
heures auparavant s’y étaient classés sans effort et dans un ordre parfait,
et se hâtaient d’y reprendre leur place aussitôt que cette heure terrible
de la leçon sous le regard de
madame
de Roquevair était passée. |66
Depuis
trois ans il en était ainsi. Paul devint d’une excessive timidité, et cette
éducation première fut le principe de cette
défiance
extrême de lui-même, dont il ne put jamais s’affranchir.
Il en
vint à croire avec une grande sincérité que son extérieur était repoussant
et qu’il avait beaucoup moins d’esprit et de facilité que son frère : il
accepta cette position avec résignation. Elle aurait eu pour résultat de
le jeter dans un découragement complet, si la tendresse de sa grand’mère
ne l’avait sauvé de cet écueil.
Paul,
le jour où commence cette histoire, fut peut-être un peu moins grondé qu’à
l’ordinaire. Les graves événements qui se passaient préoccupaient tous les
esprits ; mesdames de Roquevair partageaient l’inquiétude générale, une partie
du temps consacré aux leçons se passait à questionner M. Duval, sur ce qu’il
pouvait avoir appris la veille.
La leçon
était tout à fait interrompue, lorsqu’on annonça la visite du curé, l’abbé
de Vermot.
C’était
la première fois qu’il venait à Roquevair, n’étant arrivé dans la paroisse
que depuis fort peu de jours. Madame de Roquevair s’étonnait déjà du retard
apporté à cette visite, aussi son accueil fut-il un peu froid.
L’abbé
de Vermot était un vieillard. Il n’avait jamais eu qu’une passion, la science
: prêtre fort jeune, il entra chez les bénédictins, espérant satisfaire le
besoin de savoir plus facilement dans la vie religieuse que dans un ministère
plus actif. |67
La révolution
vint bouleverser et les trônes et la vie du pieux cénobite ; jeté dans
l’exil il regretta sa cellule avec plus
d’amertume
que les seigneurs leurs châteaux et leurs somptueux hôtels.
Il poursuivit
avec le bâton du pèlerin le rêve de sa jeunesse, et bientôt il reconnut avec
bonheur que l’homme apprend plus et plus vite en ne restant pas constamment
dans le même milieu. On peut dans la vie du cloître acquérir une spécialité
souvent intéressante. Il est beau sans doute d’interroger le passé, de remuer
sa poussière et de le reconstruire avec ses débris ; mais si l’on se borne
là, alors on reste l’homme du passé et la science servira au plus à éclairer
certains faits historiques, objet des disputes des savants.
L’abbé
de Vermot avait consumé en veilles inutiles un temps précieux. Forcé de vivre
dans le monde et de l’étudier, il arriva à cette découverte que le présent
était d’un merveilleux secours pour comprendre le passé, que tous les siècles
avaient eu leurs orages et que ceux dont il était alors effrayé, comme ceux
des temps écoulés, étaient suscités par les passions des hommes, passions
toujours les mêmes, se reproduisant sous des formes diverses, mais gardant
une physionomie unique, un type qu’on retrouve à tous les âges. Il comprit
que l’humanité tournait comme fatalement dans le même cercle d’idées et de
besoins et que ses aspirations étaient, quant au fond, toujours les mêmes
;
l’humanité
est toujours adulte, elle ne vieillit point, mais elle subit les crises de
son immortelle |68 jeunesse ; elle a comme le
cœur humain plus de besoins, plus de désirs de bonheur qu’elle ne peut en
satisfaire ; elle cherche constamment la réalisation de ce rêve, ce rêve
n’est qu’un rêve, mais à sa suite le progrès marche, et pendant que le cœur
de l’individu s’épuise et meurt dans ses aspirations infinies, l’humanité
se renouvelle et
recommence
à parcourir avec ardeur la route où si souvent elle est tombée, mais où elle
doit marcher toujours.
L’abbé
de Vermot prit dans ses voyages le goût de l’histoire naturelle ; il arriva
bien vite à la préférer à celle de l’histoire des peuples. Ne trouvant dans
le passé et dans le présent que des sujets de tristesse, il se mit à étudier
avec ardeur ce grand livre de la nature dont nul œil humain n’a fixé la dernière
page.
Dans
cette étude, son âme se reposait, son esprit se calmait ; la découverte d’un
insecte, d’une plante jusque-là inconnus aux entomologistes et aux botanistes
suffisait pour rendre à l’abbé de Vermot la fraîcheur des idées de la jeunesse.
Qui l’eût rencontré dans les montagnes, la boîte de fer-blanc sur le dos,
et le filet à la main, ne se fût pas douté qu’il cherchait par une étude
en harmonie avec son caractère à échapper aux préoccupations douloureuses
où l’avaient jeté ses craintes pour l’avenir, non d’un pays, non d’une race
d’hommes, mais de l’humanité tout entière.
L’abbé
de Vermot prolongea ses voyages bien au delà du temps que dura la persécution.
Le désir de revoir sa patrie était combattu chez lui par un désir plus ardent
|69 encore, celui d’apprendre. Il parcourut une grande partie
du monde connu, mais sa santé se trouvant altérée parla fatigue, il revint
en France. N’ayant aucune ambition, il songea seulement à assurer
son
repos, à se procurer assez de liberté pour se livrer à l’étude, et faire
cependant un peu de bien aux hommes envers lesquels il se croyait des devoirs
à remplir comme prêtre. Il demanda la plus modeste cure de son diocèse, et
c’est ainsi qu’il arriva à Roquevair.
M.
Duval avait déjà vu plusieurs fois le curé ; il l’avait trouvé excellent
latiniste, ce qui lui avait donné de lui une très-haute idée : pour ses autres
connaissances il ne s’en occupait pas. Il avait bien vu M. de Vermot dans
son presbytère arranger des minéraux, des insectes, des coquillages ; il
avait même jeté un coup d’œil sur ses herbiers, entrevu ses instruments de
physique et son laboratoire ; mais il n’en était résulté pour lui que cette
idée : — Comment un homme ayant le bonheur de comprendre
Horace24 et
Perse25 et de les traduire
avec une rare élégance
peut-il passer son temps
à des futilités, à ramasser des cailloux et de hideuses petites bêtes ? Cela
paraissait bizarre à M. Duval.
L’abbé
de Vermot aimait beaucoup les enfants. La beauté de Louis le frappa ; il
l’attira à lui, et Louis bientôt parfaitement à l’aise avec son nouvel ami
l’amusa véritablement par la vivacité de ses reparties.
Mais
il y avait là un autre enfant à demi caché par le fauteuil de sa grand’mère.
Il considérait l’abbé avec un |70 œil avide et curieux. Il
savait qu’il avait beaucoup voyagé, et initié par la grand’mère à l’étude
de la nature il comprenait beaucoup mieux que son précepteur le goût qu’on
pouvait avoir à collectionner des insectes et des plantes.
Si l’on
eût monté au dernier étage de la tour de Roquevair dans ce lieu où les petits
pieds agiles de Paul pouvaient seuls pénétrer, on eût été surpris de trouver
là des collections moins bien classées et surtout moins rares et moins nombreuses
que

24 Quintus
Horatius Flaccus (65-8 av. J.-C.), auteur de Satires, d’Odes,
d’Épodes et d’Épîtres.
25 Aulus
Persius Flaccus (34-62), auteur de Satires.
celles
de la cure de Roquevair, mais annonçant pour l’étude un véritable goût très-rare
chez un enfant de l’âge de Paul.
L’abbé
de Vermot remarqua le regard intelligent de cet enfant attaché sur lui et
mêlé d’une surprise un peu naïve.
Paul
ne comprenait pas trop comment cet homme dont on vantait la science s’amusât
avec un enfant, comme si lui-même eût été enfant : cela lui paraissait une
étrange singularité : il ne savait pourquoi cette singularité le touchait
et lui inspirait pour l’abbé de Vermot quelque chose de semblable à ce qu’il
éprouvait pour sa grand’mère. Il eût donné tout au monde pour oser s’approcher
de ce prêtre au regard si doux ; son cœur était attiré vers lui ; il l’aimait
déjà, il désirait d’en être aimé.
L’abbé
de Vermot l’appela, et comme l’enfant hésitait : — Paul, lui dit sa mère,
avec cet accent impérieux qui le faisait toujours trembler, pourquoi ne vous
approchez-vous |71 pas, lorsque M. le curé a
la bonté de vouloir bien s’occuper de vous ?
L’enfant
vint timidement se placer auprès de son frère, lequel dans ce moment s’était
emparé du rabat du curé et le mettait autour de son joli cou, en faisant
de joyeux éclats de rire.
-
Excusez l’enfantillage de Louis, dit à l’abbé
de Vermot madame de Roquevair ; il est bien plus jeune que sa taille très-
développée peut le faire supposer : il n’a pas onze ans.
-
Je lui en aurais plutôt donné quatorze, dit
l’abbé. Et vous, mon enfant, quel âge avez-vous ?
-
J’ai douze ans, répondit Paul à voix basse.
-
Sans doute, monsieur le curé, vous n’auriez
pas supposé non plus que Paul fût l’aîné et qu’il eût près de deux ans de
plus que son frère. Le pauvre enfant est en tout au-dessous de son âge :
son intelligence n’est pas plus avancée que son corps ; tout est faible en
lui.
-
Il est moins faible que vous ne le croyez
peut-être, ma fille, dit la grand’mère dont le cœur maternel souffrait en
entendant parler ainsi de l’objet de sa prédilection.
-
Oh ! ma mère, je le sais : si l’on voulait
s’en rapporter à vous, Paul serait intelligent, et sa faiblesse physique
serait même plus apparente que réelle. Malheureusement je ne puis partager
cette opinion.
Dans
ce moment on vint appeler madame Paul de Roquevair. Elle sortit ainsi que
M. Duval. Louis les suivit. |72
Resté
seul avec Paul et sa grand’mère, l’abbé de Vermot s’occupa de l’enfant, lui
parla de ses études non en le questionnant, mais en causant avec lui. Paul
n’avait jamais trouvé cette bienveillance ailleurs que chez sa grand’mère
; il sentit sa timidité disparaître, parla de ce qu’il savait, surtout de
ce qu’il désirait d’apprendre, et l’absence de sa mère s’étant prolongée,
il en vint jusqu’à montrer à l’abbé de Vermot un herbier qu’il avait commencé
sous la direction de sa grand’mère. L’abbé de Vermot loua beaucoup, critiqua
un peu. Il vit que si madame Sardan de Roquevair avait enseigné son petit-fils
avec une méthode défectueuse, elle avait su lui inspirer cette curiosité,
ce désir ardent de savoir, sans lesquels il n’y a jamais de progrès.
Paul,
entendant revenir sa mère, se hâta de cacher son herbier, et revint se mettre
auprès de l’abbé tout rouge et tout confus.
Nous
avons voulu donner à nos lecteurs une idée exacte de ce qu’avait été l’enfance
de Paul pour faire mieux comprendre son caractère.
Il fut
voué d’un côté à la compression et à l’isolement, de l’autre il reçut d’une
femme, remarquable par l’esprit et par le cœur, une éducation intellectuelle
tout à fait en dehors des règles classiques ; mais cette femme avait beaucoup
souffert et elle avait elle-même un caractère timide.
Elle
avait de trop bonne heure traité Paul en homme fait, et jeté trop d’ombres
dans les jeunes années de cet |73 enfant. Au lieu de lutter
pour lui contre les préventions de sa belle-fille, elle lui avait appris
à aimer et à souffrir. Elle ne sut pas développer en lui les instincts très-énergiques
qu’il tenait de sa mère ; elle ne les devina pas. Ces instincts furent étouffés
par la crainte et par une éducation trop féminine, ils ne servirent qu’à
rendre Paul plus malheureux. Il fallait pour qu’ils se fissent
jour,
la pression d’événements imprévus qui, secouant cette nature forte et engourdie,
prouvassent que Paul, comme le disait sa grand’mère, n’était pas aussi faible
qu’il le paraissait.
À cette
époque de grands événements se préparaient : l’Europe entière était soulevée
contre nous. En France on commençait à se lasser d’une gloire achetée par
tant de sang et par tant de larmes.
Nous
n’avons point à établir ici comment la désorganisation de l’Empire s’opérait
autant par un travail intérieur que par les revers de nos armées. On ne vit
pas longtemps en France sans
être
soutenu par l’opinion publique. Qu’elle soit raisonnable ou égarée, formée
d’éléments mauvais, ou assise sur une base morale, il faut l’avoir pour soi.
On ne peut la négliger sans péril. La cause qu’elle abandonne fût-elle la
plus juste, la plus sainte, est une cause perdue. Or l’opinion publique était
alors contre l’empire : il dut tomber.
L’abbé
de Vermot apportait de Tulle des détails à la fois glorieux et tristes sur
cette lutte terrible du génie d’un seul homme contre des forces immenses
réunies contre lui. Les succès succédaient aux défaites et les défaites |74 aux triomphes, mais les défaites abattaient les esprits
et les triomphes ne savaient plus les ranimer.
L’abbé
de Vermot était sincèrement attaché à son pays. Ce drapeau déchiré par les
balles de l’étranger n’était pas celui que sa jeunesse avait animé et vénéré,
et pourtant il eût tout fait pour lui conserver l’honneur, C’était le drapeau
de la France, il en prévoyait la chute, mais il éprouvait un sentiment d’orgueil
national en voyant combien cette chute même serait glorieuse.
Les
espérances des royalistes se faisaient jour : l’abbé de Vermot les partageait,
mais il voulait surtout les voir adopter par la France et que seule elle
décidât de ses destinées.
La douairière
de Roquevair était ardemment royaliste. En cela il se trouvait un point de
contact entre elle et sa belle-fille ; seulement l’une était royaliste par
sentiment, l’autre par orgueil.
La mère
de Paul avait pris tout à fait au sérieux la splendeur du nom de Roquevair.
Assez ignorante de l’histoire de son pays et de celle de sa famille, comme
l’était alors la généralité des femmes, elle ne doutait pas que les Roquevair
des croisades ne
fussent
les aïeux de ses fils. Elle mettait sur le compte de la jalousie tout ce
qu’elle avait entendu dire, à l’époque de son mariage, sur l’illustration
de fraîche date des Sardan. Elle croyait ou voulait croire que le vieux château,
les vieux meubles et la vieille tour étaient, de temps immémorial, la propriété
de la famille de ses enfants, et non qu’elle les possédât, il |75 n’y avait pas un siècle, par droit d’acte de vente
bien
et dûment paraphé par le tabellion, après y avoir inscrit en termes grotesques
et barbares les conditions de la vente.
Les
idées de caste privilégiée étaient tout à fait en harmonie avec l’orgueil
et l’esprit de domination de madame de Roquevair. Elle se passionna de suite
pour une opinion dont le triomphe, à son avis, devait rendre à la noblesse
les droits qu’elle avait perdus et lui assurer à elle une position digne
du noble sang auquel elle s’était alliée.
La conversation
devint très-animée. On se communiqua ses craintes et ses espérances.
La jeune
femme s’aperçut que l’abbé de Vermot entretenait à Paris avec quelques personnages
importants une correspon- dance très-régulière. Sa considération pour lui
en augmenta. Elle se fit gracieuse, et l’abbé, qui avait tout étudié, hors
le cœur humain, finit par la trouver bonne et aimable ; et, déjà entraîné
par la distinction pleine de charmes de la belle-mère, il se promit beaucoup
d’agréments du voisinage du château de Roquevair, et presque tous les jours
il vint y passer quelques heures.
L’abbé
de Vermot s’aperçut bientôt de l’injuste prédilection de madame de Roquevair
pour le plus jeune de ses enfants. Cette découverte l’attacha davantage à
Paul. Assistant souvent
aux
leçons, causant beaucoup avec les enfants, il constata que l’aîné avait sur
son frère une grande supériorité d’intelligence.
|76
XI
Une
des phases de la destinée de l’Empire s’accomplit, et la maison de Bourbon
rentra en France, apportant dans les plis de son manteau fleurdelisé les
deux biens vers lesquels tendaient alors toutes les aspirations du pays :
la paix et la liberté.
Le
témoignage d’un homme resté fidèle au principe révolutionnaire dans ce qu’il
a de plus extrême, celui du républicain Carnot, n’est pas suspect. Il constata
que « le retour des Bourbons produisit en France un enthousiasme universel
: ils furent accueillis avec une effusion de cœur inexprimable. Les anciens
républicains partagèrent sincèrement la joie commune. »26
Il y
avait pourtant dans cette joie universelle un déplorable symptôme de décadence
morale sur lequel peut-être personne n’ouvrit alors les yeux.
Les
sentiments de délicatesse et d’honneur étaient-ils donc tellement affaiblis,
qu’il fût difficile de comprendre que ces

26 Cette phrase citée par de très nombreux auteurs
est de Lazare Carnot (1753-1823), Mémoire adressé au roi en juillet
1814, 6e édition, Paris,
Arnaud, 1815, p. 20 ; mais il faut lire la suite : « Mais l’horison ne tarda
point à se couvrir de nuages : l’allégresse ne soutint qu’un moment. » (B.G.)
défections
presque générales d’hommes qui devaient tout à l’Empire étaient une honte
? On voyait, sans en paraître surpris, cette tourbe d’ingrats reniant leur
passé, se pressant autour du nouveau pouvoir, s’engageant pour l’avenir,
et prodiguant l’insulte à celui qui les avait élevés si haut et qui avait
jeté sur leur nom le rayonnement de sa gloire. Il ne se trouva pas alors
une voix pour les flétrir, et on se fit illusion au point de croire
|77 que ces trahisons de la veille deviendraient
des fidélités du lendemain.
Tout
le monde sait quelles étranges prétentions s’agitèrent autour de la maison
de Bourbon. Tant de gens déclarèrent avoir activement travaillé pour elle,
on exalta si haut les sacrifices qu’on avait faits pour la cause sacrée de
la légitimité, comme on disait alors, que la légitimité aurait pu, à bon
droit, s’étonner d’avoir foulé si longtemps le sol de l’étranger. Ceux mêmes
qui semblaient l’avoir longtemps repoussée prétendaient qu’au fond ils l’avaient
toujours servie, et n’avaient accepté les divers ordres de choses qui s’étaient
succédé que comme des transitions nécessaires.
Quant
à ceux qui, complétement ignorés jusqu’alors, et qui, après la tourmente
révolutionnaire, rentrés dans leurs petits castels, avaient fait à l’Empire
une opposition sournoise dont il ne s’était jamais aperçu, vu qu’elle n’avait
pas dépassé les limites du foyer, oh ! pour ceux-là, il faut bien en convenir,
ils répétaient sur tous les tons :
……………..
C’est moi Qui seul ai rétabli mon roi.
Pour
ceux qui avaient franchement servi la maison de Bourbon, qui lui avaient
tout sacrifié, ils eussent été dignes d’être les héros d’un autre âge.
Ils s’imaginèrent, avec
beaucoup
de naïveté, que leurs services avaient été assez éclatants pour qu’il leur
fût inutile de les faire |78 valoir ; ils ne demandèrent
rien : presque tous furent oubliés. Et vraiment, au milieu de tant de dévouements
factices, de clameurs s’élevant de tous les côtés, se plaignant, réclamant,
exigeant qu’on escomptât et la fidélité passée et la fidélité à
venir, faut-il
s’étonner
qu’on n’ait guère eu le temps de penser à ceux qui, par respect pour eux-mêmes,
croyaient que leur honneur et leur fidélité n’étaient pas choses auxquelles
ils dussent mettre un prix. Madame Paul de Roquevair, avec ses prétentions
à l’illustration de sa race, crut sa famille appelée à jouer un rôle dans
le nouveau gouvernement.
Ses
enfants étaient trop jeunes pour prendre de suite la position à laquelle
leur nom leur permettait d’aspirer ; mais il s’agissait de les y préparer
et de faire valoir les services que leurs aïeux avaient rendus à la France.
La précieuse
ignorance où l’on était de l’histoire de sa famille permettait de donner
carrière à son imagination. On savait confusément que les Roquevair étaient
nobles de nom, de cri et d’armes. On se croyait modeste en ne faisant
remonter cette noblesse qu’au delà de la première croisade. Et si l’on eût
possédé le curieux tableau représentant le Déluge, dans lequel on voit un
beau valet en grande livrée présenter à une des fenêtres de l’Arche des parchemins,
en s’écriant : Sauvez
! sauvez les titres de la maison de L... !27 bien certainement on

27 L’anecdote,
qui connaît plusieurs variantes légères, est déjà rapporté en 1830 par Antoine-Louis
Regnault, Loisirs littéraires, Paris, A. Mesnier, 1830, p. 294:
« Tout le
monde connaît cette famille d’un grand nom, qu fit peindre un tableau du
déluge dans lequel un ange, des papiers à la main, descendait sur l’arche,
et les remettait à Noé, en s’écriant: Sauvez, sauvez les titres de la maison
de C***. » (B.G.)
eût
ajouté à la légende qui, selon l’usage du temps de cette mirifique peinture,
sort de la bouche du valet : Et de la maison de Roquevair ! |79
Il fut
donc décidé qu’on avait des droits incontestables à la faveur royale, et
la douairière de Roquevair, malgré son bon sens, ne se défendait pas de cette
flatteuse idée. Elle aussi était dans la persuasion qu’il y avait encore
des Roquevair.
L’abbé
de Vermot les en croyait sur parole, et ne contrariait pas trop ces rêves
d’ambition. Il avait sur la nécessité d’une forte aristocratie les idées
anglaises, et, au risque de lui faire perdre aux yeux de certains lecteurs
l’idée avantageuse que nous avons essayé de donner de lui, nous ajouterons
qu’il mettait fort au-dessus de l’aristocratie d’argent l’aristocratie de
naissance. Il soutenait qu’en admettant que les idées sur l’utilité et la
nécessité d’une noblesse héréditaire fussent des préjugés, ces préjugés lui
paraissaient plus féconds en résultats moraux que les idées opposées.
Les
Roquevair, pensait-il, n’étaient pas très-riches ; mais de bons mariages
arrangeraient tout cela, et ce beau nom reprendrait sa splendeur depuis si
longtemps perdue.
L’abbé
de Vermot formait déjà des plans pour la restauration des Roquevair. Il avait
une nièce fort riche ; c’était une enfant, et, dans sa pensée, il associait
l’avenir de la petite Cécile à celui de son cher Paul, pour lequel son attachement
croissait tous les jours.
Près
de trois ans s’étaient écoulés. Les événements de cette époque avaient tour
à tour éteint ou ranimé les espérances des dames de Roquevair. La
seconde Restauration |80 était
accomplie
; la tranquillité paraissait enfin assurée. Madame Louis de Roquevair annonça
l’intention de se rendre à Paris pour compléter l’éducation de Louis. L’abbé
de Vermot était présent.
-
Vous ne parlez pas de Paul ? demanda la belle-mère
avec une émotion dans laquelle il y avait un mélange de crainte et d’espérance.
-
J’ai beaucoup réfléchi, répondit Louise,
à ce qu’exigeaient de moi mes devoirs de mère de famille. J’aime mes enfants,
et bien que l’aîné ne réponde pas à mes espérances, il ne m’est pas moins
cher que son frère, et, pour me déterminer, je crois avoir consulté les intérêts
bien entendus de mes deux fils.
Le nom
de Roquevair ne doit pas rester enfoui au fond d’une province. La carrière
militaire est la seule convenable à l’homme qui a l’honneur de porter ce
nom; mais il faut, pour l’embrasser, une instruction que je ne puis faire
donner ici à mes fils.
Les
conduire à Paris, m’y établir avec eux, tel eût été mon désir : la médiocrité
de ma fortune est malheureusement un obstacle.
J’aurais
voulu réunir pour mes fils et l’éducation par la science, qui en eût fait
des hommes distingués et capables de servir utilement leur pays et leur souverain,
et l’éducation du monde dans lequel les Roquevair sont destinés à vivre ;
je désirerais qu’ils y apportassent cette distinction de manières qui s’allie
si bien avec la distinction |81 de race, et qu’ils fussent
à la
fois
et des hommes instruits et des hommes de bonne compagnie.
Peut-être,
ajouta Louise en s’adressant à l’abbé de Vermot, trouvez-vous dans ce double
désir une vanité un peu puérile ?
-
Pas du tout, Madame, dit l’abbé en souriant
toutefois avec un peu de malice, tant de femmes se contenteraient de voir
leurs enfants briller dans le monde, qu’on doit vous savoir gré de ne mettre
cet avantage qu’en seconde ligne.
-
Quoi qu’il en soit, reprit madame de Roquevair,
j’ai dû renoncer à réaliser toutes mes espérances. J’ai deux fils, mais un
seul peut soutenir le poids du nom de Roquevair. Paul n’aura jamais la taille
d’un soldat, et son intelligence n’est pas beaucoup plus développée que sa
chétive personne. Je suis donc décidée à n’user de mes faibles ressources
qu’en faveur de celui qui, seul, m’offre une chance d’arriver à mon but.
Je vais
partir pour Paris avec Louis. J’espère que les services de ses aïeux, les
sacrifices que notre maison a faits pour la cause royale parieront assez
en faveur de Louis pour qu’il ne me soit pas difficile de le faire entrer
dans quelque temps page dans la maison du roi. Une fois là, je compte sur
son intelligence et sur son cœur pour faire le reste.
Quant
à Paul, ne pouvant faire pour lui que des sacrifices toujours inutiles, je
le laisserai à ma belle-mère. Je vois d’ailleurs qu’il est de mon devoir
de ne pas la priver |82 à la fois de tous ses enfants.
M. Duval me suivra à Paris comme répétiteur et surveillant de Louis.
Je sais,
monsieur le curé, combien vous aimez Paul. Vous m’avez plusieurs fois offert
de vous charger exclusivement de son éducation ; je crois pouvoir vous dire
que cette offre, je l’accepte aujourd’hui avec reconnaissance.
L’abbé
de Vermot assura madame de Roquevair qu’il travaillerait à l’éducation de
Paul avec autant de bonheur que de dévouement.
Tout
en souffrant dans son cœur maternel de voir Paul entièrement sacrifié à son
frère, madame Sardan de Roquevair ressentait une joie très-vive en pensant
qu’elle ne serait point séparée de cet enfant, et qu’il recevrait, grâce
aux talents supérieurs de l’abbé Vermot, une éducation appropriée à son individualité
si nerveuse et si délicatement impressionnable ; que cette jeune intelligence,
délivrée de ces dédains et de cette contrainte morale que sa mère avait fait
constamment peser sur lui comme un manteau de glace, se développerait en
liberté, et que ce ne serait pas seulement à ses yeux et à ceux de l’abbé
de Vermot que Paul paraîtrait merveilleusement doué.
— Quant
à sa taille, se disait la bonne grand’mère, qu’importe après tout ? Est-il
donc nécessaire d’avoir plus de six pieds pour porter noblement un nom illustre
? Il résulta de tout ceci que les arrangements de madame de Roquevair ne
rencontrèrent aucune opposition, |83 et, comme elle était, prompte
à exécuter ses décisions, huit jours après, elle partit pour Paris avec Louis
et le pédant M. Duval.
Le désespoir
de Paul en se séparant de sa mère arracha quelques larmes à celle-ci, et
elle lui prodigua de ces caresses maternelles qui depuis longtemps étaient
réservées seulement à Louis.
Paul,
cet enfant né avec une organisation d’une sensibilité si passionnée, sentit
son amour pour sa mère s’augmenter par l’absence. Il oublia sa froideur :
il se persuada qu’il avait toujours mérité ses reproches et ne se souvint
que de ses derniers baisers et des larmes qu’il avait vues couler sur ce
beau visage pâli par l’émotion. Ces larmes étaient à la fois une douleur
et un bonheur pour lui ; sa mère l’aimait ; il se reprochait comme un crime
d’en avoir quelquefois douté, et
toute
la tendresse de la grand’mère et de l’abbé de Vermot fut longtemps impuissante
à vaincre sa profonde mélancolie.
Nous
avons beaucoup insisté sur l’enfance de notre héros parce que nous tenions
à le bien faire connaître, à expliquer ce qu’il y a eu d’étrange dans sa
conduite et dans l’opinion qu’on se forma si longtemps de lui dans le monde.
Il fallait qu’on comprît combien les impressions de son enfance et de sa
première jeunesse ; son éducation à la fois soignée et négligée avait exercé
sur lui une influence fatale à laquelle il ne devait jamais se soustraire.
À présent
nous allons laisser Paul grandir un peu, très-peu, |84 pas assez pour faire un soldat, comme disait sa mère.
Nous allons le laisser s’initier à la science avec l’abbé de Vermot et amasser
en lui des trésors qu’il fut donné à peu de personnes de connaître.
Nous
dirons peu de chose du séjour de madame Roquevair à Paris.
Toutes
ses espérances avaient été loin de se réaliser.
Le nom
de Roquevair ne produisit pas l’effet sur lequel elle avait compté.
Elle
trouva de la difficulté à le faire adopter ; elle avait des lettres de recommandation
pour quelques maisons dufaubourg Saint-Germain. On la reçut poliment ; mais
elle n’avait ni assez de fortune ni assez d’élégance, ni une position sociale
assez reconnue pour être admise, comme elle l’avait espéré, sur le pied de
l’intimité et de l’égalité. On semblait lui demander : D’où venez-vous, et
que nous demandez-vous ?
Elle
comprit enfin que ce n’était pas assez que d’avoir une vieille maison et
une tour en ruines portant le nom de Roquevair pour ne pas être à Paris confondue
dans la foule.
Quelques
informations prises auprès des personnes qui s’étaient un peu
fourvoyées en donnant des lettres d’introduction amenèrent
la découverte du nom de Sardan. Or jamais d’Hozier28 n’avait établi pour un nom semblable
les titres constatant le droit de monter dans les carrosses de la cour.
Les
Rouvray de la Corrèze bien qu’ils prissent la particule |85 depuis la Restauration étaient connus seulement pour
avoir fait fortune dans le commerce en gros de l’épicerie et de la droguerie.
On se
nomme Roquevair, c’est bien. Ce nom est connu dans l’histoire ; mais quand
on le porte par droit de naissance, on tient à quelqu’un et à quelque chose
; on n’est pas seulement greffé sur des Sardan, gens de finance et sur des
Rouvray, marchands de cannelle.
Toutes
ces réflexions assez justes d’ailleurs firent que madame Sardan de Roquevair
ne put prendre pied dans ce monde aristocratique qu’elle avait rêvé être
le sien. Elle y conserva quelques relations isolées et non intimes, grâce
à l’abbé de Vermot. Mais tout se borna là : son fils n’entra point dans les
pages. Mais comme il avait de l’intelligence et qu’il avait pris assez l’amour
du travail, il fut reçu à Saint-Cyr sans

28 Charles
René d’Hozier (1640-1732), juge d’armes, généalogiste du roi, auteur du
Grand Armorial de France établi sur ordre de Louis XIV en 1696 et
comprenant 120 000 blasons peints.
qu’il
fût nécessaire de recourir à d’autre protection qu’à celle de son mérite
personnel.
En 1823,
Louis sortait de Saint-Cyr, avec les épaulettes d’officier, et Paul arrivait
à Paris. Un crêpe noir était à son chapeau, son visage portait l’empreinte
d’une douleur profonde. Sa bonne grand’mère n’était plus.
XII
-
Vraiment, Paul, les sept ans qui se sont
écoulés depuis que j’ai quitté Roquevair ne vous ont presque pas changé,
vous avez très-peu grandi, et il serait difficile, en |86 vous voyant, de s’imaginer que vous êtes majeur, et
que vous êtes venu à Paris pour régler avec votre mère vos comptes de tutelle.
Telles
furent les paroles que madame de Roquevair adressa à son fils peu d’instants
après l’arrivée de celui-ci à Paris.
Paul
était singulièrement ému. Il trouvait, lui aussi, que ces sept années avaient
laissé peu de traces sur le visage de sa mère. C’était bien elle, telle qu’elle
était toujours restée dans ses rêves depuis le moment de la séparation, seulement
alors l’éclat de ses beaux yeux était terni par des larmes et sa voix avait
un timbre caressant et doux, bien différent de cette voix sèche et brève,
dont l’accent était encore plus amer que les paroles. C’était la mère qui
dans son enfance lui inspirait une crainte ressemblant quelquefois à de la
terreur. Paul comprit qu’ils n’avaient changé ni l’un ni l’autre : il aimait
sa mère ; il n’en était pas aimé et il la redoutait toujours.
-
Je suis venu à Paris, lui dit-il, parce que
vous m’y avez appelé, ma mère ; et je n’ai encore pensé qu’au bonheur de
vous revoir, ainsi que mon frère.
-
Pourquoi êtes-vous encore en grand deuil
?
-
Il n’y pas un an que ma grand’mère est morte,
répondit Paul, et ses yeux se remplirent de larmes.
-
Eh bien, votre deuil est fini depuis longtemps,
le prolonger serait de l’affectation : que feriez-vous de plus pour votre
mère ?
D’ailleurs,
Paul, vous allez vivre dans un monde qui |87 n’est
pas
celui de la province. Il est probable que vous ne retournerez plus à Roquevair.
J’ai reçu au sujet de cette terre des propositions très-avantageuses, j’ai
l’espoir d’obtenir plus encore, et si cet espoir se réalise, je vendrai.
-
Vous vendrez Roquevair ! s’écria Paul.
-
Vous pâlissez, je crois : vendre Roquevair
vous paraît un sacrilége, n’est-ce pas ? Vos lettres me l’ont fait pressentir,
vous avez des idées on ne peut plus romanesques. Je dois vous prévenir que
ceci est du plus mauvais goût, surtout quand on est loin d’avoir la figure
et la tournure d’un héros de roman.
Travaillez
donc à vous défaire, même avec moi, de ces sentimentalités qui vous ont été
inspirées par votre aïeule : elle trouvait cela très-beau, c’était un reflet
de sa personnalité ; mais moi qui ne vois la vie que par ses côtés réels,
je trouverais ces exagérations très-ridicules, surtout venant de vous.
Mon
pauvre enfant, une mère doit toujours la vérité à son fils : eh bien ! la
nature vous a traité un peu en marâtre et vous devez chercher à être assez
simple dans vos manières et dans votre langage pour passer dans le monde
sans trop attirer l’attention. Voilà pourquoi je vous conseille de vous défaire
de votre crêpe, de votre gilet, de votre cravate noirs et de vos airs lugubres.
Il
ne
me convient pas de vous voir poser dans mon salon pour l’exagération du sentiment
filial.
-
Mon intention, ma mère, n’est point de paraître
|88 dans le monde ; vivre dans votre maison, vous voir lorsque
vous serez seule, travailler à perfectionner mon éducation, c’est tout ce
que j’ambitionne.
-
Voilà un très-beau plan ; je suis loin de
le désapprouver, seulement je vous préviens que vous ne devez pas renoncer
entièrement au monde. Je reçois beaucoup : mon fils aîné ne doit pas avoir
l’air d’être exilé ou de s’exiler lui-même de mon salon.
Quant
à vos comptes de tutelle, je dois vous dire qu’une partie de ma dot ayant
été perdue par suite des révolutions (il était de mode alors d’accuser la
révolution de ses pertes de fortune), la terre de Roquevair est insuffisante
pour le recouvrement de mes droits. Vous êtes donc, ainsi que votre frère,
entièrement sous ma dépendance. Car ce que votre grand’mère vous a donné
ne peut suffire pour vous y soustraire. Consultez mon contrat, le testament
de votre père, et vous verrez que je me renferme avec vous dans la stricte
vérité. Sans l’héritage de ma tante je serais pauvre moi-même. Au reste,
je vous le répète, consultez un homme de loi.
-
Cela est parfaitement inutile, ma mère ;
je suis heureux de dépendre de vous et lorsque je croyais avoir quelques
droits, ma pensée était de vous les abandonner.
-
C’est très-beau, très-beau, assurément, dit
madame de Roquevair. Vous êtes pour les sentiments héroïques, les désintéressements
sublimes. Je ne croyais pas que ma belle-
mère
vous eût inspiré pour moi des sentiments aussi chevaleresques.
|89
Telle
fut la première entrevue de la mère et du fils.
Louis
était une bonne nature, pas trop gâtée par une adulation continuelle. Il
était bien un peu fat, un peu présomptueux ; mais il avait une si charmante
figure, une gaieté si franche ; il était orgueilleux avec tant de naïveté
; sa bourse était si souvent au service de ses amis, il avait tant d’indulgence
pour leurs prétentions bien ou mal fondées, qu’il était difficile de ne pas
l’aimer. Il n’avait pas une très-grande valeur réelle, mais il était cependant
loin d’être un homme ordinaire. Il fut très-heureux de revoir son frère,
il l’avait toujours beaucoup aimé ; mais il ne put s’imaginer que Paul était
son aîné. II le trouva si gauche et si timide qu’il fut bien obligé de le
prendre sous sa protection. Heureusement que les airs protecteurs de Louis
n’étaient pas sans un mélange d’affectueuse bonhomie et que Paul ne demandait
pas mieux que de se laisser dominer.
Une
grande intimité s’établit entre les deux frères, et madame de Roquevair fut
entraînée à une certaine bienveillance envers cet enfant que Louis aimait.
Nous
trouvons ici dans des papiers qui nous ont été confiés, des lettres de Paul
à l’abbé de Vermot : elles auront leur intérêt.
PAUL À
L’ABBÉ DE VERMOT.
«
Vous comprenez, cher et respectable ami, combien mon cœur a été rudement
froissé par la réception dont je viens de vous faire le récit. |90
«
Je ne puis me plaindre qu’à vous : ces souffrances de l’âme que j’éprouve,
nul ici ne les comprendrait. Je suis seul, absolument seul. Mon frère, il
est si léger... ! Il vient d’obtenir d’entrer dans la garde royale : il est
ivre de joie :il aura un bel uniforme, de beaux chevaux ; que lui faut-il
de plus ? il ne rêve que plaisirs. Envisager la vie par ses côtés sérieux
ne saurait entrer dans sa pensée. Nous nous aimons, et je cause volontiers
avec lui. Il me reproche un peu de pédantisme lorsque je veux lui parler
raison et surtout l’engager à consacrer à l’étude de l’état qu’il a embrassé
les longues heures que son service lui laisse libres. Lui, de son côté, voudrait
me donner un peu de son usage du monde et surtout de cet aplomb imperturbable
qui naît sans doute de l’heureuse persuasion de son mérite.
« Vous
voulez connaître toutes les impressions que j’éprouve en entrant dans un
monde entièrement nouveau pour moi.
«
Dans ce moment il me serait difficile de les analyser.
« Je
suis dans une espèce d’étourdissement physique et moral qui ne me permet
pas de distinguer ce que j’éprouve : la sensation dont je me rends le mieux
compte est celle de l’isolement.
« Je
sens le besoin d’arranger ma vie, et je ne sais par où commencer. Je me demande
quelquefois si cela est possible ici.
«
Mon frère m’a déjà fait parcourir une partie de Paris : |91 j’ai
vu les
jardins publics, les bibliothèques, les musées, les églises, les colonnes,
les arcs de triomphe, Versailles, Saint-Cloud, Saint-Denis, Sèvres, Meudon,
tout cela dans dix jours !
« C’est
vous dire je n’ai presque rien vu, tout est entassé pêle- mêle dans mon cerveau
fatigué : je n’ai retiré de mes courses vagabondes que la conviction plus
grande que Paris est pour l’artiste et pour l’homme de science une ville
incomparable où l’intelligence peut puiser aux sources les plus capables
de l’élever et de l’agrandir.
«
Vous prétendez, mon ami, que je suis artiste et poëte : si cela est, c’est
bien sans m’en douter. Elle fut bien sérieuse, la surprise que j’éprouvai
lorsque le hasard vous ayant fait rencontrer dans le parc de Roquevair des
poésies que j’y avais composées et oubliées, vous m’assurâtes qu’elles n’étaient
pas mauvaises.
« Vos
éloges m’ont fait du bien parce que je ne les ai pas suspectés de partialité.
Excepté ma bonne grand’mère vous êtes le seul qui m’ayez jamais dit : C’est
bien, et qui, posant votre main sur mon front, ayez ajouté : Il y a vraiment
quelque chose là.
« De
ce moment je me suis livré à l’étude avec plus d’ardeur : les arts, les sciences
seront les compagnons fidèles de ma vie, je les aimerai d’un amour désintéressé,
je n’attends d’eux ni la gloire ni les honneurs ; je ne leur demande que
d’être le but de mes aspirations et de me faire vivre de la vie de l’intelligence,
si je devais renoncer |92 un jour à vivre seulement
par le cœur, comme j’ai vécu jusqu’à présent.
« Oh
! la vie du cœur, qui me la rendra ? n’est-elle pas descendue dans la tombe
avec mon aïeule ? la pierre du sépulcre se soulèvera-t-elle jamais pour lui
permettre, de me rendre mes joies perdues ?
« Aimerai-je
? serai-je aimé ? Mon ami, votre front est couronné de cheveux blancs ; mais
votre cœur n’a rien perdu de l’ineffable tendresse dont il fut doué, c’est
parce que vous n’avez jamais profané le feu sacré, que ses derniers rayons
colorent si chaudement le déclin de votre vie. Vous trouvez dans votre sœur
une âme qui correspond à la vôtre, une amitié éprouvée par le temps, par
la séparation, par tous les orages dont vos deux existences ont été remplies,
et moi je suis seul au monde !
«
Mon Dieu que le délire des passions avec ses enivrements soit à jamais éloigné
de moi ! mais qu’un cœur se rencontre sur ma route sur lequel je puisse avec
confiance appuyer le mien !
« En
écrivant ces lignes je sens mon front rougir, il me semble que je vois votre
regard si bon, et pourtant un peu malicieux, se fixer sur moi, et sonder
ma pensée. Cette pensée qui ne s’est jamais produite librement que devant
ma grand’mère et devant vous, pourquoi craindrais-je de vous la laisser pénétrer
!
« Oui,
je pensais à Cécile. Oui, son cœur est celui dont la possession me paraît
le premier des biens de la terre. Je n’aurais jamais osé y aspirer, mais
un jour vous m’avez |93 dit : Cécile est ma fille
aimée et je serai heureux si vous devenez mon fils ; votre sœur m’a tenu
le même langage. Ce jour-là il s’est fait une révolution dans moi ; j’ai
compris ce que j’éprouvais. Ce
n’était
point une de ces passions ardentes comme les dépeignent les poètes et dont
leur imagination exagère peut-être les transports ; mon cœur, je crois, n’est
pas fait pour elles. C’était un de ces sentiments profonds par lesquels,
on le sent, l’existence doit être à jamais remplie. Mais Cécile est si jeune,
quand elle entrera dans le monde elle comparera. Serai-je alors l’objet de
son choix, m’aimera-t-elle encore et suis-je fait pour être aimé ?
………..
J’éprouve dans ce moment un vif chagrin. Ma mère désire vendre Roquevair.
Vous savez qu’elle ne l’a jamais aimé. On lui fait, dit-elle, des offres
très-avantageuses ; elle paraît décidée à les accepter, pour peu qu’on les
augmente.
« Cette
propriété, dit ma mère, rapporte fort peu. Il serait possible que dans des
mains intelligentes pouvant y appliquer les nouveaux procédés de l’agriculture,
cette terre acquît une valeur bien au-dessus de celle qu’elle a aujourd’hui.
Mais Louis est appelé à une carrière plus convenable au nom qu’il porte ;
ainsi il n’y faut plus penser.
«
Je veux proposer à ma mère de m’adonner à l’étude de l’agriculture et d’être
le régisseur de Roquevair. Pour conserver le lieu où fut mon berceau, le
lieu où reposent les restes chéris de ma grand’mère, je suis capable de |94 me livrer à une étude qui ne m’inspire qu’un médiocre
attrait. J’aime la campagne en artiste et en poëte, pas du tout en agriculteur
et en propriétaire.
« Toutefois
j’aime le peuple, vous le savez, et je me mêle volontiers aux bons habitants
de nos campagnes. Il y a dans leurs traditions populaires, dans les coutumes
bizarres qu’ils ont conservées, une grande poésie dont ils ont le sentiment
sans en avoir l’idée. On peut étudier chez eux les derniers vestiges des
mœurs des races antiques, C’est un filon que les hommes de la science historique
devraient se hâter d’explorer avant que la civilisation ne soit venue dans
ces contrées niveler et effacer entièrement le passé.
« Combien
je regretterais ma vieille tour où j’allais dans mon enfance et dans ma première
jeunesse faire mes herbiers, mes collections, composer mes premiers vers.
« Depuis
longtemps, grâce à ses dégradations, mon pied seul pouvait courir le risque
de gravir son escalier ; seul je connaissais les saillies offrant quelque
solidité : j’ai pris là mes premières leçons de gymnastique ! Aussi, mon
ami, fûtes-vous tout surpris lorsque pour me fortifier vous voulûtes m’initier
à cet art, vous trouvâtes que je n’avais que les principes à apprendre.
« C’est
que, voyez-vous, dans mon enfance j’éprouvais le double besoin du repos et
de l’activité : repos de l’âme, repos du cœur, mais besoin de locomotion,
besoin un peu contrarié par ma grand’mère qui semblait |95 toujours craindre de voir mon petit corps en apparence
si frêle, se briser.
« Je
voulais le fortifier, j’avais lu dans je ne sais quel livre que des exercices
violents pouvaient donner à un être faible un force
extraordinaire
et je me mis à user de cette méthode à ma manière.
« Ma
mère et ma grand’mère se levaient très-tard ; et pendant que la dernière
me croyait dans son cabinet occuper à l’étude de leçons que, grâce à ma prodigieuse
mémoire, je savais après les avoir lues une fois, je m’élançais dans la campagne,
je gravissais les arbres et les rochers. Je m’excédais à porter de lourds
fardeaux, et je reconnaissais avec bonheur que j’étais aussi fort que le
plus fort des enfants de mon âge. Cette force m’inspirait un grand orgueil.
Seulement je cachais mes succès en ce genre à mon aïeule ; elle s’en
fût certainement effrayée.
« Je
revenais dans ma tour et j’arrivais à son sommet un peu à la manière des
lézards. Je reprenais les vêtements que j’y avais laissés pour en revêtir
d’autres plus convenables à mes courses vagabondes.
« On
ne s’apercevait presque jamais de mes absences, et comme avant de rentrer
chez ma grand’mère, je consacrais une heure ou deux à étudier dans ma bien-aimée
tour, je revenais auprès d’elle tout à fait calme, et elle ne se doutait
pas le moins du monde à quels tours de force fabuleux s’était livré son cher
Paul.
«
Je gagnai à ces rudes épreuves deux fluxions de poitrine |96
dont
seul j’aurais pu dire la véritable cause ; mais je m’en gardai bien. Ma
trop bonne grand’mère m’eût interdit mes courses folles et désordonnées.
Je lui aurais obéi sans doute, mais cette obéissance m’eût rendu malheureux.
»
XIII
PAUL
A L’ABBÉ DE VERMOT.
« Ma
mère, mon ami, a fort mal accueilli mon projet de devenir fermier de Roquevair.
Elle n’a même pas voulu le discuter avec moi.
« Le
pauvre vieux manoir sera vendu. C’est une chose à peu près décidée. Du moins
j’ai cru le comprendre ainsi ; car ma mère a répondu d’une manière si vague
à mes questions et souvent sans les avoir écoutées que le courage m’a manqué
pour obtenir des explications plus précises. Et puis je voulais encore me
faire illusion et conserver quelque espérance.
« J’ai
pourtant moins souffert que la première fois que ma mère me parla de la possibilité
de vendre Roquevair.
« Ne
devinez-vous pas, mon ami, qu’il y a trop de bonheur en moi aujourd’hui pour
que la souffrance vienne m’atteindre ? Pourquoi ne m’aviez-vous pas prévenu
? Grâce à ma pauvre organisation d’une si nerveuse impressionnabilité, j’ai
senti que je devenais alternativement rouge et pâle. Lorsque Louis se mettait
à table pour déjeuner, ma mère lui a dit : |97
« — Mon
fils, je vous prie, ne vous absentez pas ce soir.
«
— Pourquoi donc, ma mère ? Aujourd’hui n’est pas votre jour de réception.
« —
Non, cependant je recevrai quelques personnes. Vous savez que le capitaine
de l’Émeraude, M. de Cacérès, est revenu de son voyage aux Indes.
Pendant sa longue absence sa femme et sa fille sont restées chez son beau-frère,
notre excellent ami, l’abbé de Vermot. Le capitaine est allé les y chercher
et les a amenées à Paris. Je dois trop à M. de Vermot pour ne pas faire à
sa famille l’accueil le plus empressé. Puis, ajouta ma mère, M. de Cacérès
a une réputation brillante et méritée : il a su illustrer le nom qu’il porte,
sa femme appartient aux premières familles de Paris ; les recevoir dans ses
salons sera toujours de fort bon genre ; mais dans ma visite à madame de
Cacérès, j’ai surtout insisté sur les rapports d’intimité existants entre
son frère et moi.
« —
Je crois, ma mère, dit Louis, que vos rapports d’intimité avec l’abbé de
Vermot se sont bornés à l’échange de deux ou trois lettres par an.
« —
Il doit y en avoir eu plus que cela, répondit ma mère un peu embarrassée.
Ce qu’il y a de certain, c’est que l’abbé de Vermot s’est dévoué à ton frère
avec autant de zèle que si Paul eût été son fils.
« Vous
conviendrez, Louis, que mon devoir est de lui manifester ma reconnaissance
en accueillant bien sa famille, et je vous ai mis, mes enfants, à la disposition
de ces dames pour leur faire connaître Paris où elles n’étaient |98 jamais venues. Le capitaine de Cacérès est chargé d’une
mission dans nos ports, de mer, et ces dames resteront quelque temps seules
à Paris.
«
— Quel âge a mademoiselle Cacérès ? demanda Louis.
« —
Seize ans, elle est belle comme un ange, fille unique : sa fortune sera considérable
; son père, en la mariant, et encore plus sa mère ne tiendront qu’à la naissance.
Or, nous avons un nom qui doit suffire à toutes les exigences, j’ai déjà
pensé à vous, Louis.
« —
A moi, ma mère, à moi ! s’écria Louis en riant aux éclats, vous avez pensé
à moi ! mais j’ai à peine vingt ans : un sous- lieutenant de vingt ans se
marier ! Pensez plutôt à mon frère : il est mon aîné.
« —
Je ne demanderais pas mieux que de marier votre frère ; mais qui accepterait
pour gendre un jeune homme sans carrière, sans avenir ? et puis... ajouta
ma mère, en regardant Louis. Un geste de compassion dédaigneuse acheva sa
pensée.
« Moi
aussi, mon ami, je regardai Louis. Il était placé auprès de moi. En face
de nous une glace reflétait nos deux visages ; pour la première fois, je
l’admirai avec un sentiment d’envie : il me parut si beau, et je me trouvai
si laid ! Cécile allait le voir et le comparer avec moi. Eh bien ! disais-je,
quoi qu’il arrive, elle sera toujours ma sœur, et le bonheur de revoir l’amie
de ma jeunesse fut assez vif pour me faire oublier toutes mes craintes. Je
me répétais : Je la verrai ce soir ; et les yeux fixés sur la pendule, |99 je comptais les heures qui me séparaient de cet instant.
Adieu, demain je finirai cette lettre.
« Je
ne suis point fait pour la vie du monde. J’ai bien raison d’aimer les bois,
les rochers, les prés et les fleurs, d’aimer à être seul. J’ai revu Cécile,
et tout mon bonheur a été troublé, parce que mon ignorance des usages, et
encore plus ma gaucherie et
ma
timidité m’ont fait jouer un personnage ridicule aux yeux de Cécile, sans
compter que mes inconcevables bévues ont été un vrai désespoir pour ma mère
et un sujet de moqueries pour Louis !
« Ma
mère avait annoncé à votre sœur une réunion toute composée d’amis intimes.
Elle tenait sans doute à lui prouver que le nombre de nos amis est fort étendu,
car j’ai vu là des intimes que je n’avais pas aperçus depuis plus de six
mois que je suis ici. Ma mère avait nécessairement invité toutes les personnes
avec lesquelles elle vous doit d’être en relation. La réunion était donc
fort nombreuse, beaucoup plus que je ne l’eusse désiré.
« Des
parties de whist et d’écarté s’établirent, les jeunes filles s’approchèrent
du piano ; on décida que la musique la plus agréable était celle des contredanses
et l’on se mit à danser.
« J’étais
là contemplant Cécile, la trouvant mille fois plus jolie que je ne l’avais
laissée. Sa parure de soirée à la fois élégante et simple lui allait à merveille,
et, comme il faut bien arriver à vous faire une entière confession, |100 j’avoue que moi aussi je m’étais occupé de ma toilette
pour la première fois de ma vie ; j’y avais passé beaucoup de temps sans
arriver à me trouver supportable. J’ai honte surtout de vous avouer une puérilité
qui m’a été, hélas ! bien funeste. J’avais acheté des souliers avec des talons
très-hauts pour me grandir un peu.
« Quand
j’arrivai dans le salon, Cécile n’y était pas encore ; mon frère vint à moi
et m’entraîna dans une autre pièce ; il voulait refaire le nœud de ma cravate,
il paraît que je l’avais fort mal réussi, malgré le soin et le temps que
j’y avais mis.
«
En vérité, disait Louis, on ne sait où tu as pris tes types d’élégance. Une
autre fois, cher frère, appelle-moi pour présider à ta toilette : que diable
! il ne faut pas attirer l’attention sur toi de cette manière, car je suppose
que c’est par originalité que tu te fagotes ainsi.
« Vois-tu,
continua l’impitoyable Louis, je t’ai bien vu rougir lorsque ma mère a parlé
de cette belle Cécile, et puis pâlir quand elle en est arrivée à nous confier
ses mirifiques projets de mariage entre cette jolie fleur des champs et moi.
« Tiens,
tu rougis encore, allons ! reste donc tranquille, ou ta cravate sera tellement
froissée qu’il faudra en remettre une autre. Tu as vécu cinq ans avec cette
jolie Cécile. Ce n’était d’abord qu’une enfant, mais cette enfant a grandi,
et tes yeux se sont ouverts. Tu le vois, mon pauvre frère, je sais ton roman
par cœur. J’ai près de deux ans de moins que toi, mais j’ai de l’expérience,
|101 beaucoup plus que tu n’en auras jamais. Je te dis cela
encore, mon cher puritain, pour te prouver que tu as eu tort de ne pas me
prendre pour ton confident. J’aurais pu aller sur tes brisées ; mais sois
tranquille, lorsque je penserai à me
marier,
il y aura longtemps que ta Cécile sera une grave mère de famille, élevant
pieusement ses enfants comme vous avez été élevés tous les deux vous-mêmes
par ma grand’mère et par son oncle.
« Et
après avoir débité toutes ces folies, sans qu’il me fût possible de l’interrompre,
bien que je souffrisse de l’entendre parler avec tant de légèreté, il me
poussa dans le salon en me disant :
« — De
l’aplomb ! on dirait ce soir que tu as peine à marcher.
«
Hélas ! mes souliers à talons me gênaient horriblement, ils devaient m’exposer
à bien d’autres calamités.
« De
quelle façon ai-je abordé Cécile. Je n’en sais rien, un nuage était sur mes
yeux, un bourdonnement insupportable brisait mes oreilles. Je ne sais comment
je me trouvai entre Cécile et votre sœur, parlant de vous et de Roquevair.
« Votre
excellente sœur m’appelait son fils ; son mari auquel elle m’avait présenté
avait jeté sur moi un regard bienveillant. Enfin quelques mots de Cécile
m’apprirent qu’elle n’avait point changé et que cette affection qui avait
commencé et grandi dans les joies pures de l’enfance et dont l’aveu nous
était échappé au moment suprême, d’une immense douleur, que cette affection,
|102 encouragée par vous et par sa mère, était restée
inaltérable.
« Un
quart d’heure de conversation avait suffi pour me prouver que rien n’avait
été oublié entre nous trois. Les convenances me faisaient une loi de ne pas
occuper ces dames de ma personne, toute la soirée. Je m’éloignai.
« Suffoquant
de bonheur, je sortis pour reprendre un peu de calme. J’entrai dans la salle
à manger, ma mère et Louis y étaient.
« —
Quel est donc, disait ma mère, ce jeune homme qui vient d’entrer avec le
comte de *** ?
« —
Un de ses amis, ma mère, qu’il allait vous présenter quand vous êtes sortie.
« —
Et le nom de cet ami ? car je n’ai entendu ni le nom, ni le titre qu’on lui
a donné en l’annonçant.
«
— Pas de titre, ma mère, et je pourrais même dire pas de nom, car ce n’est
pas avoir un nom que de s’appeler M. Jacques.
« —
Jacques ! s’écria ma mère, comment se fait-il que le comte de *** remorque
à sa suite et présente dans mon salon un homme qui n’est pas né ?
« —
Oh ! ma mère, dit Louis, souriant de cette étrange locution, on est toujours
né, plus ou moins bien, je l’avoue ; mais enfin M. Jacques passe sans doute
dans l’esprit du comte de *** pour être parfaitement né. Quand vous rentrerez,
regardez-le et vous pourrez vous convaincre qu’il n’y a pas de prince au
monde pour posséder un plus grand air et une distinction plus réelle. |103
« Vous
saurez, mon cher ami, que mon frère professe des idées libérales, beaucoup
trop libérales, selon ma mère, pour un homme ayant l’honneur de s’appeler
Roquevair.
« C’est
pourquoi elle reprit avec un peu d’aigreur :
« — Tout
le monde a d’excellentes manières à présent, Louis.
« Les
gens de rien font élever leurs enfants comme ceux des meilleures familles
; mais je vous prie, Louis, de ne pas en introduire autant chez moi, sous
prétexte que cela est bien élevé. Je vous soupçonne pour M. Jacques d’être
un peu complice de cet original de comte de *** qui tranche du philosophe
et du libéral, et je ne vois pas pourquoi vous trouvez charmant de l’imiter
et même de le surpasser.
«
— D’abord, ma mère, je ne connais pas M. Jacques et je ne suis pas complice
du comte de *** pour le méfait de l’avoir amené dans votre salon ; quant
à notre libéralisme, nous sommes cadets, et vous savez que les branches cadettes
sont nécessairement dans l’opposition : nous sommes donc dans le rôle que
nous impose notre naissance, dit Louis avec un sérieux qui fit rire ma mère.
« — Il
est donc très-bien, ce M. Jacques ?
« —
Beau comme un héros de roman, ma mère, et d’un roman à la mode. Sa beauté
est très-romantique : il est très-pâle, il a des cheveux noirs, c’est le
type du genre ; de plus on dit qu’il a toujours de certains airs mystérieux.
|104 On prétend aussi qu’il est très-instruit, très-lettré.
Le comte de *** a mis la main sur un phénomène, il va le mettre à la mode.
Cela lui fera un grand
honneur.
« Il
me fut facile, au signalement que Louis nous en avait fait, de distinguer
le nouveau personnage dont la présence préoccupait tant ma mère.
«
Je le reconnus à l’instant pour l’avoir vu trois mois avant la mort de ma
grand’mère à la fête patronale de Treignac29.
« Tout
le monde, ce jour-là, regardait et admirait cet étranger que le hasard semblait
avoir amené là, car personne ne le connaissait. Avec son simple costume de
voyage il avait une distinction, un cachet d’élégance qui faisaient paraître
communs et vulgaires nos jeunes gens dont la mise indiquait le plus de prétention.

29 Le
texte porte ici : d’Étreignac.
«
Qu’était venu faire dans le pays ce bel étranger ? S’y arrêterait-il ? Personne
ne le sachant, il fut bientôt oublié.
« Cependant
des gens me dirent l’avoir rencontré quelques jours après, errant dans les
bois qui environnent le château de Roquevair et l’avoir vu arrêté devant
la tour, dont il considérait l’écusson mutilé et les gargouilles avec une
grande attention.
« Je
ne sais pourquoi sa présence dans le salon de ma mère me causa une impression
étrange, désagréable même ; je me mis à penser que ce pouvait être là le
futur acquéreur de Roquevair, et ce pressentiment s’est trouvé véritable.
« Ce
qui me fut plus désagréable encore, ce fut de voir |105 M. Jacques s’approcher de mesdames Cacérès et les aborder
avec un air de connaissance.
« Comment
M. Jacques les connaît-il ? Il est donc retourné dans la Corrèze depuis mon
départ ? Pourquoi ne m’en avez- vous jamais parlé ?
« Ce
jeune homme est vraiment d’une beauté remarquable ; il a quelque chose d’imprévu,
d’original, qui attire l’attention. Il m’a semblé que les yeux de votre nièce
étaient bien souvent tournés vers lui, pendant cette fatale soirée ; fatale
pour moi, car enfin il faut bien, puisque je m’y suis engagé, que je vous
raconte mes infortunes.
« Je vous
l’ai dit : on dansait.
« Une
autre contredanse se forme. M. Jacques prend la main de Cécile, ce qui, je
crois, contraria ma mère autant que moi. Un vis-à-vis manquait : pas de cavalier.
Ceux auxquels leur âge
eût
pu permettre de danser étaient tous autour d’une table d’écarté. Nous avions
bien trois ou quatre députés et deux pairs de France qui de temps en temps
nous débitaient quelques bribes d’éloquence ; mais allez donc demander à
de si graves personnages des chassez-croisez non politiques.
« Ma
mère d’un coup d’œil vit tout cela, et dans sa détresse elle s’avança vers
moi :
« —
Paul, me dit-elle avec cette voix adoucie dont l’effet est irrésistible sur
moi, et un regard qui me ferait jeter dans une fournaise : Paul, mon cher
enfant, je sais que vous avez pris quelques leçons de danse, il n’en faut
pas |106 davantage pour se rendre utile. Je vous en prie, prenez
vite une danseuse et placez- vous vis-à-vis de mademoiselle Cacérès et de
ce M. Jacques dont les grands airs me paraissent très-impertinents.
« Je
ne calculai point si ce que ma mère me demandait était pour moi dans les
limites, du possible, et si moi, sauvage enfant des montagnes, n’ayant jamais
dansé que les bourrées et les bals de nos paysans, je saurais me tirer passablement
de ces danses de salon prétentieuses et sans gaieté.
« Je
sentis bien que la pensée de me mettre en évidence me faisait perler la sueur
au front. Mais je ne songeai qu’à exécuter l’ordre de ma mère le plus promptement
possible. Je jette un regard éperdu autour de moi ; je fais une invitation
; elle est acceptée avec empressement ; je conduis en triomphe ma danseuse
en face de Cécile : pendant la ritournelle je cherche à me rassurer. Je vois
partout des regards moqueurs jetés sur moi et sur ma danseuse : je la regarde
à mon tour. Hélas ! elle avait de trente-six à quarante ans : ce qui ne l’avait
pas empêchée de prendre une toilette de jeune première qui m’avait sans doute
fait
illusion. J’avais vu une robe de soie rose, de la gaze et des fleurs ; je
n’avais pas regardé le reste. Une masse de roses- pompons se balançait sur
une tête supportée par un cou long et décharné, et grâce au décolleté extravagant
de sa robe, on eût pu faire facilement un cours d’ostéologie : ajoutez à
cela que cette malheureuse créature avait cinq pieds quatre pouces de haut,
et |107 jugez de l’effet que produisait auprès d’elle ma taille
exiguë
même avec mes souliers à talons. Ma singulière danseuse ne paraissait nullement
embarrassée de ses longs bras et de ses longues jambes ; je vis de suite
qu’elle avait des prétentions à la légèreté et à la grâce. Elle tournait,
pirouettait avec un incroyable entrain ; elle se penchait vers moi pour m’encourager
et moi sentant combien nous étions ridicules l’un et l’autre et surtout l’un
par l’autre, je brouillais les figures, et toute la politesse de bonne compagnie
n’était pas suffisante pour empêcher quelques éclats de rire. Cécile surtout,
moins habituée à se contraindre, riait de tout son cœur.
« Enfin,
une allemande à gauche est indiquée. Ma danseuse, désespérée des efforts
inutiles qu’elle avait faits pour me mettre dans le bon chemin, s’empare
de moi plus que je ne m’empare d’elle ; je veux pourtant terminer à mon honneur
cette terrible contredanse. Je m’élance : mes talons tournent sur le parquet
; je tombe, entraînant avec moi ma compagne. Le rire éclate de toutes parts.
On nous relève ; mais la pauvre fille, humiliée sans doute de sa chute ridicule,
avait pris le parti de s’évanouir. J’aurais bien voulu pouvoir en faire autant.
Au lieu de cela, il fallut m’agiter, m’excuser, et aider à la transporter
dans la salle voisine. Ne croyez pas, mon maître, que mes tribulations soient
achevées. Hélas ! je n’avais vidé que la moitié du calice.
«
Ma mère paraissait désespérée de l’accident, et, malgré tout, je voyais le
rire prêt à s’échapper de ses lèvres. |108 Si je n’eusse pas été l’un
des acteurs de cette scène burlesque, elle n’y eût pas résisté : les êtres
ridicules ont le malheur de ne point inspirer de pitié.
« Ma
mère demande son flacon de sels ; et moi, en véritable campagnard limousin,
je m’avise d’un remède que j’avais vu employer dans les cas très-rares où
une paysanne peut s’évanouir.
« J’ouvre
un buffet, je saisis une carafe et je la porte sous le nez de la grande fille
en disant : « C’est du vinaigre ; il n’y a rien de meilleur que cela !
« Bien
qu’elle fût sans connaissance, elle fit un geste si brusque pour me repousser,
que le contenu de la carafe tomba à flots sur sa robe rose ; et les éclaboussures
atteignirent la belle robe de soie gris-perle de ma mère. Hélas ! dans mon
fatal empressement à être utile, j’avais pris l’huile pour le vinaigre ;
jugez de l’effet !
« Cet
accident eut pour résultat de rappeler à la vie mon infortunée danseuse.
Pour ma mère, son dépit fut sans bornes, et tous ceux qui étaient là purent
l’entendre dire : — Mon Dieu ! qu’une mère est malheureuse d’avoir pour fils
un imbécile !
« Le
mot n’était pas très-élégant ni de très-bonne compagnie. Je crois que ma
mère ne me pardonnera pas de longtemps de l’avoir mise dans le cas de le
prononcer en public.
« Vous
pensez bien, mon ami, que je ne rentrai pas dans le salon. Je me sauvai dans
ma petite chambre : je jetai par la
croisée
les souliers à talons. Je déplorai amèrement |109 la sotte vanité qui m’avait poussé à me grandir. Je
maudis le monde et les plaisirs, et les parquets et les femmes nerveuses,
surtout quand elles sont vieilles et laides.
« J’aurais
pu me dire que tout cela m’était arrivé par ma faute ; j’aurais dû me
sentir quelque pitié pour cette pauvre vieille fille, qui, de son côté, sans
doute, m’accablait d’amères malédictions, sans songer que, si elle avait
eu le bon sens de consentir à avoir son âge, elle se fût épargné, ainsi qu’à
moi, les humiliations de cette soirée.
« Faut-il
le dire ?... je pleurai comme un enfant. Ma mère a raison : dans le monde,
je serai toujours un imbécile. Je suis gauche, embarrassé ; un regard me
trouble, un sourire moqueur me déconcerte.
« Dans
mon désespoir, j’enviais sérieusement l’aplomb audacieux, les manières aisées,
l’air de satisfaction intime de quelques-uns des jeunes gens amis de mon
frère, que, jusqu’à ce moment, j’avais regardés comme des fats d’une complète
nullité. A cette heure, je les trouvais très-supérieurs à moi, et j’aurais
donné tout mon petit bagage scientifique et littéraire pour entrer comme
eux dans un salon et saluer avec ce genre délicieux dont ils possèdent la
quintessence.
« Je
pleurais de rage en pensant que Cécile m’avait trouvé ridicule. Je ne lui
pardonnais pas ses rires moqueurs ni ceux de
-
Jacques : elle me semblait sa complice ;
je les entendais dire avec ma mère : Imbécile ! |110
«
Mon ami, tout cela est bien misérable, n’est-ce pas, et prouve que je ne
suis pas encore un homme ?
«
Aujourd’hui, je suis plus calme. Je ne suis pas, fait pour le monde, et cependant
je veux y vivre quelquefois, pour me livrer à l’observation.
«
Je trouve un grand charme dans cette étude ; ce n’est pas précisément celle
du cœur humain. Dans le monde, il ne se montre pas à découvert; mais c’est
celle de ses déguisements : elle a aussi son intérêt.
«
Mademoiselle Lucie (c’est le nom de ma danseuse) veut, à quarante ans, n’avoir
que dix-huit ans ; moi, à dix-huit ans, je vais prendre l’attitude et le
rôle d’un homme de cinquante. J’espère être plus heureux qu’elle dans ma
métamorphose. Mais alors Cécile ne me trouvera-t-elle pas bien vieux ?
«
Elle m’a semblé prendre un plaisir extraordinaire à danser, à être louée,
admirée. Ce n’était plus la simplicité de celle que je me plaisais à nommer
ma pervenche…… »
XIV
PAUL
A L’ABBÉ DE VERMOT.
«
C’est bien M. Jacques qui veut acheter Roquevair. Les prétentions de ma mère,
quoiqu’elles soient très-exagérées, sont admises sans difficulté : un sous-seing
de vente se passera demain avec un représentant de M. Jacques ; |111 celui-ci entrera en jouissance dans deux mois.
«
On vend Roquevair tout meublé. Grâce à Louis, j’ai obtenu qu’on exceptât
quelques objets ayant appartenu à ma grand’mère, entre autres son vieux clavecin.
Il a bien fallu avouer que j’avais appris un peu la musique. Ma mère s’est
contentée de hausser les épaules en me disant : — J’espère que je n’entendrai
jamais résonner cette vieille crécelle.
«
Ma mère a paru fort surprise en apprenant que la vieille tour renfermait
des herbiers, des collections, des cartons de dessin et autres objets m’appartenant
en propre.
«
— Où comptez-vous, Paul, m’a-t-elle dit, installer tout cet attirail de coquilles,
de pierres et d’herbes ramassées pendant un temps que vous auriez pu beaucoup
mieux employer ? Vous avez voulu, en cela, copier l’abbé de Vermot ; mais
votre chambre est trop petite pour contenir toutes ces choses, que vous feriez
beaucoup mieux de laisser où elles sont.
«
J’ai répondu à ma mère qu’il y avait dans les mansardes un appartement libre
plus que suffisant pour contenir tout ce que renfermait la vieille tour.
«
Ma mère n’a pas fait d’objections ; j’ai obtenu de partir de suite pour Roquevair.
Je suivrai de près ma lettre. » |112
NOTES
EXTRAITES DES PAPIERS DE PAUL.
« Roquevair, 16 mai.
«
…..Je me demande toujours, sans pouvoir trouver une solution satisfaisante,
pourquoi ce M. Jacques a mis une telle obstination à devenir le propriétaire
de Roquevair. L’abbé de Vermot ne peut pas se l’expliquer, plus que moi.
«
M. Jacques, depuis six mois, est venu plusieurs fois dans ce pays. Il en
a beaucoup fait causer les anciens habitants. Il s’est présenté chez M. de
Vermot, il en a été reçu avec politesse, mais cependant avec la froideur
que l’on témoigne à un homme qui est et qui paraît vouloir rester inconnu.
«
L’abbé m’assure du moins qu’il en a été ainsi ; mais je crois pourtant que
cette politesse a dû se changer en quelque chose de plus intime.
«
L’abbé de Vermot a découvert que M. Jacques est fort instruit, ne possédant
aucune spécialité, mais parlant très-bien de tout.
«
Je connais trop bien le caractère de mon cher maître pour ne pas deviner
que M. Jacques l’a séduit sans qu’il s’en doutât !
«
L’abbé de Vermot ne trouve pas souvent ici des intelligences à la hauteur
de la sienne, et, rien n’établit si vite une intimité comme des rapports
de science et d’études. |113
«
L’abbé m’apprend tantôt que M. Jacques a des connaissances en physique ;
une autre fois, c’est un chimiste, c’est un botaniste. Enfin, ô comble du
mérite ! et combien cette précieuse découverte n’a-t-elle pas dû rendre le
bon abbé de Vermot indulgent pour les allures mystérieuses de M. Jacques,
bien que ce genre soit antipathique à sa loyale nature, M. Jacques est un
géologue !!! Un géologue, que ne lui pardonnerait-on pas ? il a donné à M.
de Vermot de magnifiques cailloux, ils m’ont été montrés avec orgueil.
«
Comment, s’étant tenu avec M. Jacques dans une réserve si prudente, mon maître
a-t-il pu découvrir tant de choses ? il l’a rencontré souvent dans ses promenades,
c’est une explication ; mais il ne m’a pas tout dit. Je sais, moi, car la
jalousie m’a rendu curieux et questionneur, que M. Jacques avant de venir
à Paris, assister à cette soirée dans laquelle j’ai joué un rôle si brillant,
est resté ici assez longtemps, qu’il allait très-souvent chez mesdames Cacérès
(à la vérité M. le curé n’y était pas toujours) : il n’a quitté le pays que
deux jours avant ces dames.
«
J’ai donné à entendre à mon cher maître que je savais cela, il m’a paru un
peu embarrassé.
«
— Il est vrai, m’a-t-il dit, que voyant M. Jacques décidé à acheter Roquevair,
n’importe à quel prix, je l’ai traité un peu par avance en voisin et en paroissien.
«
Mais, ajouta l’abbé, en prenant un air grave qu’il essayait de rendre sévère,
je suis surpris, Paul, que vous attachiez tant d’importance aux visites plus
ou moins |114 nombreuses de cet étranger. Ne connaissez-vous pas Cécile,
sa raison au-dessus de son âge ? Ne savez-vous pas qu’elle n’attache aucun
prix à ces avantages extérieurs que M. Jacques possède, il est vrai, à un
degré fort remarquable ? Qu’importe cela à Cécile ? sait-elle
seulement
si vous êtes beau ou laid ? Elle avait onze ans quand elle est arrivée ici,
ne s’est-elle pas habituée à votre figure ? ne vous a-t-elle pas aimé de
suite ; n’êtesvous pas son ami, son frère, le compagnon de ses jeux et de
ses études ? Et Cécile ne s’est-elle pas attachée à vous par des liens d’autant
plus doux qu’ils sont plus solides, fondés qu’ils sont sur l’estime, les
convenances de caractère ? sur les rapports surtout de cette sensibilité
pleine d’entraînement que vous possédez l’un et l’autre ? Comment, mon cher
enfant, pouvez-vous supposer que cette figure romantique, comme vous l’appelez,
parce qu’elle est plus belle que la vôtre, suffira pour l’emporter sur tous
les souvenirs d’amitié sainte de votre enfance et de votre jeunesse ?
«
— Mais cet homme n’est pas seulement beau, admira- blement beau; s’il n’était
que cela, je serais bien loin de le redouter; mais il est, vous me l’avez
dit vous-même, fort distingué de toutes manières : il a des talents, il cause
bien, avec grâce, avec facilité : et moi ! et moi !
«
— Et toi ! et toi ! mon pauvre enfant, me dit l’abbé en reprenant son ton
d’amitié, si tu voulais vaincre ta sotte timidité, tu serais vingt fois au-dessus
de ce beau |115 mystérieux : il ne te va
pas à la cheville, vois-tu ! il n’a pas de fonds. Cécile le sait bien ; nous
te connaissons tous les deux
mieux
que tu ne te connais toi-même, et c’est pour cela que nous t’aimons.
«
Et puis, mon cher Paul, une autre considération moindre que les autres sans
doute, mais c’en est une, doit vous rassurer. M. Jacques n’a pas de nom,
vous connaissez assez les opinions de ma sœur ; son mari les partage, ils
ne donneront jamais leur fille à un inconnu, eût-il des millions ! et quand
on peut s’appeler madame de Roquevair, on ne va pas s’affubler du nom de
madame Jacques.
«
Avec quelle amère tristesse n’ai-je pas parcouru cette demeure abandonnée
qui renferme tous mes souvenirs ! Voilà dans ce salon l’antique et vaste
fauteuil où ma grand’mère était toujours assise. Pourquoi ne pas avoir excepté
de la vente ce vieux meuble que j’aurais voulu conserver comme une sainte
relique. Ma mère ne l’a pas voulu : l’acquéreur, disait-elle, tenait à
acheter avec le château tout ce qui avait un cachet d’ancienneté.
……
« J’ai éprouvé un vif plaisir à revoir le brave Pierre Blanchard, cet humble
débris d’un héroïque empire, comme on chante aujourd’hui. C’est une chose
singulière que le flux et le reflux de l’opinion publique. Et si l’ombre
du grand homme abandonne son fatal rocher pour venir errer sur les bords
de la Seine, il doit mépriser autant une bonne partie de ses admirateurs
|116 d’aujourd’hui que ses ennemis les plus tenaces pour
lesquels (il y en a quelques-uns) il est encore l’Ogre de Corse. Superbe
génie de la domination universelle, que vous devez sourire de pitié en vous
voyant tous les jours affublé pour le besoin de la cause de la défroque
libérale et même
républicaine
!
«
Pierre Blanchard était un des meilleurs tireurs d’armes de son régiment.
Après le bonheur de se battre, de raconter ses batailles et d’exalter son
empereur, Pierre Blanchard n’en éprouve pas de plus grand que celui de donner
des leçons de cet art qu’il place sans façon, comme son confrère du Bourgeois
gentilhomme,
au-dessus de tous les autres30.
«
L’abbé de Vermot, espérant que cet exercice me serait salutaire, me présenta
à lui comme élève. Le maître d’armes me regarda, hocha la tête d’un air qui
semblait dire : Que voulez- vous que je fasse de cette mauviette ? Cependant
comme il aimait l’abbé de Vermot, il voulut bien me donner des leçons. Il
fut d’abord assez stupéfait en voyant qu’il y avait dans mon petit corps
sec et nerveux, une élasticité, une adresse, une précision de mouvements
qui pouvaient faire espérer quelque chose de moi. Aussi le brave homme me
donna tous ses soins et il réussit bien au delà de ses espérances.
«
— Vous êtes encore plus petit que le grand Napoléon, me disait-il ; mais
vraiment, mon cher enfant, malgré votre air tranquille et votre voix douce
comme la plus douce musique, vous me faites l’effet d’être hardi comme |117 un lion, et vos mignonnes petites mains au bout de trois
mois, manient un fleuret mieux que je ne l’ai jamais vu faire à n’importe
quel élève ayant deux ans de salle.
«
Pierre Blanchard, bien qu’il méprisât assez les pistolets, me donna aussi
quelques leçons de tir... Mais là comme à l’épée, je

30 Le Bourgeois
Gentilhomme de Molière, acte II, scène 2 : « Et
c’est en quoi l’on voit (...) combien la science des armes l’emporte hautement
sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, la...
»
fus
bientôt maître à mon tour. Le brave homme n’en fut point jaloux : — C’est
à moi qu’il doit cela, disait-il.
«
Nous avons causé de l’Empereur. — Vous ne l’aimez pas, me disait-il, mais
c’est égal, morbleu ! vous lui rendez joliment justice, votre cœur est ailleurs,
mais vous l’admirez tout de même, c’est bien, ça ! Est-il bien vrai qu’il
soit mort ? me disait ensuite Pierre Blanchard.
«
Nous avons fait ensemble un petit assaut, le brave homme m’a serré dans ses
bras et m’a dit qu’il n’y avait pas dans le monde entier un tireur d’armes
de ma force et que le fameux saint Georges31 eût été un pékin auprès de moi.
«
Pierre Blanchard a eu l’honneur de faire des armes avec M. Jacques : selon
Pierre Blanchard il est d’une force remarquable, mais bien au-dessous de
la mienne.
«
Je n’ai plus que huit jours à rester ici. M. Jacques veut, dit- on, faire
reconstruire le château dans le style de la vieille tour. Certainement le
pauvre manoir gagnera à cette transformation. Mais quand je passerai devant
les fossés qui l’entourent je ne le reconnaîtrai plus. Ce ne sera plus mon
Roquevair à moi. Oh ! si. la tombe de ma grand’mère et celle de mon père
n’étaient pas là dans cet |118 humble village, je ne reviendrais
jamais ici. Mais jusqu’à ce que je me sois bâti un nid pour abriter ma vie,
loin
du
monde, jusqu’à ce que je puisse demander au village de Roquevair les ossements
blanchis qui me sont si chers, pour les emporter avec moi, je reviendrai
tous les ans prier et pleurer sur ces tombes. »

31 Saint
Georges, supplicié pour la foi chrétienne à Lydda (Lod) le 23 avril 303,
saint patron de tous les chevaliers.
XV
PAUL
À M. L’ABBÉ DE VERMOT.
«
Mon douloureux sacrifice est accompli, mon cher maître : j’ai quitté, pour
ne plus y rentrer, ce cher manoir de Roquevair. Déjà il n’appartient plus
à notre famille.
«
Mes chers souvenirs sont placés dans l’appartement en mansarde dont je vous
ai parlé. J’ai, pour l’arranger d’après mes goûts d’artiste, à peu près épuisé
toutes mes ressources. Je rougis de vous le dire, ma mère m’a fait entrevoir
qu’ayant hérité de ma grand’mère, je devais contribuer aux dépenses de la
maison.
«
J’ai prié mon frère d’arranger cette grave question avec ma mère.
«
— Tu te trompes, s’est-il écrié. Te demander une pension, à toi, ce n’est
pas possible. Je dépense, moi, outre ma solde, bien plus que le revenu que
notre bonne grand’mère t’a laissé.
«
Hier ma mère m’a fait appeler. D’après son discours qui ne m’a pas paru très-clair,
il paraîtrait qu’elle est |119 beaucoup moins riche que
je ne le pensais. Si elle n’avait pas vendu plus tôt Roquevair, c’était uniquement
à cause de ma grand’mère et surtout à cause de moi, l’air de la campagne
m’étant absolument nécessaire pendant mon enfance. Cette terre avait toujours
été pour elle une charge et après tout il se trouvait que
c’était
uniquement pour moi qu’elle s’était imposé les plus grands sacrifices.
«
— Votre éducation, continua ma mère, ne vous permet de prétendre à rien.
Ce n’est pas ma faute, c’est un peu la vôtre, un peu celle de madame de Roquevair.
Quoi qu’il en soit, mon devoir était de ne pas vous laisser vivre à Paris
dans une dangereuse oisiveté, et je n’ai jamais manqué à mon devoir.
«
J’ai obtenu pour vous une place dans les bureaux du ministère de la guerre.
Vous aurez douze cents francs d’appointements. Cette position n’est pas en
rapport avec le nom que vous portez, mais il faut cependant l’accepter. Ces
douze cents francs, vous en disposerez comme vous l’entendrez, mais vous
trouverez bon, je l’espère, que le revenu de la somme que votre grand’mère
vous a laissée soit réclamé par moi pour subvenir aux frais communs de la
maison.
«
Que pouvais-je faire, mon ami ? Je me suis incliné en signe d’assentiment.
«
Vous m’assurez qu’aussitôt que Cécile aura atteint sa dix- huitième année,
je pourrai demander sa main avec la certitude qu’elle ne me sera pas refusée.
|120
«
Avec cette ravissante perspective que ne supporterais-je pas ?
«
Dans quelques jours je commencerai à exercer ces modestes fonctions de copiste
pour lesquelles je ne me sens pas fait. Si je n’en suis pas par trop abruti,
il me restera quatre ou cinq heures par jour que je pourrai employer à l’étude
: l’espérance me rendra tout facile. »
XVI
Paul
était à la fois une nature énergique et faible, il ne pouvait résister, aux
volontés et même aux caprices des personnes qu’il aimait. Cependant il était
très-capable d’une résolution courageuse et il avait le mérite, hélas ! si
rare, d’accepter la vie par ses côtés austères sans murmurer contre le sort.
Il
se condamna donc à cette existence d’employé avec résignation. On lui donnait
à copier une très-grande quantité de notes. Il faisait ce travail assez machinalement,
y portant juste l’attention nécessaire pour ne pas commettre d’erreurs. Mais
il conservait toute sa liberté d’esprit pour accorder quelque chose à la
méditation et faire travailler simultanément son intelligence et sa plume.
Le
jour où M. Jacques devait par un acte authentique devenir le propriétaire
de Roquevair était arrivé. Louis, ce jour-là, était de service dans une résidence
royale. Madame de Roquevair voulut se faire accompagner par son fils aîné.
|121
À
quatre heures, cette heure de liberté pour les employés des ministères, la
voiture de madame de Roquevair se trouva dans la rue Saint-Dominique32, et la mère et le fils se rendirent chez le notaire.

32 Rue
du VIIe arrondissement
de Paris
Il
y avait déjà eu un acte sous signature privée entre un commettant de M.
Jacques et madame de Roquevair ; la vente était donc irrévocable, il ne s’agissait
plus que d’en toucher le prix et de faire mettre sur l’acte les noms et prénoms
de M. Jacques.
On
entre chez le notaire, M. Jacques et son commettant y étaient déjà.
M.
Jacques salua madame de Roquevair avec une politesse pleine de dignité. Le
notaire et l’acte fait d’avance dans lequel un nom avait été laissé en blanc.
Arrivé là l’officier public s’arrêta et s’adressant à M. Jacques :
-
Vos noms et prénoms ? lui dit-il, car
c’est bien vous qui vous substituez aux lieu et place de M. Fayet, ayant
acheté de madame Sardan de Roquevair par sous-seing privé.
-
Écrivez, dit M. Jacques, entre madame
Sardan et le vicomte Jacques de Roquevair.
-
Que veut dire ceci ? s’écria madame de
Roquevair en bondissant sur son siége.
-
Votre nom est bien Sardan, Madame, dit
M. Jacques.
-
Sardan de Roquevair, Monsieur !
-
Permettez, Madame, messieurs les notaires
ici présents sont vos amis. Je vous ai laissé le droit de les |122 choisir afin de terminer une discussion pénible entre
nous, sans vous froisser. Je connais les égards qu’un gentilhomme doit à
une femme et je ne les oublierai pas.
Le
nom de Roquevair m’appartient, Madame, et il n’appartient qu’à moi ; je suis
en mesure de le prouver.
Au reste,
Madame, votre surprise est bien quelque peu affectée : depuis un mois le
sous-seing de vente est passé entre vous et M. Fayet, car je tenais à m’assurer
la possession de Roquevair. Craignant, je l’avoue, que plus tard une discussion,
inévitable entre nous, ne m’exposât à un refus formel de votre part de me
vendre cette terre, depuis quinze jours, je vous ai fait prévenir qu’il vous
serait fait, ainsi qu’à vos fils, des réclamations au sujet du nom que vous
avez ajouté au vôtre, depuis de longues années sans doute, je l’avoue, mais
cela sans constituer un droit.
Vos
réponses, Madame, m’ont fait craindre de ne pas arriver facilement au résultat
que je désire obtenir. Je vous avais caché jusqu’à ce jour quel était celui
qui revendiquait comme sa propriété un nom auquel il ne veut pas renoncer,
pas plus qu’il ne veut partager l’honneur de le porter. J’ai attendu pour
cela le jour de notre réunion ici, celui où je savais...
-
Que mon fils ne pouvait m’accompagner, interrompit
impétueusement madame Sardan : vous avez voulu, Monsieur, que je restasse
seule exposée à vos outrages. |123
-
Non, Madame ; je craignais, je l’avoue, que
mon caractère et celui du plus jeune de vos fils, naturellement emportés
l’un et l’autre, n’aggravassent par un contact imprudent une position déjà
grave par elle-même.
Je suis
assez sûr de moi pour ne jamais manquer de respect à une femme, et je souffrirais
d’elle ce que je ne pourrais supporter dans un jeune homme. Devant vous,
Madame, une discussion violente serait d’une haute inconvenance. J’espère
que
le caractère de votre fils aîné, beaucoup plus calme que celui de son frère,
nous permettra de nous entendre.
Paul
surexcité par la position pénible faite à sa mère prit alors la parole et
dit avec beaucoup de hauteur :
-
Il me semble que M. Jacques devrait d’abord
fournir des preuves de ce qu’il avance, et qu’avant de s’adresser à ma mère
il aurait dû penser que madame de Roquevair avait deux fils dont l’honneur
était intéressé dans cette question.
-
J’aurais désiré, Monsieur, connaissant l’influence
de madame Sardan sur ses enfants, la convaincre elle-même que mes prétentions
étaient fondées.
Au reste,
Monsieur, pour ne pas prolonger davantage une discussion irritante, je vous
préviens que la copie de tous les titres prouvant jusqu’à l’évidence que
je suis bien le seul héritier du nom, des armes et du cri des Roquevair,
sont entre les mains de messieurs les notaires ici présents. Prenez-en connaissance,
faites-les examiner. Renoncez à mettre le nom de Roquevair dans vos actes
publics; |124 renoncez à faire peindre mes armes sur les panneaux
de votre voiture, et puisque vous ne possédez plus Roquevair, renoncez à
ce nom que l’usage, je le sais, vous avait permis de prendre ; sinon, je
serai forcé de vous
y
contraindre par les moyens que la loi met en mon pouvoir.
En
disant ces derniers mots, M. Jacques salua et sortit.
Madame
Sardan resta atterrée ; les deux notaires et M. Fayet la contemplaient en
silence ; Paul avec inquiétude, mais en même temps avec calme.
Ce
calme remarqué par madame de Roquevair lui donna contre Paul un vif mouvement
d’irritation.
-
Eh ! quoi, s’écria-t-elle, vous avez laissé
partir cet homme, sans le souffleter, sans lui demander raison de l’insulte
faite à votre mère, à votre frère et même à vous ? Oh ! pourquoi Louis ne
m’a-t-il pas accompagnée. Il eût redouté la présence de mon fils, ce lâche
insulteur. Devant lui il n’eût jamais osé se permettre ce qu’il s’est permis
devant un avorton comme vous.
Cette
sanglante injure, jetée à Paul par la bouche de sa mère, fut pour lui une
immense douleur ; il cacha sa tête dans ses mains, pour dissimuler l’altération
de son visage, qu’il sentait alternativement pâlir ou rougir.
Dans
les caractères emportés la violence s’affaisse d’elle- même aussitôt qu’elle
a passé les bornes. Madame Sardan, honteuse des paroles qui lui étaient échappées,
s’adressa d’une voix calme aux deux notaires et leur |125 demanda
s’ils avaient pris connaissance des pièces déposées par M. Jacques.
-
Non, Madame, répondirent-ils, mais nous allons
y donner toute notre attention. Il est très-possible que ce jeune homme soit
en effet un des descendants de la famille Roquevair, mais il est aussi fort
possible qu’il ne soit pas le seul.
-
On examinera cela, dit madame de Roquevair
; je dois avant tout prévenir mon second fils de ce qui vient de se passer.
Et
la fière Louise se retira avec Paul. Pendant le trajet de la rue Jacob à
la rue Caumartin33 où demeurait
madame de Roquevair, la mère et le fils n’échangèrent pas une parole.
Plusieurs
jours se passèrent. L’examen des documents était très-favorable à M. Jacques
; et la famille Sardan commençait à concevoir de vives inquiétudes. Cependant
bien qu’elle doutât de la justice de sa cause, elle se détermina à soutenir
un procès : des pièces importantes manquaient à M. Jacques. On espérait que
bien que toutes les présomptions fussent en sa faveur, l’absence de ces titres
suffirait pour obtenir contre lui une fin de non-recevoir, et si l’on ne
pouvait le contraindre à rester M. Jacques, on espérait au moins ne pas être
forcé de se contenter du nom de Sardan.
Louis
montrait dans cette affaire autant d’irritation et plus d’obstination que
sa mère. Si celle-ci n’avait pu obtenir que de se glisser dans quelques salons
aristocratiques |126 grâce, nous l’avons dit,
à la protection de l’abbé de Vermot, si elle n’avait pu y être admise que
les jours où il y a cohue et où l’on invite tout ce qui se trouve en relation
de visites, Louis, au contraire, servant dans un corps privilégié, comptait
le plus grand nombre de ses amis dans cette jeune noblesse qui, connaissant
très-bien ce nom de Roquevair, s’était trouvée toute disposée à croire que
ce jeune
homme spirituel, élégant, bienveillant pour tous, beau joueur, aimable convive,
que cette fine fleur des pois de la Corrèze était, dis-je, parfaitement en
droit de porter le nom et de prendre les armes des Roquevair.

33 La première
des ces rues est dans le VIIe arrondissement et la seconde dans le IXe.
Louis
frémissait à l’idée de déchoir de cette hauteur qui le mettait au niveau
des jeunes gens de l’aristocratie la plus quintessenciée.
— Il
te restera toujours ton mérite personnel, lui disait Paul qui professait
pour son frère une naïve admiration.
Et d’ailleurs,
ajouta Paul, le nom de Sardan est honorable, et tu peux, mon frère, le rendre
plus honorable encore.
Alors
la mère s’emportait contre les idées philosophiques et libérales de Paul,
ainsi qu’elle les appelait. Quant à Louis, il comprenait que ses compagnons
d’armes l’eussent très-bien accepté comme Louis Sardan ; il connaissait bon
nombre d’officiers qui ne devaient nullement à un nom illustre la considération
dont ils étaient entourés. Mais il ne pouvait se
dissimuler
que M. de |127 Roquevair devenu Sardan, serait, malgré tout son
mérite personnel, quelque chose d’assez
ridicule.
Et dans cette fâcheuse prévision il faisait des démarches, à l’insu de sa
mère, pour obtenir de changer de corps.
PAUL
À L’ABBÉ DE VERMOT.
« Les
événements dont je vous ai parlé, mon cher ami, rendent notre intérieur de
plus en plus triste. Ma mère est irritée, mon frère lui-même attache à cette
malheureuse affaire plus d’importance que je n’aurais pu le croire, connaissant
sa légèreté.
« Pour
moi, je me tais. Outre que je n’ai pas l’habitude de parler librement devant
ma mère, mes idées étant en complet désaccord avec les siennes, je ne ferais
qu’ajouter à ses chagrins.
«
Sans savoir au juste si les prétentions de M. Jacques sont bien fondées,
j’ai du moins la certitude que nous ne descendons nullement des anciens Roquevair.
La première fois que j’ai voulu expliquer cela à ma mère, j’en ai été fort
mal reçu, à présent elle en est aussi convaincue que moi ; mais elle ne l’avoue
pas.
« Hélas
! mon ami, cette grave question me paraîtrait bien puérile, si mon avenir
de bonheur n’en dépendait pas. M. et madame de Cacérès voudraient-ils donner
leur fille à M. Sardan ? Cécile elle-même... Ajoutez que j’ai tout lieu de
croire que ma mère est à peu près ruinée. Le prix de la vente de Roquevair
servira à payer des dettes |128 contractées, comment?...
Louis en sait peut-être quelque chose. Il a pris avec son précepteur, M.
Duval, le goût du jeu. Je suis loin de lui reprocher ses fautes. Souvent
je le vois près de me les avouer,
dans
ces moments d’expansion où son cœur se dévoile tout entier, si bon, si affectueux
; Louis est ici le seul être dont je sois aimé.
« Ma
mère et votre sœur sont brouillées. Ma mère a appris que madame de Cacérès
recevait M. Jacques, elle a vu en cela un manque d’égards pour elle. Louis
a eu beau lui représenter que M. Jacques dans ses voyages avait connu M.
de Cacérès, qu’ils étaient amis, et que madame de Cacérès ne pouvait refuser
de recevoir l’ami de son mari. Tout a été inutile, elle a défendu formellement
à mon frère et à moi de revoir ces dames.
« J’ai
appris hier qu’elles avaient quitté Paris. Avant son départ et peu de temps
avant cette malheureuse affaire, M. de Cacérès leur a loué une jolie petite
habitation à Fontenay-aux- Roses. Je sais où elle est située ; et le dimanche
je vais me
promener
de ce côté-là, évitant d’être vu, car je ne veux pas désobéir à ma mère dans
un moment où elle est malheureuse.
« Oh
! mon cher maître, tout me dit que tout est fini pour moi et cependant je
me rattache quelquefois à l’espérance en pensant à vous.
« Voilà
les motifs sur lesquels s’appuie ma conviction du peu de solidité de notre
cause……………………………………..
………………………………………………………………..
« Le
seul espoir de ma mère est donc dans ces titres que |129 jusqu’ici M. Jacques n’a pu réussir à trouver. Pour
moi, bien convaincu de la justice de la cause de notre adversaire, je n’hésiterais
pas un instant, si j’étais le maître, à quitter un nom qui ne m’appartient
pas : mais comment amener ma mère à consentir à ce sacrifice ? Comment même
y amener mon frère ? L’amour-propre blessé fausse son jugement. Je crains
toujours qu’il ne se rencontre avec M. Jacques. Ce fatal procès commencera
dans huit jours. Je redoute extrêmement le caractère bouillant de Louis.
«
La malle, contenant des papiers, qui avait été oubliée chez le roulier de
Treignac34, m’est enfin parvenue. Dans ce moment, ce
qu’elle contient peut avoir quelque importance.
« J’ai
perdu ces jours-ci dans une promenade à Fontenay-aux- Roses un travail qui
n’a pas un grand prix sans doute, mais sa perte est une grande contrariété
pour moi.

34 Le
texte porte ici : d’Étreignac.
«
Vous savez que je ne puis composer que dans les champs. J’ai besoin de la
nature pour m’inspirer. J’avais, dimanche dernier, mon album presque entièrement
rempli par les vers que j’ai composés depuis que je suis arrivé à Paris.
Ils étaient, je crois, un peu moins mauvais que ceux que je vous montrai
à Roquevair et pour lesquels vous aviez tant d’indulgence. Ceux- là, je les
ai brûlés après avoir étudié les grands maîtres. Mais les autres, je les
ai perdus et je les regrette. J’y avais mis plus que mon esprit : j’y
avais mis tout mon cœur avec ses amères
tristesses
adoucies par quelques rayons d’espérance. |130
XVII
NOTES
TROUVÉES DANS LES PAPIERS DE PAUL.
« Fontenay-aux-Roses.
« Ma
destinée est irrévocablement fixée, je vivrai et je mourrai seul.
« Cécile
! je croyais que chez elle la raison avait devancé l’âge, et ce n’est qu’une
enfant ! Elle ne pourrait être heureuse avec moi : je lui rendrai ses promesses
; l’honneur m’en fait un devoir.
« Chaste
et saint amour ! né sous le regard d’une mère et sous la protection d’un
saint prêtre, je croyais que c’était dans toi que Dieu avait placé ma portion
de bonheur sur la terre et je dois renoncer à toi. Je le sens, je pourrais
lutter et reconquérir ce trésor, il n’est peut-être pas entièrement perdu
; mais qui me rendra mes illusions à jamais évanouies ? et comment, après
avoir rêvé les joies de l’Éden, pourrais-je me trouver heureux d’un bonheur
vulgaire ?
« Dans
l’avenir, car le cœur de l’homme a d’étranges faiblesses, je pourrais regretter
la détermination que je prends aujourd’hui. C’est pour cela que je veux écrire
la fatale conversation que je viens d’entendre. Ma mémoire trop fidèle
ne
me permettra pas d’en oublier un seul mot. Si parfois d’amers regrets venaient
agiter trop fortement mon cœur, je relirai cet écrit et je me dirai : « —
Pourquoi regretter un rêve ? car tout ce bonheur |131 dont je m’étais, hélas ! trop enivré, ce bonheur n’était
qu’un rêve.
« Depuis
un mois que Cécile habite la campagne avec sa mère, poussé par un désir irrésistible
de l’apercevoir à la dérobée, je me suis rendu tous les dimanches à Fontenay-aux-
Roses.
« J’errais
autour de sa demeure, j’entrevoyais les plis de sa robe à travers le feuillage
des marronniers. Quelquefois même j’entendais le son de sa voix.
« À
l’heure des vêpres je me rendais à l’église, je me cachais soigneusement
dans un coin. Il me faut si peu de place, je suis si petit qu’il m’est bien
facile de rester inaperçu. Cécile arrivait avec sa mère. Je la voyais ; je
priais avec elle, il me semblait revenir à ces beaux jours de notre jeunesse
où nous allions tous les soirs prier ensemble à la chapelle de la Vierge,
restaurée par le zèle pieux de sa mère et de son oncle.
« Il
est une jouissance que les hommes, dans la vie desquels la religion ne tient
pas une grande place ne comprendront jamais, et cette jouissance est la plus
suave qu’il soit donné au cœur de l’homme de ressentir : c’est celle de prier
avec un être aimé, de se voir unis par la même foi, par les mêmes aspirations
de l’infini, et de sentir son amour se fondre et se spiritualiser dans un
amour tout divin.
Cécile,
me disais-je, n’a pas oublié ces moments-là, à présent, j’en suis sûr, bien
que séparée de son ami, elle prie pour lui, et
je
contemplais avec ravissement, sans |132 perdre le sentiment de respect
et d’adoration que je devais porter dans le temple, du Seigneur, cette figure
d’ange grave et recueillie. Je voyais son âme resplendir sur son visage.
« Aujourd’hui
placé dans un des angles les plus obscurs de l’église, je portais mes regards
sur la place habituellement occupée par mesdames de Cacérès : je ne les ai
pas aperçues. Les vêpres ont commencé, elles n’étaient pas arrivées. L’inquiétude
s’est emparée de mon âme ; serait-elle malade ?... ou peut-être sa mère....
« Au
moment où le prêtre allait monter en chaire, ces dames sont arrivées, elles
n’étaient pas seules ; une jeune personne était avec elles. Elle avait une
toilette très recherchée, et Cécile elle-même était mise avec beaucoup moins
de simplicité qu’à l’ordinaire.
« Cette
exhibition de luxe dans une église m’a toujours paru du plus mauvais goût.
Je crois qu’en France seulement les femmes n’ont pas assez de tact pour comprendre
cela. En Espagne et en Italie, m’a-t-on dit, elles ne paraissent dans les
églises que mises avec la plus grande simplicité. En France les femmes ne
peuvent renoncer, même dans le lieu saint, au désir de plaire et d’être admirées.
« Lorsque
tout le monde fut sorti de l’église, je me dirigeai du côté de la maison
de Cécile.
« Une
haie très-épaisse et très-élevée sépare le jardin de cette maison d’un autre
terrain appartenant à un jardinier et consacré uniquement à la culture des
roses et |133 des fraises. C’est là que je vais tous les dimanches.
Je me fais apporter du lait et des
fraises,
je cause d’horticulture avec le jardinier. Ma présence ne lui semble jamais
étrange. Les Parisiens ont l’habitude de venir passer le dimanche à la campagne.
Mon honnête jardinier me prend pour un étudiant, il paraît seulement étonné
de me voir toujours seul. Mais il trouve très-naturel que je m’établisse
auprès de la haie qui le sépare du jardin de madame de Cacérès. L’ombre des
arbres de ce jardin se projette assez loin sur les rosiers et les fraises,
et c’est pour mon hôte une grande contrariété pendant que pour moi cet ombrage
me rend cette place délicieuse.
« Je
m’y suis assis aujourd’hui, lisant, écrivant, rêvant. Mesdames de Cacérès
sont à table en ce moment, me suis-je dit, il n’est pas temps encore de chercher
à entrevoir Cécile.
« Bientôt
j’ai entendu le frôlement de robes de soie effleurant la haie ; il s’est
arrêté.
« —
Asseyons-nous ici, ma chère Cécile, disait une voix inconnue. Ce bosquet
où les rayons du soleil pénètrent à peine me paraît tout à fait propre à
faire et à recevoir des confidences. Depuis trois semaines que nous sommes
arrivées, tu ne m’en as fait que d’assez incomplètes et je veux aujourd’hui
pénétrer dans ton cœur : il ne doit avoir rien de caché pour une amie.
« —
Je t’assure, Emma, que je ne t’ai rien caché. Et la douce voix de Cécile
que je n’avais pas entendue depuis si longtemps m’a causé une si violente
palpitation |134
de cœur qu’il me semblait que les battements devaient en être entendus
de l’autre côté de la haie.
« Pendant
que je me demandais si la délicatesse ne me faisait pas une loi de me retirer,
mon nom prononcé par mademoiselle
Emma
attira mon attention : je suis resté pour savoir ce qu’elle pouvait dire
de moi, après je n’ai plus songé à m’en aller. Mon âme était passée dans
mes oreilles, et l’angoisse la plus poignante me clouait à ma place.
« —
Et M. Paul de Roquevair, ou plutôt M. Sardan de Roquevair, et mieux encore
M. Sardan tout court, car j’ai appris tout cela hier, ma chère petite, est
toujours l’homme de tes rêves ? grand seigneur ou manant, tu partageras sa
destinée ?
« —
J’aime M. Paul de Roquevair, dit Cécile, et s’il est contraint de quitter
ce nom, je ne vois pas pourquoi cela changerait mes sentiments pour lui :
quel que soit son nom, Paul ne sera jamais un manant.
« Je
respirai plus librement bien que l’accent de Cécile me parût un peu calme
après la grossière raillerie de mademoiselle Emma.
« —
Le fait est, dit celle-ci, qu’il n’a pas la vigoureuse encolure et les robustes
épaules des gens auxquels on donne ce titre. On le prendrait plutôt pour
le fils d’un de ces pauvres ouvriers de Paris élevant leurs enfants dans
des ruelles infectes sans air, sans fleurs, et sans soleil.
« Mais,
ma chère belle, je ne puis m’empêcher de rire |135 de l’admirable sang-froid avec lequel tu me dis : J’aime
M. Paul de Roquevair ; pour toi c’est encore un Roquevair, le fils des preux.
Il n’a pourtant pas l’air d’un paladin ; il serait difficile de se le figurer
revêtu d’une de ces belles armures que nous
admirions,
il y a huit jours, au Musée d’artillerie35. Conviens
que le bouclier seul le couvrirait tout entier. Tu ris, j’en suis charmée
; mais c’est un mauvais signe pour la solidité de ton amour. Je t’en préviens,
si tu avais aimé réellement Paul, tu n’aurais pas ri de ma folle imagination.
« Je
partageais l’opinion d’Emma, et l’éclat de rire un peu contenu de Cécile
avait fait à mon cœur et peut-être à mon amour-propre une profonde blessure.
« —
Parlons sérieusement, Cécile, j’ai vingt-quatre ans et tu en as seize. Tu
es très-romanesque pour une jeune fille n’ayant jamais ouvert un roman, et
tu as grand besoin de l’expérience d’une amie.
« J’ai
beaucoup vécu dans le monde, j’ai eu peut-être mes heures d’illusions, et
c’est pour cela que je sais à quelques minutes près ce que ces heures-là
peuvent durer ; mais je comprends que les tiennes pourraient se prolonger
assez pour te laisser le temps de faire une sottise, et c’est pour cela que
je veux t’éclairer.
« —
Vous oubliez, Emma, dit Cécile, et le son de sa voix me fit comprendre qu’elle
était blessée de s’entendre traiter en petite fille, que ce que vous appelez
des illusions est pour moi une affection bien sincère, que cette affection
est approuvée par ma mère et par mon oncle, |136 l’abbé de Vermot ; que tous les deux l’ont encouragée
ou plutôt l’ont fait naître dans mon cœur ; que tous les deux m’ont promis
dans le cas où Paul perdrait un nom auquel, il faut bien l’avouer,
j’attachais

35 Ce musée
fondé en 1794 était alors dans une maison de la place Thomas- d’Aquin.
beaucoup
de prix, d’employer tout leur ascendant sur mon père pour le déterminer à
mon mariage avec Paul.
« Vous
m’avez dit plusieurs fois, Emma, que l’affection que j’ai pour Paul n’est
pas de l’amour. Mais si le sentiment que j’éprouve remplit tout mon cœur
et me rend heureuse, qu’importe qu’il soit ou qu’il ne soit pas de l’amour
?
« —
Je t’ai laissée parler sans t’interrompre, Cécile ; écoute- moi à ton tour.
« Non-seulement
ton affection pour Paul n’est pas de l’amour, mais encore, si tu es prudente,
tu la conserveras dans les limites d’une affection toute fraternelle, et
rien de plus, car, si tu te maries avec lui, tu seras malheureuse.
« — Et
pourquoi cela ?
« —
Parce qu’une femme d’esprit, faite pour vivre dans le monde et pour y briller,
est toujours malheureuse quand elle a un mari ridicule.
« — Vous
trouvez donc Paul ridicule ?
« —
Parfaitement, ma belle. Je conçois très-bien que, le connaissant depuis ton
enfance, tu avais dix ans, je crois, cela ne t’aie pas sauté aux yeux et
que tu te sois habituée au personnage ; j’admets même que, dans l’intimité,
|137 M. Paul soit assez aimable pour faire oublier sa laide
figure, car il est très-laid, M. Paul !
« — Je
ne m’en suis jamais aperçue.
«
— Habitude, ma chère, habitude ; mais il est très-laid, je t’en avertis ;
et quand tu lui donneras le bras et que, bien que ta taille ne soit pas trop
élevée, tu le dépasseras de près de la tête, tu t’apercevras un peu tard,
à la promenade et en entrant dans un salon, de l’effet que vous produirez.
Ensuite, ma chère, tu me l’as dit toimême, Paul est timide jusqu’à l’absurde.
Ton oncle, ta mère et toi sont les seules personnes devant lesquelles il
ose parler et être lui-même. Il paraît qu’alors il est charmant, il a de
la gaieté, il est poëte, bon musicien ; que n’est-il pas, selon toi ? En
admettant que tu n’aies pas rêvé une partie de ces merveilleuses perfections,
il n’en résultera pas moins que ton mari dans le monde sera d’une nullité
absolue et que ton amour- propre souffrira. Or, ma chère, l’amitié ne résisterait
pas à cette épreuve, que serait-ce de l’amour conjugal ?
« Malgré
ton éducation dévote, tu aimes le monde, et si tu te livres difficilement
à ses plaisirs, si même tu es pour cela d’un rigorisme outré, j’ai remarqué,
ma petite, que lorsque tu crois pouvoir t’amuser en sûreté de conscience,
comme tu le dis dans ton joli langage mystique, tu t’amuses avec un entrain
prouvant jusqu’à l’évidence que la solitude absolue ne serait pas du tout
dans tes goûts.
« —
Qu’importent mes goûts ! je les sacrifierai avec |138 joie à Paul ; et si le monde le trouve ridicule, eh
bien ! nous fuirons le monde.
« —
Oui, tu iras cacher ton bonheur dans quelque riante oasis, parce que tu serais
un peu humiliée de le montrer. Quel dommage que Roquevair soit vendu ! vous
auriez pu demeurer dans ce vieux donjon où Paul, m’as-tu dit, aimait tant
à passer de longues heures. Vous auriez pu vivre là, loin du monde,
plongés
dans un vertueux ennui. Mais, à propos de Roquevair, tu vois souvent le nouveau
propriétaire de cette résidence ?
« — M.
Fayet ?
« —
Il ne s’agit pas de M. Fayet, petite rusée ; on sait très- bien qu’il n’a
que prêté son nom. Je parle de celui qui, selon toute probabilité, est le
seul et véritable Roquevair... Pourquoi rougis-tu, Cécile ? Tu ne rougis
jamais, quand on te parle de Paul ?
« —
Vraiment, Emma, dit Cécile d’une voix altérée, vous êtes cruelle ! Pourquoi
voulez-vous chercher dans mon âme ce que je n’y veux pas voir moi-même ?
Ma parole est engagée à Paul, j’ai l’assentiment de ma mère et de mon oncle,
j’ai celui de mon père ; ce mariage se fera, et je serai heureuse, car je
veux l’être.
« —
Et c’est parce que tu veux l’être que tu ne le seras pas. Ce mot je veux
l’être me dit tout. Tu as comparé M. Jacques à M. Paul, et la comparaison
n’a pas été avantageuse à ce dernier.
« Tu
es dissimulée, ma petite, non par nature, mais par une nécessité que tu t’es
créée. Il y a des moments où |139 tu te livres sans t’en douter
: ta physionomie te trahit. Tu ne connais pas encore l’art de la dominer
et de ne lui faire dire que ce que l’on veut bien lui laisser exprimer.
« Te
souviens-tu de cette malheureuse soirée chez madame Sardan ? Je n’ai jamais
pu rappeler devant toi les mésaventures de M. Paul sans voir aussitôt tes
joues s’empourprer de confusion. De quoi rougissais-tu ? Était-ce de lui,
parce qu’il nous avait donné cette scène d’un comique achevé, qui n’était
pas sur le programme des plaisirs de la soirée, ou bien de toi,
pour
t’être persuadée un jour que tu avais un sentiment de préférence pour ce
gauche et maladroit personnage ?
« Tu
ne le sais peut-être pas toi-même, mon enfant. Eh bien ! je vais te l’apprendre
: tu rougissais de lui, mais encore plus de toi. Pour moi, il m’est impossible
d’y penser sans rire. Je vois encore cette ridicule Lucie tomber, entraînant
après elle son malheureux danseur, et son désespoir et celui de madame Sardan
à la vue de leurs robes inondées d’huile par l’assistance inintelligente
de M. Paul. Allons ! laisse-moi rire, continua Emma. Je te vois encore dans
ce groupe effaré, tâchant d’éloigner Paul, qui, stupéfait des catastrophes
qu’il avait accumulées dans l’espace de cinq minutes, restait là immobile,
comme s’il eût été pétrifié. Je t’assure, ma chère Cécile, que ton visage
n’exprimait dans ce moment que du dépit, et pas la moindre compassion pour
l’ami de ton enfance.
«
— Enfin, Emma, vous avez un but pour me tourmenter ainsi ? |440
« —
Sans doute ; bien qu’un peu moqueuse, je l’avoue, je ne me permettrais pas
de rire à tes dépens, si je ne croyais nécessaire de déchirer le voile que
tu t’obstines à tenir sur tes yeux. Il est bien léger, sans doute, mais,
tel qu’il est, il te fatigue : il faut l’ôter et te dire :
« Ma
chère Cécile, tu n’aimes pas M. Paul, tu ne l’as jamais aimé. Le nom de Roquevair
t’a éblouie pour le moins autant que ta mère. Paul le perdra, ce n’est pas
douteux, et en même temps il perdra la plus grande partie de son prestige.
M. Jacques te trouve charmante, tu ne l’ignores pas ; ton père et lui sont
amis. Du moment qu’il portera le nom de Roquevair, ta mère sera toute disposée
à le nommer son fils. Tu auras donc contre
ton
mariage avec Paul, le cas de succès échéant pour M. Jacques, ton père, ta
mère, et ton propre cœur, qui te parle pour
M. Jacques,
et ne te dit plus rien, ou presque plus rien en faveur de M. Paul.
« —
Et quand tout cela serait vrai, Emma, quand bien même je n’aimerais plus
Paul comme je croyais l’aimer, n’aurai-je pas toujours pour lui assez d’amitié
de sœur pour repousser toute idée de rompre mes engagements ? Je veux bien
vous avouer que je comprends qu’aux yeux du monde M. Jacques est certainement
très-supérieur à Paul. Je veux bien vous avouer encore qu’un mariage avec
M. Jacques me permettrait sans doute un genre de vie plus en harmonie avec
les goûts qui se sont développés en moi. M. Jacques est un esprit sérieux,
vous
le
savez, mais il a aussi l’esprit et les goûts d’un jeune |144 homme. Paul, au contraire, semble n’avoir jamais
eu de
jeunesse.
Eh bien !je me ferai raisonnable plus vite, et probablement je ne regretterai
jamais d’avoir passé mes plus belles années dans la solitude, ou si j’étais
assez faible pour cela, le sentiment d’un devoir accompli me consolerait.
« —
Allons ! te voilà déjà prévoyant que tu auras besoin de résignation. Tu iras
plus vite que je ne l’espérais, et tu comprendras bientôt qu’aimant M. Jacques,
ce n’est pas Paul Sardan que tu dois épouser.
« Et,
se levant, Emma entraîna Cécile. Je vis la robe blanche disparaître dans
le feuillage, je la suivis des yeux tant qu’il me fut possible d’en apercevoir
un pli, et je retombai anéanti en disant : Perdue ! perdue pour toujours
! Et, comme au moment où le regard de mon aïeule se fixa sur moi pour s’éteindre
à jamais, je pleurai avec des sanglots, mais les larmes ne me soulagèrent
pas...
«
Lorsque j’arrivai à Paris, je trouvai ma mère seule. Sans doute elle fut
frappée de ma pâleur, car elle me demanda si je souffrais. Je répondis que
non. Je ne puis même exhaler ma souffrance, il faut la conserver dans mon
cœur, y ensevelir mon bonheur à jamais détruit ! Pas une main amie ne peut
toucher à cette blessure. Je suis seul au monde. L’abbé de Vermot ne peut
lui-même recevoir cette triste confidence. Il me comprendrait, il
me
plaindrait. Mais accuser Cécile auprès de lui, je ne le ferai jamais ! »
|142
XVIII
Le lendemain
de ce jour si douloureux pour Paul, madame de Roquevair et Louis se livraient
aux plus flatteuses espérances. On leur assurait que M. Jacques, désespérant
de trouver les titres qui lui manquaient, paraissait disposé à abandonner
la poursuite du procès, ne voulant pas courir la chance d’un échec.
On raconta
tout cela à Paul, et celui-ci, voyant que cette conversation avait un grand
charme pour sa mère et pour son frère, la soutint avec son calme habituel,
bien que le nom de M. Jacques, sans cesse répété, retentît douloureusement
au fond de son cœur.
Jusqu’alors
il n’avait pris que peu de part aux discussions soulevées par ce procès.
Sa mère, ne voyant que Louis au monde, seul il lui paraissait vraiment intéressé
à la solution de cette affaire.
Louis
lui-même, tout en aimant son frère et l’appréciant d’une manière plus juste
que sa mère, s’était cependant habitué à le considérer comme devant occuper
dans la famille une place tout à fait secondaire.
Mais,
comme le bonheur rend expansif, madame Sardan voulut bien donner à son fils
aîné quelques explications qu’il lui
demanda.
Paul prenait à cette question plus d’intérêt qu’à l’ordinaire : son rival
et Cécile y étaient intéressés. |143
-
Il
paraîtrait, dit madame Sardan de Roquevair, que M. Jacques aurait recueilli
je ne sais quelle tradition. Selon elle, les seigneurs de Roquevair auraient,
dans le temps des guerres de religion, caché les archives de leur famille
dans la tour de Roquevair, où ils auraient fait pratiquer une cachette dont
eux seuls avaient le secret. Vous le voyez, cela ressemble beaucoup à un
conte d’Anne Radcliffe36. Quoi qu’il en soit, M. Jacques
a attaché de l’importance à cette légende ; elle a été pour
beaucoup
dans sa résolution d’acheter Roquevair à quelque prix que ce fût : il espérait
sans doute trouver là les titres qui lui manquaient ; il a fait bouleverser
la vieille tour, sous le prétexte de la restaurer. Sans doute il n’a rien
trouvé, puisqu’il paraît disposé à abandonner la suite de cet odieux procès.
Madame
Sardan donna à Paul l’explication des titres manquant à M. Jacques, explication
très-compliquée et très- ennuyeuse, dont notre lecteur trouvera bon que nous
lui fassions grâce. Sans doute elle ne parut pas à Paul aussi fastidieuse
qu’à nous, car il l’écouta avec une attention extrême, interrompant quelquefois
sa mère pour lui faire mieux préciser les faits.
-
Je suis charmée, Paul, dit madame de Roquevair
en finissant, que vous paraissiez enfin attacher à votre nom l’importance
qu’il mérite. Sans doute Louis, par la carrière qu’il a embrassée, semble
destiné plus que vous à en soutenir la gloire ; mais enfin, vous êtes un
Roquevair, et j’avais vu avec

36 Ann
Radcliffe, née Ward (1764-1823), romancière britannique, pionnière du roman
gothique.
peine,
jusqu’à présent, que ce |144 débat entre nous et
cet aventurier vous paraissait presque indifférent.
-
Vous vous trompiez, ma mère, répondit Paul
; cette question était pour moi d’un immense intérêt.
L’harmonieuse
voix de Paul avait quelque chose de si profondément triste, que madame de
Roquevair en fut touchée presque à son insu.
-
Mon fils, lui dit-elle, ne partagez-vous
donc pas nos espérances, et l’absence de ces titres ne vous paraît-elle pas
suffisante pour forcer M. Jacques à renoncer à ses prétentions ?
C’était
la première fois que madame de Roquevair faisait appel au jugement de
son fils aîné, et Paul, reconnaissant de la moindre faveur, répondit avec
plus d’assurance qu’il n’avait coutume d’en montrer.
—Je
crois, dit-il, que si M. Jacques ne peut se procurer les titres qui lui manquent,
il lui sera impossible de prouver qu’il est bien le seul descendant des Roquevair
et de nous contraindre de fournir nous-mêmes la preuve que nous appartenons
à cette famille. Mais il restera toujours de fortes présomptions en sa faveur,
assez fortes pour que personne ne doute qu’il ne soit vraiment un Roquevair.
À présent,
ma mère, que nous ne possédons plus la terre qui nous donnait une espèce
de droit à porter le nom de Roquevair, droit consacré par l’usage et par
le temps, si j’avais sur vous et sur mon frère quelque influence, je vous
engagerais à renoncer à un nom qui |145 n’est point le nôtre ; car,
il faut bien vous le dire, notre nom est Sardan, et nous ne sommes
point les
descendants
des Roquevair. — Où as-tu pris cela ? s’écria Louis, pendant que madame Sardan
jetait sur Paul des regards, pleins de colère. — J’ai étudié attentivement
la question, mon cher Louis, et si tu veux lui consacrer quelque temps avec
moi, au lieu de la laisser entièrement aux gens d’affaires, je te montrerai
que les Sardan ont été anoblis en 1702, et Roquevair n’est en leur possession
que postérieurement à cette date.
-
Qu’importe cela ! dit avec aigreur madame
Sardan, l’essentiel est que ce M. Jacques ne puisse nous imposer des lois
déshonorantes. Je vois avec peine que je me trompais, Paul, en pensant que
vous aviez assez le sentiment de l’honneur pour tenir au nom que vous portez.
— J’y tiendrais, certainement, s’il m’appartenait, ma mère ; mais, s’il est
le bien d’un autre, la justice et la religion ne me permettent, pas de désirer
de le conserver. — Oh ! les beaux sentiments ! s’écria madame de Roquevair.
Je ne sais quelle éducation vous ont donnée votre grand’mère et l’abbé de
Vermot. Voulant que vous fussiez quelque chose en, dépit de la nature, ils
ont fait de vous une manière de dévot-philosophe, un mélange où l’on ne sait
ce qui domine, ou des idées révolutionnaires et égalitaires de Jean-
Jacques,
ou des idées exagérées des mystiques. Qu’ont à faire, je vous prie, la |146 justice et la religion dans la question qui nous occupe
? Ne convenez-vous pas que depuis longtemps nous portons le nom de Roquevair,
et que M. Jacques n’a pas de titres suffisants pour nous forcer de quitter
ce nom ? Mais vraiment, avec vos belles idées de justice et de religion,
si vous les trouviez, ces titres qui lui ont coûté tant de recherches, vous
seriez
capable de les lui rendre.
-
Sans aucun doute, ma mère.
Et
Paul, rendu à lui-même par les injustes reproches de sa mère, prononça ces
paroles avec une fermeté respectueuse.
Madame
Sardan allait éclater de nouveau, mais Louis se leva et emmena son frère
avec lui.
XIX
Louis
sortit de l’hôtel : Paul monta dans son petit appartement des mansardes,
et ouvrant la malle qu’il avait reçue la veille, il en tira des liasses de
papiers et de parchemins qu’il se mit à examiner avec une scrupuleuse attention.
La nuit se passa ainsi. Aux premiers rayons du jour, Paul fit un paquet de
quelques- uns des papiers qu’il avait lus et replaça les autres dans la malle.
— Maintenant,
dit-il, Cécile sera bien sûre d’avoir pour époux un véritable Roquevair.
Puisse le cœur de cet homme être à la hauteur du nom qu’il porte !
Et Paul,
mettant sur les papiers le nom de M. Jacques, |147 se rendit dans la rue de Rivoli. M. Jacques, lui dit-on,
venait de partir pour la campagne. Paul laissa les papiers à son valet de
chambre, en lui recommandant de les remettre à son maître sitôt qu’il serait
arrivé.
Avant
de partir pour se rendre à son bureau, Paul, selon son usage, entra chez
sa mère. Il la trouva dans une consternation profonde. Ses beaux traits étaient
altérés par les larmes : des amis, des parents l’entouraient et lui offraient
des consolations impuissantes.
Madame
Sardan de Roquevair leva à peine les yeux lorsque son fils entra, et un geste
d’impatience, quand il s’approcha d’elle, fut la seule réponse qu’il obtint
à ses questions affectueuses.
Alors
un vieux parent de madame de Roquevair, M. Rouvray, prit Paul par la main,
et le conduisant dans l’embrasure d’une croisée, il lui raconta ce qui s’était
passé la veille.
-
Ton frère, lui dit-il, est une mauvaise tête
; je m’en suis aperçu très-souvent. Je l’ai dit à ma cousine ; elle n’a jamais
voulu me croire. Cependant, je dois convenir que depuis qu’il est question
de ce procès entre vous et M. Jacques, Louis s’était comporté jusqu’à présent
avec assez de prudence. Il avait bien eu quelques velléités de décider la
question par un duel, et ta mère, qui, dans ce moment, se croit peut-être
encore l’humeur belliqueuse, était presque de cet avis ; ils finirent cependant
par adopter la voie la plus lente, mais aussi la plus sûre : celle des
avoués,
des avocats et du papier timbré. |148
Nous
abrégerons beaucoup le discours du vieux parent. Il était toujours étonné
que sa famille ne le consultât pas, et surtout, qu’on se permît de suivre
des avis opposés aux siens, Aussi était-il très-heureux quand il pouvait
dire : — Je l’avais bien prévu, vous n’avez pas voulu me croire ; mais je
savais que cela arriverait ainsi, etc. Pour ces donneurs de conseils dont
toute famille possède au moins un échantillon, le malheur de leurs parents
indociles est un triomphe. Cela leur donne l’occasion de dire : — Que je,
suis sage ! que je suis prudent ! je suis vraiment rempli de tact et de prévoyance.
Ils oublient, dans ces agréables satisfactions d’amour-propre, combien de
fois il a été heureux pour leurs proches de ne les avoir point écoutés.
-
Comme je l’avais prévu, continua-t-il, Louis
a fait des sottises. Je lui avais conseillé d’éviter avec soin tous les lieux
publics qu’il savait être fréquentés par M. Jacques ; jusqu’à présent, il
avait suivi ce conseils ; mais il paraît qu’hier on a apporté la nouvelle
que M. Jacques était disposé à se désister de ses prétentions. Là-dessus
la tête a tourné à ta mère et à son fils. Je sais très-bien qu’ils ne sont
pas plus Roquevair que moi. Quand ta mère voulut, surtout par orgueil, épouser,
ce pauvre Roquevair, qui était un bon garçon, pas rusé du tout, tu lui ressembles
extrêmement, je disais à ma nièce : — Je vous assure que le nom est Sardan,
et rien de plus ; les Rouvray sont beaucoup plus anciens, — Elle ne voulut
pas me croire, J’avais
bien
prévu ce qui arrive ; il n’était |149 pas possible que cette
famille fut éteinte, je l’ai toujours dit.
-
Je conviens, mon oncle, que vous vous trompez
rarement.
-
Rarement, mon neveu ! dites : jamais ! Jamais
je ne me trompe : j’ai de l’expérience.
-
Sans doute, mon cher oncle ; mais, de grâce,
qu’est-il arrivé ?
-
Rien encore, parbleu ! mais il arrivera,
c’est moi qui te le dis. Ce M. Jacques, j’en ai beaucoup entendu parler ;
il est très- adroit, il tuera ton frère ; et voilà ce que c’est que de ne
m’avoir pas écouté. — M. Jacques tuera mon frère !
-
Allons ! femmelette, vas-tu te trouver mal
? j’ai toujours dit qu’on ne t’élevait pas bien. Ta grand’mère te gâtait.
-
C’est
vrai, mon oncle, vous avez raison. Mais, dites-moi, que s’est-il passé entre
M. Jacques et mon frère ? — J’ai raison, j’ai raison ; certainement, j’ai
raison, trop, quelquefois. Eh bien ! ton frère est allé hier au café de
Foy37. Il n’ignorait pourtant pas que M. Jacques y va
tous les soirs ; il l’y a trouvé. Je crois que Louis avait bu du punch et
des liqueurs chez un de
ses
amis, et que sa tête était un peu échauffée. Il y a eu des provocations de
la part de ton frère. M. Jacques, furieux sans doute de ne pouvoir poursuivre
ce sot procès, les a relevées. Un duel a été décidé, sans qu’il fût possible
de l’empêcher. Mais, comme ton frère est aujourd’hui de |150 service, ces deux
spadassins
ne pourront se battre que demain. Ton frère sera tué, bien certainement.
Il est si maladroit au pistolet, qu’il manquerait un bœuf à dix pas. Quant
à l’épée, je sais qu’il n’est pas fort. Ce serait toi qui devrais te battre,
que je ne serais pas beaucoup plus inquiet.
-
Mais, puisque cette scène a eu lieu publiquement,
il serait facile d’empêcher un duel que les lois divines et humaines défendent.
-
Tout cela est bel et bien, mon cher neveu
; mais ce que tu dis n’a pas le sens commun. D’abord, le duel n’a été décidé
que devant un petit nombre de témoins sortis du café avec ces deux fous pour
les empêcher de se battre sur-le-champ. Ils ont promis le secret, et ils
le garderont, car ce sont des gens d’honneur.
-
Ô mon oncle ! vous appelez cela des gens
d’honneur !

37 Café
parisien en activité de 1725 à 1863, rue Richelieu, près du jardin du Palais-
Royal, rendez-vous sous la Restauration des ultra-royalistes.
-
Et comment, diable ! veux-tu que je les appelle
? Je sais bien que le duel est un préjugé, surtout pour toi, qui te piques
d’être un philosophe religieux. Moi, vois-tu, qui ne le suis pas, et qui
n’aime plus guère ceux-là que les autres, bien que je les estime davantage,
j’ai pour principe qu’il faut être de son temps et se soumettre à l’usage.
Vois-tu, mon petit, il n’y a rien à répondre à cela.
Paul
trouvait, au contraire, qu’il y avait beaucoup à répondre ; mais ce n’était
pas le moment d’engager une polémique, et le temps eût-il été pour cela plus
opportun, |151 c’eût été chose fort inutile avec cette espèce d’avocat
campagnard, bouffi de suffisance, et persuadé que le bon sens ne peut manquer
d’arriver quand les cheveux s’en vont.
Paul
se rapprocha de sa mère, et, se penchant vers elle, il lui dit :
-
Croyez-moi, s’il ne fallait que donner ma
vie, je ne dis pas pour sauver celle de mon frère, mais seulement pour sécher
une de vos larmes, je n’hésiterais pas un instant.
La
voix de Paul, avec ses douces inflexions, produisit un effet irrésistible.
Madame de Roquevair ne put s’empêcher d’en être émue, et prenant dans ses
mains la tête de son fils, elle la couvrit de baisers et de larmes en lui
disant :
-
Mon fils, mon cher fils, il ne me restera
bientôt plus que toi !
Paul
rendit à sa mère ses caresses, et sortit en se disant : Il faut à tout prix
éviter ce duel. Ô mon Dieu ! inspirez-moi.
Alors
il retourna dans la rue de Rivoli. M. Jacques n’était pas revenu. Paul reprit
au valet de chambre le paquet qu’il lui avait confié deux heures auparavant,
et se fit donner les indications nécessaires pour rencontrer M. Jacques.
Celui-ci était à Ville- d’Avray, où il avait loué une maison de campagne
pour passer une partie de l’été.
Ceux
qui avaient l’habitude de voir Paul auraient |152 peut-être eu quelque peine à le reconnaître. Sous l’impression
d’une violente surexcitation morale ; son être physique semblait avoir subi
une transformation. Toute trace de timidité avait disparu ; son regard assuré,
son maintien plein de dignité, révélaient en lui l’homme possédant la première
de toutes les forces, la force morale.
M. Jacques
était chez lui ; il était seul.
On introduisit
Paul dans un salon dont les fenêtres donnaient sur un jardin planté d’arbres.
Ce salon
semblait consacré à l’étude.
Des
livres, de la musique, une boîte à couleurs, des miniatures, des esquisses,
quelques jolis tableaux, des statuettes, des armes en faisceau, des manuscrits,
tout cela disposé dans un désordre beaucoup trop pittoresque pour être naturel
et pour qu’on ne soupçonnât pas un peu de vanité dans cette exhibition. Paul,
qui avait l’habitude du travail, remarqua que si tous les objets rassemblés
là semblaient s’y trouver par hasard, ils occupaient pourtant la place la
plus propre à les faire valoir. Pas un grain de poussière sur ces in-folio
entr’ouverts, sur ces manuscrits entassés, sur ces cartons de dessins laissant
échapper les richesses qu’ils contenaient.
Paul
en conclut que M. Jacques voulait surtout paraître artiste et penseur. Il
savait qu’il se piquait d’avoir fait en Allemagne de fortes études philosophiques,
qu’il déclamait avec beaucoup d’esprit sur la légèreté des Français, |153 déclarant qu’il n’était guère possible d’étudier chez
eux autre chose que leurs modes.
Il faut
convenir que cette étude avait parfaitement réussi au futur vicomte de Roquevair.
Lorsque M. Jacques vit paraître Paul, il se leva et le salua avec une politesse
froide mais digne.
-
Monsieur, lui dit Paul, j’ai appris il y
a à peine deux heures, la regrettable scène qui s’est passée hier au soir
au Palais-Royal.
-
Très-regrettable, en effet, monsieur Sardan
-
Du moment que vous en convenez, j’espère
qu’il me sera facile, en invoquant les droits de la raison, d’empêcher deux
hommes estimables de risquer leur vie pour des paroles que la vivacité à
pu leur arracher.
-
M. Louis Sardan vous a-t-il donc envoyé ici
comme médiateur ?
-
Non, monsieur ; le rôle de médiateur est
un rôle honorable, mais ce n’est point à mon frère qu’il appartenait de me
demander de l’accepter. J’ai espéré, monsieur, qu’ayant été l’offenseur et
non l’offensé, vous comprendriez qu’un homme d’honneur a quelque chose de
mieux à faire que d’offrir une réparation dont les chances, en les supposant
égales, peuvent, par un cas fortuit, tourner en sa faveur.
-
Eh bien ! monsieur, quand cela serait ?
—Eh
bien ! monsieur, j’ai de la peine à admettre, en invoquant les lois de la
raison et du simple sens commun, qu’un homme qui en insulte un autre, et
ensuite le |454 tue ou le blesse en duel, puisse se dire en rentrant
chez lui : Ma conscience ne me reproche rien. J’ai offensé mon adversaire,
mais je lui ai donné une réparation. Je l’ai tué, je suis vraiment honorable.
— Monsieur, des jeunes gens insensés peuvent trouver cette
manière
d’agir fort naturelle, mais vous êtes un homme sérieux, et c’est ce qui m’a
engagé à venir vous trouver. J’ai pensé qu’il nous serait facile de nous
entendre.
-
Je vois, monsieur Sardan, que vous êtes philosophe.
Je le suis pour le moins autant que vous, et, comme vous le dites, je suis
un homme sérieux. Mais je suis aussi homme du monde, monsieur Sardan ; et
les maximes de la philosophie ne s’accordent pas toujours avec celles de
ce monde, dont on subit les exigences, tout en les méprisant.
-
Je pourrais alors vous dire, monsieur, avec
un philosophe pour lequel vous professez probablement une plus grande estime
que moi-même :
« Si
le philosophe et le sage se règlent dans les plus grandes affaires de la
vie sur les discours insensés de la multitude, que sert tout cet appareil
d’études, pour n’être au fond qu’un homme vulgaire ? »
En prononçant
ces paroles, Paul ne put s’empêcher de jeter un regard empreint de quelque
ironie sur cet appareil d’études qui l’entourait.
-
Jacques surprit ce regard ; il dissimula
le dépit qu’il lui fit éprouver, et répondit à Paul d’un ton railleur :
-
Eh ! monsieur, j’ai lu comme vous la
fameuse lettre |155 du
philosophe de Genève sur le duel. Je sais que vous pouvez me dire que César
n’envoya point de cartel38
à Caton ou Pompée à César ; mais je ne me pique pas d’être
un Caton, et je crois que monsieur votre frère n’est pas encore un César.
Et si ces grands hommes eussent vécu de notre temps, il est probable qu’ils
auraient subi la loi des préjugés telle qu’on la subit aujourd’hui.
Toute la
philosophie du monde ne peut rien à cela.
-
Il y a, monsieur, une philosophie, qui
pourrait beaucoup, et par cela même elle prouverait sa supériorité sur celle
que vous professez et que vous aimez, malgré que vous constatiez son impuissance.
-
Et cette philosophie, monsieur Sardan
voudrait-il bien me la faire connaître ?
-
C’est la philosophie chrétienne, monsieur.
-
Ah ! fit M. Jacques, je conviens que
celle-ci est fort respectable. Malheureusement, je l’avoue, je n’ai pour
elle qu’un respect de théorie. Je reconnais sa supériorité, mais je, n’ai
pas, comme vous, l’avantage d’être dévot : ma raison n’a pu me conduire jusque-là.
-
Plût au ciel, monsieur, que vous fussiez
assez chrétien pour agir non-seulement d’après les lumières de votre conscience,
mais d’après celles de votre raison !
-
Monsieur Sardan, vous le voyez, je veux
bien discuter avec vous. Vous êtes chez moi, je dois vous recevoir avec les
égards

38 Défi
par écrit.
qui
sont dus à un homme honorable, surtout quand cet homme est mon ennemi. |156
-
Je ne suis point l’ennemi de monsieur
Jacques.
-
Soit. Je n’ai pas l’habitude de redouter
ni le nombre ni la force de mes ennemis ; mais enfin, monsieur, je m’applaudis
de ne pas vous compter parmi eux. Arrivons au fait. Que voulez- vous de moi
? Je nie avoir été le provocateur dans cette déplorable affaire vous voyez,
je répète le mot déplorable survenue entre votre frère et moi.
On a
prétendu que j’avais des raisons graves pour renoncer à la revendication
de mon nom et de mes armes, que, faute de quelques pièces essentielles, je
serais obligé de tolérer une usurpation et de continuer à me faire appeler
simplement M. Jacques, si je ne voulais pas partager avec les Sardan l’honneur
du nom, des armes et du cri des Roquevair. Lorsque M. Sardan me rencontra
au café Foy, sans doute il avait entendu parier de cette prétendue renonciation
à mes droits. Je crois qu’il était un peu animé par quelques imprudentes
libations ; cependant elles ne peuvent être invoquées comme une excuse.
Quoi
qu’il en soit, M. Louis Sardan eut dans les regards qu’il jeta sur moi, dans
son attitude, dans les demi-mots qui lui échappèrent, quelque chose d’un
triomphe si insolent, qu’il me fut difficile de conserver mon sang-froid.
Je ne sais, monsieur Sardan, ce que la philosophie chrétienne vous eût inspiré
; quant à l’a mienne, je l’avoue, elle a quelquefois bien peu de
force
contre la violence de mes passions. À la piquante ironie de votre |157 frère, j’ai opposé l’insulte. Je conviendrai facilement
avec vous qu’après lui avoir dit que son triomphe
n’était
pas assuré, et que ces pièces essentielles étaient plus près d’être en mon
pouvoir qu’il ne le pensait, j’aurais dû m’arrêter.
-
Vous lui avez dit cela ?
-
Sans doute, répondit M. Jacques, un peu déconcerté
par le sourire qui errait sur les lèvres de Paul.
-
Et mon frère, n’ayant pas une grande confiance
dans cette assertion, s’est mis à rire, et c’est alors que vous l’avez insulté
?
-
Oui; monsieur ; vous êtes, je le vois, parfaitement
informé. J’ai insulté votre frère, et je lui ai offert une réparation ; elle
pourrait, j’en conviens, devenir une leçon sévère : car, vous le savez, j’ai
eu plusieurs duels, et j’ai toujours mis mes adversaires hors de combat.
-
Mon frère, monsieur; a eu tort de douter
de votre parole : vous étiez beaucoup plus près de la vérité qu’il ne le
pensait... et que vous ne le pensiez vous-même.
-
Que voulez-vous dire, monsieur Sardan ? Vos
airs ironiques dans cette circonstance sont au moins déplacés. Si j’oubliais
quevous êtes chez moi, et qu’à ce titreje vous dois des égards, je ne pourrais
pas, comme votre frère, vous offrir une réparation.
-
Et pourquoi cela ? dit Paul, dont le sourire
prit une expression plus marquée de raillerie.
-
Pour plusieurs raisons, monsieur Sardan.
D’abord, je ne pourrais me battre avec vous qu’après avoir tué |158 monsieur votre frère, et, vraiment ! il serait
dommage que vous ne
restassiez
pas pour perpétuer la race des Sardan ; et puis je sais, vous me l’avez dit,
que votre philosophie chrétienne vous défendrait d’accepter un duel. Il faut
convenir, continua M. Jacques, exaspéré par le sang-froid ironique de Paul,
qu’une déclaration de principes est fort commode pour masquer l’impuissance
du courage.
Paul
devint très-pâle, et s’approchant de M. Jacques il lui dit :
-
Je n’ai jamais insulté personne, monsieur,
et je vous prie de m’expliquer ce qui, dans mes paroles, a pu vous paraître
un outrage. Cette réparation, vous pouvez, je pense, me l’accorder.
-
Alors répondez-moi, monsieur ; pourquoi m’avez-vous
dit que les titres qui me sont nécessaires étaient plus près d’être en mon
pouvoir que je ne le pensais moi-même ?
-
En vous vantant, monsieur, de la possibilité
de les avoir, vous avez fait une rodomontade, ce qui est bien un peu puéril,
pour un grave philosophe comme vous, Et cependant, monsieur, cette rodomontade
pourrait être une réalité. Je ne regarde pas la chose comme impossible. Pour
moi, je crois que ces titres sont, en effet, très-près d’être entre vos mains.
-
Monsieur Sardan, s’écria Jacques, votre persiflage
est une lâcheté. Vous agissez comme les femmes et les enfants : vous abusez
de votre faiblesse. |159
-
Ainsi, dit Paul, au lieu de me demander une
explication convenable de mes paroles, et surtout de l’écouter, vous préférez
m’insulter : vous me traitez de lâche. Eh bien ! monsieur, apprenez donc
que la principale raison qui m’empêche de vous dire : Monsieur Jacques, nous
allons nous
battre
à l’instant au pistolet, à l’épée, peu m’importe, n’est pas celle-ci : je
suis chrétien, et j’ai l’habitude de régler mes actions sur ma croyance ;
mais celle-ci : je ne veux pas vous tuer ; car, si nous nous battions, je
vous tuerais, monsieur, entendez-le bien.
-
Oui, oui, j’entends très-bien ! répondit
Jacques en tombant sur un canapé et riant aux éclats. Allons ! monsieur Sardan,
épargnez-moi, je vous en prie ! Je demande grâce ; vous allez me tuer à force
de me faire rire !
-
Calmez-vous, monsieur, répondit Paul ; et
puisqu’il vous faut une leçon, recevez-la !
-
Oublierez-vous donc vos grands principes
pour vous battre avec-moi ? dit M. Jacques en riant toujours.
-
Oui, monsieur, dit Paul.
Et
saisissant dans ses petites mains les poignets de Jacques, celui se trouva
debout sans avoir pu opposer la moindre résistance. M. Jacques ne riait plus
: il considérait ses poignets entourés d’un cercle rougeâtre, et il les frictionnait
doucement pour rétablir la circulation du sang, brusquement interrompue.
-
À présent, monsieur, lui dit Paul, pensez-vous
que je puisse me battre avec vous ? |160
-
Nous n’avons pas de témoins, dit M. Jacques
d’un air sombre.
-
Serait-il donc si difficile de trouver deux
hommes Je ne connais point, du reste, les règles du noble jeu du duel ; je
sais
seulement
que l’enjeu est la vie d’un homme. Or, monsieur, je jouerai à coup sûr; et
vous n’aurez pas plus d’avantage sur moi qu’un provincial jouant dans une
maison suspecte de Paris avec des cartes biseautées.
-
C’en est trop, dit M. Jacques ; battons-nous
de suite et que cela soit fini. Vous avez le choix des armes.
-
Je choisis l’épée, dit Paul ; mais je ne
consentirai pas à me battre dans ce moment. Il vous faut quelques instants
pour vous remettre, et vos poignets doivent encore vous faire souffrir. Voyez;
ils prennent à présent une teinte bleuâtre. Il faut pourtant que rien ne
gêne la liberté de vos mouvements ; car enfin, monsieur, puisque vous me
forcez de vous assassiner, encore faut-il que je me trouve, après cela, le
moins de remords possible.
-
On n’assassine pas quand on se bat loyalement.
-
Je suis de votre avis, monsieur ; mais on
ne se bat loyalement que lorsque l’on se bat à forces égales. Or, c’est de
quoi l’on ne s’occupe jamais. Vous êtes fort adroit, je le sais, monsieur,
et vous avez une force ordinaire, très-ordinaire ; vous l’avez vu, je suis
beaucoup plus fort que vous, et comme j’ai causé avec Blanchard, je sais
aussi qu’à l’escrime je suis beaucoup plus adroit que vous. Ensuite, monsieur,
j’ai un sang- froid qui ne |161 m’abandonne jamais ; vous,
vous perdez le votre au bout de quelques temps de résistance. Alors, monsieur,
vous le savez, les chances de l’adversaire doublent. Si je me
battais
avec vous avec l’avantage de l’adresse et du sang-froid, si j’usais de ma
supériorité sur vous, dans ma pensée, je serais un assassin.
-
Si je me battais, dites-vous ; est-ce que
vous ne voulez plus vous battre ? mais je le veux, moi !
-
Si j’ai choisi l’épée, continua Paul, sans
avoir paru s’apercevoir de l’interruption de son adversaire, ne croyez pas
que ce soit parce que cette arme m’est plus familière que le pistolet ; non,
c’est dans votre intérêt.
-
Dans mon intérêt !
-
Dans votre intérêt, monsieur, dit Paul, et
j’ajoute aussi dans le mien. Je suis l’offensé, j’ai donc le droit de tirer
le premier ; dans ce cas, votre vie m’appartient. Je puis vous tuer, mais
je ne saurais en venir à cette extrémité. Vous m’avez traité de lâche, et
le mot, j’en conviens, a mal sonné à mes oreilles. Vous m’avez raillé fort
insolemment sur ma faiblesse physique ; je crois vous avoir prouvé qu’elle
n’est qu’apparente. La leçon que je vous ai donnée suffit à mon orgueil,
si toutefois un homme doit se trouver humilié de ne pas avoir l’apparence
d’un Hercule. J’ai répondu comme je le devais à des provocations de mauvais
goût. Je vous ai amené à désirer de vous mesurer avec moi : cette gloire
me suffit. À présent, si j’allais sur le terrain, ne voulant pas vous envoyer
une balle
dans
la tête ou dans la poitrine, |162 je serais, forcé de tirer
en
l’air.
Peut-être ne verriez-vous dans cette action que le désir d’être épargné ou
une maladresse, ce qui serait très-piquant pour moi. Il faudrait donc vous
faire une légère blessure ; mais la blessure la plus légère peut devenir
grave. Je répondrais bien de vous envoyer une balle de telle sorte que le
coup ne fût pas mortel par lui-même, mais il pourrait le devenir. L’humiliation
d’avoir été vaincu par un si chétif adversaire peut enflammer le sang. La
vie, d’un homme est, à mes yeux, trop précieuse pour
que
je puisse consentir jamais à la risquer ainsi. À l’épée, monsieur,
ce sera autre chose : je serai sûr de vous et de moi.
-
Tout ce que vous dites là, monsieur, me donne
un désir plus ardent de mettre à l’épreuve cette merveilleuse adresse que
vous vantez avec un peu d’outrecuidance, je vous en avertis.
-
Que voulez-vous ! dit Paul avec bonhomie,
vous avez cherché à m’humilier, je cherche à me réhabiliter ; je crois même
que j’ai quelque peu réussi. Mais, tenez, voilà de magnifiques pistolets,
sont-ils chargés ?
-
Ils le sont......
-
Eh bien ! regardez-là, dans le jardin, ce
beau cerisier sur lequel il reste à peine quelques fruits. Voyez-vous ce
gracieux, petit oiseau lissant ses plumes, à l’extrémité de cette branche
où, se trouve un bouquet de cerises ?
-
Je le vois très-bien.
-
Je ne veux pas le tuer, ce gentil petit animal,
mais seulement un peu l’effrayer ; il va s’enfuir à tirer d’ailes, |163 et le bouquet de cerises tombera au pied de l’arbre.
Et
visant légèrement, Paul fit partir la détente du pistolet. L’oiseau s’envole,
et après avoir tournoyé quelques secondes ; dans les airs ; il revient, se
placer sur l’arbre. Les cerises étaient tombées sur le sable.
M.
Jacques considérait Paul avec une surprise sans égale. Ses sens se calmaient
; il n’y avait pas là de témoins pouvant jouir
de
sa confusion, et son orgueil était par cela même de bien meilleure composition.
Il
commençait à se repentir d’avoir insulté un homme qui ne lui paraissait plus
lui être inférieur sur aucun point.
-
Je reconnais que vous tirez admirablement,
monsieur Sardan ; mais, dans un duel où votre adversaire devrait tirer le
premier, votre supériorité pourrait vous être inutile.
-
Pour que je ne tirasse pas le premier, il
faudrait que je fusse l’offenseur. À cela, je n’ai qu’une réponse à vous
faire ; je n’offense jamais personne volontairement.
-
Soit ; mais involontairement, cela peut arriver.
Dans
ce cas, je n’hésiterais pas un instant non à faire des excuses, on n’en doit
que pour une offense volontaire, mais à expliquer mes paroles et mes actions.
-
Et si l’on refusait d’accepter vos explications
?
-
Dans ce cas, je trouverais fort déraisonnable
d’offrir une épée ou des pistolets comme moyens de conviction.
-
Et quelle que fût l’offense que, vous pourriez
recevoir, vous n’en demanderiez jamais raison ? |164
-
Non, en vérité, car alors toutes les chances
seraient pour moi. Que voulez-vous, monsieur, c’est peut-être une bizarrerie,
mais je mets la vie d’un homme fort au-dessus des blessures que mon orgueil
peut recevoir. Selon moi, je vous le répète, celui qui, connaissant sa supériorité,
en use, est un assassin ;
voilà
pourquoi je ne me battrai jamais. Ne pas user de ses avantages serait s’exposer
à être tué, vous conviendrez que ce serait chose absurde.
-
Monsieur Paul, dit alors M. Jacques, évitant
cette fois de donner à son adversaire le nom de Sardan, sur lequel il avait
jusqu’alors appuyé avec une affectation malveillante dont l’intention n’avait
point échappé à Paul, voulez-vous me donner votre main ?
-
Bien volontiers, monsieur, répondit Paul
; et à présent que je vous ai forcé de m’estimer, souffrez que je vous force
encore d’être plus digne d’estime non-seulement à mes yeux, mais encore aux
vôtres.
-
Voudriez-vous donc me faire renoncer au duel
que je dois avoir avec votre frère ?
-
C’est pour cela que je suis venu ici, dit
Paul. J’ai voulu m’adresser à votre raison, aborder franchement avec vous
la question du véritable honneur. Je savais que vous étiez un homme d’études
sérieuses, d’études philosophiques. J’avais le droit de trouver en vous autre
chose qu’un esprit vulgaire, incapable de s’élever au-dessus des préjugés
reçus, et n’ayant
pas
le courage d’être conséquent avec lui-même. Je suis convaincu que je ne me
suis |165 pas trompé. Depuis vingt- quatre heures vous avez offensé
les deux frères. Votre orgueil vous a bien permis de me tendre la main ;
souffrez qu’au nom de Louis je vous tende la mienne.
-
Franchement je voudrais de tout mon cœur
racheter le passé. Mais vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas demander que
je fasse des excuses à votre frère, et m’est-il possible de lui
laisser
le droit de dire qu’après l’avoir insulté, j’ai refusé de lui accorder une
réparation de mes insultes. Puis-je sans me déshonorer m’affranchir des lois
d’un préjugé barbare.
-
Si vous partagiez mes convictions religieuses,
dit Paul, je vous dirais : Il faut renoncer à ce duel parce que vous le devez.
J’avoue qu’avec le secours de la raison purement philosophique il faut parler
moins haut, il lui est souvent bien difficile de se mettre au-dessus de ce
qu’elle méprise. M. le vicomte de Roquevair, vous croiriez-vous sérieusement
déshonoré en refusant de vous battre contre mon frère ? Votre passé ne vous
absoudrait-il pas même aux yeux les plus sévères sur ce que l’on est convenu
d’appeler le point d’honneur ? Tous ceux qui vous connaissent ne supposeraient-ils
pas que vous avez eu des raisons bien graves pour vous décider à un tel sacrifice
; n’êtes- vous pas au fond de l’âme très-persuadé que cet honneur plus cher
à un gentilhomme que sa propre vie ne saurait être entaché parce que vous
aurez fait votre devoir ?
-
Pourquoi M. Paul, dit Jacques d’une voix
un peu |466 peu émue, me donnez-vous le titre de vicomte de Roquevair
que vous m’avez tous jusqu’ici refusé avec tant d’obstination ?
-
Je voudrais, dit Paul, avant de satisfaire
votre juste curiosité, avoir reçu de vous une réponse ; elle sera telle,
je n’en doute pas, que je la désire.
-
Je ne me battrai point avec votre frère,
Monsieur. Nous venons d’avoir ensemble une espèce de duel, je confesse que
vous y avez eu tout l’avantage : il est juste de mettre le vaincu à la merci
du vainqueur.
-
Vicomte de Roquevair, dit Paul avec effusion,
je suis heureux de reconnaître que la noblesse de votre cœur ne le cède point
à la noblesse de votre sang. Je suis heureux de ce que pouvant vous racheter
la vie de mon frère, je la dois à votre générosité et de ce que vous ne m’avez
pas mis dans le cas de faire valoir comme un titre à votre reconnaissance
d’avoir rempli envers vous un devoir de justice.
-
Racheter la vie de votre frère ! remplir
envers moi un devoir de justice ! expliquez-vous : car je cherche en vain
un sens à vos paroles.
-
Vous allez les comprendre. Je compte sur
votre honneur, vicomte de Roquevair, pour tenir secrète la démarche que je
fais aujourd’hui auprès de vous. Je vais agir ainsi que l’exigent selon moi
les lois de la plus simple probité. Pourtant il est dans ma famille des personnes
qui peut-être auraient le droit de se plaindre de ne pas |167 avoir été consultées. Ce que je vais vous révéler doit
donc rester éternellement secret entre nous.
Et
tirant de la poche de son habit un rouleau de papiers assez volumineux, Paul
le présenta à M. Jacques.
-
Ce matin, lui dit-il, j’ai porté ce paquet
chez vous. Votre valet de chambre m’a dit que vous étiez à la campagne et
que vous y passeriez la journée ; je lui ai recommandé de vous remettre ces
papiers à votre retour. Je me suis rendu chez ma mère : là j’ai appris ce
qui s’était passe la veille. J’ai couru à votre hôtel, j’ai repris ces papiers
et je suis venu ici. Vous savez le reste.
Bien
que le service que je vous rends ne soit qu’une simple restitution, je
savais cependant qu’il calmerait tous vos
ressentiments.
Je pouvais tout attendre de cette ressource. Je vous remercie de ne m’avoir
pas mis dans la nécessité de l’employer.
M.
Jacques prit le paquet des mains de Paul. En parcourant les papiers, une
exclamation de surprise et de joie lui échappe, il a reconnu les titres qui
lui manquaient pour prouver sa filiation. C’était bien là l’acte de naissance
de cet aîné des Roquevair qui jadis avait quitté la France pour aller en
Hollande. C’était bien celui de son fils né à Roquevair : des lettres, d’autres
titres établissaient, en contrôlant les uns par les autres ces papiers authentiques
et ceux que possédait déjà le vicomte, qu’il était bien le seul et unique
héritier des Roquevair.
-
Apprenez-moi, dit-il en pressant avec effusion
les mains de Paul dans les siennes, comment ces papiers sont |168 tombés votre possession et me sont remis par vous ?
-
Ces papiers, lui dit Paul, étaient dans la
tour de Roquevair. J’ai toujours eu une passion pour cette vieille tour.
Lorsque les temps pluvieux si communs dans le Limousin, pendant une grande
partie de l’année, ne me permettaient pas d’aller dans la campagne me livrer
à mes rêveries, je montais au sommet du vieux donjon.
Cette
ascension offrait assez de difficultés pour que je fusse bien certain que
ma solitude ne serait pas troublée. Il vous est facile d’imaginer que j’ai
dû explorer les moindres recoins de latour. Le hasard servit ma curiosité
enfantine. Je découvris le secret d’une cachette habilement pratiquée dans
l’épaisseur du mur. Je trouvai là ces papiers, leur ancienneté m’intéressa
; mais je ne pus, alors parvenir à les déchiffrer. Je parlai de ma découverte
à ma grand’mère, elle n’y attacha aucune
importance.
Bientôt je n’y pensai plus moi-même. J’appris, il y a quelques jours, que
vous étiez entravé dans vos poursuites en raison de pièces importantes qui
vous manquaient : je me souvins des parchemins de la vieille tour. Je supposai
qu’ils pouvaient avoir pour vous une grande importance ; mais la caisse
contenant ces papiers, au lieu de m’avoir été expédiée avec d’autres caisses
renfermant mes herbiers et mes collections, avait été oubliée dans une auberge,
il m’a fallu la réclamer. Hier seulement elle m’est parvenue. Toutes mes
incertitudes ont été fixées. Ces papiers sont bien à vous, le
hasard
les a fait tomber entre mes mains : |169 c’est une restitution que
je vous fais, et rien de plus.
Adieu,
vicomte de Roquevair ; nous ne nous reverrons plus. On doit toujours ignorer
que nous nous sommes vus aujourd’hui et surtout quels furent les motifs de
cette entrevue.
— Cher
monsieur Sardan, dit le vicomte, votre âme si noble et si droite vous fait
regarder l’action généreuse que vous venez de faire comme un acte de probité
commune, et je ne connais personne, pas même moi, qui eût été capable de
la faire. Ne me quittez pas encore, poursuivit le vicomte profondément ému,
dans deux heures les témoins de votre frère vont arriver. Je désire que sans
être vu, vous puissiez entendre notre convention. Et si nous devons nous
séparer pour toujours, au moins donnez-moi le bonheur de passer quelques
instants avec l’homme que j’admire et que j’estime le plus au monde. Et M.
Jacques approchant deux fauteuils de la table de travail, en offrit un à
Paul. Celui-ci l’accepta.
À peine
la conversation fut-elle engagée que Paul brisé par les efforts qu’il avait
faits sur lui-même perdit cette surexcitation nerveuse qui l’avait soutenu
jusqu’alors : il redevint ce qu’il
était
habituellement, timide, taciturne, ne répondant plus que par monosyllabes.
Son regard animé dans lequel le vicomte avait surpris l’éclair du génie,
semblait nager dans le vague et suivre quelque rêve dans des mondes inconnus.
Bien
que le vicomte de Roquevair se laissât quelquefois |170 dominer par une vanité puérile, bien qu’il eût plus
de prétentions à la science que de science réelle et qu’il s’exagérât beaucoup
la portée de son intelligence, il était loin d’être un homme ordinaire. Il
lui avait été donné de voir Paul dans un de ces rares moments qui le transfiguraient,
et il avait reconnut la supériorité réelle du jeune Sardan. À présent il
se demandait le mystère de cette organisation à la fois si puissante et si
faible, et, cédant à un moment d’impressionnabilité, il prit une des jolies
mains de Paul entre les siennes et en examina la délicate contexture.
— Seule,
dit-il, la nature a le secret de la force qu’elle vous a donnée en la cachant
sous l’apparence de la débilité ; mais ne pourriez-vous pas m’éclairer sur
le mystère de votre organisation morale qui me semble plus étrange encore
que votre organisation physique ?
Il y
a dans votre être tout entier quelque chose d’indéfinissable. Ainsi votre
voix dont le timbre est si doux ne semble vous avoir été donnée que pour
chanter des vers ou murmurer des paroles de tendresse, et tout à l’heure,
lorsque vous vous sentîtes irrité parce qu’il faut bien nommer mon impertinence,
aux inflexions de cette voix harmonieuse succédèrent des notes graves, énergiques
: elles révélaient encore plus que vos paroles deux êtres différents. N’avez-vous
jamais réfléchi sur vous-même et verriez-vous, dans ma
curiosité
à cet égard autre chose que le mouvement d’irrésistible sympathie qui m’attire
vers vous ? |174
La physionomie
de Paul s’éclaira par un doux sourire, et Jacques qui l’examinait avec attention
trouva dans ce visage une sorte de beauté que le vulgaire ne pouvait comprendre.
— Non,
dit Paul, je n’ai pas beaucoup réfléchi sur moi-même. Ma force musculaire
est, comme vous le dites, le secret de la nature. Il n’est pas rare d’en
rencontrer une très-développée sous une apparence de faiblesse. L’étude de
la physiologie en fournit plus d’un exemple.
Quant
à ma force morale, je puis dans un moment donné éprouver en moi comme une
révolution subite. Mon extrême timidité disparaît, mon cœur devient inaccessible
à la crainte : mais probablement, ajouta Paul en souriant, que je ne suis
pas né pour les luttes morales, car elles m’épuisent. J’ai besoin de calme
et si je suis sorti aujourd’hui de cette apathie qui me fait, craindre tout
contact, parce que tout contact me blesse, c’est que la vie de mon frère
était exposée, c’est que ma mère était au désespoir ; et pour éviter une
douleur à ma mère, voyez-vous, je trouverais en moi une puissance d’énergie
et de force qui me briserait peut-être mais qui, à coup sûr, triompherait
de tous les obstacles.
— Votre
mère, dit le vicomte attendri, doit bien vous chérir, car elle sait, elle,
ce que vous êtes. Paul devint affreusement pâle : dans ces moments d’excitation
il agissait comme dans un rêve, il s’oubliait lui-même et ne sentait plus
ni ses joies ni ses douleurs personnelles ; |172 il semblait qu’il y eût en lui deux êtres dont l’un,
à un moment donné, exerçait sûr l’autre une
sorte
de magnétisme moral qui l’absorbait dans une unique pensée.
La parole
de M. de Roquevair fut le réveil complet de ce rêve qui n’ayant plus sa raison
d’être, commençait à se dissiper de lui-même.
Tout
revint dans la mémoire de Paul, et l’isolement de son enfance ; et Cécile,
et ses illusions perdues.
-
Personne ne m’aime, murmura-t-il d’une voix
étouffée.
-
Vous êtes donc malheureux, mon jeune ami?
dit le vicomte.
-
Il y a en moi, répondit Paul, une telle puissance
d’affection que personne sur la terre ne peut la partager ni la comprendre
; mais je ne suis pas toujours malheureux pour cela, ajouta Paul, car je
puis être heureux du bonheur de ceux que j’aime.
On
vint annoncer MM. de Thuy et de Mauberg, témoins de Louis, et M. de Roquevair,
soulevant une portière de velours qui séparait son salon de la chambre, dit
à Paul :
-
Entrez ici, je désire que vous puissiez entendre
la conversation que je vais avoir avec ces messieurs.
Les
témoins saluèrent M. Jacques avec tout le formalisme usité en pareille circonstance.
-
Messieurs, leur dit M. Jacques, je suis heureux
d’être connu de vous, il me sera beaucoup plus facile de m’expliquer.
|173 Je ne me vante pas d’être brave, puisque je rougirais
de ne
l’être
pas ; je l’ai prouvé souvent, trop souvent peut-être, et je crois au moins
avoir acquis le droit de refuser de le prouver une fois de plus, sans pour
cela faire suspecter et mon courage et mon honneur.
-
Quoi! Monsieur, vous refuseriez à M. de Roquevair
la satisfaction que vous lui devez après l’avoir insulté ?
-
Oui, monsieur de Mauberg, je la refuse.
Sans pouvoir m’expliquer davantage, je vous dirai, Messieurs, que ces titres
dont M. Sardan paraissait très-disposé à nier l’existence, sont entre mes
mains, et l’impossibilité d’une rencontre entre moi et
-
Sardan se lie aux circonstances qui m’en
ont rendu possesseur.
-
M. de Roquevair, dit alors le comte de
Thuy, peut exiger d’autres explications.
-
Je n’en donnerai pas d’autres.
-
Alors, reprit le comte de Thuy, M. Jacques
inaugurera le droit de porter sa couronne de vicomte en faisant des excuses
à
-
Sardan.
-
Je reconnaîtrai très-facilement que
j’ai eu dans la discussion qui s’est élevée hier, des torts plus grands
que ceux de mon adversaire. Je le crois trop galant homme pour exiger davantage.
-
Pour vous, Messieurs, si vous jugez ma
conduite peu convenable, si n’en pouvant comprendre les motifs vous m’accusez
de ne pas me conduire en gentilhomme, je suis prêt à vous prouver et à tous
ceux qui pourraient |174 partager votre
opinion
que je puis remettre mon épée dans le fourreau quand le véritable honneur
l’exige, mais que je ne craindrai pas de la sortir quand il s’agira de me
laver d’un injuste soupçon.
-
Monsieur, dit alors M. de Mauberg, vous
avez dit vrai ; vous êtes trop connu pour qu’on puisse vous accuser de lâcheté,
et bien que votre conduite me paraisse étrange, je la tiens pourtant pour
parfaitement honorable.
Monsieur
de Thuy ajouta quelques paroles dans le même sens et ils quittèrent M. Jacques.
Celui-ci fut retrouver Paul.
-
Adieu, vicomte de Roquevair, lui dit
le jeune Sardan, vous avez noblement tenu votre promesse. Adieu, soyez heureux
! je comprends que vous méritez de l’être. Il eût voulu pouvoir ajouter :
vous épouserez Cécile, rendez-la heureuse : mais ce nom, eût-il eu la force
de le prononcer, ne devait pas sortir de ses lèvres. Il serra la main de
M. Jacques et sortit.
-
N’accusons pas la société, se disait
Jacques en voyant Paul s’éloigner. N’exagérons pas ses vices. La corruption,
l’orgueil, l’égoïsme marchent au grand jour brisant tout ce qui leur fait
obstacle et ne laissant autour d’eux que des ruines. La vertu se cache dans
l’ombre ! Que d’héroïsmes méconnus ! que de grandes âmes incomprises ? Le
cœur de ce jeune homme ne renferme-t-il pas à lui seul assez de vertus sublimes
pour réconcilier avec l’humanité le plus sombre misanthrope ? On dit
que
|173 de telles âmes sont rares ; elles ne le sont peut-être
pas ; nous donnons-nous la peine de les chercher ? N’accordons-nous
pas
tout aux vaines apparences ? Si tous les saints inconnus pouvaient un seul
instant porter sur leurs fronts l’auréole qui resplendit dans leurs cœurs,
nous dirions que la vertu est reine même sur cette terre.
XX
Quelques
années se sont écoulées. La famille Sardan ne porte plus le nom de Roquevair.
Il n’y a point eu de jugement pour les y contraindre. M. Jacques, à l’aide
des papiers remis par Paul, a démontré ses droits aux conseillers de la famille
Sardan. Elle s’est rendue à l’évidence.
L’amour-propre
a souffert, mais il a soigneusement caché ses blessures. Louis est entré
dans un régiment de ligne ; il a fait la campagne d’Espagne et fait partie
de l’expédition de Grèce et de celle d’Alger39. Son courage,
son mérite réel comme officier, lui ont valu de l’avancement. Le nom de Sardan
commence à s’illustrer. Louis est parvenu au grade de chef de bataillon,
et, sans la passion du jeu qui le domine quelquefois, il justifierait toutes
les espérances de sa mère.
Au moment
où il fallut renoncer au nom de Roquevair, madame Sardan quitta quelque temps
Paris. Quand elle y revint, elle changea de quartier ; elle expliqua aux
connaissances qu’elle désirait conserver que ne possédant |476 plus
la terre de

39 L’expédition
d’Espagne fut menée par la France en avril 1823 par la France pour rétablir
la monarchie absolue de Ferdinand VII et mettre fin au triennat libéral;
celle de Grèce, plus précisément de Morée, en 1828, pour aider les Grecs
à se libérer du joug ottoman, celle d’Alger, de juin à juillet 1830, s’acheva
par la prise d’Alger.
Roquevair,
elle ne pensait pas devoir continuer à en porter, le nom.
Peu
de personnes connaissaient la lutte qui s’était élevée entre les Sardan et
le vicomte Jacques. Dans une petite ville, les moindres détails de cette
affaire eussent alimenté les conversations pendant dix ans ; à Paris personne
ne s’en occupa. On sut bien dans le grand monde qu’il y avait dans les salons
de Paris un vrai descendant de la famille des Roquevair, maison ne s’inquiéta
point s’il y en avait eu de faux, et le vicomte de Roquevair s’imposa, sur
ce sujet, le silence le plus délicat.
Peu
de jours après son entrevue avec M. Jacques, Paul avait reçu la nouvelle
de la mort de l’abbé de Vermot, son ami, son second père. Cette mort fut
pour Paul une bien vive douleur. Son isolement, était complet ; il acheva
de briser son cœur en rendant à madame de Cacérès et à sa fille la parole
qu’il en avait reçue. On ne lui demanda point d’explications, et trois mois
après Cécile portait le nom et le titre de vicomtesse de Roquevair.
Ce fut
après 1830 que l’abbé Romilly revint de ses pérégrinations apostoliques et,
se livra à la prédication en France.
Il était
parent de madame Sardan du côté des Rouvray. Il avait beaucoup aimé son cousin,
M. Rouvray frère de madame Sardan. Ce frère était mort depuis plusieurs
années. L’abbé Romilly fut heureux de rencontrer à Paris la |177 sœur de cet ami dont le souvenir lui était resté si
cher. Une liaison assez intime s’établit. L’appartement de madame Sardan
était trop vaste pour sa position de fortune : l’abbé Romilly en prit une
partie.
Le salon resta en commun et le soir les amis de madame Sardan et ceux de
l’abbé Romilly s’y réunissaient.
Lorsque
madame Sardan parlait de Louis à l’abbé Romilly, c’était avec toutes les
exagérations de la tendresse maternelle ; toutefois depuis que ce fils adoré
n’était plus que rarement à Paris, l’inaltérable douceur de Paul, l’affection
si tendre qu’il éprouvait pour sa mère, la délicatesse de ses attentions
pour elle avaient peu à peu fini par gagner le cœur de madame Sardan. Dans
son esprit Paul était toujours bien au-dessous de Louis. — Mais il est si
bon, disait-elle, qu’il est impossible de vivre avec lui sans l’aimer.
L’abbé
Romilly s’aperçut bientôt qu’à la bonté Paul joignait encore l’intelligence.
L’abbé prenait ses repas chez madame Sardan. Dans les conversations qui s’établissaient
entre eux, l’abbé remarquait que quelquefois Paul, encouragé par un sourire
de sa mère, donnait l’essor à sa pensée et que ses remarques ne manquaient
ni de solidité ni de finesse d’observation.
L’abbé
était surtout émerveillé de la prodigieuse mémoire de son neveu.
Par
suite des relations de l’abbé Romilly, le salon de madame Sardan était devenu
une espèce de salon littéraire. Il n’est pas nécessaire de dire que l’orgueil
de madame |178 Sardan était flatté de la nouvelle position qui lui
était faite. Il faut le dire, elle présidait dans son salon avec beaucoup
de grâce et un tact parfait des convenances.
Quant
à Paul, il était là ce que nous l’avons vu chez madame de Berthonville, il
gardait un profond silence et écoutait.
Un
des habitués du salon de madame Sardan y amena un soir un de nos penseurs
et de nos orateurs les plus illustres. Une discussion intéressante s’éleva
entre lui et l’abbé Romilly : les questions religieuses et politiques furent
traitées, tour à tour, avec verve et originalité par l’abbé Romilly et avec
une haute portée philosophique par son interlocuteur.
— Quel
dommage, dit l’abbé Romilly, quand il se trouva seul avec son neveu et madame
Sardan, que nous n’ayons pas eu ce soir un sténographe ! Combien dans ces
conversations particulières, dans ces improvisations spontanées, jaillit-il
de traits de lumière, oubliés quelques instants après et qu’on serait heureux
de retrouver aux heures du travail ! mais alors la pensée n’ayant rien pour
la surexciter, se trouve incapable de les reproduire.
Deux
jours après, Paul remit à son oncle un cahier assez volumineux. Toute la
conversation tant regrettée par l’abbé y était exactement retracée. L’abbé
reconnaissait toutes les paroles, toutes les pensées de l’homme distingué
avec lequel il était entré en lice ; il reconnaissait également toutes les
siennes.
Elles
étaient rendues, non d’une manière servile, mais avec une intelligence qui
leur |479 laissait toute leur originalité, et leur ôtait cependant
ces incorrections légères qui échappent toujours aux improvisateurs.
Il y
avait dans ce travail plus que de la mémoire. M. l’abbé Romilly le comprit
et se mit à observer son neveu avec plus d’attention qu’il ne l’avait fait
jusque-là. — Ce n’est pas un esprit créateur, se disait-il, mais c’est un
esprit capable de saisir la pensée se produisant devant lui, d’en pénétrer
la profondeur, de se l’assimiler. Quand on possède cette faculté, on n’est
pas un homme ordinaire. La vive lumière du génie peut frapper,
éblouir
des esprits vulgaires, mais ils ne sauraient en analyser le divin rayonnement.
Nos grands écrivains, nos grands orateurs subjuguent la foule, mais ils ne
sont vraiment compris que par un très-petit nombre d’hommes, seuls capables
de se rendre raison de leur enthousiasme.
Bien
qu’il fût réellement observateur, l’abbé Romilly en resta là. Il ne pénétra
pas plus avant dans l’intelligence de Paul. L’abbé Romilly avait surtout
le don de l’éloquence, il le possédait à un très-haut degré, et par cela
même, il lui était difficile de comprendre qu’il fût possible de concentrer
en soi la pensée, de la faire grandir, et d’allumer au fond de son âme le
feu sacré, sans que jamais une étincelle ne vînt au dehors en révéler la
présence.
Entre
sa mère et l’abbé Romilly pour lequel son attachement croissait chaque jour,
Paul se trouvait presque heureux. Évidemment les rêves de sa jeunesse |180 en, se dissipant avaient dû briser son cœur ; mais le
temps avait changé cette douleur en une mélancolie qui n’était pas sans charme.
Paul
avait suivi de loin la destinée de cette Cécile, objet d’une tendresse si
sainte et si pure. Jamais il ne l’avait revue, mais il savait que la vicomtesse
de Roquevair, restée fidèle, aux principes qu’elle avait reçus de sa mère,
et de l’abbé de Vermot, jouissait dans le monde d’une réputation irréprochable.
Cécile faisait partie de ce petit nombre de jeunes femmes, ne se laissant
pas dominer par les enivrements de leur beauté, de leur fortune, de leur
position sociale, mais, conservant avec soin le sentiment religieux qui brise
l’orgueil et maintient le cœur dans les bornes austères du devoir.
Paul
croyait Cécile parfaitement heureuse. Il se persuadait, dans sa charmante
modestie, que s’il lui eût été donné d’unir son sort à celui de l’amie de
son enfance, il eût été bien moins capable que le vicomte de Roquevair de
lui donner le bonheur qu’elle méritait.
Paul
se trompait. Cécile n’était pas heureuse. Quelques heures d’entraînement
avaient décidé fatalement de son sort. Ses premiers pas dans, le monde lui
avaient causé un éblouissement passager ; et quand elle se vit recherchée
par le vicomte de Roquevair si beau, si spirituel, si parfaitement distingué,
pouvant assurer à la femme qu’il lui plairait de choisir
l’existence
la plus brillante, Cécile prit la voix de la vanité pour celle |184 du cœur ; elle se persuada qu’elle n’avait jamais aimé
Paul. Le nom de Roquevair avait aussi sa séduction, Paul en était dépouillé
; on n’aurait avec lui qu’une existence paisible mais ignorée ; Cécile sacrifia
Paul.
Combien
ne voit-on pas, dans le grand monde, de ces jeunes femmes qui, le sourire
aux lèvres, le front couronné de fleurs, semblent dire : — Voyez, je suis
heureuse, mon sort est digne d’envie. Hélas ! si l’on pouvait lire dans leur
cœur, on y verrait souvent ce mot douloureux : Pitié ! pitié ! Que d’épines
cachées sous ces fleurs font chaque jour leur blessure ! blessure imperceptible,
qui devient, bientôt un supplice intolérable ! Il en était ainsi de Cécile.
Jetée par la vanité dans les splendeurs d’une position élevée, elle crut
que le bonheur était là. Elle rejeta celui que la Providence lui avait offert,
et le bonheur lui échappa. Le vicomte de Roquevair était à beaucoup d’égards
un homme remarquable ; mais il le savait, et surtout il le croyait trop.
Il y avait en lui trop d’admiration pour son propre mérite, pour que ce sentiment
n’absorbât pas tous les autres. Froid,
égoïste,
orgueilleux, il n’avait épousé mademoiselle de Cacérès que parce que ce mariage
réunissait les convenances de nom et de fortune, et que la beauté remarquable
de Cécile flattait son amour-propre.
Le vicomte
de Roquevair eut pour sa femme tous les égards qu’elle était en droit d’attendre
de la part |182 d’un homme bien né ; mais il n’imagina jamais qu’il
pût y avoir entre eux une association d’idées et d’intelligence, il se croyait
placé dans des régions trop supérieures pour qu’il lui fût possible d’y élever
avec lui sa jeune compagne. Il la laissait libre de suivre ses
goûts,
mais il n’eut jamais la pensée de lui faire partager les siens et de la croire
capable même de les comprendre.
Cécile
avait entrevu dans sa jeunesse le charme de cette union de deux cœurs et
de deux esprits élevés, qu’il est donné à si peu d’êtres de réaliser. Elle
se rappelait tous les trésors d’intelligence que Paul avait si souvent dévoilés
devant elle ; elle se dit que son mari pour lequel elle ne serait jamais
autre chose qu’un être frivole auquel les hochets de la vanité peuvent suffire,
était pourtant inférieur à Paul. Elle pensa que si le vicomte de Roquevair
l’avait aimée, il l’eût comprise comme Paul l’avait comprise. Les dédains
de son mari froissèrent son cœur et humilièrent son orgueil. Elle souffrit
de cet isolement dans la vie à deux, le plus pénible des isolements. Elle
regretta alors de s’être laissé séduire par des dehors brillants. Elle avait
presque rougi de son affection pour Paul ; elle vit mais trop tard que cette
affection eût pu seule la rendre heureuse.
Cécile
avait dans l’âme une véritable noblesse et surtout le sentiment du devoir.
Elle accepta avec courage la position qu’elle s’était faite ; elle ne
se posa point en |183 femme
incomprise,
bien que ce fût alors grandement la mode ; elle se résigna.
À l’époque
de la révolution de Juillet, le vicomte de Roquevair, habitant la France
depuis peu d’années, ne se trouvait lié à aucun pacte. Il crut devoir à son
nom de se rallier à celui du malheur. Le nouveau pouvoir lui offrit une position
dans la diplomatie : sa connaissance des cours étrangères et du mouvement
des esprits en Allemagne et en Italie faisait du vicomte de Roquevair une
précieuse acquisition pour le gouvernement ; il refusa et se retira pour
quelque temps au château de Roquevair dont la restauration était loin d’être
achevée.
XXI
Depuis
plusieurs années, Alger était une possession française. Le régiment dans
lequel Louis servait fut appelé en France et vint en garnison à Paris.
Madame
Sardan, dans l’enivrement de la joie de revoir son enfant de prédilection,
ne perdit pas tout à fait les sentiments d’affection qu’elle commençait à
éprouver pour Paul, mais ils se refroidirent un peu. Elle le comparait sans
cesse à son frère et cette comparaison n’était pas avantageuse à Paul. Paul
s’en apercevait, mais il était lui-même si heureux de revoir son frère, si
heureux du bonheur de sa mère, il trouvait l’admiration de celle-ci pour
Louis si bien fondée, qu’il ne lui en coûta rien |184
de s’effacer
complètement et de reprendre chez sa mère la position de nullité qu’il
y avait presque toujours eue.
Louis,
malgré les instances de madame Sardan, sortait tous les soirs et ne rentrait
que fort tard.
— Le
salon de ma mère, disait-il à Paul, est devenu une espèce de bureau d’esprit
; les hommes qui le président sont tous des hommes sérieux. Tu comprends,
mon cher ami, que cela m’est insupportable.
Bientôt
Paul s’aperçut que Louis devenait sombre et préoccupé. Il lui adressa quelques
questions sur les causes de sa
tristesse.
Louis les accueillit avec douceur, mais il refusa de s’expliquer. Il assura
son frère qu’il n’avait aucun motif de chagrin, et répondit par des plaisanteries
aux instances de Paul à ce sujet.
Louis
cessa de sortir, le soir ; il passa ses soirées dans le salon de sa mère,
et fut assez surpris au bout de quelques jours d’y trouver moins d’ennui
qu’il ne l’avait craint. Cependant il devenait de plus en plus triste, et
sa mère commençait à s’en apercevoir et à s’en inquiéter.
Depuis
quelques jours, il n’était bruit dans le monde littéraire que de l’apparition
d’un volume de poésies, publié sans nom d’auteur sous le titre de Rêveries
d’un solitaire. Ce livre excitait un enthousiasme universel.
Un
des habitués des réunions de madame Sardan lui apporta ce livre. La plupart
de ceux qui se trouvaient là ne le connaissant pas encore, on proposa d’en
faire la lecture. |185
Louis
aimait les vers ; mais rien ne lui en gâtait l’harmonie comme une lecture
inintelligente : il se hâta de proposer Paul pour lecteur, sachant que personne
mieux que lui ne savait lire à haute voix et ne disait mieux les vers.
À cette
proposition, Paul devint fort rouge. L’abbé Romilly et tous ceux qui avaient
entendu parler Paul s’accordèrent à penser que nulle voix ne pouvait, mieux
que la sienne, ajouter au charme de ces beaux vers. Les instances furent
générales. Paul pensa qu’après tout s’il ne pouvait rendre ses propres pensées,
il pouvait au moins lire celles des autres ; il s’arma de courage et consentit
à ce qu’on désirait.
Pendant
qu’on se rangeait en cercle autour de lui, ses yeux parcoururent les premières
lignes du volume, et l’étonnement le plus profond se peignit sur son visage.
Il tourne rapidement quelques feuillets, et sa surprise semble s’accroître.
Cette impression fut si forte qu’elle domina toutes les autres. Sa voix ne
trembla pas ; il lut comme s’il eût été seul.
Le poëte
avait chanté toutes les affections que l’âme humaine peut éprouver, toutes
ses aspirations, ses espérances, ses craintes, ses joies et ses douleurs.
Tout cela était décrit avec un charme incomparable, une richesse d’imagination
jetant sur chaque pensée le plus brillant coloris. En même temps, tout était
chaste, tout était pur : le sentiment religieux dominait partout. Il jetait
son voile divin sur ce qui tenait de trop près aux
|186 dangereuses passions du cœur. Le poëte était
chrétien.
L’admiration
de tous ceux qui étaient là fut extrême. — Il faut, dit M. de Canisy qui
avait apporté le volume, pour lire ainsi les vers en sentir soi-même toute
la beauté : je voudrais que l’auteur de cette belle poésie eût été là pour
l’entendre lire par M. Sardan.
Vous
deviez être heureux vous-même, M. Paul, en nous faisant cette lecture.
-
Moi, dit Paul, mais je vous assure... je
ne vois pas.... je ne trouve pas... que ces vers méritent autant d’éloges.
-
Ah ! ciel ! dit madame Sardan à l’abbé Romilly,
interrompez cette conversation ! Par quelle inconcevable sottise va-t-il
critiquer ce que tout le monde admire ?
Heureusement
pour l’amour-propre de madame Sardan, M. de Canusy eut pitié de Paul et ne
lui demanda pas compte de son opinion. L’abbé Romilly disait à madame Sardan
:
-
Qui aurait cru, en entendant lire Paul, qu’il
ne possédât pas le sentiment de la poésie ?
-
Eh ! mon Dieu ! dit madame Sardan, la voix
de Paul est un instrument, voilà tout. Elle rend naturellement ce qui est
mélodie. Il en est de même de sa mémoire, elle rend avec une rare perfection
ce qu’elle a entendu. Mais lui qui ne parle jamais, pourquoi ce soir est-il
sorti de sa prudente habitude ?
Le
fait est qu’il avait fallu toute la déférence qu’on |187 devait à la maîtresse de la maison pour que l’opposition
de Paul ne soulevât pas un tolle général, et M. de Canisy disait en
sortant :
-
M. Sardan lit admirablement bien ; mais je
le crois inepte. Il a l’air de seritir et il ne comprend même pas.
Louis
accompagna son frère dans sa chambre.
-
Je voudrais bien, lui dit-il, être le monsieur
***, auteur du livre que tu nous as lu ; il est probable que je n’emploierais
pas son talent d’une manière aussi morale, mais je serais bientôt riche.
-
Riche, dit Paul, et pourquoi ?
-
Pourquoi ? mais un talent semblable, mon
cher Paul, est une fortune.
-
Tu trouves donc ces vers... passables.
-
Passables ! quel mot tu emploies ! dis donc
admirables : ils le sont tellement que j’ai oublié, en te les entendant lire,
quelques instants mes chagrins.
-
Je ne m’étais donc pas trompé, dit Paul,
tu souffres ; pourquoi ne voulais-tu pas me le dire ?
-
Mes peines sont mon ouvrage, Paul ; je sais
bien que ta pitié pour moi en sera plus grande. La pitié, je la repousserais
de tout autre que d’un frère, mais de toi elle m’est douce, Paul.
-
Ouvre-moi donc ton cœur, Louis. Je ne pourrai
peut-être rien pour adoucir tes peines, mais je saurai toujours les partager.
Alors
Louis avoua que depuis qu’il était à Paris, il avait joué et perdu une somme
assez forte. Selon les lois du |188 jeu, il avait dû la payer
dans les vingt-quatre heures. Il avait eu pour cela recours à un usurier
et consenti une lettre de change. Il espérait regagner ce qu’il avait perdu.
Le sort lui était resté contraire ; et celui qui lui avait prêté à deux fois
différentes était, le matin, venu lui dire qu’il ne voulait pas consentir
à renouveler ses billets. Il savait que la fortune de madame
Sardan
n’était pas considérable, et qu’elle était toute en porte- feuille. Enfin,
dit Louis, dans trois jours il faut que je trouve trente mille francs !...
-
Eh bien ! dit Paul, ma grand’mère m’a laissé
une rente de mille francs. Les fonds sont au pair, il faut la vendre.
-
Y penses-tu, Paul ? moi, te ravir tout ce
que tu possèdes ! et ces mille francs, tu les donnes à ma mère.
-
Oh ! je suis riche à présent, mon cher Louis,
je gagne à mon bureau quinze cents francs. La pension que je donne à ma mère
sera donc exactement payée ; le surplus me suffira. En donnant vingt mille
francs à ton créancier, tu pourras pour le reste obtenir du temps.
Louis
exprima à son frère la plus vive reconnaissance. Il pleura : il l’appela
son sauveur, sa providence ; lui protesta qu’il ne toucherait des cartes
de sa vie.
Paul
savait avec quelle facilité de semblables promesses s’oublient ; mais il
avait trop de délicatesse pour paraître douter de la sincérité de celles
de son frère.
L’usurier
ne voulut consentir qu’à un délai d’un mois.
Paul
vendit quelques objets d’art auxquels il tenait |189 beaucoup ; mais cela était loin de faire les dix mille
francs.
Il savait
que madame Sardan, pendant que Louis était dans la garde, avait souvent
payé les dettes de jeu de son fils, et que la gêne où elle se trouvait
n’avait pas d’autre cause. Depuis plus de dix ans, Louis semblait corrigé.
Madame
Sardan s’applaudissait de n’avoir pas désespéré de la raison et surtout du
cœur de son fils. Paul comprenait que révéler à sa mère les
nouvelles fautes de Louis, lui demander de nouveaux sacrifices,
serait lui porter un coup d’autant plus douloureux, qu’il serait attendu.
Avant tout, Paul voulut éviter une peine à sa mère. Mais quel moyen employer
?
Une
inspiration subite arriva. Il prit dans son bureau un manuscrit, et quelques
instants après il était chez un libraire de la rue de Seine.
Paul
demanda à parler à M. Fabry ; on le fit entrer dns un salon. Paul était dans
un si piteux embarras, sa voix, en saluant
-
Fabry, était si tremblante, que lui-ci devina
de suite, surtout en voyant un rouleau papier sortir à demi de la poche de
son visiteur, qu’il avait devant lui un écrivain à son début. Sa physionomie
en conséquence fut expression glaciale, et sans prier Paul de s’asseoir,
il lui demanda ce qu’il désirait. Paul sortit le rouleau de sa poche; et
le présentant au jestueux éditeur, il lui dit :
-
Monsieur, je voudrais vendre ce manuscrit.
-
Le temps est mal choisi, Monsieur ; le
commerce |190 de la. librairie est presque nul. Nous sommes encombrés....
Quel est le genre de l’ouvrage que vous me proposez ?
-
Ce sont des vers.
-
Des vers, mon cher Monsieur ! Mais la
poésie est complètement tombée aujourd’hui. Éditer des poésies ! mais on
n’en vendrait pas cent exemplaires. Je crois les vôtres excellents ; mais
si des vers ne sont pas signés Lamartine ou Victor Hugo, ils ne se vendent
pas.
-
Cependant, Monsieur, dit timidement Paul,
vous avez édité les Rêveries d’un solitaire, et ce livre a obtenu
un beau succès.
-
J’en conviens, dit M. Fabry; l’auteur
a reçu trois mille francs pour les deux premières éditions. Elles ont été
enlevées
dans
quinze jours. J’ai offert à l’auteur neuf mille francs de la propriété de
l’ouvrage, et je lui offre pour un second volume le double de cette somme.
J’ai fait là une heureuse rencontre, je l’avoue ; mais généralement, je n’édite
pas ce genre d’ouvrage.
-
Ainsi, Monsieur, vous connaissez l’auteur
des Rêveries d’un solitaire ?
-
Sans doute, puisque je traite avec lui
directement. C’est un jeune homme déjà connu dans le monde littéraire par
des bluettes, des vaudevilles, des drames. Il a débuté, par là ; mais, ces
essais ne semblaient pas promettre un poëte aussi remarquable. C’était plus
que médiocre.
-
Et vous refusez absolument d’être mon
éditeur. |194 Je ne serais pourtant pas exigeant. Vous avez offert
à l’auteur des Rêveries dix-huit mille francs d’un second volume ;
je me contenterais, moi, du tiers de cette somme.
-
Le tiers ! s’écria M. Fabry, pardonnez-moi.
Monsieur, si je vous fais observer que vous n’entendez rien, absolument rien
aux affaires de librairie. Comment ! vous voulez que je vous paye un essai
six mille francs, et des vers, encore ! Si j’en offre dix-huit à M. ***,
si je suis même disposé à aller jusqu’à vingt, c’est qu’il y a là un succès
assuré, une réputation déjà faite. Tenez, voilà l’auteur des Rêveries
d’un solitaire qui arrive, pardon si je ne puis vous donner plus de temps.
Si vous vous essayez dans quelque autre genre, nous verrons ; je pourrai
peut-être faire quelque chose avec vous. Mais la poésie, Monsieur, croyez-moi,
renoncez-y.
M. ***
était un jeune homme dont la figure ne manquait pas d’intelligence. Mais,
dans tout l’ensemble du personnage, dans
la
voix surtout, il y avait quelque chose de vulgaire qui ne permettait pas
de supposer que son esprit s’élevât à de hautes conceptions et l’assurance
avec laquelle ce jeune homme se présentait, ressemblait fort à de l’effronterie.
-
Eh bien! mon cher Fabry, dit-il, les
deux premières éditions de mon livre sont épuisées ? Vous m’offrez neuf mille
francs de la propriété de mon ouvrage. Vous comprenez que je ne puis me contenter
de cela. |192
Ensuite
je veux mettre mon nom à l’édition nouvelle, comme vous me l’avez conseillé.
Et se
retournant pour arranger ses cheveux devant une glace, le jeune auteur aperçut
Paul.
-
Ah ! pardon, fit-il, je vois, mon cher
Fabry, que vous êtes occupé avec monsieur.
-
Pas le moins du monde, dit Fabry, regardant
Paul d’un air qui semblait dire : Pourquoi êtes-vous encore là ?
-
Que ma présence, dit Paul, ne vous empêche
pas de continuer votre conversation, Messieurs ; elle est pour moi d’un haut
intérêt.
-
Vraiment ? dit le jeune homme. Et pourrait-on
savoir, Monsieur, quelle espèce d’intérêt vous pouvez prendre à ce qui me
concerne ?
-
Rien de plus facile, Monsieur. Je vois
que vous avez une grande habitude de traiter avec les libraires, et je suis
déterminé
à
en passer par les conditions que vous ferez accepter à M. Fabry.
-
Ah ! monsieur est auteur? (Il a une figure
famélique, celui- là, murmura tout bas le jeune homme.) Ainsi, continua-t-il
d’une voix plus haute, vous voulez que mon traité vous serve de modèle ?
-
Mais non, mais non, dit Fabry, pouvant
à peine contenir son impatience et se sentant pressé du désir de prendre
Paul par les épaules et de le conduire à la porte. Je vous assure, monsieur
Blanchard, que je n’ai rien à traiter avec monsieur. |193
-
Vous vous trompez, monsieur Fabry, dit
Paul en souriant, vous avez traité avec monsieur que voilà pour les deux
premières éditions de mon ouvrage, il me semble qu’il est plus que juste
que vous traitiez des éditions suivantes avec moi.
-
Votre ouvrage ! s’écrièrent à la fois
Fabry et Blanchard.
Le libraire
jeta un regard sur ce jeune homme. II le vit pâlir d’une manière effrayante.
La confusion éclatait dans tous ses traits. Aussi M. Fabry se retourna du
côté de Paul et lui demanda avec beaucoup de politesse de s’expliquer.
-
Avez-vous, lui dit Paul, le manuscrit
des premiers vers que vous avez publiés ?
-
Oui, lui dit Fabry; et mettant la main
sur une étagère, il en retira l’album perdu jadis à Fontenay-aux-Roses.
-
Le voici, dit-il, en le présentant à
Paul.
-
Comparez, monsieur Fabry, l’écriture
de cet album et celle du manuscrit que je vous offre ; vous verrez qu’elle
est identique ; et puis remarquez que mon nom inscrit à la première page
a été effacé.
-
Vous n’avez rien à répondre à l’accusation
que monsieur porte contre vous, monsieur Blanchard ?
-
Non, dit le jeune homme d’une voix étouffée.
J’ai trouvé ces vers, je l’avoue. J’en ai reconnu de suite le mérite. Je
les ai gardés longtemps sans les montrer ; |194 plus tard, ayant besoin d’argent, je les ai publiés,
mais je n’y ai pas mis mon nom.
-
Et c’est une délicatesse dont on doit
vous savoir gré, dit Paul, qui souffrait de l’humiliation de ce jeune présomptueux.
M. Blanchard
regarda Paul; il trouva sur son visage une si grande expression d’indulgence,
qu’il comprit tout ce qu’il pouvait attendre de générosité de la part de
son adversaire.
-
Monsieur, lui dit-il, vous pouvez me
perdre ; mon nom n’est pas célèbre, mais enfin il est connu dans un certain
genre de littérature. Avec ma plume, je suis parvenu à me créer une existence.
Mon père est un ancien militaire ; il n’a pour vivre qu’une petite pension.
J’ai eu jusqu’à présent le bonheur de lui être utile. Si mon fatal secret
est dévoilé, je suis déshonoré ; je serai forcé de quitter Paris. J’aurai
la ressource de me faire soldat, mais mon père sera misérable.
-
Monsieur, répondit Paul, votre père,
dites-vous, est un ancien militaire ? Vous vous appelez Blanchard : seriez-vous
le fils de Pierre Blanchard, ancien maître d’armes habitant depuis de longues
années une petite ville de la Corrèze ?
-
À
Treignac40.
-
Précisément, je savais que Pierre Blanchard
avait un fils, mais j’ignorais que ce fils fût à Paris. Je vois à votre confession,
Monsieur, que votre âme n’est point dégradée. Le nom de votre père vous protège
auprès de |195 moi. La leçon que vous recevez aujourd’hui vous sera,
je l’espère, salutaire. M. Fabry et moi nous vous garderons un secret inviolable.
M. Blanchard
se retira. Resté seul avec M. Fabry, Paul lui dit :
-
À présent, Monsieur, voulez-vous traiter
avec moi ?
-
De tout mon cœur, Monsieur ; je maintiens
les offres que j’avais faites à ce jeune homme. Je serai heureux de mettre
votre nom à la place du sien.
-
Non, Monsieur, dit Paul ; je veux que
mon nom reste inconnu. Mettez un pseudonyme, Henri Lesueur, si vous voulez.
M. Fabry
consentit à tout ce que voulut Paul, il lui promit de ne jamais révéler
son nom et de se taire sur les singulières circonstances
de leur entrevue. Il prit aussi des termes pour les payements. Mais Paul
eut de suite à sa disposition la somme nécessaire pour compléter les trente
mille francs dus par Louis.
Celui-ci
tint parole ; il ne joua plus. Il ignorait comment son frère avait pu réussir
à compléter la somme qu’il devait. Paul à toutes les questions répondait
d’une manière évasive.

40 Le
texte porte à nouveau : à Étreignac.
Le
second volume des Rêveries obtint un succès égal à celui du premier.
Paul
fut bien forcé de croire en dépit de sa défiance de lui- même et de son incomparable
modestie, qu’il avait reçu de Dieu des facultés intelligentes au-dessus de
celles |196 accordées au vulgaire. Il se livra dès lors à un travail
assidu. Ce fut dans ce temps qu’il eut la douleur de perdre sa mère ; madame
Sardan mourut sans avoir connu son fils. Mais elle avait pris pour lui depuis
quelques années un véritable attachement. Les regrets de Paul furent extrêmes.
L’héritage de sa mère, les
trente
mille francs que son frère lui remit, permettaient à Paul de quitter son
emploi au ministère de la guerre. Il allait prendre cette détermination,
mais des événements inattendus changèrent cette résolution.
Paul
apprit que le vicomte de Roquevair, par suite des dépenses sucessives qu’il
avait faites pour la restauration de son château, et de malheureuses spéculations
dans lesquelles il avait engagé sa fortune et celle de sa femme, était entièrement
ruiné. Roquevair était hypothéqué au delà de sa valeur.
Louis
et l’abbé Romilly furent très-étonnés quand tout d’un coup Paul leur dit
qu’il était décidé à ne pas abandonner son bureau, que l’habitude lui avait
rendu cette occupation nécessaire. Comme après tout la fortune de Paul était
médiocre, son frère et son oncle n’insistèrent pas.
Mais
à cette même époque le vicomte de Roquevair reçut une somme assez considérable
par une voie inconnue, on lui disait que c’était une restitution. Le vicomte
imagina qu’un des fripons qui l’avaient volé, avait eu un salutaire remords
de conscience : il s’applaudit fort du résultat. |197
Cet
envoi suffisait pour dégrever quelque peu Roquevair, et permettre d’y vivre.
Mais si la misère était bannie du château, la gêne y était encore.
Paul
avait conservé pour l’abbé de Vermot une profonde reconnaissance. Il regardait
avec raison le développement de son esprit comme l’œuvre de cet excellent
ami.
— Je lui
dois tout, disait-il.
Quand
même Cécile ne fût pas toujours restée pour Paul une sœur bien-aimée, il
eût fait pour elle les mêmes sacrifices : c’était la nièce de l’abbé de Vermot.
Seulement ces sacrifices devaient être à jamais ignorés de ceux qui en étaient
l’objet. Mais Paul savait bien qu’ils ne soupçonneraient pas un pauvre employé
dans un ministère, d’être venu à leur secours. Il conserva donc une place
qui lui était devenue nécessaire. Ce fut à cette époque qu’il se mit à accompagner
tous les dimanches l’abbé Romilly chez madame de Berthonville. Depuis la
mort de sa mère, Paul avait toujours vécu avec son oncle.
Paul
se livra à un travail incessant, il abandonna la poésie pour des travaux
plus sérieux. M. Fabry ne refusait plus d’éditer des ouvrages dont le succès
était assuré.
Deux
ans s’étaient écoulés depuis que Paul venait chez madame de Berthonville
; plusieurs envois avaient été faits à Roquevair. Paul se mit à composer
un ouvrage |198 dont le prix devait lui donner les moyens de libérer
entièrement Roquevair.
Ce fut
alors qu’il tomba malade et que l’abbé Romilly nous parut si cruellement
inquiet.
Paul
trouva la force de lutter contre la maladie et de terminer cette œuvre nouvelle
; il en reçut le prix convenu et se dit : Je puis à présent mourir ; ma tâche
est accomplie.
Un jour
l’abbé Romilly sortit laissant son neveu beaucoup mieux, mais trop faible
pour permettre de supposer qu’il eût la pensée de quitter l’hôtel. M. Romilly
avait fait un livre sur les orateurs chrétiens, il voulait le faire paraître.
Après avoir fait plusieurs courses dans Paris, parlé à deux ou trois libraires
sans avoir pu s’arranger avec eux, il entra chez M. Fabry qu’il ne connaissait
pas du tout.
À côté
du salon où M. Fabry recevait sa clientèle, se trouvait un petit cabinet
de travail dont la porte était située en face de la cheminée du salon. Lorsque
l’abbé entra dans le salon, M. Fabry sortit du cabinet.
-
Pouvez-vous, lui dit l’abbé, me donner quelques
instants ?
-
Certainement, monsieur l’abbé, répondit celui-ci.
Fabry reconnut de suite l’abbé Romilly : il l’avait vu en chaire, et il professait
pour son beau talent une grande admiration.
L’abbé
expliqua à M. Fabry ce qu’il désirait, et, les arrangements terminés, on
causa. |199
-
Je vais, dit le librairie, éditer un ouvrage
que je crois appelé, à un immense succès. Il est de l’auteur connu sous le
nom de Henri Lesueur. C’est une œuvre d’une haute portée philosophique, qui
augmentera beaucoup, la réputation de cet écrivain.
-
Mais enfin, dit l’abbé, quel est ce Henri
Lesueur que tout le monde lit et que personne ne connaît ? comment, depuis
trois ans, le mystère dont il s’enveloppe ne s’est-il pas dévoilé ? Voyons,
M. Fabry, dites-moi ce secret.
-
Impossible, M. l’abbé. M. Henri Lesueur m’a
promis que je serais son seul éditeur à la condition que je cacherai toujours
son nom : j’ai donné ma parole, je la tiendrai.
-
Mais c’est inconcevable, poursuivit l’abbé
; après, des succès éclatants et dans tous les genres, comment se fait-il
que son incognito n’ait pas été trahi ? il n’est pas probable que vous possédiez
seul son secret ; il doit avoir une position dans le monde. Ceux qui l’entourent
doivent être dans sa confidence : il a des amis bien discrets !
Dans
ce moment M. Fabry se leva pour entr’ouvrir une fenêtre, afin de laisser
échapper de la fumée qu’un vent assez violent faisait pénétrer dans le salon.
Le courant d’air fit brusquement ouvrir la porte mal fermée du cabinet, et
l’abbé Romilly debout devant la glace qui lui renvoyait parfaitement la vue
de l’intérieur du cabinet, |200 aperçut assis auprès d’une
table et corrigeant des épreuves, Paul, son neveu.
-
Comment mon neveu se trouve-t-il ici ? dit
l’abbé Romilly, en désignant Paul au libraire.
-
M. Henri Lesueur est votre neveu ! et vous
prétendiez ne rien savoir ! M. Romilly, c’était donc une épreuve, que vous
me faisiez subir ?
-
Une épreuve ! que voulez-vous dire ? ce jeune
homme serait Henri Lesueur ?
-
Lui-même.
Paul
absorbé dans son travail n’avait rien entendu. Mais tout à coup il sent deux
mains presser sa tête et des lèvres qui impriment un baiser sur son front.
Il regarde et voit son oncle. Des larmes de bonheur coulaient sur les joues
du vieillard.
On s’explique.
Paul est tour à tour grondé et caressé par l’abbé ; celui-ci déclare à son
neveu qu’il entend que le voile de l’anonyme soit complètement déchiré et
que le nouvel ouvrage édité par M. Fabry porte le nom de Paul Sardan.
Paul avait
pris avec son oncle les habitudes de soumission qu’il gardait envers sa mère
; il consentit à tout ce qu’on voulut.
Nul
sur la terre n’est absolument parfait. Paul au fond de son cœur ne fut peut-être
pas très-fâché d’être contraint à mettre son nom sur, ses œuvres. S’il était
possible qu’il y eût au monde un auteur qui n’eût rien à démêler avec le
démon de l’orgueil, cet auteur eût |204 été Paul. Mais nous n’osons
affirmer que notre héros fût à ce point dépouillé du vieil homme, et que
ce bruit fait autour de son nom, dont la seule idée l’effrayait au commencement
de sa carrière, n’eût pas fini par lui paraître sinon désirable au moins
facile à supporter.
Paul
fit plus de résistance quand son oncle le pressa de quitter son emploi. Il
disait avec raison que ses appointements lui étaient nécessaires.
— Mais
tu as la fortune de ta mère, et je sais que M. Fabry t’a payé tes œuvres
consciencieusement, tu as gagné beaucoup d’argent... Allons ! tu rougis,
n’en parlons plus, je soupçonne là-dessous quelque généreux mystère. Je ne
veux rien savoir.
Seulement
je veux que tu abandonnes un travail ingrat qui fait perdre un temps précieux
à un homme de lettres... Vous êtes chez moi, Monsieur, et vous ferez ma volonté
!
Ce fut
le lendemain de ce jour mémorable que.l’abbé Romilly revint avec son neveu
chez madame de Berthonville, et que nous fûmes tous frappés, on s’en souvient,
de l’air radieux de notre excellent abbé. C’était le 1er février. |202
XXII
LA VICOMTESSE
DE ROQUEVAIR À MADAME EMMA DE HANLAY.
Décembre 184...
« Il
est vrai, ma chère amie, que toutes les épreuves dont je vous ai fait le
récit ont été pour moi très-pénibles à supporter, mais à côté des malheurs
qu’il nous envoie, Dieu place souvent des consolations qui nous font souffrir
sans murmures les amertumes de la vie.
« Au
moment où, même en vendant Roquevair plus cher qu’il n’avait été acheté,
nous ne pouvions éviter de tomber dans une affreuse misère, qu’il m’eût été
difficile de supporter avec résignation, car enfin je suis mère, on a envoyé
en trois fois différentes à mon mari, à titre de restitution, des sommes
assez considérables. Nous avons pu libérer une partie de la propriété pour
y vivre sans augmenter le chiffre de nos dettes.
« Alors,
plus calme, je me suis dévouée à mon mari et à ma fille.
« La
solitude, la pauvreté, les craintes de l’avenir ont amené entre M. de Roquevair
et moi une intimité qui n’avait jamais pu s’établir dans le grand monde.
Était-ce ma faute, était-ce celle
du
tourbillon dans lequel nous vivions ? Je ne le sais pas ; mais à coup sûr,
nous avons découvert ici que nous ne nous connaissions |203 pas : mon mari prétend avoir eu en moi, pendant de longues
années, un trésor dont il n’avait jamais apprécié la valeur. Il en est résulté
que nous avons recommencé une nouvelle vie. Aussi, j’ai béni la pauvreté
; c’est à elle que je dois d’être heureuse du seul bonheur qu’un cœur honnête
puisse
envier,
une affection légitime fondée sur l’estime et sur une confiance réciproque.
« Riez-en,
si vous le voulez, mais à trente-six ans je commence à réaliser les rêves
charmants de la jeunesse, et j’ai la certitude que cette félicité, si lente
à arriver, sera durable.
« Ma
fille a dix-sept ans. Elle répond à toutes nos espérances. Sa raison est
parfaite. Elle a accepté notre détresse d’abord, ensuite notre médiocrité,
avec un courage qui ne s’est pas démenti un seul instant. Sa vivacité, sa
gaieté mettent la vie dans notre intérieur. Marie est l’ange chargé d’éloigner
de son père et de moi toutes pensées sombres, tous regrets du passé, tous
soucis pour l’avenir.
« Le
jour où je crus qu’il faudrait vendre Roquevair, j’éprouvai une grande douleur
; mais du moment que la restitution mystérieuse nous eut permis de conserver
ici un abri et d’y vivre, il m’a semblé que le malheur ne pouvait plus m’atteindre.
« Ma
fille est douée d’une intelligence vraiment supérieure. Elle aime passionnément
la lecture. Aussi, nous faisons venir tous les ouvrages nouveaux qui nous
paraissent mériter d’être lus. C’est notre seule dépense |204 de luxe. Nous faisons un choix pour ma fille, elle a
déjà une fort bonne bibliothèque.
Parmi
les écrivains modernes, notre auteur de prédilection est Henri Lesueur ;
ma fille surtout-en est véritablement enthousiasmée ; elle sait par cœur
toutes ses poésies, et je crois qu’elle ne passe pas un seul jour sans lire
quelques pages de son auteur favori.
« Nous
avons appris avec beaucoup de surprise que personne ne connaît Henri Lesueur,
à Paris ni ailleurs. Ce nom est un pseudonyme ; on n’a pu découvrir le véritable.
« Ce
mystère, je le crois, augmente encore le goût de ma fille pour cet auteur
; elle soutient que si elle vivait dans le même monde que lui, elle le devinerait
de suite. M. de Roquevair prétend que Marie a une véritable passion pour
cet inconnu. Je serais quelquefois tentée de le croire.
« Sans
m’inquiéter de ce goût si prononcé, mais si peu dangereux, je n’approuve
pas trop les plaisanteries continuelles que Jacques fait à Marie à ce sujet.
Ces plaisanteries sont acceptées par ma fille avec beaucoup de gaieté. Pour
elle et pour son père, c’est un jeu d’esprit qui les amuse. Seulement je
trouve qu’il se prolonge un peu trop….
ROQUEVAIR,
10 janvier.
« Vous
me demandez, ma chère amie, si j’ai entendu parler des anciens propriétaires
de Roquevair. Je ne crois pas que vous ayez un grand désir de connaître la
|205 destinée des Sardan, mais vous voulez savoir si j’ai
entièrement oublié les premières années de ma jeunesse.
« Je
suis trop heureuse du présent pour redouter les souvenirs du passé. Roquevair
en est rempli, je ne cherche point à les
éloigner.
Mon mari les connaît tous, il m’y ramène souvent lui- même. Sans m’expliquer
entièrement, je puis vous dire que le vicomte de Roquevair connaît Paul personnellement,
et qu’il a pour lui une haute estime. A ses yeux Paul est ce qu’il a toujours
été aux miens, un homme très-distingué.
« Je
sais que M. Sardan a perdu sa mère et qu’il habite avec l’abbé Romilly, ce
célèbre orateur dont vous m’avez souvent parlé. Il est de la Corrèze et parent
de la famille Sardan par les Rouvray. Paul est employé dans les bureaux du
ministère de la guerre. Son frère est colonel d’un régiment de cavalerie.
« On
annonce un nouvel ouvrage d’Henri Lesueur. C’est, dit- on, un livre de philosophie.
Marie assure qu’elle n’est pas effrayée de ce grand mot, et qu’elle dévorera
le livre de son ami inconnu jusqu’à la dernière page.
« Nous
avons encore reçu, toujours à titre de restitution, vingt mille francs. Ainsi
Roquevair va se trouver libre d’hypothèques.
« L’abbé
Romilly vient prêcher cette année le Carême à Tulle. Tous les Corréziens
se font une fête de le voir arriver. Pour moi qui, dans mon enfance, ai si
souvent admiré son portrait placé alors dans le grand salon de |206 Roquevair, j’éprouve à son égard une grande curiosité.
Il a bien trente-cinq ou quarante ans de plus que son portrait ; il est à
croire que je ne le reconnaîtrai
pas.
« M.
de Roquevair veut entendre l’abbé Romilly, et parler avec lui de Paul Sardan.
Nous irons passer le temps du carême à Tulle. »
XXIII
Le vicomte
de Roquevair avait reçu sans trop de surprise le premier envoi d’argent qui
lui avait été fait. Le deuxième et le troisième l’étonnèrent beaucoup. Le
quatrième lui inspira des soupçons qu’il voulut éclaircir.
Par
délicatesse, il n’avait pas cherché à connaître, et même à deviner quel était
l’auteur de ces restitutions. Tous ceux avec lesquels il avait perdu étaient
ou ruinés eux-mêmes, ou des fripons exerçant à l’étranger et même en France,
le métier de faire des dupes. L’argent qui lui avait été envoyé ne pouvait
venir de là.
M. de
Roquevair avait été intimement lié avec M. de ***, devenu alors préfet de
police ; il lui écrivit confidentiellement et lui exposa ses doutes.
Le préfet
de police se mit à la disposition du vicomte pour les éclaircir. Ses agents,
munis des indications fournies par M. de Roquevair, commencèrent leurs recherches,
et quinze jours après, le vicomte reçut une lettre du préfet de police. Elle
contenait ces mots ; |207
« Les
sommes qui vous ont été adressées à quatre époques différentes viennent
d’une seule personne, M. Paul Sardan,
demeurant
à Paris, chez son oncle, l’abbé Romilly, rue de Lille,
97.
»
Le vicomte
répondit :
« Mon
cher préfet, M. Paul Sardan n’a pas de fortune, il est obligé pour vivre
de travailler dans les bureaux du ministère de la guerre ; cet argent ne
peut venir de lui. Il serait tout au plus un intermédiaire dans cette affaire.
Le véritable auteur de l’envoi est toujours pour moi à l’état d’inconnu.
Vos agents ne se sont pas montrés pour cette fois très-habiles. »
L’abbé
Romilly arriva à Tulle, et deux jours après le vicomte de Roquevair recevait
une nouvelle lettre du préfet de police.
« Mes
agents sont très-habiles, mon cher vicomte. C’est M. Sardan qui vous a fait
remettre tout l’argent que vous avez reçu. De plus, apprenez un secret qui
dans deux jours sera connu de tout Paris et bientôt du monde entier. C’est
que le fameux Henri Lesueur, dont les écrits ont obtenu un si éclatant succès,
n’est autre que M. Paul Sardan lui-même. L’ouvrage annoncé par les journaux
va paraître avec le nom véritable de l’auteur, Paul Sardan. »
Tout
fut expliqué pour te vicomte de Roquevair : Paul était son bienfaiteur. Le
vicomte appréciait trop bien la noblesse du caractère de Paul pour ne pas
comprendre que ce n’était pas seulement une affection |208 étouffée dans son principe qui lui avait inspiré tant
de dévouement et de sacrifices, mais encore plus la reconnaissance de ce
qu’il devait à l’abbé de Vermot.
Il
se demanda comment il pourrait faire pour s’acquitter à son tour envers Paul.
Une idée subite se présenta à son esprit, il appela sa fille.
-
Marie, lui dit-il, je connais le véritable
nom de Henri Lesueur.
La
jeune fille devint très-pâle.
-
Mon Dieu ! se dit le père de Marie, y aurait-il
quelque chose de sérieux dans les sentiments de cette enfant pour un inconnu
? S’il en est ainsi, soyez béni, ô mon Dieu !
-
Mon enfant, poursuivit le vicomte, Henri
Lesueur est libre. Son véritable nom n’avait avant lui aucune illustration
; mais celle qu’il a acquise est à tes yeux comme aux miens, la plus noble
de toutes. Je t’ai dit souvent que je croyais que tu aimais l’auteur des
Rêveries d’un solitaire. Je voudrais aujourd’hui, ma fille, avoir
dit la vérité.
-
Mon père, serait-il possible ?... parlez-vous
sérieusement ? Eh bien ! alors, écoutez-moi. Oui, j’aime M. Lesueur, parce
que j’ai cru voir dans ses ouvrages les épanchements d’une belle âme, un
amour sublime pour la vertu ; je me suis dit que lorsqu’on écrivait ainsi,
on devait approcher de bien près de cette perfection idéale qu’on cherche
toujours et que l’on rencontre si rarement. Il est vrai, mon père, que je
me, suis livrée à mon |209 enthousiasme avec d’autant
plus de facilité, que je le croyais sans danger. Mais à présent, mon père,
que vous me faites entrevoir, une espérance, eh bien ! je le sens, si elle
ne se réalisait pas, il me faudrait du courage pour ne pas me
trouver
malheureuse.
-
Tu seras heureuse, je l’espère ; mais, ma
fille bien-aimée, je dois te prévenir que M. Lesueur n’est plus jeune, il
est presque de mon âge : trois ou quatre ans de moins, je crois ; il a donc
trente-sept ou trente-huit ans.
-
Mais, mon père, vous n’êtes pas vieux ; et
vous êtes encore plus beau que tous les jeunes gens que je connais.
-
Ah ! petite flatteuse, prenez garde, si
vous tenez à la beauté, il faut bien vous dire que M. Lesueur est très-laid.
-
D’abord, mon père, je ne tiens pas du tout,
mais du tout à la beauté ; et puis, il est impossible qu’une belle âme et
une haute intelligence ne jettent pas quelque reflet sur les traits les plus
irréguliers. Mais, mon père, pourquoi l’appelez-vous toujours Henri Lesueur
? Dites-moi son véritable nom.
Le
vicomte nomma Paul Sardan. — M. Sardan ! s’écria Marie, l’ancien propriétaire
de Roquevair ! celui que...
-
Que ta mère devait épouser ; oui, ma fille,
elle m’a préféré à lui, et c’est la seule faute de sa vie ! |210
-
Ô mon père, que dites-vous ?
-
La vérité, mon enfant ; mais cette faute,
tu le comprends, je ne puis la lui reprocher. Quand je lui apprendrai tout
ce que nous devons à M. Paul Sardan, elle trouvera que ce n’est pas trop
pour nous acquitter envers lui que de lui offrir notre cher trésor. Paul
a beaucoup aimé ta mère : tu es la vivante image de sa Cécile. Il t’aimera,
ma fille, surtout quand il apprendra que tu l’as aimé, parce que tu as deviné
son cœur dans ses ouvrages.
Alors,
M. de Roquevair raconta à sa fille ce que Paul avait fait pour eux. Marie
pleura d’attendrissement et de reconnaissance. Après une longue conversation
avec sa femme, le vicomte fut trouver l’abbé Romilly : il lui apprit tout
ce qui s’était passé.
-
Nous pouvons, dit le vicomte, accepter les
bienfaits d’un fils, mais non de celui qui voudrait rester pour nous un étranger.
L’abbé
écrivit à Paul de se rendre de suite à Tulle. Paul vit Marie. Il crut retrouver
sa chère Cécile telle qu’il l’avait vue la dernière fois.
Un mois
après, l’abbé Romilly bénissait l’union de Marie de Roquevair avec le vicomte
Paul Sardan de Roquevair. Le père de Marie avait obtenu pour son gendre le
droit de prendre le nom, le titre et les armes des Roquevair.
Deux
ans après, j’ai vu un héritier des Roquevair essayer |214 ses premiers pas sur une magnifique pièce de gazon placée
au milieu de la grande cour. Il a la beauté de sa mère ; on espère qu’il
aura le génie et surtout le cœur de Paul.
FIN.
CORBEIL.
— Typ. et stér. de CRÉTÉ.
MÊME
LIBRAIRIE
NOUVELLE
BIBLIOTHEQUE
DE
VOYAGES ET DE ROMANS
À L’USAGE
DES FAMILLES UN FRANC LE VOLUME.
*
*
*
M. DE SAULCY,
membre de l’Institut. — Voyage autour de la mer Morte. 2 vol.
M. L’ABBÉ
DOMENECH. — Voyages dans les solitudes, américaines : le Minesota.
1 vol.
AUGUSTE MÉRAL.
— Les Roquevair.
-
L’homme aux romans. 1 vol.
CHARLES AUBERIVE.
— Les bandits célèbres du dix-septième siècle. 1 vol.
-
Voyage d’un curieux dans Paris.
LE
BARON D’ANGLURE. — Le saint Voyage de Jérusalem, 1395. 1 vol.
M. LE COMTE
D’ESCAYRAC DE LAUTURE. — Voyage au grand Désert et au Soudan. 1 vol.
Mlle ÉMILIE DE VARS. — Geneviève
de Paris. 1 vol.
-
Les enfants de Clovis. 1 vol.
-
Le Roman de ma portière. 1 vol.
Mme DE LA BÉRANGÈRE. — Le
Retour des Tribus captives.
P. CAMUS,
évêque de Belley. — Alcime. 1 vol.
VICTOR DE
SAINT-PREUIL. — Ève dans l’Éden. 1 vol. LOUIS DUMONTEIL. — Un ambitieux
de Province. 1 vol.
-
La Petite Main de bronze. 2 vol.
*
*
*
Le roman
est une forme littéraire universellement adoptée aujourd’hui. Il faut donc
écrire le roman et se servir de lui pour répandre dans les intelligences
les grandes et impérissables idées du vrai et du beau. Il faut que le roman,
sous la forme la plus attrayante, soit un éducateur, un conseiller délicat,
un ami qui nous dise toute chose, et nous montre la vie dans ses phases diverses
avec ses joies, ses épreuves, ses dangers, ses chutes, ses dégradations,
pour que chaque âme se voie elle-même dans ce drame qui lui rappelle sa propre
existence, et pour qu’elle s’en impressionne de manière à en tirer une leçon
perpétuelle de vertu.
CORBEIL,
typ. et stér. de CRÉTÉ.
Quelques
données sur l’auteure
Autant
l’abbé Michon a fait l’objet de recherches variées en rapport avec la diversité
de ses talents et les rebonds tumultueux de sa carrière, autant son amie
et collaboratrice Émilie de Vars, pourtant également subtile et diverse,
ne paraît pas avoir retenu jusqu’à présent l’attention que semblent pourtant
mériter autant sa vie que ses œuvres.
Nous ne
donnerons pas ici une réelle étude, mais nous donnerons au moins son état
civil, qui ne semble jusqu’ici avoir intéressé personne, au point que ni
la date exate de sa mort, ni l’année même de sa naissance ne paraissaient
avoir été jusqu’ici été établies.
Voici
donc quelques données de base, à partir desquelles on pourrait diriger des
recherches plus approfondies, tant sur l’ensemble de sa vie et de son œuvre,
que plus particulièrement sur les soubassements de ce roman et notamment
de son arrière-plan étampois, qui reste à préciser et à éclaircir.
1807.
Mariage des parents de l’auteure
N°10
– Mariage de Jean Devars avec Cécille Susanne Elisabeth Dumartray – L’an
mil huit cent sept, le vingts deux juillet, par devant nous François Roy
maire et officier de l’état civil de la commune de St Preüil, canton
de Chateauneuf,
departement
de la Charante, sonts comparus sieur Jean Dévars employé dans les droits
réunis, fils majeur agé de vingts quatre ans et quelques mois pour être née
le vingts deux mai mil sept cent quatre vingts trois ainsy qu’il résulte
de l’extrait du régistre des actes de l’état civil de la commune de Moinfond
arrondissement communal d’Angoulesme pour l’année mil sept cent quatre vingts
trois # [# délivré par Lavauzelle segretaire general de la prefecture de
ce departement le trois juillet mil huit cent sept, signé Lavauzelle ] est
née en la ditte commune de Moinfond, demurants au chef lieu de la commune
de Rouliac [Rouillac], fls de sieur Claude Devars des Barriere prpriaitaire
demurants en la commune de Chongnies pres Engoulesme consentant au dit mariage
ainsy qu’il resulte de sa procuration passé à Engoulesme par Lescallier et
son confrere notaire public à l’arrondissement du dit Engoulesme le vingts
neuf juin mil huit cent sept signé Léscullier et Aubin, enregistré [à] Angoulesme
le huit le huit juin mil huit cet sept, signé Richard et visé par le présidant
du tribunal civil de premiiere instance de l’arondissemnt d’Angoulesme le
premier juillet mil huit cent sept, signé Fouchet, laquelle sera annexée
au présant acte, et de dame Marie Anne Marie du Frénau si devant son épouse,
et demoiselle Cécille Suzanne Elisabeth Dumartray âgé de vingt trois ans
quelques mois, pour être née le huit novembre en la commune de St Preüil,
où elle a son domicille, fille majeure de sieur Guillaume Dumartray et de
Anne Croix de Foubelle propriaitaire demurants au lieu de Puiroyet, commue
de S Preüil, ainsy qu’il résulte de l’extrait du régistre des acte de l’état
civil de la commune de St Preüil pour l’anné mil sept cent quatre vingts
trois, signé Lavauzelle ségrétaire général, lsquels nous ont requis de proceder
à la clébration du mariage projetté entre eux, et dont les publications ont
été faitte dévant les prinsipalle porte des maisons commune de Rouliac
les
douze
et dix neuf juillet mil huit cent sept à l’eure de midy par
P. Maurin maire, ainsy qu’il resulte du certificat délivré par
le dit maire le vingt un du presant, signé P. Maurin, et par l’adjoint de
la commune de Champnier les douze et dix neuf ausy du presant mois de juillet
mil huit cent sept au lieu ordinaire à dix heures du matin ainsy qu’il
resulte du sertificat délivré par le dit adjoint le vient un juillet mil
huit cent sept, signé Dubois adjoint, et à St Preüil par le maire devant
la prainsipalle porte de l’église de la commune les douze et dix neuf juillet
présant mois savoir la première à l’eure de midy et la segonde à l’eure de
neuuf du matin ; aucunne oposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée,
faisant faisants [sic] droit à leur requisition aprèes avoir donnée lecture
de toutes les piece cy dessus mensionne et du chapitre six du code sivil
intitulé Du mariage, avons demandé au futur époux et la future épouse s’ils
veullent se prendre pour marie et pour famme, chaqun d’eux ayants repondu
séparément et afirmativement, déclarons, au nom de la loi, que Claude Devars,
et Cecille Suzanne Elisabeth Dumartray sont unis par le mariage. De quoy
avons dréssé le présant acte en présance de sieur Guillaume Dumartray icy
présant et consentent au dit mariage, et Jean Bourrat âgé de vingts cinq
ans reçeveur à cheval de droits reunis au chef lieu de la commune de Rouliac,
y demurants, de Jean Lys agé de vingts cinq ans propriaitaire demurants commune
de Plasac, arrondissement de Jonzac, departement de la Charante inférieure,
Jean Léonor Norric agé de Sinquante cinq ans propriaitaire demurants [à]
Angoulesme chel lieu de ce departement et de Guilhaume Bernard Joseph Puisaud âgé de quarante deux ans proffession de cultivateur
demurants au lieu de la Métérie, commune de St Preüil, thémoins connu qui
ont avec nous signé le presant acte après que lecture leur en a été faitte,
exsepté le dit Puisaud qui a declaré ne le savoir. –
Aprouvé
le renvoie pour valloir ainsy que trois mots interligne et regeté pour nuls
trois mots rayé. – Suit la procuration dont est mentionde l’autre pars. Par
devant nous Gabriel Lescallier et son confrere notaire public à la résidance
d’Angoulesme et fut presant monsieur Claude Devars demurants au chef lieu
de la commune de Champniers [Chaniers], lequel de son grée et vollonté a
fait et constitué son procureur general et spesial Jean Michel Rideau Dudognon
son couzain germin auquel il donne pouvoir de pour luy et en son nom sa personne
représanter devant tout notaire et autre personne public qu’il apartindra
à l’effet de consentir au maraige proposé d’entre sieur Jean Leonard Desvars
son fils légitime et de dame Anne Marie cy devant son épouse, avec demoiselle
Cécille Suzanne Margueritte Elisabeth Dumartray fille de monsieur Guillaume
Dumartray et de dame Anne Susanne Sara Emilie Croix de Fonbelle son épouse
au lieu de Puiroyet commune de St Preüil, canton de Chateauneuf asister à
la sélébration du dit mariage et générallement faire raison de de ce tant
que sera jugé nésésaire et convenable par le dit sieur procureur constitué,
p[r]ometant, oblige[a]nt et fait et passé [à] Angoulesme en l’étude avant
midy le vingts neuf juin mil huit cent sept, et le dit sieur Devars a signé.
Un mot nul le mot juillet et gl rayé nul. Claude Devars, Aubin, Lescalliers.
Enregistré Engoulesme le trente juin mil huit cent sept, reçu un franc dix
sentime, signé Richard ; nous Pierre Souchet présidant du tribunal sivil
de premiere instance de l’arondisement d’Angoulesme certifions que le sinature
apposée au bas de l’acte des autre pars sont selle d’Aubin et Lescullier
notaire public de cette ville et que foi doi y étre ajouté, Angoulesme le
premier juillet mil huit cent sept, signé Foucht. Est à l’instant intervenuee
la dame Anne Croix de Fonbelle mere de la future qui consent ausy au dit
mariage et a ausy signé avec nous après que lecture du tout a eté de nouveau
fait.
– [Signé :] Cecile Dumartray – Devars – Dumartray – Fonbelle Dumartray –
Horric Devars – Vidaud Dudognon – Louise Dumartray – Alphonse Dumartray –
J. L. Horric – Bourrat – Lys – Pellachonnée Ferpaud – [trois points maçonniques
alignés entre deux barres parallèles horizontales] Roy [paraphe] maire.
1810.
Naissance à Saint-Preuil (Charente).
N°20.
Naissance de Suzanne Cécile Emilie Louise Eléonore Dévars. – L’an mil huit
cent dix le six septembre par devant nous François Roy maire et officier
public de l’état civil de la commune de St Preuil, canton de Chateauneuf,
cinquième arrondissement du département de la Charente, est comparu Françoise
Fourétier femme de Jean-Jean qui ont profession de cultivateurs âgée de quarente
ans demeurante au chef lieu de la commune de Bouteville, laquelle nous a
déclaré que le jour de hier cinq du présent à trois heures après midi est
né un enfant du sexe féminin en la maison du sieur Dumartray, située au lieu
de Puiroyet en cette commune, qu’elle nous a présenté et auquel elle a déclaré
donner les prénoms de Suzanne, Cecille, Emilie, Louise, Eléonnore, lequel
enfant est né de Jean Léonnor Dévars, receveur à cheval dans les droits réunis
à la résidance de Champlects [Champleix?], arrondissement d’Issoire, département
du Puy-de-Dôme, agé de vingt huit ans, et de Suzanne Emilie Cécile
Emilie Louise Dumartray son épouse, la dite déclaraton faite par la dite
Forétier qui a assisté aux couches de la dite dame Devars et en présence
de Jean Bernard, agé de soixante-deux ans demeurant au lieu de Gautier, de
François Angelier agé de soixante-six ans demeurant au lieu de la métairie,
qui ont l’un et l’autre profession de cultivateur, leurs demeures en cette
commune, la déclarante a déclaré ne
sçavoir
signer, les temoins ont avec nous signé excepté le dit Angelier qui a déclaré
ne le savoir après que lecture du présant acte leur a eté faite, rejetté
un mot rayé pour nul, et approuvé le mot agée surchargé de la quatrième ligne
pour valloir. – [Signé :] Bernard – Roy [paraphe] maire.
1858-1858.
Premières publications
Émilie
de Vars (1810-1877), Les Enfants de Clovis (in-16 ;
212
p.), Paris, Pouget-Coulon (« Bibliothèque catholique de voyages et de romans
»), 1858.
Émilie
de Vars, Geneviève de Paris [in-16 ; 240 p.], Paris, Bureau de la
Bibliothèque catholique de voyages et de romans, 1858.
Émilie
de Vars, Le Roman de ma portière (in-16 ; 224 p.), Paris, Pouget-Coulon,
1858 (« Bibliothèque catholique de voyages et de romans »), 1858.
Émilie
de Vars (sous le pseudonyme d’Auguste Méral), L’homme aux romans (in-16
; 215 p.), Paris, Pouget-Coulon (« Bibliothèque catholique de voyages et
de romans »), 1858.
Émilie
de Vars (sous le pseudonyme d’Auguste Méral), Une déception (in-12
; 194 p.), Paris, Victor Sarlit (« Nouvelle bibliothèque de voyages et de
romans à l’usage des familles »), 1860.
1860.
Les Roquevair. Recension.
Émilie
de Vars (sous le pseudonyme d’Auguste Méral), Les Roquevair (in-12
; 211 p.), Paris, Victor Sarlit (« Nouvelle bibliothèque de voyages et de
romans »), 1860.
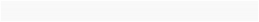
Recension
de William O’Gornam, in Revue critique des livres nouveaux 27 (1859),
p. 411 :
«
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE de voyages et de romans, à 1 franc le volume. Les Roquevair,
par Aug. Méral. Paris, Victor Sarlit, rue Saint-Sulpice, 85 ; 1 vol. in-12.
« Avant
d’entrer en matière, M. Auguste Méral, par la bouche de l’abbé Romilly, indique
un moyen très-facile et très-simple de contre-balancer les effets déplorables
que les mauvais romans produisent : c’est de faire de bons romans. Facile
! cela vous plaît à dire, Monsieur l’abbé ; si par bons vous entendez seulement
des romans moraux, oui, cela est facile : il suffit d’avoir un cœur honnête,
et, Dieu merci, ce n’est pas chose si prodigieusement rare.
« Mais
si vous entendez par là des romans où des caractères vivants se meuvent au
milieu d’une action qui unit la vraisemblance à l’intérêt, où se fondent
harmonieusement l’idéal et le réel ; des romans écrits d’un style pur, animé,
poétique et simple pourtant, oh ! alors, Monsieur l’abbé, n’écrit pas qui
veut de tels romans, car n’est pas qui veut un grand écrivain.
« Sans
réaliser de tout point cet idéal, M. Auguste Méral nous raconte avec agrément
et intérêt l’histoire d’un homme qui cache, sous un extérieur disgracieux
et gauche, l’âme la plus noble et les talents les plus distingués. Nous trouvons
bien quelque peu invraisemblable que Paul Sardan, poëte, philosophe, naturaliste,
musicien, dessinateur, de première force à l’escrime et au pistolet, puisse
commettre toutes les balourdises que l’auteur lui prête, et passer pour un
niais et un imbécile auprès de ceux qui le voient tous les jours. Malgré
cette invraisemblance, nous sympathisons avec ce brave garçon, et nous sommes
très-contents de le voir, à la fin, après tous ses malheurs et tous ses sacrifices,
obtenir et la renommée et le bonheur.
«
Le style, malgré de légères incorrections (de suite pour tout de
suite, par exemple), est vif, facile, et de jolies descriptions varient
le récit. Enfin ce petit roman, joignant à ces mérites celui d’une irréprochable
moralité, nous le recommandons avec plaisir et en toute conscience.
W. G. »
1861-1879.
Publication postérieures
Émilie
de Vars, Radégonde (in-12 ; 176 p.), Paris, Victor Sarlit (« Nouvelle
bibliothèque de voyages et de romans »), 1861.
Émilie
de Vars, Lettre à M. Louis Veuillot sur le Parfum de Rome (in-8° ;
16 p.), Paris, É. Dentu, 1862.
Émilie
de Vars, La Joueuse, mœurs de province (in-18 ; II+241 p.), Paris,
Michel Lévy frères, 1863.
Émilie
de Vars (sous le pseudonyme d’Auguste Méral), Mémoires d’une institutrice
(in-18 ; 304 p.), Paris, Librairie internationale (A. Lacroix, Verboeckhoven
& Cie), 1867.
Émilie
de Vars, Les Ultra-catholiques (in-18 ; XII+276 p.), Paris, É. Dentu,
1870.
Émilie
de Vars, Les Ultra-catholique. Lettres à une femme du monde. 2e édition,
revue (in-12 ; XX p. ; ne contient que le titre, la dédicace et la préface
de la 2e édition), Paris,
Sandoz et Fischbacher, 1872.
Émilie
de Vars, « De la graphologie dans ses rapports avec la psychologie et la
littérature » (suite d’articles), in La Graphologie. Journal des autographes
(hebdomadaire) 1873.
Émilie
de Vars, Histoire de la graphologie. Suivie d’un Abrégé du système de
la graphologie (in-12 ; 70 p. ; 1ère édition), Paris, É. Dentu, 1874.
Émilie
de Vars (sous le pseudonyme : Un Ami de l’abbé X), Les amours d’une cosaque
(in-18 ; 252 p.), Paris, A. Degorce- Cadot, 1875.
Émilie de Vars, Histoire de la graphologie. Suivie d’un
Abrégé du système de la graphologie. 2e éd. (in-12 ; 69 p. ; fac- similés),
Paris, Librairie moderne, 1877.
Émilie de Vars (†1877), Histoire de la graphologie. Précédée
d’un Abrégé du système de graphologie, avec une préface par J.-H. Michon.
3e édition, corrigée (in-18 ; 72 p. ; fac-similés), Paris, Bureau du journal de La
Graphologie (« Bibliothèque graphologique »), 1879.
1877.
Décès à Paris.
948
– Acte de décès du vingt neuf avril mil huit soixante dix sept, à une heure
un quart du soir – Ce matin, à quatre heures, est décédée en son domicile,
rue Chanaleilles n°5, Cécile Émilie de Vars, rentière, âgée de soixante-six
ans, née à Saint- Preuil (Charente), célibataire, fille de Léonard de Vars
et de Cécile du Martray, son épouse. – Le décès a été constaté suivant la
loi, par nous Jacques Eugène Dauchez adjoint au maire du septième arrondissement
de Paris, officier de l’état civil, chevalier de la légion d’honneur, et
le présent acte rédigé sur la déclaration de Joseph Mattern, employé âgé
de quarante un ans, boulevard des Invalides n°14, et de Pierre Audoire, âgé
de quarante neuf ans, rue de Grenelle n°105, qui ont signé avec nous après
lecture. – [Signé :] Mattern – P. Audoire – Eugène Dauchez.
1877.
Nécrologie.
(que
nous n’avons pu consulter)
Jean-Hippolyte
Michon (1806-1881), Nécrologie. Émilie de Vars (in-8° ; 8 p. ; extrait
du journal La Graphologie du 15 mai 1877), Orléans, A. Chérié, 1877.
CRÉDITS
Page
1 de couverture : château corrézien de Chaban d’après une carte postale ancienne
— pp. 1 et 3 : logo du Corpus Étampois dessiné par Gaëtan Ader — p. 4 : Couverture
de l’exemplaire du roman mis en ligne par la BnF sur son site Gallica — p.
10 : gravure non signé extraites des Environs de Paris illustrés,
édition de 1881. — pp. 17 et 35 : gravures extraites du Limoges illustré
de 1908 — p. 37 (et 1 de couverture) : blason des Roquevair dessiné par
Bernard Gineste.
TABLE
DES MATIÈRES
Préface
5-6
|
CH.
I.
|
Quel
agréable souvenir je
|
|
|
conserverai...
|
10-17
|
|
CH.
II.
|
Madame
de Berthonville avait
|
|
|
entrepris…
|
18-21
|
|
CH.
III.
|
Un
soir la fille de madame Prémian….
|
22-29
|
|
CH.
IV
|
Le
dimanche suivant l’abbé vint
|
|
|
seul…
|
30-34
|
|
CH.
V
|
Transportez-vous
sur les confins de la
|
|
|
Hte-Vienne…
|
35-46
|
|
CH.
VI.
|
C’était
le 21 février 1814…
|
47-56
|
|
CH.
VII.
|
Au
commencement des guerres de
|
|
|
religion…
|
57-62
|
|
CH.
VIII.
|
Dans
les dernières années du règne de
|
|
|
Louis
XIV…
|
63-69
|
|
CH.
IX.
|
Louise
avait trop de pénétration…
|
70-77
|
|
CH.
X.
|
Nous
avons laissé les deux enfans…
|
78-89
|
|
CH.
XI.
|
Une
des phases de la destinée de
|
|
|
l’Empire…
|
90-99
|
|
CH.
XII.
|
Vraiment,
Paul, les sept ans qui se
|
|
|
sont
écoulés…
|
100-108
|
|
CH.
XIII.
|
Ma
mère, mon ami, a fort mal
|
|
|
accueilli…
|
109-122
|
|
CH.
XIV.
|
C’est
M. Jacques qui veut acheter
|
|
|
Roquevair…
|
123-129
|
|
CH.
XV.
|
Mon
douloureux sacrifice est
|
|
|
accompli…
|
130-131
|
|
CH.
XVI.
|
Paul
était à la fois une nature
|
|
|
énergique
et faible…
|
132-141
|
|
CH.
XVII
|
Ma
destinée est irrévocablement
|
|
|
fixée…
|
142-153
|
|
CH.
XVIII.
|
Le
lendemain de ce jour si
|
|
|
douloureux…
|
154-158
|
|
CH.
XIX.
|
Louis
sortit de l’hôtel : Paul monta…
|
159-185
|
|
CH.
XX.
|
Quelques
années se sont écoulées…
|
186-193
|
|
CH.
XXI.
|
Depuis
plusieurs années, Alger était…
|
194-211
|
|
CH.
XXII.
|
La
vicomtesse de Roquevair à
|
|
|
madame…
|
212-215
|
|
CH.
XXIII.
|
Le
vicomte de Roquevair avait reçu…
|
216-220
|
|
Annexe
|
Émilie
de Vars
|
222-231
|
|
Crédits
|
|
232
|
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com