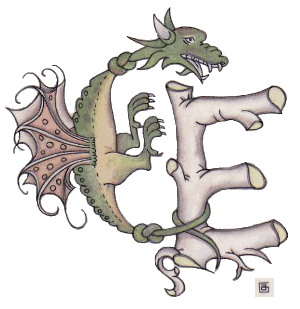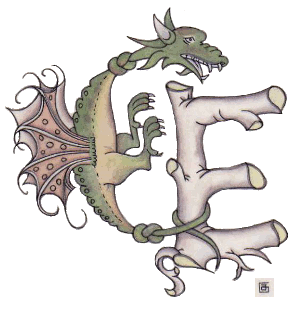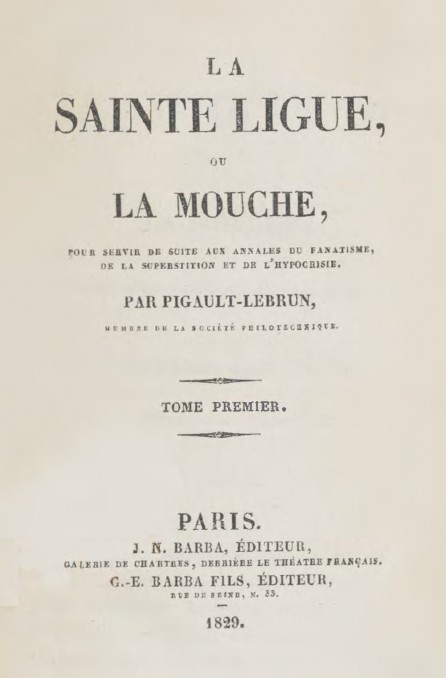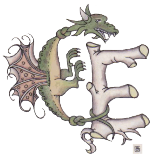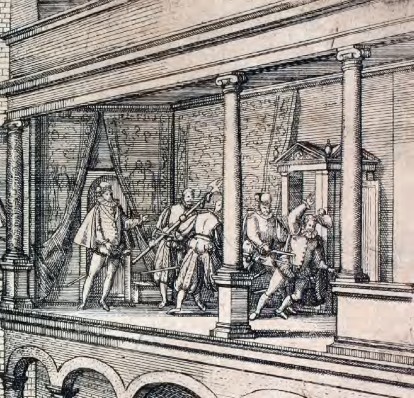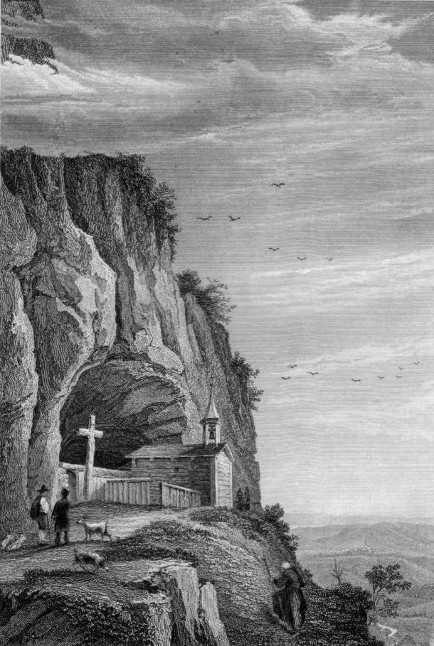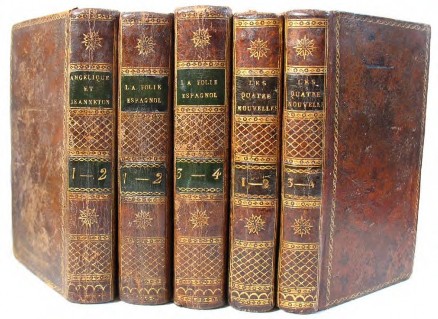|
BHASE n°12
(janvier 2015)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page est une simple
reversion automatique et inélégante au format html
d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne),
pour la commodité de certains internautes et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase012w.pdf
|
|
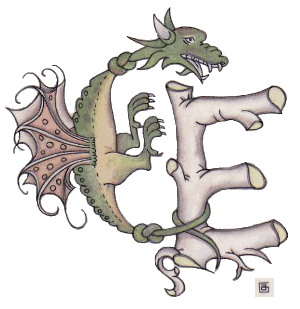
|
BHASE
n°12 (janvier 2015)
|
Préface
|
(de
l’éditeur, 2014)
|
5-12
|
|
Avis
|
(de
l’auteur, 1829)
|
14-15
|
|
CH.
XX.
|
Règlement
pour l’intérieur du ménage.
|
16-35
|
|
CH.
XXI.
|
Journée
des barricades, et autres événemens plus
|
|
|
gais.
|
36-58
|
|
CH.
XXII.
|
Détails
de ménage. M. de la Tour est député aux
|
|
|
États-Généraux.
|
60-86
|
|
CH.
XXIII.
|
Seconds
États de Blois. Assassinat du duc de
|
|
|
Guise.
|
88-111
|
|
CH.
XXIV
|
Evénemens,
gais, tristes, affligeans. Grand
|
|
|
procès,
etc.
|
112-136
|
|
CH.
XXV.
|
La
Tour reçoit le coup le plus terrible, dont il pût
|
|
|
être
frappé.
|
138-160
|
|
CH.
XXVI.
|
Départ
pour la Suisse.
|
162-187
|
|
CH.
XXVII.
|
Suite
de notre voyage.
|
188-213
|
|
CH.
XXVIII.
|
Métamorphose,
partie de pêche, et autres
|
|
|
événemens.
|
214-239
|
|
CH.
XXIX.
|
Les
Cretins. Le coup de tonnerre.
|
240-265
|
|
CH.
XXX.
|
Les
chamois. Histoire de Joseph.
|
266-295
|
|
CH.
XXXI.
|
Noces
de Joseph. Statistique du canton d’Uri.
|
296-327
|
|
CH.
XXXII.
|
La
troupe nomade entre dans le canton
|
|
|
d’Appenzell.
|
328-349
|
|
CH.
XXXIII.
|
Grande
Catastrophe. Notre emménagement.
|
350-375
|
|
CH.
XXXIV.
|
Usages,
jeux, travaux, bergers, événemens.
|
376-402
|
|
CH.
XXXV.
|
Suite
de la vie de nos héros en Suisse. Nouvelles
|
|
|
de
France.
|
404-423
|
|
CH.
XXXVI
|
Voyage
au haut de l’Ebenalp.
|
424-443
|
|
CH.
XXXVII.
|
La
petite colonie gravit l’Ebenalp.
|
444-461
|
|
CH.
XXXVIII.
|
Les
alambics. Nouvelles de France.
|
462-479
|
|
CH.
XXXIX.
|
Dénouement
prévu.
|
480-495
|
|
Annexe
1
|
Revue
Encyclopédique.
|
496-497
|
|
Annexe
2
|
Journal
général.
|
498
|
|
Annexe
3
|
Mercure
de France.
|
499-500
|
|
Annexe
4
|
Ami
de la Religion.
|
501-504
|
|
Annexe
5
|
Southern
Review.
|
505-506
|


Piuault-Lebrun

LA SAINTE
LIGUE.2

ou: es Aventures
d'unÉtampais pendant les Guerres de Religion BHASE 0°12 811.Lte .

janvier
2015 ••• etfi n
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE
n°12
Bulletin
historique et archéologique du Sud-Essonne
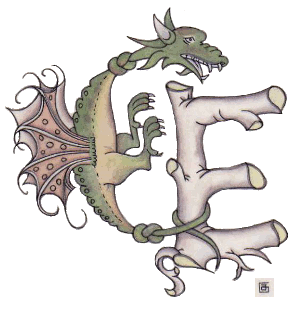
Publié par le
Corpus Étampois
janvier
2015
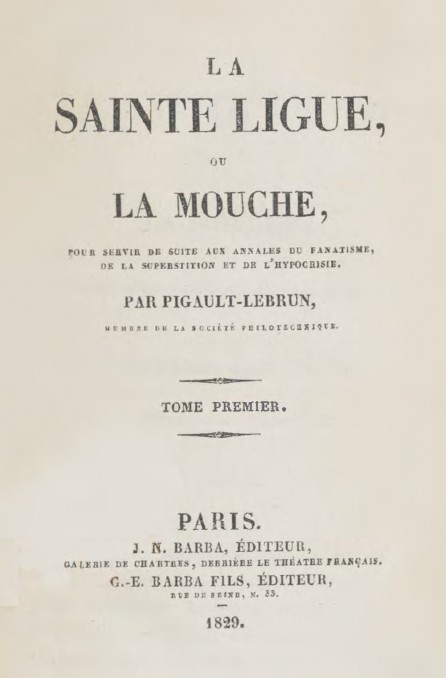
Pigault-Lebrun
LA SAINTE-LIGUE
ou
la Mouche, pour servir de suite aux Annales du fanatisme,
de la
superstition et de l’hypocrisie.
(Deuxième
et dernière partie.)
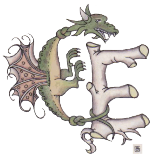
Corpus
Étampois
1829-2015

La
Tour de Brunehaut avant sa destruction
Préface
Nous
donnons, ici, comme nous l’avions annoncé, la deuxième moitié du dernier
roman de Charles-Antoine- Guillaume Pigault de l’Épinoy, dit Pigault-Lebrun.
Le présent deuxième tome de la Sainte-Ligue correspond en effet aux
trois derniers volumes de l’édition originale de 1829.
On se
souvient que notre héros est un certain Antoine Mouchy ; il est né
à Étampes, dont il part vers 1576, à la veille de la sixième guerre de Religion.
Après diverses aventures il revient au pays et s’achète, près d’Arpajon,
les ruines d’un château, qu’il achève de démonter, pour se construire à sa
place un manoir plus confortable. Il s’y installe avec son épouse et son
valet et ami, André.
-
La Sainte-Ligue et le château de
Brunehault
On
a déjà dit qu’il ne faut pas chercher dans ce roman des informations sur
le XVIe siècle réel du
pays étampois. Déjà, avions-nous fait remarquer, l’auteur aurait-il dû appeler
Arpajon Châtres, puisque ce ne fut qu’en 1720 que Châtres prit le
nom d’Arpajon. Dans cette deuxième partie il faut relever une autre bévue
apparente de l’auteur qui, pour les besoins de son intrigue, fait venir en
appel devant le bailli d’Étampes une
cause
d’abord jugée à Arpajon ; alors que Châtres n’a jamais fait partie du bailliage
d’Étampes.
Mais
en fait, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une erreur de l’auteur
; c’est seulement un effet de sa discrétion, parce qu’il a voulu masquer,
aux yeux du plus grand nombre, de quelle réalité étampoise de son temps il
s’était inspiré, en dépaysant son action au pays voisin d’Arpajon. Car il
faut bien reconnaître, en trame de fond secrète de ce roman, le pays étampois
de la première Restauration, de 1814 à 1830.
Le
château qu’achète et reconstruit notre héros n’est pas en réalité arpajonnais
; il est bien étampois, et on peut même préciser que c’est celui de Brunehaut,
situé dans la commune de Morigny-Champigny, qui touche Étampes au nord-est.
On
pouvait déjà le soupçonner, à un détail que donne Pigault- Lebrun sur la
Tour qui est abattue par Antoine et André à savoir qu’elle était
carrée, comme celle de Brunehaut. Or c’est justement vers cette
époque que le vicomte Charles de Viart a remanié complètement un pavillon
élevé sur ce qui restait de la très antique Tour de Brunehaut, mentionnée
depuis le XIe siècle. Il
y a élevé un manoir plus conforme aux goûts du jour,
et
qui de nos jours encore s’appelle le château de Brunehaut.
La
deuxième partie de notre roman en donne de nouveaux indices extrêmement transparents
et intéressants pour établir ce qu’était la vie intellectuelle des nouveaux
châtelains étampois du début du XIXe siècle.
Ainsi,
l’auteur n’a pu s’empêcher de glisser dans le roman quelques clins-d’œil
discrets à ses amis étampois. Par exemple, lorsqu’on cherche à occuper
la nouvelle châtelaine, qui va,
comme
une nouvelle Pénélope, broder une tapisserie, on lui achète un canevas des
plus étranges, dont le sujet vient dans le roman comme un cheveu sur la soupe
: Il déroula, devant nous, un grand canevas, sur lequel était tracé le
supplice de la reine Brunehaud. « Ah ! mon cher André, quel sujet tu as choisi
! — Vous auriez préféré les amours de Mars, et de Vénus ; mais Madame veut
réellement travailler, et j’ai dû éviter tout ce qui aurait pu vous donner
des distractions. — C’est très-bien vu, s’écria Colombe. La reine Brunehaud
t’éloignera de mon métier.
Troisième
indice. Le nouveau châtelain aime à composer des chansons, et l’auteur nous
raconte avec complaisance comment une discussion érudite à bâtons rompus
débouche sur la composition par Antoine de Mouchy d’une chanson en l’honneur
du roi Louis XII et de l’empereur Titus. Précisément, nous avons conservé
au moins une chanson composée par Charles de Viart au château de Brunehaut
en 1825 ; nous avons montré ailleurs qu’elle contient une discrète allusion
à la découverte, lors de la construction de ce château, d’une sculpture gallo-romaine
alors identifiée comme représentant le dieu Priape. Même inspiration
antique, et même goût pour les allusions discrètes.
Quatrième
indice. Le même Antoine donne le plus grand soin à la construction de son
manoir, à ses dépendances et à son jardin. Le roman s’attarde longuement
sur le charme de ces lieux, ainsi aménagés. Précisément Charles de Viart
avait conçu une telle fierté de ce qu’il avait fait à Brunehaut qu’il en
avait tiré un ouvrage intitulé Le jardiniste moderne, qui eut un grand
succès et connut deux éditions, en 1819 puis 1826, sans parler d’un plagiat
qui n’eut pas moins de succès.
Cinquième
indice. Le même Antoine songe à écrire des contes édifiants pour les enfants.
Mon bon Antoine, fais de petits contes bien gais, bien moraux, bien
catholiques, pour amuser notre enfant, quand il saura lire. Tu les feras
imprimer. Notons l’anachronisme, car il n’est guère d’ouvrages pour les
enfants qui aient été publiés à une époque aussi reculée que le XVIe
siècle.
Antoine finit pourtant par renoncer à ce projet et se rend aux arguments
de son ami André : L’ouvrage que vous méditez ne peut être bien fait que
par un adulte de quinze à seize ans, heureusement organisé : à cet âge on
est encore plein des souvenirs de l’enfance, et on n’a perdu aucune des expressions
qui lui sont propres. L’enfant qui n’entend pas bien ce qu’il lit, jette
bientôt son livre, et court à sa balle ou à son cerceau. Croyez-moi, Monsieur,
cessez de ressembler à cet homme qui sautait à la lune, et qui voulait la
prendre avec les dents. Ne tentez pas l’impossible.
Il
est difficile de ne pas voir ici une charge contre le voisin de Charles de
Viart, à savoir contre le châtelain du château de Jeurre, dont le parc jouxte
celui de Brunehaut. En effet ce n’est pas Charles de Viart qui publie alors
des contes pour les enfants prévus originellement pour les siens. C’est son
voisin Abel Dufresne de Saint-Léon, qui a donné en 1822 des Contes à Henriette
et en 1824 de Nouveaux contes à Henriette. Il vient encore
de donner, l’année précédant la Sainte-Ligue, des Contes à Henri,
et donnera encore en 1835 de Nouveaux contes à Henri. Ces ouvrages
auront tant de succès qu’ils seront traduit en anglais et réédités jusqu’aux
États-Unis. Mais ils n’ont pas l’heur, semble-t-il, de plaire à Pigault-Lebrun.
On peut se demander en effet s’ils intéressaient autant les enfants pour
qui on les achetait que ceux qui les achetaient pour eux en raison de leur
caractère pesamment édifiant.
Même
le titre qu’il envisage un temps, le premier pas de l’enfance dans la
voie du salut, semble une parodie de certains titres d’ouvrages du millionnaire
catholique Dufresne, tels que : Leçons de morale pratique à l’usage des
classes industrielles (1826), ou Agenda moral des enfants (1829).
Sixième
indice. Le roman fait allusion à d’ennuyeux voisins. Est-ce là une nouvelle
allusion aux Dufresne de Jeurre ? Il s’agit dans le roman d’un certain M.
Richoux (rappelons que les Dufresne étaient riches à millions), et
de sa femme, un peu grassouillette, qui fatigue tout le monde de ses rires
idiots ; ils ont deux filles en âge de se marier et passablement éteintes,
et un plus jeune fils particulièrement sans-gêne, sinon casse-pieds. Mais
ces derniers détails ne cadrent pas avec ce que nous savons de la famille
des Dufresne de Saint-Léon, car Abel Dufresne n’avait alors une fille et
un fils, Henriette et Henri, nés respectivement en 1817 et 1820, âgés seulement
de 12 et 9 ans à l’époque où paraît notre roman.
Il
faut donc chercher ailleurs, et nous tourner par un troisième château de
la commune de Morigny-Champigny, à savoir celui de Morigny. Il est alors
tenu par le comte Auguste de Poilloüe de Saint-Périer (1787-1870), qui précisément
se trouve alors avoir deux filles aînées en âge de se marier, Marie Euphrosyne
et Marie Eugénie, nées respectivement en 1806 et 1807, qui d’ailleurs mourront
toutes les deux jeunes, en cette même année 1829 ; puis un fils plus jeune,
René de Poilloüe de Saint-Périer (1810-1888), grand-père de son homonyme,
archéologue et historien du pays d’Étampes (1877-1950).
Septième
indice. Le châtelain du château de la Tour redoute un siège, à l’occasion
des guerres de religions qui menacent à nouveau le pays d’Étampes. Et de
fait il doit repousser l’assaut
d’une
bande de pillards. Il finit par vendre son château et part s’installer en
Suisse. On a là clairement un écho des troubles occasionnés dans le pays
d’Étampes par la Révolution puis par la chute du Premier Empire. Dufresne
de Saint-Léon, propriétaire du château de Jeurre, s’était exilé à Milan de
1792 à 1799 ; quant au château de Brunehaut, il a été occupé en 1814 par
une fraction de l’armée russe, comme le rapporte Jeanne de Poilloüe de Bonnevaux
dans une lettre qu’elle adresse à cette époque à son propre frère : « Il
y a, à Brunehaut, un mille de Tartares et de Baskirs qui sont les plus indisciplinés
et les plus pillards ; le reste est campé au-dessus de Morigny. »
Voilà
quelques-uns des indices qui dans ce roman nous ramènent à Brunehaut, c’est-à-dire
à Étampes et à Morigny- Champigny plutôt qu’à Arpajon. On pourrait sans doute
consacrer toute une étude spéciale à cette question, et plus généralement
à tout ce que reflête de l’histoire locale le fil de ce roman plein de gaieté
et de bonne humeur. Et cela d’autant plus que cette période de l’histoire
étampoise reste à étudier d’une manière plus fine et approfondie qu’elle
ne l’a été jusqu’à ce jour.
-
La Sainte-Ligue et les Mouchy d’Arpajon
Pourtant
il nous reste encore une question à examiner : pourquoi Arpajon ? Cette question
n’est pas sans rapport avec le nom même de notre héros, qui s’appelle Antoine
de Mouchy. Ce nom n’est pas choisi au hasard.
Pigault-Lebrun
fait de son héros le petit-fils imaginaire d’un personnage qui a réellement
existé, et qui a même retenu l’attention de Voltaire dans son Histoire
du Parlement de Paris, à savoir le « fameux Antoine de Mouchy ». C’est
d’ailleurs à
Voltaire
que Pigault-Lebrun emprunte l’idée que le mot même de « mouchard » proviendrait
du nom d’Antoine de Mouchy (1494-1574), théologien catholique et grand
persécuteur des huguenots, que Voltaire range au nombre honni des inquisiteurs.
Mais
pourquoi Pigault a-t-il tenu à rattacher son héros à ce personnage somme
toute relativement obscur du XVIe siècle ? Car cet Antoine de Mouchy n’est mentionné
par Voltaire que très cursivement. Et pourquoi transporte-t-il le château
de son personnage de Morigny-Champigny à Arpajon précisément ? La question
est d’autant plus troublante que les derniers seigneurs d’Arpajon ont aussi
été des ducs de Mouchy, et que
leurs
descendants sont encore possessionné à Arpajon en 1829, quand paraît notre
roman.
Depuis
1819, c’est Charles de Noailles (1771-1834) qui a hérité du titre de duc
de Mouchy. C’est lui qui vend à la commune d’Arpajon, le 18 avril 1821,
la magnifique halle médiévale qui orne encore la place du marché de cette
ville. Il est le petit-fils de Philippe de Noailles (1715-1794), premier
duc de Mouchy, maréchal de France, ambassadeur en Espagne, et de son épouse
Anne Claude Louise d’Arpajon (1729-1794), dame d’honneur de Marie-Antoinette.
De plus,
Charles de Noailles duc de Mouchy a lui-même épousé Nathalie de Laborde (1774-1835),
la plus jeune fille de Jean-Joseph de Laborde (1724-1794), financier richissime
possesseur et rénovateur d’un autre château du pays d’Étampes et non des
moindres, celui de Méréville.
Or c’est
cette Nathalie de Laborde duchesse de Mouchy, contemporaine de l’auteur,
et libertine fameuse (amante par
exemple
de René de Chateaubriand), qui fut surnommée par son entourage « la mouche
» (y compris par le dit Chateaubriand dans plusieurs de ses lettres intimes).
Voilà qui nous ramène encore dans le pays d’Étampes, par de nouvelles allusions,
qui mériteraient elles aussi des études spéciales. Sans doute Pigault- Lebrun
a-t-il été invité à Méréville en même temps que Chateaubriand en mai 1805
à l’occasion du mariage d’Alexandre de Laborde. Il est bien certain en tout
cas que
l’histoire
du XIXe siècle étampois
recèle encore, à défaut de pépites, nombre de petits secrets pittoresques.
Du reste,
bien d’autres aspects de ce roman-fleuve pourraient nourrir les recherches
de jeunes étudiants, s’il pouvait s’en trouver de nos jours qui fassent autre
chose que des rapsodies de copiés-collés.
Ainsi
l’étude des sources de Pigault-Lebrun pour la partie du roman où le héros
s’installe en Suisse. Il est bien certain par exemple qu’il a largement puisé
dans un ouvrage paru en 1825 et intitulé Un
mois en Suisse1. Nous en reprendrons d’ailleurs
quelques illustrations.
Bonne
lecture à tous.
Bernard
Gineste, janvier 2015

1 Un mois
en Suisse, ou Souvenirs d’un voyageur, recueillis par M. Hilaire Sazerac
et ornés de croquis lithographiés d’après nature par M. Édouard Pingret (4 fascicules in-folios, avec figures, planches et plan), Paris,
Sazerac et Duval, 1825.

AVIS
AU LECTEUR,
introduction,
préface, ce que l’on voudra, et ce qui aura le mérite d’être court.
Je n’ai
jamais aimé les romans historiques ; je ne les crois propres qu’à égarer
le lecteur. Quelques soins que prennent les auteurs, ils offrent presque
toujours au public un mélange de fable et d’histoire plus que difficile à
démêler.
Tous
mes principaux personnages sont historiques ; ce que je leur fais faire d’essentiel
l’est aussi : tout cela se fond dans des fictions qui rendent la vérité méconnaissable.
Voilà un grand trait de ressemblance entre moi et mes devanciers ! Mais je
veux avoir sur eux l’avantage de la bonne foi. Voulez-vous connaître les
règnes de Henri III et de Henri IV ? consultez mon
libraire,
Barba ; il vous conseillera de lire mon Histoire
de France2 ; il vous
en garantira la véracité et l’impartialité.

2 Histoire
de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu’au règne d’Henry
IV, inclusivement; avec cette épigraphe : la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité ; par Pigault-Lebrun. 8 vol. in-8 de 600 pages chacun.
Prix 48 francs (note de l’auteur).

Le
château de Brunehaut vers 1808
CHAPITRE
XX
Règlement
pour l’intérieur du ménage.
Le brillant
duc de Guise n’était, en politique, qu’un homme ordinaire. Nous apprîmes,
peu de jours après notre retour à Arpajon, qu’il avait engagé le vieux cardinal
de Bourbon à se déclarer premier prince du sang, et héritier présomptif de
la couronne. Il était contre toute espèce de vraisemblance que le cardinal
succédât jamais à un prince qui avait trente ans moins que lui. Le duc de
Guise voulait donc détrôner Henri III, et renverser ensuite un vieux roi
sans vices, sans caractère, et à qui la nation ne pouvait s’attacher. On
peut arracher la couronne à son maître ; en annoncer le projet est le moyen
le plus sûr de ne pas réussir.
Les
irrésolutions continuelles du duc de Guise permirent bientôt à la faction
des Seize d’éclater. On la nomma ainsi parce qu’elle donna des chefs à chacun
des seize quartiers qui partageaient Paris. Ces chefs, aidés de l’or de l’Espagne,
firent, en peu de temps, de nombreux prosélytes à Philippe II. L’impulsion
était donnée. Il n’était plus au pouvoir du duc d’en arrêter les effets.
Les
Seize lui offrirent vingt mille hommes pour lui aider à détrôner le roi.
Il pouvait, à la tête de ses ligueurs, briser l’instrument qui l’eût placé
sur le trône. Il crut que s’unir, pour
un
moment, aux Seize, ce serait servir les projets du roi d’Espagne, et il refusa
le secours qui lui était offert. C’était commettre une faute irréparable.
Henri
III connut alors les véritables projets des Guise, de la Ligue et de Philippe
II. Il ne vit qu’un moyen d’échapper à des ennemis puissans, c’était de se
jeter dans les bras du roi de Navarre. Il lui fit proposer d’embrasser la
religion catholique, et, à cette condition, il s’engageait à le reconnaître
pour son successeur.
Henri
de Navarre pouvait, d’un mot, renverser les Guise, la Ligue, les Seize, et
le parti huguenot. Son infernale opiniâtreté le fit persévérer dans ce qu’il
appelait la religion de ses pères. Quelle religion que celle qui méconnaît
l’autorité absolue du pape, et les saints dogmes que l’Église enseigne !
Nous
gémissions, Colombe et moi, sur cet excès d’aveuglement. André prenait tout
gaiement, et philosophiquement. Il prétendait que le roi de Navarre avait
fait tout ce qu’on pouvait exiger de lui, en offrant à Henri III son épée
et toutes ses forces, pour le soutenir contre la Ligue. Je le répète : André
était entaché d’hérésie ; mais il avait su se rendre agréable à Colombe et
à moi, et il nous avait rendu tolérans tous les deux… pour lui bien entendu.
Le duc
de Guise commit une nouvelle faute en sortant de Paris. Il voulut faire voir
aux Français le cardinal de Bourbon, qui ne leur inspira d’autre sensation
que celle de la curiosité. Le duc laissait en présence ses ligueurs, qu’il
ne dirigeait plus, et les Seize, qui pouvaient tout entreprendre.
Il
avait une armée à lui, qu’il payait avec l’or de l’Espagne, et à laquelle
il ne faisait faire aucun mouvement. Elle menaçait également les huguenots
et les catholiques, qui étaient restés attachés au roi. Henri III combattit
ses ennemis par des proclamations ; on les tourna en ridicule. Il se
hâta de lever quelques troupes, et il n’avait pas de quoi les payer. Dix-huit
mille Suisses, que lui envoyaient les cantons, sur de simples promesses,
furent arrêtés par les ligueurs, qui étaient maîtres de la Bourgogne et de
la Champagne. Le roi demeura sans défense.
Catherine
de Médicis, éperdue, désespérée, courut à Reims, où étaient le ridicule cardinal
de Bourbon, et l’ambitieux, mais irrésolu, duc de Guise.
Il intima
ses ordres au roi dans un écrit, qu’il intitula Requête de la Sainte Ligue.
Il ordonnait à son maître de reprendre, de vive force, les places de sûreté,
qu’il avait abandonnées aux huguenots, par le dernier traité de paix ; de
proscrire à jamais, par un édit, la religion réformée de la surface de la
France, et de donner des gouvernemens aux princes de la maison de Lorraine,
qui n’étaient déjà que trop puissans.
Catherine
fut obligée de souscrire ces conditions au nom du roi. Si Guise eût exigé
qu’il déposât sa couronne, il aurait fallu obéir.
J’avais
tout fini avec le duc de Guise, et j’étais revenu à mes premiers sentimens
pour Henri III. Nous déplorions, Colombe et moi, les malheurs d’un prince,
à qui il était difficile d’accorder quelque estime, dans sa conduite politique
; mais qui était catholique ardent, et qui régnait d’après des droits incontestables.
Un événement heureux nous consola, au moins
pendant
quelques jours. Sixte-Quint fut porté sur la chaire de saint Pierre.
Quel
homme que ce pape, qui, de l’état le plus vil, parvint, à force de vertus,
à la première dignité de l’Eglise ! Son premier soin fut d’attaquer les huguenots,
dans les personnes de leurs chefs. Il excommunia le roi de Navarre et le
prince de Condé ; il les nomma, dans sa bulle, génération bâtarde et détestable
de la maison de Bourbon. Ce respectable pontife vécut trop peu pour le
bien de la Religion, et l’édification des fidèles.
Le roi
de Navarre crut voir toute l’Europe catholique soulevée contre lui. Son courage
infernal ne fut pas abattu. Il rassembla ses huguenots de toutes parts. La
fille de l’infâme monarque, qui avait sacrifié son salut et celui de ses
sujets à de honteuses passions, Elisabeth d’Angleterre, donna à Henri de
Navarre l’argent nécessaire pour payer ses troupes. Elle seule pouvait prêter
son appui aux autels de Baal.
Cet
hérétique se trouva bientôt à la tête d’une armée formidable. Guise entra
en campagne, et força bientôt l’ennemi de la foi à diviser ses forces. Il
fit marcher contre lui le duc de Joyeuse, qui fut le chercher jusqu’en Guyenne.
Les
deux armées se trouvèrent en présence dans les plaines de Coutras. Les drapeaux
de Joyeuse étaient consacrés par des mains saintes, et la bonne cause succomba.
Les catholiques eurent sept mille hommes tués ou blessés. Ils perdirent leur
général, ses lieutenans, leur artillerie et leurs bagages.
En apprenant
cette affreuse nouvelle, nous tombâmes à genoux, Colombe et moi, et nous
priâmes pour les martyrs, qui s’étaient sacrifiés dans cette déplorable journée.
André prétendit
que
le roi de Navarre y avait déployé les talens d’un général consommé, et la
valeur du plus intrépide soldat. « Eh ! comment, m’écriai-je, les catholiques
pouvaient-ils gagner cette bataille ? les huguenots étaient commandés par
Satan en personne. — Mais, me répondit André, en souriant, Satan commandait
aussi à Saint-Denis, à Dreux, à Montcontour, et les réformés furent vaincus.
— Du moins ne se déshonorèrent-ils pas en courant, du champ de bataille,
se livrer à des amours illicites, et c’est ce qu’a fait votre roi de Navarre.
— Monsieur, quand on est vaincu, on ne pense qu’à fuir. — Le Béarnais et
la comtesse de Grammont finiront mal, je vous le prédis. — Je vous crois,
Monsieur. Comment résisterais-je à un prophète de vingt-un ans, beau comme
Adonis, et qu’inspirent les Grâces ?
— On
ne peut raisonner avec cet homme-là. »
Je pris
la main de Colombe, et je la conduisis dans nos bosquets. Nous y oubliâmes
et ma prophétie, et le reste du monde.
Bientôt
notre maison fut terminée, et nous nous empressâmes de nous y installer.
André, homme unique en plus d’un genre, avait tout prévu, et nous trouvions,
sous notre main, ce que nous pouvions désirer. Chaque objet avait, pour
nous, un air d’élégance et de nouveauté : André avait fait venir tout
de Paris.
Sa prévoyance
s’était particulièrement exercée dans notre chambre à coucher. Nous y trouvâmes
jusqu’à une glace de Venise, de deux pieds en carré, ma foi. Colombe s’y
arrêta pendant quelques minutes. Elle examinait la glace, disait-elle ; elle
n’en avait jamais vu de cette beauté… Est-ce bien la glace qu’elle regardait
?
Du
haut de la nouvelle tour la vue était belle et variée. Une espèce de je ne
sais quoi, nous y offrait un abri contre le soleil et la pluie. Des rideaux
étaient destinés à nous garantir des regards indiscrets. C’est charmant !
c’est charmant ! s’écriait Colombe à chaque pas, et André jouissait ! Le
suffrage de Colombe était la récompense de ses travaux.
Il s’était
logé modestement ; mais il avait réuni dans sa chambre tout ce qui pouvait
la rendre agréable. Il n’avait rien oublié : je remarquai une porte de dégagement,
qui ouvrait sur un corridor, au bout duquel était la chambre de Claire. Je
ne lui demandais rien ; il se hâta de me faire voir un escalier dérobé, qui
était près de cette porte, et par lequel il monterait et descendrait, sans
craindre de nous déranger.
Nous
avions vu faire tout cela ; mais le sentiment de la propriété nous était
encore inconnu. Il commença à se faire sentir du moment où nous prîmes possession
de notre domaine. Ce sentiment-là fait trouver une chaumière charmante, et
notre maison était digne d’un plus grand seigneur que moi.
Nous
trouvions, à chaque pas, des jouissances nouvelles ; des remises, des écuries,
une basse-cour, cachée par un mur, qui bientôt se déroberait lui-même sous
le lierre et le chèvrefeuille qui commençaient à le couvrir ; une avant-cour,
dont le pourtour était garni de fleurs odoriférantes ; un ruisseau, de l’eau
la plus belle, qui serpentait sous nos pas, qui arrosait un jardin potager,
déjà en plein rapport, qui formait un étang, prêt à recevoir la barque légère,
où je promènerais Colombe, qui enfin était rendu à sa source, après avoir
traversé dans tous les sens, des bosquets délicieux ; tout se réunissait
pour faire de notre domaine un séjour enchanteur.
Le
bras de Colombe était encore passé sous le mien ; je tenais sa main, je sentais
battre son pouls. Son mouvement accéléré, la rougeur qui ajoutait quelque
chose au coloris de la pêche, exprimaient la vive satisfaction qu’éprouvait
la femme charmante, et son bonheur ajoutait au mien. Je voulus le faire partager
à tout ce qui nous entourait.
« Mon
ami André, Claire nous a suffi pendant que nous habitions la petite maison
d’Arpajon. Notre nouveau local exige des travaux, qui sont au-dessus de ses
forces. — Monsieur, l’observation est très-juste ; mais j’ai voulu vous laisser
le plaisir de la faire. — Il faut lui donner une femme, qui sera chargée
des gros ouvrages de la maison, et qui lui sera soumise. Tu mettras à la
basse-cour, une fille qui entende bien cette partie-là, et tu ne choisiras
pas de ces jolies figures, qui récréent la vue, et qui ne coûtent pas plus
que d’autres : nous en avons assez d’une. » André avait commencé par sourire
en m’écoutant ; mes derniers mots lui donnèrent un air sérieux et réfléchi.
Il se remit bientôt.
« Monsieur,
me dit-il, ces deux femmes-là ne suffiront pas. Il vous y faut un domestique,
pour soigner vos mules, votre cheval, la voiture, et vous conduire, quand
vous voudrez aller à Paris ou ailleurs. Vous pouvez vous permettre cette
dépense-là ; vous avez deux mille livres de rente, et douze mille autres
en caisse, tous les mémoires payés. — Tu as raison, mon ami, je ne peux me
passer d’un domestique ; je suis bien aise, d’ailleurs, d’avoir quelqu’un
qui porte ma livrée. — Hé ! Monsieur, en avez-vous une ? — Rien ne t’embarrasse
; tu me la feras. — Y pensez-vous, Monsieur ? — Je suis noble. — Vous n’êtes
pas gentilhomme. Un corbeau entendit chanter le rossignol, et voulut chanter
comme lui. Il croassa, et fut bafoué par les
oiseaux
de la forêt. — André, tu as plus de bon sens que moi.
— Je
ne dis pas cela, Monsieur. — Moi, je le sens. Allons, allons, pas de livrée.
»
«
Vas3 à Arpajon, et tâche de
te procurer les trois sujets dont nous avons besoin. — Vous les aurez ce
soir. — …Ah ! dis-moi donc, André… que ferons-nous des douze mille livres
que tu as en caisse ? — Monsieur, vous ne tarderez pas à être atteint de
la maladie, qui attaque tous les propriétaires : vous voudrez vous agrandir.
Quelqu’un de vos voisins jouera à la prime, ou voudra avoir un équipage de
chasse, ou acheter à Paris la fidélité d’une femme, qui n’est jamais
fidèle, par la raison qu’on la paye. Nous profiterons des folies
du voisin. A ce soir, Monsieur. »
En
effet, il m’amena dans la journée, deux filles d’une figure fort ordinaire,
et un valet qui ne pouvait donner de tentations à Claire. Voilà notre maison
montée. Jouissons, sans ostentation de tous les avantages que mon patron4 m’a accordés.
Le malheur
développe le jugement et forme la raison. Sous ces deux rapports. Colombe
était très-avancée pour son âge.
« Mon
Antoine, me dit-elle un jour, nous vivons à l’heure, à la minute ; nous nous
demandons souvent ce que nous allons faire, et cette manière d’être ne vaut
rien. Il faut régler invariablement l’emploi de nos journées. Établissons,
dans nos travaux et nos plaisirs, une variété qui éloigne l’ennui, et on
s’ennuie nécessairement, quand on se demande ce qu’on fera. — Moi, Colombe,
m’ennuyer auprès de toi ! — Oui, mon ami, quand on passe sa vie ensemble,
on n’a pas toujours quelque chose de

3 Sic (B.G.)
4 À savoir
son saint patron saint Antoine de Padoue (B. G.).
nouveau
à se dire. Que fait-on, quand la conversation est tombée, et qu’on ne s’occupe
pas ? — On bâille, répondit André, Madame a raison, Monsieur. L’homme qui
sait établir l’ordre dans sa maison, peut gouverner un royaume ; il y a la
différence du petit au grand, je le sais ; mais est-il impossible qu’un bon
peintre en miniature, devienne un grand peintre d’histoire ? si j’étais roi,
et qu’on me proposât quelqu’un pour remplacer un ministre, comme il y en
a tant, voilà les questions que je ferais : a-t-il de l’intelligence et de
la probité ? ces deux qualités sont indispensables dans un homme public.
Si on me répondait affirmativement, je demanderais s’il a de l’ordre dans
sa conduite, si sa femme, ses enfans, remplissent exactement les devoirs
que leur position leur impose. Comment un homme qui ne sait pas gouverner
sa famille, maintiendrait-il une foule d’employés dans le devoir ? je voudrais
savoir enfin, si ses valets sont affables envers les étrangers. Si personne
ne se plaignait d’eux, j’en conclurais que ses commis ne seraient pas arrogans.
« —
Quels contes tu nous fais là, André ! tu sais bien que je ne serai jamais
ministre. — Conduisez-vous donc, comme si vous deviez l’être.
« Madame
ne vous a pas proposé de régler l’emploi de vos journées, sans avoir arrêté
un plan ; priez-la de vous le communiquer. — Parle, ma Colombe. La sagesse
perdra son austérité, en prenant, pour organe, cette bouche charmante.
« —
Mon ami, nous consacrons à la prière, le moment de notre réveil. — Oh ! c’est
un devoir sacré. — Nous donnons une heure à la promenade, dans nos bosquets,
ou sur notre étang, quand la nacelle y sera lancée. — Oui, l’air du matin
est bienfaisant. — Nous rentrons, et nous déjeûnons gaîment. —
On
est toujours de bonne humeur, quand on est heureux. — Nous montons chez nous.
Tu écris… — Oui, je compose un ouvrage qui prouve clairement que le Béarnais
est un suppôt de l’enfer. — Moi, je fais de la tapisserie. — À merveille
: c’est l’occupation des grandes dames, et même des princesses. — À midi,
nous dînons. — Oh, c’est trop juste. — Nous faisons une seconde promenade,
et nous la prolongeons un peu. — Oui, la balançoire, le jeu de raquettes
font digérer facilement. — Nous rentrons. Je reprends mon aiguille, et tu
me fais une lecture pieuse. — L’Ange-Conducteur, le Guide du Pécheur…
— Les Œuvres de Sainte Thérèse. Elle apprend à aimer Dieu, et par conséquent
l’objet auquel il nous a unis. — Après, ma Colombe ? — Oh, alors, nous causons.
— Oui, nous causons vivement. — Ou avec calme ; mais il me semble qu’après
une privation de quelques heures, on a nécessairement quelque chose à se
dire. — Nous voilà arrivés à six heures du soir. — Tu comptes avec André.
— Oh, je ne compterai jamais avec lui.
-
Prenez garde, Monsieur. Vous en rapporter
aveuglément à moi, ce serait manquer d’ordre dans votre conduite, et il faut
qu’un ministre en ait. — Va te promener, avec tes plaisanteries.
«
Et puis, Monsieur, il faut pour ma tranquillité, que mes mémoires soient
arrêtés. — Je compterai tous les matins avec Claire… — Je le crois. — Et
tous les soirs avec vous. — Ma Colombe, il est six heures. — Tu me donnes
une leçon d’écriture : j’en ai besoin, puisque je n’ai pas osé écrire les
statuts que je te propose. Nous soupons ensuite, et nous allons prendre le
frais, et contempler la lune, quand elle paraîtra : c’est l’astre des amans….
— Et je serai toujours le tien. » Un doux baiser, donné par Colombe, interrompit
pour un moment la conversation.
«
Colombe, il est sept heures. — Nous entrons dans l’oratoire du bosquet, dédié
à Saint-Antoine. Nous y remercions le ciel des jours heureux qu’il nous a
dispensés, et nous le supplions de nous en accorder un grand nombre d’autres.
— Mais, Madame, ne se couchera-t-on pas à la tour ? — À huit heures, mon
ami.
-
Pour se lever à six. Cet article peut passer.
»
André
et moi, employâmes le reste de la soirée à faire des copies de ce règlement,
dicté par la sagesse, et Colombe nous reprenait, quand nous nous trompions.
Nous en attachâmes des copies partout, depuis la cave, jusqu’aux galetas
où logeaient nos domestiques subalternes, prévoyance fort inutile, puisqu’ils
ne savaient pas lire ; mais Colombe l’ordonna ainsi.
André
voulut être le législateur de l’écurie, de la basse-cour et de la cuisine.
Il rédigea des statuts, qu’il mit en harmonie avec ceux de Colombe, en ce
qui concernait les heures des repas. Les autres articles réglaient ce que
chacun ferait provisoirement, pour qu’il n’y eût jamais de retard dans le
service.
Il rassembla,
autour de lui, tout son monde ; monta sur une chaise, et lut, deux fois,
le code qu’il venait d’imaginer, avec un sérieux imperturbable.
Le lendemain,
le règlement fut mis en vigueur. Les meilleures lois ne sont pas celles qui
paraissent dictées par la sagesse ; mais celles qui conviennent le mieux
aux mœurs, aux goûts, aux habitudes du peuple qu’elles doivent gouverner.
Notre promenade du matin fut prolongée au-delà du terme fixé. Nous folâtrions,
nous courions, et quand-la beauté fuit devant l’amour, c’est toujours pour
se laisser prendre. La cloche nous avait appelés deux fois au déjeuner, et
nous ne l’avions pas
entendue.
Il y avait un cadran solaire dans le jardin ; mais je ne pouvais le porter
sous mon bras à la promenade.
Le déjeuner
était froid. Claire fronçait le sourcil. André riait. Colombe réfléchissait,
moi je me mis à table. C’est souvent là que viennent les lionnes idées. Colombe
y trouva un article additionnel, dont l’expérience venait de démontrer la
nécessité. II fut arrêté, que mon valet viendrait, d’heure en heure, nous
avertir de ce que nous devions faire.
Nous
montâmes chez nous. Je commençai l’exorde de mon mémoire contre les huguenots
et leur chef. Colombe devait faire de la tapisserie ; il ne lui manquait
qu’un métier, du canevas et de la laine. « Ma chère amie, lui dis-je, la
nymphe Égérie dicta des lois à Numa-Pompilius ; mais il fallut du temps pour
les mettre à exécution. » II fut décidé que celle de l’article IV serait
remise au lendemain.
J’appelai
André et je lui contai notre mésaventure. « Je n’ai pas été plus chanceux
que madame, nous dit-il. Je me suis déjà trouvé en contradiction avec moi-même.
Il n’est pas si aisé qu’on se l’imagine de faire des lois, et tout le monde
veut être député aux états-généraux. »
Il monta
à cheval, pour aller chercher à Paris les ustensiles propres à faire de la
tapisserie. Il y a huit lieues d’Arpajon à Paris. Il ne pouvait être de retour
que le lendemain. Colombe fut obligée d’ajourner, jusqu’au surlendemain,
la mise en activité de son règlement, et je lui fis remarquer qu’on se passe
facilement de lois, quand on est soumis à la nature et à l’amour. En effet,
cette journée et une partie de celle qui la suivit s’écoulèrent aussi doucement
que celles qui les avaient précédées.
André
entra dans la cour, à peu près à l’heure où nous l’attendions. Claire accourut
pour lui tenir l’étrier. Mon valet que ce soin regardait particulièrement,
arriva trop tard ; mais il n’avait pas de raison de se presser, il détacha
les paquets qui surchargeaient le devant et le derrière de la selle. Que
de choses André nous apportait ! il nous dit qu’il se plaisait à la tour,
qu’il n’aimait pas à découcher, il avait de bonnes raisons pour cela, et
qu’il avait tâché de tout prévoir.
Il remit
un paquet à Claire, qui, le dimanche suivant, était parée d’un juste et d’une
jupe que je ne lui avais pas vus encore. Il donna au valet un sac rempli
d’objets à l’usage de la cuisine, et il monta à notre chambre ce qui devait
assurer l’exécution du règlement.
Il déroula,
devant nous, un grand canevas, sur lequel était tracé le supplice de la reine
Brunehaud. « Ah ! mon cher André, quel sujet tu as choisi ! — Vous auriez
préféré les amours de Mars, et de Vénus ; mais Madame veut réellement travailler,
et j’ai dû éviter tout ce qui aurait pu vous donner des distractions. C’est
très-bien vu, s’écria Colombe. La reine Brunehaud t’éloignera de mon métier.
Que renferme ce paquet-là, André ?
« Madame,
vous avez décrété que de deux à quatre heures, Monsieur vous ferait une lecture
pieuse, et pour cela il faut des livres. — Étourdie ! j’ai oublié l’essentiel.
— Vous avez cela de commun, Madame, avec beaucoup de législateurs. De là,
tous ces amendemens qui ressassent nos lois, comme une ravaudeuse bouche
des trous. Les fils paraissent ; mais cela va toujours.
« Voilà
l’Ange conducteur, le Guide du pécheur, et les Œuvres de sainte Thérèse,
en cinq volumes, bien gros et bien
larges.
J’y ai jeté les yeux, et je crois que lorsque vous serez à la fin, vous recommencerez.
Il y a de l’amour là-dedans, il y en a ! ce livre-là deviendra votre bréviaire.
« Vous
ne folâtrerez pas toujours pendant vos promenades, et je vous apporte de
quoi charmer vos momens de repos. — Qu’est-ce ? — Ronsard, Jodelle et Belleau.
C’est ce que nous avons de plus distingué dans la littérature française.
Il est charmant, m’écriai-je. — Il est unique, répondit Colombe. »
« Mon
bon Antoine, demain nous exécuterons à la lettre ce que prescrit le règlement.
Tu le veux bien, mon ami ? — Puis-je avoir d’autre volonté que la tienne
? »
En effet,
nous mîmes à l’exécution de nos lois, elle tout l’empressement d’un législateur,
moi, la docilité d’un sujet soumis.
Tout
alla à merveille jusqu’au moment où Colombe se mit à son métier. Je me plaçai
auprès d’elle, un volume de sainte Thérèse à la main. C’est celui qui est
intitulé : le Chemin de la Perfection.
L’auteur
la trouve toute entière dans l’amour de Dieu. Mais cet amour est exprimé
avec une chaleur qui tient du délire, avec une éloquence, une pureté de style
qui m’entraînaient. Je retrouvais mon cœur à chaque paragraphe, à chaque
ligne, à chaque mot. Bientôt ma main, qui était libre, se trouva sur l’épaule
de Colombe. « Otez votre main, Monsieur ; vous m’empêchez de travailler.
»
Je 1’ôtais,
je la replaçais… Le livre tomba… Colombe, dépitée, fit un mouvement, et se
piqua le doigt. Son sang coula ;
je
voulus l’étancher ; elle se dégagea et s’enfuit. Je courus sur ses pas ;
elle était déjà loin.
Je la
cherchai de tous les côtés. Je l’aperçus enfin dans la partie la plus épaisse
de nos bosquets. Elle me fit signe de me taire, et de m’approcher sans bruit.
Qu’a-t-elle vu, que veut-elle me faire voir ? un nid d’oiseaux, peut-être.
C’était
André, c’était Claire, qui nous croyaient fidèles aux statuts, et occupés
dans notre chambre. Ils avaient, probablement, leur petit code à eux, et
ils exécutaient, avec sécurité, l’article qui leur prescrivait la promenade,
quand nous étions chez nous. Cet article permettait certaines libertés, qui
n’avaient rien de scandaleux, mais qui annonçaient une union intime.
Nous
découvrions tout à travers une touffe de lilas. Je prévis que la scène pourrait
s’animer davantage, et je toussai, pour avertir mon bon André. Il enfila
une allée, Claire une autre, et ils disparurent.
La physionomie
de Colombe exprimait la colère. Je cherchai à la calmer ; elle éclata. «
Cela est affreux, abominable. — Un peu de charité, ma bonne amie. Ne nous
arrêtons pas à la paille, qui est dans l’œil du voisin. — C’est la poutre,
Monsieur, que j’y vois. — Modère-toi, ma chère Colombe, et réfléchis. André
ne peut reprendre sa femme, tu le sais, et il n’est pas de marbre.
— Claire
n’a pas d’excuse à donner. — Elle était, peut-être, sans expérience. — Je
la soupçonne d’en avoir beaucoup. — On a pardonné à Madeleine. — Mais elle
s’est convertie. — Elle était majeure alors, et savons-nous ce que fera
Claire, quand elle aura quarante ans. — Pas de mauvaise plaisanterie, Monsieur.
Je vous déclare que je ne veux pas de ce désordre-là
chez
nous. » — Tu pourrais exiger, Colombe, que je me séparasse d’André, qui m’a
rendu les plus importans services, qui est mon véritable ami, et dont, hier
encore, tu louais l’intelligence, l’activité, le zèle ! — Il fut un temps,
Monsieur, où loin de combattre mes désirs, vous vous empressiez de les prévenir.
— Tu me dis vous, Colombe, pour la première fois ! Ah quel mal tu
me fais ! — Hé, croyez-vous, Monsieur, que je ne souffre pas de la résistance
que vous m’opposez ?... Ah, tu n’es plus mon Antoine… les hommes sont inconstans,
perfides, cruel ! — Tu pleures, ma Colombe !... ils partiront. »
Je la
quittai, désolé, affligé de ce qu’elle exigeait de moi, et surtout de la
froideur qu’elle m’avait marquée. J’allai chercher André, et jamais, je crois,
aucun homme ne fut aussi embarrassé que moi. Je ne le trouvai point, et je
revins auprès de Colombe, mécontent, et presqu’irrité. Je sentais qu’il n’eût
fallu qu’un mot désobligeant, de sa part, pour me faire éclater. Nous marchions
l’un à côté de l’autre, sans nous parler. Peut-être en avions-nous une égale
envie : le difficile était de commencer. Je me laissai aller sur un banc
de gazon ; elle s’assit près de moi. Elle prit ma main ; je ne la retirai
pas. Elle me regarda avec une douceur, un charme !... J’allais tomber à ses
pieds. Je me levai ; elle me suivit. « Croyez-vous, me dit-elle, à demi-voix,
que j’aie la coupable prétention de vouloir mener mon mari ? Je n’ai rien
pensé, je n’ai rien dit, je n’ai rien voulu que pour venger la Religion outragée.
— Rappelez-vous, Colombe, que trois fois nous avons été bien près, à la Rochelle,
de l’outrager nous- mêmes, et que le ciel ne nous a pas chargés du soin de
sa vengeance. » Nous tournâmes nos pas vers la maison, en gardant le plus
profond silence. C’était l’heure du dîner.
Rien
n’était préparé pour nous recevoir. La grosse servante nous servit des mets
brûlés, ou à demi-cuits. Il fallut manger, cependant, pour avoir l’air de
faire quelque chose, qui nous dispensât de parler. En sortant de table, un
homme se présenta à moi. Il venait d’Arpajon, et il me remit une lettre.
Je reconnus l’écriture d’André. Je la lus à voix basse, et je la passai
à Colombe.
« Monsieur,
« Je
suis revenu sur mes pas dans les bosquets, et j’ai entendu votre conversation
avec madame. J’avoue que la conduite de Claire et la mienne sont répréhensibles
; mais nous sommes jugés avec une rigueur qui m’a étonné. La prudence avait
dirigé nos démarches jusqu’alors. Notre secret n’est connu encore que de
vous et de madame, et elle a oublié le précepte du Sauveur à l’égard de la
femme adultère : Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première
pierre. » Que celui de vous, qui est sans péché, répéta Colombe. Elle se
tut.
« J’ai
emporté cent pistoles, pour me tenir lieu des gages qui n’ont pas été arrêtés
entre nous, et sur lesquels je n’ai rien reçu. Si madame juge que ce soit
trop, je lui renverrai ce qu’elle ordonnera.
« Nous
sommes établis dans votre maison d’Arpajon, dont le bail n’est pas expiré.
Nous en sortirons si madame l’exige. » — Pourquoi donc moi, toujours moi
!
« Mon
cœur est brisé ; mais j’ai emporté la consolation de n’être pas un objet
de discorde entre deux époux si bien assortis. Je désire que mes services
ne leur soient jamais
nécessaires.
Si cela arrivait, qu’ils disent un mot, et je vole auprès d’eux. »
Colombe
fondait en larmes. Elle me prit la main, me conduisit dans notre chambre,
et me fit mettre à genoux auprès d’elle.
« Mon
ami, prions nos patrons de nous éclairer. Que t’a dit saint Antoine ? — Que
j’ai brisé le cœur de mon pauvre André. Que t’a dit sainte Colombe ? — Elle
m’a répété le précepte de l’Évangile : Que celui de vous qui est sans péché…
— Colombe, c’est nous ordonner d’être indulgens. — Mon ami, prends ta voiture,
et va les chercher. »
Je m’élançai
dans ses bras ; elle me pressa contre son cœur. Notre raccommodement fut
délicieux, complet. Je ne prévoyais pas le charme d’un raccommodement ; mais
que les momens qui l’avaient précédé avaient été cruels ! « Colombe, je t’en
supplie, n’ayons plus à nous raccommoder. »
Je volai
à Arpajon. J’embrassai André comme un frère chéri, qu’on croyait perdu, et
qu’on vient de retrouver. Je crois que j’embrassai Claire aussi.
André
voulut parler ; je ne l’écoutai pas. Je les poussai tous deux dans la voiture
; j’y montai après eux, et je les ramenai au galop à la tour. Colombe nous
attendait.
Elle
nous reçut avec un air solennel, et nous conduisit, en silence, à l’oratoire
de saint Antoine. Elle en ferma la porte sur nous. Son teint et ses yeux
s’animèrent. Je crus voir une femme inspirée, une seconde sainte Thérèse.
« Pécheurs,
tombez à genoux ; priez le Ciel d’oublier vos égaremens passés, et puisse-t-il
vous pardonner, comme je vous
pardonne.
Jurez-lui, mon cher André, de réparer l’honneur de cette fille, s’il lui
plaît d’appeler votre femme à lui, et, qu’en attendant, votre amour sera
chaste, comme le fut le nôtre, avant que nous fussions unis en légitimes
nœuds. »
Le double
serment fut prononcé à haute voix, et Colombe leur donna le baiser de paix.
« Souvenez-vous toujours, leur dit-elle en sortant, que si vous manquez à
vos promesses, ce n’est pas moi que vous tromperez. J’ai mis ma conscience
en repos ; je ne peux rien faire de plus. »

Le
moulin de Brunehaut vers 1808 (dessin de Bourgeois)
CHAPITRE
XXI.
Journée
des barricades,
et
autres événemens plus gais.
L’ordre,
la paix, la gaîté étaient rétablis dans la maison. Colombe et moi nous étions
heureux. Je ne sais si André et Claire tinrent leurs sermens. Du moins, aucun
nuage ne troubla la tranquillité de Colombe à cet égard.
Le règlement
fut scrupuleusement observé pendant quelques jours ; mais les meilleures
lois tombent en désuétude ; celles de Solon et de Lycurgue sont, à peu près,
perdues dans la nuit des temps.
Nous
commençâmes par nous permettre certaines petites négligences, qui semblaient
ne pas tirer à conséquence ; mais qui amenèrent insensiblement des transpositions
d’exercices, et par la suite des suppressions absolues. Une seule chose qui
n’était pas portée dans les statuts, et qui tenait de très-près à la Religion,
fut, par cela même, rigoureusement pratiquée.
André
avait fourni l’étang de fort bon poisson. Le vendredi matin, Colombe et moi,
nous nous levions de bonne heure, et
nous
allions pêcher la provision du jour et du lendemain. Quand la pêche n’était
pas heureuse, André venait se joindre à nous, et bientôt la nasse était garnie.
Il y
avait quelques écrevisses dans le ruisseau. Mais, d’après les observations
d’André, nous résolûmes de n’y pas toucher d’un an : c’était un moyen sûr
d’en avoir à foison.
Le supplice
de la reine Brunehaud attristait Colombe, et puis elle se piquait souvent
les doigts, lors même que je n’étais pas auprès d’elle. Nous savions sainte
Thérèse par cœur. Il y avait, de temps à autre, quelques momens de vide dans
la journée.
Je trouvais
que le murmure des ruisseaux flattait moins mon oreille ; Colombe eut un
petit rhume, qu’elle attribua à l’humidité de nos bosquets. Nous trouvions
toujours superbe la vue dont nous jouissions du haut de la tour ; mais il
fallait y monter.
Nous
découvrions, de là, le domaine de M. Richoux. Il était peu éloigné du nôtre
; mais la mauvaise saison approchait, et les soirées sont longues l’hiver.
Je proposai à Colombe de faire une visite à M. Richoux, « André, qui sait
tout, me dit-elle, prétend qu’il est très-bon catholique, et que cependant
il n’est pas ennemi des plaisirs. Sa femme joue très-bien à la prime... —
Et cela fait passer une heure ou deux. — On se rassemble tantôt chez eux,
tantôt chez nous. — La table de jeu est auprès du foyer... — Moi, j’y fais
cuire des marrons. — André nous choisit une bouteille de bon vin blanc...
— Les grands jours on soupe ensemble. — On peut même danser le dimanche.
— Oh, mon Antoine, on dit que c’est un péché. — Les filles de Sion ne dansaient-elles
pas devant l’Arche, au son de la harpe
du
saint roi David ? — Tu as raison, mon ami. Allons voir M. Richoux. — Partons.
»
M. Richoux
était un homme de cinquante ans, et sa femme une grosse réjouie de quarante.
Ils avaient deux filles prêtes à être mariées, et un jeune garçon d’une assez
jolie figure. Nous fûmes reçus, par ces braves gens-là, comme des voisins
avec qui on désirait faire connaissance ; mais les campagnards ont leur étiquette
comme les habitans de la ville et de la cour : il était de rigueur que nous
fissions la première visite à M. Richoux.
Nous
reconnûmes bientôt que la politique était l’affaire essentielle du mari.
C’est assez l’occupation des propriétaires, qui habitent leur manoir, et
qui ne s’y mêlent que de compter avec leur fermier. Madame Richoux riait
de tout, même d’une mouche, qui, d’un coup d’aile, lui chatouillait le bout
du nez. Ses deux grandes filles étaient assises, immobiles et droites, comme
un cierge pascal. Le petit garçon attachait un morceau de papier au bout
de la queue du chat.
Quand
on a épuisé les premiers complimens, et qu’on ne se connaît pas encore, on
ne sait que dire. Nous étions chez M. Richoux ; c’était à lui à soutenir
la conversation. Il le sentit.
Depuis
long-temps je n’avais pensé ni au roi, ni au duc de Guise, ni au Béarnais.
M. Richoux commença par nous apprendre qu’il avait à Paris un correspondant
très-instruit, qui ne lui laissait rien ignorer de ce qui concernait les
affaires d’Etat.
Il parlait
avec facilité ; il parla longtemps, et je l’écoutais avec intérêt : il m’apprenait
des choses toutes nouvelles pour moi.
Madame
Richoux savait qu’il ne voulait pas être interrompu, et dès que son mari
eut ouvert la bouche, elle avait emmené, dans une chambre haute, Colombe,
son fils et le chat. Là, elle pouvait rire à son aise. Les deux demoiselles
étaient restées sur leurs chaises, dans la plus complète immobilité.
La Sorbonne
avait publié un arrêté, qui déclarait déchus de la couronne les rois incapables
de la porter. Les rues, les places publiques, les chaires des églises retentissaient
des éloges du duc de Guise. Le décret de la Sorbonne paraissait rendu uniquement
en faveur de ce prince. Les Seize s’en étaient saisis, et voulaient l’interpréter
en faveur du roi d’Espagne. La Sorbonne, une assemblée de simples prêtres,
osait prononcer la déchéance d’un roi de France !
Les
princes Lorrains s’étaient assemblés à Nancy. Forts de l’appui du haut et
bas clergé, et de l’idolâtrie d’une grande partie de la nation, ils avaient
adressé au roi, sous le titre de requête, des ordres, dont l’exécution devait
mettre le royaume en feu. Ils exigeaient qu’il chassât de sa cour ceux dont
le bras lui était le plus nécessaire ; qu’il mit en vigueur les décrets du
concile de Trente ; qu’il rétablît l’inquisition ; qu’il sanctionnât les
entreprises de la sainte Ligue, pour le passé à le présent et l’avenir ;
enfin qu’il levât, sur les frontières de la Lorraine, une armée, dont le
commandement serait dévolu au duc de Guise. Si le roi se fût soumis à ce
que lui prescrivait cette requête, il eût signé son abdication.
Bientôt
l’intrigue et l’audace n’avaient pas suffi au duc de Guise. Il avait fait
assassiner Saint-Mégrin, un des mignons du roi. M. Richoux et moi convînmes
qu’il n’y avait pas grand mal à cela.
Le
Béarnais avait surpris, à Nérac, un zélé catholique, qui avait tenté de le
poignarder. Il lui avait pardonné, et se l’était attaché, par les moyens
de séduction, qui lui étaient familiers.
Nous
regrettâmes sincèrement que cette entreprise n’eût pas réussi : les huguenots
fussent tombés avec leur chef. Nous déplorâmes l’influence inconcevable qu’exerçait
ce prince sur tous ceux qui l’approchaient, et qui m’avait entraîné moi-même.
Nous y reconnûmes clairement l’œuvre du démon.
Enfin
M. Richoux m’apprit que le prince de Condé venait d’être empoisonné, et de
mourir à Saint-Jean d’Angély. La voix publique accusait Charlotte de la Trémouille,
son épouse.
Mon
cœur se dilata à la pensée de la mort du second chef des huguenots, et je
bénis la main qui avait servi la vraie Religion.
Le petit
garçon vint, en sautant, avertir son père que le souper était servi. M. Richoux
nous invita cordialement à le partager avec lui. Nous acceptâmes sa proposition
; mais sous la condition expresse qu’il viendrait, avec sa famille, passer
la journée du lendemain à la tour.
Nous raisonnâmes
longuement, à table, sur les événemens que
M. Richoux
m’avait appris. Il prétendait qu’ils annonçaient une suite effrayante de
calamités. Moi, je tirais, de la mort du prince de Condé, un présage certain
du triomphe de la bonne cause. Colombe étouffait des bâillemens ; madame
Richoux riait de tout, et quelquefois de rien. Ses deux filles ne disaient
mot, et peut-être n’avaient pas une idée. Le petit garçon, qui n’avait plus
besoin de rien, se roulait sous la table, et s’amusait à nous pincer les
jambes.
«
Ne trouves-tu pas cette maison ennuyeuse, me demanda Colombe, quand nous
en fûmes sortis ? — Ma chère amie, M. Richoux reçoit exactement de Paris
la nouvelle du jour. — Oui, mais sa femme est une folle, ses filles des imbéciles,
et son fils un polisson très-importun. J’ai seule ce fardeau-là sur les bras,
pendant que tu jases avec le père. — Hé bien, ma Colombe, nous les recevrons
demain avec bienveillance, et nous ne retournerons plus chez eux. — Nous
ne manquerons pas de prétextes pour rester chez nous. »
Le lendemain
je racontai à André ce qui s’était passé chez M. Richoux. « Voilà, me dit-il,
de grandes nouvelles ; mais madame les a payées un peu cher. Notre règlement
est au diable, et je peux, de temps en temps, aller passer un jour à Paris.
Tout le monde s’y mêle des affaires publiques, et je crois que je me lierai
facilement avec quelqu’un qui ne soit pas enthousiaste, et qui ait le sens
commun. — Et où trouveras-tu cet homme-là ? — Sur le pavé. On se jette dans
les groupes, on écoute, et quand on a rencontré son homme, on le mène au
cabaret. — Tu iras à Paris, André. Je compte beaucoup plus sur ton discernement
que sur celui de M. Richoux. »
Les
voisins arrivèrent juste au moment où la bienséance permet de se présenter
dans une maison décente. Colombe était à peine préparée à les recevoir. André
la tira d’embarras. Il conduisit la mère à la tour, et l’y laissa avec une
lunette d’approche. Il mena ses filles dans le jardin, et les invita à faire
des bouquets. Il mit une ligne à la main du petit garçon, et lui permit de
pêcher dans l’étang.
M. Richoux
m’avait abordé, une longue lettre à la main : il venait de la recevoir de
Paris.
Les
ligueurs et les Seize avaient inondé cette ville de libelles contre le roi,
et le peuple demandait à grands cris qu’il fût arrêté et déposé. Le roi venait
de faire entrer dans la ville toutes les troupes, dont il avait pu disposer,
et ses ennemis avaient dépêché au duc de Guise un courrier, qui importait
le brevet de lieutenant-général du royaume, et une lettre qui le pressait
de se rendre, sans délai, dans la capitale. Le roi eu avait, au même instant,
fait partir deux autres, chargés de la défense expresse, adressée au duc,
d’entrer à Paris, à peine d’être poursuivi comme criminel de lèse-majesté.
Le duc
avait perdu mon estime et mon attachement, depuis que j’avais acquis la preuve
qu’il n’avait pas de religion, et qu’il n’était qu’un ambitieux, qui méditait
un crime, qu’il n’avait pas le courage de consommer. Tous mes vœux étaient
pour le roi, dans ce moment de crise.
M. Richoux
ne partageait, pas mes opinions. « Mon cher voisin, me dit-il, tout propriétaire
doit tenir à la conservation de ce qu’il a. Il est donc dans son intérêt
de s’attacher au parti le plus fort, et celui du duc de Guise doit infailliblement
triompher. »
Je le
laissai parler tant qu’il le voulut : je ne voulais pas ouvrir avec lui de
discussion politique. Presque toujours les parties s’échauffent, s’exaltent
; elles s’injurient quelquefois, et se séparent, sans avoir rien gagné l’une
sur l’autre.
La cloche
nous appela pour dîner. J’introduisis M. Richoux. Je ne voyais pas nos autres
convives. Il fallut les chercher. Colombe trouva madame Richoux, au haut
de la tour, se tenant les côtés, et riant à perdre la respiration. Elle avait
vu une aile de moulin enlever un âne, par son bât, et le faire tourner avec
elle.
Le meunier avait saisi son âne par la queue, et tout cela tournait ensemble.
André
rencontra les demoiselles endormies dans les bosquets. Il les éveilla, en
effeuillant, sur leurs figures insignifiantes, les roses qu’elles avaient
cueillies. Le petit garçon arriva, mouillé des pieds jusqu’aux hanches. Aucun
poisson n’avait mordu à sa ligne, et selon l’usage des pêcheurs malheureux,
il avait changé de place à chaque instant. Il avait vu une écrevisse en longeant
le ruisseau, puis une seconde, une troisième. Il était sauté dans l’eau,
avait tâtonné, dans tous les trous, avec le manche de sa ligne, et avait
empli d’écrevisses le seau destiné à recevoir ses carpillons. J’étais furieux
; mais je me gardai bien de le faire paraître. Je dis seulement à André,
et je le lui dis bien bas, d’aller remettre les écrevisses dans le ruisseau.
« Comment,
Fifi, s’écria madame Richoux, tu as pris tout cela ! L’aimable enfant ! Il
sait que j’aime les écrevisses à la folie ! » II n’y eut plus moyen de reculer.
Il fallut les envoyer à la cuisine. Il fallut ensuite qu’André déshabillât
Fifi. Il le fourra tout entier dans un de ses hauts-de-chausses. Madame Richoux
trouva le travestissement très-drôle, et en rit pendant un quart d’heure.
Je bouillais d’impatience, et Colombe gardait un sérieux imperturbable. C’est
tout ce que la politesse exigeait d’elle.
Comment
n’avoir pas beaucoup d’humeur ? Il était une heure, et le dîner avait été
servi à midi. Tout était froid ; on ne mangeait qu’en faisant la, grimace,
et cela n’égaie point un repas.
André
se battit les flancs pour animer la conversation, et ses efforts furent vains.
Madame Richoux elle-même cessa de rire,
et
on quitta la table, à peu de chose près, comme on s’y était mis.
Il est
cruel pour une maîtresse de maison de voir son dîner gâté. Colombe si aimante,
si communicative, allait et venait, sans objet déterminé. Je passais de monsieur
à madame Richoux, et je ne trouvais rien à leur dire : je ne pensais qu’à
mes pauvres écrevisses. Nos convives erraient, çà et là. Je crois que la
soirée leur parut aussi longue qu’à nous. Je me gardai bien de les retenir
à souper.
Ils
prirent congé de nous à la chute du jour ; Madame Richoux nous remercia,
en riant aux éclats, des agrémens que nous leur avions procurés, et ils nous
quittèrent, aussi satisfaits, probablement, de se voir libres, que nous d’en
être débarrassés.
«Mon
ami, me dit Colombe, c’est donc là ce qu’on appelle s’amuser, se distraire
? — Ma chère amie, j’ai eu de l’humeur pendant toute la journée. — Je le
crois, reprit André. La chauve-souris et l’hirondelle ne sont pas faites
pour se trouver ensemble. »
Je sentais
que la société des Richoux ne nous convenait pas, et je me promis de ne me
lier, désormais, qu’avec des gens que je connaîtrais bien. Cependant je regrettais
les feuilles de M. Richoux. Tout annonçait des troubles prochains dans Paris.
Nous n’en étions pas assez éloignés pour que je fusse tranquille sur l’avenir
de Colombe, et sur nos propriétés. « Monsieur, me dit André, je monterai
à cheval demain matin ; j’observerai tout, j’écouterai tout, et je ne crois
pas être plus maladroit que le correspondant de M. Richoux. »
Il
était absent depuis trois jours, et nous ne savions que penser de ce retard,
Colombe et moi. Je remarquai que Claire devenait rêveuse, pensive, et que
vingt fois le jour elle montait à notre observatoire. Des paysans, qui passaient
sur la grande route, nous dirent que tout était à feu et à sang dans Paris.
Colombe et moi tremblions que l’empressement, qu’avait mis André à me complaire,
ne lui eût coûté la vie. Claire ne pensait plus à nous cacher ses alarmes.
Le voilà,
le voilà, nous cria-t-elle du haut de la tour. C’était lui, en effet. Il
était couvert de poussière, et ses habits étaient en lambeaux. Il avait le
plus grand besoin de se reposer : mais il n’était pas un homme ordinaire.
Il s’oublia, pour satisfaire notre impatience. Malgré la défense du roi,
Guise entra dans Paris, et tel était son mépris pour ce prince, qu’il ne
s’était fait accompagner que de sept à huit hommes d’armes. Dès qu’il parut,
une foule innombrable l’entoura, et le salua des acclamations les plus
flatteuses. On le nommait le sauveur de la religion catholique. Ceux qui
purent l’approcher baisaient ses vêtemens, et les harnais de son cheval.
Les femmes, placées aux fenêtres, jonchaient de fleurs les rues par lesquelles
il passait.
Le maréchal
de Biron fit entrer six mille Suisses dans Paris et les conduisit au Louvre
: le roi n’osait plus confier sa personne à des Français. Le duc de Guise
rassembla les ligueurs et les seize. En moins de six heures, cent mille hommes
sont sous les armes.
Les
marchés, les places, les ports, les principales rues sont fermés par des
chaînes de fer, ou des barricades élevées avec des madriers, des tonneaux,
de la terre ou du fumier. Ces barricades sont poussées jusqu’à cinquante
pas du Louvre ; les troupes du roi sont cernées de toutes parts.
Le
tocsin sonne dans toutes les églises. Les rues sont dépavées, et une immense
quantité de grès va pleuvoir du haut des toits sur les troupes royales qui
oseront s’éloigner du Louvre. Bientôt elles sont contraintes de s’enfermer
dans ce palais.
Le roi
terrifié fait proposer un accommodement au duc de Guise. Il exige que son
titre de lieutenant-général du royaume soit confirmé par le souverain ; que
le prince rende un édit qui déclare les Bourbons, non engagés dans les ordres,
incapables de succéder aux Valois ; que cet édit soit enregistré, sans le
moindre délai, au parlement de Paris ; que les troupes de la maison du roi
soient licenciées ; que les Parisiens reçoivent des sûretés, pour l’avenir,
et que six places de guerre soient immédiatement livrées à la ligue.
Le roi
eut la bassesse de se soumettre à ces conditions infamantes. Mais il sortit
furtivement de Paris, et on ignore encore dans celte ville, où il s’est réfugié.
Le duc
de Guise est maître, en ce moment, du Louvre, de la Bastille, de l’Arsenal,
des deux Châtelets, du Temple, de l’Hôtel-de-Ville, de Charenton, Saint-Cloud,
Pontoise, Corbeil et du cours de la Seine.
« Hé
quoi, m’écriai-je, il est tout puissant à Paris ; il a réduit son souverain
à prendre la fuite, et il n’ose se faire proclamer roi. J’ai bien jugé cet
homme : il n’a pas plus d’énergie que de religion. Mais comment se fait-il,
André, que tes vêtemens soient dans ce triste état, puisqu’on ne s’est pas
battu ? — Cela pouvait arriver, Monsieur, et vous savez que je n’aime ni
le fer, ni la poudre à canon. Quand j’ai entendu sonner le tocsin, je me
suis blotti dans le grenier de Mortier ; je m’y suis caché sous de
vieux
bois, et les clous et la poussière m’ont mis dans l’état où vous me voyez.
« —
Oh, ce duc de Guise, ce duc de Guise ! L’ambition, l’orgueil, l’audace et
la pusillanimité percent dans toutes ses actions ! — Monsieur, vous vous
êtes formé sur ce prince, une opinion que beaucoup de gens partageront avec
vous ; mais qui, permettez-moi de vous le dire, ne me paraît pas fondée.
— Pourquoi cela, André ?
« —
Monsieur, je n’ai pas passé trois jours dans le grenier de Mortier. J’ai
vu, j’ai écouté et j’ai réfléchi. Le duc a nommé le cardinal de Bourbon premier
prince du sang, et il en a fait l’héritier de la couronne. Peut-il la mettre
sur sa tête avant la mort de ce prélat, courbé sous le poids des années ?
Je crois, d’ailleurs, que ce coup d’éclat, qui n’est prévu de personne, pourrait
l’exposer aux plus graves dangers. J’ai reconnu que le cardinal est aimé
des ligueurs. Mais les seize forment un parti très-puissant dans la capitale,
et vous savez, mieux que moi, Monsieur, qu’ils sont vendus au roi d’Espagne,
dont les intérêts sont opposés à ceux du duc de Guise. Enfin, le parlement
de Paris s’est prononcé hautement contre la journée des barricades. Le duc
a donc les plus fortes raisons d’attendre, et il attend. — Mon cher Antoine,
me dit Colombe, on ne se battra donc que contre les huguenots, et ils se
tiennent dans le midi de la France. Cette maison, ces alentours si jolis,
que tu t’es complu à élever et à embellir pour moi, continuera d’être l’asile
du bonheur et de la paix. Mais plus de voisins, mon tendre ami. Que nous
faut-il à tous deux ? de l’amour, et dans notre intérieur des occupations
que le moment fera naître : on fait toujours avec plaisir ce qui n’a pas
été arrêté de la veille. Je reconnais, et j’avoue humblement que mes statuts
étaient plutôt l’ouvrage de
ma
vanité que de ma raison. Pardonne-moi, mon cher ami, d’avoir voulu être législateur
à dix-neuf ans. Je ne m’en souviendrai que pour être modeste à l’avenir,
et me borner à répandre sur ta vie le bonheur dont tu embellis la mienne.
Prions sainte Colombe et saint Antoine d’éloigner de nous le théâtre de la
guerre ; de nous maintenir dans ce calme de l’âme, si préférable aux jouissances
orageuses des passions ; de veiller sur le fruit précieux que je crois porter
dans mon sein ; de nous faire la grâce de l’élever dans la religion catholique,
apostolique et romaine, et dans la haine des huguenots. ».
J’étais
muet d’étonnement ; j’étais ivre de plaisir… « Serait-il vrai, ma Colombe
? une nouvelle source de jouissances s’ouvrirait pour nous ! Ah, parle, mon
ange, confirme le bonheur que tu viens de me laisser pressentir. »
Nous
rassemblâmes, nous commentâmes les observations qu’elle avait faites. J’en
conclus que je pouvais prétendre à l’honneur, à la félicité d’être père.
Nous
avions chanté un te Deum le jour de notre mariage ; nous en chantâmes
un second pour en célébrer les suites heureuses. Colombe envoya notre valet
acheter à Arpajon le plus gros cierge qu’il y trouverait ; elle fit une couronne
qu’elle orna de ce qu’elle avait de plus précieux ; elle prit une jupe de
velours, dont elle se parait aux grands jours, et nous courûmes ensemble
à l’oratoire du bosquet.
Nous
décorâmes saint Antoine de la parure qui lui était destinée : jamais, de
son vivant, il n’avait été si beau. Nous allumâmes le cierge qui venait d’arriver,
et nous chantâmes des cantiques d’action de, grâces, que nous adressâmes
à mon patron : c’est à lui que je devais tout ce qui m’était arrivé
d’heureux,
depuis qu’il m’avait fait naître. C’est lui qui me donnera un fils qu’il
conduira, par la main, à la béatitude- éternelle. Ainsi soit-il.
André
suivait tous nos mouvemens. Tantôt il souriait : tantôt il paraissait rêver.
« Ah, dit-il, ce qui fait le bonheur d’une femme en jette une autre dans
d’étranges embarras, et une cérémonie de plus ou de moins fait toute la différence
que la société établit entre elles. — Une cérémonie, André ! dis un sacrement.
— C’est une terrible chose, Monsieur, que la force des circonstances ! Vous
avez été marié deux fois, et vous vous en félicitez ; je ne l’ai été qu’une,
et j’ai lieu de m’en repentir : une femme qui fait des enfans avec monsieur
Scaramouche !...
« Ah,
quelle idée me frappe en ce moment !.... Comment ne s’est-elle pas présentée
plutôt ! J’ai épousé une huguenote, et je suis catholique. Un ministre huguenot
nous a mariés à la Rochelle, et ce mariage-là est nul, de toute nullité aux
yeux de l’église P romaine. — Tu as raison, André. Cette union-là n’était
qu’un concubinage. — Le légat qui a relevé madame de ses vœux, peut, à plus
forte raison, me déclarer libre. »
Je voyais
clairement où André en voulait venir. Mais le succès de ses démarches me
paraissait fort incertain. Le duc de Guise avait eu besoin de moi, et il
m’avait fait rendre Colombe. André ne pouvait lui être d’aucune utilité,
et qu’est-ce qu’un homme inutile aux yeux d’un grand seigneur ?
« Hé,
Monsieur, je n’ai pas besoin du duc de Guise. Vous savez que les obstacles
ne m’effraient pas, et que je sais les surmonter. »
André
concevait facilement, et il exécutait de même. « Vous avez terminé, Monsieur,
votre mémoire contre le Béarnais. Il est écrit avec éloquence, et fort en
raisonnemens théologiques. Je vais à Paris, je le présente à la Sorbonne,
et je m’en déclare l’auteur. La Sorbonne me proclame une colonne de la Religion
; elle me présente au légat, ou à l’archevêque, ou à un de ses grands-vicaires,
le reste va de suite. — Mais, André, cette marche-là ressemble singulièrement
à de l’intrigue.
« —
Hé, Monsieur, ne sommes-nous pas tous, plus ou moins, des intrigans ? Tout
homme a un but. Il faut bien qu’il prenne un détour, quand il ne peut pas
y arriver en ligne droite. Par où avez-vous passé, vous-même, pour parvenir
jusqu’à Madame ?
« —
Monsieur André, je fais une autre réflexion. — Laquelle, Monsieur ? — Mon
mémoire est un chef-d’œuvre. — Je le sais bien, Monsieur. — Et vous voulez
vous en attribuer l’honneur !
-
Vous voyez, Monsieur, que je ne peux pas
faire autrement.
-
Je ne le souffrirai pas. — Ah, Monsieur !
— J’ai fait d’excellens ouvrages : les franciscains et madame la maréchale
me l’ont dit. Ils sont tous perdus ; celui-ci serait imprimé, et je n’y mettrais
pas mon nom ! — Monsieur, par grâce.... — Je ne vous sacrifierai pas ma réputation.
— Hé, Monsieur, souvenez- vous... — Monsieur André, vous êtes trop exigeant.
— Vous n’avez pas la moindre complaisance, et cependant... — Quel ton vous
prenez, Monsieur ! — Le vôtre est celui d’un homme qui croit n’avoir plus
besoin de mes services. — Vous osez m’accuser d’ingratitude ! — Jugez-vous,
Monsieur. »
Colombe
était présente, et elle n’était pas lettrée. Elle me représenta que je ne
devais pas tenir aussi fortement à douze ou quinze pages d’écriture, et,
qu’avec ma facilité, je réparerais facilement cette perte. « Hé, croyez-vous,
ma chère amie, qu’on
puisse
renoncer à la satisfaction d’être imprimé pour la première fois, et qu’un
auteur soit toujours en verve ? — Mon bon Antoine, fais de petits contes
bien gais, bien moraux, bien catholiques, pour amuser notre enfant, quand
il saura lire. Tu les feras imprimer. Ton mémoire, contre le Béarnais, ne
sera recherché que par les théologiens ; tes contes seront utiles aux Français
de tous les partis, et il est beau d’être le précepteur de la génération
qui s’élève. Permets à André de prendre ton mémoire. Tu le veux bien, n’est-ce
pas, mon Antoine ? fais cela pour moi, mon bon ami. »
Je ne
répondais rien. Colombe me caressa les joues, et me donna cinq à six baisers
bien tendres. André conclût de mon silence que, qui ne dit mot, consent.
Il mit mon manuscrit sous son bras, et un moment après il était à cheval.
Il partit au galop, il craignait sans doute que je le rappelasse. J’en avais
bien envie ; mais Colombe était là, et elle a une manière de me regarder
quand elle veut quelque chose !
Dès
le lendemain, le plancher de notre chambre à coucher était chargé de toile.
Colombe, une aune d’une main, et de grands ciseaux de l’autre, mesurait,
taillait. Son grand sérieux annonçait une opération importante. « Que fais-tu
donc là, ma Colombe ? — Une layette, mon bon Antoine. Commence un conte.
— Comment l’intitulerai-je ? — Je ne sais pas, mon ami.
— Ah,
le premier pas de l’enfance dans la voie du salut. — C’est cela, c’est
bien cela. »
Nous
avions le temps de faire dix layettes, et autant de volumes de contes, avant
que nous fussions trois. Mais, qui n’a pas cru hâter le moment désiré, en
s’en occupant d’avance ? quel amant n’a pas regardé vingt fois son cadran
solaire, pendant la journée dont la fin lui promet le bonheur ? quelle
jeune
fille n’a pas été tentée de se parer en se levant, pour un bal qui ne doit
commencer qu’à trois heures après midi ? quel ambitieux n’a pas étudié, pendant
des jours entiers, les révérences qu’il doit faire au moment où il sera présenté
à la cour ? Tous accusent la lenteur du temps, et leur impatience, leurs
murmures n’en accélèrent pas la marche.
J’écrivais,
j’écrivais, et je ne faisais rien de bon. Je sentis bientôt qu’il faut se
faire enfant, quand on écrit pour l’enfance, et, cela me parut difficile.
Que d’auteurs consultent plutôt, en prenant la plume, leur vanité ou leur
intérêt, que les dispositions qu’ils ont reçues de la nature ? Au reste,
je me rassurai, en pensant que je pourrais revoir, corriger, et même refaire
mon ouvrage, avant qu’il pût être utile.
Claire
avait des heures de loisir, depuis que nous lui avions donné des aides. Elle
ne paraissait jamais devant nous, lorsqu’André était à la tour. Elle se trouvait
désœuvrée, et elle vint, avec de petites grâces, qui lui étaient naturelles,
demander à Colombe la permission de travailler avec elle.
Je la
regardais, je l’examinais attentivement, et mon talent pour l’observation
me fut utile encore dans cette circonstance. Je la jugeai plus avancée que
Colombe, et j’arrangeai un plan de conciliation, pour l’instant où la chose
éclaterait. Il était évident qu’elle avait précédé le fameux serment prononcé
devant l’image de mon patron ; qu’André ne voulait se faire déclarer libre,
que pour s’attacher plus étroitement à sa Claire ; qu’ainsi la sainte colère
de Colombe manquerait d’aliment, et que mes représentations éviteraient à
mon ami des scènes, aussi fâcheuses pour moi que pour lui.
A
la fin du huitième jour, André rentra dans mon château, triomphant et joyeux.
Je vis, avec un plaisir inexprimable, qu’il joignait un bon cœur aux qualités
que je lui connaissais déjà.
Après
s’être reposé un moment, il commença l’histoire de son voyage. Claire laissa
tomber son aiguille, et porta la tête en avant, pour mieux entendre : elle
craignait de perdre un mot.
« Mon
premier soin, en arrivant chez Mortier, fut de présenter à la Sorbonne une
requête, tendante à obtenir la permission de faire imprimer un mémoire contre
le Béarnais. Le titre piqua la curiosité de Messieurs les docteurs. Ils me
répondirent, à l’instant, que l’intention de l’auteur était louable ; mais
qu’ils ne pouvaient approuver l’impression de l’ouvrage, avant que de l’avoir
entendu, et que j’eusse à me rendre en Sorbonne le lendemain à huit heures
du matin.
« Je
trouvai mes docteurs, en longue robe fourrée, rangés circulairement autour
d’une table, devant laquelle le doyen d’âge me fit signe de m’asseoir.
« On
lit toujours avec confiance un ouvrage dont on est sûr, et je tenais votre
chef-d’œuvre. » Je crus devoir interrompre le narrateur, par une profonde
inclination. « Je me sentais animé, et par ce que je lisais, et par la
satisfaction qu’exprimaient les vieilles figures de mes docteurs.
« Quand
j’eus terminé ma lecture, on me fit passer dans un cabinet voisin, pour que
mes théologiens pussent délibérer librement. Je m’ennuyai là pendant une
heure au moins, et je fus appelé pour entendre l’arrêt de la docte assemblée.
«
Le doyen me déclara qu’on n’avait trouvé, dans l’ouvrage, aucune proposition
mal sonnante et sentant l’hérésie ; qu’il était écrit avec pureté, élégance,
et rédigé dans les vues les plus utiles à la Religion. Il me demanda si j’en
étais l’auteur. Je répondis affirmativement. » Ici, je ne pus m’empêcher
de froncer le sourcil.
« Je
racontai ensuite mon histoire, et celle de madame Scaramouche. Je suppliai
l’assemblée de vouloir bien intervenir auprès des puissances ecclésiastiques,
pour me faire débarrasser de celle femme-là.
« L’ouvrage
que vous venez de nous lire, me dit le doyen, d’un ton sévère, est d’un théologien
consommé. Si vous en étiez l’auteur, vous sauriez que votre mariage est nul,
absolument nul. Vous avez trompé l’assemblée. Je crus mon affaire manquée.
Cependant, je ne désespérai pas de désarmer mes juges par ma sincérité :
vous savez, Monsieur, que je ne désespère jamais. Je nommai M. de la Tour.
» Je sentis un sourire de satisfaction errer sur mes lèvres.
« On
inscrivit au bas de votre mémoire un permis d’imprimer et de distribuer,
conçu dans les termes les plus flatteurs. C’était beaucoup pour vous, Monsieur.
Ce n’était pas assez pour moi. Je rappelai madame Scaramouche en scène.
« Annonçons
à tout l’univers catholique, dit gravement le doyen, ce que pense l’auguste
Sorbonne de ces ministres de Baal, qui singèrent d’unir des enfans d’Israël
à des filles madianites. Donnons à cet homme une déclaration authentique
et motivée qui le déclare libre, entièrement libre. Exhortons tous les prêtres
catholiques à le considérer comme tel ; à le marier selon les lois de l’Église,
lorsqu’il se présentera au pied
des
autels avec femme élevée, comme lui, dans notre sainte Religion, et après
qu’il se sera préalablement purgé, par la confession, du crime de concubinage.
« Le
vieux docteur m’exhorta ensuite à ne pas omettre, dans ma confession, le
péché de mensonge que j’avais commis devant la respectable assemblée ; à
ne jamais oublier que ce péché est une indignité dans la bouche d’un bon
catholique, qui doit, s’il le faut, mourir pour la foi, plutôt que de la
trahir par un mensonge.
« Après
ces réflexions, recommandations et exhortations, dont je me serais fort bien
passé, j’emportai gaîment toutes mes pièces, et je courus dans les ateliers
des imprimeurs. L’un tenait, sous presse, un manifeste du roi contre Calvin
et ses suppôts, et un écrit politique et anti-catholique de Duplessis- Mornay
; un autre tirait l’histoire de vingt ou trente miracles nouveaux, faits
exprès pour confondre les mécréans, et les poésies de l’hérétique Buchanan
; un troisième imprimait le mandement de monseigneur l’archevêque, qui défend
de manger du beurre et des œufs pendant le carême prochain : moyen certain,
pour les catholiques, de battre les huguenots. À côté de la presse qui gémissait
sous le mandement, j’en vis une autre qui criait sous une édition nouvelle
des œuvres de Théodore de Bèze. Je conclus de tout cela, que l’autorisation
de la Sorbonne n’était qu’une chose de forme, qui tenait uniquement à maintenir
des droits, dont l’origine se perd dans la nuit des temps, et que peut être
elle n’a jamais exercés, sans opposition, que sous François premier. J’en
conclus encore que les imprimeurs sont des fripons, toujours prêts à souffler
le froid et le chaud...., pour de l’argent.
«
Je tombai enfin chez un pauvre diable, qui avait une femme malade et quatre
enfans. Il manquait d’ouvrage, quoiqu’il n’y ait que sept imprimeurs dans
Paris. Les catholiques lui reprochaient d’avoir réimprimé les psaumes de
Marot, il y a dix ans, elles huguenots, de perdre son temps à soigner sa
femme. L’esprit de parti se fait des armes de tout.
« II
me demanda si je voulais corriger les épreuves. Je lui répondis que je n’étais
pas expert en celle matière, et que, d’ailleurs, c’était son métier. J’avais
remarqué, chez ses confrères, que les protes se mêlent particulièrement du
travail matériel, et de régler la banque, à la fin de la semaine. J’avais
compris de quelques mots, échappés à ces messieurs, qu’ils tiraient souvent,
pendant que les épreuves étaient chez les auteurs. J’inférai de là, qu’il
était fort inutile que je me fatiguasse à faire un métier que je n’entends
pas.
« Hier
matin, j’ai reçu mon édition complète. Le ballot est là ; mais j’en ai tiré
un exemplaire que j’ai voulu avoir le plaisir de vous présenter moi-même.
« Voyez,
Monsieur : Mémoire contre le Béarnais, par M. de Mouchy de la Tour. »
Je ne
tins pas à ce dernier trait-là. Je pressai André dans mes bras, et je l’embrassai
du fond du cœur.
Claire
le regardait du coin de l’œil. Elle semblait attendre encore quelque chose.
Il la comprit.
« Vous
savez, Monsieur, que je connais le prix du temps, et que je n’en perds jamais.
En revenant de Paris, je me suis arrêté chez le curé d’Arpajon, et je lui
ai présenté la cédule de la
Sorbonne.
Il en a approuvé hautement le contenu, et il m’a solennellement promis de
publier, dimanche prochain, mon premier ban de mariage avec Claire. »
Claire
sourit ; Colombe fit un mouvement de surprise et de joie. « Madame n’a pas
oublié que nous avons juré, entre ses mains, de nous unir aussitôt que les
circonstances le permettraient. Je n’ai violé de mes sermens que celui de
fidélité que j’ai prêté à madame Scaramouche ; mais il n’était pas tenable.
»
Colombe
voulait chanter un Te Deum encore. Je lui représentai que la journée
était fort avancée, et que cela pouvait se remettre au lendemain. La gaîté
brillait dans tous les yeux, et nous soupâmes tous ensemble. Colombe permit
à la future madame André de se mettre à table avec nous, mais sans que cela
tirât à conséquence. Tel mari est souvent caressé par les grands, chez qui
sa femme n’est pas admise. Qu’est-ce que cela prouve ? Que les grands sont
quelquefois bien petits. Mais comment nommer la condescendance du mari ?...
— Bassesse.

Le
château de Brunehaut vers 1902
CHAPITRE
XXII
Détails
de ménage.
M.
de la Tour est député aux États-Généraux.
Ce jour
était un grand jour pour André, pour Claire, et même pour nous. Claire était
mise avec une élégante simplicité ; André avait soigné sa toilette ; Colombe
était dans tous ses atours ; je m’étais paré, avec une recherche toute particulière
: j’étais bien aise qu’on demandât autour de moi qui j’étais, et d’entendre
répondre : C’est le seigneur de la Tour.
Nous
nous rendîmes à Arpajon, avec la plus grande pompe. Nous et les futurs époux
étions dans ma voiture ; nos domestiques, mon fermier et sa famille s’étaient
arrangés, très- proprement vêtus, dans la charrette couverte de la ferme.
Deux ménétriers d’Arpajon marchaient en tête du cortège. Le son de leurs
instrumens invitait les amateurs des belles choses à se grouper autour de
nous.
L’église
était décorée de guirlandes de fleurs, et le célébrant nous attendait à l’autel,
revêtu de la belle chasuble de damas, galonnée en cuivre.
Certains
mariés seraient fort embarrassés de produire leur père et leur mère : il
leur en faut cependant, au moins ce jour-là. Je représentai le papa de Claire,
et ma charmante Colombe, la maman d’André.
Le curé
prononça, selon l’usage, un discours sur les devoirs des époux. Il n’hésita
pas un moment, par une raison très- simple : il le répétait peut-être pour
la millième fois. On n’a pas d’esprit tous les jours ; quelquefois, même,
on n’en a jamais, et quand on a trouvé ce qu’on peut dire de mieux, on fait
bien de s’en tenir là.
J’examinais
les physionomies des mariés. Je n’y trouvais rien du délire qui annonce cet
amour violent, qui fait tant de bien et tant de mal. Il y a tant de motifs
qui poussent au mariage, depuis le grand seigneur jusqu’au sabotier ! c’est
l’ambition, la nécessité d’apaiser des créanciers, le désir de remonter sa
maison pour les uns ; un bout de pré, une vache de plus, pour les autres
; quelquefois, un besoin naturel détermine. Mais cette sensation s’use promptement,
quand elle n’est pas soutenue par un sentiment exclusif, enivrant, qu’on
ne peut comparer à aucun de ceux qu’on a éprouvés pendant le cours de sa
vie. Tel fut celui qui m’unit à Colombe. Je ne vois dans presque tous les
autres mariés, que des gens qui ne se conviennent pas, qui se gênent, qui
s’évitent, qui cherchent ailleurs des jouissances qu’ils ne trouvent pas
chez eux, et à qui leur existence paraîtrait insupportable, s’ils ne pensaient
souvent, le mari, à l’emploi qui fut le prix de sa main, la femme, au rang
que lui a donné le mariage.
Une
salve de mousqueterie nous attendait à la sortie de l’église. C’est une manière
obligée de témoigner aux mariés, la part qu’on prend à leur bonheur, supposé,
au moins, et de leur
tirer
de l’argent. André se comporta noblement dans cette circonstance ; mais un
maladroit creva un œil à mon plus beau mulet. Il est convenu qu’on ne calcule
pas, un jour de mariage ; le lendemain c’est tout différent. Je n’étais pas
le marié ; mais le seigneur de la Tour ne devait pas s’arrêter à un œil de
plus ou de moins. Cependant il fallut dételer la pauvre bête. Les petits
payent toujours les plaisirs des grands.
Un maréchal
d’Arpajon s’empara de mon mulet, et mon cheval était à la tour ; il n’y en
avait qu’un à la charrette du fermier ; il fallut que les mariés, le seigneur
et la dame châtelaine s’en retournassent à pied, ce qui blessait directement
un usage consacré par le temps : il faut aller à l’église en voiture, et
en revenir de même, dussent les nouveaux époux n’avoir pas de pain le lendemain.
C’est
peu de chose que les frais de voiture ; mais le dîner de noce ! C’est là
ce qui épuise la bourse du pauvre ; mais, dans toutes les classes de la société,
on veut représenter.
Le seigneur
et madame, marchaient avec la gravité convenable à leur rang; les mariés
sautillaient au bruit des deux violons; les gens du village formaient des
rondes autour d’eux. Je prévis que la cave de M. de la Tour allait recevoir
un échec ; mais je pensai que probablement André ne se marierait plus.
Il était
midi, quand nous rentrâmes à mon château. À propos de dîner de noce, nous
remarquons que rien n’est préparé. Personne de nous n’y avait même pensé.
Ne pas dîner un jour de noce ! cela est dur, Claire murmurait que son père,
le porte- faix, et sa mère, la poissarde, avaient fait, le jour de leur mariage,
un repas somptueux, dont ils parlaient avec enthousiasme, les jours où ils
ne se battaient pas, et madame
André
n’avait pas seulement un poulet rôti à offrir à M. et madame de la Tour !
Le seigneur et la dame châtelaine lui répondirent qu’ils avaient pris leur
parti là-dessus.
Mais
une trentaine de personnes, et les ménétriers attendaient le banquet nuptial.
André avait toujours un expédient à son service. Il prit quatre des plus
vigoureux de la bande, leur fit monter une pièce de vin de la cave ; leur
aida à la rouler dans les bosquets, et à la mettre debout. Il la défonce
d’un coup de masse, fait venir des pots pour les élèves de Sylène, et des
tasses pour les plus modérés. « Dansez et buvez un coup, leur dit-il, pendant
qu’on apprêtera le dîner. Il sera, je crois, deux heures quand on se mettra
à table ; vous en aurez meilleur appétit. À deux heures, me dit-il, ils seront
ivres, et qui dort, dîne. Nous voilà débarrassés de ceux-là. »
Je m’étais
marié à Limoges, d’une manière extraordinaire. M. Dupont nous avait donné
un asile, et toute la ville ne pouvait tomber chez lui ; d’ailleurs, nous
avions été unis par monseigneur, et un évêque n’est pas un coureur de dîners.
Il existait un usage antique que je ne soupçonnais pas, ni André non plus.
Le prêtre, qui prononce le ego vos conjungo, assiste de droit au banquet,
à la suite duquel il bénit le lit nuptial. Ici, sa bénédiction était inutile,
puisque la mariée, coiffée du chapeau virginal, était, grosse de trois mois.
M. le
curé d’Arpajon parut au moment où nous pensions le moins à lui. C’est le
diable, me dit André. Il nous trouva tous quatre, mangeant une copieuse omelette
et une salade. Il fit une mine, mais une mine ! compter sur un festin, et
ne trouver que des œufs ! « Monsieur, lui dit André, quand une cuisinière
se marie, elle n’a pas le loisir de se mêler du dîner ; d’ailleurs, nous
profitons, comme vous le voyez, de l’instruction pastorale
que
vous nous avez débitée avec tant d’onction. Nous commençons à sanctifier
le mariage, en faisant maigre aujourd’hui ; mais il n’est pas juste que l’Eglise
perde ses droits : veuillez accepter ce doublon d’Espagne. Demain, le repas
de noce serait digéré, et avec cette pièce d’or, un homme sobre, comme vous,
vivra le reste de la semaine. — Vous avez parbleu raison, M. André. À l’avenir,
je percevrai de l’argent, selon la fortune des conjoints, et la pompe qu’ils
voudront mettre à la cérémonie. Ce n’est pas que je prétende vendre un sacrement
; je recevrai le prix convenu à titre d’honoraires. Quel dommage que M. de
la Tour soit marié ! ce jour-là m’eût valu au moins vingt livres. »
M. le
curé se retira très-satisfait. Je le reconduisis jusqu’à la porte, où il
me combla de politesses et de révérences. « Je crains bien, nous dit André,
d’avoir ouvert au clergé une nouvelle branche d’industrie. » En effet, l’exemple
de M. le curé d’Arpajon fut promptement suivi par messieurs ses confrères
des environs. Bientôt, la rétribution pécuniaire fut perçue dans toute la
France, et au moment où j’écris, on marchande à la sacristie, un mariage
ou un enterrement, comme une poularde au marché.
« —
André ? — Monsieur ? — Vous nous chercherez une nouvelle cuisinière. — Pourquoi
cela, Monsieur ? Parce que vous avez mal dîné hier ? — Non, André. C’est
parce que la femme de mon ami, de mon homme de confiance, ne doit paraître
désormais à la cuisine que pour y donner des ordres. — Monsieur, personne
n’ira y chercher ma femme, et à cet égard, votre amour-propre n’a rien à
craindre. — Mais les personnes de notre connaissance sauront — J’aime mieux
leur entendre dire que madame André est une bonne cuisinière, qu’une
bourgeoise
gauche, et par conséquent ridicule. — Mais sa vanité... — La fille d’un porte-faix
doit se trouver satisfaite de jouer le premier rôle subalterne au château
de la Tour. — Mais, toi-même... — Moi, Monsieur, je ne connais que deux classes
de femmes : celles qui sont jolies, et celles qui ne le sont pas. Or, madame
André est incontestablement de la première classe. Que m’importe, à moi,
que ses jolies formes soient cachées sous la soie, ou sous le lin ?
« Tenez,
Monsieur, on ne rencontre, dans le monde, tant de gens tourmentés ou malheureux,
que parce que chacun veut s’élever au-dessus de son état. Si cette manie
pouvait réussir, tous les hommes monteraient indéfiniment, et ne laisseraient
derrière eux ni boulangers, ni vignerons. » Les Chinois sont bien plus sages
que nous : ils ne permettent pas aux enfans de quitter la profession de leur
père. Il résulte de là que chacun fait bien son métier, et alors, comme dit
un vieux proverbe, les vaches sont bien gardées. Claire restera cuisinière.
« —
Mais André, d’après ton système, que deviendrait l’émulation ? — L’émulation,
Monsieur ? dites la vanité, l’orgueil, l’ambition. Voilà les leviers qui,
malheureusement aujourd’hui, soulèvent tous les hommes. Un savetier veut
que son fils soit bottier; un paysan, que le sien soit moine ; le moine prétend
à la crosse ; le marquis vise à un duché ; le duc de Guise à un trône. Personne
n’est content, excepté nous, peut- être, qui sommes réellement heureux, par
la seule raison que nous avons cessé de vivre dans l’avenir, et que nous
jouissons paisiblement de ce que le sort a placé sous notre main. Claire
restera cuisinière. — Ma foi, mon cher André, je crois que tu as encore raison.
«
À propos, que sont devenus les buveurs et les danseurs d’hier ? — Ils n’ont
été satisfaits de leur position qu’après être tombés dans l’ivresse. Il est
résulté de là qu’ils sont retournés chez eux ce matin, malades et transis
de froid. »
Nos
journées s’écoulaient paisiblement. Notre félicité ne pouvait plus s’accroître,
puisque nous n’avions plus rien à espérer. Je n’osai demander à André si
espérer, même ce qu’on sait ne pouvoir obtenir, n’est pas déjà une jouissance.
Colombe
avait abandonné la reine Brunehaud, pour s’occuper exclusivement de sa layette.
Que fera-t-elle quand elle sera terminée ? Claire travaillait à la sienne,
à côté de Colombe, quand elle en avait le temps. André avait la direction
générale de mes affaires, et des détails de la maison. Il était toujours
occupé, et par conséquent il ne s’ennuyait presque jamais. Moi, je faisais
un conte à mon fils, je le déchirais, je le recommençais, et j’éprouvais,
parfois, un vide fatigant.
Je trouvai
un jour André s’efforçant de déchiffrer un des brouillons que j’avais jetés
dans un coin. « Monsieur, me dit-il, l’homme, dans la force de l’âge, ne
peut s’occuper, avec succès, que de ce qu’on est convenu d’appeler de grandes
choses. L’esprit humain a une tendance naturelle à se porter en avant ; il
ne rétrograde jamais. L’ouvrage que vous méditez ne peut être bien fait que
par un adulte de quinze à seize ans, heureusement organisé : à cet âge on
est encore plein des souvenirs de l’enfance, et on n’a perdu aucune des expressions
qui lui sont propres. L’enfant qui n’entend pas bien ce qu’il lit, jette
bientôt son livre, et court à sa balle ou à son cerceau. Croyez-moi, Monsieur,
cessez de ressembler à cet homme qui sautait à la lune, et qui voulait la
prendre avec les dents. Ne tentez pas l’impossible. — Que ferai-je donc,
André, car enfin il faut bien
que
je fasse quelque chose ? » Le coquin sourit. « Monsieur, me dit-il, vous
ne me faisiez pas cette question à Limoges. » Le maladroit ! Je lui tournai
le dos.
J’étais
quelquefois tenté de retourner chez Richoux. Bah, pensais-je, je m’ennuierais
là. Un homme qui ne peut parler que de la politique ; une femme qui rit de
tout ce qu’on lui dit, et même de ce qu’on ne lui dit pas ; deux grandes
filles, bêtes comme des oisons… Non, je n’irai pas chez Richoux.
Je passais
une heure auprès de Colombe ; elle ne me parlait plus que de sa layette et
de son fils. Ingrat ! t’entretenir de ces objets-là, n’est-ce pas te parler
amour ? Je l’embrassais tendrement, et j’allais à la pêche.
J’entrai
un jour dans l’oratoire de saint Antoine. Ma ferveur pour ce grand personnage
était singulièrement diminuée, depuis que je n’attendais plus rien de lui.
Je remarquai,
avec étonnement, quelques araignées qui avaient tendu leurs filets au haut
de la voûte. Je courus faire une scène à la grosse fille de cuisine ; cela
fait passer un moment. Elle prit un grand balai, et me suivit en pleurant.
« Tu pleures, mon enfant. Je me suis emporté, et j’ai eu le plus grand tort
: la colère est un des sept péchés capitaux. Prends cet écu, et pardonne-moi.
» Je sentis que j’avais fait une bonne action, et je me trouvai mieux. Je
crois que l’homme est naturellement porté au bien, et que ses passions seules
l’en éloignent. Quand Javotte fut sortie de l’oratoire, je priai. Je ne savais
que demander à mon patron, et quand on n’a pas d’objet déterminé, on est
sujet aux distractions. Je regardais machinalement le compagnon du grand
saint Antoine. Le maître vivait dans un désert, me dis-je. Il est vraisemblable
qu’un sanglier, qu’il avait apprivoisé.
s’était
attaché à lui… Un sanglier !... Les grands trouvent tant de plaisir à chasser
cette espèce de gibier ! Pourquoi ne chasserais-je pas aussi ?
Il est
incontestable que toute pensée heureuse nous vient d’en haut, et je remerciai
mon patron de celle qu’il venait de me suggérer. Je courus auprès de Colombe.
« Ma chère amie, on a besoin, dans ta position, de mets substantiels, mais
légers ; une perdrix, une caille, mettraient de la diversité dans les alimens
qu’on te sert ; je veux chasser. — Tu feras bien, mon ami. » Elle voulut
à son tour que j’admirasse un petit bonnet qu’elle venait de terminer. Il
était vraiment fort joli.
Il ne
me restait plus, pour mettre à exécution mon projet du moment, qu’à savoir
s’il y avait du gibier sur ma terre.
J’interrogeai
Thomas. « Monsieur, me dit-il, il y aurait ici de la perdrix et du lapin
en abondance, si les gens d’Arpajon n’y venaient braconner dans la saison.
— De misérables paysans osent méconnaître ce qui reste du régime féodal,
gouvernement admirable, qu’on devrait rétablir dans toute sa splendeur !
Je ferai de mon valet d’écurie un garde-chasse, et je lui ordonnerai de traîner
en prison le premier qui osera paraître sur mes terres, un mousquet à la
main. — Hé, Monsieur, ces braconniers n’ont pas tiré un coup sur votre terre,
depuis que vous y êtes établi ; d’ailleurs, ce sont des malheureux qui viennent
tuer ici quelques pièces, et qui vont les vendre au marché, pour donner du
pain à leurs femmes et à leurs enfans. — Voilà qui change singulièrement
la face de l’affaire. Je suis fier, Thomas ; mais je ne suis pas insensible
aux devoirs que m’impose l’humanité. Les pauvres chasseront sur mes terres
; mais ils me présenteront un certificat d’indigence, signé, non du bailly,
mais du curé. Les curés connaissent l’intérieur des consciences, et ils devraient
seuls
gouverner leurs communes. Cela viendra peut-être. Ainsi soit-il. »
Bon,
pensai-je, je serai le premier seigneur qui aura renoncé à ses droits. Cela
me fera bien voir du peuple. Je donnerai quelques dîners au curé. Je le crois
déjà mon ami, et je lui ferai faire ce que je voudrai. Le duc de Guise force
le roi à rassembler, une seconde fois, les États-Généraux à Blois ; il n’y
a pas de raisons pour que je ne sois point élu. Le duc composera cette assemblée
de ses créatures. Je lui ai rendu des services, qui peuvent le faire croire
à mon dévouement, et il ne mettra pas d’obstacles à mon élection. Je serai
député. Chassons, en attendant.
« André,
va à Paris. Achètes-y ce qui est nécessaire pour monter un modeste équipage
de chasse. Nous nous amuserons ensemble. — Je vous préviens, Monsieur, que
je tirerai les yeux fermés. — Hé bien, tu ne tueras rien. — Ni vous, peut-être,
avec les yeux ouverts. — Nous nous formerons ensemble. L’homme fait toujours
bien ce qu’il veut fortement faire. C’est ainsi que je serai député aux Etats-Généraux.
— Vous, Monsieur ! — Oui. Monsieur, moi-même. — Et que ferez-vous là ? —
Ma foi, je n’en sais rien. Je ferai comme tant d’autres, qui veulent être
nommés, et qui s’inquiètent peu du reste. — Il est constant que le titre
de député donne de l’éclat, et souvent de la fortune ; mais il faut savoir
choisir le parti pour lequel on votera. — Je n’aime, je n’estime pas le duc
de Guise, et je voterai pour le roi. — Ce sera très bien fait, si le duc
succombe.
— Allons,
va acheter des mousquets de chasse. »
Je me
présentai devant Colombe, avec la démarche que je crus convenable à la dignité
que j’ambitionnais, et je lui fis part de ce grand projet. Elle avait consenti
à ce que je chassasse : elle
ne
devait presque pas me perdre de vue ; mais aller à Blois, lorsque son état
actuel ne lui permettait pas de m’y suivre ! « Il fut un temps, me dit-elle,
où tu ne pouvais t’éloigner de moi un moment. Cet heureux temps n’est plus,
» et elle fondit en larmes.
Claire
pleura aussi. Je me sentais prêt à pleurer avec elles. Je me possédai cependant.
Je représentai à Colombe le nouvel éclat que jetterait sur elle la qualité
de femme d’un député.
« Ah,
me répondit-elle, je ne veux être que la femme d’Antoine. » Je l’engageai
à éloigner d’elle ces idées bourgeoises ; à penser que j’allais ouvrir à
son fils la route des grandeurs et de l’opulence. Je parlais avec chaleur,
et je parlais bien. Elle souriait à son bambin, traîné dans une superbe coche,
entouré de valets de toutes les couleurs, et se caressant la pointe de la
barbe, en regardant l’humble piéton avec dédain. Un bonheur obscur suffisait
à Colombe ; au nom de son fils, des pensées plus nobles l’occupèrent. C’est
l’histoire de toutes les mères.
Elle
me demanda comment je m’y prendrais pour me faire nommer. Je lui détaillai
mon plan, dans toutes ses circonstances. J’écrivis, sous ses yeux, un billet
d’invitation à
M. le
curé, au bailly, aux propriétaires d’Arpajon. Je n’oubliai pas même Richoux
: il n’est pas de mince levier, avait écrit le duc de Guise, qui ne puisse
être utile.
André
arriva avec un attirail, dont l’aspect seul m’embarrassa. Ce que j’y trouvai
de mieux, fut un joli chien de chasse, dont on avait garanti à André l’excellente
éducation. Nous endossâmes le harnais, et précédés de Castor, nous nous enfonçâmes
dans mes bois. Castor chassa ventre à terre ; dans une demi-heure, il parcourut
tous les recoins de ma petite forêt, et ne fit pas lever
une
perdrix. « Oh, oh, dis-je à André, je ne m’étonne plus que les braconniers
aient cessé de venir ici. Les coquins n’y ont rien laissé. — Cependant, Monsieur,
on persiffle les chasseurs, qui rentrent chez eux sans gibier. Il faut que
vous tuiez quelque chose.... Tenez, voyez-vous ce geai, perché au haut de
ce sycomore ? — Tire-le, André. — Non, Monsieur, à vous l’honneur. »
Je regardai
fixement le geai, et non le bout de mon mousquet. Je tirai, et je tuai Castor,
qui fatigué de courir, s’était couché à mes pieds. André éclata de rire.
« L’homme fait toujours bien ce qu’il veut fortement faire, me répéta-t-il,
et vous avez fortement voulu être un grand chasseur. Puissiez-vous être meilleur
député. » J’étais piqué ; mais je ne répondis pas un mot : André n’eût pas
cessé de me plaisanter. Je rentrai au château, l’oreille basse, très-basse.
Colombe me demanda où étaient les alimens substantiels, mais légers, qu’on
devait lui servir. Claire me demanda ce qu’était devenu Castor. « André,
fais mettre notre équipage de chasse au grenier, et qu’il n’en soit plus
question. »
Colombe
voulut des détails, et je m’exécutai de bonne grâce. Elle se moqua de moi
; Claire se moqua de son mari. On rit beaucoup, et cela vaut mieux que bâiller.
Nous
apprîmes, le soir, qu’une nuée de missionnaires était partie de la capitale,
avec l’ordre de se répandre sur toute la France. Ceux, qui s’étaient arrêtés
à Arpajon, devaient prêcher le lendemain. J’ai toujours beaucoup aimé les
sermons, et ceux- ci devaient me rappeler aux idées de piété, dont je m’écartais
trop souvent.
Nous
nous rendîmes à Arpajon, Colombe et moi, dans toute la pompe que nous pûmes
étaler : il faut se faire remarquer dans les églises, quand le parti du clergé
est le dominant. Avec quel zèle, quelle chaleur, quelle haine des huguenots,
quel mépris pour le roi s’exprimèrent les révérends pères ! J’étais de leur
avis sur tous les articles, à l’exception du dernier. Je dissimulai ma façon
de penser : se taire n’est pas mentir.
Je les
invitai à augmenter la nombreuse et brillante compagnie que j’attendais à
midi : quand on veut être député, il faut caresser tout le monde. Le père
Polycarpe me demanda si j’étais ce monsieur de la Tour, que le duc de Guise
avait chargé de missions importantes. Je conclus, de celte question, que
les révérends pères avaient une liste des sujets qu’ils devaient présenter
aux électeurs, chacun dans son département, et j’en augurai bien.
Claire
se surpassa ce jour-là. Elle nous donna un dîner aussi somptueux que délicat.
André avait déterré, je ne sais où, des vins fins, qui produisirent le meilleur
effet. Je remarquai que mes missionnaires, malgré leurs yeux baissés, et
leur croix de bois passée dans leur cordon, faisaient fête à tout. Cela était
bien naturel : ils s’étaient fatigués le matin, et le bon vin entretient
le velouté de l’estomac, la force des poumons, si nécessaires à un prédicateur.
De temps
en temps, le père Polycarpe levait un œil furtif jusqu’à Colombe. Il n’est
pas défendu d’admirer le père commun, dans la plus belle de ses créatures.
À la
fin du repas, je portai, à plein verre, la santé du duc de Guise. Il faut
bien se permettre ce qu’on ne doit pas se dispenser de faire, et puis, je
n’avais pas de raisons de désirer
que
le duc de Guise fut malade. D’ailleurs, j’avais ma restriction mentale :
je bus mon verre, d’un trait, au roi, très- zélé catholique. C’est une chose
admirable qu’une restriction mentale. Elle arrange tout.
À la
fin du repas, les missionnaires assurèrent nos autres convives que j’étais
une des colonnes de la sainte ligue, et qu’ils ne pouvaient se dispenser
de me donner leurs voix. Tous le jurèrent, en prenant le petit verre d’eau-de-vie
brûlée.
Les
missionnaires devaient prêcher, le soir, sur l’abomination de certains hommes,
qui s’unissent à des filles huguenotes, et qui croient leur mariage valide.
Il fallut se séparer ; mais mes convives promirent de se réunir chez moi,
quatre jours après. Je m’étais aperçu que c’est avec des dîners qu’on gouverne
les hommes.
« Vous
serez député, me dit André, quand nous fûmes seuls. N’allez pas tuer le roi,
en voulant le servir contre le duc de Guise. Souvenez-vous de Castor. » Cette
plaisanterie me parut du plus mauvais goût, et je tournai encore le dos au
pédagogue. Cela dispense de répondre.
Cependant
André m’était nécessaire, dans mes momens de loisir, et j’en avais beaucoup.
Je me rapprochai de lui. On sent bien que nos conversations roulaient toujours
sur l’objet dont j’étais exclusivement occupé. André prévoyait une grande
catastrophe. « Au reste, dit-il, il n’est pas étonnant que des révolutions
politiques agitent, tourmentent les hommes, puisque la terre, dont ils émanent,
est sujette à des bouleversemens épouvantables. » — Les hommes émaner
de la terre !
« Monsieur
André, cette opinion est matérialiste au premier chef. — Il est bien
étonnant que ceux qui se piquent de
pratiquer
rigoureusement leur religion, en oublient les premiers élémens. Souvenez-vous,
Monsieur, que le premier homme fut fait de terre et de salive. — Fort bien
ergoté, fort bien. Tu aurais été, si tu l’avais voulu, un père Polycarpe,
ou un Théodore de Bèze. Mais quelles sont ces grandes catastrophes de la
terre, que les hommes imitent en petit, quand il leur plaît de s’égorger
?
« —
Vous savez, Monsieur, que les grandes masses de pierre ne se forment jamais
à la surface du globe. La terre les élabore dans ses entrailles, et cependant
nous avons vu, dans nos voyages, d’énormes roches calcinées, qui semblent
avoir été jetées ait hasard les unes sur les autres. Or, le mot hasard est
vide de sens. Le feu central, comprimé, gêné dans son action, s’est fait
jour avec une extrême violence, et a lancé, dans l’espace, tout ce qui lui
opposait de la résistance. Ainsi, nous avons vu des traces de violens tremblemens,
qui ont agité la terre jusqu’en ses fondemens ; ainsi les révolutions politiques
précipitent les hommes les uns sur les autres.
« On
peut reconnaître partout des marques de volcans éteints ; ainsi le noyau
du feu central a subi de fortes diminutions. La chaleur est l’unique principe
de la vie. D’après cela, toutes les espèces d’animaux doivent dégénérer,
et dégénéreront jusqu’à ce que le globe soit refroidi au point de ne pouvoir
plus rien produire. La chaleur du soleil, que rien n’attirera plus, sera
sans puissance sur une masse inerte, et ce qui restera d’hommes périra. —
Ce sera la fin du monde, annoncée dans les écritures.
« Les
vérités, que je viens de vous exposer, sont faciles à vérifier. Descendez
dans un puits, pendant les chaleurs de la canicule. Vous y éprouverez une
fraîcheur, qui bientôt vous sera insupportable. Parcourez les côtes
qui bordent la mer
glaciale.
Vous y trouverez, presque partout, une nature stérile, ou morte. Le petit
nombre d’hommes que vous rencontrerez épars, çà et là, sont d’une petite
stature, et leurs facultés intellectuelles sont bornées comme leur individu.
« Après
avoir examiné, en passant, les ravages qu’a faits le feu, arrêtons-nous,
un moment, aux désastres occasionnés par l’eau. Le feu central lui-même a
pu en être la cause principale. Il est très-vraisemblable que l’Europe a
été unie à l’Afrique, par un isthme que le temps a brisé, et qui est aujourd’hui
le détroit de Gibraltar. Cette langue de terre a été, pendant des siècles,
minée par les flots, et un tremblement de terre a achevé de la précipiter
au fond de la mer. Alors l’océan furieux s’est roulé dans des régions plus
basses que son lit. Il a englouti des villages, des villes, des provinces,
des royaumes ; il a formé ce qu’on appelle, improprement, la mer Méditerranée.
Ce n’est que le plus grand des lacs, qui, comme les autres, de moindre étendue,
n’a ni flux ni reflux.
« Quelle
désolation, quelle terreur a dû répandre, dans le reste du monde, une catastrophe
terrible, dont le souvenir s’est perdu dans la nuit des siècles qui se sont
écoulés ! L’isolement de la Sicile, produite par le Vésuve ou l’Etna ; celui
de l’Angleterre, occasionné peut-être par la même cause, ont ajouté aux terreurs
qui tourmentaient l’espèce humaine. L’homme, rongé d’inquiétudes, en proie
à des alarmes continuelles, ne portait plus le pied qu’en tremblant sur cette
terre qui lui avait donné la vie, et qui le menaçait sans cesse de la lui
ravir.
« Que
de traditions terrifiantes ont passé de génération en génération ! Que de
fables l’imagination humaine a dû ajouter à des horreurs trop réelles ! une
catastrophe nouvelle a fait oublier celle-là, et l’a été à son tour.
«
Et nous marchons avec confiance sur des ruines ! des hochets, des places,
des cordons, des amourettes nous occupent exclusivement, et demain, ce soir,
notre dernière heure peut sonner. — Tâchons donc, mon cher André, d’être
toujours en état de grâce.
« Mais
sais-tu que c’est de la très-haute philosophie que tu viens de faire là ?
» — Monsieur, je pense rarement, parce que cela fatigue ; mais savez-vous
quel est le résultat de mes réflexions ? c’est que les passions des hommes
bouleversent le dessus, comme les volcans le dessous, et que, tout bien calculé,
ce n’est pas la peine de naître.
« Éloignons
de nous ces tristes idées : il n’y a pas tous les jours des tremblemens de
terre, ni des révolutions politiques. Caressons nos femmes, et nos enfans,
quand nous en aurons ; sablons votre bon vin ; il entretient la gaîté, et
laissons aller la terre et les hommes comme ils le pourront. »
Mon
second dîner fut aussi brillant que le premier ; même affection, même dévouement
de la part de mes convives ; même gaîté, mêmes éloges prodigués à ma cave
et à ma cuisine. Les particuliers vivaient encore sobrement, et je donnais
des repas de prince. Pendant deux jours, on ne parla dans le canton que de
ma magnificence.
Je me
croyais sûr d’être élu. Cependant je jugeai à propos de redevenir la Mouche.
J’observai ce qui se passait autour de moi, et à Arpajon. Richoux et le curé
faisaient des visites secrètes aux électeurs, et on ne se cache que lorsqu’on
a des vues auxquelles la publicité peut nuire. Ou sait que la modestie n’est
pas ma vertu d’habitude ; cependant je crus devoir faire des démarches de
mon côté. Je fis aussi des visites. C’est ainsi que,
lorsqu’il
y a une place vacante à la pléiade française, les aspirans courent
de tous les côtés, pour s’assurer des suffrages.
J’avais
remarqué que les femmes mènent leurs maris, et que les enfans mènent leurs
mères. Je ne perdis pas mon temps, à dire des choses flatteuses à des lourdauds,
dont la plupart n’étaient capables que de juger mon vin ; j’adressais des
douceurs aux dames ; je vantais les attraits, même de celles qui n’en avaient
pas, et qui voulaient bien me croire sur ma parole. Je trouvais charmans
des marmots dont les criailleries me rompaient la tête ; je leur distribuais
l’ample provision de joujoux, qu’André avait fait, venir de Paris ; je caressais
jusqu’au petit chien qui était en faveur.
Je démêlai
les désirs secrets de ces dames. Je promis à l’une une place auprès de la
reine ; à l’autre, un emploi chez la duchesse de Guise ; je changeais de
parti d’après l’opinion qui dominait dans la maison où j’entrais. Toutes
ces dames me proclamèrent un homme charmant. Quelques-unes me parurent pénétrées
de ce qu’elles me disaient de flatteur ; mais mon amour pour Colombe ; mais
la sainteté du mariage ; mais la crainte de mon patron...
Je rendais
compte de mes démarches à André. « Savez-vous, Monsieur, comment cela s’appelle,
en bon français ? — De la sagacité. — De l’espionnage, et par conséquent
de la bassesse. Vous redevenez la Mouche. — J’en conviens ; mais vous avez,
André, des expressions bien déplacées. — Réfléchissez, Monsieur, et jugez-vous.
— Je juge, je juge… que tout est permis à qui veut être député. »
Oh,
cette fois, je fus dupe de ma sagacité. Les femmes se confient volontiers
ce qui flatte leur amour-propre : c’est une
espèce
de triomphe pour celle qui parle, et celle qui écoute ne laisse pas échapper
l’occasion de prendre une revanche. Madame de la Motte fut jalouse de la
place que j’avais promise à madame Desmarais ; madame Lefort envia le joujou
que j’avais donné à la petite Tournier. Les mécontentes se rassemblèrent,
et se promirent de déterminer leurs maris en faveur de Richoux. Une petite
servante à qui j’avais donné un joli collet montant, vint me dévoiler le
complot.
« Donnez
donc des dîners, me dit André ; des dîners à trente personnes, dont le dernier
vous a coûté plus de quarante livres ! voilà de l’argent bien placé ! — Aux
grands maux, les grands remèdes. Je pars pour Paris. — Qu’y allez-vous faire
? — Tu le sauras à mon retour. »
Je montai
à cheval aussitôt. J’eus de la peine à parvenir jusqu’à M. Péricard ; mais
enfin, j’entrai dans son cabinet. On n’a pas oublié que M. Péricard était
le secrétaire intime, le premier ministre du duc de Guise. Je lui fis part
des intrigues qui agitaient Arpajon. Il manda le sieur de Maineville. « Avez-
vous envoyé des missionnaires à Arpajon ? — Oui, Monsieur.
— Capitaine
la Tour, ont-ils fait leur devoir ? — Oui, Monsieur. — Et qui sont les insolens
qui oseraient voter pour un candidat que l’autorité ne leur a pas désigné
! Maineville, que cent ligueurs, bien armés, se rendent à Arpajon, pour y
maintenir la liberté des suffrages : vous m’entendez. Qu’ils soient logés
chez les bourgeois, et qu’ils y vivent à discrétion. Qu’on me laisse seul.
»
La veille
du grand jour, cent ligueurs, cent enragés, cent diables, entrèrent à Arpajon,
le mousquet sur l’épaule, tambour battant, et le drapeau déployé.
Je
crus qu’il était dans les convenances que j’invitasse le capitaine à prendre
son logement chez moi. Je me nommai, et il accepta ma proposition ; mais
il me fit observer qu’il fallait qu’il s’occupât d’abord de ses hommes. «
Hé, où les mettrez- vous ? — Oh, je ne suis pas embarrassé ; vous allez voir.
»
Il fil
faire un roulement à son tambour. « La cause du Roi, dit- il aux curieux,
est dans un triste état ; mais il y a ici de bons royalistes qui m’aideront
à rétablir ses affaires. Je forme l’avant-garde d’une année de dix mille
hommes, commandée par le maréchal de Biron. Que le duc de Guise soit le maître
dans Paris, à la bonne heure ; mais les troupes qui s’avancent conserveront
la banlieue au souverain. Allons, mes amis ; vive le Roi ! »
Vive
le Roi ! crièrent vingt ou trente individus, qui annonçaient de l’aisance,
et qui attendaient du maréchal, qui était dans le Périgord, la conservation
de leurs propriétés.
« Ah!
canailles, vous êtes royalistes, s’écria le capitaine ! je vous corrigerai
de ce défaut-là. » Aussitôt, huit à dix soldats s’emparent de chacun des
crieurs, les font rentrer chez eux, et s’établissent les maîtres de la maison.
Je souffrais beaucoup de voir les sujets fidèles du Roi reconnus, maltraités
et pillés ; mais que pouvais-je faire à cela ? Je me tus.
Le capitaine
n’avait pas oublié mon invitation. Il me suivit, accompagné de deux de ses
soldats qui, dit-il, lui tenaient lieu de domestiques. « Ne vous gênez pas
pour me bien loger : je dors partout ; mais je tiens à la bonne chère et
au bon vin. Voyons d’abord le garde-manger.... Oh! oh, il paraît que vous
vivez bien, M. de la Tour. Je serai à merveille chez vous… Diable, vous avez
une jolie cuisinière !.... » et il appliqua à
Claire,
cinq à six baisers sur les joues, et où il put l’attraper.
« Monsieur
le capitaine, madame est ma femme. — Je vous en fais mon compliment, mon
ami, et il embrassa Claire avec une nouvelle vivacité. Son chignon lui tomba
sur les reins, et son collet montant sur les épaules. « Ce n’est rien, ce
n’est rien, la belle. Allons, la main à l’œuvre. Cette éclanche de veau à
la broche ; ces côtelettes de porc frais sur le gril ; cette carpe à la poêle,
et demain nous verrons. J’espère, mon cher la Tour, que vous et Madame me
ferez l’honneur de souper avec moi. Vous voyez que j’en use sans façon avec
vous ; mais je suis ici pour protéger la liberté des suffrages, et demain,
je vous fais député. » Oh, pensai-je, si je ne visais à l’honneur d’être
un des représentons du peuple français, il y a long-temps que je t’aurais
mis à la porte, ou que tu aurais tiré l’épée avec moi.
« À
propos, ami la Tour, M. de Maineville m’a dit que vous avez une très jolie
femme. Je vais lui faire ma cour, pendant que cette belle enfant-ci s’occupera
de nous, » et il partit, comme un trait. Je courus sur ses pas ; je le suivis,
de chambre en chambre, et enfin, nous trouvâmes ma pauvre Colombe, roulée
dans un petit arrière-cabinet, bien sombre, où elle devait se croire en sûreté.
Il allait
la traiter comme Claire, et peut-être plus mal. Je l’arrêtai par son manteau.
« Capitaine, je me suis marié pour moi. — Sans doute ; mais entre amis tout
est commun. — Je ne veux plus être député. — Tu le seras malgré toi. — Si
vous portez la main sur Madame, je vous passe mon épée au travers du corps.
— Ah ! tu es ferrailleur ! je suis ton homme. En garde. »
Colombe
jeta les hauts cris ; mais avant qu’elle fût sortie de sa cachette, le capitaine
avait reçu un coup d’épée, qui lui perça la
cuisse
de part en part. Il fut forcé de s’asseoir sur le carreau, par la raison
qu’il n’y avait pas de siège derrière lui. « Diable, me dit-il, tu es brave.
Tu mérites d’appartenir à la sainte ligue. »
J’enlevai
Colombe, je la portai dans la chambre la plus reculée de la maison. J’en
fermai la porte à double tour, et je mis la clef dans ma bourse. Je descendis
à la cuisine : Claire et André avaient disparu. Les soldats, valets du capitaine,
tournaient la broche, et faisaient marcher la grosse fille de cuisine, une
houssine à la main. Javote jurait ; les chenapans juraient plus haut qu’elle.
Mon valet d’écurie, qui avait voulu rétablir l’ordre, avait un œil poché,
et le nez cassé. Le pavé était couvert des débris de ma vaisselle ; je ne
reconnaissais plus ma maison. Je saisis un chenet au fond de la cheminée
; Bertrand, encouragé par ma présence, empoigna l’autre ; nous tombâmes sur
nos deux coquins, et nous les renvoyâmes à Arpajon, joindre leurs camarades,
dont, sans doute, les royalistes n’avaient pas à se louer. Je remontai, suivi
de Bertrand : il ne me quittait plus. « Tu m’as blessé, me dit le capitaine,
c’est fort bien ; mais ce n’est pas assez : il faut me panser maintenant.
» Mon premier mouvement fut de le prendre, avec Bertrand, et de le jeter
par la fenêtre. L’humanité l’emporta sur le ressentiment. Nous le mîmes sur
un fauteuil, qui se trouva là.
Je ne
savais où prendre ce qu’il fallait pour faire un pansement : André et Claire
avaient les clefs de tout. Bertrand, il faut trouver André. Cherche, appelle,
crie. Il s’était réfugié, avec sa femme, sur la plate-forme, au plus haut
de la maison, et ils avaient fermé la trappe sur eux. Ils parlementèrent
avec Bertrand, à travers les planches. Quand ils surent que le capitaine
était hors d’état de se remuer, et que ses valets étaient éreintés, ils descendirent.
«
Poltron, m’écriai-je, vois dans quel embarras tu m’as laissé !
— Monsieur,
je vous ai prévenu, vingt fois, que vous pouviez compter sur moi dans toutes
les circonstances, bataille excepté.
« Sacreudié,
finirez-vous de bavarder ? Qu’on me panse, et toi, petite, va soigner le
souper. — On ne soupe pas quand on est blessé. — Tu m’as donné un coup d’épée,
et tu veux encore me mettre à la diète ! Je souperai, ou le diable emportera
la maison. »
Claire
retourna à la cuisine ; André mit des compresses d’eau- de-vie sur la blessure
du capitaine ; nous le portâmes ensuite dans un assez bon lit. « À souper,
à souper !... Ah, j’ai demain une mission importante à remplir, et M. Péricard
n’est pas plaisant du tout. Monsieur le factotum, vas à Arpajon ; fais-moi
faire deux béquilles, et que demain, à la pointe du jour, elles soient au
chevet de mon lit. Informe-toi, dans le village, si mes gens ne font pas
trop de dégât. Je tiens à la discipline, et je sais la maintenir. A souper,
à souper ! »
André
partit, et le capitaine dévora ce qu’on lui servit de bon ou de mauvais.
Il but comme une épongé, et deux heures après, il eut une fièvre de cheval.
Je laissai Bertrand auprès de lui, et je fus retrouver Colombe, qui était
à peine remise des alarmes que lui avait causées cette mémorable soirée.
André
revint, et nous dit que tout était dans le plus grand désordre à Arpajon.
« Savez-vous, Monsieur, ce qui arrivera de tout ceci ? quand ces enragés-là
seront partis, les Arpajonais mettront le feu à votre château. » Cela n’était
pas impossible, et on ne dort pas, quand on est fortement préoccupé. Nous
ne fermâmes pas l’œil.
Vers
le milieu de la nuit, Bertrand vint me crier, par le trou de la serrure,
que le capitaine se mourait. Je me levai, j’appelai Javotte, et je lui fis
mettre un chaudron plein d’eau sur le feu. Le capitaine avait, pour l’eau,
une adversion insurmontable ; il refusa d’en boire. Bertrand et Javotte lui
tinrent la tête, et je l’emplis d’eau chaude, à l’aide d’un entonnoir. La
nature chercha bientôt une issue. L’eau chaude et le souper partirent ensemble,
et la fièvre se calma.
Oh,
que j’étais las de mes grandeurs à venir ! combien je regrettai les douceurs
de la vie que j’avais menée jusqu’alors ! Je ne savais quel parti je devais
prendre.
Au point
du jour, le capitaine se fit habiller par Bertrand ; à huit heures, il lui
ordonna de m’appeler. Je le trouvai, appuyé sur ses deux béquilles, faisant
des grimaces dignes d’un possédé ; mais ayant toute sa tête. Je fis mettre
les mules à la voiture ; nous l’y juchâmes, et je me plaçai à côté de lui.
Je lui
parlai, en route, du triste pronostic d’André. « Brûler ton château, un château
où j’ai été traité comme un prince, à un coup d’épée près ! Corbleu, je les
en empêcherai bien. »
Nous
descendîmes sur la place d’Arpajon. Il reprit ses béquilles ; sa physionomie
parut calme et imposante, et il souffrait beaucoup. Il faut avouer qu’il
était doué d’un grand caractère.
Il y avait
deux hommes dans ce vaurien-là.
Il fit
battre la générale. Quand sa troupe fut rassemblée, il demanda si quelqu’un
avait à se plaindre de ses hôtes. Un cri général s’éleva contre eux.
«
Oh, oh, dit-il, je vois que les soldats de la sainte ligue se sont conduits
comme des brigands. Ils sont indignes de servir une si belle cause, et j’en
ferai une justice éclatante, quand nous serons rentrés à Paris. Rendons-nous,
Messieurs, au lieu choisi pour l’élection. »
Nous
entrâmes à l’Hôtel-de-Ville. Les électeurs commençaient à s’y rassembler.
Le capitaine plaça ses soldats dans toutes les avenues. Il entra ensuite
dans la salle avec un air de dignité qui n’avait rien de gauche. «Vous vous
demandez à l’oreille, Messieurs, pourquoi je suis boiteux aujourd’hui, moi,
qui ne l’étais pas hier. En montant un escalier, assez sombre, chez M. de
la Tour, je me suis donné une entorse ; voilà tout. Occupons-nous de notre
affaire. » II prit le fauteuil, et le scrutateur monta au bureau.
La plupart
des électeurs ne savaient ni lire ni écrire. On avait remédié à cet inconvénient,
en faisant faire un grand nombre de petites boules, sur chacune desquelles
était gravée une lettre de l’alphabet. Chacun des électeurs s’approcha du
scrutateur, lui dit à l’oreille le nom du candidat qu’il voulait élire, et
reçut une boule en conséquence.
Je m’attendais
à être nommé. Le dépouillement du scrutin donna à Richoux dix ou douze voix
de plus qu’à moi. Je remarquai que les électeurs promettent beaucoup, le
verre à la main, et oublient bientôt leurs promesses.
Le scrutateur
allait proclamer Richoux, « Un moment, s’écria le capitaine. Sergent, faites
entrer vingt-cinq hommes dans la salle. Messieurs ; je représente ici monseigneur
le duc de Guise. J’v suis pour maintenir la liberté des votes ; mais aussi
pour prévenir toute espèce de fraude. Je veux vérifier le scrutin…
Scrutateur,
je vous soupçonne fortement d’être un fripon, et je devrais vous faire pendre
; mais monseigneur le duc de Guise, dont je suis mandataire, m’a recommandé
de mettre beaucoup de douceur dans l’exercice de mes fonctions. Rassurez-vous,
scrutateur ; vous ne serez pas pendu.
« Voyons,
examinons les boules. Je n’y trouve que des R et des T. Electeurs, avez-vous
voté seulement pour MM. Richoux et la Tour ? — Moi, j’ai donné ma voix au
curé ; moi à M. de la Motte ; moi à M. Desmarais ; nous à M. le Fort ; nous
à…— En voilà assez. Scrutateur, vous êtes convaincu de friponnerie, et je
déclare le scrutin nul. J’ajoute ces vingt voix à celles qu’a obtenues M.
de la Tour, et je le proclame député. »
Quelques
murmures se firent entendre. « Sergent, qu’on arrête ceux qui troublent le
bon ordre. » Le plus profond silence régna dans la salle, et la séance fut
levée.
Le capitaine
fit faire un nouveau roulement sur la place.
« Arpajonnais,
vous vous êtes montrés les amis de la bonne cause, en nommant librement M.
de la Tour pour votre député. Mais il y a partout des perturbateurs de l’ordre
public. Epiez-les soigneusement, et dénoncez-les : car si, pendant l’absence
de son mari, madame de la Tour ou ses propriétés éprouvaient le moindre dommage,
monseigneur le duc de Guise ne laisserait pas pierre sur pierre dans Arpajon
; il tient autant à la rigoureuse justice qu’à la liberté des votes. »
Et voilà
comment se faisaient les élections.
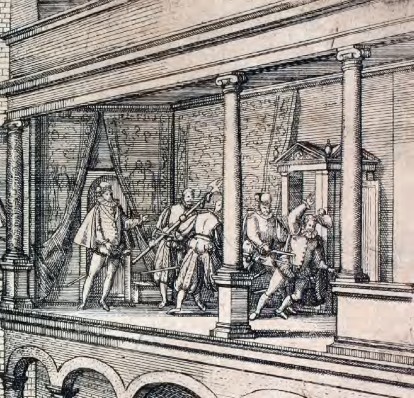
Assassinat
du duc de Guise
CHAPITRE
XXIII
Seconds
États de Blois.
Assassinat
du duc de Guise.
Le capitaine
ne pouvait ni marcher ni se tenir à cheval. J’allais lui offrir ma voiture
; il me la demanda. Je lui donnai, pour le conduire, Bertrand, grand et fort
garçon, qui avait toutes les qualités requises pour faire un bon ligueur.
Je croyais ne plus le revoir, et je pensai que le capitaine trouverait ma
voiture très- commode, pour entrer en campagne.
Le lendemain,
Bertrand et mon équipage revinrent au château. Le capitaine ne pensa pas
à venger la discipline militaire, violée à Arpajon ; mais il chargea mon
valet de choses fort obligeantes pour moi et madame de la Tour. C’était un
homme très- singulier que ce capitaine. Au reste, combien ne rencontre-t-on
pas d’individus, qui réunissent tous les extrêmes ?
Bertrand
nous apprit que le plus grand mouvement régnait dans Paris. La cour, le duc
de Guise, et les députés de la capitale se préparaient à partir pour Blois.
Le duc avait fait toutes ses dispositions, pour y étaler la plus grande magnificence.
D’après
cela, je me préparai à me mettre en route. Colombe voulait que je prisse
André avec moi. Il était le seul avec qui elle pût s’entretenir agréablement,
pendant mon absence, et je résolus de partir seul. Nous nous séparions pour
la première fois ; nos adieux furent déchirans. André prononça que les états-généraux
ne dureraient pas quinze jours, parce que le duc de Guise avait sans doute
pris des mesures certaines pour écraser le roi. On croit facilement ce qu’on
désire, et nous nous consolâmes, Colombe et moi, en pensant à mon retour.
Je trouvai
Bertrand monté sur une de mes mules : c’était une attention de Colombe. Je
sentis de quelle utilité il me serait en route, et je lui permis de m’accompagner.
Je me
rappelai les dernières paroles d’André. Non, me dis-je, le duc n’écrasera
pas le roi. Je vais à Blois pour le sauver, et il n’est pas de mince levier
qui ne puisse être utile.
Il ne
m’arriva rien de remarquable de Paris à Blois. Je revis avec une sorte de
plaisir cette ville où j’avais joué du serpent, à la procession des bilboquets.
Depuis cette époque, j’étais devenu un personnage,
Je trouvai
difficilement à me loger. Toutes les maisons étaient surchargées de monde,
et Bertrand n’avait pas l’adresse d’André. M’adresser à Zampini, c’était
dévoiler mes opinions et mes vues, et peut-être ne m’eût-il pas reçu. Je
me contentai du premier coin que je trouvai.
J’arrêtai
le plan de conduite que je devais suivre. Il fallait d’abord me rendre impénétrable,
tout voir, tout écouter, ensuite continuer d’être la Mouche, et tâcher enfin
de tirer parti des circonstances.
J’allai
saluer M. Péricard. Je devais commencer mes observations, en écoutant attentivement
l’écho du duc de Guise. Je fus reçu avec une bienveillance, qui annonçait
clairement qu’on avait besoin de moi. Plusieurs députés se présentèrent,
et furent accueillis aussi favorablement. Je fus persuadé qu’on se préparait
à frapper un grand coup.
Péricard
prit nos adresses, et il me chargea d’aller, de maison en maison, prendre
celle des autres députés, et de les lui faire passer. C’était ce que je pouvais
désirer de plus avantageux. L’agent de Péricard ne pouvait pas être suspect
aux créatures du duc de Guise, et on ne prend pas l’adresse d’un homme, sans
lui parler, et sans qu’il réponde. Or, je savais entendre à demi-mot.
Péricard
nous prévint que nous recevrions, tous les soirs, une note qui nous indiquerait
l’objet qui serait mis en délibération le lendemain, et la conduite que nous
devrions tenir. Il nous congédia, en m’invitant à le voir souvent. Comme
cet homme- là me servait !
J’employai
deux jours à remplir la mission dont j’étais chargé. Avant la fin de la seconde
journée, je savais que l’assemblée serait très-incomplète ; qu’on n’y avait
pas admis un seul huguenot, ce qui annonçait le louable projet d’écarter
à jamais les Bourbons du trône ; que les députés élus l’avaient été comme
moi, à quelques circonstances près ; enfin que le roi n’avait, parmi eux,
personne sur qui il pût compter.
La veille
du jour fixé pour l’ouverture des États-Généraux, le roi ordonna une procession
générale, où il donna des marques de la plus sincère dévotion. Quelques-uns
de mes collègues me firent remarquer qu’il invoquait le Saint-Esprit, entouré
des compagnons de ses débauches. Cet aspect m’indigna ; mais je
pensai
que je n’étais pas son juge, et qu’il était assez jeune encore pour pouvoir
se corriger. Je priai mentalement mon patron d’opérer ce prodige.
A côté
du roi, marchait le duc de Guise, la tête haute, l’œil fier et menaçant.
Il couvrait encore du nom de Dieu ses sinistres projets. Je soupçonnai que
l’exécution n’en serait pas longtemps différée.
Le roi
prononça, selon l’usage, un discours d’ouverture, dont je fus assez content.
Je sentais que je l’aurais fait mieux ; mais la rédaction de ces sortes de
pièces appartient de droit au chancelier.
Le duc
se fit remettre le manuscrit, et il y fit les changemens qu’il crut nécessaires
à ses vues, avant que de l’envoyer à l’impression. Il n’était plus permis
à Henri de dire à ses sujets ce que lui dictait son cœur, et ce qui pouvait
contribuer au bien public.
Les
états commencèrent par rendre des décrets, qui permettaient de pénétrer dans
l’avenir. Ils forcèrent le roi à proscrire les Bourbons huguenots, et tous
les Français de cette secte, sans exception ; à défendre toute association,
la sainte ligue exceptée, sous peine de mort.
La première
partie de ce décret me parut conforme aux principes sacrés de l’église catholique.
Mais comment le roi pouvait-il se défendre, si ses ennemis seuls pouvaient
se rassembler ? Je vis le piège, et je ne pensai plus qu’aux moyens de le
lui faire éviter.
Il
sentit que son sort était dans les mains du duc de Guise, et la terreur s’empara
de toutes ses facultés. Il jura, sur l’Eucharistie, une amitié inaltérable
à la maison de Lorraine. Il ajouta qu’il voulait remettre les rênes de l’état
à sa mère et au duc de Guise, et qu’il finirait, sa carrière dans la retraite,
et les exercices de la religion.
Il était
impossible que le roi aimât les Guise. Son serment n’était donc qu’un sacrilège,
et cette pensée me révoltait. Je m’attachai à une idée qui me parut assez
simple : une restriction mentale pouvait tout concilier. Je crus que ces
paroles signifiaient qu’il ferait tout ce qui serait en lui pour aimer sincèrement
les Guise. »
Le Béarnais
nous adressa une protestation contre l’illégalité de notre composition, et
le décret qui le déclarait déchu de ses droits : les droits d’un huguenot
! L’ordre du clergé délibéra seul sur cette protestation. Quelques-uns de
nos collègues trouvèrent cette mesure arbitraire. Je l’approuvai sincèrement.
N’est-ce pas à l’église seule qu’il appartient de statuer sur les affaires
politiques qui se rattachent à la religion ? Le clergé déclara le Béarnais
opiniâtre et relaps.
Le moment
de la grande crise approchait. Déjà on comparait, dans l’assemblée, Henri
III aux derniers princes Mérovingiens, et le duc de Guise à Pépin. Le duc
de Savoie s’empara du marquisat de Saluces. Il nous adressa des dépêches,
par lesquelles il protestait n’avoir pris les armes que pour soutenir la
sainte ligue, de concert avec le pape, l’empereur et le roi d’Espagne. On
devait donc s’attendre à une irruption générale.
Les
esprits fermentèrent dans toute la France, et jusqu’au sein des états généraux.
Nous nous divisâmes en deux partis. L’un
voulait
que le roi fît immédiatement la guerre au duc de Savoie ; l’autre, qu’on
dissimulât l’injure faite à la France par ce petit souverain, jusqu’à ce
que les huguenots fussent exterminés. J’étais du second parti. En effet,
comment le roi pouvait-il faire la guerre, puisque nous avions reçu l’ordre
positif de lui refuser des subsides.
Il me
parut évident que le duc de Guise voulait charger le roi du double fardeau
de la guerre civile et d’une guerre étrangère ; que, privé de toute espèce
de ressources, il succomberait infailliblement ; qu’alors le duc prendrait
la couronne, lèverait des troupes avec l’or de l’Espagne même, contiendrait
les étrangers, et serait proclamé le libérateur de la France.
Le danger
était imminent ; je le voyais dans toute son étendue ; mais pouvais-je conjurer
l’orage, moi, qui n’avais que ma voix, el qui, hors l’enceinte de l’assemblée,
n’étais qu’un simple particulier ? Cependant je ne désespérai de rien. Une
circonstance imprévue pouvait naître ; je l’épiais, et je me sentais les
qualités propres à en profiter.
J’allais
souvent chez Péricard. Il me comptait au nombre des ennemis du roi, et se
contraignait peu en ma présence. La fermentation croissait sans cesse, et
quelques habitans de Blois crurent devoir s’éloigner d’une ville, où bientôt,
peut-être, personne ne serait en sûreté. Le roi n’était plus rien, et ils
vinrent demander des passe-ports à Péricard. J’étais chez lui alors. « Attendez
quelques jours, leur dit-il, bientôt nous changerons de qualité. » Je vis,
dans ces mots, l’arrêt de la déposition du roi, et peut-être de sa mort.
Éperdu,
hors de moi, je cherchai, pendant le reste de la journée, les moyens de le
soustraire au coup fatal. Je ne pouvais
m’adresser
directement à lui, sans dévoiler mes véritables dispositions. Je me déterminai
à lui écrire. Il fallait que je prévisse tout. Mon billet pouvait tomber
au moment où j’essaierais de le lui remettre. Il était donc nécessaire qu’il
fût conçu d’une manière obscure, et écrit dans une langue étrangère. On parle
généralement latin en Pologne, et le roi devait y avoir appris cette langue.
Je traçai les mots suivans sur un très-petit morceau de papier : Mors
Coradini, vita Caroli ;
mors
Caroli, vita Coradini5.
Comment
remettrai-je ce billet au roi ? Ma mort peut être la suite de la moindre
imprudence. Dans deux mois je devais être père, et je tenais à la vie plus
que jamais. Cependant, je montai au château, résolu de sauver le roi, si
une occasion favorable se présentait.
Ce prince
sortit de ses appartemens pour aller entendre la messe. Il marchait entre
messieurs de Villeroi et de Villequier, secrétaires d’état. Je m’approchai
en tremblant. M. de Villeroi me reconnut, me sourit et m’adressa quelques
mots. Le roi s’arrêta, et me reconnut aussi. Il se souvint que je lui avais
apporté des dépêches du maréchal de Biron, aux premiers États de Blois. Il
me présenta sa main à baiser, et j’y glissai mon papier.
Je me
retirais, en regardant autour de moi, et je ne vis personne qui
pût me compromettre. Je descendis rapidement les marches du château, et
je rencontrai M. de Maineville qui montait. Il me demanda brusquement
ce que je faisais là. « Ce que vraisemblablement vous venez y faire vous-même.
J’étais

5 Cayet
assure, tome 1er qu’un
billet, ainsi conçu, fut remis au roi, par une main inconnue, deux jours
avant l’assassinat du duc de Guise.
bien
aise de voir ce qui se passe ici. — M. Péricard vous a-t-il chargé de cette
mission ? — Non, Monsieur ; mais mon zèle....
-
Apprenez, la Tour, que nous ne voulons pas
qu’on nous devine, et que, dans les grandes occasions, nous ne nous servons
pas d’agens subalternes. Et, qu’avez-vous remarqué ?
-
Le roi m’a paru être dans la plus entière
sécurité. — Retirez- vous, et ne paraissez plus ici sans ordres positifs.
»
Je courus
me renfermer chez moi, et j’y passai le reste de la journée à méditer sur
les conséquences qui pouvaient résulter, pour moi, de ce que j’avais fait
le matin. J’étais dévoré d’inquiétudes, et ma position actuelle
me rappela, avec un charme tout puissant, les jours heureux que j’avais
passés auprès de Colombe. Je brûlais de retourner à la Tour, et je m’étais,
malheureusement, jeté dans les affaires publiques. On ne s’en éloigne pas,
quand on le veut.
Le lendemain,
22 décembre 1588, le duc de Guise trouva, sous son couvert, un billet qui
l’avertit, que le roi voulait attenter à sa vie. Il écrivit au bas du billet
: Il n’oserait. Telle était sa sécurité, qu’il laissa ce billet ouvert
sur sa table.
Le même
jour, le roi se rendit au conseil, et dit qu’il voulait qu’on expédiât, le
lendemain, quelques affaires urgentes, pour qu’il pût se livrer exclusivement
aux pratiques de l’Église, pendant les fêtes de Noël. Ainsi le masque de
la religion couvrit encore un dessein, qui était irrévocablement arrêté,
et dont, peut-être, j’avais été la première cause.
Le 23,
à huit heures du matin, Guise et le cardinal, son frère, entrèrent dans la
salle du conseil. À l’instant, un huissier de la chambre vint avertir le
duc que le roi avait une affaire importante à lui communiquer. Guise
se lève, salue les
membres
du conseil, traverse la salle sans crainte, et entre dans le cabinet du roi.
Sa chambre à coucher s’ouvre ; neuf satellites en sortent précipitamment,
s’élancent sur le duc, saisissent son épée et le percent de coups. Il se
débat ; il crie. Le cardinal accourt : il est trop tard, il trouve son frère
sans vie.
Le maréchal
d’Aumont arrête le cardinal de Lorraine, et l’enferme dans un grenier du
château. On s’assure de la duchesse de Guise, du prince de Joinville, son
fils, et de plusieurs seigneurs, ouvertement attachés à la maison de Guise.
Mayenne s’enfuit. Il ne pouvait être dangereux que par l’affection de la
Ligue, et il était fort douteux qu’elle reportât sur lui l’amour que lui
avait inspiré son frère.
À la
première nouvelle de la mort du duc, tous les députés se rendirent à la salle
de leurs assemblées. Richelieu, prévôt de l’hôtel, y entra, et fit arrêter,
une liste à la main, un certain nombre de députés. Ma figure rayonnait de
joie, et cependant je fus confondu avec les coupables du crime de lèse-majesté.
Je fus traîné en prison.
Je voulus
m’expliquer avec Richelieu. Il me dit qu’on avait remarqué mes assiduités
auprès de Péricard, et il refusa de m’entendre.
J’étais
sur les épines. La nécessité est souvent mère de l’industrie. J’écrivis à
M. de Villeroi, et j’entrai, avec lui, dans les plus grands détails. Je n’étais
pas au secret, et moyennant une pièce d’or, le geôlier se chargea de ma lettre.
Dans quelles angoisses je passai l’heure que dura ma détention ! Le présent
me paraissait insupportable, et l’avenir affreux. Misérable ambitieux, me
disais-je, quelle fureur t’a poussé à quitter tes foyers ? La lassitude d’un
bonheur paisible, dont tu n’étais pas
digne.
Oh, Colombe, combien tu es vengée ! Et l’amour se rallumait dans mon cœur,
tel qu’il était, quand je partis avec elle de la Rochelle. Peut-être ne devais-je
plus la revoir !
Au bout
d’une heure des plus cruelles anxiétés, Richelieu vint faire ouvrir les portes
de ma prison, et me remit une lettre de M. de Villeroi. Ce ministre me disait
que le roi n’oublierait jamais le service que je lui avais rendu, et que
Sa Majesté était disposée à m’accorder la récompense que je lui demanderais.
Je n’en
voyais pas qui fût au-dessus de moi. Les fumées de l’orgueil reprirent sur
moi leur premier empire, et je ne pensais plus à retourner à la tour. Triste
et déplorable composition qu’un cerveau humain !
En examinant
les prérogatives et les émolumens attachés aux grandes places, je pensais
au duc de Guise, dont la fin tragique devait me porter à celle que j’ambitionnerais.
Ce prince était l’ennemi déclaré et irréconciliable du roi. Tous les Français,
les huguenots exceptés, étaient de son parti. Il fallait donc que le roi
ou lui succombât. Mais Henri devait-il se défaire de son rival par un assassinat
? Le maréchal d’Aumont lui avait conseillé de faire arrêter le duc et le
cardinal, et de les traduire devant la cour des Pairs. Mais le plus grand
nombre de ces seigneurs et des membres du Parlement était composé de ligueurs
furieux : ces deux corps eussent absous les princes Lorrains. D’ailleurs,
il n’y avait pas un huguenot dans Blois ; qui eût-on chargé de les arrêter
?
Je jugeai
devoir débuter modestement dans la nouvelle carrière qui s’ouvrait devant
moi. Je me bornais à une place de sous-secrétaire d’Etat. Cet emploi me permettrait
de voir le roi tous les jours, et m’offrait la perspective de la
plus haute
fortune.
Je résolus d’aller saluer, le lendemain, M. de Villeroi, et de lui faire
part de mes vues.
Le lendemain,
tout changea pour moi, et pour le souverain. J’appris, en me rendant à la
cour, que le cardinal de Lorraine venait d’être assassiné au château de Blois.
Lognac, Saint- Capautet, Alfrenas, Herbelade, pauvres gentilshommes gascons,
avaient trempé leurs mains, sans scrupule, dans le sang du duc. Ils frissonnèrent
à la proposition de verser celui d’un prêtre. L’infâme Henri III lui fit
ôter la vie par quatre misérables, quatre mécréans, qui le tuèrent à coups
de hallebarde. Faire assassiner un prêtre !
Les
bienfaits d’un tel roi me parurent odieux. Je retournai chez moi ; j’ordonnai
à Bertrand de préparer ma voiture, et je sortis de Blois avant la fin du
jour.
Nous
apprenions, de ville en ville, les événemens nouveaux, qui se passaient à
Blois et à Paris. Le roi avait pris des mesures pour se venger, et aucune
pour régner. Au lieu de marcher rapidement sur Paris, avec ce qu’il avait
de troupes, il transigea avec les états-généraux. Il fit rendre la liberté
à tous ceux qui avaient été arrêtés, après la mort du duc de Guise. Il perdit
ainsi un temps précieux. Le ciel frappe d’aveuglement les mauvais rois.
Henri
avait cru se populariser par un acte de clémence. Il confirma l’opinion qu’on
avait de sa faiblesse. Le meurtre du cardinal le rendit exécrable aux yeux
de tous les catholiques, et ne changea rien à sa position.
Dès
que le crime du roi fut connu à Paris, le peuple s’assembla en tumulte. Il
court à l’hôtel de Guise ; il jure à la
veuve
du duc, et à la duchesse de Montpensier, sa belle-sœur, de venger la mort
des princes Lorrains. Les prédicateurs nomment Henri tyran, assassin, ennemi
de la Religion et de l’État. Ils rangent les Guise au nombre des saints martyrs.
Ils avaient incontestablement raison à l’égard du cardinal-prêtre.
Le peuple
nomme Charles de Lorraine, duc d’Aumale, gouverneur de Paris. La Sorbonne
confirme celte nomination, et déclare les français déliés du serment de fidélité
et d’obéissance envers Henri de Valois. Le clergé, en corps, est le juge
suprême des rois, et la Sorbonne en était une fraction importante.
Des
députés aux états-généraux présentèrent au Parlement de Paris une espèce
de requête, par laquelle ils demandaient que Henri de Valois, pour raison
d’assassinat commis ès- illustrissimes personnes des duc et cardinal de Guise,
fût condamné à faire amende honorable en chemise, la tête et les pieds nus,
la corde au cou, tenant en main une torche ardente, et conduit par l’exécuteur
des hautes-œuvres ; qu’il eût à déclarer, à genoux, qu’à tort et sans cause,
il a commis ledit assassinat, duquel il demande pardon à la justice et aux
Etats ; qu’il fût déclaré indigne de la couronne, et confiné au couvent des
hiéronimites, près Vincennes, et là, mis au pain et à l’eau pour le reste
de ses jours. Le parlement n’eut pas assez de vertu pour faire droit à cette
requête.
Orléans
et Chartres s’armèrent pour soutenir la Religion, outragée dans la personne
du cardinal. Jéhu, le lâche Jéhu trembla dans Samarie. Henri de Valois s’enferma
dans le château de Blois, et voyait fondre sur lui la population de Chartres
et d’Orléans. Il eut la bassesse d’écrire au duc de Mayenne, pour lui demander
pardon de l’assassinat de ses deux
frères.
Mayenne répondit verbalement : « Je ne pardonnerai jamais à ce misérable.
»
Ce prince
se mit à la tête de la Sainte-Union, fraction de la Sainte-Ligue, et il entra
dans Paris. Il fut aussitôt déclaré lieutenant-général de la couronne de
France. Tel était l’état des affaires publiques, lorsque j’arrivai à Étampes.
Je me rendis au couvent des filles du Sacré-Cœur de Jésus. Ma mère y avait
terminé sa pieuse carrière, de la manière la plus édifiante. Je donnai des
larmes à sa mémoire, et je la priai d’intercéder pour moi, auprès du grand
saint Antoine.
J’arrivai
à Arpajon. La plus grande fermentation y régnait. Les royalistes détestaient
Henri ; ils le disaient, au moins. Les partisans connus de la maison de Guise
ne parlaient que de mesures violentes. Ils m’avaient cru sincèrement attaché
à leur parti. Ils me revirent avec plaisir.
Je ne
m’arrêtai pas auprès d’eux : j’étais dégoûté des grandeurs. Mon cœur m’appelait
à la Tour, et je courus me jeter dans les bras de Colombe.
Oh,
si on savait quelle force nouvelle six semaines de séparation donnent à l’amour,
les jeunes époux se ménageraient des absences, qui rendent si vif le bonheur
de se retrouver ! Colombe avait été constamment la même, et j’éprouvai, pour
la seconde fois, ce délire, cette ivresse, cet enchantement, qui prêtent
à l’homme quelque chose de la félicité des anges. Je jurai à la charmante,
à la céleste Colombe de ne plus m’éloigner d’elle. Ce serment l’enivra à
son tour. Sa figure était radieuse de bonheur et de plaisir.
Après
avoir payé à l’amour le tribut si doux que je lui devais, je pensai à l’amitié.
Je me tournai vers André et sa femme : ils attendaient leur tour. Je les
embrassai tendrement.
Des
sensations plus calmes me permirent de raconter ce que j’avais vu, et ce
que j’avais fait. Nous nous assîmes, en demi- cercle, devant un grand feu,
et je pris la parole.
Je commençai
par assurer Colombe que la plus grande de mes privations était de n’avoir
pu lui écrire, et cela était à peu près vrai. Mais j’avais manqué d’occasions
pour lui faire parvenir mes lettres. Elle prit mes mains, et ses yeux me
dirent amour et reconnaissance. Je continuai de parler.
« Je
ne me permettrai jamais de te contredire, me dit-elle, quand j’eus terminé
mon récit, sur les choses auxquelles tu tiendras essentiellement. Mais si
tu avais eu assez de confiance en moi pour me consulter, je t’aurais prédit
ce qui t’est arrivé. Je suppose que tu aies complètement réussi dans tes
projets, qu’en serait-il résulté ? Je crois qu’on s’accoutume promptement
au luxe et aux distinctions, que procure une grande place. » Et quels effets
produit-elle ? Elle dessèche le cœur, source unique des vraies jouissances.
Le possesseur devient étranger à sa famille, pour s’occuper exclusivement
de son avancement. Il autorise sa femme et ses enfans à le négliger à leur
tour : l’amour peut-il se soutenir, quand il n’est plus partagé ? Crois-moi,
mon Antoine, ton bonheur est ici ; il ne peut être qu’ici. Cesse de le chercher
ailleurs.
« Monsieur,
reprit André, la saine raison vient de s’exprimer par l’organe de madame.
— Et sa bouche de roses lui donne un charme irrésistible. — En effet, qu’avez-vous
vu à Blois, qu’avez-vous éprouvé ? Des furieux, des forcenés des deux
partis,
méditer et consommer des crimes. Les circonstances vous entraînent à y prendre
une part directe ; des regrets amers suivent l’assassinat du cardinal, que
vous avez peut-être préparé ; des alarmes dévorantes, pendant une heure
de captivité, et enfin-le mépris d’une grande place, objet unique de vos
vœux ; vous rentrez chez vous précisément dans la position où vous étiez,
quand vous êtes parti ; voilà toute votre histoire. C’était bien la peine
de tant vous tourmenter !
« Hé,
croyez-vous, Monsieur, que les calamités publiques s’arrêteront là ? Des
crimes succéderont à d’autres crimes. Vous verrez toute la France se soulever
contre Henri. Des provinces se prononceront pour Mayenne ; d’autres pour
le roi de Navarre, ou pour celui d’Espagne. Les Français se poursuivront
avec une fureur délirante. Réformés, catholiques, royalistes, ligueurs
s’égorgeront, sans pouvoir éteindre la soif du sang qui les dévorera.
« L’homme
raisonnable s’éloigne de ce théâtre d’horreurs. Il jouit de la paix du cœur
auprès d’une femme jolie et bonne. Un échange continuel de soins, de prévenances,
d’égards, l’éducation d’enfans, dans lesquels ils se complaisent à se retrouver,
assurent le calme et la félicité de leur 33 vie. Prononcez, Monsieur, vous
qui connaissez si bien les douceurs de cette position. — Je ne sais, André,
comment la tête est organisée ; mais tu as raison, toujours raison. Ta philosophie
est la bonne ; c’est celle qui conduit au bonheur, dont l’homme est susceptible.
« —
Monsieur, votre arrivée nous a fait avancer le souper de deux heures. Il
n’est pas tard, et nous avons encore bien des choses à nous dire. Voulez-vous
que nous passions cette soirée, comme nous en avons passé beaucoup avec Madame,
en parlant
de
vous ? — De tout mon cœur André. — Je vais chercher la bouteille de bon vin
blanc. Claire, apporte-nous les marrons ; nous les croquerons, en jasant.
»
Toutes
mes soirées, à Blois, avaient été tristes, soucieuses, et souvent suivies
d’un sommeil pénible. Ici, je retrouvais la confiance, la paix, la gaîté.
Nous rîmes, nous folâtrâmes, nous chantâmes ; de tendres caresses suspendaient
nos jeux ; André et Claire étaient nos ombres, nos échos. Le bonheur était
là, au milieu de la ronde que nous dansions sans prétention, sans apprêt.
C’était la douce lumière de l’aurore, qui annonce un jour sans nuages.
Une
nuit charmante compléta les plaisirs innocens de la soirée. « Ton réveil
à Blois, me dit Colombe, en ouvrant les yeux, te rappelait aux souvenirs
fâcheux de la veille. Aujourd’hui ta jolie figure est empreinte des sensations
d’hier. Vois la mienne, mon Antoine, et pense combien ton bonheur ajoute
à celui de ta Colombe. Tu ne la quitteras plus, n’est-ce pas, mon ami ? —
Je te le promets. — Dans un mois, je serai mère. Tu recevras ton enfant ;
tu entendras son premier cri, et tu répandras des larmes de tendresse, qui
me feront oublier mes douleurs. »
« Monsieur,
Monsieur, me cria André du fond de son corridor, dans une heure ou deux,
tout sera fini de mon côté. Préparez- vous à être parrain. » II courut à
Arpajon. Colombe s’habilla à la hâte, et se rendit auprès de Claire. Elle
y trouva la grosse Javotte, qui lui donnait des soins directs, en attendant
la matrone, qu’André était allé chercher à Arpajon. Colombe voulut la faire
retirer. « Ne craignez rien, Madame; je sais ce que c’est : j’en ai eu trois.
— Trois enfans sans être mariée !
Que
de crimes ! — Non, Madame ; ce ne sont que des fautes légères : je les ai
faits avec le sonneur de la paroisse. »
La force
de l’argument ne convainquit pas Colombe. Elle sortit, en grondant, de la
chambre de Claire, et vint me conter ce qu’elle avait appris. J’en ris de
tout mon cœur. « Ah, mon ami, tu as laissé la foi et ta piété à Blois. Tu
ris de ce qui eût excité ton indignation, avant que tu fisses ce fatal voyage.
Il faut marier cette fille, ou la chasser. — Marions-la ; ce sera plus gai.
»
Quand
la matrone arriva, André était père d’un gros garçon.
« Allons,
mon ami, voilà ton nom appuyé. — Oh, Monsieur, je n’y tiens pas du tout.
— Moi, je tiens au mien. — C’est tout simple ; un capitaine, en non activité
cependant, le propriétaire d’un fief, un ex-député aux états-généraux...
je vous souhaite, Monsieur, une postérité aussi nombreuse que les étoiles
du firmament. — Va te promener avec tes souhaits. Mes enfans seraient des
misérables. — Pourquoi cela, Monsieur ? Qu’étiez- vous, quand vous êtes arrivé
à la Rochelle ? Un petit novice, échappé de son couvent… Vos enfans feront
comme vous : ils seront les fils de leurs œuvres. — Tu as encore raison.
Ayons des enfans, André, beaucoup d’enfans. C’est un joli jeu. Il durera
plus long-temps que la prime.
« Ah,
çà, Monsieur, vous me ferez l’honneur d’être le parrain de mon petit André.
— L’honneur, l’honneur ! Ce mot-là doit être banni entre nous. — Il est très
en vogue à la cour. — On a souvent besoin d’y couvrir le vide des pensées
sous des phrases de convention, qui au fond ne signifient rien. C’est de
la fausse monnaie, qui a cours dans ce pays-là. — Vous l’avez vu de près,
Monsieur, et vous l’avez jugé. Vous commencez à suivre les préceptes de M.
de Poussanville, votre premier instituteur.
—
Prends les hommes comme ils sont, m’a-t-il ; et ne l’attache fortement à
aucun. — André excepté, Monsieur. — Oh, il y a long-temps que je ne vois
plus en toi un homme ordinaire. — Monsieur est bien bon. Vous serez donc
le parrain.
« —
Oui ; mais occupons-nous de ce qui presse le plus. Procure-toi une nourrice.
— Une nourrice ! Pour quoi faire ? La nature dit aux femmes : Je t’ai donné
la force de faire un enfant ; tu as nécessairement celle de le nourrir.
C’est un devoir que je t’impose, et tu ne le violeras pas impunément. Tu
expieras cette faute, tôt ou tard, par des maladies, et peut-être par la
mort. Un enfant doit être entièrement celui de son père et de sa mère.
« Un
grand épouse une princesse étrangère ; son fils n’est Français qu’à moitié.
Une femme mercenaire lui donne son lait ; voilà encore un second mélange.
Le bambin n’a réellement de sa famille que le premier germe auquel il doit
l’existence. Les petits n’ont pas toujours les qualités qui distinguent certains
grands ; mais ils en copient servilement les ridicules ; c’est tenir à eux
par quelque chose. On prend des nourrices partout. Certains maris s’en trouvent
bien, je l’avoue. Des cris aigus ne troublent jamais leur sommeil, et madame
conserve l’élégance et la pureté de ses formes. Mais l’enfant rentre à la
maison paternelle avec un œil crevé, ou avec Un membre ankylosé, ou avec
un sang vicié, que sais-je moi ? Mon petit André est déjà suspendu au sein
de sa mère. — Cet homme-là a toujours raison. Colombe nourrira le petit
de la Tour. Elle y est disposée, et j’appuierai un dessein que j’ai toujours
combattu, dans des vues, purement sensuelles, je le confesse. Que mon patron
me le pardonne.
«
— Ah, ça, il me faut une marraine. Je vais prier madame de vouloir bien l’être.
— Toi, qui sais tant de choses, tu n’as pas la moindre connaissance en théologie.
Tu ignores qu’un parrain et une marraine contractent une affinité spirituelle,
qui ne leur permet plus de se marier sans dispense. — Non, Monsieur, je ne
savais pas cela. — Colombe et moi sommes mariés, très-mariés, et l’Église
ne nous permet pas de contracter une seconde alliance. — Hé bien, Monsieur,
je chercherai, et je trouverai une marraine à Arpajon. Vous en rapportez-vous
à moi ? — Oh, absolument.
Je me
rendis le soir à Arpajon. Conduit par André, j’allai prendre ma commère chez
elle, chargé de dragées et de confitures sèches : c’était le moyen d’être
bien reçu de la femme du bedeau. Nous portâmes le petit André à l’église,
et nous eûmes le bonheur de le laver du péché originel. Je le vouai à saint
Antoine, et je lui donnai son nom.
« Monsieur,
me dit le curé, vous savez que je ne vends pas les sacremens ; mais celui
du baptême est d’une 33 telle importance, qu’il peut valoir une légère rétribution
à celui qui l’administre. Vous avez donné un noble et grand exemple le jour
du mariage de M. André, et un homme comme vous est fait pour voir suivre,
par tous mes paroissiens, ceux qu’il lui plaira de donner encore. » Un homme
comme moi ! Je mis deux écus dans la main du bon curé ; je jetai de la menue
monnaie aux pauvres, qui doivent vivre aussi, et j’allais me retirer comblé
de bénédictions.
« Monsieur,
me dit le bedeau, c’est moi qui ai porté le rituel aux fonds baptismaux,
et qui avais pris à la sacristie les linges nécessaires à la cérémonie. »
Il me parut constant que le bedeau avait joué un rôle très-important dans
cette affaire, et je lui
glissai
un écu. « Sauvons-nous, Monsieur, me dit André, voilà les enfans de chœur
qui viennent à vous d’un côté, et le sonneur de l’autre. Ils vous prouveront
que sans eux vous n’auriez pu faire un chrétien. » Il m’entraîna.
En retournant
à la Tour, je pensai à Javotte, à ses trois enfans, et à l’humeur qu’avait
montrée Colombe. J’en parlai à André.
« Que
diable, Monsieur, ce sonneur-là a donc le diable au corps ? Il était peut-être
réduit au choix de faire des enfans à Javotte ou d’être pendu. — Cependant
en voilà trois de faits. Colombe prétend qu’il faut renvoyer cette fille
ou la marier ; moi, je suis pour le mariage. — Et moi, pour l’expulsion.
— Que deviendra cette fille ? — Ce qu’elle pourra. Pensez donc, Monsieur,
que vous vous chargeriez, en la mariant, d’elle, du sonneur et de trois enfans
; la charge serait forte. Si vous vous érigez en réparateur des torts qu’ont
les amans envers leurs belles ou leurs laides, je vous garantis ruiné avant
deux ans. — On dit, en effet, que ces accidens-là sont fréquens cette année.
— Et
on ignore ce qui arrive aux femmes mariées. — Il n’y a donc plus de mœurs,
André ? — Ma foi, Monsieur, il est très- commode de n’en pas avoir. — Voilà
la véritable cause des maux dont le ciel frappe la France.
« —
Monsieur, retournons à Arpajon. — Pourquoi faire ? — J’y prendrai une fille,
qui remplacera Javotte. — Quoi, lui donner son congé aussi brusquement ?
— Vous ne prétendez pas garder malgré madame. Il y a de petits sacrifices
qu’il faut faire à la paix du ménage. — Je sais bien cela. »
Nous
fîmes marcher en avant la matrone qui portait le petit Antoine, et nous revînmes
en effet à Arpajon. Une heure après, André avait trouvé la fille qu’il nous
fallait.
«
Je sais, André, que Madame de la Tour sera sensible à la marque de déférence
que je vais lui donner. Mais que dirai-je à cette pauvre Javotte ? — Vous
lui direz : Pauvre Javotte, vous avez fait preuve de talent, en facilitant
la délivrance de Madame André ; allez l’exercer dans un village voisin. Voilà
dix écus, qui vous aideront à attendre de l’occupation. — C’est cela, c’est
bien cela. » Comme on cherche les choses les plus simples ! comme elles échappent
souvent à nos méditations ! Tu as de l’esprit, André. — Ah ! Monsieur ! —
Beaucoup d’esprit. Tu devrais te faire homme de lettres.
« —
Monsieur, j’y ai déjà pensé. J’ai le cerveau meublé, je suis inventif. —
Hé, Monsieur, j’y suis : je prends les Œuvres de nos anciens auteurs dramatiques.
Je réduis leurs pièces de cinq actes à trois, et je suis proclamé homme de
lettres- arrangeur. — Voilà du nouveau, voilà encore ce que je n’aurais pas
trouvé. Je te recommande expressément de ne pas toucher aux Œuvres de Jodelle,
le Sophocle de la France. — Je m’en garderai bien : j’ameuterais contre moi
les membres de la pléiade française, et les amateurs du sublime. »
Je rentrai
dans mon château. Javotte travaillait à son ordinaire. Colombe n’avait rien
voulu prendre sur elle ; mais elle savait si bien m’amener à ce qu’elle voulait
! Je voulus avoir au moins l’honneur de l’invention. Je lui pris la main,
je la conduisis à la cuisine, et je répétai, mot à mot, à Javotte ce qu’André
m’avait soufflé. Elle prit son parti avec une facilité, sur laquelle je ne
comptais pas.
Elle
prit sa gratification, son paquet, et elle allait sortir. Une vieille se
présente ; un enfant est accroché à chacun des côtés de sa jupe ; elle porte
le troisième sur son dos, et se traîne, appuyée sur un bâton : « Les voilà,
dit-elle à Javotte, fais-en ce que tu
voudras
; moi, je n’ai plus le moyen de les nourrir. — Partez, partez, leur dit André,
et emmenez cette graine avec vous. — Monsieur, répondit la vieille, a fait
tant de bien au clergé ! Il ne rejettera pas ses enfans. — Qu’est-ce à dire,
ses enfans ! — Monsieur sait bien qu’un sonneur tient nécessairement à l’Église.
Il ne dit pas la messe ; mais personne n’y viendrait, s’il ne la sonnait
pas. » Elle jette son bâton, se redresse, s’enfuit avec sa fille, et me voilà
au milieu de trois enfans, dont je ne sais que faire. « Par saint-Antoine,
m’écriai-je, je ne me chargerai pas des péchés du sonneur. André, prenez-moi
ces marmots-là, et portez-les où vous voudrez. »
Colombe
rit, de tout son cœur, de ma position, de ma mine, de ce que je disais, et
quand elle rit elle ne me contredit jamais. Je retrouvai mon courage, et
nous délibérâmes tranquillement sur le parti qu’il fallait prendre, dans
cette circonstance singulière.
« Monsieur,
me dit André, vous mènerez demain les deux aînés à Paris, et le capitaine,
qui vous a nommé député, en fera des fifres dans sa compagnie. Bertrand l’a
conduit à Paris, il le retrouvera aisément ; mais le troisième marche à peine,
et celui- là m’embarrasse. — André, porte-le cette nuit à la porte du curé
d’Arpajon. — Ah ! mon Antoine, tu aurais la cruauté de faire exposer ce petit
malheureux ! » Je jouais serré avec ma femme, je voulais la voir venir. «
Ma Colombe, il n’y a pas de maisons publiques pour recevoir ces enfans-là.
Les curés ne sont-ils pas les pères des pauvres ? — Mon bon ami, si les curés
se chargeaient des enfans abandonnés, il faudrait décupler leurs revenus.
— Mais que veux-tu que je fasse de ce marmot ? — Le garder pendant quelques
jours : nous verrons ensuite. » C’est là que je voulais amener Colombe.
«
Parbleu, s’écria André, il faut avouer que je suis un grand sot ! Au lieu
de m’arrêter à la mine de monsieur, au rire inextinguible de madame, au lieu
de parler, j’aurais dû agir. Il fallait courir après ces femmes-là, les ramener
ici, et les forcer à reprendre leurs marmots. Il est bien temps de réfléchir
à présent !
«
Venez ici, jolie petite brune. Comment vous appelez-vous ?
— Marianne,
Monsieur. — Avez-vous servi quelqu’un avant que d’entrer ici ? — Le marguillier
d’Arpajon. — Faites souper ces trois marmots ; couchez-les où vous pourrez,
et allez demander à votre marguillier un certificat de bonne conduite. Je
ne veux pas qu’il pleuve des enfans ici. — Ma foi, André, te voilà réellement
inventeur, et ton nom passera à la postérité. — Comment cela, Monsieur ?
— C’est à toi qu’on devra l’usage utile de n’admettre chez soi que des sujets,
sur lesquels on aura pris de rigoureuses informations. — C’est parbleu vrai.
Me voilà économiste et homme de lettres-arrangeur. Encore une ou deux inventions
comme celles-là, et j’arrive à la célébrité, d’après un raisonnement fort
simple : de petites choses réunies, en composent nécessairement une grande.
»
André
nous quitta pour aller voir sa femme, et pour lui demander des conseils sur
la manière dont il s’y prendrait pour nous faire un souper présentable. La
fille de basse-cour était auprès d’elle ; Javotte était en fuite, Marianne
était allée chez son marguillier. Elle en rapporta, le soir, un certificat,
qui nous détermina à l’admettre au nombre de nos commensales ; mais, en attendant,
il fallait bien qu’André fît la cuisine. Heureusement le bon André était
propre à tout, et rien ne lui paraissait au-dessous de lui.

Un
juge au XVIe siècle
CHAPITRE
XXIV.
Evénemens,
gais, tristes, affligeans. Grand procès, etc.
Bientôt
j’entendis mon philosophe, mon inventeur appeler Bertrand à faire trembler
les vitres de la cuisine. Je quittai Colombe, et je descendis. André voulait
transformer Bertrand en marmiton, et cela était juste. Ce coquin de Bertrand
ne se trouvait pas. « André, dans les occasions pressantes, il faut que chacun
mette la main à la pâte ; je serai ton aide de cuisine. — Vous, Monsieur
! je ne le souffrirai pas. Vous ne devez pas jouer un rôle secondaire chez
vous. — Ce sera une partie de carnaval. » Une discussion s’engagea. Colombe
descendit. Elle n’avait appris à faire la cuisine, ni chez la maréchale de
Biron, ni chez les filles de Saint-Augustin.
« Vous
me gênez, vous me gênez singulièrement, nous dit André. Le seul service que
vous puissiez me rendre, c’est d’aller chercher la fermière. — Allons chercher
Catherine. » Et nous partons, bras dessus, bras dessous, trottillant, et
chantant la chansonnette, quoique les soirées fussent froides encore.
Nous
revenions avec Catherine, quand nous rencontrâmes Bertrand. Nous poussâmes
la fermière à la cuisine, et nous savons que Colombe a un goût décidé pour
les interrogatoires. Elle en fit subir un, dans toutes les formes, à Bertrand.
«
D’où venez-vous ? — De Saint-Arnoult. — Qu’avez-vous été faire là ? — J’y
ai suivi Javotte et sa mère. — Ah, ah ! et qu’avez-vous appris ? » Bertrand
ne s’exprime pas avec facilité ; mais à force d’interpellations, de questions
et de réponses, nous sûmes qu’il était entré dans un cabaret, et qu’il y
avait pris des renseignemens. Que la vieille était réellement dans la misère
; que Javotte avait eu deux faiblesses avec le sonneur, qui est, en même
temps, le premier savetier du village, et qui, par conséquent, est très à
son aise ; qu’il avait marqué une certaine velléité de donner son nom à ses
enfans ; mais que le premier sabotier du village lui disputa la paternité
du troisième, sans avoir aucune envie d’en remplir les devoirs ; que cet
incident fit penser au sonneur qu’il pouvait très-bien n’être pas plus le
père des deux aînés que du cadet ; qu’il avait renoncé à son premier dessein
; que Javotte, turlupinée dans le village, avait laissé ses enfans à la vieille,
ce qui n’est pas maternel du tout, et qu’elle était venue chercher une condition
à Arpajon.
Tout
cela ne nous parut pas concluant, et ne nous tirait pas d’embarras. Un sot,
un butor s’en fût tenu à ces renseignemens préliminaires. Bertrand n’avait
pas d’élocution ; mais il était malin. Il nous proposa de prendre la charrette
du fermier, d’y mettre les trois bambins, et de les conduire à Saint-Arnoult
; de descendre les deux aînés chez le sonneur, et le petit, chez le sabotier.
Il ajouta, avec beaucoup de sagacité, qu’il faudrait bien qu’ils se chargeassent
des fruits de leurs œuvres, puisqu’ils les avaient avouées publiquement.
Cette idée nous parut assez bonne, et l’exécution en fut remise au lendemain
matin.
Ce souper,
si difficile à apprêter, parut enfin. André en fit les honneurs avec une
emphase comique. « Ne vous attachez pas à
ces
mets vulgaires, nous dit-il ; goûtez ce plat-ci, je vous en prie. Il est
tout entier de mon invention. » C’était un lapin dépecé, défiguré », et
que la tête seule nous fit deviner. Nous trouvâmes le ragoût excellent. «
Oh, parbleu, dit André, celui-ci portera mon nom : personne ne me disputera
l’honneur de l’invention. Je vous régalerai souvent d’une andréade.
— Mon cher André, Christophe-Colomb découvrit l’Amérique, et Améric-Vespuce
lui donna son nom. Zuingle créa l’hérésie, pour la damnation d’une partie
du genre humain, et les huguenots français se nommèrent calvinistes. Tu vois,
ajoutai-je en riant, que les grands hommes ont toujours des envieux. » En
effet, l’invention d’André se répandit, et le peuple, qui fait tout à sa
tête, la nomma tout platement une gibelotte. « Mon ami, dis-je alors, répétons
ensemble les sic vos, non vobis, de Virgile. »
J’avais
désiré de l’occupation. J’en eus bientôt à pouvoir à peine y suffire.
Bertrand
rentra à pied, le lendemain, vers une heure après- midi. Il avait les
cheveux en désordre, le nez cassé, et sa souquenille était en
lambeaux. Les enfans, le cheval, la charrette, tout était resté
à Saint-Arnoult. Notre premier mouvement fut de l’interroger sur les causes
de sa mésaventure.
Il était
entré triomphant au village voisin, et il se préparait à remplir sa mission
de la manière la plus brillante. Il descend chez le sonneur, un enfant de
chaque main, et les présente à leur père putatif. Le sonneur jure qu’ils
ne sont pas à lui, et les met dehors à grands coups de pied dans le derrière.
Bertrand juge que son éloquence serait sans effet sur un pareil homme, et
il lui donne, à grands coups de manche de fouet, une leçon de sentimens naturels.
Sans
perdre de temps, il court chez le sabotier. Celui-là se moque de lui, et
Bertrand n’est pas endurant. Il répète ici la correction qu’il a administrée
au sonneur.
Celui-ci
arrive, et se joint au sabotier. Tous deux tombent sur Bertrand, et lui eussent
cassé les reins, si les habitans n’étaient intervenus. Les bambins errent
par le village, leurs petites mains en l’air, et crient en pleurant : papa,
maman ! maman, papa ! Personne ne leur répondait.
Comment
cette scène finira-t-elle ? il y a dans tous les villages un plaisant et
un orateur. Le plaisant se charge spécialement d’égayer les veillées d’hiver,
moyennant une bouteille de picquette. Il n’avait rien à dire ici. L’orateur
monte sur un tonneau vide, placé sous le grand tilleul, et on se rassemble
autour de lui. Il pérore sur la nouvelle du jour, sur les grands événemens
; il se permet même quelquefois, le dimanche, de critiquer le prône du curé.
« Au tilleul, au tilleul, cria l’orateur de Saint-Arnoult. » Il commença
par dire qu’on ne doit jamais se vanter d’un fait, quand on ne veut pas en
adopter les conséquences ; qu’il était notoire que le sonneur et le sabotier
s’étaient vantés publiquement d’avoir fait des enfans à Javotte, qui ne pouvait
pas les nourrir, et que ce devoir-là devait être rempli par les deux pères.
« Bravo, bravo, cria l’auditoire. Qu’une députation se rende chez les pères
perâtres, continua l’orateur, et leur déclare que s’ils ne veulent
pas reconnaître le sang de leur sang, nous ferons raccommoder nos galoches,
et nous achèterons nos sabots à Rochefort. Bravo, bravo, répétèrent les spectateurs.
»
Tous
les hommes sont bons, à leurs intérêts près, et un intérêt moyen l’emporte
toujours sur un plus faible. D’après la promesse positive, faite aux deux
papas, qu’ils conserveraient la
pratique
de tous les habitans, ils embrassèrent leurs marmots, ou ceux de quelques
autres, et promirent solennellement de leur donner du pain, et de la soupe
le dimanche.
Cette
négociation terminée, l’orateur appela de nouveau son monde sous le tilleul,
et il commença sa péroraison. « Vous avez fait un acte de charité, mes amis
; mais tout n’est pas terminé. De quel droit cet homme-là est-il venu faire
la police chez nous ? dis donc, un tel, où demeures-tu ? — Chez M. de la
Tour. — Je suis d’avis que nous le laissions libre, parce que le maître est
caution de ses valets ; mais que nous gardions la charrette et le cheval,
en garantie de l’amende, à laquelle M. de la Tour sera condamné. — Oui, oui,
et nous nourrirons le cheval en commun, parce que nous nous en servirons,
chacun à notre tour. — Bien pensé, très-bien pensé.
« L’amende
sera forte, parce que le sonneur savetier a le dos meurtri, et le sabotier
un œil à moitié crevé. — Et moi, qui me payerai mon nez cassé, et ma souquenille,
qui était neuve, et dont je ne peux plus me servir ? — Toi ? tu n’auras pas
un sou, répondit l’orateur à Bertrand. Tu te souviendras qu’il y a des lois
pour quelque chose, et qu’il n’est pas permis d’enjamber sur leurs prérogatives.
Où en serions-nous, si chacun s’ingérait de se faire justice à soi-même ?
respect aux lois, c’est le dicton des gens de Saint-Arnoult.
« Et
à propos de lois, mes amis, il en est une terrible, effroyable, et qui n’en
doit pas moins être maintenue. » Elle a été fabriquée pour prévenir le scandale,
et Javotte en a donné un grand, un très-grand dans le village. II faut qu’elle
soit victimée, pour empêcher nos jeunes filles de donner dans le travers.
Je suis sûr qu’elle n’a déclaré au juge d’Arpajon aucune de ses grossesses.
— Oh, dis donc, Jérôme, tu ne veux pas faire pendre
Javotte.
— Et toi-même, Ambroise, tu ne vois donc pas ce p’tit Charles qui rôde sans
cesse autour de ta maison ! veux-tu qu’il arrive à ta Denise, la même chose
qu’à Javotte ! Les lois, les lois, je ne connais que ça. Les lois, les lois,
cria tout l’auditoire. »
Je m’impatientais,
et en effet, je m’intéressais fort peu aux phrases de Messieurs de Saint-Arnoult.
« Au fait, Bertrand. — Monsieur, ils vont me faire assigner par-devant le
juge d’Arpajon. Javotte sera pendue, et vous paierez l’amende. Voilà le fait.
« —
André, n’es-tu pas un peu jurisconsulte ? — Je possède quelques-unes de nos
lois ; mais je ne connais rien de celles qui concernent les filles grosses,
par la raison, toute simple, que je ne l’ai jamais été, et que je ne me fatigue
pas la tête de choses qui ne peuvent me regarder dans aucune circonstance.
« Il
me semble que l’affaire de Bertrand, avec le sonneur et le sabotier, se réduit
à quelques coups échangés, et que si quelqu’un peut se plaindre, c’est Bertrand,
qui a eu deux adversaires à combattre. Il faut qu’il les prévienne, et qu’il
aille porter plainte contre eux. J’ai souvent remarqué que celui qui parle
le premier a raison, auprès de certaines gens, et le juge d’Arpajon n’est
pas un aigle. L’orateur de Saint-Arnoult a établi, en principe, qu’on ne
doit pas se faire justice à soi- même, et il a poussé quelques imbéciles
à retenir la charrette et le cheval de votre fermier. Autre plainte à porter
contre lui et ses suppôts. Tout cela se réduira à rien ; mais allons tous
trois à Arpajon : cela nous fera passer une heure. — Tu veux me transformer
en avocat. Je suis donc destiné à faire tous les métiers, les uns après les
autres. — Monsieur, je vois plusieurs avantages à cela. D’abord, vous
ne paierez pas d’avocat,
puisque
vous serez le vôtre ; ensuite vous aurez l’occasion de déployer votre éloquence,
et vous en avez beaucoup ; enfin, il est bon de savoir faire un peu de tout.
— Allons à Arpajon. »
Déjà
les plaignans de Saint-Arnoult étaient rangés en demi- cercle. Le juge était
dans le fond de la salle, revêtu du costume propre à sa dignité, et son greffier
écrivain était assis sur le modeste tabouret. André poussa Bertrand en avant,
et le mit en ligne avec le sonneur et le sabotier. « Ah, encore un plaignant,
dit le juge ! M. de la Tour, vous vous êtes fait là une mauvaise affaire.
» Je m’avançai. « C’est moi, Monsieur, qui me constitue partie plaignante.
— Et de quoi vous plaignez-vous ? Vous envoyez votre charretier battre les
gens à Saint-Arnoult... — La preuve de cela, Monsieur le juge. — Elle est
écrite au procès- verbal du greffier, d’après la déposition de vingt témoins.
— Je m’inscris en faux contre eux. — Prenez garde, Monsieur ; vous savez
que les faux témoins sont pendus. — Ce sont leurs affaires. — Vous savez
encore qu’un charretier, son cheval et sa voiture ne vont jamais qu’où le
maître les envoie. — Cela n’est pas toujours vrai. — Vous avez envoyé votre
équipage à Saint- Arnoult. — Je nie le fait. — Tout mauvais cas est niable.
Votre charretier a battu le sonneur et le sabotier ; donc vous l’avez envoyé
pour cela. — Donc M. le juge ne saisit pas l’affaire sous son véritable point
de vue. — Prétendez-vous, mon petit Monsieur, m’apprendre mon métier ? —
Prétendez-vous, mon grand Monsieur, faire passer vos paroles pour des oracles
? — Ne savez-vous pas qu’on a dit, dans tous les temps, que la justice est
en possession d’en rendre d’incontestables ? — Oui, quand les lumières et
la sagacité de ses organes sont bien constatées. — Prétendez-vous dire, Monsieur,
que je sois dépourvu des unes et de l’autre ? — Je n’ai rien dit de cela.
— Mais vous le pensez peut-être. — Ma pensée m’appartient ; elle
fait
partie intégrante de mon être, et je n’en dois compte à personne.
« Au
reste, je demande la lecture du procès-verbal. — Lisez, greffier.
« …Ont
déposé tels, tels et tels, que le charretier Bertrand a battu le sonneur
et le sabotier de Saint-Arnoult, et qu’il y avait été vraisemblablement envoyé
par son maître, à cet effet.
« —
Je retire mon inscription en faux, parce que le mot vraisemblablement,
loin de présenter une disposition positive, rend l’accusation hypothétique.
— Hypothétique, hypothétique ! Vraisemblablement, Monsieur, est un
adverbe, placé là pour arrondir la phrase. — Monsieur, il n’est pas question
en justice de phrases arrondies, mais de mots précis, positifs. — Greffier,
biffez le mot vraisemblablement, puisqu’il déplaît à Monsieur. — Greffier,
gardez-vous-en bien, ou, si vous le faites, je rétablis mon inscription en
faux. — Monsieur le juge, dit l’orateur de Saint-Arnoult, nous n’avons pas
déposé avoir la certitude que M. le la Tour ait envoyé son charretier chez
nous pour nous battre; mais seulement que nous avions lieu de le croire.
« —
Que diable, voilà qui change toute la face de la procédure. Vous déposez
d’une façon, vous déposez d’une autre. On ne sait à quoi s’en tenir avec
vous. Toujours est-il vrai que Bertrand a battu le sonneur et le sabotier,
et que son maître leur doit une indemnité. — Toujours est-il vrai, répondis-je,
que le sonneur et le sabotier ont battu Bertrand. Voyez son nez, et les lambeaux
de sa souquenille, pièces probantes au procès. — Ils l’ont battu ; mais pour
raison de défense naturelle. — Le sonneur a été le chercher chez le sabotier,
et ils sont tombés
tous
deux sur lui. — Voilà une procédure qui ne finira pas. Il est deux heures,
et je goûte à trois. Avocat, concluez. — Je conclus à ce que les parties
soient mises hors de cause, dépens compensés, s’il y en a. — S’il y en a
! Mon greffier a-t-il fait ses écritures pour rien ? Ai-je passé là deux
heures uniquement pour vos menus plaisirs ? — Je conclus encore à ce que
les gens de Saint-Arnoult soient condamnés à cinq livres de dommages et intérêts,
envers mon fermier Thomas, pour avoir retenu, de vive force et illégalement,
sa voiture et son cheval. — Ta, ta, ta ! qu’on fasse silence et qu’on m’écoute
: je vais prononcer. Nous condamnons le sieur de la Tour en une amende de
vingt livres, en réparation des faits et gestes de son charretier Bertrand,
lesquelles vingt livres seront réparties entre le sonneur et le sabotier,
parties lésées ; plus aux frais de la procédure. Autorisons le fermier Thomas
à aller reprendre, sans frais, sa voiture et son cheval.
« —
J’appelle du jugement au bailliage d’Étampes. — Je juge, sans appel, jusqu’à
la concurrence de vingt livres. Voilà pourquoi je n’ai pas porté l’amende
plus haut. J’estime les frais à quarante livres, ce qui fait bien soixante
livres en tout, que le sieur de la Tour paiera, dans les vingt-quatre heures,
à peine d’y être contraint, et par corps. » Je le tirai à part. « Monsieur
le juge, vous vient-il souvent de ces procès-là dans une semaine ?
— Hé,
de quoi vivrais-je donc ? Avec quoi marierais-je ma fille, paierais-je la
pension de mes deux fils, qui sont chez les révérends pères jésuites de Paris,
et qui savent déjà qu’on peut, qu’on doit déposer un roi, qui ne marche pas
dans les voies tracées par la société de Jésus ?
« Monsieur
de la Tour, je ne vous en veux pas personnellement; j’aurais dû peut-être
condamner le sonneur et
le
sabotier ; mais ce sont de pauvres diables, de qui je n’aurais pas tiré un
sou, et je vous le répète : il faut que je vive. — Au moins, Monsieur, vous
êtes de bonne foi.
« Vous
avez là une pauvre fille qui attend... — Oh ! par exemple, celle-là sera
pendue. Je n’ai rien à gagner avec elle, et je ne veux pas qu’on dise que
je favorise exclusivement les pauvres. Je vais envoyer Javotte au procureur
du roi d’Étampes. Fort heureusement pour elle, je n’ai pas le droit de condamner
à mort. — Voudriez-vous me communiquer la loi ? — Oh ! elle est positive,
je vous en réponds. »
M. le
juge reprit l’audience qu’il avait suspendue un moment.
« Qu’on
fasse entrer Javotte. Tu as fait trois enfans, et tu ne m’as déclaré aucune
de tes grossesses. — Non, Monsieur. — Hé bien, tu seras pendue. Greffier,
donnez-moi la loi. Toute fille qui ne déclarera pas sa grossesse sera
pendue. » La pauvre Javotte s’évanouit.
Je demandai
à voir cette loi. « Êtes-vous aussi l’avocat de cette fille ? — Oui, Monsieur,
et vous n’avez pas le droit de me refuser ce que je vous demande. — Hé bien,
la voilà cette loi. — Toute fille qui n’aura pas déclaré sa grossesse sera
pendue, si elle est dans l’impossibilité de représenter son fruit, quand
elle en sera requise. Or, vous savez que ses trois enfans courent les rues
de Saint-Arnoult. — Qu’est-ce que cela fait au fond de l’affaire ? — La seconde
partie de la phrase met Javotte à l’abri de toute espèce de poursuite. —
Il n’y a pas de seconde partie de la phrase ; mais deux phrases isolées.
— Elles ne sont séparées que par une virgule, qui en fait une phrase unique.
— Elles le sont par un point. — Par une virgule. — Par un point, vous dis-je.
Regardez bien. — Je vous répète que c’est une
virgule.
— Et moi que c’est un point. D’ailleurs, c’est au pouvoir discrétionnaire
du juge à prononcer là-dessus. — Ainsi la vie de cette malheureuse dépendra
d’un point, ou d’une virgule ! — C’est vous qui l’avez dit. — Monsieur le
juge, vous êtes un sot, ou un fripon ; peut-être l’un et l’autre. — Injurier
un magistrat dans ses fonctions ! Je vous attaque en réparation d’honneur,
dommages et intérêts. — C’est moi qui vous prends à partie. Voilà vos soixante
livres.
« Je
vais dévoiler votre odieuse conduite dans un mémoire que j’adresserai au
procureur du roi d’Étampes. S’il n’y fait pas droit, j’irai le présenter
au parlement de Paris, et je vous ferai destituer. Un magistrat, qui ose
faire une spéculation de l’administration de la justice, et qui se joue publiquement
de la vie des malheureux ! Je me retirai. Il me suivit.
« M.
de la Tour, ne plaisantez pas, — Jamais je n’en ai eu moins d’envie. » —
Voilà vos quarante livres de frais. — Je ne tiens pas à l’argent. — Je vais
faire mettre Javotte en liberté, en reconnaissant qu’il y a une virgule,
et non un point. — Faites ce que vous voudrez ; je me conduirai, moi, comme
je dois le faire. »
Je ne
nomme pas ce juge par considération pour sa famille, qui est recommandable.
Le procureur du roi doit être discret, et j’espère qu’il le sera.
« Monsieur,
me dit André, vous avez parlé comme Cicéron pro Milone. Faites-vous
recevoir avocat, et vous serez l’aigle du barreau français. — Tu crois, André
? — Je vous le certifie. — Je pourrai bien finir par là. En attendant, je
vais écraser ce misérable d’Arpajon. »
Pendant
que je racontais à Colombe ce qui s’était passé, et ce que j’allais faire,
Javotte entra au château, sautant, chantant, enchantée de se trouver libre.
Elle me nommait son patron ; je l’appelais ma cliente ; elle me bénissait
; Colombe m’approuvait ; André me louait ; c’était charmant.
Je m’enfermai
dans ma chambre, et je commençai à écrire. Colombe m’appelait pour souper
; je ne l’écoutais pas. Mon indignation et mon enthousiasme étaient au comble,
et je savais déjà qu’un écrivain qui éprouve une grande impression, ne doit
jamais la laisser échapper. J’écrivais avec véhémence ; je présentais les
faits avec clarté ; mon style me paraissait entraînant ; j’étais content
de moi.
On fait
vite et bien, quand on est plein de son sujet. A dix heures sonnantes, mon
mémoire était terminé, j’avais soupe, et je reposais dans les bras de Colombe.
André passa la nuit à copier mon nouveau chef-d’œuvre : il m’en fallait une
copie pour le parlement, dans le cas où le procureur du roi ne se conduirait
pas comme j’avais lieu de l’espérer.
Le lendemain,
de grand matin, je partis pour Étampes, accompagné de mon fidèle André. J’étais
persuadé que j’allais commencer une révolution dans la pitoyable administration
de la justice. André partageait mon opinion.
J’avais
eu occasion de voir le nouveau procureur du roi d’Étampes, quand je présentai
Colombe à ma mère. Je n’avais pas eu à me plaindre de lui, et les rigueurs
salutaires, qu’il exerçait contre tout ce qui sentait l’hérésie, lui avaient
concilié mon estime.
Il
me reconnut et me reçut bien. Je lui présentai mon mémoire, avec la confiance
que m’avait inspirée André, et l’air important d’un auteur satisfait de son
ouvrage. Il le lut rapidement.
« Que
m’apportez-vous là, Monsieur de la Tour ? Un tissu de calomnies. Voilà le
procès-verbal du juge d’Arpajon. Je trouve l’affaire de Bertrand très-bien
jugée parce qu’il est constant qu’il fut l’agresseur. Le juge aurait pu condamner
les détenteurs du cheval et de la charrette de votre fermier, à vingt-quatre
heures de prison. Il n’a pas cru devoir le faire, parce que je lui ai toujours
recommandé d’exercer ses fonctions avec douceur : ce n’est pas dans des temps
de troubles, qu’il faut irriter les esprits. Jusqu’ici, je ne vois rien qui
justifie les plaintes amères que vous portez contre ce magistrat.
« Quant
à cette Javotte, sur laquelle vous vous exprimez avec une chaleur très-inconvenante,
le juge n’a pu se dispenser d’informer contre une femme, traduite et accusée
devant lui. Mais il a seulement voulu l’effrayer, dans le cas où elle se
permettrait une quatrième faiblesse, et ce qui le prouve sans réplique, c’est
que sur votre simple attestation de l’existence de ses trois enfans, elle
a été mise en liberté.
« Croyez-moi,
Monsieur de la Tour, laissez aller le cours des choses, et s’il s’en présente
qui vous paraissent vexatoires, tyranniques, consultez votre raison et votre
jugement, avant que de faire éclater un zèle indiscret. » Il jeta mon mémoire
au feu.
« Monsieur,
me dit André, quand nous fûmes dans la rue, les fripons sont plus adroits
que les honnêtes gens. Notre juge, prévenu du coup que vous alliez lui porter,
vous a devancé, et il faut avouer qu’il a présenté l’affaire au procureur
du roi, avec
une
simplicité, une tournure faites pour le convaincre. — André, je vais à Paris.
— Qu’y ferez-vous ? — J’y traduirai le procureur du roi et le juge devant
le parlement. — Le parlement ordonnera une enquête, et le procès-verbal du
juge lui servira de base. Elle tournera contre vous. Il est beau de protéger
les opprimés ; mais il est dur de l’être soi-même, et c’est ce qui vous arrivera
infailliblement, si vous vous érigez en nouveau don Quichotte.
« L’homme,
m’avez-vous dit un jour, est naturellement porté au bien ; mais ses passions
l’en éloignent. Tous les hommes sont donc passionnés, car il en est bien
peu d’honnêtes. Les passions des grands sont dangereuses en diable, et c’est
précisément à ceux-là que vous auriez affaire. Le peuple est fait pour souffrir.
Qu’il subisse sa destinée, et suivez la vôtre. »
J’allais
combattre les raisonnemens d’André, qui ne me paraissaient pas raisonnables
du tout. Des groupes d’hommes, préoccupés et curieux, se formèrent dans toutes
les rues. On venait de recevoir de grandes nouvelles de Paris.
Des
gens superficiels s’accordaient pour trouver un souverain adroit et ferme
dans Sixte-Quint. Je ne voulais voir en lui que le plus grand des papes.
Il venait de punir le meurtrier d’un cardinal-prêtre, en l’écrasant des foudres
de l’excommunication.
Malheureusement,
l’assassin n’était pas sans ressources. Henri III avait auprès de lui les
Gardes françaises et suisses. D’Épernon lui avait amené quatre mille hommes
d’infanterie, et huit cents chevaux.
L’armée
du vengeur de la Religion, du duc de Mayenne, était plus nombreuse, et elle
était exactement payée, avec l’argent que la sainte Ligue levait dans les
provinces, qui lui étaient soumises. II se préparait à attaquer l’excommunié.
Un homme
frappé par l’Eglise ne peut conserver des sentimens généreux. Henri ne fut
pas rebuté par le mépris avec lequel Mayenne avait reçu ses premières ouvertures.
Il lui fit proposer le gouvernement de la Bourgogne, la nomination de tous
les commandans de places fortes, et de toutes les charges publiques de cette
province. Il offrait au jeune duc de Guise le gouvernement de la Champagne
; celui de la Picardie au duc d’Aumale ; Metz, Toul et Verdun au marquis
de Pont-à- Mousson, fils aîné du duc de Lorraine. L’impie s’engageait à joindre
des places de sûreté à ces gouvernemens. La main du Très-Haut l’avait frappé
d’aveuglement. Il ne sentit pas qu’il abandonnait sa couronne à la maison
de Lorraine.
Ces
princes, sans religion, guidés par des motifs purement humains, ne méritaient
pas de régner sur la France : Mayenne refusera les propositions de Henri.
Que
va faire l’excommunié ? se soumettra-t-il à notre saint père le pape ? Le
suppliera-t-il de lui imposer une pénitence, qui le réconcilie avec l’Eglise,
dont la puissance seule peut désarmer ses ennemis ? Non. Il recherchera la
protection de l’enfer. Il s’alliera avec ce Béarnais, dont les fausses vertus
séduisent ceux qui l’approchent, dont l’épée, à deux tranchans, a été trempée
dans les ateliers infernaux. Ces deux renégats se rencontrent à Tours. Henri
III paraît accablé du poids de l’excommunication. « Soyons vainqueurs, lui
dit gaîment son beau-frère, et nous aurons l’absolution. André, l’homme qui
se rit de pareilles choses est damné par anticipation. — Hé,
Monsieur,
ne damnons personne ; remplissons nos devoirs de chrétiens, et pensons à
nos affaires.
« Vous
ne voulez servir ni le roi de France, ni le roi de Navarre. Vous ne voulez
pas aider Philippe II à dévaster, à asservir notre malheureuse patrie. Laissez
ces enragés s’arranger comme ils l’entendront, et rentrez, pour n’en plus
sortir, dans la classe des citoyens obscurs. — C’est de l’égoïsme que tu
me conseilles là. — Hé, Monsieur, ceux pour qui, ou contre qui vous combattrez,
sont-ils autre chose que des égoïstes ? D’ailleurs, je ne vois aucun parti
que vous puissiez servir. Celui des politiques est disséminé sur toute la
France. Il est composé d’honnêtes gens, qui veulent la paix, qui négocient,
et qui ne se battent pas.
« On
nous dit que les deux rois marchent sur Paris. Mais ils n’y entreront pas
: Mayenne y est avec ses troupes, et leur alliance a porté la fureur du peuple
au plus haut degré. Les curés et les moines proclament Henri de Valois l’ennemi
le plus acharné de la religion catholique. Du haut de toutes les chaires,
ils chargent les deux rois d’anathèmes ; enfin Mayenne commande une population
immense. Dans ce danger pressant, la faction des Seize, et les partisans
du roi d’Espagne se réunissent à lui.
« Que
nous importent les scènes qui se passeront sous Paris ? Votre terre en est
éloignée de huit lieues. Nous n’aurons à y craindre que quelques coureurs,
dont il est facile d’empêcher les approches. Retournons à la Tour et fortifions-nous.
— Tu as raison, toujours raison. Retournons à la Tour.
« —
Par quelle déplorable fatalité des hommes, raisonnables et paisibles, sont-ils,
plus ou moins, forcés à prendre part aux
horreurs
qui accompagnent les guerres civiles ? L’homme, dites-vous, est naturellement
porté vers son bien. En quoi consiste principalement son bien-être ? À vivre
libre, sous de bonnes lois, sagement exécutées. Le despote, au contraire,
tend à accroître sans cesse son autorité. Il ne veut qu’un culte, au nom
duquel il parle ou fait parler. Il ne voit dans les peuples que de vils troupeaux,
qu’il s’arroge le droit de faire égorger, sous son bon plaisir. Il rompt,
il pulvérise les barrières qui s’opposent à sa volonté, et pour perpétuer
l’aveugle soumission des peuples, il perpétue leur ignorance. Mais l’excès
de l’oppression fait renaître, avec certaines modifications, la liberté primitive
de l’homme. Des nations, fatiguées du joug insupportable, qui pesait sur
elles, l’ont secoué, l’ont foulé aux pieds, et, par des actions héroïques,
elles ont forcé leurs oppresseurs à reconnaître leur indépendance. Les Hollandais,
par exemple... — Ne me parle jamais de ces misérables-là : ce sont des huguenots.
— Hé bien, parlons des Suisses dont l’émancipation a prévenu celle de la
Hollande.
« Plusieurs
cantons sont restés catholiques. Celui d’Appenzell est divisé en deux partis,
les rhodes intérieures et les rhodes extérieures. Les premières ont conservé
le culte romain dans toute sa pureté. — Oh, les braves gens ! — On les voit
sur les chemins, sur la cime des montagnes, sur le bord des précipices réciter
leur chapelet. Chez eux, la prière est une introduction aux repas. Ils tombent
à genoux au son de la cloche qui annonce l’angélus. Ils exercent l’hospitalité,
et le voyageur trouve à la porte de chaque maison un bénitier qui l’avertit
qu’il entre chez un catholique romain. — Oh, les braves gens, les braves
gens !
« —
Cette partie du canton d’Appenzell présente un vaste jardin, où tout est
délicieux et varié. Les points de vue, les plus
séduisans,
flattent l’œil étonné, et jettent le spectateur dans une douce rêverie.
« Les
gens les plus laborieux sont ordinairement les plus modérés et les plus sages.
Ce sont eux qui gouvernent les bons Appenzellois. Ce sont des paysans. Mais
ceux-ci ne sont pas courbés sous le poids de la misère, flétris par la servitude
et le mépris ; ce sont de véritables hommes, qui commandent à d’autres hommes.
— Tu me présentes un tableau enchanteur, entraînant. Mais où as-tu appris
tout cela, et où veux-tu en venir ? — Monsieur, tout cela se trouve dans
des livres et j’ai lu avec quelque fruit. Voici maintenant où j’en veux venir.
« Vous
savez que je ne suis pas brave. Cependant je suis incapable de vous abandonner,
et je me laisserai tuer à côté de vous, si vous êtes forcé de combattre.
Mes dernières paroles vous recommanderont Claire et mon petit Antoine, et
mon dernier vœu sera pour vous. » Je l’embrassai avec la plus vive tendresse.
« Mais,
Monsieur, pensez à votre Colombe et à votre enfant. Ne les exposez point
aux orages qui nous menacent de toutes parts, et qui ne tarderont pas à éclater.
— Tu me fais frémir. — Fuyons sur une terre libre. Avec ce qui vous reste
en caisse, nous achèterons un coin de terre, une prairie et un troupeau.
Nous vivrons sans faste, mais dans l’aisance, du lait de nos vaches, de nos
chèvres, de nos brebis, et du produit de notre champ. La maison que nous
avons élevée sur des troncs de sapin, est assez vaste pour loger commodément
deux familles, pour recevoir nos récoltes, et abriter nos bestiaux, pendant
l’hiver. Notre champ s’appellera le champ d’asile.
«
Là, nous vivrons sans maîtres et sans esclaves. Nous ne chercherons à nous
élever au-dessus de personne, parce que personne ne sera au-dessus de nous.
Le magistrat, qui nous parlera au nom de la loi, redeviendra notre égal,
quand il aura rempli ses fonctions. Là, nous instruirons nos enfans dans
ces principes de liberté, qui élèvent l’homme au-dessus de lui- même, et
qui enfantent des héros.
« Là,
ils apprendront à vivre et à mourir pour leur patrie, parce qu’ils en auront
une.
« —
Oh, André, André, tu m’as vaincu, tu m’as gagné !... Mais pourquoi nous borner
à un coin de terre ? Vendons mon fief, et achetons, en Suisse, une grande
et belle propriété. — Ah, Monsieur ! vous n’êtes pas corrigé de vos idées
de grandeur. Elles vous perdraient dans ce pays-là. Vous corrompriez, avec
de l’or, de petits propriétaires. Ils vous vendraient chèrement le modique
héritage de leurs pères. Ils abandonneraient les tombeaux de leurs ancêtres.
Ils seraient méprisés de leurs compatriotes ; vous en seriez haï, vous, la
cause unique de ces désordres, et peut-on être bien, où l’on n’est pas aimé
?
« Vous
parlez de vendre la tour ! Qui vous achètera un château, qui, dans un mois,
dans six semaines, peut être brûlé de fond en comble ? Tous les capitalistes
enfouiront leurs richesses, dussent-ils ne les jamais retrouver, quand le
glaive tombera des mains de barbares, fatigués de s’entr’égorger.
« —
Tu as encore raison, et je ne suis plus retenu que par une considération,
dont tu sentiras la justesse. Je touche au moment d’être père. Exposerais-je
Colombe aux fatigues, aux dangers d’une longue route, dans l’état
où elle est ? —
Prenons
avec nous Marianne, Javotte même, si vous le voulez, et nulle part Madame
ne sera sans secours. — Madame de la Tour deviendrait mère au milieu d’un
grand chemin, comme la dernière des villageoises ! — Ce n’est plus l’homme
dont j’avais excité la sensibilité qui me répond ; c’est le capitaine la
Tour, c’est le possesseur d’un fief, qui ne veut renoncer à aucune de ses
prérogatives. Ne parlons plus de cela. Demain je commencerai à fortifier
votre château. »
Le joli
mois de mai commençait à ranimer la nature, flétrie par les frimas. La trompette
guerrière allait sonner l’heure des combats ; mais aussi la tendre verdure
éveillait les amours ; l’oiseau léger chantait les siens, en voltigeant autour
de nos croisées. Son chant nous plongeait, Colombe et moi, dans une douce
rêverie. On aime à prolonger cette situation, difficile à définir, et qui
tient, à la fois, de la veille et du sommeil. Depuis quelques heures, le
soleil dorait nos champs, quand je m’éloignai du lit conjugal.
Ah,
mon ingénieur en chef a prévenu mon lever. Déjà il a fait deux voyages à
Arpajon. Voyons ce qu’il a fait, et tâchons de deviner ce qu’il se propose
de faire. Nous nous sommes quittés, hier au soir, à demi-brouillés, et je
ne le crois pas disposé à entrer avec moi dans de longues explications. Ce
bon André ! Il voulait faire de moi un laboureur, un pâtre, et Colombe m’a
assuré n’avoir aucun goût pour la vie pastorale. Battons-nous, s’il faut
combattre.
La charrette
du fermier est chargée de je ne sais quoi. Elle a déjà apporté un veau et
deux cochons. Il est constant que le premier soin d’un gouverneur de place
doit être de la fournir de vivres. Ah, qu’y a-t-il dans ce gros sac ? Je
ne me permettrai pas de l’ouvrir, diable ! ce serait manquer essentiellement
à
mon
ingénieur. Mais je peux y porter la main. C’est-du sel : vous verrez que
mon précepteur aura tout prévu. Il me mettra en état de soutenir un siège
d’un mois. En effet, je vois là-bas cinq à six cuviers de différentes grandeurs,
et d’amples vases de terre. Tout cela est destiné à recevoir les salaisons.
Ah !
on décharge la charrette ! Trois sacs ; une poussière blanche annonce du
plâtre ou de la farine. Nous n’avons pas besoin de plâtre ; ainsi la boulangerie
va être, fournie. Six tonneaux pleins ; voilà pour la cave. Trois mousquets,
et deux que nous avons déjà font cinq. Un baril de médiocre grandeur, hermétiquement
fermé ; c’est de la poudre. Une besace bien garnie, d’où s’échappent quelques
balles ; ce sont les munitions de guerre.
André
monte au château et en sort aussitôt. « Madame est éveillée, dit-il ; tout
le monde peut travailler. » Où donc est ce monde ?
Un homme
sort de la cuisine, les manches retroussées, un tablier devant lui, et un
couteau à gaine passé dans sa ceinture ; c’est le bouclier de la place. Six
femmes s’échappent de la basse-cour, et viennent se ranger auprès d’André
: qu’en veut-il faire ? Ma pénétration ne va pas jusque-là. Cependant je
ne parlerai pas le premier, ma position sociale me le défend.
Je continuai
mes observations, autour de ma maison, et dans l’éloignement. Douze à quinze
hommes, la pioche et la bèche à la main, travaillaient à détourner le ruisseau.
Je vois ce que c’est : un fossé large et profond défendra les approches de
la place. Plus loin, j’entends résonner la hache. J’y cours. Des bûcherons
abattent des arbres de deux pieds de circonférence : le fossé sera revêtu
de palissades. Où André a-t-il appris tout
cela,
lui qui ne s’est jamais battu que les yeux fermés ? Ah, il va me parler.
Je ne ferai pas le cruel : j’ai besoin de l’entendre, et de lui répondre.
« Monsieur,
si vous aviez jugé votre fermier digne de respirer le même air que vous,
votre ferme serait enfermée dans mes fortifications. Si on vous attaque,
elle sera brûlée. — Hé bien, mon cher André, tu la rebâtiras. — Cela est
bientôt dit. Mes dispositions exigent de la dépense, et il vous restera peu
de chose de vos épargnes, quand j’aurai tout payé. Avec ce que coûteront
les fortifications de la place, vous vous seriez procuré un bien-être certain
dans le canton d’Appenzell. — Tu es opiniâtre, André. — Au contraire, Monsieur
; vous voyez bien que je vous mets en état de tenir ici, comme si vous n’aviez
pas d’autre ressource. — Mais comment fais-tu donc pour avoir toujours raison
? — Je réfléchis avant que d’agir, et tant d’autres ne réfléchissent qu’après.
— Une épigramme, André !
— Il
faut bien que je me venge un peu du mal que vous vous faites. »
Le soir,
les viandes étaient dans les saloirs ; l’étang était à sec ; le poisson était
salé, et tout cela attendait un siège, rangé au fond de mes caves. Voilà
à quoi André avait employé ces femmes, dont je n’avais prévu la destination.
Il ne
perdait pas un moment. Au clair de la lune, il fit monter ses farines dans
mon grenier, et tirer son vin dans de petites bouteilles, dont chacune devait
faire une ration. « Tout cela est très-bien, mon cher André. Mais où est
la garnison pour laquelle tu as empli tes magasins ? — Je la trouverai, Monsieur,
quand il en sera temps. »
Il
fallait qu’il comptât les jours, les heures, les minutes. Nous savions que
toutes les villes, situées sur la route de Tours à Paris, ouvraient leurs
portes aux deux rois, ou étaient enlevées l’épée à la main ; que Mayenne
était accouru pour mettre un terme à ces succès ; mais que dix mille Suisses,
et deux mille cavaliers allemands avaient joint les troupes royales devant
Pontoise. Henri III était à la tête de quarante mille combattans. Mayenne,
poussé par les deux renégats, s’était hâté de rentrer dans Paris. Nous avions
cette ville entre le théâtre de la guerre et nous ; mais, si le siège en
était arrêté, les opérations militaires pouvaient nous exposer aux plus grands
dangers.
Colombe
avait constamment entendu parler de guerre auprès de madame la maréchale.
Elle avait vu de près le prince de Condé et Livarot. Elle était tranquille
; elle croyait avoir vu la guerre. La pauvre jeune femme n’avait entendu
ni le bruit du canon ni celui de la mousqueterie. Je me gardai bien de troubler
sa sécurité. Je me gardai aussi de faire part à André de mes pressentimens
: il m’eût parlé encore de son canton d’Appenzell, et de sa vie pastorale.
Au bout
de huit jours, ses dispositions étaient terminées. Un fossé de quinze pieds
de large, sur six de profondeur, entourait ma maison. Il était complètement
palissadé de notre côté. Ainsi il fallait que les agresseurs, après avoir
passé le fossé, arrachassent les palissades, ou les escaladassent. Les murs
de mon château étaient crénelés, les planchers de chaque étage étaient percés,
en plusieurs endroits. Nous pouvions commencer notre feu quand on tenterait
le passage du fossé, et le continuer, à bout portant, d’étage en étage, si
l’ennemi parvenait à enfoncer les portes.
Trois
ligueurs d’Arpajon, ennemis jurés des deux rois, étaient entrés dans notre
forteresse, avec leurs femmes et neuf enfans. Ils juraient de les sauver,
ou de mourir. Il me parut qu’André avait fait un bon choix.
Thomas
et Catherine vinrent me supplier de leur accorder un asile. Laisser ruiner
mes fermiers, c’était me ruiner moi-même. D’ailleurs j’aimais ces bonnes
gens. Ils entrèrent avec leurs marmots, leurs bestiaux, et ce qui restait
dans leurs granges. Que de bouches inutiles ! Claire, Marianne, la fille
de basse- cour en augmentaient le nombre. Le bas de ma maison, ma basse-cour,
les remises, les écuries, les hangars, tout était encombré.
Ce ruisseau,
qui serpentait dans nos bosquets, et qui y répandait la fraîcheur, était
desséché. Nos bois étaient dévastés. L’oratoire de Saint-Antoine était à
demi-écrasé par la chute des arbres, transformés en palissades.
Déjà
on n’entrait plus chez moi, et ou n’en sortait qu’à l’aide de cette nacelle,
dans laquelle nous nous promenions sur ce vaste étang, qui n’existait plus.
On l’avait transportée, à force de bras, dans les fossés de la place. Tristes
effets de ces passions désordonnées qui allument les guerres civiles !

Henri
III et le futur Henri IV
CHAPITRE
XXV.
La
Tour reçoit le coup le plus terrible, dont il pût être frappé.
C’est
au milieu du désordre, et des craintes, que je dissimulais, que je devais
être père. Colombe éprouva ces douleurs, qui m’eussent comblé d’espérances
et de joie, dans d’autres circonstances. Sous quels tristes auspices elle
va devenir mère ! Ah, si j’avais suivi les conseils d’André, elle serait
en sûreté au canton d’Appenzell. Elle respirerait un air libre ; elle y jouirait
de toutes les douceurs de la maternité. Réflexions trop tardives, et par
conséquent mutiles !
Je ne
voulus m’en rapporter à personne du soin de procurer à ma Colombe les secours
qui lui étaient nécessaires. Je courus à Arpajon, et je cherchai la matrone,
qui avait soigné Claire, pendant quelques jours. Les habitans étaient plongés
dans les plus vives alarmes, et personne n’était en état, de répondre à mes
questions : chacun s’occupait de soi. Les uns barricadaient leurs maisons
; les autres fuyaient avec leurs femmes, leurs enfans, et ce qu’ils avaient
de précieux.
L’enfance
joue partout, tant que la faim ne se fait pas sentir ; elle joue même avec
la faulx de la mort, qui ne lui inspire aucune crainte, parce qu’elle est
sans prévoyance. Un petit garçon rassemblait les effets, qui tombaient des
bras des fuyards ; il en faisait un tas, duquel, me dit-il, il allait faire
un feu de joie. Je l’interrogeai, et, pour une petite pièce d’argent,
dont
il n’avait plus besoin, dans un bourg en combustion, il me conduisit à la
porte de la matrone. Je la trouvai cachée dans une armoire.
Sa tête
n’était plus à elle. Je lui dis que j’allais la mettre en sûreté ; elle refusa
de me suivre. Je la pris dans mes bras, et je l’emportai.
Le grand
air, des paroles consolatrices et rassurantes la rendirent à elle-même. Elle
me fit promettre que je la garderais à la Tour, jusqu’à ce que l’orage qui
menaçait le canton fût dissipé, et elle consentit à marcher.
Je n’avais
aucune idée précise des dangers qui allaient fondre sur nous. Je la pressai
de questions. A travers des mots entrecoupés, et souvent sans suite, je découvris
que bientôt nous n’aurions de salut à attendre que de notre courage.
Les
deux excommuniés s’étaient emparés de tous les points, qui rendaient Paris
accessible. Ils étaient maîtres du cours de la Seine, et ils interceptaient
les convois de vivres, destinés aux habitans de cette ville immense. On excite
facilement les fureurs populaires ; elles s’éteignent à l’aspect de la misère
et du châtiment.
La consternation
était générale dans Paris. Les troupes de Mayenne désertaient par pelotons,
et allaient demander du pain aux impies. Le Béarnais, fidèle à son système
infernal, les accueillait, les nourrissait : il voulait faire des huguenots
de tous les Français.
Les
Parisiens, qui attendaient la vie de leur obscurité, criaient qu’on leur
ouvrît les portes. Des aventuriers, des brigands,
excités
par la faim, et la soif du pillage, se répandaient dans les campagnes. Déjà
quelques-uns d’entre eux avaient paru à Arpajon, et y avaient porté le désordre,
et les alarmes.
J’avais
cru, jusqu’alors, les opérations militaires fixées du côté de Pontoise. Le
blocus de Paris avait étendu le danger sur tous les points.
Nous
approchions de la Tour. Je me tournais souvent du côté d’Arpajon, et cette
précaution ne fut pas inutile. Quatre ou cinq misérables nous avaient aperçus,
et nous poursuivaient. Ils étaient mal armés ; cependant, je ne l’étais pas
moi-même, et je ne pouvais leur résister. « Je reverrai Colombe, m’écriai-je.
Je saisis fortement la matrone par un bras ; je la poussais, je la traînais,
et je courais aussi rapidement que me le permettait le fardeau, dont j’étais,
à peu près, chargé.
Cependant
ces brigands gagnaient considérablement sur moi. J’approchais du fossé ;
mais la nacelle était de l’autre côté. C’est là qu’il fallait mourir. Je
pris une pierre de chaque main, décidé à disputer une vie, que je ne pouvais
plus sauver.
…..
Un coup de mousquet partit d’une des croisées du château. Un de ces pillards
tomba, frappé à mort. Les autres s’arrêtèrent. Ils délibérèrent, pendant
quelques secondes, et ils prirent la fuite. La nacelle passa, et nous recueillit.
Je me
rendis auprès de Colombe, et je ne la quittai plus. La matrone prononça qu’elle
serait bientôt mère, et la joie rentra dans mon cœur, flétri, quelques minutes
auparavant. Il arriva enfin ce moment si vivement désiré. J’attendais un
fils ; je reçus une fille. Son premier cri me fit éprouver une sensation
si délicieuse, qu’on ne doit l’éprouver qu’une fois.
Tout
était en mouvement dans le château. André avait distribué, à chacun, le travail,
auquel il était propre, et il avait établi le plus grand ordre partout. Tous
étaient satisfaits : ils voyaient leur subsistance assurée, et ils étaient
traités avec une douceur, à laquelle les seigneurs n’avaient pas accoutumé
leurs vassaux. Nous n’étions que cinq disposés à combattre ; mais nous étions
pleins d’ardeur, et notre position nous rendait presqu’invincibles.
Je passai
le reste de la journée auprès de Colombe. Nous étions trois alors, et le
petit être, que nous tenions de la bonté de mon patron, partageait avec nous
les plus tendres caresses.
« Monsieur,
me dit André, à la nuit tombante, il nous reste encore huit mille livres,
il faut les mettre en sûreté. L’oratoire de Saint-Antoine est en ruines,
et il n’y a rien là à prendre. Les pillards ne s’y arrêteront pas. C’est
sous cette chapelle qu’il faut cacher notre petit trésor. Nous ne devons
pas craindre une attaque de nuit ; marchons.
Il y
avait une heure qu’André avait sonné la retraite, avec un cornet-à-bouquin.
On n’entendait plus aucun bruit dans le château. Nous prîmes nos sacs,
des pioches et des bêches, et nous passâmes le fossé du côté des bosquets
dévastés.
« Il
est important, dit André, que nous soyons deux. Il est possible qu’un de
nous survive à ce moment de crise, et cet argent ne sera pas perdu. »
Nous
creusâmes dans l’intérieur de la chapelle, à l’aide d’une lanterne sourde.
Nous enterrâmes nos sacs ; nous les couvrîmes de terre, et des débris du
toit, qui étaient autour de nous. Nous rentrâmes au château, et mon
premier soin fut d’instruire
Colombe
de ce que nous venions de faire. Elle tenait ma fille dans ses bras. L’enfant
pressait, de ses lèvres purpurines, et de ses petites mains, le sein charmant
que lui avait présenté sa bonne mère. Je me jetai sur un matelas à côté d’elles.
À la
pointe du jour, je montai sur la plate-forme de la tour. La campagne était
couverte de brigands et de fuyards. Ah, ceux qui obéissent à l’aiguillon
de la faim, ne sont des brigands que pour l’homme riche, qui ne voit que
lui au monde. Je les plaignais ; mais je ne pouvais leur sacrifier l’existence
de Colombe, de sa fille et la mienne.
Bientôt
quarante ou cinquante de ces malheureux se rassemblèrent ; ils avaient des
armes à feu. Il n’était pas vraisemblable qu’un château fortifié ne fût pas
pourvu de vivres. Ils se dirigèrent vers la tour, marchant sans ordre, et
probablement sans chef. J’allai embrasser Colombe, peut-être pour la dernière
fois, je descendis précipitamment ; et je criai aux armes.
André
m’avait prévenu qu’il était incapable de se battre ; mais fidèle à sa promesse,
il se tint constamment auprès de moi.
Un homme
se détacha de la troupe, et s’avança jusqu’au bord du fossé, un chiffon blanc
à la main : « Nous ne voulons pas vous faire de mal ; nous ne voulons que
du pain, et vous nous en donnerez. » Faire ce qu’exigeaient ceux-ci, eût
été attirer sur nous, successivement, tous les ligueurs qui étaient sortis
de Paris. Je répondis, avec fermeté, que nous n’avions que ce qui nous était
rigoureusement nécessaire. Nous n’avions de vivres, en effet, que pour un
mois, pour six semaines au plus.
L’envoyé
retourna vers sa troupe, qui s’avança aussitôt. Chacun de nous était à son
poste. Une décharge générale nous fit juger que nous étions attaqués vivement.
Nous étions à l’abri des coups, et par conséquent personne ne fut touché.
Nous ripostâmes, et nos cinq coups portèrent. « Ceux-là sont heureux, crièrent
les assaillans : ils ne souffriront plus de la faim. »
Il est
impossible de tout prévoir. La nacelle aurait dû être attachée à un fort
pieu, par une chaîne de fer. Elle ne l’était qu’avec une corde. Une seconde
décharge de l’ennemi la coupa. La nacelle fut entraînée par le cours de l’eau
et les ligueurs cherchèrent à la saisir. Nous étions placés derrière les
palissades, et j’ordonnai de tirer seulement sur ceux qui s’approcheraient
du bateau. Ils étaient protégés par le feu de leurs compagnons, qui nous
empêchaient de nous montrer à découvert ; mais nous ajustions à travers les
intervalles, que laissaient des arbres noueux, qu’on n’avait pas eu le temps
d’écarrir. André, pâle, défait, avait perdu toutes ses facultés morales.
Je le forçai à s’asseoir. Bientôt un incendie violent éclata sur notre gauche.
C’étaient ma ferme, et les bâtimens de Richoux qui brûlaient. Je prévis les
maux qui nous attendaient, si nous étions vaincus.
Quelques
ligueurs saisirent enfin la nacelle. Les premiers qui y entrèrent furent
tués à coups de mousquet, et d’autres les remplacèrent, en criant : du pain,
du pain ! Ils me brisaient le cœur. Nous ne pouvions charger nos armes assez
promptement pour faire face partout. Quatre ou cinq hommes passèrent
; d’autres les suivirent à la nage. Ils s’accrochèrent aux palissades.
J’avais
prévu cet incident. De vieilles épées, des broches de cuisine, de gros marteaux,
des haches, étaient couchés par terre,
et
renversèrent les premiers, qui tentèrent d’escalader notre retranchement.
Un événement imprévu, terrible, suspendit nos coups.
Colombe
m’appelait à grands cris. Elle avait fait de vains efforts pour s’échapper
de son lit. Claire, Marianne, et la matrone, l’y avaient retenue jusqu’alors.
Sa tendresse pour moi, ses alarmes, avaient doublé, triplé ses forces. Celles
des femmes qui la gardaient étaient épuisées. Elle s’échappa.
Elle
vint se ranger près de moi, pâle, échevelée, et presque nue. « Que deviendra
ta fille, lui dis-je, si nous périssons ici tous deux ? Elle ne me répondit
pas un mot. Elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine, et elle s’éloigna.
Ce moment
fut court, très-court, et cependant le danger était accru d’une manière alarmante.
Sept hommes avaient escaladé les palissades, et s’étaient placés de manière
à nous couper la retraite sur le château. Il fallut combattre corps à corps.
Bertrand et moi nous tombâmes sur eux, lui avec une masse de fer, moi avec
mon épée. Nous nous précipitâmes au-devant des coups : il n’y avait peut-être
que ce moyen-là de les éviter. Trois ligueurs tombèrent à nos pieds. Les
quatre autres jetèrent leurs armés et nous demandèrent la vie, et un morceau
de pain. Je leur promis l’un et l’autre, et je leur ordonnai de se retirer
dans la basse-cour. Ils devaient y trouver de quoi apaiser leur faim.
Quelques
coups de mousquet s’étaient fait entendre derrière nous. Je retournai aux
palissades, avec mon brave et fidèle Bertrand.
D’autres
ligueurs avaient ressaisi la nacelle. Ils voulaient venir seconder leurs
camarades. Tout était fini pour nous, s’ils eussent, passé. Nos trois compagnons
d’armes avaient eu le temps de recharger leurs mousquets ; leurs coups portèrent.
Bertrand et moi tirâmes les nôtres ; mais que pouvaient cinq coups de feu
sur des hommes poussés au dernier désespoir ? Les morts furent aussitôt remplacés
par d’autres, qui se précipitèrent dans la nacelle. Ils la surchargèrent
au point que la barque chavira au milieu du trajet. Quelques-uns regagnèrent
le rivage, d’où ils venaient de s’éloigner. Le plus grand nombre périt par
l’eau, ou par notre feu.
Nous
comptâmes à peine quinze hommes de l’autre côté, et quelques-uns étaient
blessés. Ils se retirèrent hors de la portée du mousquet, délibérèrent un
.moment, et disparurent.
Je cherchai
mon bon André. Je le trouvai évanoui, où je l’avais laissé. Son bras droit
était ensanglanté. Je coupai la manche de son pourpoint. Une balle avait
percé les chairs, je ne sais à quel moment.... S’il eût pu prendre sur lui
de se battre, peut-être n’eût-il pas été touché. La frayeur ne sauve pas
celui qui en est frappé ; elle rend le danger inévitable.
Nous
le prîmes, Bertrand et moi, et nous le portâmes sur son lit. J’appelai Claire
et la matrone. Elles préparèrent aussitôt ce qu’il fallait pour le pansement.
Les matrones savent un peu de tout, et nous n’avions pas de chirurgien.
Il avait
fallu faire face de tous les côtés, pendant trois heures, et nous étions
tous excédés. J’ordonnai à Bertrand de distribuer double ration aux hommes,
de ne pas s’oublier, et de se mettre en vedette sur la plate-forme de la
tour, jusqu’à ce que la nuit
vînt
assurer notre tranquillité, au moins pour quelques heures. J’entrai chez
Colombe.
Elle
était endormie, ou accablée. Les alarmes, qui l’avaient si vivement tourmentée,
rendaient la seconde opinion vraisemblable. Notre petite dormait à côté de
sa mère. Je les embrassai toutes deux, avec un sentiment de satisfaction
bien naturel : je venais de leur sauver la vie.
Je descendis
à la cuisine, et je pris ce qui se trouva sous ma main. J’avais besoin de
rétablir mes forces physiques et morales.
J’entendis
le bruit de quelques coups de mousquet. Il me parut venir du côté de la basse-cour,
et j’y courus.
Quel
spectacle s’offrit à mes yeux ! André, son bras suspendu à une écharpe, venait
de commander le feu. Sur qui fut-il dirigé ? sur les quatre malheureux
à qui j’avais accordé la vie. On venait de leur faire sauter la cervelle.
J’éprouvai un mouvement d’horreur inexprimable.
André
avait l’habitude de lire sur ma physionomie.
« Monsieur,
me dit-il, ces misérables ont mérité leur sort. Ils ont commencé par s’enivrer,
et ils ont fini par outrager ces femmes, qui s’étaient empressées d’apaiser
leur faim. Leurs maris, indignés, connaissent votre sensibilité, et sont
venus m’apprendre ce qui se passait. Je me suis levé à la hâte. Vous savez
le reste.
« Réfléchissez,
d’ailleurs, Monsieur, combien était déplacée la clémence dont vous aviez
usé à leur égard. Vous ne pouviez garder ici des inconnus ; vous les eussiez
donc renvoyés. Leurs
compagnons
se sont retirés, persuadés qu’ils avaient eu affaire à des forces supérieures.
Ces quatre misérables leur eussent fait connaître et notre faiblesse, et
les ressources que leur offrait l’intérieur du château. Un second combat
vous eût été livré demain, et cinq hommes fatigués eussent-ils pu le soutenir
? savez-vous enfin à quel nombre vous auriez eu affaire ?
« Je
redoute autant que vous, l’effusion du sang humain. Mais ces quatre malheureux
se fussent-ils conduits avec sobriété et décence, c’étaient des victimes
qu’il fallait sacrifier à la sûreté commune. » Je ne répondis pas un mot.
Je retournai près de Colombe.
Quel
fut mon étonnement ! Ma petite fille était, suspendue au sein de Claire.
Une idée terrible me frappa, et je ne pus retenir un cri de terreur. Colombe
ouvrit les yeux, me reconnut, et me sourit. Je me jetai dans ses bras. «
Ne pleure pas, mon ami, tout ira bien, je l’espère. »
Je
conduisis la matrone dans un coin de la chambre.
« Madame,
me dit-elle, a éprouvé une révolution cruelle. Elle a perdu son lait ; mais
elle n’a pas encore de fièvre. »
Éperdu,
hors de moi, je sortis, et je descendis sur le bord du fossé. Je voulais
le traverser. La nacelle transportait les cadavres à l’autre bord. J’attendis
son retour. J’y montai ; André s’y plaça auprès de moi. « Pauvre blessé,
soigne-toi. — Hé, qui vous soignera, vous ? »
Nous
arrivâmes aux débris de la chapelle. Je me saisis de la statue mutilée de
mon patron. André prit quelques cierges brisés, et nous retournâmes vers
le château, dans le plus profond silence. « Que voulez-vous faire de cela,
me dit-il, quand nous
fûmes
dans la nacelle ? — Mon ami, l’homme qui redoute un grand malheur porte ses
regards vers le ciel. Il y cherche l’espérance et des consolations. Je vais
placer l’image de mon patron, près du lit de Colombe ; nous allumerons ces
cierges, et nous prierons. — Qu’allez-vous faire, Monsieur ! Persuader à
madame que sa vie est en danger, et joindre le mal de la crainte à celui
qu’elle éprouve déjà ? » Je n’étais plus qu’un enfant. Je me laissai conduire.
André
plaça sous la chambre de Colombe l’image de saint Antoine, et il alluma les
cierges. « Ils sont bénits, lui dis-je. Leur chaleur montera jusqu’à elle,
et lui donnera des forces. » Je me mis à genoux, et je priai.
Quand
je me relevai, André n’était plus avec moi. Frêle roseau, j’avais besoin
d’un appui. Je cherchai mon ami fidèle. Il était dans la basse-cour. Il y
dirigeait la confection d’un traîneau, qui devait traverser le fossé, et
traîner au loin les cadavres gisans sur les bords : nous n’avions pas assez
de bras pour les rendre à la terre. Cette dernière opération se fit pendant
la nuit.
Je ne
quittai plus Colombe du reste de la journée. Mes yeux étaient sans cesse
fixés sur cette figure céleste. Aucune de ses variations ne m’échappait.
Je remarquai que sa pâleur commençait à disparaître sous des roses, qui percèrent
bientôt d’une manière sensible. Elles ramenèrent une sorte .de tranquillité
dans mon âme. Cependant je craignis de m’en rapporter uniquement à moi. J’examinai
scrupuleusement les trois femmes qui étaient dans la chambre. Les physionomies
de Claire et de la matrone étaient dépourvues d’expression. Celle de Marianne
exprimait de l’anxiété, et une profonde tristesse.
Peut-être,
pensai-je, a-t-elle laissé des parens à Arpajon, et est- elle tourmentée
d’inquiétudes bien naturelles.
André
entra et me pressa de prendre un peu de repos. J’en avais le plus grand besoin,
et je me jetai dans un fauteuil. Je m’endormis bientôt. Comment pus-je dormir
?
Le soleil
reparaissait, pur et brillant, quand je m’éveillai : les tourmens de quelques
malheureux n’influent pas sur la marche de la nature. Elle suit les lois
éternelles auxquelles le grand être l’a soumise.
Je m’approchai
du lit de Colombe. Un rouge ardent brûlait ses joues. Je lui pris la main,
et je sentis son pouls battre, avec une extrême violence. Je descendis et
j’appelai Bertrand. André était derrière moi. « Où allez-vous ? Que voulez-vous
faire ? — Je vais chercher un médecin à Arpajon. — Vous allez vous faire
tuer ? — Hé, si ma femme succombe, ne faut-il pas que je meure ? »
André,
blessé, ne voulut pas me quitter. Nous traversâmes le fossé tous les trois.
Bertrand et moi avions un mousquet en bandoulière, des pistolets à notre
ceinture et l’épée au côté. Nous n’avions pu faire sortir ma voiture et mes
mules. Il fallut marcher, et ce moyen ne répondait pas à mon impatience.
Vers
la moitié, du chemin de mon château, à Arpajon nous rencontrâmes un gros
de cavalerie. André pâlit. « Voilà votre dernier moment, me dit-il ; je ne
vous survivrai pas. » Il fut présenter sa poitrine découverte au commandant.
Notre dernière heure n’avait pas sonné. Cet officier l’interrogea. André
n’avait plus sa tête à lui. Il raconta, péniblement, et d’une manière diffuse,
les événemens de la veille. L’officier nous fit signe
d’approcher.
« Si les choses, me dit-il, sont telles que cet homme vient de me les raconter,
vous vous êtes conduits en gens de cœur et vous avez usé du droit naturel,
qui nous permet une défense légitime. Les faits furent bientôt constatés
: tous les passans déposèrent en notre faveur. C’étaient des habitans d’Arpajon,
qui rentraient tranquillement dans leurs foyers.
Je ne
concevais pas leur sécurité. Le commandant nous apprit que ce changement
était la suite de la mort récente de Henri III. Le premier soin de Henri
IV, avait été de purger les environs de Paris des brigands qui les désolaient.
Le maréchal de Biron et le duc de Luxembourg avaient secondé ses vues bienfaisantes,
et ils avaient dirigé des détachemens de cavalerie sur tous les points.
Les
vues bienfaisantes d’un huguenot ! Je jugeai les opinions de l’officier qui
me parlait, et je m’éloignai de lui. D’ailleurs, je n’avais pas un moment
à perdre. André resta auprès de ce commandant : il était curieux, et voulait
connaître les détails de la mort de Henri III.
Nous
entrâmes à Arpajon, Bertrand et moi. Nous cherchâmes un médecin, de maison
en maison. Nous n’en trouvâmes qu’un. Il n’avait pu fuir avec ses compatriotes
: il était goutteux et impotent. Il ne pouvait nous être utile.
J’allai
au presbytère ; le curé n’y était pas rentré encore. Je courais d’un côté,
Bertrand allait de l’autre, et nos recherches étaient infructueuses. Je me
désolais.
Un habitant
eut pitié de la douleur qui me brûlait. Il avait exercé la chirurgie autrefois,
et s’était retiré à Arpajon, avec une
honnête
aisance. Il consentit à me suivre. Je tombai à ses pieds, et j’en baisai
la poussière.
Un colporteur
passa près de nous. Il criait la grande complainte, annonçant la mort de
l’excommunié, effectuée par saint Jacques Clément, religieux dominicain et
martyr. En tête de la complainte était le portrait du saint. On avait gravé
ces mots au bas : Saint Jacques Clément, priez pour nous. J’en pris
un exemplaire, et nous partîmes.
Nous
précipitions notre marche ; mais nous avions une grande demi-lieue à parcourir.
J’étais rongé d’inquiétude, dévoré d’impatience ; je m’épuisais et j’avançais
peu. J’aurais donné tout ce que je possédais pour avoir une voiture.
André
nous avait joints à notre sortie d’Arpajon. Il s’approcha de moi, passa son
bras sous le mien, et m’aida à marcher. Il aurait eu besoin d’être soutenu
lui-même : sa blessure le faisait souffrir. Il s’oubliait pour moi.
Il essaya
de me distraire. Il me raconta les grandes nouvelles qu’il avait apprises
de l’officier de cavalerie. Elles étaient de nature à me forcer d’écouter.
Les
deux rois se disposaient à livrer un assaut général aux faubourgs de Paris.
Henri III jura qu’il n’y laisserait pas une maison debout. Mayenne résolut
d’aller chercher la mort dans les rangs ennemis.
Un jeune
dominicain, nommé Jacques Clément... « Un ange, m’écriai-je, » résolut de
venger la religion catholique. Les prédications incendiaires... « salutaires,
» dont retentissaient les églises de Paris, avaient exalté ce jeune homme.
Son prieur,
Bourgoing,
nourrissait, en secret, ses fatales dispositions. « Son saint zèle, André,
son saint zèle. » La duchesse de Montpensier, sœur du duc de Guise, se prostitua
à Bourgoing, sous la condition expresse que Henri III serait assassiné. «
C’est une nouvelle Judith ! que mon patron la protège ! »
Bussy-Leclerc
retenait à la Bastille le comte de Brienne, et le premier président du Harlay.
Clément se présenta devant eux, protesta de son attachement à la personne
du roi, et du désir de faciliter l’entrée de ce prince dans Paris. Il leur
demanda un passe-port, indispensable pour pénétrer jusqu’à Henri. Un projet
de soumission circulait sourdement dans Paris. Les deux prisonniers en connaissaient
quelque chose. Ils crurent Clément, chargé de quelque négociation secrète
; ils lui délivrèrent le passe-port.
Il sortit
de Paris à la nuit tombante, et se dirigea sur Saint- Cloud, où était le
quartier-général du roi. «De l’excommunié. » Il fut arrêté par les gardes
avancées, et conduit devant Jacques de Laguesle, intendant de l’armée royale.
« Troupes madianites. »
Laguesle
lut son passe-port, et lui dit qu’il ne pouvait obtenir d’audience à cette
heure. Il l’invita à souper, et à coucher dans son logement. Clément coupa
son pain avec un large couteau qu’il portait à sa ceinture. Il mangea, but
et, dormit tranquillement. « Son sommeil était celui du juste. »
Le lendemain,
de grand matin, Laguesle avertit le Roi qu’un jeune religieux, arrivé de
Paris, sollicitait l’honneur de lui parler. « L’honneur ! » Il ordonna que
le dominicain fût aussitôt introduit. Il sentit de la joie en le voyant
s’approcher : son cœur
s’épanouissait
toutes les fois qu’il voyait un moine. « Et il avait assassiné
un cardinal prêtre ! »
Le roi
conduisit Clément dans l’embrasure d’une croisée, et reçut de lui une lettre,
que lui avait écrite le président du Harlay. Pendant que le Roi la lisait,
le dominicain lui plongea son couteau dans le ventre. Henri retira lui-même
le fer de sa plaie, et en frappa l’assassin au-dessus de l’œil. « Assassin
! Ange exterminateur ! »
Laguesle
passa aussitôt son épée au travers du corps de Clément. Les gentilshommes
de la chambre jetèrent le cadavre par une fenêtre. Les soldats le mirent
en pièces, le brûlèrent, et jetèrent ses cendres dans la Seine. « Saint Jacques
Clément, priez pour nous. »
Le roi
expira le lendemain, et sa mort releva le courage des Parisiens. Les duchesses
de Montpensier, mère et bru, montèrent sur un char magnifique, parcoururent
les rues de Paris, et ordonnèrent des fêtes publiques. Des feux de joie furent
allumés sur toutes les places publiques. On plaça, sur tous les autels de
la capitale, le nom de Jacques Clément, écrit en gros caractères. On proposa
de lui ériger une statue. « Je veux être mis au nombre des souscripteurs.
»
Nous
étions arrivés sur les bords du fossé. Je contemplai, d’un œil avide, les
croisées de la chambre de Colombe, et toutes mes idées politiques s’évanouirent.
La nacelle
vint nous prendre. Je demandai à un de nos ligueurs qui la conduisait, dans
quel état était la bien-aimée.
« La fièvre
est forte, me répondit-il. — Et son lait ? — Il n’a
pas
reparu. » Je fixai mon vieux chirurgien. Sa figure était impénétrable
comme celle de Claire et de la matrone.
Je ne
pus attendre que la barque fût amarrée. Je sautai dans l’eau jusqu’à la ceinture
; je courus, je volai.
Quel
spectacle s’offrit à moi ! Un délire épouvantable s’était emparé de Colombe.
Les trois femmes qui la gardaient pouvaient à peine la retenir dans son lit.
Elle m’appelait à grands cris. Elle ne me connaissait plus. Je m’élançai
sur ce lit de douleur. On me porta à l’autre extrémité de la chambre.
Le chirurgien
examina la malade adorée. Il prononça qu’une saignée au pied pourrait dégager
la tête, et il la fit copieuse. Un peu de calme parut une heure après. J’espérais,
je frissonnais, j’espérais encore, je tombais dans le désespoir.
Claire
profita du moment où elle n’était pas nécessaire auprès de la malade, pour
déshabiller André et le faire panser : il l’avait été mal la veille, et
on n’avait pas levé le premier appareil. Le chirurgien trouva de l’inflammation
à la blessure ; mais il répondit des suites, si le blessé voulait se laisser
conduire. Il ne répondait que d’André !
Colombe
paraissait légèrement assoupie. Claire fit téter les deux enfans. J’étais
à genoux devant le lit. J’invoquais toutes les puissances célestes. Une voix
semblait me répondre : Le ciel la réclame. « Et la terre, m’écriai-je, dont
elle est le plus bel ornement ! Ah ! cette vie n’est qu’un passage. Heureux
qui arrive rapidement de celle-ci à une meilleure. Mais les survivans !...
Le
reste de la journée s’écoula dans des alternatives d’espérances et d’alarmes.
La nuit vint. Les ténèbres ajoutent à l’horreur d’une situation désespérante.
Plus un moment de distraction à espérer. La nature vivante sommeillait autour
de moi. Des cierges de cire jaune répandaient une lumière, pâle et lugubre,
sur cette figure angélique. Je croyais voir la faulx de la mort planer sur
ce lit où était mon univers.
Il était
minuit, et le calme se soutenait. Elle ouvrit les yeux, me reconnut et me
tendit les bras. Je m’y précipitai. On eut la cruauté de m’en arracher. Le
chirurgien craignait les émotions fortes, et il avait raison.
Bientôt
une crise plus violente que la première se manifesta. On répéta la saignée.
Celle-ci ne produisit aucun effet. Le délire se soutint, sans interruption,
jusqu’au jour, et il était effrayant.
L’âme
la plus pure rêvait l’enfer et ses tourmens. Ils étaient au fond de mon cœur.
André
se permit de s’élever contre les vices de notre première éducation. Je n’eus
pas la force de lui imposer silence.
Il fallait
que l’accès se calmât ou qu’elle pérît. J’interrogeais à chaque instant le
chirurgien. Il finit par me rappeler à la résignation que commande le christianisme.
« De la résignation ! Je n’en ai pas. Je méconnais des lois injustes, tyranniques.
Je brave une puissance, qui nous accable de maux, et qui se joue de nos souffrances…..
Pardonnez-moi, mon Dieu !..... J’ai osé vous blasphémer, vous qui vouliez
que je me fisse un mérite du coup dont vous me menacez….. » J’étais à genoux,
deux ruisseaux de larmes sillonnaient mes joues.
«
Rendez-la moi, mon Dieu, rendez-la moi !.... »
La
fièvre tomba tout à coup ; mais ses forces étaient épuisées ; elle n’avait
plus qu’un souffle de vie. Elle demanda sa fille d’une voix mourante. Elle
l’embrassa à plusieurs reprises, et la rendit à Claire, en la lui recommandant.
Elle me fit signe de m’approcher. Je lui pris la main. Elle m’adressa un
regard qui avait quelque chose de céleste. Elle voulut parler. Les mots expirèrent
sur ses lèvres. Ses yeux se fermèrent... Ils ne devaient plus se rouvrir.
Je ne
vis plus rien ; je n’entendis plus personne. Mon regard était fixe ; mes
muscles étaient tendus ; ma poitrine était gonflée ; je ne respirais qu’avec
des efforts violens. J’attendais la mort ; je l’invoquais ; elle ne vint
pas. « Je te suis, je te suis, m’écriai-je d’une voix étouffée. » Je m’élançai
vers une croisée ; j’allais l’ouvrir... Le chirurgien et Bertrand m’en arrachèrent.
André
mit ma fille dans mes bras. « Voilà celle à qui vous vous devez maintenant
tout entier. Voilà celle qui vous ordonne de vivre. Si vous la repoussez,
la Religion, dont vous parlez sans cesse, n’est pour vous qu’un vain mot,
dont vous aurez abusé, comme en abusent les tyrans de toutes les professions.
Oserez-vous me rendre cette enfant ? — La repousser ! Jamais, jamais ! Oui,
je vivrai pour toi. Je le jure par ta mère. »
Tous
ceux qui m’entouraient fondaient en larmes. Ils m’enlevèrent de ce lieu de
désespoir. Ils m’entraînèrent à l’extrémité de la maison... je ne sais où,
dans la chambre d’André, peut-être. J’y restai autant qu’on le voulut. J’y
fis ce qu’André me prescrivit. Il exerçait sur moi l’empire que prend toujours
la raison aimante sur un aveugle délire. Quand on remarquait de l’altération
sur ma figure, on remettait ma fille dans mes bras. Je la regardais, je la
baisais, je pleurais, je me
calmais.
Je ne sais combien de jours je passai dans cette chambre.
« Ôte-moi
de cette maison, dis-je à André. Je ne peux .plus l’habiter ; je ne peux
plus m’y souffrir. » Il allait m’obéir.
« Conduis-moi
dans sa chambre ; que je voie encore ses restes inanimés ; que je les couvre
de baisers et de larmes. » Il prit mon bras, et nous marchâmes vers cette
chambre d’amour et de douleur... Il n’y restait rien d’elle. Les meubles
mêmes étaient changés.
« Où
est-elle, André, où est-elle ?... Au nom de Dieu, dis-le- moi. » Il ouvrit
ma chemise ; il me passa une espèce de chaîne au cou. Elle était faite grossièrement
; mais c’étaient ses cheveux. Il me mit dans les mains un vase de terre,
de faïence, de... « C’est son cœur, Monsieur, ce cœur qui n’a jamais battu
que pour vous. Je t’entends, lui dis-je. Beauté, grâces, vertus, amabilité,
la tombe dévore tout. » Je voulus ouvrir le vase ; il était scellé. Je le
portai à mes lèvres, avec amour et respect.
Je parcourus
la maison. J’y cherchai les places qu’elle y avait occupées ; le siège sur
lequel elle s’était assise... l’air qu’elle avait respiré. Je retrouvai un
fauteuil... On n’avait pu tout enlever. J’y déposai le vase. « Vois-tu, André
? c’est un autel. Il est consacré aux larmes et aux regrets. — Venez voir
votre fille, Monsieur. Votre imagination brûlante se calmera auprès d’elle.
Elle se nomme Colombe-Antoinette. — Ah, tu as tout prévu, tout fait ! Tu
l’as nommée Colombe! Puisse-t-elle me rendre sa mère ! »
Il me
fit prendre un peu de nourriture, et me mena respirer le grand air. Je marchais
machinalement ; mais je voyais autour de moi. Il n’y avait plus personne
à la basse-cour. André avait
congédié
les familles étrangères, et leur avait donné des vivres pour huit jours.
Une partie des palissades était arrachée, et convertie en un pont solide.
« Oui, oui, André, je suis bien faible ; mais notre voiture passera là.
Mène-moi pleurer sur sa tombe. — Demain, Monsieur, demain. — Demain ! Au
moins me le promets-tu ? » — Je vous le promets. »
Ce lendemain
fut une pompe funèbre. Nous montâmes en voiture, André, Claire, les deux
enfans et moi. Marianne et Bertrand nous suivirent à pied. Pas un crêpe,
pas un ruban noir. Le deuil était au fond des cœurs. Que nous importaient
les vivans ? Ce n’est pas pour eux que nous pleurions.
Nous
arrivâmes au cimetière. Nous y entrâmes dans le plus profond recueillement.
André me conduisit. Je tombai à genoux devant une fosse nouvellement couverte.
Une pierre sépulcrale la dominait. Vers le haut, je vis une colombe prenant
son vol vers le ciel. Je lus au-dessous : Le reste repose ici. Partout,
je rencontrais André, son intelligence, sa prévoyance, son affection. Quel
ami j’ai là ! et que serais-je sans lui !
Il y
avait long-temps que j’étais à genoux. Ma tête était vide, et cependant exaltée....
Est-ce une illusion…. une réalité ? Vois- tu, André, vois-tu ? Regarde, regarde.
— Je ne vois rien. Monsieur. — Tu ne vois pas ces Anges, qui se groupent,
qui descendent, qui remontent, qui planent sur cette tombe ?..... Elle s’ouvre,
André, elle s’ouvre….. Ces restes éteints reprennent une nouvelle vie…. Colombe
se lève... Elle s’élance dans les bras des anges, brillante de jeunesse et
de beauté. Elle m’appelle, elle m’attend.... Je ne vois plus rien. Je me
meurs….. »
Je
me retrouvai dans la chambre d’André. Je cherchai, autour de moi, ces images,
dont il me restait des idées confuses. « Je ne la vois plus, André, je ne
la vois plus. — Elle est montée au ciel, Monsieur. La terre n’était pas digne
de la posséder. Son cœur vous reste. Le voilà. Pressez-le sur le vôtre. —
Il me brûle, André... Oh, non, non, laisse-le-moi, il purifiera le mien...
Je te jure, à la face du ciel, d’où tu m’écoutes, d’où tu m’entends, qu’aucune
femme ne te bannira de ce cœur, dont tu as reçu le premier hommage. Tu y
régneras jusqu’à sa dernière pulsation…. »
« André,
ai-je été long-temps malade ? — Quinze jours, Monsieur. — Je suis bien faible
; mais je suis calme. Je me trouve mieux. Où est Colombe-Antoinette ? Claire
me la présenta. Mettez-la près de moi, sur mon oreiller. Je la regardais,
je la caressais, je retrouvais la vie auprès d’elle.

Le
château de Brunehaut vers 1960 (cliché La Pie)
CHAPITRE
XXVI.
Départ
pour la Suisse.
L’habitude
affaiblit les impressions produites par les charmes et les qualités de l’objet
aimé ; sa perte les rétablit dans toute leur étendue. Devant elles s’éteint
le souvenir de quelques légers défauts, de quelques contrariétés, qui en
sont la suite inévitable. On voit le beau idéal des perfections, qui n’appartiennent
pas à la nature humaine.
Cette
idée reste, parce qu’on se complait à la nourrir. D’abord poignante et amère,
elle cède insensiblement au temps qui use tout ; une douce mélancolie lui
succède, et amène le repos absolu.
Je causais
librement avec André ; j’exerçais avec lui mes forces renaissantes. Je commençais
à m’occuper de l’avenir.
« Si
nous sommes attaqués, lui dis-je un jour, comment nous défendrons-nous ?
Tu as renvoyé nos trois ligueurs. — Je les rappellerai. — Ce pont donnera
un libre accès aux assaillans. — Je le ferai sauter. Soyez tranquille, Monsieur,
nous n’avons rien à craindre. »
En
effet, Henri IV avait signé un acte, qui lui fut présenté par le maréchal
de Biron, le duc de Luxembourg, et les autres généraux catholiques. Il s’engageait
à maintenir directement la religion romaine ; à rendre au clergé les biens,
dont les réformés s’étaient emparés ; à exclure ceux-ci des grandes charges,
civiles et militaires, et à poursuivre les complices de l’assassin de Henri
III. On sent bien qu’ici c’est André qui parle.
Les
zélés catholiques n’avaient plus à opposer aux prétentions légitimes de Henri
IV que la religion qu’il professait. Mais l’esprit de parti se fait des armes
de tout. Le duc d’Épernon saisit ce prétexte pour s’éloigner, avec six
mille fantassins, et douze cents chevaux. Ce qui restait de troupes françaises
à Henri IV, suivit ce dangereux exemple. Ses soldats désertèrent par pelotons.
Bientôt il n’eut plus que des Allemands et des Suisses, qu’il ne pouvait
payer. Il se retira, avec eux, en Normandie.
L’armée
de la ligue, au contraire, se fortifiait tous les jours. Mayenne était maître
du cours de la Seine, et les vivres abondaient dans Paris. Il voulait se
faire aimer, et il établit une discipline sévère, dans la capitale, et dans
les villages environnans. Il est toujours facile de se faire obéir par des
soldats qui ne manquent de rien, et la sécurité commençait à renaître. André
avait apprécié les circonstances, et nous n’avions, en effet, rien à craindre,
au moins pour le moment.
Je réfléchis
profondément sur ce qu’André venait de me dire. J’examinai la position des
grands personnages qui s’arrachaient les lambeaux de la France, et je les
jugeai d’après leurs intérêts respectifs. Voulez-vous savoir ce que fera,
ce que doit nécessairement faire un homme, dans telle ou
telle
circonstance?
mettez-vous à sa place, identifiez-vous avec lui, et vous le devinerez.
Le Béarnais,
me dis-je, est né pour affliger la France de tous les maux qui peuvent peser
sur elle. Ambitieux, fort du droit de sa naissance, il veut régner, et versera
le sang à flots, pour arriver au trône. Il feindra, peut-être, d’abjurer
les erreurs de sa secte : ce ne sera qu’un piège qu’il tendra à la crédulité
publique. Il séduira les Français par de fausses vertus, et, maître du royaume,
il fera peser sur ses sujets un sceptre infernal. Cet homme-là ne sera jamais
mon roi.
Le cardinal
de Bourbon, le seul être vertueux de cette famille, n’a que les qualités,
très-respectables sans doute, de son état. Courbé sous le poids des années,
incapable, par conséquent, de supporter le fardeau des affaires publiques,
et même de juger sa position, il ne sent pas que Guise l’a porté en avant,
comme on place un épouvantail dans un champ, dont on veut éloigner l’oiseau
de proie, et qu’on renverse quand on n’en a plus besoin. Il ne règnera jamais
sur les Français.
Mayenne
a hérité des projets et de la valeur de son frère ; mais il manque d’esprit
de conduite. Indifférent en matière de Religion, il croit prouver son catholicisme
par des mots, et des pratiques affectées. Il ne sait pas que le zèle ne persuade
que lorsqu’il s’exprime du fond du cœur, et que la ruse se dévoile tôt, ou
tard. Il n’a, d’ailleurs, aucun des talens militaires, qui distinguent particulièrement
le Béarnais. Il n’a rien de l’activité, de la prévoyance, des moyens de séduction
de son adversaire. Il tombera devant lui.
Philippe
Il n’est qu’un intrigant, sombre, soucieux, défiant, opiniâtre. Il veut subjuguer
la France, et il n’a pu conserver la
Hollande.
Les trésors du Nouveau-Monde viennent se fondre dans Paris, et l’ambassadeur
d’Espagne ne voit pas que cet or alimente les différens partis qui se disputent
la France. Il faut cependant en excepter celui des Seize, qui paraît agir
de bonne foi en faveur de Philippe. Mais les Seize ne composent qu’une fraction
des habitans de Paris, et ils n’ont aucune influence sur le reste du royaume.
Donc
Philippe n’ajoutera jamais la couronne de France à celles qui surchargent
son front débile. Je ne veux pas, d’ailleurs, être sujet d’un étranger, qui
ne pourrait nous faire d’autre bien que de rétablir la sainte-inquisition
dans le royaume.
Il résulte
de tous ces élémens opposés, une fermentation générale qui annonce une guerre
longue, sanglante, et dont l’issue est incertaine. Pourquoi y prendrais-je
part ? Mes idées de grandeur se sont éteintes sur le tombeau de Colombe ;
d’ailleurs, je n’ai pas d’héritier du nom que je pourrais rendre célèbre.
Je me
livrais un jour à des méditations profondes sur mon bonheur passé, sur ma
situation actuelle, sur l’avenir qui me menaçait. J’ai toujours été, me disais-je,
en proie à des chimères. André seul les a combattues par des raisonnemens
sages, que mon délire ne me permettait pas d’écouter. Ah ! si j’avais suivi
ses conseils, Colombe vivrait ; elle serait heureuse en Suisse, au milieu
de bons paysans, simples, aimans comme elle. Mon aveuglement, mon opiniâtreté
lui ont donné la mort. C’est moi qui l’ai tuée ! Ces pensées étaient
désespérantes. Elles me plongeaient dans une noire mélancolie ; souvent
elles faisaient couler mes larmes. Alors, j’évitais André. Il eût voulu connaître
la cause de ma douleur. Il n’eût pas été en ma
puissance
de la lui cacher, et il m’eût répondu : C’est vous qui l’avez voulu.
Je ne
le connaissais pas encore. Combien faut-il donc d’années pour apprécier son
ami ?
Des
nouvelles intéressantes me rendirent, pour un moment, à moi-même. Nous apprîmes
que le canon du château Saint-Ange avait annoncé aux Romains la sublime action
de saint Jacques Clément ; que son éloge fut prononcé dans toutes les églises
de la capitale du monde chrétien ; que cet exemple avait été suivi dans tous
les États catholiques. Venise seule s’y était refusée ; mais l’or est l’unique
divinité de cette république.
Ma maison
n’avait pas souffert du combat que j’avais soutenu. La dévastation des jardins
pouvait disparaître promptement, sous des mains industrieuses. Les arbres
abattus ne devaient pas renaître ; mais j’apprenais à me passer de ce que
je n’avais pas.
André
et moi remplissions le vide de nos journées, en rétablissant le cours du
ruisseau, en le ramenant dans la pièce d’eau, en le faisant serpenter dans
ce qui restait du petit bois. Bertrand et la fille de basse-cour, le fermier
même se joignaient à nous, quand leur travail habituel le leur permettait.
Claire apportait les deux enfans près de nous. Elle rendait à leurs petits
membres une liberté, dont on ne devrait jamais les priver. Ils s’essayaient
à des mouvemens, que leur faiblesse ne leur permettait pas encore d’exécuter.
Nous revenions, André et moi, puiser de nouvelles forces auprès d’eux. Marianne
arrivait avec les provisions de bouche.
Le
travail donne de l’appétit; l’appétit produit la gaîté ; la gaîté amène un
sommeil paisible. Nous étions tout à nous ; nous ne vivions que pour nous
; nous étions étrangers à tout ce qui nous environnait. Je jouissais d’une
existence tout à fait nouvelle pour moi. Je la comparais au tumulte de ma
vie passée. Je commençais à ne plus concevoir comment l’homme, tourmenté
de désirs inquiets, et toujours renaissans, va chercher au loin, ce que la
nature a placé près de lui.
En effet,
qu’avais- je trouvé dans mes voyages ? des passions violentes, qui se heurtent,
qui se froissent ; les excès, les fureurs, qui en sont les suites nécessaires
; l’égoïsme, qui dessèche des cœurs déjà corrompus. C’est la tempête qui
agite la mer jusqu’en ses fondemens, et que voit avec indifférence le sage,
qui ne s’est pas confié à cet élément perfide. Je contemplais, du rivage,
les flots en fureur. Mais ne pouvaient- ils pas se rouler jusqu’à moi, et
m’entraîner avec eux ? Quelle sécurité m’offrait la France ?
« André,
tu ne me parles plus du canton d’Appenzell. — Vous en parler, Monsieur, serait
vous adresser un reproche cruel, et je ne sais rien reprocher à ceux
que j’aime. » Quel homme !
« André,
j’ai commis une faute irréparable. Rappelons-nous-la, pour en prévenir d’autres.
Ces enfans nous demandent la conservation de leur existence, et des jours
heureux. Allons à Appenzell. » Oh ! cette fois, ce fut André qui m’embrassa,
et qui me pressa long-temps sur son cœur.
Ce projet,
arrêté en masse, nous conduisit aux détails. La première mesure à prendre
était de vendre la tour. André avait jugé la chose difficile, quelques
mois auparavant ; mais les circonstances étaient changées. Paris et ses
environs jouissaient d’un moment de repos. « Un homme prévoyant, me
dit-il,
n’achètera
pas à présent. Mais la France pullule de fous, qui ne réfléchissent qu’après
l’événement. Ils voient le calme actuel, et ils ne pensent pas aux orages
qui doivent succéder à ceux auxquels ils ont échappé. Mettons à profit la
sottise humaine. Je vais à Paris. »
Trois
jours après, il m’amena ce capitaine Saint-Paul, dont j’ai déjà parlé. Cet
homme, sincèrement attaché à la maison de Guise, voyait déjà le duc de Mayenne
sur le trône, et la paix établie sur des bases inébranlables. Sa pénétration
ne dépassait pas la pointe de son épée.
Je le
promenai partout. « C’est joli, c’est joli, disait-il à chaque pas. Mais
tout est petit ici, et ce qui convient à un capitaine, n’est pas digne d’un
maréchal de France. Or, vous sentez, mon cher Monsieur, que je le serai quelque
jour. » Il ne le fut jamais.
« Monsieur
le maréchal, lui dit André, en souriant, vous pouvez vous étendre. L’habitation
de notre voisin Richoux a été brûlée, et il est dans l’impossibilité de la
faire rebâtir. Il faut qu’il vende sa terre. — Sans doute, sans doute. Combien
ce Richoux a-t-il d’arpens ? — Deux cent cinquante. — Et deux cents que je
vois ici. Oui, cela me fera un joli parc. Je le fermerai de murs. Il y a
sûrement de la pierre dans le voisinage. Mes vassaux m’arrangeront cela,
à leur aise ; je ne veux pas les fouler. J’ajouterai une aile à chaque côté
de la maison, et cela pourra passer. Je logerai le roi Mayenne dans le corps
de logis, quand il me fera l’honneur de me venir voir, et je chasserai avec
lui dans mon parc. Voilà mes idées fixées. Voyons, Monsieur de la Tour, combien
voulez-vous de cela ?
«
Monsieur le maréchal, répondit André, un particulier paierait ce bien
cinquante mille francs. Mais nous n’y regarderons pas de si
près avec un des meilleurs officiers de la Ligue, un officier ennemi juré
des huguenots, qui les a bien pillés un peu, et qui est intéressé à mettre
à l’abri des évènements l’or qu’il a péniblement acquis. De l’argent se
vole ; mais la terre reste. — Il a parbleu raison, s’écria le capitaine,
en riant aux éclats. Le duc de Mayenne sait que j’ai de l’argent. Il pourrait
me l’emprunter, pour me le rendre, quand ? Il ne m’empruntera pas ma terre.
Allons, à combien le fief de la Tour ? Je n’aime pas les affaires qui traînent
en longueur. — Monsieur le maréchal, nous vous le laissons pour quarante
mille livres, et c’est donner. » Il m’en coûtait trente.
« Voilà
qui est fini. Demain, à la même heure, chez le notaire d’Arpajon. Ah ça,
n’allez pas m’appeler là, Monsieur le maréchal Je ne le suis pas encore,
et cette qualification prématurée pourrait paraître ridicule…. Ah, vox
populus, vox deum. Cela peut forcer la main au duc de Mayenne. Ma foi,
appelez-moi, comme vous le voudrez. » Il remonta à cheval, et s’en retourna
comme il était venu, au grand galop.
« André,
ta conduite, envers cet homme-là, ne me paraît pas loyale. — Hé, ne voyez-vous
pas, Monsieur, que cet argent-là doit s’en aller comme il est venu. Il vaut
autant que nous en profitions qu’un autre. Et puis, je ne me pique de délicatesse
qu’avec ceux qui en ont.
« —
Ah ça, nous allons donc nous trouver propriétaires de quarante-huit mille
livres. — Vous allez, Monsieur… — Nous allons. J’ordonne pour la dernière
fois, et je veux, j’entends que tout soit désormais commun entre nous. —
Monsieur, les dons
de
l’amitié…. — Et de la reconnaissance. — Les dons de l’amitié et
de la reconnaissance n’humilient pas, et j’accepte.
« —
Je suis content de toi. Mais, dis- moi, André, ce que nous ferons en Suisse
de quarante-huit mille livres. — Nous en ferons…. Nous en ferons…. On n’est
jamais embarrassé de cela.
« —
Tes dernières paroles sur Appenzell sont restées gravées dans ma mémoire.
Vous corrompriez avec de l’or de petits propriétaires ; ils vous vendraient
chèrement le modique héritage de leurs pères ; ils abandonneraient les tombeaux
de leurs ancêtres ; ils seraient méprisés de leurs compatriotes ; vous en
seriez haï, vous la cause unique de ces désordres, et peut-on être
bien, où on n’est pas aimé ?
« —
J’ai dit cela ! j’ai dit cela ! Diable, diable !... Hé bien oui, je l’ai
dit. Je voulais vous ôter l’envie de jouer un rôle brillant en Suisse ; vous
amener au point où vous a conduit votre seule raison ; vous faire désirer
de mener à Appenzell une vie pastorale, que les passions ne troublent jamais.
Je n’ai pas été en Suisse ; je ne sais pas comment nous nous y arrangerons
; mais nous y porterons notre argent. Oui, j’ai dit, et je me dédis. J’ai
cela de commun avec des personnages marquans, qui disent noir aujourd’hui,
et qui diront blanc demain.
« Monsieur,
occupons-nous des dispositions de notre voyage. Il sera long. Le canton d’Appenzell
est à l’extrémité septentrionale et orientale de la Suisse, bornée par
la Souabe, cercle divisé en plusieurs principautés. L’Allemagne est en paix,
et les Français ne viendront pas nous chercher là. Mais nous ne trouverons
pas une auberge dans les treize cantons, et nous aimons la bonne chère. —
Nous ferons des
provisions.
— Cela est clair. Mais il nous faut des moyens de transport. Voyons, de qui
se composeront nos deux maisons, qui n’en feront qu’une ?
« —
De toi, de ta femme et de ses deux nourrissons. — Ne vous oubliez pas, Monsieur.
— Sois tranquille. Nous amènerons Bertrand. — C’est une bête ; mais il s’est
bien battu, à ce que vous dites, et nous ne devons pas l’abandonner. — Nous
prendrons Marianne avec nous. — Oui, elle commence à très-bien faire la cuisine.
— Pour la fille de basse-cour. — Ma foi, nous la laisserons à M. le maréchal.
Il en fera ce qu’il pourra.
« Récapitulons
maintenant. M. de la Tour…. — Je reprends mon nom de Mouchy. — Et vous faites
bien. M. de Mouchy….
— Je
supprime le De. — M. Mouchy, M. André, Claire, les deux enfans, Marianne
et Bertrand, total, sept personnes, grandes ou petites, grosses ou minces
qui n’entreront pas dans votre jolie voiture, aux armes de la maison de Biron.
— Il faut s’en défaire. Je ne peux y porter les yeux, sans éprouver une sensation
pénible.
« —
Et la remplacer par une autre, vaste et commode. J’y joindrai un fourgon,
au fond duquel sera notre magasin. Il faudra quatre mulets de plus. — Sans
doute. Ils nous serviront, d’ailleurs, à franchir, en selle, les pas difficiles.
— Et la voiture, et le fourgon ? — Oh, la voiture…. la voiture…. Nous verrons
cela, quand nous y serons. Touchons d’abord les doublons du capitaine Saint-Paul,
c’est l’essentiel. Le reste ira de suite. »
Il fut
exact au rendez-vous : il grillait d’être propriétaire. D’ailleurs, un vieux
soldat ne se fait jamais attendre.
Le
notaire d’Arpajon ouvrait de grands yeux, en écoutant les conditions arrêtées
entre nous. Il ne put s’empêcher de dire que le prix lui paraissait trop
élevé. L’honnête homme fut sur le point de nous faire perdre dix mille livres
; mais nous avions affaire à un sot, qu’André avait démêlé, avec peine, dans
la foule de ceux qui pullulent à Paris. « M. le garde-note, dit le capitaine,
mon métier est de prendre ou d’acheter ; le vôtre est de rédiger des actes,
écrivez. Je sais ce que j’ai à faire, et je n’aime pas les observations.
»
Quand
il eut signé et payé, il nous demanda quand il entrerait en jouissance.
« A
l’instant même si vous le voulez, » lui répondit André. — Comment si je le
veux ! Sans doute. — Mais nous vous demandons trois jours pour faire nos
préparatifs de départ. — Trois jours ! C’est beaucoup. — Et puis que feriez-vous
seul dans cette vaste habitation ? — Vous avez raison. Je retourne à Paris,
et j’y trouverai les moyens de peupler mon château. Mon lieutenant et une
compagnie de ligueurs rendront ce séjour-là fort agréable. À propos, où donc
est ce Richoux, dont vous m’avez parlé ? — Ma foi, qu’il se retrouve ou ne
se retrouve pas, peu m’importe. Je prendrai possession de sa terre avec ma
compagnie, et je l’achèterai ensuite, si cela me convient.
« Mais,
Monsieur le capitaine, reprit le notaire, cette manière d’opérer n’est pas
légale. — Je vous ai déjà dit que je n’aime pas les observations.
« Ma
loi est dans le fourreau de mon épée ; je n’en connais pas d’autre. — Mais,
monseigneur le duc de Mayenne a rétabli la discipline militaire… — Oui, pour
la canaille. Mais il a besoin du capitaine Saint-Paul, et ce qu’il pense,
ce qu’il dit, ce
qu’il
fait, est bien pensé, bien dit et bien fait. — Mais, Monsieur. — Je crois
que les épaules te démangent. As-tu besoin de vingt-cinq coups de plat d’épée
? — Non, Monsieur.
—
Hé bien, tais-toi.
« Ah
ça, la Tour, c’est aujourd’hui lundi. Il est convenu que mercredi soir j’entre
dans mon château, tambour battant, et drapeau déployé. Si vous y êtes encore,
nous nous griserons tous ensemble, en chantant la chanson de Roland ; mais
vous déguerpirez le lendemain à la pointe du jour. Vous voyez que je suis
bon diable. »
« Ne
perdons pas de temps, dis-je à André, quand le capitaine fut parti. Je ne
veux rien avoir de commun avec cet enragé-là. Nous ne serions pas deux heures
ensemble sans nous battre, et je me suis assez battu. Allons chercher, en
Suisse, la liberté et le repos. »
André
partit aussitôt pour Paris, avec Bertrand, ma voiture, mes deux mulets, et
de l’argent. C’est une ville de ressource que Paris. On s’y procure ce qu’on
veut à l’instant, surtout quand on ne marchande pas. Le mercredi matin, André
arriva avec ses équipages et des provisions de bouche choisies. Elles étaient
déposées dans le fond d’un grand fourgon, dont le devant devait être garni
de matelas, précaution indispensable dans un pays où on ne trouve pas d’auberges.
Des cachettes étaient ménagées en différens endroits. Elles étaient destinées
à recevoir notre capital, divisé en petites parties. Quand on fait un long
voyage en France, il ne faut pas négliger de faire la part des voleurs, c’est-à-dire
des ligueurs et des huguenots. On jette un sac aux uns, un sac aux autres,
et on se tire d’affaire.
Une
belle et vaste coche, bien rembourrée, et garnie en coutil de Flandres, ma
foi, devait recevoir messieurs les associés et leur famille. Nous allions
habiter le pays de l’égalité, et nous dédaignâmes tout ce qui avait le moindre
rapport avec la féodalité. Il fut arrêté que Marianne serait admise dans
la coche. Bertrand était transformé en cocher ; mais comme il ne pouvait
conduire deux voitures à la fois, André décida que le fourgon serait attaché
derrière la coche, ou la coche derrière le fourgon,
Car il
m’importe guère, Que fourgon soit devant, ou fourgon soit derrière.
Dans
les pas difficiles, André ou moi devions descendre pour conduire une des
deux voitures. Enfin elles étaient traînées chacune par trois vigoureuses
mules. Ce n’était pas trop pour des chemins défoncés par l’artillerie des
deux partis, et où on ne marchait, souvent, que la sonde à la main.
Le capitaine
devait arriver le soir, et nous ne jugeâmes pas à propos de l’attendre. Nous
nous hâtâmes de charger nos voitures; nous laissâmes un lit bien garni pour
Saint-Paul, un autre pour son lieutenant, avec liberté entière de coucher
ses soldats, comme il l’entendrait.
Il était
temps de quitter la France. André nous raconta que la division commençait
à s’établir entre les ligueurs et les seize, et même parmi les ligueurs.
Mayenne, fatigué d’un rôle qui était au-dessus de ses forces, faiblissait
devant l’ambassadeur d’Espagne. Les catholiques s’observaient, et se défiaient
les uns des autres. Déjà ils n’avaient plus le même esprit ; les opérations
allaient manquer d’ensemble, et des déchiremens cruels devaient être la
suite de cette mésintelligence.
Ce
mercredi, 15 octobre 1589, à deux heures après midi, nous remîmes les clefs
au fermier, désolé de nous perdre, et nous montâmes en voiture.
J’éprouvai
un violent serrement de cœur, en m’éloignant de ces lieux, que Colombe avait
embellis. André me devina, et me présenta le vase précieux. C’est tout ce
qui me restait de la bien-aimée. Je le portai à mes lèvres, et je lui donnai
encore des larmes. Je regardai Colombe-Antoinette, et je pleurai aussi sur
elle.
« Je
suis sa seconde mère, me dit Claire, et j’espère qu’elle ne regrettera pas
la première. » La bonne Claire m’embrassa. Cet acte d’abandon et de franchise
me fit grand bien. « Je vous la donne, lui dis-je. N’oubliez jamais ce que
vous venez de me promettre. »
André
n’aime pas les conversations sentimentales. Il prétend qu’elles affaiblissent
les qualités morales de l’homme, qui n’en a jamais trop. Il mit fin à celle-ci,
en nous faisant des contes, plus ou moins plaisans. Je sentais le besoin
de me distraire, et je me laissai aller à ses folies. Madame André riait
aux éclats ; Marianne, bornée aux fonctions de cuisinière, se pinçait les
lèvres, pour ne pas éclater. Bertrand riait sur son siège, parce qu’il voyait
rire tout le monde. Moi, je souriais : c’était beaucoup.
Nous
étions partis tard, et la nuit nous surprit à Essonne. Nous l’y passâmes,
et nous y fûmes très-bien, ma foi, pour des voyageurs philosophes, qui ne
veulent plus connaître que les besoins de la nature. Nous couchâmes le lendemain
à Melun, ville célèbre par ses anguilles. On nous en offrit ; nous en achetâmes,
et Marianne nous assura qu’elles se laissent
écorcher
aussi paisiblement que celles de Paris. Parlez-moi des anguilles qui se laissent
écorcher, des poules qui se laissent plumer sans crier, n’est-ce pas, Messieurs
les gouvernans ?
On ne
passe pas à Montereau sans visiter ce fameux pont, où fut assassiné un duc
de Bourgogne, fameux par ses crimes. Je commençais une dissertation
sur ce grand événement,
« Parbleu,
me dit André, la rage se communique, et s’occuper sérieusement de ceux qui
en ont été atteints, c’est s’exposer à en être attaqué soi-même. Laissons
dans l’oubli les crimes dont le récit trouble l’imagination, et faisons du
bien quand l’occasion s’en présentera. Cela fait dormir d’un bon somme. »
Je voulais faire de l’érudition, partout où nous nous arrêtions.
« Hé,
Monsieur, qu’est-ce que l’histoire ? une longue série de forfaits, qu’il
faudrait jeter au feu. Il n’est pas un point sur le globe, qui n’ait été
souillé par quelque crime. Il s’en est commis dans des villes qui n’existent
plus, dont les noms sont perdus, et sur les ruines desquelles roulent, peut-
être, en ce moment, nos lourdes voitures. Parlons de Titus, de Louis XII.
Ils ont commis des fautes ; mais que de bien ils ont fait à l’espèce humaine
! Nous allons arriver à Auxerre, et nous y boirons une bouteille de Bourgogne
de plus, à la mémoire de ces braves gens –là. — Tope, André. — Nous chanterons
la chansonnette en leur honneur. — En sais-tu sur ces bons princes ? — Nous
en ferons une. — Elle sera mauvaise. — Madame André en fera des papillotes,
quand nous l’aurons chantée ; nous ne sommes pas de ces auteurs vaniteux,
qui ont la manie de casser la tête à tout le monde avec leurs rapsodies.
»
Nous
étions assis autour d’une table ronde. Ce sont les bonnes : on s’y voit au
moins, quand on ne se touche pas. « Ma foi, dis-je à André, le vin de Bourgogne
vaut l’Hippocrène. Je
me
sens inspiré. — Et moi aussi. — Écrivons. — Un moment. Trouvons d’abord un
air nouveau. — Tu as raison. Que de chansons ne doivent leur succès qu’à
l’air sur lequel on les a mises ! — Un air nouveau…. Hé, parbleu, réveillez-
vous y belle endormie. On ne chante que cela à la cour. — Écrivons.
— Écrivons.
Ta, la, la la…. J’ai trouvé le premier vers. — Voyons cela, André.
« Titus
fit le bonheur du monde…
« —
C’est très-bien, mon ami ; vers harmonieux, riche de pensée. — Faites le
second, Monsieur. — Oh, moi, j’aime mieux faire vingt premiers vers qu’un
second. — Mais, Monsieur, nous sommes deux pour quelque chose…. Ah, le voilà.
« Titus
fit le bonheur du monde,
« Jusqu’au
moment de son trépas.
« Attends,
attends, je vais trouver le troisième.
« Louis,
d’une ardeur sans seconde…
« — Sublime,
Monsieur, sublime.
« Sans
seconde, qui n’est comparable à rien, que rien ne peut égaler ! Il n’en faut
plus qu’un, et nous tenons notre premier couplet.
« Marcha,
sans cesse, sur ses pas.
« —
Sans cesse est admirable. Il fit le bien sans se reposer, sans reprendre
haleine. — Notre chanson commence à
merveilles
; mais si nous la continuons sur ce ton-là, il faudra bien nous garder de
la rendre publique. — Pourquoi cela, André ? — L’éloge des bons rois est
la satire des mauvais. Il ne faut jamais donner d’humeur au prince régnant.
— Duquel parles-tu ? de Mayenne, de Philippe, ou du Béarnais, car nous en
avons trois. — Et ce n’est pas le cas de dire, qu’abondance de bien ne nuit
pas. Chantons, Monsieur.
« Titus
fit le bonheur du monde,
«
Jusqu’au moment de son trépas.
«
Louis, d’une ardeur sans seconde,
« Marcha,
sans cesse, sur ses pas.
« Ah,
quel effet, Monsieur ! si vous aviez-là votre serpent, il y aurait de quoi
rendre fous tous les habitans d’Auxerre. — Tu as encore raison, un accompagnement
de serpent ferait merveilles. »
Nous
chantions avec la persévérance d’auteurs contens d’eux. Claire avait un enfant
à chaque sein, et elle battait la mesure avec les hochets, inutiles en ce
moment. Le bruit des grelots se mariait, étonnamment bien, avec nos voix,
et nous engageait à passer au second couplet.
Bertrand
entra comme un coup de tonnerre. « Aux armes, Monsieur, aux armes. La ville
est pleine de soldats, d’officiers, de je ne sais quoi. » Je sautai sur mes
pistolets. Le dernier mot du couplet expira sur les lèvres d’André.
J’entendais
un grand mouvement dans la rue ; mais je ne voyais personne. Je sortis. Le
premier individu que je rencontrai, fut le capitaine Saint-Paul. « Que faites-vous
ici, Capitaine ? — Hé, qu’y faites-vous, vous-même ? — Je voyage
paisiblement,
en amateur. — Je voyage, parce que tel est le bon plaisir de M. de Mayenne.
— Et où vous envoie-t-il ? — Il ne m’envoie pas. Je l’accompagne. — Il est
ici ! — Avec Péricard, son secrétaire, et deux cents hommes d’armes. Chacun
s’occupe de se loger, et je vais faire comme les autres. Adieu. »
Tout
était assez tranquille, et André reparut, le sourire sur les lèvres. Il ne
concevait pas ce que Mayenne faisait à Auxerre, ni moi non plus. Tout s’éclaircit
bientôt.
Péricard
entra dans notre cabaret, suivi de quelques soldats, et nous ordonna d’en
sortir. Il n’y avait rien à répondre à ce genre d’invitation. Je dis à Bertrand
d’atteler une voiture. Péricard me regarda, et me reconnut. « Vous n’êtes
donc plus, me dit-il, un capitaine honoraire ; vous voilà en activité de
service. Tant mieux : vous trouverez les occasions de vous signaler.
Nos affaires vont bien ; mais il faudra se battre.
« Le
pape et tous les parlemens du royaume se sont prononcés contre Henri de Navarre.
Il a eu la maladresse de faire arrêter le cardinal de Bourbon., que nous
avons proclamé roi, en attendant mieux, et nous devons à cette mesure
la rigueur de celles qu’ont prises les cours souveraines. Or, les parlemens
entraînent le peuple. Il veut bien voir en eux le soutien de ses libertés,
qui n’existent pas, et n’existeront jamais.
« Cependant
Henri ne désespère pas de sa fortune. Il a des succès en Normandie, et il
y enlève des places importantes, avec une poignée de soldats. Monseigneur
de Mayenne ne veut pas dégarnir Paris, et il lève des troupes dans son
gouvernement de Bourgogne. Au premier jour nous entrerons en campagne. Le
Béarnais ne tiendra pas contre nous ; mais cette expédition vous vaudra un
régiment : il y a long-temps
que
vous êtes capitaine ; et puis, vous êtes observateur, négociateur assez habile.
Nous vous emploierons de toutes les manières. Allons, mon ami la Tour, il
faut pousser la fortune. » J’étais fort embarrassé ; je ne savais que dire,
et je répondais par de profondes révérences. C’est la réponse des sots, et
quelquefois celle des gens d’esprit, qu’on prend au dépourvu.
« Mais
comment se fait-il, mon cher la Tour, que vous ne soyez pas venu me saluer,
depuis votre départ de Paris ? — Ah, Monsieur, vos occupations continuelles…
leur importance…. et les soins qu’exige ma compagnie…. — Mais il me semble
qu’en veillant sur elle, vous ne vous oubliez pas. Tudieu, comme vous êtes
logé ! mon cher ami, vous trouverez bon que je vous remplace. Un capitaine
n’a besoin que d’une botte de paille.
« Monsieur,
vint me dire Bertrand, vos voitures sont-là, elles n’attendent plus que vous
et M. André. » Mon embarras augmentait à chaque instant. « Que vois-je, s’écria
Péricard ! des équipages dignes d’un général ! des femmes, des enfans ! il
y a du louche dans cette affaire-là. Vous désertez, la Tour, et vous êtes
pris sur le fait. Soldats!.... » Ses soldats le croyaient logé, et étaient
allés chercher à souper, chacun de son côté, André n’était jamais embarrassé,
quand il n’y avait pas de coups à recevoir, et le premier officier de plume
du duc de Mayenne n’était pas un homme redoutable. « Ces équipages, lui dit-il,
sont ceux du capitaine la Tour. — Hé, la Tour n’a ni femmes, ni
enfans. Je vous arrête tous les deux. — Monsieur, tout ceci demande des explications
secrètes, que nous ne pouvons vous donner au milieu de la rue. Daignez entrer
avec nous dans ce cabaret, et vous userez pleinement satisfait. » Péricard
nous suivit.
«
C’est moi, Monsieur, lui dit André, qui vous arrête. M. Mouchy, Bertrand,
prêtez-moi main-forte. » Je ne prévoyais pas ce qu’André voulait faire ;
mais j’étais certain qu’il allait me tirer de ce mauvais pas. Bertrand et
moi nous nous présentâmes le pistolet au poing.
Cette
scène attira le cabaretier et sa femme. « Marchez tous trois, leur cria André,
ou on va vous faire sauter la cervelle. » Où les conduit-il, me demandai-je?
qu’en veut-il faire ?... il les fit descendre dans la cave. « Messieurs,
dit Bertrand, faut-il les tirer en bouteilles ?
« —
André, les voilà dans la cave, c’est très-bien ; mais ils crieront…..
« —
Le soupirail est bouché. — Ils frapperont à la porte. — Je vais leur donner
de l’occupation. »
La cave
est garnie de tonneaux dans toute sa longueur. Sur celui qui est en perce,
André a aperçu et saisi un foret. Il en donna un grand coup dans le flanc
d’une barrique, et vite, il appose un des pouces du cabaretier sur le trou.
« Laisse-le-là, si tu ne veux pas » que ton vin coule. » Il fait la même
opération, six pas plus loin, et c’est le pouce de madame qu’il applique
sur ce tonneau. Il passe à M. Péricard, et pan, encore un grand coup de foret.
« Monsieur n’a pas l’habitude de se laver les pieds dans le vin ; c’est pourtant
ce qui lui arrivera, s’il dérange son pouce du point où je l’ai placé.
« Voyons
maintenant, si le cabaretier, et sa femme n’ont pas de faussets dans leurs
poches. Rien.
»
Résignez-vous à passer, comme » cela, le reste de la nuit. A la pointe »
du jour, on vous appellera, on vous cherchera, on vous trouvera, on vous
tirera de là, et nous serons loin. »
Nous fermâmes
la porte sur eux.
Nous
la barricadâmes avec des fagots, des pierres, avec tout ce qui se trouva
sous nos mains. « Montons en voiture, nous dit notre chef ; il n’y a pas
un moment à perdre. »
Nous
traversâmes la ville fort tranquillement ; mais la crise n’était pas terminée.
L’officier, qui commandait à la porte de sortie, nous demanda qui nous étions,
où nous allions. André répondit, avec beaucoup de sang-froid, que c’étaient
une partie des équipages du duc de Mayenne, que Monseigneur envoyait à Sens.
« Hé, vous n’êtes pas sur la route, vous prenez celle de Dijon. — Nous le
savons bien ; mais les rues de la ville sont encombrées, et nous la tournerons
à l’extérieur, quand nous en serons sortis. — Passez. »
Nous
gagnâmes la campagne, en proie aux plus vives inquiétudes. M. Péricard pouvait
ne pas craindre de mettre ses bottines citron au rouge foncé. Il eût fait
alors un tapage d’enfer. Mais il avait vu de près la bouche d’un pistolet,
et il était, vraisemblablement, aussi poltron qu’André. Nos trois prisonniers
passèrent la nuit, le pouce sur le trou, et ce qui le prouve, c’est qu’on
ne nous suivit pas.
Nous
marchâmes, toute la nuit, avec des peines incroyables. À chaque instant,
il fallait descendre, pour dégager les roues avec des pinces de fer, et l’obscurité
était effrayante. Nous et nos mules étions excédés de fatigue.
Le
jour parut enfin, et nous reconnûmes que nous nous étions jetés dans des
chemins de traverse. Ce fut peut-être un bien. Ce n’est pas dans de semblables
routes qu’on devait chercher deux pesantes voitures. Nous gagnâmes un bois,
qu’André crut être dans les environs de Joux-la-Ville. Nous nous y arrêtâmes,
et nous y tînmes conseil.
Il fut
décidé d’abord que nous passerions là la journée, et la nuit prochaine :
nos bêtes avaient le plus grand besoin de repos. Pendant la nuit, Bertrand
et moi devions veiller alternativement sur les voitures, et tirer un coup
de pistolet, au moindre sujet d’alarme.
Il fut
arrêté, en outre, que nous éviterions toutes les villes : il était très vraisemblable
que Mayenne irait à Dijon, et il n’eût pas été agréable, pour nous, de rencontrer
Péricard. Nous résolûmes enfin de gagner la Franche-Comté, qui appartient
à l’Espagne.
La route
était longue, et elle devait être pénible. Mais la liberté et une vie agréable
devaient être le prix de nos travaux.
Je bénis
la prévoyance d’André : il nous avait fourni de tout ce qui est nécessaire
à une petite colonie nomade. Nous marchions le jour; nous dormions la nuit,
dans notre fourgon. Nos inquiétudes se dissipaient insensiblement. Au bout
de huit jours, nous étions accoutumés à notre vie errante, et la sécurité
avait ramené la joie.
Dijon
était loin derrière nous, et nous n’avions rencontré que quelques paysans
isolés, dont le désordre de nos costumes, et la forme de nos voitures
attiraient l’attention. Ils étaient sans
armes
; ils nous saluaient, ils passaient, et nous suivions notre roule.
Nous
touchions aux frontières de la Franche-Comté, et le lendemain nous devions
entrer à Dôle, où de nouveaux dangers nous attendaient, peut-être : André
ni moi n’avions la moindre notion du gouvernement espagnol. Nous ne manquions
jamais de nous enfoncer dans les bois, quand notre bonne fortune nous en
offrait un. Une vaste forêt se présenta, et nous résolûmes d’y passer une
dernière nuit. Le lendemain, nous devions chercher les villes, et jouir des
commodités de la vie.
Bertrand
était de garde, et je dormais. Un coup de feu m’éveille en sursaut. Je saute
en bas du fourgon, un pistolet à chaque main, mon épée dans les dents, et
je cours à Bertrand.
« Sur
qui as-tu tiré ? — Ce n’est pas moi qui ai fait feu. — Qui donc ? — Voyez-vous
ces quatre hommes, là-bas, à gauche ? La lune porte d’aplomb sur eux. — Hé
bien ? — Un d’eux vient de lâcher son coup ; mais ce n’est pas sur moi :
je n’ai pas entendu siffler la balle. — Que peut-ce être ? — Ma foi,
je n’en sais rien. »
L’alarme
s’était répandue dans le fourgon. Claire criait ; Marianne gémissait ; les
deux enfans pleuraient, non de frayeur, sans doute. Je n’entendais pas André.
Il était vraisemblablement entre deux matelas, ou sous une des voitures.
Cependant, ces cris, ces pleurs, les ténèbres, quatre hommes armés, à cent
pas de nous, tout concourait à rendre cette scène effrayante. Je me sentis
ébranlé un moment. Je me remis bientôt.
«
Allons à eux, dis-je à Bertrand, et sachons ce qu’ils font là.
—
Ce qu’ils font là, vous le voyez bien. Ils viennent de tuer un
homme,
et ils le couvrent de branchages. — Marchons sur eux. Pour peu que leur conduite
soit suspecte, expédions chacun le nôtre ; les deux autres ne seront pas
à craindre. »
Nous
avançâmes courageusement. Nous n’étions plus qu’à cinquante pas d’eux, lorsqu’ils
nous aperçurent à leur tour. Ils se mirent en ligne, et nous ajustèrent.
« Messieurs les gardes, nous dit un d’eux, dans le patois du pays, » nous
vous respectons beaucoup ; mais si vous faites un pas de plus, vous êtes
morts. » Je me mis à rire. « Je me donne au diable, dit Bertrand, si
je vois-là rien de plaisant. — Imbécile, tu ne vois pas que ce sont des braconniers.
L’homme que tu leur as vu tuer, n’est autre chose qu’un cerf, ou un sanglier.
»
Je leur
criai que nous étions des voyageurs égarés, et que nous ne pensions pas à
les inquiéter. L’un d’eux se détacha et vint à nous. Il vit nos voitures
; il entendit les criailleries de nos femmes ; la confiance s’établit, et
la connaissance fut bientôt faite.
C’était
en effet des braconniers francs-comtois, qui venaient, pendant le jour, guetter
le gibier sur la frontière de la Bourgogne, qui le tuaient la nuit, quand
leurs chiens le retrouvaient, et qui le cachaient jusqu’à ce qu’ils fussent
sûrs que leur coup de feu n’avait attiré personne. À la pointe du jour, ils
emportaient leur proie, et l’allaient vendre au marché de Dôle. Ainsi ils
faisaient manger de bons morceaux à leurs compatriotes ; ils se garnissaient
la bourse, et n’avaient à craindre que les gardes-chasses bourguignons.
Nous
avions tous passé une nuit, à peu près blanche. L’appétit succède ordinairement
à une frayeur calmée, et depuis neuf jours nous n’avions pas goûté de chair
fraîche. Je proposai à nos
chasseurs
de nous vendre leur gibier, et de nous aider à l’apprêter. C’était
un jeune chevreuil.
Ils
acceptèrent la proposition. André, qui se retrouva, comme par enchantement,
nous déclara qu’un bon repas, pris en Bourgogne, n’avait nul attrait pour
lui. D’après le rapport des braconniers, nous étions, au plus, à une lieue
de la lisière de la Franche-Comté, et ils ne se souciaient pas trop, eux-mêmes,
de s’arrêter là trop longtemps.
Je ne
redoute pas le danger ; mais je me rends facilement à un conseil raisonnable.
Nous jetâmes le chevreuil dans le fourgon, et nous nous remîmes en route,
guidés par nos paysans. Une heure après, nous étions sortis de la forêt,
et nous entrâmes dans un village, où tout portait les livrées de la misère.
Tel est l’effet d’un gouvernement despotique. Des impôts excessifs tuent
l’industrie, et le paysan ne cultive pas une terre, dont la violence lui
arrache les produits. Tous les hommes de ce village étaient braconniers,
et ils payaient, au gouverneur de Dole, un droit pour le gibier qu’ils portaient
au marché. « Au moins, leur dis-je, ce chevreuil-ci ne paiera rien. »
André
prétend que lorsqu’on veut manger une bonne matelote, il faut qu’elle soit
apprêtée par les mariniers qui ont pris le poisson. Je fis la même remarque
au sujet du gibier. Il nous parut délicieux, et il n’en resta rien. À la
vérité, les braconniers, leurs femmes et leurs enfans, s’étaient joints à
nous. André prodigua notre vin : la gaité fait oublier le mal passé, et empêche
de penser au lendemain. Les chaumières de ces paysans n’étaient pas habitables.
Nous remontâmes dans notre fourgon, et nous y dormîmes comme des gens qui
ne craignaient plus Mayenne, ni Péricarde.

Dôle en
1610 (détail d'un dessin d’Étienne Martellange)
CHAPITRE
XXVII.
Suite
de notre voyage.
Nous
arrivâmes aux portes de Dôle, par le plus beau temps du monde. Je l’ai déjà
dit : le soleil marche toujours, sans égard à la position des humains. Il
éclaire indistinctement un crime, une faute, une bonne action, une démarche
indifférente. Qu’éclairera-t-il aujourd’hui ?
Un officier
espagnol nous demanda qui nous étions, d’où nous venions, où nous allions,
« Français, de France, en Suisse, répondit gaîment André. » Sa gaité durera-t-elle
longtemps ? On nous donna un caporal et quatre hommes, qui nous conduisirent,
avec nos équipages, à la porte de M. le gouverneur.
Don
Pédro de Vélasco, de Bontados, de Larguillas, croyait Philippe II le plus
grand des rois, nés et à naître ; sa fille Eugénie, la plus belle princesse
de l’univers, et il n’en fallait pas davantage pour être bien à la cour de
Madrid. Il était gouverneur de Dôle.
Nous
le trouvâmes assis dans un grand fauteuil, derrière lequel étaient plantés
deux Alguazils, ayant chacun une hallebarde à la main. Le premier regard
que nous adressa sa seigneurie, exprimait le dédain le plus complet, et j’avoue
que
le
désordre de nos vêtemens ne commandait pas la considération.
Don
Pédro de Vélasco, de Contados, de Larguillas, était un homme de cinquante
ans, sec comme une allumette, et fier comme un Espagnol. Il nous interrogea
avec le ton d’un juge qui cherche des coupables. Sa barbe en escopette, sa
longue moustache grise, qui lui couvraient la moitié de la figure, ne m’empêchèrent
pas de deviner l’homme à qui j’avais affaire. Je me sentis inspiré, et cette
fois, ce fut moi qui pris la parole.
Je déclarai
à sa seigneurie que j’avais l’honneur d’être membre du comité des seize,
qui ne s’occupait qu’à mettre sur le trône de France, le grand Philippe II,
ou son incomparable fille Eugénie, et qui, sans doute, réussirait dans son
louable projet. Je nommai mes honorables confrères, la Roche Blond, bourgeois
recommandable de Paris ; Jean Prévôt, curé de Saint- Séverin ; Jean Boucher,
curé de Saint-Benoît ; Guillaume Rose, évêque de Senlis, et Mathieu de Launay,
chanoine de Soissons. À chacun de ces noms illustres, le gouverneur se permit
une légère inclination de tête.
J’ajoutai
que nous nous rassemblions toutes les nuits chez le vieux Sanchez, où nous
réglions le travail, en sablant le bon vin d’Espagne ; que tous les matins
j’allais rendre compte de nos opérations à l’illustrissime Bernardin de Mendoza,
ambassadeur du grand Philippe. Don Pédro de Vélasco, de Contados, de Larguillas
avait entendu parler de tous ces personnages- là, et au nom de Mendoza, il
se leva tout-à-fait.
Je me
plaignis amèrement d’obstructions au foie qui me forçaient à suspendre mes
travaux, et pour lesquelles les médecins m’avaient ordonné d’aller
respirer l’air de la
Suisse.
« Vous avez sans doute des papiers ? — J’en avais d’excellens,
un sauf-conduit de monseigneur de Mendoza, visé par monseigneur l’évêque
de Senlis. Mais…. Mais…. Mais, quoi, reprit le gouverneur, qu’on nomme ordinairement
don de Vélasco pour en finir ? »
Je racontai
à sa seigneurie, comme quoi nous nous étions trouvés nez à nez à Auxerre,
avec le duc de Mayenne. « On dit, en effet, qu’il lève des troupes en Bourgogne.
» Comme quoi j’avais brûlé mon sauf-conduit, qui eut suffi pour me faire
pendre ; comme quoi, malgré cette précaution, M. Péricard m’avait arrêté
; comme quoi, enfin, nous l’avions enfermé dans la cave d’un cabaret, pour
pouvoir nous échapper. Cette dernière partie de mon récit, expliquait le
désordre de notre costume, qu’on voyait, d’ailleurs, avoir été brillant.
J’attendais
que sa seigneurie parlât.
Péricard
encavé, le faisait rire au point que je ne lui voyais plus les yeux, ni le
nez ; la barbe et la moustache avaient absorbé le reste de la figure. Il
retrouva enfin la parole pour me demander si j’étais gentilhomme. « Certainement,
Excellence. Je suis capitaine au service des seize, et seigneur d’un fief
magnifique, situé près de Paris. — Votre nom ? — Antoine de Mouchy, de la
Moucherie, de la Tour. — Diable ! vous êtes noble comme un Espagnol. Et votre
compagnon, l’est-il ? — Au moins autant que moi. Il est fils naturel du
roi de France Henri II, et de la plus jolie femme d’Angoulême. » Don Vélasco
se leva une seconde fois, et nous adressa un salut fort poli.
« Seigneur
de Mouchy, de la Moucherie, de la Tour, vous irez en Suisse. Mais défiez-vous
de cet air-là ; il est contagieux. Ces
gens-là
ont soutenu à coups de canon, de mousquet, et de pertuisane, qu’ils devaient
être libres, et vous savez qu’il nous faut des sujets soumis, et qui ne raisonnent
jamais. »
Nous
allions nous retirer. « Ah ! nous demanda le gouverneur, où allez-vous loger
? — Ma foi, Monseigneur, au premier cabaret qui se présentera. — Fi donc.
Deux gentilshommes seraient confondus avec la canaille ! je ne souffrirai
pas cela. D’ailleurs, le logement d’un membre du comité des seize est marqué
de droit au palais du gouvernement. » Nous nous serions fort bien passés
de cet honneur-là.
On nous
conduisit, hommes, femmes et enfans, dans un coin du palais délabré du gouvernement.
Nous y trouvâmes une table vermoulue, quelques mauvaises chaises ; des lambeaux
de tapisserie, qui servaient de tapis de pied, l’hiver, et qu’on accrochait
aux murs, au retour du printemps. Notre premier soin fut de nous mettre décemment.
Madame André, qui ne savait quel rôle elle jouerait dans la journée, suivit
notre exemple.
Pendant
que nous faisions notre toilette, André me félicita sur la fécondité de mon
imagination, sur la facilité avec laquelle j’avais menti, pendant un grand
quart-d’heure. « Mais, ajouta-t- il, que doit penser de cela le grand saint
Antoine ? — Le grand saint Antoine ne m’a pas conservé Colombe. D’ailleurs,
le mensonge est permis, quand il est utile. — Voilà une jolie logique. Vous
vous formez, Monsieur. Bientôt vous ne serez plus qu’un dévot, comme nous
en avons rencontré tant. — Allons nous présenter à M. le gouverneur. »
Il recula
de deux pas, en nous voyant ; ses vieux oripeaux disparaissaient devant notre
mise, riche, fraiche et élégante : nous avions pris ce que nous avions
de mieux. « Quelle
tournure,
» s’écria t-il ! Pardon, Messieurs, si je vous ai pris d’abord pour des aventuriers.
Votre costume de voyage a causé mon erreur. Avec cette démarche, ce maintien,
il est impossible que vous ne soyez pas nobles du temps de l’expulsion des
Maures par Ferdinand et Isabelle. Savez-vous, M. de Mouchy, de la Moucherie,
de la Tour, qu’on ne se douterait pas, en vous voyant, que vous ayez des
obstructions au foie. Personne, au reste, ne le sait mieux que vous.
« Dites-moi,
Messieurs, êtes-vous mariés ? — Mon compagnon, le marquis André de Valois
l’est. — Et il a laissé madame la marquise en France, pour vous suivre ?
— Pardonnez-moi, excellence ; nous voyageons tous ensemble, à petites journées,
philosophiquement…. — Madame de Valois est ici ! elle est ici, et vous ne
me l’avez pas présentée ! Elle est ici, et je l’ignore ! allez la prendre,
Messieurs ; amenez-la- moi…. Que dis-je ? Je vais la chercher en personne….
La galanterie espagnole exige…. Madame la Gouvernante sera enchantée de voir
madame de Valois…. Messieurs, nous dînons tous ensemble. » Le gouverneur
part ; nous le suivons.
Il présente
la main à madame de Valois, avec les simagrées et les contorsions usitées
à la cour de Charles-Quint. Madame de Valois se prête à la circonstance ;
on lit même sur sa physionomie le plaisir que lui cause la démarche du Gouverneur.
Son excellence la conduit à l’appartement de madame la Gouvernante, l’y laisse,
après le cérémonial de rigueur, et nous ramène dans sa salle d’audience.
André
me parut embarrassé. Que peut-il craindre, pensai-je ? il me semble que tout
va à merveille. « Excellence, dit-il, la galanterie espagnole, sa vivacité,
sa précipitation, ne m’a pas donné le temps de vous prévenir que madame de
Valois a des
absences….
— Des absences ! — Oui, elle dit souvent des choses fort extraordinaires….
C’est le lait qui lui porte à la tête. Je lui ai donné un second nourrisson,
pour faire descendre cette liqueur, si précieuse et si perfide à la fois.
Vaine espérance ! il a fallu avoir recours à la faculté. M. Miron, ci-devant
premier médecin de Henri III, m’a conseillé de la faire voyager en Suisse….
— M. Miron croit donc que l’air de la Suisse est un spécifique contre le
lait ? ce médecin-là est un sot. — Pardonnez-moi Monseigneur, c’est un savant.
— L’un n’empêche pas l’autre. — Je prie votre excellence de remarquer que
l’air des montagnes est très-dilaté, très-raréfié, et que ce doit être un
précipitant. — Ah, voilà un argument sans réplique. » Le gouverneur tira
ses tablettes et écrivit : L’air de la Suisse est excellent contre les obstructions
au foie, et le lait remonté.
Madame
la Gouvernante entra précipitamment. C’était une jolie brune, de dix-huit
à vingt ans, très-éveillée, très-vive, une de ces femmes qu’un homme de cinquante
ans n’épouse pas toujours impunément. Elle riait aux éclats ; madame de Valois
la suivait et riait aussi. Nous avons déjà eu l’occasion de remarquer que
le rire se communique.
« Vous
êtes joué, mon cher Vélasco, et vous le méritez bien : vous êtes d’une facilité
! Au reste, cette aventure ne présente aucun inconvénient pour nous, et je
la trouve très-réjouissante. Ah ! ah ! ah ! Madame de Valois, ou d’autre
chose, m’a parlé d’un Bussy-Leclerc, gouverneur de la Bastille, qui lui a
appris à tirer des armes ; d’un André, fort honnête homme, qui l’a épousée
deux mois avant ses couches ; d’un Mouchy, novice chez les Franciscains d’Étampes,
puis capitaine, puis seigneur d’un château. Que sais-je, encore ? Elle raconte
tout cela avec
une
volubilité, qui m’a permis à peine de la suivre, moi qui n’ai pas une grande
habitude de la langue française. Une femme qui tire des armes ! Ah, ah, ah
! qui fait un enfant sans être mariée ! Ah, ah, ah ! et qui vient ici jouer
la femme de qualité ! c’est trop plaisant, en vérité ! »
« Madame,
lui dit gravement don Vélasco, comment, avec la pénétration que je vous connais
la cause de ces extravagances vous est-elle échappée ? Vous ne voyez pas
que c’est le lait qui monte à la tête de cette dame ! M. de Valois, qu’a
prescrit le docteur Miron contre ces accès-là, en attendant que l’air de
la Suisse les dissipe entièrement ? — De mettre les pieds de la malade dans
de l’eau très chaude. — Vite, vite, Madame ; que votre camériste fasse
chauffer de l’eau. »
Claire
avait de l’esprit naturel. Quelques œillades d’André lui firent aisément
comprendre que son bavardage eût pu nous compromettre au plus haut degré.
Elle n’était au courant de rien, et elle passa d’une loquacité, très dangereuse,
au silence le plus absolu.
« Remarquez,
Madame, s’écria le gouverneur, cette transition subite de l’exaltation à
l’accablement. Vite, vite de l’eau chaude. » Pendant que l’eau chauffait,
madame la Gouvernante promena ses yeux noirs sur André et sur moi. Elle me
fit l’honneur de les fixer sur ma petite personne. Elle revint, avec beaucoup
d’adresse, sur l’opinion qu’elle avait d’abord émise contre nous ; elle nous
marqua des égards qui me parurent partir autant du cœur que de sa conviction.
André demanda la permission d’accompagner madame de Valois dans la chambre
qu’on lui avait donnée, et où il allait trouver, sous sa main, le linge nécessaire
à un lavabo. Ils sortirent.
Dona
Inès me proposa de danser, avec elle, un fandango, en attendant le
diner. Je n’avais dansé de ma vie ; mais comment résister à une jeune femme,
dont les yeux vous disent : Allons, laissez-vous aller ?
Elle
prit ses castagnettes ; elle préluda, et fort bien. Elle dansa, très bien
encore. Moi, je la suivais, en sautillant : je ne pouvais faire mieux. Inès
riait de tout son cœur, en tournant autour de moi. « Madame, lui dit Vélasco,
on ne plaisante pas un membre du comité des seize de Paris. N’abusez pas
plus long-temps de la complaisance de M. de Mouchy, de la Moucherie, de la
Tour. » Inès me prit la main, me remit à ma place, et me fit la plus jolie,
et la plus piquante des révérences.
M. et
madame de Valois rentrèrent. Je vis d’abord qu’André avait fait la leçon
à Claire, et qu’elle en avait profité. Elle se présenta, sans gaucherie et
sans affectation ; elle parla peu, et ne dit rien qui ne fût conforme à la
fable que nous avions imaginée. Faites des contes ; ayez l’air d’y croire,
et vous persuaderez vos amis. Ceux-là entraîneront les autres.
On vint
avertir son Excellence que le dîner était servi. Le lait de Claire était
réellement descendu, ou monté. Don Vélasco ne cessait, en lui donnant la
main, de contempler les deux sources volumineuses, qu’il enviait probablement
aux nourrissons. Claire était vraiment jolie.
Je présentai
le poignet à madame la gouvernante. Cette marque de déférence est de rigueur
en Espagne, quand on conduit une femme de distinction d’un appartement à
un autre. Inès prit le poignet, coula sa petite main le long de la mienne,
l’ouvrit, caressa le bout de mes doigts, et me dit à voix basse :
«
Vous dansez mal ; mais vous êtes beau garçon. »
Nous
nous mîmes à table. On sent bien qu’Inès me plaça à côté d’elle. M. le gouverneur
s’assit, sans façon, auprès de madame de Valois.
Une
forte odeur d’ail nous frappa, désagréablement, l’odorat. L’olla-podrida,
le mets essentiel du repas, en était infecté. Les deux Espagnols semblaient
trouver cela admirable. Les trois Français les regardaient faire. André était
doué d’une prévoyance, que rien ne pouvait mettre en
défaut.
« Monseigneur,
dit-il, nous ne sommes pas habitués à la cuisine espagnole, et nous avons,
dans notre fourgon, des choses excellentes, que nous avons prises à Paris.
Votre Seigneurie serait-elle fâchée de voir comment on fait la pâtisserie
dans ce pays-là ? » » Voyons la pâtisserie française, dit Inès. Voyons-la,
répéta don Vélasco. »
Il sortit
et rentra, précédé par Bertrand, qui portait un superbe pâté d’Arpajon. Nous
le réservions pour célébrer notre affranchissement, le jour où nous mettrions
le pied sur le territoire suisse. Le marquis de Valois supplia monseigneur
de l’ouvrir.
« Que
vois-je, s’écria Vélasco! Un papier plié entre deux bécasses ! Voyons ce
que c’est. — Monseigneur, reprit André, je confesse que j’ai commis une infidélité,
et ce papier en porte, peut-être, la preuve. Nous avons reçu ce pâté des
mains de l’illustrissime Bernardin de Mendoza, qui le destinait à monseigneur
le gouverneur de Besançon. Mais votre Excellence nous a reçus avec tant de
grâce, tant d’amabilité, que nous aimons mieux le fêter ici qu’à Besançon.
— Diable ! diable ! Si j’avais pu prévoir cela, je ne l’aurais pas ouvert.
Le
gouverneur de Besançon commande toute la province ; donc il est mon supérieur.
Et puis il descend des rois de Portugal, que les Espagnols viennent de chasser
de leurs Etats, et pour le consoler de cette disgrâce, le grand Philippe
II lui a donné le gouvernement de la Franche-Comté. Manger son pâté ! Diable
! diable ! — Monseigneur, je vais le refermer. — Monsieur le marquis, on
verra toujours qu’il a été ouvert. — C’est vrai, c’est très-vrai. — Voyons
ce que dit ce papier. Nous nous conduirons d’après ses indications. »
À peine
Vélasco se fut-il mis en devoir de déchiffrer ce papier, auquel je ne comprenais
rien encore, qu’Inès s’était saisie d’une bécasse, l’avait mise en pièces,
et m’en avait servi le meilleur morceau. Elle boucha, sans s’en douter, un
très-petit trou, par lequel André avait insinué le papier. Elle engagea la
conversation sur la destination primitive du pâté, et dit qu’il serait fâcheux
qu’il n’eut pas été mangé à Dôle. En effet, il était fort bon. Inès accompagnait
ses petites phrases coupées, de regards, auxquels il m’eût été difficile
de me méprendre. Je sentis bientôt son pied mignon presser tendrement le
mien.
Je n’avais
pas oublié le serment prononcé sur le tombeau de Colombe ; je n’avais pas
oublié non plus les chagrins cuisans, que m’avait fait éprouver la comtesse
de Montbason, et je me promis de n’être plus cruel.
Le gouverneur
finit enfin d’étudier ce qui était écrit sur ce papier, et il nous le lut,
tant bien que mal.
« Mon
cher gouverneur, d’après le bien que j’ai dit de noble et honorable homme
de Mouchy, de la Moucharderie, de la Tour, dans le sauf-conduit que je lui
ai délivré, vous n’aurez pas manqué de l’engager à dîner. Je suis tellement
satisfait de ses
services,
que je vous autorise à lui apprendre, au dessert, que j’ai demandé pour lui,
à Madrid, la décoration de l’ordre… de l’ordre…. Que diable, la graisse a
formé là une tache d’encre. » Je me doutai qu’André n’avait su de quel ordre
il devait me décorer.
« Voyez
donc, Messieurs, tâchez de lire cela. — Je ne saurais, dit André. Ni moi,
ajoutai-je. — C’est sans doute un des ordres les plus honorables de l’Espagne.
Monsieur de Mouchy, de la Moucharderie, de la Tour, je vous en fais mon compliment.
Signé le duc Bernardin de Mendoza, avec paraphe. »
Je repris
ce papier. Il était tout gras, tout roussi. André avait emprunté le ministère
de Marianne.
Le gouverneur
reprit la parole, avec une dignité tout-à-fait remarquable. « Messieurs,
dit-il, cette affaire est de la plus haute importance. Un pâté, qui était
destiné à monseigneur le gouverneur de Besançon, et que madame la gouvernante
a mis en pièces ! » Ceci n’est pas un jeu d’enfans. Diable ! Donnez- moi,
Messieurs, votre parole de gentilshommes français de ne parler à qui que
ce soit de l’aventure du pâté. » On sent, que nous la donnâmes, et de grand
cœur.
« Je
vous conseille à présent, Messieurs, de ne point passer à Besançon. C’est,
d’ailleurs, le chemin le plus long pour arriver à Genève. Suivez la ligne
directe ; tirez à droite, et prenez par Saint-Claude. Vous avez brûlé votre
sauf-conduit ; je vous en donnerai un autre, et vous en serez contens, car
vous le ferez vous-mêmes. Je me bornerai à le signer.
«
Voilà une affaire qui me paraît sagement arrangée ; mais, diable, elle était
embarrassante ! M. de Valois, passez-moi une moitié de bécasse.
« Excellent,
délicieux ! Jacques de Compostelle, va me chercher cette cruche de vin d’Arbois.
— Laquelle, Monseigneur ? — La dernière que ces contrebandiers ont voulu
introduire à Dôle, en fraudant les droits. Je ne peux la boire en meilleure
compagnie, et puis nous la viderons à la santé du gouverneur de Besançon.
»
Vélasco
versait à Claire ; Inès me versait, et ne s’oubliait pas. Elle chantait la
romance, en me pinçant doucement le genou. Vélasco devenu très tendre, serrait
de près la marquise de Valois. André n’est pas jaloux ; mais, semblable à
bien des maris, il n’aime pas qu’on caresse sa femme devant lui. Il envoya
Claire à ses nourrissons. Vélasco la suivit ; André sortit avec eux.
J’étais
seul avec Inès, et Jacques de Compostelle. J’avoue humblement que la petite
dame me plaisait, et beaucoup. Le valet était de trop : elle l’envoya chercher
des pipes.
Il fut
assez long-temps à les trouver, et quand il rentra, les fumées du vin d’Arbois
étaient à peu près dissipées. Inès alluma une pipe et me la présenta. Je
lui dis que je n’étais pas habitué au tabac. Elle prit la pipe, et la fuma
elle-même. « Comment, petite mal-propre, vous mangez de l’ail, et vous fumez
! » Je me levai ; elle voulut me retenir. Le charme était détruit.
Don
Vélasco reparut, un peu tard, et il avait beaucoup d’humeur. « Votre marquis
de Valois, me dit-il, est jaloux comme un tigre. Croiriez-vous qu’il a enfermé
sa femme à la
clef
? Je n’enferme pas la mienne, moi qui suis Espagnol. » Le marquis le suivait,
pas à pas. Il tenait un papier d’une main, et une plume de l’autre. Le gouverneur
signa le sauf-conduit ; il y apposa son cachet, et toutes les pretintailles
d’usage.
« Monsieur,
me dit le marquis, j’ai donné ordre qu’on attelât les voitures. Je vous prie
de vous tenir prêt à monter dans la vôtre. Que diable, décria le gouverneur,
il faut passer le reste de la journée ensemble. Vous partirez demain matin.
Cela n’est pas possible, répliqua le marquis. Nous avons le plus haut intérêt
à arriver promptement en Suisse. Il n’est que deux heures ; nous irons coucher
à Arbois. — Que diable, vous y arriverez trop tard. — Il fait clair de lune.
— Dites-lui donc, Monsieur le membre distingué du comité des seize, que vous
ne voulez partir que demain. — Je ne prendrai pas cela sur moi, Excellence.
Comment désobliger un seigneur, qui pourrait disputer la couronne de France
au grand Philippe II, s’il était légitimé ? » Bertrand vint nous dire qu’on
n’attendait plus que nous. Inès tira un petit mouchoir blanc, et rentra tristement
chez elle. Le gouverneur oublia la morgue espagnole, et nous conduisit jusques
dans la rue : il voulait dire un dernier adieu à madame la marquise.
Nous
partîmes enfin, très-satisfaits du dénouement d’une aventure, qui pouvait
finir très-mal. Nous étions obligés de garder, jusqu’à Genève, les qualifications
que nous avions prises, et nous nous les donnions, en riant aux éclats, pour
ne pas les oublier.
C’était
jouer la comédie ; mais tous les hommes ne la jouent- ils pas ? Un comédien
n’est roi que pendant deux heures ; mais qui de nous est sûr d’être demain
ce qu’il est aujourd’hui ?
Nous
n’avions pas envie de réciter notre histoire à chacun des commandans de ville,
que nous devions trouver sur notre route. C’eût été nous imposer une contrainte
continuelle, et il est ennuyeux de se répéter tous les jours : cela ne convient
qu’à des sots.
En conséquence,
nous nous bornions à présenter notre sauf- conduit à la porte des places
fortes, dont la Franche-Comté était surchargée. Nous passions incognito,
et nous étions bien partout, grâces aux provisions et aux bons lits que nous
portions avec nous.
Mais
nous ne pûmes éviter de représenter à Saint-Claude. Monseigneur l’abbé, seigneur
du lieu, jouissait de la plénitude de ses droits, et il faisait conduire,
devant lui, tous les étrangers qui passaient par sa petite ville. Nous arrivâmes
au palais abbatial, au milieu des gardes-du-corps et de la garnison sous
les armes. Le tout se composait de deux cents hommes, destinés à réprimer
les entreprises des Genevois, qui ne pensaient à attaquer personne.
Les
gardes-du-corps étaient rangés sur deux files, le long de l’escalier, et
le poste d’honneur occupait la salle d’audience ou Monseigneur nous reçut.
Il parait qu’on regarde, dans ce pays- là, les grands fauteuils comme la
marque de la plus haute distinction. Monsieur l’abbé en occupait un énorme,
surchargé de coussins. Un jeune clerc, d’une très-jolie figure, tenait, auprès
de sa grandeur, la crosse abbatiale. Je vis d’un coup d’œil rapide, qu’elle
était surmontée d’une petite couronne en vermeil, quoique Jésus-Christ ait
dit : Mon royaume n’est pas de ce monde.
Monseigneur
lut notre sauf-conduit, et le lut très-couramment. Pendant qu’il lisait,
je pensais qu’il pouvait bien avoir une petite couronne, puisque notre très
saint père le pape en a trois grandes. Au reste, me dis-je, autre temps,
autres mœurs. « Vous êtes, nous dit l’abbé, des personnages très-recommandables,
et vous dînerez avec moi. » Nous nous excusâmes sur la fatigue d’une longue
route. Monseigneur parut piqué de la tiédeur avec laquelle nous avions reçu
la plus honorable des invitations, et il n’insista point.
Nous
nous retirions. « Quel bonheur, dis-je à André, pour ces paysans et ces vilains,
d’être vassaux de cet illustre et saint personnage ! Peut-être ne le sentent-ils
pas. » Nous rencontrâmes sept à huit misérables qui montaient l’escalier
à genoux. « Voilà sans doute, me dit André, quelques-uns des heureux vassaux
de Monseigneur. » Nous vîmes, dans la cour, un malheureux, nud jusqu’à la
ceinture, attaché à un poteau de bois. Le sang jaillit au premier coup de
fouet, et il en reçut vingt-cinq. Ses cris nous perçaient le cœur ; nous
restâmes cependant. Inexplicable empressement de voir des misérables !
Monseigneur
parut à une croisée, et fit un signe de la main, auquel le fouet tomba de
celles de l’exécuteur.
Nous
demandâmes quel crime avait commis cet homme. « Il doit trois jours de travail,
par semaine, à Monseigneur, et pendant celle qui vient de s’écouler, il ne
lui en a donné que deux.
Nous
nous regardâmes André et moi. Nous nous prîmes la main, et nous nous entraînâmes
loin de cette scène d’horreur.
« Ah, lui
dis-je, en voyant de telles choses, on est tenté de pardonner aux huguenots
! — Votre raison se développe,
Monsieur.
Mais partons, sans perdre une minute. L’air qu’on respire ici et malfaisant.
»
Trois
heures après, nous étions sur le territoire de Genève. Un soupir d’allégement
s’exhala, à la fois, de toutes les poitrines ; d’un mouvement spontané, nous
saluâmes la terre de la liberté, et nous jetâmes aux vents les morceaux de
notre sauf-conduit. L’histoire des tyrans, de toutes les classes et de tous
les grades, est pour les Genèvois, ce que sont, pour les enfans, en France,
les contes de génies malfaisans, que la vertu blesse et irrite souvent. L’histoire
leur apprend à chérir leur indépendance, et à la conserver au prix de leur
sang.
Genève
ne doit la sienne qu’au peu d’étendue de son territoire. Elle est placée
entre des États puissans, à qui elle sert de barrière, et qui tous sont intéressés
à la protéger. Hélas, l’Océan n’a pas arrêté les Espagnols. Ils ont noyé
un nouveau monde dans le sang.
Je croyais
prendre une nouvelle existence. Je n’avais plus d’inférieurs ; mais aussi
je n’avais plus de maîtres. La loi seule était au-dessus de moi, et les magistrats,
chargés par le peuple de la faire respecter, lui étaient soumis, comme le
particulier le plus obscur. Je me trouvais grandi, en me livrant à ces pensées.
Cependant je déclarai à André que je n’entrerais pas à Genève.
« Pourquoi
cela, Monsieur ? » Cette ville est ce que fut la Rochelle, il y a quelques
années. Elle est la métropole des huguenots, avec cette 33 différence que
les Rochellois ne persécutaient personne, et qu’ils se bornaient à se défendre.
Ici, Calvin, usurpateur du plan et du nom de Zuingle, a fait brûler Michel
Servet, qui n’avait fait d’autre crime que de ne pas penser comme lui. L’homme,
qui découvrit la circulation du sang, devait être sacré pour Calvin et cet
attentat devait le
rendre
odieux aux Genèvois. Son nom est encore respecté et béni dans Genève. N’entrons
pas là, André. Descendons sur le bord du lac. Nous nous y embarquerons avec
nos équipages, et nous entrerons dans le canton de Fribourg, par la rive
opposée.
— Nous
trouverons des protestants partout, je vous en ai prévenu. — Au moins, ils
ne sont point persécuteurs. — Parce qu’ils sont contenus par les catholiques.
Partout l’homme veut dominer. Ses adversaires sont-ils puissans ? il ploie,
et ne rompt pas. Quand l’orage est calmé, il se relève, et opprime à son
tour.
« Presque
de nos jours, Villegagnon, grand navigateur, chevalier de Malte, mais protestant
dans le cœur, équipa trois navires, avec les secours qu’il reçut de ses co-religionnaires.
Il embarqua trois cents réformés, et ce qu’il fallait de catholiques pour
ne pas donner de soupçons. Il descendit au Brésil, sur une île inhabitée,
et il y bâtit un fort. Bientôt les protestans persécutèrent, égorgèrent les
catholiques. Les Portugais profitèrent de ces divisions et les exterminèrent
tous.
« Allez
en Angleterre, vous y verrez les anglicans, détester les catholiques, ceux
d’Irlande surtout ; vous les verrez tenir ceux- ci dans un état d’abjection,
qui, tout ou tard, les poussera à la révolte, vous les verrez… — Je vois,
d’après tes propres aveux, que la religion, dite réformée, devrait être anéantie,
et est-il inconcevable que tous les souverains ne se soient pas ligués contre
elle.
« Monsieur,
Monsieur, il n’est pas de médaille qui n’ait deux faces. Nous avons examiné
un côté de celle-ci ; arrêtons-nous un moment à l’autre. Qui a fait égorger
neuf mille Bulgares, qui étaient venus se donner à Dagobert premier ? Qui
a massacré, brûlé les Albigeois ? Qui a soufflé le feu des croisades ? Qui
a exterminé neuf millions d’hommes en Amérique ? Qui a
couvert
la France de bûchers, et a imaginé l’horrible supplice de l’estrapade ? Qui
a fait la Saint-Barthélémy ? Sont-ce les protestans ? Vous ne répondez pas,
Monsieur. Dirai-je, comme vous, que les princes protestans devraient se liguer
pour faire disparaître la religion catholique de la terre ?
« La
morale est une ; elle est nécessaire, indispensable à l’homme civilisé. Nous
élèverons-nous contre elle, parce que trop souvent nos passions l’ont déshonorée
? De quoi a-t-on pas abusé ? De quoi n’abusera-t-on pas encore ? Dérobons
le bien à travers les excès qui nous le cachent ; saisissons-le, pratiquons-
le.
« Rappelons-nous
souvent le mot de votre ami Poussanville : prends les hommes comme ils sont.
Paraphrasons-le. Ménage les opinions des autres, si tu veux qu’on respecte
les tiennes ; fuis les méchans ; cherche les bons ; ne sois jamais plus sévère
que le Grand-Être, qui supporte les premiers, et qui attend les seconds.
Garde-toi, surtout, de parler en son nom, jusqu’à ce que tu aies soulevé
le voile dont il enveloppe son essence divine. — Ma foi, mon ami André, je
crois que tu as encore raison.
« —
Nous entrons dans un pays où chacun prie, d’après les opinions qu’il a sucées
avec le lait, et où personne ne dogmatise. Gardez-vous de vous ériger en
missionnaire. Oubliez vos homélies, et de vaines disputes de controverse.
Riez de tout cela : c’est le seul moyen de ne pas vous passionner.
« —
André, n’entrons pas à Genève. Je crains de voir le théâtre du supplice de
Michel Servet. — Votre répugnance est
louable,
si elle est l’effet d’un tolérantisme naissant. N’entrons pas
à Genève. »
Nous
arrivâmes sur les rives du lac. Deux mariniers dormaient dans une grande
barque, qui nous parut assez spacieuse et assez forte pour nous recevoir
avec nos équipages. Nous les éveillâmes, et nous les trouvâmes très-disposés
à gagner notre argent. Nous convînmes avec eux d’un prix honnête, pour nous
transporter à l’autre extrémité du lac. Ils nous firent observer qu’il a
quinze lieues de long ; que la journée s’avançait, et qu’il fallait coucher
à Coppet sur la rive gauche, ou à droite à Beauregard. Nous entrions dans
un monde inconnu pour nous, et nous n’avions pas de raisons de préférer un
gîte à un autre. Nous nous laissâmes conduire, et c’est ce que nous pouvions
faire de mieux.
Partout
les hommes tiennent à leur pays ; ils y tiennent dans la proportion de ce
qu’il offre de remarquable. Nos bateliers, sans nous consulter, nous menèrent
à l’endroit dit la perte du Rhône.
Ce fleuve
a sa source dans les environs d’Oberwald ; il se grossit à mesure qu’il avance,
et il se jette dans le lac près de Noville. La rapidité de sa course l’empêche
de se mêler avec les eaux tranquilles du lac. Arrêté par un banc de rochers,
il se jette avec fureur dans une ouverture qui, à sa naissance, n’a que deux
pieds de largeur. Ses flots comprimés se soulèvent, s’agitent, se fondent
en écume. Ce spectacle étonne l’imagination.
Bientôt
l’ouverture s’élargit, et le fleuve reprend sa marche, rapide et majestueuse.
Il se perd ensuite sous un énorme amas de rochers : c’est ce qu’on appelle
la perte du Rhône. Il reparait à soixante-quinze pieds, environ,
de distance ; mais il se
promène
calme, tranquille, ce qu’André ne put expliquer malgré sa grande pénétration.
Nous
remerciâmes nos conducteurs de la jouissance qu’ils nous avaient procurée.
Ils nous apprirent que le lac est très- poissonneux, et que nous trouverions
d’excellentes truites à Copet. Ils nous parlaient de ces truites en amateurs,
et nous ne l’étions pas moins qu’eux.
Je leur
demandai s’il y avait des aubergistes à Copet. Ma question parut les étonner.
Je leur expliquai ce que c’est qu’une auberge. Ils se regardèrent, et se
mirent à rire. Je conclus de-là que l’invention d’André, qui commençait à
se réaliser en France, n’était pas connue encore dans ces cantons. « Hé bien,
dîmes-nous gaîment, nous coucherons dans notre fourgon. Cela ne plaira peut-être
pas, ajoutai-je, à madame la marquise de Valois. — Madame la marquise, me
répondit-elle, est redevenue Claire, et ne veut plus être autre chose. »
Notre
barque s’arrêta à Copet, devant la cabane d’un pêcheur. Cet homme sortit
aussitôt, et vint à nous d’un air riant. « Ces Messieurs veulent des truites
? — Oui, mon ami. — Je ne suis l’ami que de ceux que je connais bien. — Pardon,
Monsieur. — Je ne suis pas un Monsieur. Je m’appelle Simon, le pêcheur. —
Hé bien, Simon, nous mangerons des truites. — Je vais vous arranger cela.
» Il eût été ridicule, dans ce pays-là, de payer des hommes pour ce que nous
pouvions faire nous-mêmes. André, Bertrand et moi, nous aidâmes nos mariniers
à monter nos voitures sur la berge.
La grande,
la belle pièce de Simon était sa cuisine, et les soirées commençaient à être
fraîches. Un feu pétillant nous attira. Marianne prit la première place,
en sa qualité de
cuisinière.
Elle voulait, dit-elle, voir comment on apprête les truites à Copet.
Le plat
était copieux. André me fit observer que dans le pays de la liberté les hommes
sont égaux, quand ils ne remplissent pas de fonctions publiques.
En conséquence de ce raisonnement, il invita nos mariniers, et
Simon, le pêcheur, à se mettre à table avec nous. Ils ne lui firent pas répéter
l’invitation.
Les truites
étaient excellentes, et j’en fis compliment à Simon.
« À
la bonne heure, dit-il. J’ai reçu ici, il y a huit jours, un mylord anglais,
et cinq à six domestiques. Le maître est un assez bon-homme ; mais ses valets
sont d’insolens drôles, qui trouvaient tout mauvais, et qui me commandaient,
comme s’ils eussent parlé à un soldat allemand. N’oubliez pas, leur dis-je,
que je suis un homme libre. Si vous continuez à faire les insolens, je vous
mets tous à la porte de chez moi. Ils devinrent souples comme un prêtre papiste
devant son évéque. »
Je compris
quelle est la politesse en usage en Suisse : c’est la cordialité et la leçon
de Simon ne fut pas perdue. Cependant je ne pus louer son vin. Il me devina.
« Il est un peu aigrelet, nous dit-il ; mais je n’en ai pas d’autre. »
André sortit, et rentra bientôt avec deux bouteilles de notre vieux macon.
Je versai le premier verre à Simon. Il se leva, ôta son bonnet, et but à
notre santé. « Diable, dit-il, il est bon, et je vous remercie. »
Nous
pensâmes à nous coucher. Simon n’avait que de la paille à nous offrir, et
nous avions de bons lits dans notre fourgon. Mais faudrait-il qu’un de nous
veillât à son tour, comme nous avions fait en Bourgogne et en Franche-Comté,
ou pouvions- nous nous croire en sûreté sur les bords du lac ?
Simon
nous dit que dans le territoire de Genève, il y a, comme ailleurs, des fortunes
inégales, parce que tous les hommes ne sont pas également industrieux, ni
heureux dans leurs entreprises ; mais qu’à Copet, en parlant rigoureusement,
il n’y avait ni riches, ni pauvres ; ni mendians, ni voleurs.
« La
mendicité, ajouta-t-il, n’est commune que dans les États mal gouvernés, et
on dit qu’il y en a beaucoup. — André qui peut lui en avoir tant appris ?
— Monsieur, les magistrats des pays libres ne redoutent pas les lumières
; ils favorisent l’instruction, qui élève l’homme, et l’éclaire sur ses droits.
»
Nous
montâmes dans notre fourgon ; nous nous souhaitâmes une bonne nuit. J’embrassai
les deux enfans, et je m’endormis du sommeil d’un homme libre, sans soucis,
et sans craindre que quelques sbires vinssent troubler mon repos. Mes compagnons
de voyage dormirent aussi tranquillement que moi, et le chant du coq nous
éveilla tous ensemble. Ce réveil-matin établit l’égalité, partout où on veut
se mettre à portée de l’entendre…. Mais les grandes villes, mais les palais;
mais les châteaux de campagne, toujours éloignés des bassecours…. Le coq
ne chante là que pour ses poules.
On est
bientôt debout, quand on ne s’est pas déshabillé. Nous nous secouâmes les
oreilles, tous ensemble encore, et nous descendîmes. Une femme, ni jeune,
ni vieille, ni belle, ni laide, ni grande, ni petite, lavait la chaumière
de Simon. Je demandai au brave homme qui elle était. « C’est ma ménagère,
Monsieur.
— Comment,
Simon, vous êtes marié, et votre femme n’a pas paru hier ! — Monsieur, les
femmes ne sont pas nées pour perdre le temps à caqueter ; mais pour soigner
leur ménage. Les maris Gènevois et Suisses sont naturellement bons et doux
; mais ils veulent que leurs femmes soient soumises…
Pendant
le jour, aucune d’elles ne parait devant des étrangers, si elle n’est appelée.
Le soir, on se couche ; le mari éteint la lampe, et l’égalité renait. » Il
n’y avait rien à répondre à cela.
Simon
nous demanda si nous désirions qu’il apprêtât le déjeûner, ou si mademoiselle
Marianne rentrerait en fonction. Simon n’avait plus de truites ; il ne pouvait
plus nous offrir que du lait, du fromage et du pain noir. Nous le priâmes
de trouver bon que mademoiselle Marianne pourvût à nos besoins.
Nous
étions économes de nos provisions ; mais nous n’y avions pas touché la veille
au soir. Nous fûmes bien aises de donner à Simon une idée de la cuisine française.
« Oh ! quel étalage, dit-il ; que d’embarras, quand on peut vivre de si peu
de chose ! Au reste, tout cela a fort bonne mine. » Nous lui demandâmes la
permission d’inviter sa ménagère à se mettre à table avec nous. « Non, dit-il,
non : nous ne prenons pas de mauvaises habitudes, et nous n’en faisons prendre
à personne, surtout à nos femmes. Demain Claudine trouverait son pain noir
et dur, son fromage aigre, et son petit vin piquant. J’éprouverais le même
dégoût, si je me mettais à table avec vous. Je vais déjeûner avec ma femme.
— Comment, Simon, vous nous abandonnez ! — Pas du tout, Monsieur. Un coup
de sifflet, et je suis à vous. »
On pense
bien qu’il eut plutôt fini que nous. Il allait, il venait, il tournait autour
de nous ; il nous regardait ; il paraissait réfléchir. « Messieurs, j’ai
assez de mes affaires, pour ne pas m’occuper de celles des autres. D’ailleurs,
je ne suis pas curieux. Mais vous me convenez, et beaucoup. Je vais vous
faire quelques questions. Vous allez peut-être en Suisse ? — Au canton d’Appenzell.
— Pour vous y fixer ? — Précisément.
-
Ah, fort bien.
«
Nous touchons à la Savoie et à la Franche-Comté. On trouve encore, dans Genève,
quelque chose des usages de ces pays-là. On n’y remarque pas le petit manteau
de soie, le juste-au-corps, le haut-de-chausse de la même étoffe, galonnés
en or ou en argent, et la petite toque de velours, ornée d’une plume blanche,
qui tombe sur l’oreille. Que ferez-vous en Suisse, sous cet attirail-là ?
À propos, savez-vous l’allemand ? — Pas un mot.
-
Hé bien, on s’arrêtera pour vous regarder.
On se moquera de vous, et vous ne vous en douterez pas. Si on vous entend
prononcer le mot de comte ou de marquis, on vous fera la grimace.
Vous parlerez, et on ne vous répondra pas. Vous vous fâcherez ; vous tirerez
votre longue épée ; on vous rira au nez. — Que faut-il faire, mon cher Simon,
pour éviter ces désagrémens-là ? — Monsieur, il faut entrer dans la Suisse,
vêtu comme ses habitans. — Cela est facile à dire. — Il s’établit un ménage
partout où il peut vivre. »
Il nous
raconta que maitre Luker, tailleur de profession, faisait d’assez mauvaises
affaires dans le canton de Fribourg, où il est né ; que des avanies, faites
à de beaux messieurs et à de belles dames, qui se disaient gens comme
il faut, avaient changé ses idées, et qu’il était venu à Copet ouvrir
une nouvelle branche d’industrie. « Il fait des habits suisses pour les deux
sexes, et il les fait fort bien. Souvent même, il en a de tout prêts. Il
vend à des prix modérés, aux voyageurs raisonnables, qui viennent visiter
nos montagnes, qui n’ont rien de bien attrayant, et il en passe souvent.
Dans ce costume commode, et un gros bâton ferré à la main, ces curieux grimpent
partout. Il y en a bien quelques-uns qui tombent au fond des précipices ;
mais ce sont leurs affaires.
«
— André, que dis-tu de cette idée ? — Qu’il faut aller chez Luker. Il n’y
a pas à balancer. »
Il nous
parut que, depuis quelque temps, il n’était passé aucun de ces curieux, qui
se cassent le cou. Les guerres intestines qui désolent la France ; l’invasion
du duc de Savoie dans le Dauphiné, leur ôtent peut-être l’envie, ou les moyens
de courir le monde. Quoi qu’il en soit, le tour de la boutique de Luker était
garni d’habits de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et de toutes
les formes.
Luker
nous parla un français très corrompu, et cependant il est du canton de
Fribourg, qui touche au territoire de Genève.
« Que
sera-ce, André, quand nous arriverons au centre de la Suisse ? nous n’entendrons
plus un mot. — Qu’est-ce que cela fait, Monsieur ? — Comment, ce que cela
fait ? — On rencontre une jolie femme ; on porte la main sur son cœur. On
a bon appétit ; on ouvre la bouche, et on y présente ses doigts en pointe.
Ce langage-là s’entend partout. — Mais les détails ?
— Mais
la pantomime ? Et puis nous savons le latin, et les curés suisses entendent,
au moins, celui de leur bréviaire. Enfin nous apprendrons la langue. Nous
ne sommes pas plus bornés que les habitans du pays, et ils parlent tous
allemand. — Ils l’ont appris dès leur enfance. — Nous l’apprendrons plus
tard, voilà tout. »

Costumes
de Lucerne et de Lug par Achille Dévéria, vers 1830
CHAPITRE
XXVIII.
Métamorphose,
partie de pêche, et autres événemens.
« Luker,
vous avez donc fait le tour de la Suisse ? Je vois chez vous des costumes
tout-à-fait différens. — Oui, j’ai voyagé en Suisse, et je fais un peu de
tout, parce que beaucoup de personnes préfèrent l’agrément à la régularité.
— Il connaît les hommes. »
Certains
auteurs ont la manie de vouloir savoir et parler tous les baragouins.
Ils
se battent les flancs, pour fatiguer leurs lecteurs. Moi, qui ne suis pas
un échappé de la tour de Babel, et qui ne veux pas le paraître, je traduis
en français les germanismes de Luker.
« Quel
est ce costume ? il n’est pas beau. — Tout le monde en dit la même chose,
et tout le monde l’achète. C’est l’habit des vachers de l’Emmenthal. Voyez
cette calotte et ces genouillères de cuir. Le voyageur qui veut trancher
du chasseur de chamois, ne craint pas que le vent enlève son chapeau. Quand
il est embarrassé, il se traîne sur ses genoux, et il conserve sa peau. D’ailleurs,
ce costume n’est pas laid. Examinez-le bien. Gilet
croisé
et culotte couleur de soufre, veste lilas, voilà pour l’agrément. Examinez
cette grande panetière, dont la courroie noire tranche sur le jaune. Le coureur
de glaciers met, là- dedans, ses petites provisions de bouche, et elles y
sont en sûreté. »
André
remarqua que nous pourrions, comme d’autres, être tentés de jouer à nous
casser le cou, et il fit mettre de côté trois costumes de vachers de l’Emmenthal.
Luker y joignit trois gros bâtons, fortement ferrés, instrumens très-utiles
à ceux qui veulent faire la chasse aux ours.
Claire
et Marianne avaient déjà profité des remarques de Simon sur la réserve des
femmes suisses. Elles ne disaient rien ; mais elles examinaient les vêtemens
de paysannes suisses. Elles prendront les plus jolis, sans égard aux cantons
d’où Luker les a empruntés.
Elles
attendirent modestement, pour se prononcer, que nous ayons fait notre
choix. Que deux Parisiennes entrent chez une galantière, elles parleront
modes, pendant deux heures. Elles et la marchande finiront par ne plus s’entendre,
et souvent elles sortiront, sans avoir rien acheté. André prétend qu’elles
sont comme cela depuis le règne de Charlemagne, et qu’elles ne seront pas
changées sous celui de Louis XLII. « Mon ami André, vous êtes un mauvais
plaisant. »
Nous
choisîmes, lui et moi, deux habits du canton de Lucerne. Grand chapeau rond
à forme plate ; cravate noire ; longue veste rouge ; ample habit de drap
gris, descendant jusqu’au-dessous du jarret ; culotte de laine bleue ; bas
blancs ; la jarretière noire, attachée sous le genou ; patte, ou détroussis
de maroquin rouge, couvrant la boucle du soulier. Nous les prîmes
absolument
semblables,
en signe de notre amitié, et de l’égalité parfaite qui était établie entre
nous.
Nous
allions nous occuper de Bertrand. Madame André réclama la préséance, et cela
était juste.
Quand
il est question de toilette, les femmes n’oublient rien. Madame André s’était
pourvue pour la fin de l’été, et pour son hiver.
À mettre
de suite, un grand chapeau de paille jaune, pendant et badinant devant et
derrière ; le tour de la forme garni de fleurs, quand il y en a. Là- dessous,
les cheveux de derrière tombent en longues tresses, jusqu’où ils peuvent
descendre. Une fraise de mousseline remonte jusqu’au menton. La partie inférieure
tombe négligemment sur les rubans du corset, sans manches, et entr’ouvert
par le milieu ; gros lacet de couleur tranchante. Les manches de la chemise,
qui doit toujours être d’une grande blancheur, se terminent par de petites
manchettes serrées autour du poignet. Une jupe, très-courte, de couleur tendre
; un tablier de siamoise rayée, élégamment relevé sur le côté; un bas bien
blanc, à coins rouges ou verts ; un soulier mignon, relevé par des pattes
de maroquin rouge, découpées en festons, tel est le costume des femmes du
canton de Lucerne.
Le choix
de madame André me fit croire qu’elle avait la jambe bien. C’est ce que je
me proposai de vérifier.
Elle
emprunta son costume d’hiver aux femmes des Frey- Aemter. La tête est enveloppée
d’un mouchoir blanc ou de couleur, surmonté d’un petit chapeau de feutre
noir ; cravate de même couleur. Collerette rouge, bordée de vert ; corset
jaune, très-exactement fermé ; par-dessus le corset, petite camisole
grise,
garnie en rubans de couleur ; jupon de laine noire ; tablier de siamoise
; bas de laine rouge.
Marianne
sentait bien qu’elle ne devait pas être mise aussi élégamment que madame
André. Elle se borna, pour l’été et l’hiver, à des habits du canton de Lucerne,
et de celui d’Underwalden. Ils avaient, dans leur simplicité, une sorte d’élégance
: les femmes ne se trompent jamais là-dessus.
Nous
avions été frappés de la variété des objets, étalés chez Luker. Nous nous
étions plu à les examiner en détail. Mais ce qui ne flatte que les yeux,
les femmes exceptées, ne les fixe pas longtemps. Nous dîmes à Bertrand de
prendre ce qui lui conviendrait, pour les jours de travail et les dimanches,
et je termine ici mes descriptions. Si le lecteur trouve que je me sois arrêté
trop tôt, qu’il aille à Copet, et qu’il entre chez Luker, s’il y est encore,
ce qui est plus que douteux.
Madame
Luker, femme qui connaît les bienséances, fit passer Claire et Marianne dans
une arrière-boutique. Nous essayâmes, André, Bertrand et moi, de nous travestir
où nous étions. Notre choix était fait et prononcé ; les prix arrêtés. Nous
pensions n’avoir plus qu’à partir. Nous fûmes arrêtés tous cinq, par une
difficulté, qu’il n’était, cependant, pas difficile de prévoir : rien de
tout cela n’allait bien. Il fallait que chaque pièce passât par les mains
de l’artiste.
Madame
Luker nous protesta que, dans deux heures, tout serait prêt. Je n’en crus
pas un mot ; mais je me gardai bien de la presser : je n’avais pas oublié
mes couturières, et le vin chaud de Limoges. « Hé bien, mon ami André ? —
Hé bien, Monsieur ? — Que ferons-nous jusqu’à ce soir ? — La mine. — La mine,
la mine ! il est à peine dix heures, et je ne
veux
pas bouder jusqu’au coucher du soleil. — Hé bien, rions.
—
Et de quoi ? — Demandez cela à madame Richoux.
Je pensai
à l’âne emporté par l’aile du moulin ; au meunier accroché à la queue de
l’animal, et emporté avec lui. Je crus que j’allais rire ; je me pinçais
le bout des lèvres : il y a des jours où on n’est bon à rien. Nos deux femmes
marchaient, en se dandinant, et en bâillant. Bertrand attendait des ordres,
en regardant ce qui se passait au ciel. André, ne sachant que faire, jetait,
à droite et à gauche, les cailloux qu’il trouvait à ses pieds. L’ennui avait
étendu son voile noir sur tous les membres de la colonie.
« Parbleu,
nous dit Simon, c’est une terrible chose que d’être désœuvré !
« Quand
vous serez à Appenzell, vous ferez comme moi ; vous travaillerez toute la
journée, et si vous comptez les heures, ce sera pour vous assurer que celle
de se mettre à table et de se reposer a réellement sonné. Je n’ai plus de
poisson, et depuis que vous êtes sortis de chez moi, je n’ai pas perdu un
moment. J’ai mis en état ma barque et mes filets, et je vais aller à la pêche.
Voulez-vous venir avec moi ? — Très-volontiers, maître Simon. — Vous me gênerez
un peu ; mais je ne veux pas que vous disiez à Appenzell qu’on s’ennuie à
Copet. »
Claire
voulut rester pour soigner les enfans ; le résultat de la pêche étant fort
incertain, Marianne resta aussi pour nous préparer à dîner ou à souper :
c’est s’occuper. Nous autres hommes, qui n’avions rien à faire au monde,
nous montâmes sur la barque de Simon. Il trouva les moyens de nous faire
travailler tous trois : c’était nous faire prendre un intérêt direct à la
pêche. « Maître André, faites ceci…. Et vous, comment vous
appelez-vous
? — Antoine. — Maître Antoine, faites cela. Vous, grand garçon, prenez les
avirons, et faites marcher le bateau, pendant que je déroulerai mes filets.
Oh, les maladroits !... Un capitaine est roi à son bord, et, si vous ne prenez
garde à vous, le capitaine Simon vous mènera mal. »
Le balancement
du bateau me jetait sur André ; André tombait sur Bertrand ; Bertrand sur
Simon. Nous éclations de rire tous les quatre, et nous ne prenions rien.
« Attendez, attendez, dit Simon. Si nous ne rapportons pas de poisson, au
moins nous aurons du gibier. » En effet, des oiseaux, que nous ne connaissions
pas, voltigeaient au-dessus de nos têtes. Ils étaient de la grosseur d’une
poule, et leur plumage était d’un blanc argenté. « Ce sont des grèbes,
nous dit Simon. On fait de leurs plumes de très belles fourrures. Je les
chasse, quand j’en vois ; et quand j’en ai tué quelques-unes, je vais
à Genève lever des impôts sur les belles dames de la ville. Elles sont
libres, disent-elles, et la coquetterie, la vanité les subjuguent. »
Il alla
prendre un mousquet, serré dans ce qu’il appelait sa tire. C’était
une petite cabane en planches, élevée à la poupe du bateau. Il tira et abattit
deux grèbes. Il se saisit des avirons, et André et moi primes facilement
les deux oiseaux, qui palpitaient encore. « Cela vaut mieux que deux grosses
truites, dit-il, en rechargeant son mousquet. Une demi-heure après, il en
tua deux autres. « La journée est bonne, dit-il encore ; mais cependant je
ne voudrais pas perdre mes filets. Je ne vois plus surnager les morceaux
de liège qui les maintiennent debout. Ils ne doivent pas être allés au fond
de l’eau : il y en a ici plus de vingt brasses. »
On n’apercevait
plus que l’extrémité de la corde qui attachait les filets au bateau.
Simon le maintint en place, avec les
avirons,
et nous tirâmes tous trois sur la corde. La résistance était forte ; cependant
les filets arrivaient petit à petit. Bientôt nous sentîmes des secousses
violentes. « C’est un monstre, s’écria Simon ! Tirez, tirez vite et fort.
»
Nous
amenâmes, en effet, au fond du bateau, un très-gros poisson, dont les bonds
nous effrayèrent tous. « C’est un saumon, c’est un saumon ! Bertrand, assommez-le
avec la crosse de mon mousquet. » Bertrand se baisse, et frappe d’aplomb
sur la tête du monstre. Un coup de queue terrible le prend par le milieu
de l’estomac ; il perd l’équilibre, et tombe dans le lac. André se laisse
aller sur le banc, je pousse un cri, Simon se jette à l’eau.
Il saisit
Bertrand par un bras, et le ramène à bord. Bientôt le fond du bateau s’emplit
de l’eau qui découle de ses habits, et de ceux de Simon. Le saumon mourant
se débat dans son élément ; il nous couvre de boue ; Simon l’achève ; nous
ramenons, sur la tire, le reste des filets.
Nous
respirâmes alors, et nous nous regardâmes. Nous éclatâmes de rire tous quatre
à la fois. Simon rit plus long- temps que les autres, et il avait ses raisons.
À l’aspect de nos habits et de nos figures, presque méconnaissables, se joignait
celui d’un saumon de trente à quarante livres.
Il nous
apprit que ce poisson est très-rare dans le lac, et qu’il est vraisemblable
que ceux qu’on y prend, y remontent par le Rhône. Que cette opinion fût fondée
ou non, le volumineux animal était là, et Simon le contemplait avec un plaisir
inexprimable. « Si les dames de Genève, nous dit-il, aiment la parure, ces
Messieurs sont amateurs des bons morceaux. Demain j’irai à la ville…
à moins, mes amis, que vous ne
vouliez
prendre votre part d’une pêche, dont le succès vous est dû. » Je lui jurai
que le saumon, tout entier, figurerait sur le marché de Genève. Cette assurance
le fit rire encore.
Il dirigea
le bateau vers la berge, et dès qu’il put se faire entendre, il appela sa
femme de toute la force de ses poumons.
« Quatre
grèbes et un saumon ! — Quatre grèbes et un saumon, répéta sa femme, du
ton de l’enthousiasme et de l’admiration » »
Nous
rentrâmes chez Simon, tenant chacun notre pièce de gibier à la main. Le capitaine
de haut-bord portait de plus son saumon sur l’épaule, et il marchait avec
la légèreté d’un chevreau. Claire et Marianne rirent à leur tour, en nous
voyant, et la gaîté devint générale. Fort heureusement, nous avions repris,
pour nous embarquer, les habits avec lesquels nous étions entrés à Dôle.
Cette précaution nous avait été dictée par la prévoyance de Simon.
Nous
étions mouillés jusqu’aux os, et il fallut aller changer de tout. Le fourgon
était notre chambre à coucher, notre cabinet de toilette, et quelquefois
notre salon. « Hé bien, Monsieur, me dit André, avez-vous eu une journée
semblable auprès du maréchal de Biron, du duc de Guise et de Henri III ?
les soucis entraient, avec vous, sous des lambris dorés. Vous avez joui ici
de la plénitude de votre existence. L’homme réfléchi revient tôt ou tard
à la nature, et il s’en trouve bien. » André avait encore raison.
La conversation
est inépuisable, quand elle porte sur un sujet heureux ou intéressant. Les
détails de la journée se reproduisirent, sans relâche, pendant le souper.
Nous avions tous quelque chose à rappeler, et souvent nous parlions tous
ensemble.
De temps en temps, le dialogue était coupé par un rire inextinguible. Nos
mariniers seuls gardaient un sérieux imperturbable. Je les devinai.
« Nous vous avons fait perdre une journée, leur dis-je, et nous vous la paierons.
» Ils prirent alors une part directe à la conversation, et ils rirent comme
les autres.
Nous
nous amusions si naturellement, avec une bonhomie si vraie, que nous ne pensions
plus à maître Luker, ni à ses costumes. André, le plus prévoyant de nous
tous, nous rappela que nous devions partir le lendemain de bonne heure, et
que, pour cela, il fallait nous aller ensuisser, avant de nous coucher.
Simon prétendit que nous lui avions porté bonheur, et il fit tous ses efforts
pour nous engager à rester encore. André se leva, et nous le suivîmes.
Il paraît
que les femmes suisses, et surtout les hommes, ne perdent pas de temps à
leur toilette : en moins d’une demi-heure nous fûmes tous travestis.
André
et moi ressemblions à des cultivateurs-propriétaires, et Bertrand à un maître-garçon
de ferme. Claire et Marianne… oh, ma foi, elles étaient charmantes sous leur
nouveau costume. Je ne m’étais pas trompé : madame André avait la jambe très-bien
faite. Je m’aperçus, pour la première fois, que la figure de Marianne avait
quelque chose d’agréable et même de piquant. Ah ! vingt ans, et un costume
avantageux…. !
Avant
de payer Luker, je lui demandai s’il voulait nous acheter notre attirail
de seigneurs. « Ce serait avec plaisir, me répondit-il, si j’avais le projet
d’aller m’établir à Venise. Je louerais cela à des moines et à des courtisanes,
pendant le carnaval. En Suisse tout cela n’est bon à rien. — Bah, dis-je
à André, il sait qu’il y a un carnaval à Venise, et nos
paysans
français ne se doutent pas de l’existence de cette ville.
— Je
vous l’ai dit, les magistrats des pays libres ne redoutent pas les lumières.
Les gouvernemens oppresseurs cherchent à les éteindre. Elles perceront malgré
eux. »
Nous
payâmes, et le lendemain, au point du jour, nous nous disposâmes à remonter
sur notre grande barque. Simon nous serra la main avec affection, en recevant
notre argent.
« Il
vous est égal, nous dit-il, en prenant congé de nous, de prendre une route
ou une autre. Faites-vous descendre à Saint- Gingolph ; entrez dans le Valais
; poussez jusqu’à Sion, et allez voir les cretins. Vous êtes savans,
vous expliquerez peut-être ce qui, jusqu’à présent, a paru inexplicable.
»
Nous
allions lui demander ce que c’est que des cretins. La barque avait
déjà pris le large.
La journée
était superbe. Bientôt le lac s’élargit à chaque instant, et nous découvrîmes
des objets qui nous frappèrent d’étonnement, d’admiration, et dont le souvenir
ne s’effacera jamais de notre mémoire. Nous vîmes ce dominateur des Alpes,
ce fameux Mont-blanc, dont la cime se perd dans les cieux, et dont les bases
descendent, peut-être, jusques dans les entrailles de la terre. Nos mariniers,
accoutumés à faire ce voyage, et à entendre raisonner quelques voyageurs,
nous dirent que c’est sur ces montagnes que s’accumulent, que se condensent,
que se divisent les nuages pour retomber en neiges ; que ces monts, sourcilleux
et menaçans, sont les sources intarissables des fleuves et des lacs dont
la Suisse est couverte. À certaines époques de l’année, ces neiges se fondent,
et forment des mers de glace dans des précipices d’une éternelle stérilité.
Ces glaces se brisent à leur tour avec un bruit épouvantable, entraînées
par
leur
propre poids. Une chaleur douce les dissout insensiblement, et leurs eaux
vont porter, dans les vallons, la fécondité et la vie.
« Ah,
m’écriai-je, les hommes qui habitent ces climats doivent être libres. Qui
pourrait les forcer dans ces rochers inaccessibles ? » Le systématique André
vit dans les Alpes des preuves des opinions qu’il avait émises sur la formation
des montagnes. « Nous avons remarqué, me dit-il, que les pierres ne se forment
pas à la surface de la terre. Elles naissent dans son sein, et elles y sont
toutes rangées en couches horizontales. Regardez ces masses de rochers que
l’œil ne peut mesurer ; elles ont toutes été lancées dans l’espace, par une
de ces déplorables révolutions, qui ont bouleversé le globe. Elles sont retombées
au hasard, et se sont entassées, sans ordre, les unes sur les autres. — Ami
André, celte opinion-là n’est pas très- orthodoxe, je te l’ai déjà dit. —
Parbleu, Monsieur, je vais la justifier. Les théologiens les plus exercés
ne nient pas l’existence d’un noyau de feu au centre de la terre. Ce feu
est aussi ancien que la création, et les événemens, qui en sont résultés,
sont la conséquence nécessaire de l’impulsion primitive, donnée par l’auteur
du grand-œuvre. — Oh, rien ne t’embarrasse, toi. Je te le répète : tu aurais
joué un grand rôle au colloque de Poissy, quel que fût le parti que tu eusses
adopté.
« Laissons
l’origine des montagnes, et parlons de choses qui sont à notre portée Les
Suisses sont libres, voilà une vérité incontestable. Mais comment le sont-ils
devenus ? sais-tu cela?
— Je
vous ai dit que j’ai lu et que j’ai de la mémoire. Pendant que vous regarderez
les Alpes, et que vous vous appuierez de raisons, bonnes ou mauvaises, pour
vous persuader qu’elles sont la depuis la formation du monde, je vais rappeler
et classer
mes
idées sur l’émancipation de la Suisse. Je voulais être homme de
lettres-arrangeur à Paris. Je vais me faire historien sur le lac de Genève.
Je ne vous donnerai ni du Tite- Live, ni du Tacite. Mais vous êtes mon ami,
et le cœur n’est pas difficile sur les productions de l’esprit. »
André
va prendre dans le fourgon ce qui lui est nécessaire pour écrire ; il se
fait un pupitre des genoux de Claire. La jolie suissesse Marianne prend les
enfans sur les siens, et les fait sauter en leur chantant le petit couplet…..
Ces pauvres petits ! ils se regardent ; ils se sourient ! Je les embrassai
tous les deux, et j’allai déraisonner, avec les mariniers, sur le Mont-Blanc,
le Tucul, et le Dôme du goûte.
L’historien
de la Suisse quitta la plume pour déjeûner avec nous. « Tite-Live et Tacite
avaient probablement bon appétit, nous dit-il, et je leur ressemble, au moins
de ce côté-là. »
Après
le dîner, il s’arma du redoutable cahier, et nous nous rangeâmes tous autour
de lui, tous jusqu’à Bertrand, qui n’était pas fâché, nous dit-il, de connaître
les gens avec qui il allait vivre. Notre Tacite tousse, crache, se mouche
; il promène, sur son auditoire, un œil qui lui sourit de manière à captiver
sa bienveillance, et il commence.
Les
Helvétiens, du temps de Jules César, étaient d’une haute stature, et d’une
force de corps extraordinaire. Leur parole était inviolable. Ils ne connaissaient
ni le commerce, ni l’agriculture. Ils sortaient armés de leurs montagnes,
pour se procurer les choses nécessaires à la vie, et ils regardaient le pillage
comme un droit que la nature a donné au pauvre sur le riche.
Lorsque
l’empire romain tomba, ils furent conquis par les rois Burgondiens. Ils devinrent
sujets de la France, de l’an 340 à 888. Ils retombèrent encore sous le joug
des rois de Bourgogne, et leurs montagnes stériles furent enfin réunies à
l’empire d’Allemagne.
Semblables
à ces coursiers qui rongent leur mors, et le couvrent d’écume, les Helvétiens
supportaient leur joug avec impatience. « André, la comparaison est brillante.
— Brillante ou non, laissez-moi lire. — Ne te fâche pas, mon ami. — Où en
étais-je ?... M’y voilà. »
Les
Helvétiens portaient leur joug avec impatience. L’empereur Albert, homme
absolu et cruel renvoya, à Schwitz, Un et Underwald, trois baillis, qui se
conduisirent en tyrans. Ils enlevaient les femmes des habitans. Leurs mœurs
étaient pures, et cette conduite les indigna. Aujourd’hui encore personne
n’aime qu’on lui enlève sa femme. « André, la plaisanterie ne s’accorde pas
avec la gravité de l’histoire. — Monsieur, il est très-impoli d’interrompre
un auteur à chaque mot. — Je me tais. »
Les
maris outragés se plaignirent hautement, et les baillis les firent jeter
dans des cachots. Ils confisquèrent, à leur profit, le peu que possédaient
ces malheureux, et ils levèrent des impôts sur tous. Henri Melchtal, Verner
Stauffacher, et Walter Furts furent les premiers conjurés, et ils appelèrent
leurs concitoyens à la liberté. Chacun d’eux en gagna trois. Ces douze hommes
enlevèrent l’Helvétie à l’Autriche.
Le canton
de Schwitz fut le premier qui s’insurgea, et, plus tard, les habitans des
treize cantons s’honorèrent de prendre son nom, que nous prononçons Suisse,
parce que nous avons la
manie
de franciser tous les noms propres. « La remarque est judicieuse. — Paix
donc. »
Il n’est
pas de peuple qui ne s’attribue une origine extraordinaire, et par conséquent
fabuleuse. Les Suisses ont fait de Guillaume Tell le héros de leur liberté.
Leurs descendans ont adopté cette opinion, et elle est devenue celle de toute
l’Europe. Il est constant, d’après ce que j’ai dit plus haut, que Tell ne
put être que le treizième conjuré. Voici ce qu’on raconte.
Le bailli
Grizler gouvernait le canton d’Uri. Il avait fait planter sur la place d’Altorf,
principal bourg du canton, une longue perche, au haut de laquelle était attaché
un de ses bonnets. Les habitans reçurent l’ordre de se découvrir, et de fléchir
le genou devant ce bonnet, quand ils passeraient sur cette place. Il est
difficile de croire à cet excès de délire. La chose n’est pourtant pas impossible.
Guillaume Tell affecta de passer devant ce bonnet, sans le saluer. Il fut
arrêté, et conduit devant le bailli qui lui demanda pourquoi il lui manquait
de respect. Tell lui répondit, avec fierté, qu’il était né libre, et qu’un
homme libre ne s’abaisse pas devant les tyrans. On n’a pas réfléchi à l’absurdité
de cette réponse. Tell était né sujet de l’Autriche, et les cantons de Schwitz,
d’Uri et d’Underwald, qui s’insurgèrent les premiers, ne l’étaient pas encore,
puisque Grizler n’était pas chassé d’Altorf. Donc Tell n’était pas un homme
libre.
Le bailli
furieux, ordonna à Tell, qui passait pour un archer très-adroit, d’abattre,
avec une flèche, une pomme qu’il fit placer sur la tête de son fils. La flèche
part, et la pomme est enlevée. Tell en avait une seconde cachée sous son
habit. Grizler lui demanda ce qu’il en voulait faire. « Je te la destinais,
monstre,
si j’avais eu le malheur de tuer mon fils. » Puisqu’il était décidé à percer
le tyran, devant ses satellites, s’il eût ôté la vie à son fils, que ne le
tua-t-il d’abord ? C’était un moyen sur de garantir les jours de son enfant.
Le tyran,
écumant de rage, fait porter Tell, lié et garrotté, dans son bateau. Il voulait
le conduire à son château, pour lui faire subir un supplice long et cruel.
Mais on ne nous dit pas où était ce bateau. Etait-il sur la rivière de Reuss,
qui sort du lac de Lucerne, et qui passe en effet près d’Altorf ? Il ne s’élève
pas de tempêtes sur une rivière, et bientôt le bateau courut le plus grand
danger. Il était donc sur le lac, et il faut convenir que la scène de la
pomme fut placée un peu loin de la perche et du bonnet.
Une
tempête terrible s’éleva. Les matelots, frappés de terreur, abandonnent les
rames. Le bateau, en proie à la violence des vents, va se briser contre les
rochers. Mais Tell réunit tous les talens. Il est aussi bon pilote qu’adroit
archer. Grizler lui fait ôter ses liens ; il prend le gouvernail, et manœuvre
avec tant d’habileté, qu’il aborde sous un rocher, sur lequel il s’élance,
et, d’un vigoureux coup de pied, il repousse le bateau au milieu des flots.
Ces
matelots, que la crainte avait glacés, se rassurent, quoique le péril ne
soit pas diminué. Ils travaillent, ils manœuvrent et abordent. Tell ne les
a pas perdus de vue. Au moment où Grizler débarque, il lui décoche une
flèche qui le frappe au cœur. Je demande, puisque l’histoire ne le dit pas,
où Tell avait trouvé un arc et des flèches, au moment où on venait de le
dégager de ses chaînes. Je demande comment les satellites de Grizler ne vengèrent
pas leur maître en perçant Tell à l’instant. Il fallait, dans l’intérêt
de la fable, qu’il survécût à ces
incroyables
événemens. Cette fable est devenue un article de foi en Suisse. Ce qu’il
y a de fâcheux, c’est que les Danois ont aussi leur histoire de la pomme,
et que Peterman Eterlin, le premier qui ait parlé de Guillaume Tell, n’a
écrit que deux cents ans après l’époque où il a placé la mort du héros. C’est
ainsi qu’on a imaginé Hercule, Thésée, Philoctète.
Ce qui
est d’une incontestable vérité, c’est que le pape Jean XII, qui protégeait
alors la maison d’Autriche, lança, contre les Suisses, les foudres du Vatican.
Les Suisses les bravèrent, et se mirent en état de défense.
Léopold
marcha contre eux, avec toutes ses forces. Il crut qu’il allait accabler
trois cantons, qui ne purent lui opposer que treize mille hommes. Les Impériaux
s’engagèrent dans le défilé de Morgenten. Treize cents Suisses étaient postés
sur la cime des montagnes. Ils roulèrent, sur leurs ennemis, d’énormes quartiers
de pierre, qui bondissaient de rochers en rochers, avec un bruit épouvantable.
Des compagnies entières furent écrasées. Les Impériaux fuirent en désordre.
La véritable armée suisse, embusquée sur différens points, fit un carnage
affreux des fuyards. La victoire ne coûta aux Suisses que quatorze hommes.
Cette affaire, de la plus haute importance, eut lieu en 1315.
En 1394,
les cantons de Zug, de Lucerne et de Glaris s’unirent aux trois premiers,
qui avaient proclamé la liberté de l’Helvétie. C’était se prononcer tard
; mais ces nouveaux alliés se montrèrent dignes de défendre la cause qu’ils
embrassaient.
Cette
république naissante n’était connue encore que par sa pauvreté, ses mœurs
simples, et sa valeur. Les souverains les plus puissans l’attaquèrent successivement,
et toujours sans succès. Les hommes ne pourront-ils jamais vivre et
mourir
libres,
même sur des rochers stériles, sans armer contre eux le despotisme, et les
passions haineuses, qui l’accompagnent toujours ?
En 1453,
Charles VII, roi de France, fit marcher le dauphin Louis contre les Suisses,
à la tête de cinquante mille hommes. Douze cents hommes, détachés de l’armée
des confédérés, eurent l’audace d’attaquer l’avant-garde française, forte
de huit mille hommes, et la battirent complètement. Les débris de cette avant-garde
se replièrent sur Mutterz, où ils se rallièrent à dix mille Armagnacs. Les
Suisses combattirent cette nouvelle armée, et la défirent. On a calculé que
dans cette affaire chaque Suisse avait eu dix-huit ennemis à combattre.
Exaltés
par ces premiers succès, ils marchèrent, malgré leurs officiers, contre le
gros de l’armée française. Ils attaquèrent, avec fureur, un pont défendu
par huit mille hommes. Forcés de céder à des troupes retranchées, ils se
jetèrent dans la rivière, et gagnèrent une petite île à la nage. Les Français
les y suivirent, et, après la plus opiniâtre résistance, ils furent contraints
de sortir de l’île.
Il n’était
plus en leur pouvoir de vaincre. Réduits au nombre de cinq cents, ils résolurent
de vendre chèrement leur vie. Ils percèrent l’armée française, et se retiraient
du côté de Bâle. Ils tombèrent dans une embuscade de huit mille ennemis,
et leur courage ne se ralentit pas. Ils se jetèrent dans un hôpital, et,
à la faveur des murailles qui les couvraient, ils résistèrent aux efforts
de toute l’armée réunie. Le feu prit à la maison. Forcés d’en sortir, ils
se précipitèrent dans les rangs ennemis ; ils versèrent le sang à flots,
et après un combat qui dura dix heures, ils moururent tous les armes à la
main, à l’exception de douze, qui s’échappèrent. Ils furent chassés de leur
pays, pour avoir
préféré
une vie honteuse à une mort honorable. Ils combattirent avec un tel acharnement,
que les blessés arrachaient de leurs corps les flèches qui les avaient percés,
et ils les renvoyaient à l’ennemi. Un général français parcourut ce petit
espace, théâtre de la plus héroïque valeur. Il s’écria que le sang des Suisses
était plus délicieux pour lui qu’un bain de roses. Un Suisse expirant fait
un dernier effort. Il se relève, saisit une pierre, et la lance, avec tant
de force et d’adresse, qu’il renverse mort ce général féroce.
Charles
VII sentit que de pareils hommes ne se soumettent pas. Il s’allia avec eux,
par un traité, qui fut signé au mois de novembre de la même année.
En 1476,
Fribourg, Soleure, Schaffousen, Bâle et Appenzell n’étaient pas encore réunis
à la Confédération helvétique, et toutes les forces de Charles-le-Téméraire,
duc de Bourgogne, échouèrent devant celles de huit cantons.
Ce prince
joignait, au duché de Bourgogne, l’Artois, la Flandre, la Hollande, la Franche-Comté
et la Lorraine, qu’il venait de conquérir, Il voulait ériger ses États en
royaume. Une partie de ces possessions touche à la Suisse, et il résolut
de la soumettre.
Il y
entra, sans déclaration de guerre, et sans autre motif que de satisfaire
une déplorable ambition. Il se présenta devant Granson, ville située près
du lac de Neuchâtel. Elle n’était défendue que par cinq cents hommes. Ils
se battirent courageusement ; mais ils furent bientôt contraints de se rendre
à discrétion. Le duc abusa indignement de son avantage. Il en fit pendre
quatre cents, et jeter les autres dans le lac.

Costumes
du canton de Schwitz, par Achile Dévéria, vers 1830
À
cette nouvelle, les Suisses descendent de leurs montagnes. Ils brûlent de
venger leurs compatriotes. Les despotes n’ont pas d’idée de ce que peut l’amour
de la liberté. Charles crut n’avoir affaire qu’à une multitude, sans ordre
et sans plans, qui se disperserait devant lui. Il s’éloigna de la plaine
de Granson, où sa cavalerie pouvait se déployer avec avantage, et les Suisses
n’en avaient pas. Il s’engagea dans des gorges voisines.
Ces
pâtres, qu’il dédaignait, se hâtèrent de remonter sur leurs montagnes. Ils
écrasèrent une partie des Bourguignons, sous des troncs d’arbres et des quartiers
de rochers. Ils descendirent, alors, se formèrent en colonnes serrées et
pénétrèrent, de toutes parts, dans les débris de l’armée bourguignone. Ils
n’eurent que la peine de tuer. Le duc fut obligé de fuir, heureux de parvenir
à trouver un asile.
Son
artillerie, ses bagages, sa vaisselle, un diamant estimé un million huit
cent mille livres, tombèrent au pouvoir des vainqueurs. L’ignorance des Suisses
était telle, que celui, qui trouva ce diamant, le vendit un florin à un
homme, qui le revendit trois livres. Ils déchirèrent des tentes, brillantes
d’or et d’argent, pour s’en faire des habits, et ils prirent l’argenterie
du duc pour de l’étain.
Charles
voulut effacer l’impression défavorable qu’avait produite sa défaite. Il
rentra en Suisse, dans la même année, altéré de vengeance et de sang. Il
assiégea Morat, chef-lieu d’un bailliage, situé entre un petit lac du même
nom, et la rivière de Saane, dans le canton de Fribourg. Morat n’avait que
huit cents hommes de garnison. Ils soutinrent trois assauts, que leur donna
le duc. Inquiet, irrésolu, il se fut peut-être déterminé à une
retraite
humiliante, lorsqu’il apprit que l’armée confédérée des Suisses s’approchait
à marches forcées.
La position
de ces braves gens n’était plus la même : l’ambition du duc leur avait donné
des alliés. Les villes du Rhin leur avaient envoyé quatre mille hommes de
cavalerie. Ils pouvaient alors combattre en plaine, et l’armée combinée était
de trente mille hommes.
Le duc
n’en avait que vingt-cinq mille. Certain d’anéantir en plaine les ennemis
qu’il s’était faits, il s’avança, contre eux, sans daigner s’informer du
nombre, et du genre de troupes qu’il allait combattre.
Les
Suisses se battirent pour leur liberté, et ils avaient la supériorité du
nombre. La victoire ne pouvait être douteuse ; mais elle leur coûta cher.
Dix-huit mille Bourguignons restèrent sur le champ de bataille. Leurs ossemens
furent rangés dans une église, située près de Morat. Les Suisses montrent,
avec orgueil, aux voyageurs, ce trophée de leur gloire.
C’est
par ces combats de géants, qu’ils établirent leur liberté, sur des bases,
qui paraissent inébranlables. Puissent-ils la conserver long-temps !
Entraînés
par ces grands exemples, les cantons qui étaient depuis longtemps indécis,
irrésolus, se réunirent aux huit autres. Ils complétèrent la république fédérative,
qui se compose, aujourd’hui, de treize cantons.
« Mon
ami André, tu m’as rendu fier d’être Suisse. Il faudra nous faire naturaliser
à Appenzell. — Mais à condition que je ne me battrai pas.
«
— Mais il me semble que tu as singulièrement généralisé les faits, et cependant
tu as écrit pendant six heures au moins. — Hé, croyez-vous, Monsieur, qu’on
fasse l’histoire comme des homélies ? N’a-t-il pas fallu que je compulsasse
ma bibliothèque ? — Ta bibliothèque ! Et où est-elle ? — Dans ma tête, Monsieur.
N’a-t-il pas été nécessaire de me rappeler les noms d’hommes et de lieux
; de classer les faits, d’établir les dates ? On prétend que les historiens
ne sont que des compilateurs. On jouit de leurs ouvrages, et on ne pense
pas au travail qu’ils leur ont coûté. Au reste, je viens de me parer d’un
talent de plus. Récapitulons un peu ceux que je possède à présent.
— Ne récapitulons rien. Ne vois-tu pas que nous voilà arrivés à Saint-Gingolph
? À terre, à terre. »
Nous
sautâmes sur la berge, et nos voitures nous suivirent de près. « À propos
d’histoire, dit André, il est très beau sans doute d’être Suisse ; mais pour
vivre libre, il faut manger, et nos provisions sont épuisées, ou bien peu
s’en faut. — Pourquoi n’as-tu pas parlé de cela dans la journée ? nous aurions
relâché dans quelque bourg. — Oh, ma foi, j’étais dans le feu de la composition.
— Et à Capet ? — Les costumes, la partie de pêche….. si je n’oubliais rien,
je serais un homme accompli. Et puis les Suisses qui battirent Charles VII
; ceux de Granson et de Morat mangeaient du pain noir, des légumes et du
fromage, et c’est ce qui les rendait invincibles. Nous vivrons comme eux.
»
Cependant
Saint-Gingolph n’était pas tout-à-fait sans ressources, et nos mariniers
nous conseillèrent d’enlever tout ce que nous trouverions. Ils nous assurèrent
que, de là à Sion, nous serions tout-à-fait au régime des paysans suisses.
Nous
battîmes tout le village comme des chasseurs traquent une forêt. Nous apportions,
religieusement à la masse, ce que nous avions découvert. Claire tenait une
vieille poule ; Marianne un quartier de lard ; je roulais devant moi un petit
baril garni de truites marinées ; Bertrand portait sur une épaule une feuillette
de vin, le moins aigre du lieu, et sur l’autre, la moitié d’une jeune chèvre.
André arriva le dernier ; mais il avait fait la découverte la plus importante.
Il poussait, sur une brouette, un gros sac de pure farine d’avoine, un pot
de beurre, et une certaine provision de sel.
Quand
les succès sont à peu près égaux, entre rivaux d’industrie, l’envie dort,
parce qu’elle n’a rien de mieux à faire. Nous nous félicitâmes, nous nous
primes la main ; nous nous embrassâmes, et je trouvai que Marianne avait
la peau aussi douce que fraîche.
André
nous apprit que le paysan, qui lui avait vendu sa farine, nous prêterait
son four, « et, Mesdames, il est temps de mettre la main à la pâte : nous
n’avons plus de pain que pour souper. Nous mangerons celui-là, ce soir, gaîment
; nous dormirons dessus, et nous tâcherons de rêver que nous avons toujours
vécu de pain d’avoine. »
André
était à tout, et partout. Il donna une tournure plaisante au régime que la
nécessité nous imposait. Claire et Marianne s’étaient mises en petit corset,
par égard pour leurs costumes suisses, et elles paraissaient ne pas craindre
que l’œil furtif des spectateurs fut obligé de se détourner. Je me permettais
quelques quolibets ; ces dames avaient l’air de ne rien entendre. Elles paraissaient
tout à leur pétrin. André tenait les deux enfans sur ses bras, et ne prenait
garde ni aux corsets, ni à autre chose. Bertrand dépeçait la chèvre, et la
salait, fort proprement,
dans
une grande terrine de terre. Moi, j’étais redevenu la Mouche. Je ne me lassais
pas d’observer, quoique mes observations ne dussent influer en rien sur le
gouvernement de la Suisse.
Ces
dames se relevèrent enfin, et je perdis tous mes avantages. Bertrand s’arma
de la longue pelle de bois, et poussa, dans le four, le pain qui devait nous
écorcher le gosier le lendemain. Pendant qu’il cuisait, nous allâmes souper.
Le pain fut défourné, au moment convenable, et nous nous logeâmes tous dans
notre fourgon, à nos places ordinaires, et très- modestement. Nous passâmes
encore cette nuit sur la berge, livrés à la loyauté valaisanne, et elle justifia
notre confiance.

Lithographie
d’Édouard Pingret, 1825

Crétin
des Alpes (gravure allemande)
CHAPITRE
XXIX.
Les
Cretins. Le coup de tonnerre.
Nous
partîmes, à la pointe du jour, de Saint-Gingolph, que nous n’avions aucune
raison de regretter. Nous nous engageâmes, André et moi, dans des discussions
historiques, philosophiques, économiques, qui ne mènent pas à grand’chose,
mais qui usent le temps. Il semble, en vérité, que l’existence fatigue l’homme,
et qu’il cherche à s’étourdir sur la vie, par tous les moyens que lui suggère
son imagination. Ces réflexions nous conduisirent à une conséquence toute
simple : c’est que l’homme qui travaille ne trouve pas le temps long, et
qu’il goûte les douceurs de la vie commune, qui est sans attraits pour l’homme
riche et désœuvré : la satiété est l’ennemie la plus cruelle du plaisir.
Nous nous promîmes bien de le chercher, tous les jours, au bout de nos bras,
quand nous serions à Appenzell.
Ce genre
de conversation était fatigant pour deux femmes sans instruction, et qui
avaient leurs petites idées à elles. Claire et Marianne jasaient, pendant
que nous dissertions, et comme on ne peut toujours parler, nous finîmes par
les écouter. Rien n’avait émoussé, en elles, cette finesse de sensation,
ce tact sûr, que la plupart des femmes reçoivent de la nature. Leur conversation
était sans art, sans ordre, et même sans suite ; mais de l’esprit naturel,
et des saillies, sans prétention, la rendaient
fort
agréable. J’ai eu depuis des occasions de voir des femmes savantes. Elles
avaient toutes perdu en agrémens ce qu’elles croyaient avoir gagné par l’instruction.
Nous
étions sur la route d’Aigle, qui conduit à Frenière, à Vetroz et à Sion.
Déjà nous commencions à prévoir des difficultés, peut-être insurmontables,
quand nos grandes et lourdes voitures seraient engagées dans les montagnes.
« Bah, bah, dit André, nous ne sommes pas les premiers qui voyagions en Suisse.
Nous profiterons de l’expérience de nos prédécesseurs. Quand nos voitures
ne pourront plus avancer, nous les laisserons là. Nous avons six bons mulets
; nous les chargerons de nos provisions, et de nos lits ; la fortune fera
le reste. De quelque manière qu’elle nous traite, nous n’aurons pas à redouter
de grands seigneurs, leurs grands vassaux, des ligueurs, des huguenots,
des dévastations, des incendies. Quand nous aurons ensemencé un champ, personne
ne nous disputera notre récolte. Vive la liberté, et le canton d’Appenzell.
« Le
soleil est déjà haut. Il faut déjeuner. Ce gazon nous servira de nappe.
À terre, à terre. » En un instant, nous fûmes tous arrangés. Nous avions
formé un cercle, au milieu duquel figurait un pain d’avoine, que nous désirions,
et que nous redoutions de goûter. « Il n’est pas bon, dis-je, en faisant
la grimace. Non, répondit André, mais je le préfère à de beau pain blanc,
qu’il faut disputer à coups de mousquet. »
Les
truites étaient épicées en diable ; je sablai un verre du petit vin de Saint
Gingolph, pour les faire passer. La liberté, à laquelle nous trinquâmes,
ne me le fit pas trouver moins aigre.
« Vous
avez pris, assez facilement, l’habitude de vous exposer à vous faire tuer.
Il me semble qu’il est plus facile encore de
s’accoutumer
à boire de mauvais vin. — Tu as raison, André ; vive la liberté, et la piquette.
»
Nous
vécûmes, nous couchâmes à Aigle, à Frenière, et à Vetroz, comme à Saint-Gingolph,
et à Copet. Mais les chemins devenaient difficiles. Plusieurs fois, nous
avions été obligés de descendre tous, pour soulager nos mulets. De temps
en temps, les trois hommes poussaient à la roue, pour tirer une voiture d’un
trou, ou pour la hisser sur un lit de pierre, qui traversait le chemin. André
faisait tout, en riant, dans les grandes occasions. C’est un moyen certain
d’encourager les autres. Claire et Marianne tournaient autour de nous, ne
faisaient rien, parce qu’elles ne pouvaient rien faire, nous conseillaient,
et haletaient à l’unisson avec nous.
Le poète-arrangeur
arrangea, sur ces dames, un apologue qui avait bien son mérite. Il les comparait
à une mouche, qui va et vient, en bourdonnant aux oreilles d’un cheval embourbé,
que le fouet du charretier tire d’affaire. Le bourdon ne manqua pas de s’attribuer
l’honneur du succès. Il perdit son apologue entre Vetroz et Sion. Un autre
le refera, dit-il, et il n’y pensa plus.
Nous
serions arrivés à Sion dans l’état le plus délabré et le plus comique, si,
dès le premier pas difficile, nous n’avions eu la précaution de quitter nos
habits de Suisses opulens, pour prendre nos costumes de vachers de l’Hemmentbal.
Nos culottes et nos genouillères de cuir nous furent très-utiles, quand nous
poussions des genoux et de la tête. Nous rendîmes grâce à la prévoyance de
maître Luker. Mais dès que nous aperçûmes le clocher de Sion, nous fîmes
halte, et nous nous donnâmes une tournure. L’amour-propre ne perd jamais
ses droits.
Sion
est située près du Rhône, sur une hauteur, d’où la vue est variée et agréable.
Tous les habitans sont prêtres ou soldats. La cathédrale est belle, et les
maisons des chanoines se font particulièrement remarquer. Les bourgeois se
rassemblent tous les dimanches, pour s’exercer au tir, sous la direction
d’un capitaine, qui nous parut être le meilleur homme du monde.
Les femmes
sont, en général, grandes, bien faites, blondes et jolies. Elles ont de la
grâce sans affectation. Elles regardèrent beaucoup nos petites suissesses,
dont la mise élégante effaçait la leur. Les hommes considéraient attentivement
nos voitures. Nous crûmes d’abord que notre luxe les blessait. Un d’eux nous
dit qu’il ne concevait pas comment nous oserions nous engager dans les montagnes,
avec des équipages de telles dimensions. Cet homme nous indiqua un
très-bon cabaret, où nous trouverions tout, dit-il, excepté des lits,
et c’était l’essentiel : depuis Montereau, nous ne nous étions pas
déshabillés, et André commençait à se fatiguer de n’être qu’un mari honoraire.
Maître
Cormier nous reçut fort bien, et nous donna deux chambres et un cabinet,
placés directement sous le toit de la maison. Le bas était réservé aux buveurs.
Cormier nous laissa la liberté de nous arranger, comme nous l’entendrions,
et on pense bien qu’André s’empara du cabinet.
Bertrand
monta les matelas, et pour la première fois, depuis Montereau, des draps
furent tirés de la caisse où ils étaient renfermés. Quand notre hôte eut
reconnu nos dispositions, il monta quelques futailles vides dont il entoura
le coin que Marianne s’était réservé : c’était un homme très-pudique que
maître Cormier. J’aurais autant aimé qu’il n’eût pas porté la prévoyance
aussi loin. J’abandonnai la chambre toute entière à la petite Marianne, et
je me logeai dans l’autre avec Bertrand.
Nous
avions tous besoin de repos. Marianne se déchargea de ses fonctions journalières
sur maître Cormier. Il nous donna un assez bon souper, du vin très-passable,
auxquels nous fîmes honneur, et chacun alla chercher son lit. J’eus une excellente
nuit, qui fut cependant troublée deux ou trois fois, par les cris d’Antoine
et d’Antoinette. Peut-être André les réveillait-il. Heureux coquin !
Je me
souvins, en m’éveillant, que, depuis long-temps, je n’avais pas prié. On
cherche toujours à pallier ses torts. J’attribuai les miens à l’hypocrisie
des chefs de parti qui désolaient la France, aux prédications incendiaires
d’hommes qui leur étaient dévoués, et qui tous déshonoraient la religion.
Je pensai comme André, que le fanatisme et la bigoterie ne peuvent plaire
à Dieu. Je le priai, et je me rappelai un mot de Poussanville : Quand on
peut parler au maître, on n’a pas besoin des valets. Je résolus de suivre
ma religion dans toute sa pureté, et de vivre en paix avec mes compatriotes
suisses, quelle que fût leur croyance.
Maître
Luker vendait des costumes, et maître Cormier des voitures, à l’usage du
pays. Ce sont de petits chariots couverts, que deux hommes peuvent transporter
à bras, quand ils sont déchargés. Nous sentîmes, de suite, les avantages
du troc que Cormier nous proposait. Il nous demanda beaucoup de quatre de
ses chariots, et il nous offrit peu de nos deux voitures. Il ne pourrait
les vendre, nous dit-il, qu’à quelques seigneurs de la Souabe, qui traverseraient
la Suisse, pour aller manger des truites du lac de Genève. Il ajouta que
ces occasions-là sont rares, et il pouvait avoir raison. Il est constant
que nous ne pouvions mener plus loin le fourgon et la coche, et il faut que
chacun vive de son métier.
Après
le déjeuner, nous parlâmes des Crétins. Cormier entendait fort bien son commerce
; mais il n’était pas aussi instruit que Simon. Tout ce qu’il put nous dire
des Cretins fut que c’étaient des êtres extraordinaires, dont l’aspect nous
ferait mal, et que pour en voir un certain nombre, il fallait aller au village
de Villeneuve. Ces dames voulurent nous accompagner : tout ce qui sort de
la nature connue pique leur curiosité. Nous prîmes un guide, et nous nous
mîmes en route.
Les
femmes et les hommes de Villeneuve étaient à leurs travaux, lorsque nous
y entrâmes. Nous trouvâmes les maisons ouvertes, et, au dehors et en dedans,
étaient des animaux immobiles, dont nous n’avions aucune idée. Ils ont beaucoup
de rapports avec l’homme, et nous reconnûmes, en les examinant avec soin,
que ce sont en effet des hommes, mais dégénérés, ou disgraciés de la nature.
Leur taille moyenne est de quatre pieds, quelques-uns n’en ont que trois
et demi ; aucun n’excède quatre pieds et demi.
Ils
ont les paupières épaisses et le regard stupide, le nez épaté, les lèvres
grosses et décolorées, les joues pendantes, le teint livide, et un goitre
énorme leur tombe quelquefois jusqu’au mi- lieu de la poitrine. Nous adressâmes
la parole à quelques-uns d’entre eux. Les uns nous répondirent par des sons
inarticulés, d’autres ne nous répondirent pas du tout.
Ils
marchent en se balançant, et avec une peine qui fait souffrir le spectateur.
Quelques-uns vivent et meurent à la même place ; ce sont des huîtres attachées
à leur rocher. Ils ne sont capables que d’un mouvement régulier, celui de
la mastication ; il en est même qu’on est obligé de nourrir comme des enfans
nouveau-nés. Enfin ils sont hideux, dégoûtans, et ils n’ont rien de cette
intelligence, qui fait quelquefois supporter la
laideur.
Au reste, ils ne connaissent ni le mal physique ni le mal moral, puisqu’ils
sont privés de sensations. Tel Cretin a peut- être une existence plus douce
que celle dont a joui Jodelle, et dont commence à jouir Garnier, son successeur
et son émule.
Les
paysans, qui commençaient à revenir des champs, nous apprirent que beaucoup
de Crétins naissent, vivent et meurent avec un goitre, qui grossit presque
toujours de la naissance à la mort. Ces gens simples les préfèrent souvent
à leurs autres enfans ; ils les nomment bonnes âmes de Dieu, nettes de
péchés. Ils les considèrent comme des êtres privilégiés, destinés à un
bonheur éternel. La liberté tend à la propagation des lumières ; mais il
faut des siècles pour détruire certains préjugés. Le menu peuple en est encroûté
partout, et, à cet égard, bien des grands sont peuple.
Ce spectacle
nous avait profondément émus, et nous nous éloignâmes avec satisfaction de
ce village. Nous n’avions pu nous empêcher de nous identifier un moment avec
ces malheureux ; il nous sembla que nous redevenions hommes à mesure que
nous nous éloignions d’eux.
Je demandai
à mon philosophe quelle était son opinion sur la cause de cette difformité
: « Cela n’est pas difficile à trouver, me répondit-il. Les goitres viennent
de l’usage, en boisson, de l’eau de neige fondue. — Mais les enfans, fœtus
encore, n’en boivent pas. — Mais leurs mères en boivent pour eux. — Hé,
pourquoi ces mères et les trois quarts des habitans de Villeneuve n’ont-ils
pas de goitres ? tous font usage de la même boisson. — La question est embarrassante,
et je ne me charge pas de la résoudre. Quelle est, Monsieur, votre opinion,
à vous, à cet égard-là ? — Moi, je n’en ai point. — C’est plutôt fait.
Au reste, une question en suspens et une
question
résolue sont à peu près la même chose, en certaines circonstances. Si jamais
un savant met le doigt sur la cause des goitres, il n’empêchera probablement
pas certains Valaisans d’en avoir. »
Nous
étions venus de Sion à pied, et nous y retournions de même : la route n’est
pas bien longue. Claire portait son Antoine, et Marianne mon Antoinette.
Je regardais leurs jambes fines, les tresses de leurs cheveux qui descendaient
au-dessous des reins ; le grand chapeau de paille, dont le jeu cachait et
découvrait, tour à tour, deux jolies figures…. Tout à coup, un cri perçant
m’échappe…. Il paraît que mademoiselle Marianne a un goût prononcé pour les
beaux sites. Elle était montée sur un tertre, avec l’agilité et les grâces
d’un chevreuil... Le pied lui manque… elle tombe de douze à quinze pieds
de haut, et elle roule sur des cailloux. Je crois mon enfant tué. Je continue
de crier ; je m’élance…. Bertrand avait déjà relevé Marianne. Je prends ma
fille dans mes bras, je la caresse, elle me sourit, donc elle n’a pas de
mal.
Marianne
pleurait. Au moment de sa chute, elle avait élevé les bras pour sauver l’enfant,
les cailloux lui avaient fait une large écorchure à chaque coude, le sang
coulait ; fort heureusement, la figure n’avait pas porté. Je voulais la gronder
de s’être exposée inconsidérément. Je pensai qu’un mouvement, plus prompt
que la réflexion, l’avait portée à se sacrifier pour mon Antoinette, et le
reproche expira sur mes lèvres. Je m’approchai d’elle ; je tâchai d’étancher
le sang ; je la consolai, je lui adressai des paroles bienveillantes. « Ces
écorchures ne sont rien, me dit-elle, puisque vous n’êtes pas fâché. » Il
était difficile de dire plus en aussi peu de mots.

Quand
nous rentrâmes à Sion, les coudes étaient roides. La pauvre fille ne pouvait
les ployer, ou les étendre sans douleur. André courut la ville pendant une
heure. Il revint avec une grosse et forte fille du canton de Berne, qui parlait
un mauvais français, qui, peut-être, ne parlait pas un allemand bien pur
; mais qui savait assez des deux langues pour nous servir d’interprète. Marianne
était hors d’état de rien faire, pendant quelques jours. Claire l’avait formée
; elle formera Gott. C’est une bouche de plus ; mais nous trouverons à Appenzell
des chèvres, des vaches à traire, et de petits poulets à élever. Ces raisonnemens
d’André me parurent sans réplique ; j’étais, d’ailleurs, très-disposé à les
trouver bons : il m’avait deviné.
Nous
employâmes le reste de la journée à décharger nos grosses voitures, et à
mettre nos effets dans les petites. Légères et étroites, il ne fallait qu’un
mulet à chacune, et nous en avions six. Nous achetâmes deux selles d’hommes,
et deux de femmes. C’était un moyen de sortir de nos petits chariots, quand
nous serions las d’y être enfermés. C’en était un aussi de varier nos plaisirs,
sans ralentir notre marche.
Nos
équipages n’avaient plus rien d’extraordinaire : c’étaient ceux de paysans
suisses opulens.
Nous
sortîmes du Valais par Gelten, et nous entrâmes dans le canton de Berne.
Là tout était suisse, et nous y commençâmes à le devenir nous-mêmes. Nous
fûmes frappés d’abord par des sites, des mœurs, des habitudes, des usages,
tout-à-fait nouveaux pour nous. Des montagnes, toujours des montagnes, mais
dont l’aspect était varié à l’infini, et par conséquent toujours nouveau
; des mœurs douces, simples et patriarcales, qui avaient succédé aux fureurs
des combats, et qui laissaient entrevoir une longue suite d’années de paix,
et de générations
heureuses
; des habitudes, commandées par la nature d’un pays, peu productif en général,
et où le travail et le repos se succèdent sans interruption ; des usages,
qui dérivent nécessairement du genre de vie des habitans, voilà ce que nous
saisîmes en masse. Peu à peu, nous étudiâmes et nous connûmes les détails.
Nous
entrâmes à midi à Boschenried. Des hommes et des femmes vinrent au-devant
de nous. Aucun d’eux n’entendait un mot de français, et Gott commença à nous
être de la plus grande utilité. On exerce l’hospitalité dans ce canton, et
dans les autres, comme la pratiquaient les patriarches. Quand les voyageurs
sont nombreux au point de surcharger un seul ménage, les habitans les partagent
entre eux, et tous, sans exception, les logent à leur tour. Les hommes leur
serrent la main ; c’est partout une marque d’amitié. Les femmes leur servent,
avec gaité et quelque grâce, ce qu’elles ont de mieux, du pain bis, du fromage,
du lait, des œufs, et de l’eau, ou de l’hydromel, dans les endroits où l’on
ne recueille pas de vin. De la paille d’avoine fraîche cousue dans un long
sac de toile, bien blanche, compose le lit. Les vêtemens du voyageur lui
tiennent lieu de couverture. Après le souper, le père de famille ouvre sa
bible ; il en lit un chapitre ; on fume sa pipe, quand on en a l’habitude,
et chacun se retire dans le coin qui lui est assigné.
Trois
hommes et trois femmes composaient notre caravane. Ces bonnes gens voulaient
faire de nous trois couples, André et Claire, moi et Marianne, Bertrand et
Gott. Ils furent très- étonnés quand ils surent qu’André seul était marié.
Ils ne concevaient pas que des filles fissent un long voyage avec deux hommes,
qui n’étaient pas au moins leurs proches parens. Ils ne concevaient pas davantage,
que six individus, qui, par leurs
habits,
paraissaient appartenir à plusieurs cantons suisses, ne sussent pas un mot
d’allemand entre eux tous.
Gott
leur apprit que nous étions Français, et que nous allions nous établir au
canton d’Appenzell. Ils lui répondirent qu’ils n’aimaient pas les sujets
des rois ; mais que tous les hommes avaient droit à leurs secours et à leur
protection. Ils eussent dit la même chose au maréchal de Biron, et
ils lui eussent offert le morceau de fromage, et le sac de paille d’avoine.
Nous
fûmes logés selon les lois de la plus rigoureuse décence, un à un, André
et sa femme exceptés. Nous aurions préféré être tous ensemble, et nous coucher
sur nos matelas, dans nos voitures ; mais c’eût été désobliger ces bonnes
gens, et je me souvins que le denier de la veuve fut reçu avec bonté.
J’avais
pour hôtesse une petite femme éveillée, qui se mit dans la tête de m’apprendre
l’allemand, pendant que je soupais, avec la frugalité d’un Spartiate. Elle
me montrait du doigt les objets qui étaient à notre portée ; elle me les
nommait, et me faisait répéter. J’essayais, avec des efforts incroyables,
d’arracher ces sons barbares du fond de mon gosier. Je crus que j’aurais
une indigestion de consonnes. La petite femme riait de tout son cœur, en
m’entendant estropier les mots. Son mari gardait un sérieux imperturbable,
et avait un air de dignité qui l’eût rendu ridicule à Paris. Cet air-là est
plus ou moins, celui de
tous
les Suisses. Il leur est naturel, comme la force et la majesté le sont au
chêne6. Ils sont pénétrés de ce que vaut un homme libre,
et aucun d’eux ne changerait son sort contre celui d’un prince.

6 On sent
que M. de Mouchy peint les Suisses qui vivaient de son temps. On croit que
leurs descendans ont un peu changé.
Le
lendemain matin, je présentai de l’argent à mon hôte, et je lui fis signe
de prendre ce qui lui conviendrait. Il me répondit, par d’autres signes,
qu’il ne vendait pas ses services. Je m’attendais à cette réponse-là.
Nous
nous rassemblâmes tous. Mes compagnons m’apprirent que leurs hôtes avaient
marqué le même désintéressement que le mien. « Par la sambleu, dit André,
on ne peut rien demander à des gens qui ne veulent rien recevoir, et Appenzell
est à l’extrémité de la Suisse. Il serait dur de vivre, jusque-là, de pain
et de fromage, et de coucher sur une paillasse. »
Nous
tînmes un conseil général, dès que nous fûmes sortis du village, et nous
le tînmes en plein vent, comme les Suisses tiennent leurs conseils de guerre.
Chacun y eut voix délibérative, jusqu’à Gott, qui connaissait, beaucoup mieux
que nous, ce qu’on pouvait se permettre, et ce qu’on devait s’interdire en
Suisse.
Il fut
arrêté et écrit, ad perpetuam rei memoriam : 1° que nous vivrions
aussi bien que les circonstances nous le permettraient, et que nous pourrions
en profiter, sans offenser personne. 2° Que pour ménager nos compatriotes
les Suisses, nous ne nous montrerions dans les villages, qu’après avoir pris
nos repas. 3° Que nous dormirions dans nos voitures, comme nous l’avions
pratiqué depuis Montereau jusqu’à Sion, et que les bienséances seraient scrupuleusement
observées, comme elles l’avaient été jusqu’alors. La seconde clause de cet
arrêté était du législateur André. 4° Que Marianne donnerait à Gott des leçons
de cuisine française, et que Gott lui marquerait les égards qu’on doit à
son institutrice. Cette dernière clause était de ma façon, et elle fit sourire
Marianne. 5° Enfin, que nous chercherions les gros bourgs, quand nos provisions
diminueraient d’une manière
alarmante
; que Gott irait au marché, et qu’elle ferait les choses en conscience. Elle
nous demanda ce que cela voulait dire avec un ton de candeur, qui nous persuada
que nous n’avions rien à craindre.
Le temps
se soutenait. Le chemin, assez facile, était bordé d’arbres, et nous marchâmes
un peu. Les hôtesses de mes camarades leur avaient aussi donné des leçons
d’allemand, dont ils n’avaient pas plus profité que moi. Gott remarqua que
mademoiselle Marianne était celle qui avait le plus profité. Était-ce
vrai, ou la grosse Bernoise voulait-elle seulement plaire à sa maîtresse
? Je pensai que les femmes, les plus grossières, ont un certain tact qui
les dirige aussi sûrement que l’esprit cultivé des dames de salon. Quoi qu’il
en soit, je sus bon gré à Gott de son observation.
Nous
sentions tous la nécessité d’apprendre cette langue ; nous y étions excités
par le charme de la nouveauté. Nous entourions Gott, nous lui demandions
comment on dit, en allemand, un lac, un arbre, une montagne. Nous répétions
tous ensemble, et nous faisions un bruit à faire fuir une procession. Les
corbeaux crurent que nous parlions leur langue ; ils s’attroupèrent sur les
arbres qui garnissaient le chemin, et ils croassèrent avec nous, ce qui produisit
un concert, tel que nous n’en avions jamais entendu, et que mes lecteurs
n’en entendront jamais.
Dans
le courant de la journée, nous découvrîmes le premier châlet, et nous nous
en approchâmes. Ces bâtimens sont le laboratoire, la salle à manger, la chambre
à coucher, l’étable et la laiterie des Suisses, qui sont bornés au nécessaire.
Ceux qui ont de l’aisance se forment une petite maison à côté de leur châlet.
Celui-ci
était une hutte, peu élevée, assez spacieuse, et bâtie en pierres sèches
: presque partout, en Suisse, on les trouve sous sa main, et on n’a que la
peine de les placer les unes sur les autres. Les toits se composent de planches
grossières. On jette du foin dessus, et on le fixe avec des cailloux, jetés
sans proportions et sans ordre. Là-dessous habitent les maîtres, les bergers,
et les troupeaux. Ils ne sont séparés que par une crèche, haute de dix-huit
pouces. Les vaches y sont attachées, et passent souvent leur tête dans la
cuisine. Les femmes les caressent, et pendant l’hiver, elles s’assoient entre
elles, leur passent les bras au cou, et se réchauffent à leur haleine. Cette
douce chaleur leur plait davantage que les ardeurs d’un foyer, qui brûle
pendant une grande partie de la journée. Les châlets n’ont pas de cheminée.
La fumée s’évapore par les intervalles, qui se trouvent entre les pierres
des murs et les planches, qui forment le toit. Un bras de bois, frappé dans
une potence tournante, de la même matière, soutient une grande chaudière,
dans laquelle on fait tout, alternativement. Tantôt, on y cuit des pommes
de
terre7, en assez grande quantité pour nourrir la famille, pendant deux
jours ; tantôt, on y fait le fromage compact, qui se
conserve
très-long-temps. Le petit lait, chaud encore, sert de boisson aux pauvres.
Ils l’emploient aussi à amollir un pain d’avoine grossier, qui est la base
essentielle de leur nourriture.
Le maître
du châlet sait ce qu’il peut exiger de ses bergers, de ses laitières, et
jamais il n’excède ses droits. Les domestiques connaissent leur devoir, et
les heures précises où telle ou telle chose doit être faite. Il est rare
que le maître ait un ordre à leur donner. Après le souper, l’égalité la plus
parfaite, la gaîté et de

7 Il paraît
peu vraisemblable que la pomme de terre, rapportée depuis peu des Amériques,
ait dès cette époque fait partie du régime habituel des paysans de ces régions
alpestres (B. G.)
petits
jeux succèdent à la soumission et au travail. On se jette sur la paille,
et on dort, les portes ouvertes. Le châlet que nous visitâmes n’en avait
pas, du moins dans les premiers jours de septembre. Gott nous dit que dans
la plupart de ces châlets il n’entre ni farine de froment, ni vin, ni argent.
Les
habitans de ces pauvres demeures y vivent heureux, parce qu’ils y sont nés
; qu’ils n’éprouvent d’autre désir que de trouver une compagne au printemps
de leur vie ; qu’ils ne craignent ni les passions haineuses, ni les persécutions
des grands ; qu’ils ne connaissent d’orages que le bruit du tonnerre, qui
éclate dans leurs montagnes.
À Paris,
l’homme ambitieux et inquiet ne trouve pas toujours le sommeil sous ses lambris
dorés. Bussy Leclerc, suivi de ses satellites, enfonce les portes, au milieu
des ténèbres, et il traîne à la Bastille celui qu’a proscrit la Ligue, ou
le conseil des seize.
Fidèles
aux usages du pays, les bonnes gens chez qui nous étions nous invitèrent
à partager avec eux leur pain noir, leurs pommes de terre et leur petit lait.
Nous leur répondîmes que nous avions dîné dans le village d’où nous sortions.
Nous avions effectivement dîné, mais en pleine campagne. Nous regagnâmes
nos petits chariots, et nous continuâmes notre route.
Bertrand
se détacha, pour aller couper des broussailles : Marianne voulait donner
à Gott une leçon de cuisine, pour laquelle le feu était indispensable. Bertrand
en alluma, à l’aide de son briquet. Mais, ô douleur ! des nuages épais s’élevaient,
s’aggloméraient, nous menaçaient. Les pointes aiguës des rochers, qui couronnaient
les montagnes, allaient les diviser ;
nous
étions menacés d’un déluge. Tels sont les vains projets des hommes : la petite
Marianne soupira, en renonçant au sien.
Nous
n’avions pas de temps à perdre pour nous mettre à l’abri de l’orage, et nous
étions privés de ce vaste fourgon qui nous recevait tous si aisément. Un
de nos chariots suffisait à peine pour contenir nos provisions. Il en restait
trois pour loger six personnes. Je ne savais comment nous nous arrangerions.
André nous donna un exemple que nous suivîmes tous. Il prit à l’office, ce
qu’il lui fallait, et s’enferma dans un chariot avec sa femme et les enfans.
Marianne me regarda, et baissa les yeux aussitôt. Je crois que je rougis.
Je fis avancer Bertrand, et je montai avec lui dans un chariot. Ce n’était
pas lui que je désirais ; mais je devais l’exemple des bonnes mœurs. Marianne
et Gott s’arrangèrent dans le quatrième chariot.
Bientôt
la pluie tomba à flots, et le tonnerre gronda, avec un bruit épouvantable.
Les détonations se succédaient sans relâche. Les trois femmes criaient à
la fois. La peur, qui glace ordinairement, semblait ajouter à leurs forces.
Elles voulaient fuir ; mais où aller, pour éviter le danger ? André contenait
Claire ; Marianne et Gott étaient maîtresses de leurs actions.
Je les
entendis sauter à terre. Marianne, privée encore de l’usage de ses bras,
m’inspira les plus vives alarmes. Je me précipitai. Le ciel paraissait embrasé
; la pluie tombait avec la même abondance. Nous étions tous trois dans l’eau,
jusqu’à la cheville du pied. Je fis monter la petite et Gott dans mon chariot
; je m’y plaçai avec elles, et très-certainement les bienséances étaient
encore observées : nous étions quatre. Mais nous étions les uns sur les autres.
Bertrand
descendit, en me disant qu’il allait prendre au magasin de quoi couvrir nos
mulets, attachés derrière les chariots, que l’orage effrayait aussi, et qu’il
irait ensuite passer le reste de la nuit dans le chariot de mademoiselle
Marianne. Nous n’étions plus que trois ; ce n’était pas ma faute.
Un coup
terrible me fit frissonner moi-même. Gott s’écria, dans son baragouin, que
le tonnerre était tombé sur le chariot. Elle s’élança, et fut se blottir
dessous ; Marianne oublia ses blessures, et me saisit dans ses bras. Nous
n’étions plus que deux. Ce n’était pas ma faute.
Le lendemain,
à la pointe du jour, le ciel était pur, et le soleil éclaira l’intérieur
des chariots. André et sa femme seuls étaient présentables. Les autres avaient
leurs habits crottés, froissés ; nous étions dans un état à faire pitié.
André dirigea le convoi sur le bourg d’Abmen.
Il prétendit
que tous les enfans nous suivraient, nous hueraient, si nous nous montrions
dans un tel désordre. Il nous pria instamment de tenir nos rideaux fermés,
jusqu’à ce que nous fussions entrés dans une maison hospitalière. Il fallut
rester cachés. Ce n’était pas ma faute.
Nous
ne ressemblions pas mal à ces animaux, que ceux qui les montrent font voyager
dans de grandes cages, où l’œil des passans ne peut pénétrer. Nous entrâmes
dans une vaste cour. On est curieux en Suisse comme ailleurs. Les gens de
la maison se rassemblèrent, pour voir ce qui allait sortir des chariots.
C’étaient simplement des voyageurs, maltraités par l’orage, dont quelques-uns
avaient besoin de repos.
André,
qui marchait en avant, avait trouvé un cabaret qui ne valait pas celui de
Sion, et où il y avait cependant une chambre haute, que maître Waters nous
donna de fort bonne grâce.
André
et Claire n’avaient rien à changer à leur costume ; mais nous…. Je prononçai
que Marianne et Gott feraient leur toilette dans cette chambre, et que Bertrand
et moi, nous nous arrangerions où nous pourrions. Mon ami André me félicita,
en souriant, de mon respect pour les mœurs ; Marianne me jeta un coup d’œil
en-dessous, qui ne pouvait m’échapper. Nous nous séparâmes, et chacun s’occupa
de ses petites affaires.
Nous
reprîmes, Bertrand et moi, nos costumes de vachers ; Marianne la petite robe
d’indienne qu’elle portait à la Tour, et Gott se mit dans ses atours du dimanche
: elle n’en était pas plus belle. Waters alluma un grand feu dans la chambre
haute, et il étendit, sur des bancs, les habits que nous venions de quitter.
Bertrand nous monta le déjeûner, et ensuite des matelas sur lesquels nous
nous jetâmes tous, après avoir réparé nos forces épuisées. André et sa femme
n’avaient pas plus dormi que nous.
À notre
réveil, un homme très-simplement vêtu, entra dans notre chambre. Il nous
demanda si nous manquions de quelque chose, et il nous offrit tous les secours
que pouvait nous donner la commune. C’était le bourgmestre. En France, un
procureur du roi nous eût fait amener chez lui, nous eût demandé nos sauf-conduits,
et nous eût fait mettre en prison, jusqu’à plus ample informé, parce que
nous n’en avions pas.
Gott
joua le premier rôle dans cette circonstance importante. Elle remercia, en
notre nom, M. le Bourgmestre de ses offres obligeantes. Marianne lui fit
demander, par notre truchement,
une
couturière habile. Son costume suisse avait été très- endommagé ; elle y
tenait beaucoup, et elle avait raison : il lui allait à merveille.
Le bourgmestre
parut trouver extraordinaire qu’on s’occupât d’un corset et d’une jupe, quand
on devait avoir des besoins plus pressans. Gott lui dit, sans en être chargée,
que nous étions Français. Il sourit, avec une sorte de dédain ; mais elle
ajouta, fort heureusement, que nous échappions aux furieux qui opprimaient
la France, et que nous venions chercher la liberté en Suisse. Il nous prit
la main à tous, sans exception, et il nous la secoua fortement. Il nous salua
avec affabilité et se retira.
Bientôt
la couturière si désirée parut. Claire et Marianne s’en emparèrent. Elles
donnaient des conseils ; elles en demandaient : deux Françaises qui tiennent
leur couturière, n’ont jamais fini. Nos mulets avaient été mouillés toute
la nuit, et l’avaient passée à jeun. Ils avaient besoin de se refaire. On
décida qu’on passerait la journée à Habmen. C’était entrer dans les vues
de Marianne.
Nous
envoyâmes Gott à la provision. C’était heureusement jour de marché. Elle
mit deux sacs sur le bras de Bertrand, et ils partirent côte à côte. Ils
revinrent une heure après, chargés de ce qu’ils avaient trouvé de mieux.
Waters nous fit goûter d’un vin du Rhône qui nous parut agréable. Nous en
prîmes une feuillette. Nous pouvions marcher long-temps, sans craindre la
famine, et sans être à charge à personne.
Le lendemain
matin nous comptâmes avec Waters. Il nous dit que nous ne devions rien pour
ce qui avait été consommé chez lui ; mais que son vin devant être bu dans
des communes, qui devaient fournir à nos besoins, il était juste de le lui
payer. Ces
usages
étaient nouveaux pour nous, sans doute. Nous nous y soumîmes sans réclamation
: ils faisaient honneur au peuple qui nous adoptait. Cependant, je glissai
un doublon dans la main d’un enfant qui tournait autour de nous, et nous
partîmes.
Bientôt
nous entendîmes crier derrière les chariots. C’était Waters qui rapportait
le doublon. Il nous dit, avec colère, que si on savait dans la commune qu’il
eût reçu de l’argent de nous, il en serait chassé. En France, on fait payer
le plus léger service, et quand on a reçu votre argent, on vous demande quelques
pièces de cuivre, pour boire. Nos crocheteurs devraient aller apprendre à
vivre en Suisse. Je calmai le bon Waters, et je remis mon doublon dans ma
poche.
Nous
nous dirigeâmes sur le canton d’Uri, et nous passâmes plusieurs jours dans
une uniformité de conduite et de vie qui n’a rien d’amusant : il n’y a pas
d’orages tous les soirs. Nous philosophions, André et moi. Ces dames n’étaient
pas philosophes. Claire parlait à ses nourrissons, qui ne lui répondaient
pas. La petite Marianne raisonnait sur le tonnerre, et ses effets inattendus.
Elle m’adressait, de loin en loin, un coup d’œil furtif, qui ne troublait
pas la sérénité de l’air : ce n’était pas ma faute.
Nous
découvrîmes, en passant à Niesen, le fameux Simplon, dont le front sourcilleux
menace le Valais. Nous aurions pu le voir plutôt ; mais la philosophie ;
mais les nourrissons ; mais le tonnerre, nous occupaient assez régulièrement.
D’ailleurs, il eût été fatigant d’avoir toujours le cou tendu pour regarder
à droite et à gauche. L’aspect de cette énorme montagne, nous étonna moins
que le Mont-Blanc, peut-être parce que nous la considérions de plus loin,
et, après tout, les hautes cimes des Alpes ont, entr’elles, une grande ressemblance.
Nous
vîmes le premier chamois, après avoir dépassé Gsteig. Il était sur une pointe
de rocher assez élevée, et il nous fut difficile de juger sa forme et les
dimensions de son corps. « Ah, dis-je à André, si nous avions pris avec nous
cette lunette d’approche, avec laquelle Madame Richoux croyait toucher les
moulins, les ânes et les meuniers…. — Je vais vous la chercher, Monsieur.
Vous savez que je n’oublie rien, et je savais qu’il y a des montagnes en
Suisse…. la voilà, Monsieur. — Monsieur, Monsieur !... ne sommes-nous pas
égaux, associés, et surtout amis ? — Comment voulez-vous que je vous appelle
? — Hé, parbleu, appelle-moi Antoine. — Comme vous voudrez. — Et pourquoi
vous ? — Le mendiant que vous avez trouvé à Saurigny ne doit pas se
permettre le tu. — Je le veux, et je commande pour la dernière fois.
— À la bonne heure. Mais pour les soins, les prévenances, et le travail qu’ils
exigent ? - Tu continueras de t’y livrer. Nous te nommons maréchal-général-
des-logis, et grand-maître des cérémonies de la caravane. Te voilà le
premier dignitaire de la troupe, et j’ai besoin que tu le sois : je n’aurai
plus la peine de me mêler de rien. »
Nous
descendîmes tous pour considérer le chamois, et nous le regardâmes, alternativement,
dans la lunette d’approche.
Il nous
parut supérieur, en taille et en force, à une grande chèvre. Son agilité
nous frappa d’étonnement. Il sautait de rochers en rochers, avec une prestesse
inconcevable, et ses pieds tombaient toujours sur le seul point qui pût
lui servir d’appui. Une idée en amène toujours d’autres. Nous nous interrogions
sur les habitudes de cet animal, sur les moyens de défense que lui a donnés
la nature ; sur les dangers et les fatigues que bravent les chasseurs, qui
lui font la guerre. Nous répondions de travers, et cela devait être. Ne m’arriva-t-il
pas
de
dire, moi, grand théologien, que les bâtons ferrés que nous avait vendus
Luker, devaient être indispensables pour cette chasse ? Mon égal et ami André
me rit au nez. En effet, on ne chasse pas le chamois avec un bâton ferré
à la main, mais avec un mousquet, et il faut que le chasseur ait le pied
aussi sûr, et qu’il soit presque aussi agile que l’animal qu’il poursuit.
Tout le monde rit de mon idée, qui ne parut ridicule, que lorsqu’André eut
prouvé combien elle était peu fondée. Je ris à mon tour, lorsque mon aristarque
dit que ces chasseurs portaient, vraisemblablement, dans leur havresac, une
échelle de cordes pour gravir les rochers à pic. — Et qui va leur accrocher
l’échelle, Monsieur le critique ? — C’est vrai, c’est vrai. Ce que je viens
de dire n’a pas le sens commun. » Marianne avait gardé un sérieux imperturbable,
quand je parlai des bâtons ferrés, et elle rit de tout son cœur de l’échelle
de cordes. J’interprétai la différence de ses sensations, et je crois que
je ne me trompai point.
« Que
conclurons-nous de notre bavardage, dit André ? que si nous sommes bien plus
savans que les Suisses, sur certaines choses, ils en savent plus que nous,
sur beaucoup d’autres. Il faut leur demander des explications sur ce que
nous ignorons, et s’ils rient de notre simplicité, nous leur parlerons philosophie,
histoire, littérature. Nous leur réciterons des vers de Jodelle. — Ils ne
nous entendront pas. — Sans doute, et c’est là le beau. Le vulgaire n’admire
et ne croit jamais aussi fortement que les choses qu’il ne comprend pas.
« Nous
passerons demain à Faulhorn, et c’est dimanche. — Nous irons à la messe.
— Très-certainement. Après le service, nous ferons connaissance avec le curé,
et nous lui parlerons latin. Il nous répondra, et si, comme je le crois,
il n’est pas
expert
sur la chasse aux chamois, il nous procurera quelqu’un qui nous donnera les
renseignemens que nous désirons. Cela vous convient-il, Monsieur ? — Encore
vous ! encore Monsieur ! — Ma foi, j’ai eu Antoine et
tu sur le bout de la langue ; mais il m’a semblé que j’allais jurer.
Tenez, la distinction des rangs n’est pas une chimère. L’ordre social ne
peut exister sans cela. Les Suisses, si libres et si fiers de leur liberté,
n’ont-ils pas des magistrats ?
« Un
roi qui ne sait pas régner, ou qui ne veut pas s’en donner la peine, a un
premier ministre, qui ne le tutoie pas. Plus il marque de respect au souverain,
plus il donne de relief à sa place. Il monte dans le degré de l’élévation
où il place son maître. Je continuerai d’être votre premier ministre, mais
sans qualification. J’ai bien le droit d’avoir aussi une volonté à moi, et
je veux, j’ordonne que les choses restent dans l’état où elles étaient.
« Votre
proposition fait l’éloge de votre cœur. Peut-être avez- vous fait ce que
vous deviez. Je fais ce que je dois, en refusant de vous faire descendre
jusqu’à moi. »

Vue
du Niesen par Pingret, 1825

Costumes
de Glaris, par Achille Dévéria, vers 1830
CHAPITRE
XXX.
Les
chamois. Histoire de Joseph.
Nous
partîmes pour Faulhorn, par le plus beau temps du monde. Des sites rians
disposent l’homme à être gai, comme un ciel nébuleux l’attriste. Circonscrits
dans la nature, nous sommes constamment soumis à son influence. Nous descendîmes
de nos chariots ; nous chantâmes, nous sautâmes. Madame André, ordinairement
sérieuse, partageait la gaité générale. Marianne, vive, étourdie même, la
provoquait ; André la soutenait par ses saillies ; moi, je tenais ma petite
Antoinette dans mes bras ; elle me souriait, je lui rendais son sourire pénétrant,
et je sentais que le rire, qui a sa source dans le cœur, est bien préférable
à celui que produit la grosse gaité.
Bientôt
nous nous engageâmes dans une gorge, formée de deux montagnes. Le précipice,
qui les sépare, était devenu un chemin assez difficile ; mais cependant praticable.
Nous ne pensâmes point à remonter dans nos chariots, nous les eussions surchargés.
Nous en avions quatre, et six mulets.
Deux
se reposaient, alternativement, et marchaient en lesse. Gott était infatigable
; Marianne et Claire commençaient à ralentir leur marche. Je rappelai à André
que nous avions des selles de femmes.
Il
fallut porter Claire sur son mulet. Marianne sauta sur le sien, avec la légèreté
d’un oiseau. Claire se tenait à sa selle ; Marianne, très-bien placée, jouait
avec sa bride. Elle me regardait d’un air, qui signifiait clairement : Vous
voyez que je ne suis gauche nulle part. André et moi portions les enfans
; Gott et Bertrand se jetaient de petits cailloux. C’est ainsi que commencent
les amours de village.
Tout
allait bien jusque-là. Mais nous arrivâmes au bord d’une fondrière, que l’orage
avait formée. Il y restait de l’eau, et nous ne pouvions distinguer ce qui
était dessous. Marianne passa avec intrépidité ; mais elle s’aperçut, plusieurs
fois, que son mulet bronchait sur des pierres. André se rappela ce que nous
avait dit maître Cormier, à Sion, et nous résolûmes de décharger nos voitures.
Il fallut reprendre nos habits de vachers, si peu avantageux, mais si commodes.
Nous décidâmes que nous ne les quitterions plus qu’à Appenzell. Il nous était
impossible de prévoir les obstacles que nous rencontrerions, et il n’est
pas plaisant de faire toilette en plein air.
André
attacha son fils devant Claire, et lui recommanda de n’aller qu’au petit
pas. La recommandation était inutile. Marianne me demanda Antoinette. Son
adresse éprouvée me décida à la lui confier.
Nous
nous mîmes au travail, avec l’ardeur de gens qui veulent aller à la messe,
et connaître les chamois. Cependant il fallut rester là deux heures. Nous
y eussions passé la journée, sans une idée qui passa par la tête d’André.
Il en avait presque toujours de bonnes. « Déchargeons le chariot qui sert
de magasin, et voyons comment il passera à vide. »
Bertrand
se mit à califourchon sur le mulet d’attelage, et il passa facilement, à
quelques cahots près. André le fit revenir avec sa voiture. « Il faut maintenant
répartir cette lourde charge dans les quatre chariots, et cela ira. »
Tout
passa en effet ; mais, malgré notre enthousiasme de liberté, nous convînmes
que la Suisse n’est pas le plus beau pays de la terre.
Claire
nous attendait tranquillement de l’autre côté de la fondrière. Je ne vis
plus Marianne, et elle portait mon enfant ! Je regardai en avant. L’angle,
très-saillant, d’un énorme rocher, me dérobait la route….. Je courus.
J’aperçus,
derrière la roche, un sentier, qui me parut avoir été taillé à mains d’hommes.
Il montait à mi-côte, et devait abréger la route. Peut-être évitait-on, en
le prenant, d’autres mauvais pas, qui pouvaient arrêter nos chariots.
Je regardai
devant moi ; je voyais assez loin, et je n’apercevais pas Marianne. Inquiet,
tourmenté, je montai le sentier. Quand je fus parvenu à une certaine élévation,
je découvris le bourg de Faulhorn. Nous n’en étions pas éloignés ; mais ce
n’était pas ce que je cherchais.
Je remarquai,
à une assez grande distance, une baume, espèce d’enfoncement ou de grotte,
creusée par la nature. Je crus y reconnaitre du mouvement ; j’y volai.
Oh,
je grondai Marianne, je la grondai ! c’est toujours par-là qu’on commence,
quand on a de l’humeur, et qu’on croit avoir raison de se fâcher. La pauvre
petite me dit, en pleurant, que son mulet l’avait entraînée, malgré elle,
et cela pouvait être
vrai.
Elle avait mis l’enfant à l’abri du soleil, à l’entrée de la baume. Une chèvre,
appartenant, elle ne savait à qui, s’était trouvée là, tout à-propos, comme
la biche de Geneviève de Brabant, et elle avait fait téter Antoinette. Il
est constant que la chèvre était là, bien là ; l’enfant dormait sur de la
mousse, très- vraisemblablement parce qu’il n’avait besoin de rien. La chèvre
broutait à l’entrée de la baume ; le mulet arrachait quelques pointes de
verdure qui poussaient à travers les fentes des rochers.
Je m’étais
emporté ! j’avais eu tort, évidemment tort. J’essuyai les larmes de Marianne.
Je la consolai…. oui, je parvins à la consoler.
Cette
petite ne se permit-elle pas de m’appeler Antoine ? Elle était sûre, au moins,
que personne ne pouvait l’entendre. Oh, les belles choses que le tonnerre
et une baume !
Nous
nous remîmes en marche, et nous n’avions plus rien à nous dire. Des idées
tristes s’emparèrent de moi. Je me reportai à Arpajon. Je me souvins du serment
solennel que j’avais adressé aux mânes de….. Je n’osai proférer son nom.
J’étais
mécontent, très-mécontent de moi. Je portai machinalement les yeux sur Marianne
; elle me sourit. J’ai promis, me dis-je, qu’aucune femme ne la remplacerait
dans mon cœur, et très-certainement je ne violerai pas cette promesse ; mais
vingt-quatre ans, et la nature !...
Je fus
honteux de la facilité avec laquelle cette petite changeait la direction
de mes pensées, et l’humeur me gagna de nouveau. J’avais fait quelques observations
pendant l’orage, et j’eus la cruauté de vouloir humilier Marianne.
Je les lui
communiquai
nettement. De nouvelles larmes mouillèrent ses paupières. « Doit-on, dit-elle,
garder son cœur pour quelqu’un qu’on ne connaît pas, et qui, peut-être, ne
se présentera jamais ? Et elle avait à peine vingt ans !
Je ne
répondis rien. Je m’avançai sur le bord du rocher, et je vis nos voitures
qui s’avançaient, sans rencontrer d’obstacles. André et Bertrand regardaient
de tous les côtés. Ils étaient, vraisemblablement, aussi inquiets que je
l’avais été moi-même. Je les appelai ; ils me reconnurent, et nous nous réunîmes
à une portée de mousquet de Faulhorn.
Claire
voulut faire téter Toinette ; elle refusa le sein. Il fallut raconter une
partie de ce qui s’était passé là-haut. André sourit. Cet homme-là me devine
toujours.
Nous
entrâmes dans le bourg, et nous descendîmes à un cabaret qui nous parut valoir
celui de maître Waters. Le bourgmestre se conduisit comme celui d’Habmen.
Nous le remerciâmes de ses offres, et nous courûmes à la messe. À la messe
! et une heure avant…. Il semble que la nature ait jeté, dans un même moule,
des vices, des vertus, des faiblesses, des qualités. Attrape qui peut.
L’intérieur
de l’église me parut extraordinaire. Pas de tableaux, de statues ; point
de chapelles. Une table de marbre noir était placée dans un enfoncement :
c’était sans doute l’autel. Un prêtre était monté en chaire, et il n’avait
ni aube ni surplis. Je n’entendais rien de ce qu’il disait, quoique nous
sussions déjà beaucoup de mots allemands. Nous n’en étions pas encore aux
phrases. André me regardait et se pinçait les lèvres, pour ne pas éclater
de rire. On chanta enfin, et on chanta en allemand. Je vis alors que
j’étais dans un temple de
huguenots.
Mon premier mouvement fut de sortir, André me retint. « Ce ministre de l’Evangile,
me dit-il bien bas, n’a pas de vassaux comme l’abbé de Saint-Claude, et s’il
en avait, il ne les traiterait pas comme lui. Souvenez-vous que vous avez
été tenté de pardonner aux huguenots ; tâchez de les aimer, puisqu’il faut
que vous viviez avec eux. »
Nous
sortîmes avec les autres, et André se frappa le front. « Il faut avouer que
je suis un grand imbécile. Il y a quelque temps que nous sommes en Suisse,
et je ne sais pas encore s’il faut frapper à droite ou à gauche pour trouver
la bonne porte. Gott, à moi. »
Maître
Sturtt, notre hôte, avait le mérite de connaître assez bien son pays. C’est
encore un avantage qu’ont les paysans suisses sur nos rustres français. Cependant
nous fûmes étonnés de l’érudition du cabaretier. Quand la tête est montée,
on trouve tout admirable.
Nous
apprîmes d’abord que tout le canton de Berne est protestant, et nous rîmes
de la bévue qui nous avait fait chercher une messe où nous ne pouvions en
trouver.
Les
cantons de Lucerne, d’Uri, de Schwitz, d’Underwalden, de Zug, de Fribourg,
et de Soleure, sont catholiques. Ceux de Zuric, de Berne, de Bâle, de Schaffousen,
sont protestans. La population de Glaris et d’Appenzell se compose de catholiques
et de réformés.
Et nous
avions pris notre route par le canton de Berne, dont la vaste étendue, réunie
à celle de Zuric, de Bâle, et de Schaffousen, prouve la plus triste vérité
: c’est que les sectaires
des
deux religions sont en nombre à peu près égal. Mais aussi ils vivent en paix.
André,
à qui rien n’échappait, remarqua que Sturtt ne nous avait pas nommé les treize
cantons dans l’ordre de leur réunion à la confédération helvétique. Il nous
répondit, sans hésiter, qu’il les avait classés selon le rang qu’ils prennent
aujourd’hui dans les assemblées générales, et dans les actes publics. Monsieur
le critique fut désarmé, et cependant Sturtt s’était trompé sur ce dernier
objet. Nous ne tardâmes pas à reconnaître son erreur.
Notre
manière de causer avec lui était fatigante. Gott le traduisait platement,
et presque toujours avec obscurité. Nous désirions avoir beaucoup de détails
sur les chamois, et sur la manière dont on chasse des animaux qui sont aussi
souvent en l’air que sur les pointes des rochers. Il fallait une conversation
suivie pour arriver à ce but, et André me proposa d’aller rendre visite au
pasteur. J’y répugnai d’abord. J’avais compté avoir un entretien avec un
curé, et non avec un ministre. Cependant je me laissai entraîner. Ma conscience
devenait facile en capitulations.
Nous
trouvâmes M. Werner assis dans une espèce de chaise curule, en bois de chêne.
Il se leva, dès qu’il nous aperçut. Madame Werner et ses demoiselles travaillaient
à l’aiguille. Elles nous firent une moitié de salut, sans lever les yeux
sur nous.
Le pasteur
était un homme de cinquante ans environ, d’une belle taille, d’une figure
noble et imposante. Sa femme avait été belle, et ses filles, âgées de seize
à dix-huit ans, me parurent jolies, autant que je pus juger deux petites
figures, constamment
baissées
sur leur ouvrage. La simplicité et la modestie nous parurent les qualités
distinctives de cette famille.
Je fus
choqué d’abord de voir un prêtre marié et père de famille. J’aurais dû m’attendre
à cela. Hé, me dis-je, saint Paul n’était-il pas marié ? Les prêtres de la
primitive Église ne l’étaient-ils pas ? On a privé le clergé catholique de
ses femmes ; celui de la réforme les a reprises, et certainement la sagesse
doit leur être plus facile qu’aux premiers. Ils sont placés dans l’État.
Leur qualité de pères de famille en fait des citoyens, et leur intérêt particulier
se lie à l’intérêt général. La patrie de tous les prêtres catholiques est
à Rome. On voit que je me forme.
M. Werner
ne savait pas un mot de français. Nous lui parlâmes latin. Nous eûmes d’abord
de la peine à nous entendre. La grande difficulté était dans la différence
de la prononciation, et particulièrement dans celle des u. Quand il
fut reconnu qu’il disait ou et nous u, la conversation s’anima.
Lorsqu’il
sut que nous étions des Français, qui voulions nous faire naturaliser à Appenzell,
il nous fit l’accueil le plus cordial, et nous invita à partager son dîner
frugal. Il ne nous demanda pas si nous étions catholiques ou réformés. Cela
lui était égal. Les protestans croient qu’on peut se sauver dans les deux
religions. Ce n’était pas la peine d’en changer.
« Nous
acceptâmes son dîner. C’était un moyen sûr de causer avec lui jusqu’à satiété.
Mon critique ne manqua pas de lui faire part de l’observation qu’il avait
adressée à Sturtt, sur l’ordre dans lequel il avait rangé les cantons. Monsieur
Werner lui répondit que lui et Sturtt avaient eu à moitié raison. « Il est
constant qu’on ne vous les a pas présentés d’après le rang que
devraient
leur donner les époques de leur réunion à la confédération. Il est constant
aussi que quelques décrets, des siècles et des usages qu’ils consacrent ont
interverti l’ordre naturel. Voilà celui dans lequel les représentais des
treize cantons siègent et votent à l’assemblée générale. Zuric, Berne, Lucerne,
Uri, Schwitz, Underwalden, Zug, Glaris, Bâle, Fribourg, Soleure, Schaffousen
et Appenzell. »
Tout
cela m’était assez égal : j’avais été député aux États- Généraux de Paris,
et je ne m’en étais pas bien trouvé. Je n’ambitionnais pas, alors du
moins, l’honneur de représenter le canton d’Appenzell à la diète helvétique.
Je voulais en venir aux chamois, et on parlait de tout excepté de cela.
Un ministre
de l’Evangile a de l’amour-propre, comme un membre de la pléiade française.
M. Werner vit qu’André l’écoutait avec intérêt, et il prolongea sa dissertation.
« Supposons,
dit-il, que les treize cantons veuillent lever une armée de dix mille six
cents hommes. Voici quelle en sera la répartition. Zuric fournira 1,400 hommes
; Berne 3,000 ; Lucerne 1,200 ; Uri 400 ; Schwitz 600 ; Underwalden 400 ;
Zug
400
; Glaris 400 ; Bâle 400 ; Fribourg 800 ; Soleure 600 ;
Schaffousen
400 ; Appenzell 600.
« La
population du canton de Berne est de 294,500 âmes. Voilà du papier et une
plume. Pouvez-vous me dire le nombre des habitans des autres cantons, en
admettant que celui des femmes, des enfans et des vieillards soit à peu près
égal partout, a ce qui est vrai, et en calculant d’après le nombre de soldats
que doit fournir chaque canton ? — Dans la proportion de 5,000 hommes que
doit donner le canton de Berne, qui a 294,500 habitans ? — Précisément.
» André n’était pas
embarrassé
du tout. Il avait appris l’Arithmétique, l’Algèbre, et tout ce qui s’ensuit,
chez les jésuites d’Angoulême. Il fut bien aise de faire voir qu’il n’était
pas un homme ordinaire. Moi, je maudissais la fantaisie qu’avait eue le docteur
évangélique de faire le savantasse. Je m’approchai des jeunes personnes qui
s’étaient remises à leur ouvrage. Je croyais trouver, dans leur conversation,
un dédommagement à l’ennui que m’inspirait mon Euclide angoumois. Aux premiers
mots allemands que je leur adressai, et qu’elles ne devaient guère entendre,
elles se levèrent et sortirent.
Que
leur ai-je donc dit ? Gott, ou quelque mauvais plaisant m’aurait-il trompé,
en me traduisant un mot français, que tout le monde peut entendre, par un
autre, qu’on ne peut prononcer devant certaines personnes ? J’étais intrigué,
et M. Werner me tira de peine. « Nos jeunes filles, me dit-il, ne causent
qu’avec leurs parens, » des amis particuliers de leur famille, et jamais
avec des étrangers. Je crois que les bonnes mœurs y gagnent. » Il était bien
question de mœurs là ! Cet homme a la manie de parler de tout.
« À
propos de jeunes filles, ajouta-t-il, n’est-ce pas ce que vous appelez, en
France, des demoiselles ? — Presque toujours, surtout quand elles sont jolies.
— Ainsi la fille d’un duc et pair et celle de son cordonnier sont deux demoiselles.
Cela est pitoyable. — Je le sais bien ; mais dans les pays de servitude,
on court après les distinctions. Quand elles sont établies, il faut s’y soumettre.
« Je parlerai
de cela à Paris, quand j’y retournerai. »
André
avait fini, et soumit son calcul au ministre. Celui-ci le vérifia, se leva,
prit la main du calculateur, et la lui serra de
manière
à le faire crier : rectè, optimè, mirificè, exclamavit doctor.
Cet
homme-là était infatigable. Il voulut nous faire connaître le gouvernement
des divers cantons, qui tous sont libres, mais dont le mode d’administration
diffère à certains égards. Oh, ma foi, je n’y pus tenir plus longtemps. Je
le remerciai, assez poliment, de sa complaisance ; mais je lui déclarai
que je n’avais pas la tête assez forte pour soutenir une conversation scientifique,
pendant trois heures. J’avouai, modestement, que l’objet principal de ma
visite était de lui demander des renseignemens certains sur les chamois,
et sur les hommes déterminés qui les chassent.
« Rien
de plus facile, Messieurs. Dans ma première jeunesse, j’ai vu de près les
uns et les autres. J’ai même quelquefois porté le havresac d’un chasseur
de mes amis ; mais jusqu’au point d’élévation où une chute ne pouvait être
dangereuse. » Voici le résumé de la dernière partie de notre conférence.
On trouve
deux sortes de chamois dans les Alpes. La petite espèce habite les Alpes
du Dauphiné. La forte race ne se tient que dans les grandes Alpes, au milieu
des glaciers. Son port est plus noble, sa tête plus belle, ses yeux plus
animés. Le chamois est un peu plus grand que la chèvre ; il a des cornes
comme elle, et il est beaucoup plus fort et plus agile. L’homme le plus vigoureux
ne pourrait arrêter, par ses jambes de derrière, un chamois de six semaines.
Il franchit d’un bond des distances étonnantes. Il atteint les sommets les
plus escarpés ; il se précipite des roches les plus élevées, sans crainte,
et sans se faire le moindre mal. Il vit en société avec les bouquetins, ou
boucs et chèvres sauvages.
Il
connaît l’homme, le craint, et l’évite avec intelligence. Ces animaux se
rassemblent assez ordinairement dans les passages qui tournent ; ils ne manquent
pas de placer des surveillans aux angles. Ils paissent alors en sûreté ;
mais à un signal donné, à une espèce de sifflement, la troupe fuit, se disperse,
et disparaît. Ces animaux emploient la même tactique pour échapper aux ours,
qui ne sont pas rares dans les Alpes.
La chasse
du chamois occupe un certain nombre d’habitans, quoiqu’elle soit très-périlleuse.
Il faut suivre l’animal, de rochers eu rochers, presque tous bordés de précipices.
L’animal s’échappe souvent, en parcourant des abîmes que l’œil de l’homme
ne mesure qu’avec effroi. Il apprécie les distances, et quelquefois il attend
le chasseur jusqu’à ce qu’il le voie prêt à le tirer. Il s’élance alors sur
des pieds, qui paraissent élastiques, et trompe l’espoir de son ennemi par
sa vélocité.
Le chasseur
ne se décourage pas. Il suit la bête, lentement ; il raisonne sa marche,
et tâche de prendre le dessus du vent, pour que le bruit qu’il fait nécessairement
et les émanations qui s’échappent de son corps, n’avertissent pas le chamois
du danger, auquel il va être exposé. Malgré ces précautions, l’animal brave
souvent le chasseur, s’il est retenu par des rochers tout-à-fait inaccessibles
pour lui. Alors il s’arrête, le chasseur tire, et s’il manque le but, il
tâche d’effrayer le chamois, pour l’obliger à se précipiter. Mais s’il juge
que la profondeur de l’abîme lui ôte tout espoir de salut, il refuse de reculer,
et ses cornes menacent le chasseur de le précipiter lui- même. On en a vu
s’élancer sur l’homme, pour s’en délivrer, au risque de mourir avec lui.
Souvent
le chasseur périt en suivant la proie qui lui échappe. Un brouillard épais
l’égare dans les glaciers, et il y meurt de
froid
et de faim. Des orages, des pluies, rendent la surface des roches si glissante,
que des souliers ferrés ne peuvent s’y attacher. Le malheureux, voit, pendant
quelques secondes, la mort inévitable, et il la subit.
L’été,
la chaleur lui dessèche tellement le visage et les mains, qu’il est forcé,
pour les humecter, de tirer son propre sang de ses jambes et de ses pieds.
Un autre danger l’attend sur les glaciers qu’il est obligé de traverser.
Le soleil frappe sur ces immenses miroirs, et convertit en diamans, la multitude
de pointes dont ils sont couverts. Des gerbes de feu frappent les yeux du
chasseur, et le privent de la vue pendant plusieurs jours.
Ces
chasseurs semblent avoir renoncé à toutes les douceurs de la vie. Ils partent
de chez eux, pendant la nuit, et arrivent au point du jour sur les pâturages
les plus élevés, où le chamois vient paître, avant qu’on y conduise les troupeaux.
Il regarde soigneusement autour de lui, et s’il ne voit rien, il poursuit
sa marche. Une journée perdue ne le fait pas désespérer du lendemain. Il
reste dans les montagnes ; il y vit de pain et d’eau. Le soir, il s’enveloppe
dans un sac de peau, pour ne pas être gelé pendant la nuit, et un quartier
de roche est son oreiller.
Mais
le lendemain, si la fortune parait vouloir le favoriser, sa gaité et ses
forces renaissent. Il a aperçu sa proie ; il la tourne, et fait les plus
grands efforts pour se placer au-dessus d’elle. Dès qu’il distingue les cornes
du chamois, il est sûr de le tenir à la portée du mousquet. Il ajuste,
il tire, et presque toujours la balle perce son innocente victime. Il court
sur elle, et l’emporte pour nourrir sa famille, surtout si le chamois est
jeune. Quelquefois l’éloignement, ou les difficultés de la marche l’empêchent
de se charger de sa proie. Il se borne,
malgré
lui, à enlever sa peau et les cornes de la tête et des pieds. Ces objets
se vendent avec avantage.
Ainsi
ces hommes passent la plus grande partie de leur vie à courir de rochers
en rochers, aux pointes desquels ils restent quelquefois accrochés par leurs
mains, jusqu’à ce que l’épuisement de leurs forces les condamne à se laisser
aller dans l’abîme. Ils traversent des réservoirs immenses de neige, sans
savoir s’ils arriveront à l’autre bord, ou s’ils seront engloutis. Ils passent
quelquefois plusieurs jours de suite dans ces déserts, dont la nature avait
interdit l’accès à l’homme. Leurs femmes, leurs enfans les attendent dans
des alarmes, qui éloignent d’eux le sommeil. Il en est qui ne reviennent
jamais.
Malgré
tant de périls et de peines, cette chasse devient une passion insurmontable,
pour ceux qui s’y livrent. Les prières, les supplications, les larmes de
ceux qui leur sont chers ne peuvent les arrêter. Qui peut alimenter cette
inconcevable fureur ? la cupidité ? le plus beau chamois se vend à peine
un écu d’argent, et, pour le gagner, le chasseur a vingt fois exposé sa vie.
Ce délire ne naîtrait-il pas d’une agitation continuelle ; des alternatives
d’espérance et de crainte ; d’un exercice violent et soutenu, qui finissent
par faire voir au chasseur une étroite prison dans sa chaumière ? N’est-ce
pas l’assemblage de toutes ces sensations, qui forme le soldat et le navigateur
?
On reconnaît
facilement ceux qui ont vieilli dans ce genre de vie, et ils ne sont pas
nombreux. Leur démarche, leurs manières sont sauvages. La peau de leur figure
est desséchée. Ils ont l’œil hagard, et le regard farouche. Des jeunes gens,
que cet extérieur repoussant n’éloigne pas d’eux, les accompagnent, deviennent
leurs élèves, et plus tard, leurs émules. Si cette fureur n’est pas bientôt
réprimée, la race des chamois sera rayée du livre de la
vie,
comme l’ont été tant d’espèces, que l’homme a sacrifiées à son avarice ou
à sa sûreté.
Le récit
du pasteur nous avait fortement intéressés. Mais je m’écriai, lorsqu’il eut
fini, que jamais je ne serais un chasseur de chamois. Ni moi, parbleu, dit
André.
Il était
tard, et M. Werner nous engagea à souper avec lui. Il aimait à parler, et
il n’eût pas manqué de revenir au gouvernement des treize cantons. Je trouvai
que la journée avait été remplie. D’ailleurs, je ne me souciais pas de rester
plus long-temps avec de petites filles, dont on ne pouvait voir que le bout
du nez. Nous remerciâmes le docteur de son offre obligeante, et nous prîmes
congé de lui.
Nous
vécûmes là, comme à Habmen, c’est-à-dire que nous ne dépensâmes rien. Nous
partîmes le lendemain, résolus à faire une journée complète. Nous n’avions
de conférence à demander à personne, les chemins étaient assez bons, et rien
ne semblait devoir nous arrêter; mais l’homme est, pendant toute sa vie,
le très-humble serviteur des circonstances. Nous entendîmes bientôt un bruit
de tambours et de fifres. Un moment après, nous reconnûmes une troupe nombreuse
qui s’avançait vers nous. Fort heureusement nous étions sortis des gorges
de Faulhorn, et nous pûmes laisser un passage convenable aux héros helvétiques.
C’étaient
trois mille Suisses des cantons de Lucerne, d’Underwalden, d’Uric, de Zug
et de Glaris, qui s’étaient vendus à Mayenne, et qui l’allaient joindre,
en suivant la route que nous avions prise. Le roi de Navarre en avait à son
service. Ainsi des gens d’une même nation, allaient se battre, les uns contre
les autres, pour un peu d’argent. Cette idée m’attrista.
Elle
ôta quelque chose à la grande estime que j’avais vouée aux Suisses.
Un paysan
d’un village voisin nous avait instruits de la destination de ceux-ci, en
les regardant défiler avec nous ; on sent bien que Gott était toujours notre
intermédiaire, et cependant nous commencions à entrevoir l’époque où nous
pourrions nous passer d’elle. Je lui dis de faire part à cet homme des réflexions
qui m’agitaient. « Une grande partie de la Suisse, répondit-il, est stérile,
et les pauvres font beaucoup d’enfans. Depuis long-temps les récoltes ne
sont plus en proportion avec la population. Il faut donc, de loin en loin,
provoquer des émigrations. Lequel est le plus avantageux, pour un État, d’expédier,
à grands frais, des colonies pour l’Amérique, ou d’envoyer à l’école de la
guerre, chez ses voisins, les citoyens qu’il ne peut nourrir ? La Suisse
n’est pas assez riche pour prendre le premier parti, et elle tire de l’argent
du second.
« Ceux
qui échappent aux dangers de la guerre, rentrent, tôt ou tard, dans leurs
foyers, et ce sont des soldats sur lesquels nous pouvons compter, si on nous
attaque. — Mais ceux qui tombent sous le fer ennemi ? — Ils sont allés au
feu gaîment, et ils ont perdu la faculté de se plaindre. D’ailleurs, combien
revient-il d’Espagnols, de ceux qu’on envoie au Mexique et au Pérou ? Les
tempêtes, l’insalubrité du climat, les Portugais en détruisent le plus grand
nombre. Ainsi, tout est compensé. »
C’était
un paysan du village de Scheidegg qui s’exprimait ainsi ! Je lui dis que
Philippe II avait envahi le Portugal. Il me répondit que les Portugais des
deux Indes ne l’avaient pas encore reconnu. Nouveau sujet d’étonnement. À
quelle école les paysans suisses envoient-ils donc leurs enfans ? Ce n’est
pas
à celle des jésuites, ni des Franciscains, puisqu’ils n’en ont pas. De simples
magisters de village, instruisent leurs élèves, et développent leur raison
et leur jugement. Au reste, il ne faut pas croire que les paysans, tels que
celui que nous venions de rencontrer, soient communs en Helvétie. La nature
départ ses dons avec inégalité. Partout on trouve des géans et des nains.
Nous
entrâmes, le quatrième jour, dans le canton d’Uri, sans avoir eu de tonnerre
et sans avoir rencontré de baumes. J’entendais très-bien ce que me disaient
les yeux de la petite. Les miens lui répondaient : que voulez-vous que j’y
fasse ?
Nous
allions entrer dans la vallée de Goschenen. À peu de distance de la route
était une cabane, couverte en chaume. Une chèvre était sur le toit ; elle
cherchait, à travers les brins de paille, quelque chose qui pût lui convenir.
Cinq à six poules grattaient et becquetaient autour de la maison. Un vieillard
et sa femme étaient assis, devant la porte, sur une même bancelle. Le bon
vieux avait un bras passé autour de sa femme, et il la pressait contre lui.
Son autre main soutenait sa tête, inclinée vers sa poitrine. Sa femme, très-âgée
aussi, tournait, vers le ciel, des yeux mouillés de larmes; elle les portait
souvent sur la route par où nous arrivions, et elle ne nous voyait pas.
« Elle
pleure, s’écria Marianne ! » Elle sauta à terre, et courut à la bonne femme.
Marianne a un bon cœur, pensai-je, et ses qualités peuvent rendre excusable.
« Les femmes, dit André, contractent de bonne heure l’habitude de souffrir,
et il est rare que la douleur physique leur arrache des m larmes. Ces bonnes
gens sont plongés dans l’affliction. » Je descendis. Gott marcha sur mes
pas.

Chasseur
de chamois, par Pingret, 1825
«
Demandez-leur, lui dis-je, comment, dans un pays dont les mœurs sont si douces,
il ne se trouve personne qui cherche à les consoler, ou qui, du moins, partage
leur douleur. Il est des maux, répondit Wenta, sur lesquels les consolations
ne peuvent rien. » Nous la pressâmes de s’expliquer.
Il y
a cinquante ans, elle épousa Makleer, et jamais aucun nuage ne s’éleva entre
eux. Une fille fut l’unique fruit de leurs amours, et ils la marièrent selon
son cœur. Ludger, le mari de Fauste, était fort et courageux. Un ours attaquait
les bestiaux dans nos montagnes. Deux bergers avaient voulu les défendre,
et avaient perdu la vie. Personne n’osait plus conduire les troupeaux aux
pâturages ; on osait, moins encore, combattre l’animal vorace.
Un matin,
Ludger embrassa sa femme, plus tendrement, plus longtemps que de coutume.
Il sortit de la cabane, sans dire un mot à aucun de nous. Il se retourna,
plusieurs fois, pour nous regarder encore. Il partit ; il s’était dévoué.
Nous
le crûmes livré à son travail de chaque jour, et chaque jour amenait son
pain. Le soleil annonçait l’heure du repas, et Ludger ne rentrait pas. Fauste,
fatiguée de regarder sur la route qu’il suivait d’ordinaire, courut au petit
champ qu’il cultivait. Ludger n’y était pas.
Elle
rentra éplorée, et se jeta dans mes bras. Mon bon Makleer regarda derrière
un bahut, où il mettait son mousquet. L’arme n’y était plus. Sans doute,
il était allé la cacher, la veille, dans quelques broussailles. Nous nous
regardâmes tous les trois. Fauste et moi nous pleurions. Makleer, l’œil sec
et menaçant, prit sa pique. « Ne vous exposez pas, mon père, s’écria
Fauste.
» Et cependant elle le laissa partir. Pauvre jeune femme ! moi, je
ne fus pas assez forte pour le retenir.
La journée
s’écoulait. Deux heures encore, et la nuit allait nous ôter notre dernière
espérance. Nous avions pleuré ensemble, il nous sembla que la peur nous avait
rendu des forces. Nous voulûmes monter jusqu’aux glaciers. Nous fûmes obligés
de nous asseoir à quelques pas de la cabane. Nous étions dans un état à
faire pitié.
Nous
regardions sans cesse cette montagne, où nous avions perdu, peut-être, tout
ce qui nous liait à la vie. Un homme parut, dans le lointain ; il venait
à nous. Sa marche était rapide, et il faisait tourner un long bâton autour
de sa tête. Il portait un pesant fardeau. « C’est Makleer, nous écriâmes-nous
toutes deux. Il rapporte Ludger ; le malheureux est blessé. »
Dans
un moment il fut auprès de nous. « Nous n’avons plus de fils, me dit-il.
Tu as tout perdu, dit-il à Fauste. » Il jeta à terre ce qu’il portait. «
Voilà la peau de la bête farouche. J’ai vengé Ludger ; mais nous ne le verrons
plus. »
Il avait
trouvé son corps en pièces, et son arme déchargée Il avait manqué l’ours,
ou l’avait tiré de trop loin. Sans doute, il n’avait pas eu le temps de recharger
son mousquet.
Makleer
déposa ces lambeaux sanglans dans un creux de rocher, et il alla chercher
la bête. Il ne fut pas obligé d’aller loin. L’ours se présenta à lui, la
gueule ouverte et enflammée. La colère ne lui ôta pas son jugement et son
adresse. Il attendit l’animal, de pied terme, et lui enfonça sa pique dans
la gueule. La pointe sortit par le flanc.
Makleer
abandonna son arme, et laissa l’animal se débattre. Ses griffes de devant
brisèrent la partie du bâton qui sortait de la tête ; mais la blessure était
mortelle. Pourquoi le brave homme n’a-t-il pas eu le courage d’aller, la
veille, combattre l’ours ? Ludger vivrait encore ; mais il ne se doutait
pas que son fils pensait à l’aller attaquer. Il y a vingt ans de cela, et
cette peau nous a toujours servi de lit. C’est là que, tous les matins et
tous les soirs, nous prions pour nos pauvres enfans.
Fauste
était prête d’accoucher, quand ce triste événement arriva. Tous les paysans
des environs étaient accourus pour remercier Makleer, et lui offrir du gruau
et du fromage. Ils reçurent dans leurs bras l’enfant, à qui notre fille donna
le jour. La triste mère mourut huit jours après son mari.
Nous
restâmes seuls avec un enfant nouveau-né, que je ne pouvais allaiter. Le
chagrin nous consumait. M. le curé vint nous voir. Il nous redonna de l’espérance,
et nous rendit du courage. Il nous détermina à vivre, pour le faible enfant,
qui pouvait seul nous consoler de ce que nous avions perdu.
Nous
avions une chèvre, jeune, bien blanche, et bien douce. Elle fut la nourrice
de Joseph. Makleer n’avait que cinquante ans ; il travaillait, et nous vivions.
Joseph grandissait ; il promettait d’être beau comme sa mère, et fort comme
son père. Chacun riait de ses petits contes, et disait qu’il aurait de l’esprit.
M. le
curé se plaisait à l’instruire, parce qu’il avait des dispositions.
Ce joli
enfant sentit bientôt que son grand-père vieillissait, et qu’il avait besoin
d’aide. Il faisait tout ce que nous pouvions attendre de ses petites forces,
et il était content, quand il avait
épargné
une goutte de sueur à son père. Nous ne vivions plus qu’en lui.
Notre
voisin Werdaff, sa chaumière est là, voyez-vous? Notre voisin a une belle
petite fille, plus jeune que Joseph de quatre ans. Ces enfans semblaient
ne se chercher jamais, et se rencontraient toujours. Ils s’aimaient, ils
se le disaient, et nous en étions bien aises.
Le voisin
a deux vaches, et nous n’en avons qu’une ; quatre chèvres, et nous deux ;
une prairie, et nous n’avons pas un coin de terre en propre. Werdaff, simple
et modeste comme nous, comme tous les bons Suisses, disait que bons bras
valent richesse, et que nos enfans feraient un bien joli couple.
Le dimanche,
ils allaient à la messe, bras dessus bras dessous. Nous les suivions, d’un
peu loin, et nous riions de petites agaceries qu’ils se faisaient. À la fin
de l’office, M. le curé fait mettre les enfans en rond, et ils répètent leur
catéchisme. Il interrogeait toujours Joseph le dernier, parce qu’il répondait
mieux que les autres, et que le bon pasteur aime à faire valoir sa brebis
favorite.
En sortant
de l’église, Guite et Joseph partageaient les petits jeux des enfans de leur
âge. Ils jouaient, fort bien au cercle, et aux œufs. Guite tâchait de gagner
pour plaire à Joseph. Joseph ne voulait devenir le plus adroit, que pour
plaire à Guite.
Les
années, qui manquaient à ces enfans, arrivaient comme celles que nous avons
de trop, et on parla tout de bon de les marier. Les conditions furent bientôt
réglées. Nous nous promîmes de vivre tous ensemble, et de mettre en commun
le
peu
que nous avions. Un mois encore, et ces chers enfans allaient être
contens.
Un chasseur
de chamois fit croire à Joseph que la vie qu’il menait était celle de nos
anciens, qui mouraient sur les rochers, et qui écrasaient, avec des quartiers
de pierres, toute une armée de Bourguignons. Sont-ce ceux qui vivent dans
les plaines, lui dit-il, lui feraient de pareilles choses, si nous étions
attaqués ? Il ajouta que les filles aiment les garçons qui montrent du courage,
et Joseph le suivit.

Le
départ du chasseur de chamois (gravure allemande)
Werdaff
le sut, et nous déclara que tout était rompu. Il se tuera, nous dit-il. Guite
peut vivre comme elle est. Que fera-t- elle, si Joseph lui laisse deux ou
trois enfans ?
Nous
le grondâmes bien fort quand il rentra. Il courut chez le voisin, et trouva
Guite en pleurs. Il leur promit à tous deux de ne plus aller à la chasse
aux chamois. Le père et la fille s’apaisèrent, et le jour des noces fut convenu,
pour la deuxième fois.
Deux
jours avant, le chasseur lui dit qu’un chamois rendrait le repas de noce
bien beau ; qu’il fallait seulement qu’on ne sût pas qui l’avait tué ; que
cela était facile à cacher, et il l’entraîna. Mais le voisin le guettait.
Il lui dit, quand il revint, qu’un bon Suisse ne manque pas à sa parole,
et qu’il ne serait jamais son fils. Guite pleura encore ; Joseph se désespéra.
Nous lui donnâmes des consolations. Mais console-t-on un jeune garçon qui
perd son amie ? Il parut tranquille, et il nous trompait.
Ce matin,
trois mille Suisses ont passé par ici : vous devez les avoir rencontrés.
Joseph nous dit qu’il allait se joindre à eux, et il nous embrassa tendrement.
Je pleurais sur ses mains que je pressais ; son père a fait tous ses efforts
pour le retenir ; il s’est échappé de nos bras. J’ai fait un paquet de ses
hardes ; je n’y ai pas mis d’argent : nous n’en avons pas, et j’ai couru
après l’ingrat. Il était déjà loin.
Je suis
revenue ici, la mort dans l’âme. Mon bon homme et moi nous sommes tombés
sur cette bancelle, et nous y sommes restés, sans mouvement. Voyez-vous cette
roche blanche, là- bas, au loin, à droite ? c’est là qu’il a disparu. Elle
est moins dure que son cœur.
Il nous
abandonne, et nous avons déjà un pied dans la tombe. Makleer ne peut plus
travailler. Qui nous nourrira, pendant le peu de jours que nous avons encore
à vivre ?
«
Ce sera moi, m’écriai-je. André, mon cher André, mon associé et mon ami,
dis-moi, qu’allons-nous faire ? — Hé, parbleu, un mariage. Nous avons bien
plus d’argent qu’il n’en faut pour être riches en Suisse. Emportons des bénédictions
du canton d’Uri. » Oh, comme je l’embrassai ! Marianne, l’œil humide, lui
baisait les mains. Le bien qu’on se promet de faire est déjà une jouissance.
Nous
prîmes de l’or dans nos escarcelles ; nous fîmes mettre un second mulet à
un de nos chariots, et nous courûmes après la colonne. Nous la joignîmes
bientôt. Le commandant était un franc et loyal Suisse. Quand nous lui eûmes
demandé à quel prix il mettait la liberté de Joseph, il nous répondit qu’il
n’était pas porté sur ses contrôles ; qu’il ne pouvait servir que comme volontaire,
et, qu’il se retirerait quand il le voudrait. « À merveilles, dit André,
avec cet argent-là ils auront des vaches, et des chèvres de plus. »
Nous
priâmes l’officier de nous désigner Joseph. Sa taille était belle, et sa
figure charmante. Je lui dis que nous allions le ramener avec nous. Ce jeune
entêté nous répondit qu’un Suisse, qui a pris son parti, ne revient jamais.
« Tu ne sais ce que tu dis, répliqua André. N’avais-tu pas pris le parti
d’épouser Guite ?
-
Ce n’est pas moi qui ai manqué à ma parole.
— Tu l’épouseras aujourd’hui, et, ce soir, la peau d’ours vous recevra tous
deux. — Ah !... ah !... se peut-il ?... dois-je croire?.... ah !... ah !...
— Finis tes ah ; monte dans notre voiture, et reviens avec nous. —
Mais, est-il bien il vrai… — Nous sommes francs comme des Suisses. Et puis,
si nous te trompions, ne serait-il pas encore temps de te faire soldat ?
» Il monta. —« Tes bans ont été publiés, n’est-ce pas ? — Ils l’ont été deux
fois. — C’est assez pour se marier une. Ah, ça, plus de chasse aux chamois.
-
Je le promets. — Tu le jureras sur l’Evangile.
— De tout mon cœur. — Tu sais ce qui attend ceux qui violent un serment prononcé
sur le livre saint ? — La damnation éternelle. — Hé bien, prends y garde.
»
Nous
le ramenâmes en triomphe. Quand nous approchâmes de la cabane, Bertrand fit
sonner son cornet-à-bouquin, et cria de toutes ses forces, en allemand :
Le voilà, le voilà ! Il paraît que Gott lui donne des leçons particulières.
Cela promet.
Nous
sautâmes tous à terre. Nous trouvâmes Makleer et Wenta dans la position où
nous les avions laissés. Une jeune fille, jolie comme les Amours, était assise
entre les deux vieillards, et pleurait avec eux. Tous trois ouvrirent leurs
bras à Joseph, qui s’y précipita. Les larmes séchèrent à l’instant. Le calme
et le bonheur reparurent sur ces figures, qu’allait sillonner la douleur.
Regarde-la, regarde-la, dit André, et dis- moi, si cette fille-là ne vaut
pas tous les chamois des Alpes. »
On s’expliqua.
La bonne femme tomba à nos pieds. Le vieillard nous serra dans ses bras.
Guite prit la main de Joseph. Ils se regardaient!... ils se regardaient,
comme des malheureux condamnés à un long supplice, et à qui on vient de faire
grâce. Ils nous embrassèrent à leur tour. Ah, si le duc de Guise eût eu la
moindre idée du bonheur que nous éprouvions, il n’eût pas désolé la France,
et il vivrait encore.
Guite
s’échappa en répétant : Il jurera sur l’Évangile ! Il était facile de deviner
où elle allait.
Il était
temps de déjeûner. « Bertrand, arrange-nous cela. » Une table, vieille, mais
propre, fut tirée de la maison. La journée était toute à la vie. Nous ne
voulûmes pas perdre de vue
son
auteur, et le soleil d’octobre n’est pas brûlant. Il pouvait encore ranimer
les deux vieillards.
Nous
nous mîmes tous à table. « Où donc est Joseph? Ah, dit la bonne mère, en
riant, il est où est Guite. »
Ils
étaient partis deux ; ils revinrent trois. Le père Werdaff nous salua, nous
embrassa à son tour, et nous bénit. Ces hommages-là partent du cœur. Ils
sont doux pour ceux qui les reçoivent, quand ils sont mérités.
Nous
déjeûnions gaîment ; la bonne vieille avait pris, sur ses genoux, Toinon
et Toinette, pour que Marianne et Claire fussent à leur aise. Elle regardait
les deux enfans d’un air attendri. « Ils seront beaux, dit-elle, comme Guite
et Joseph, et ils auront un cœur, comme eux. — Ah, mon cher André, quel trait
de lumière ! — J’ai déjà eu cette idée-là, Monsieur. Mais il ne convenait
pas que j’en parlasse le premier. »
Les
bonnes gens ne savaient pas encore tout. À la fin du déjeuner, je mis sur
la table trente pistoles en or. « Voilà, dis-je, de quoi arrondir et peupler
la prairie du père Werdaff. » Ces bons paysans n’avaient jamais vu d’or.
Ils étaient penchés sur la table, et ils regardaient nos pistoles d’un air
émerveillé. Ils n’osaient y toucher. J’en mis quinze dans les mains de Joseph,
et quinze dans celles de Guite.
Les
papas trouvaient notre vin du Rhône excellent. « Ne perdons point de temps,
leur dit André. Il y a long-temps que nous n’avons été à la messe ; nous
en entendrons une aujourd’hui. Que chacun prenne ses habits des dimanches,
et nous irons trouver M. le curé. Bertrand, déchargeons le magasin. Nous
n’aurons pas trop de nos quatre chariots pour
placer
tout notre monde, et donner une certaine tournure aux gens de la noce. »
Guite et son père étaient déjà loin. Nous quittâmes nos habits de vachers,
et nous primes le costume décent.
Le père
et la tille revinrent bientôt. En effet, la toilette de Guite n’avait pas
demandé beaucoup de temps. Une chemise blanche, et des souliers neufs étaient
ce que ce changement offrait de plus remarquable ; mais elle était parée
de ses dix- sept ans.
Les femmes
n’ont le nécessaire qu’avec un peu de superflu. Claire et Marianne avaient
en réserve quelques aunes de ruban prises chez Luker. Elles s’exécutèrent
de très-bonne grâce. Pendant que Claire couvrit de nœuds le corset, un
peu sec, de Guite, et en garnit le bas de son jupon, Marianne arrangeait
ses cheveux, avec goût, avec grâce. La petite était enchantée ; Joseph
la dévorait des yeux ; jamais il ne l’avait vue aussi belle.
Bertrand
demanda un bout de ruban, pour mettre au bout du manche de son fouet, et
un autre pour passer à sa boutonnière. Cela était de rigueur.
Nous
entrâmes dans le village, avec une pompe qu’on ne connaissait pas dans le
pays. Les habitans accouraient de tous les côtés, et Werdaff leur criait
: « Il va jurer sur l’Évangile. »
Nous
descendîmes chez le curé. C’était un homme simple et bon, qui ne parlait
jamais de politique, parce que les prêtres, disait-il, ne sont pas institués
pour gouverner, mais pour prier. Il écoutait les pénitens au confessionnal,
et ne les interrogeait jamais. Il n’entrait dans les querelles de ménage,
que pour réconcilier les époux. Il visitait les malades, et les consolait.
Il
donnait
à tous l’exemple des bonnes mœurs. L’évêque de Limoges, et bien d’autres,
devraient aller à l’école de cet homme-là.
Nous
lui racontâmes ce qui s’était passé, et nous le priâmes d’unir nos jeunes
gens. Notre demande lui parut juste. Nous partîmes tous ensemble, pour nous
rendre à l’église. Elle fut pleine de curieux, en un moment.
Le curé
parut bientôt dans ses habits sacerdotaux. Il portait le livre des Évangiles,
ouvert sur ses deux mains. Il fit approcher Joseph, et reçut son serment
dans les formes usitées. Il adressa ensuite une exhortation énergique à ceux
qui arrachent les jeunes gens à des travaux paisibles et utiles, pour les
traîner dans des montagnes, où les attendent des dangers, sans cesse renaissans,
et quelquefois la mort. Le chasseur de chamois était dans l’église. Il s’approcha
d’un air contrit, mit la main sur l’Évangile, et jura à son tour. La figure
du bon curé était rayonnante : il venait de faire deux conversions.
Il prononça
le ego vos conjungo, si désiré par quelques-uns, si regretté par d’autres,
et il célébra une messe, que nous entendîmes tous dans un profond recueillement.
Nous
engageâmes, André et moi, le bon curé à honorer de sa présence le repas de
noces. Nous le priâmes de ne pas s’arrêter à l’exiguïté d’une cabane, où
tout était de la plus grande modestie. « Je vais partout, nous dit-il, quand
mes paroissiens sont dans la peine. Pourquoi ne partagerais-je pas la joie
qui va parer cette chaumière ? »

Le
Pont du Diable au canton d’Uri (gravure anglaise de 1773)
CHAPITRE
XXXI.
Noces
de Joseph. Statistique du canton d’Uri.
Nous
fîmes monter le bon curé dans le plus propre de nos chariots. André et moi
le plaçâmes entre nous deux, et le cortège se mit en route. Les jeunes garçons,
les jeunes filles du village nous accompagnaient, et faisaient retentir l’air
de leurs acclamations. « Il a juré, ils ont juré, disaient-ils, et nous jurons
aussi. » Et la jeune fille, craintive sur l’avenir de son tendre ami, se
rassurait, et l’embrassait avec toute la franchise des bons paysans suisses.
Ainsi les chamois des montagnes voisines vont vivre en paix, et multiplier
avec sécurité. Ainsi les habitudes des hommes de la vallée de Goschenen furent
changées en un instant, parce que l’un d’eux s’était fait soldat.
Les
provisions réunies des deux familles se bornaient à bien peu de chose. Nous
avions donné à déjeuner ; le diner fut tiré encore de notre garde-manger.
Il n’y
avait pas là un être qui ne fut satisfait, ou du bien qu’il éprouvait, ou
de celui qu’il avait fait. Le contentement, je le répète, produit la gaité,
et il ne s’échappa pas un mot qui pût déplaire au bon pasteur : il est un
tact des bienséances que les hommes semblent saisir aussitôt que leurs idées
commencent à se développer. Peut-être aussi apprenons-nous, par l’exemple,
ce
que nous devons d’égards à ceux pour qui en ont nos parens : les enfans sont
imitateurs.
Le curé
trouvait notre vin du Rhône très-bon, et il en but… avec modération. Nos
autres convives se ménagèrent moins. La vieille mère, placée entre son fils
et sa bru, les embrassait à chaque instant. On se lasse de tout, même de
caresser les objets les plus chers. Elle commença à chanter, d’une voix chevrotante,
la romance de Granson, et celle de Morat. A la fin de chaque couplet, tous
les convives faisaient chorus, avec enthousiasme. Le bon vin et l’amour de
la liberté commençaient à échauffer les têtes, et si un nouveau duc de Bourgogne
eût paru dans la vallée, Werdaff, Makleer et Joseph n’eussent pas manqué
de l’aller attaquer. Je crois, en vérité, que je me serais mis de la partie.
Marianne
ne manquait pas d’amour-propre, et quelques verres de vin lui avaient donné
de la confiance. Elle a vraiment une jolie voix ; mais elle s’avisa de commencer
la complainte de la Saint-Barthélemy ; peut-être ne savait-elle pas d’autres
chansons. Dès le troisième couplet, le curé l’arrêta.
« Mademoiselle,
lui dit-il, je sais que ce triste événement a été célébré à Rome par des
processions, et des salves d’artillerie. Nous avons le plus profond respect
pour notre saint père le pape ; mais nous ne le croyons infaillible que lorsqu’il
est à la tête d’un concile. Nous ne voyons, dans les réformés, que des chrétiens
comme nous, et nous disons anathème à ceux qui les persécutent. C’est à Dieu
seul qu’il appartient de les juger. » Je crois, en vérité, que ce curé-là
convertirait les ligueurs, s’il était à Paris.
Marianne
rougit, et me regarda. Mes traits exprimaient sans doute du mécontentement.
Elle baissa les yeux, et ne dit plus un
mot.
Je viens de le dire : les têtes commençaient à s’échauffer, et le curé s’en
aperçut. Il se leva, et il prit les mains de Joseph et de Guite. « Soyez
heureux, leur dit-il, et puissiez-vous vivre long-temps avec les enfans que
le ciel vous donnera. Joseph, si vous avez un goût prononcé pour la chasse,
chassez les marmottes ; ce plaisir-là ne vous exposera pas. Je vais souvent,
le vendredi, chercher un terrier, et quelquefois j’y trouve ma provision
du dimanche. Venez me prendre ; nous nous amuserons ensemble, et je répondrai
de vous à vos parens. »
Il se
retira et je le suivis. Je n’avais jamais entendu parler de la chasse aux
marmottes, et je ne me doutais pas qu’on pût les manger. J’aime à me mettre
les idées neuves dans la tête, et j’interrogeais le bon curé. Il n’était
pas verbeux, et son latin n’était pas très-correct. Cependant je recueillis,
à peu près, les renseignemens que je désirais obtenir.
Nous
avons tous vu des marmottes, et nous croyons que cet animal n’a pas à se
louer de la nature. Il tient, dans ses formes, de l’ours et du rat, qui ne
sont pas ce que nous connaissons de plus séduisant. Il est cependant très-vraisemblable,
plus que vraisemblable que la dame marmotte a beaucoup d’attraits pour celui
qui n’est pas mieux fait qu’elle.
Nous
savons encore que les petits savoyards nous assurent qu’elles dansent. Ce
mensonge innocent a pour objet d’obtenir du passant une petite pièce de monnaie.
Les talens de la marmotte se bornent à se lever, et à se tenir debout, soutenue,
par ses pattes de devant, sur le bâton de son jeune maître. C’est lui qui
danse pour elle, en chantant, en soulevant et en laissant retomber, verticalement,
son bâton en mesure.
Ce
que je ne savais pas, c’est que la marmotte est la véritable institutrice
des petits savoyards. Quand elle est libre, elle l’un de l’autre. Pour cela,
elle se cramponne avec les pattes, et se soutient avec le dos. Il est évident
que c’est d’elle que les Savoyards tiennent l’art utile de ramoner les grimpe
sur tous les objets qui se présentent. Elle se plait surtout à monter entre
deux parois de rochers, très-voisins cheminées ; mais ce qui n’est qu’utile
est peu considéré, et mal payé. Nous n’avons jamais vu de Savoyards caressés
par de belles dames, ni faire leur fortune.
L’homme
serait-il né ingrat ? Le petit savoyard tourmente la marmotte qu’il apporte
en France. Revenu dans ses montagnes, il poursuit ses institutrices à grands
coups de bâton. Il ne faut pas d’autres armes pour s’immortaliser à cette
chasse. Mais je m’aperçois que je ne suis pas méthodique ; j’ai parlé de
la marmotte civilisée, je devais commencer par peindre la marmotte de la
nature.
Le beau
sexe aime les petits chiens et les petits chats. Il dédaigne la marmotte,
qui a cependant, avec lui, un rapport, dont les hommes font le plus grand
cas : c’est une extrême propreté. Elle s’enterre, comme le lapin, et sa retraite
est meublée avec art. Elle est tapissée de foin, et d’une mousse fort épaisse.
Elles en font une ample provision, pendant l’été. Les unes coupent l’herbe
fine, les autres la rassemblent. Quelques- unes se mettent sur le dos, étendent
leurs pattes en l’air, et forment ainsi une espèce de charrette. Leurs compagnes
les chargent, et les traînent au terrier, par la queue. Si le fait est exact,
on conviendra que les marmottes sont aussi industrieuses que les castors.
La
chaleur de leur sang n’est qu’à dix degrés, et cependant elles vivent au
milieu des neiges et des frimas. Aussi, à l’approche de la mauvaise saison,
elles s’enferment dans leur domicile ; elles en bouchent la porte, avec tant
de solidité, qu’il est plus facile de percer la terre dans les alentours
que sur ce point. Là, elles sont dix à douze, roulées sur elles-mêmes comme
un chapelet qu’on mettrait en paquet.
Elles
n’ont porté chez elles aucune provision de bouche. La nature leur a appris
qu’elles n’en auront pas besoin. Elles dorment pendant tout l’hiver, et d’un
sommeil si profond, que souvent le chasseur les emporte chez lui sans les
éveiller. Elles sont très-grasses alors, et il en est qui pèsent jusqu’à
vingt livres. Leur chair, huileuse et musquée, est recherchée par les montagnards,
qui ne sont pas délicats. Leur graisse est un remède puissant contre les
douleurs rhumatismales. Leur peau a très-peu de valeur.
La douce
chaleur du soleil d’avril les réveille ; mais dans la plus grande maigreur
: leur graisse les a nourries pendant quatre ou cinq mois. Elles sortent
alors; mais elles s’éloignent peu de leur terrier. Pendant qu’elles broutent,
une d’elles est en vedette. Si celle-ci aperçoit un homme, un aigle, un chien,
elle en avertit la troupe par une espèce de sifflement. Elles se hâtent de
rentrer chez elles, et c’est la sentinelle qui ferme la marche Elles ne produisent
qu’une fois l’an, et leurs portées sont de quatre ou cinq petits. Celles
qui échappent à la persévérance du chasseur, vivent neuf à dix ans.
Nous
étions arrivés à la porte du presbytère. Le curé m’engagea à entrer. « Je
ne vous crois pas, me dit-il, bien pressé d’arriver à Appenzell. Le canton
d’Uri est digne de l’observation du voyageur, quoiqu’il soit très borné.
— Oui,
comme
votre village et ses chaumières. — Les maisons de nos paysans n’ont pas besoin
d’être grandes, parce qu’ils n’y sont guère que la nuit. Leur peu de solidité
vous étonne. C’est l’effet de l’habitude où vous êtes de vivre dans de belles
prisons de pierre, et dans des forteresses. Là, vous étiez dépendans de tout
ce qui voue entourait. Ces cabanes paraissent belles à ceux qui les habitent,
parce qu’ils n’ont rien vu de plus relevé, et qu’ils y sont libres. Si la
guerre s’allumait entre l’Allemagne et la Suisse, ils quitteraient, sans
regret, une habitation, qu’ils ont bâtie en quinze jours, pour se retirer
dans leurs forteresses. Les voilà, ce sont ces montagnes, qui font notre
force, et qui ont toujours été fatales à ceux qui sont venus nous attaquer.
« Je
vous répète l’invitation de ne pas sortir du canton d’Uri sans avoir vu ce
qu’il offre de remarquable : Altorf, lieu de la naissance de Guillaume Tell
; la chapelle que lui a élevée la reconnaissance nationale ; le Saint-Gothard,
la Reuss, le Saut- du-Moine, le Pont-du-Diable, et la vallée d’Ursern. »
Nous
nous quittâmes satisfaits l’un de l’autre, et je me hâtai de retourner chez
Makleer. J’entendis de loin le son d’une cornemuse, et je pressentis ce que
j’allais voir.
Les
jeunes garçons et les jeunes filles du village étaient venus féliciter Joseph
et Guite, ayant à leur tête le musicien du village, homme précieux, parce
qu’il était le seul qui pût les faire danser. Le curé ne leur interdisait
pas cet amusement, parce qu’il croyait que sauter n’est pas pécher, et que,
d’ailleurs, c’est à ces bals champêtres que se préparent les mariages.
On dansait
donc. Guite et Joseph se regardaient ! et ils sautaient comme s’ils n’avaient
eu rien de mieux à faire.

Costumes
du canton d’Uri, par Achille Dévéria, vers 1830
Marianne
s’était mêlée à ces jeux, et se faisait remarquer. Les petites filles paraissaient
contentes d’elle, parce qu’elle leur marquait de l’amitié, et que partout
les femmes aiment à être caressées. Les jeunes gens s’empressaient de lui
présenter leurs mains, bien propres et bien dures, parce qu’elle était jolie
et qu’elle dansait bien. La paisible Claire, assise sur un escabeau, un enfant
sur chacun de ses genoux, regardait ce riant tableau. Je pensai que peut-être
elle n’avait jamais dansé qu’avec André.
« À
propos d’André, où est-il donc ? » Marianne quitta son danseur, et vint me
dire, en me faisant une jolie petite révérence, qu’il était dans la maison.
J’y entrai.
Ici
le spectacle était changé. Werdaff, Makleer, et quelques vieillards, qui
étaient venus se joindre à eux, commençaient à chanceler. La grand’-mère
dormait dans un coin : elle n’avait pas la tête aussi forte qu’une bacchante
; Gott et Bertrand étaient fermes à table. Je ne voyais pas André. Il rentra
bientôt, avec une cruche de notre mauvais vin de Saint-Gingolph. Il avait
enlevé et mis en sûreté ce qui restait dans la chaumière de celui du Rhône.
« Dans l’état où les voilà, tout leur est bon. Je ne veux pas qu’ils épuisent
ce que nous avons de meilleur, et qu’ils nous laissent la picquette. — Supérieurement
vu, ami André. »
Je retournai
voir la danse. Marianne vint me prier de lui faire l’honneur de danser avec
elle. Le moyen de refuser Marianne ! Je n’avais dansé de ma vie, et je m’en
tirais mal, je le sentais. Les jeunes paysans se regardaient et souriaient
: « Donnez-vous une entorse, me dit Marianne, c’est le seul moyen de finir
tout cela. » Un homme qui a une entorse, a besoin d’un bras. Marianne me
donna le sien ; je boitai bien bas, et elle me conduisit, je ne sais où,
dans une touffe de verdure, que sans
doute
elle avait remarquée dans la journée. Quand nous fûmes là, je me dressai,
et complètement. Voyez où conduit une entorse !
Le jour
commençait à baisser, quand nous allâmes nous réunir à la troupe joyeuse.
On parlait de se retirer, pour pouvoir se livrer au travail le lendemain
de bonne heure. On proposa d’aller faire le lit des mariés. Les mariés ne
tenaient qu’au moment présent.
Nos
vieux Silènes avaient entièrement cédé à la force des fumées bachiques. Ils
étaient par terre, accrochés les uns aux autres, comme les marmottes dans
leur terrier. André avait promis, le matin, à Joseph, qu’il coucherait le
soir sur la peau d’ours, et Guite était disposée à trouver bons tous les
lits qu’elle partagerait selon son cœur.
Nous
avions été proclamés, André et moi, les garçons d’honneur de la fête.
Nous
enlevâmes la peau d’ours, et c’était tout ce que nous pouvions porter. Cet
ours-là était le géant des Alpes.
Le joueur
de cornemuse prit la tête du cortège. C’est le privilège des ménétriers,
ainsi que des tambours. Nous suivîmes tous l’instrument champêtre, en sautant.
Nous arrivâmes ainsi à la cabane de Werdaff. La porte était ouverte. Nous
avons déjà remarqué qu’on ne craint pas les voleurs en Suisse.
Un tas
de paille reçut la peau d’ours, et les jeunes filles la jonchèrent de fleurs.
Nous souhaitâmes une nuit heureuse aux mariés. On ne doit la souhaiter bonne
qu’à ceux qui ont besoin de dormir.

Chemin
sur le Saint-Gothard, par Édouard Pingret, 1825
«
Voilà une noce, me dit André, qui a singulièrement diminué nos provisions.
— Nous les renouvellerons. — Quand ? — Quand nous le pourrons. — En attendant,
nous mangerons du pain noir et du fromage. — Nous les trouverons bons en
pensant aux heureux que nous allons laisser derrière nous. »
Nous
allions partir. Les deux familles attendaient notre réveil, pour nous saluer,
nous remercier et nous bénir. « Ne trouves-tu pas, André, que le pain noir
commence déjà à blanchir ? »
Nous
aperçûmes bientôt le mont Saint-Gothard. Il est plus élevé, dit-on, que le
Mont-Blanc et le Simplon. Mais quand l’imagination a été frappée deux fois,
il est difficile qu’un objet de la même nature lui donne une troisième secousse.
Nous regardions ce mont sans éprouver de sensation réelle. André a entendu
dire qu’il est élevé de onze mille deux cent cinquante pieds au-dessus du
niveau de la mer. « Vois donc quelle énorme quantité d’eau a dû tomber, pendant
quarante jours, pour que la cime de cette prodigieuse montagne en ait été
couverte. C’est sans doute là que s’est reposée l’arche.
« —
Non, Monsieur, c’est, du moins je le crois, sur les montagnes d’Arménie.
— Et ces montagnes-là sont-elles comparables à celles-ci ? — Ma foi, je n’en
sais rien ; ce que je sais, c’est que cela est écrit. — Mais l’auteur du
livre sacré n’a- t-il pas pu se tromper, comme géographe seulement ? — Mais
je crois, en vérité, que vous devenez hérétique. — M’en préserve le ciel
! — Vous ne seriez pas le premier qu’on eût vu passer d’un extrême à un autre.
— Tâchons de tout concilier. As-tu appris le grec chez tes Jésuites
? Es-tu fort sur les racines? — Ah ! vous voulez me faire étymologiste
? Voyons, réfléchissons, examinons…. Hé parbleu, il existe une
analogie
frappante entre les deux mots Arménie et Gothard. On trouve des a et
des r dans l’un et dans l’autre.
« —
André, je crois que tu te moques de moi. — Mais ne m’en avez-vous pas donné
l’exemple avec vos racines grecques ? »
Un paysan,
qui passa là, mit fin à notre discussion. Nous l’interrogeâmes non sur les
étymologies, mais sur les phénomènes que présente le Saint-Gothard.
Nous
ne nous arrêtâmes pas à la nomenclature des pics qui environnent la montagne
principale, ni à celle des petites prairies que les bergers rencontrent sur
ses flancs. Ce qui nous étonna, c’est que ce mont est couronné de vingt-huit
petits lacs, qui ne gèlent jamais, et près desquels sont huit glaciers. C’est
là que sont les sources du Tésin, de la Reuss, du Rhône et du Rhin.
Des
Bénédictins ont pensé qu’il vaut mieux être utile aux hommes, que de passer
sa vie sur de vieux manuscrits. Ils ont délaissé leurs confrères, et ils
sont venus fonder un hospice sur un flanc très-élevé de la montagne. Ils
n’y connaissent pas l’abondance ; mais ils partagent ce qu’ils ont avec les
pauvres voyageurs. Ceux-ci sont sûrs d’être bien accueillis, et de trouver
de bons lits, du pain et du vin.
Quand
le bruit effrayant des avalanches se fait entendre, ces bons religieux sortent,
munis de longues perches, et suivis de forts chiens, dont l’odorat est sûr.
Ils sondent la neige, avec leurs perches, où les chiens s’arrêtent et grattent.
Souvent, à force de travail, ils retirent de ces abîmes des malheureux que
l’avalanche avait engloutis. Ils les chargent sur leurs épaules ;
ils
les portent à l’hospice, et ils leur prodiguent leurs soins. Bons et respectables
prêtres, qui ont renoncé à toutes les douceurs de la vie, pour la conserver
à d’autres !
Ils
ne demandent rien à personne. Mais les riches savent que l’hospice ne se
soutient que par des aumônes. Ils donnent pour eux et pour les pauvres. «
Ah ! nous écriâmes-nous simultanément, combien ces bons pères sont au-dessus
de nos Franciscains et de nos Jésuites ! » En effet, qu’avons-nous constamment
reconnu en eux ? L’esprit de parti, d’intrigue, et de domination.
Je me
souvins de Poitiers, de Poussanville et du père Guignard. Les opinions du
jésuite sur les rois, étaient loin d’être orthodoxes. Il avait oublié le
rendez à César ce qui appartient à César.
Nous
abandonnâmes les cimes pelées de ces montagnes, et les tristes forêts de
pins, qu’on découvre, de loin en loin, sur leurs flancs. Nous entrâmes dans
la vallée d’Ursern. Tout y est riant, animé, enchanteur. Tout y annonce l’aisance
et le bonheur.
La nature
se peint rarement en beau dans la Suisse. Nous passâmes promptement, de cette
vallée de vie, dans un lieu de ténèbres et de mort. Les rochers de Teufelsberg
semblaient avoir séparé, de ce côté du moins, l’heureuse vallée du reste
du monde. L’homme y a forcé la nature. Il a ouvert, à force de travail, un
passage à travers ces roches. Cette espèce de galerie a deux cents pieds
de long, sur douze de largeur et de hauteur. Nous nous enfonçâmes sous cette
voûte noire et humide, et nous n’en sortîmes que pour être frappés d’un autre
genre de terreur.
Nous
arrivâmes au pont du Diable, que bien certainement le Diable n’a pas
bâti. Mais il est composé d’une seule arche de soixante-quinze pieds d’ouverture,
et quand l’imagination de l’homme est frappée, il en jaillit des fables.
Le pont
n’est qu’une faible partie de la scène qui s’ouvre ici. Elle étonne, elle
frappe, elle terrifie le voyageur. La Reuss tombe là de cent pieds de hauteur,
avec un fracas épouvantable. Ce torrent, poussé dans des directions différentes,
par l’inégalité des rochers, parcourt un espace de trois cents pas, avant
que de tomber dans le lit qu’il s’est creusé ; c’est celui qui forme la continuité
de la rivière.
Les
rugissemens de cette cascade étourdissent, effraient le voyageur. La violence
de la chute agite, frappe l’air, et produit une tempête locale, qui durera
autant que les rochers qui en sont la cause première. Nous frémîmes en traversant
le pont. Nous crûmes, un moment, que le vent allait nous précipiter dans
le gouffre, et nous rîmes de nos frayeurs quand nous touchâmes à l’autre
rive. Voilà l’homme.
Nous
devions passer cette journée entière dans des alternatives de terreur et
de sécurité. Nous entrâmes dans la gorge glacée, dite les Schollenen. La
nature a perdu là son activité et sa vie. Aucune habitation humaine, le passage
d’aucun oiseau, ne dissipent la tristesse profonde qui serre le voyageur.
Là, tout est silencieux, tout est néant. Des croix, plantées çà et là, nous
avertirent que le sol que nous foulions pouvait s’ouvrir sous nos pas ; qu’une
avalanche allait, peut- être, nous engloutir à jamais.
Nous
marchions avec précaution ; nous cherchions, par des mouvemens irréfléchis,
et cependant calculés par cet instinct
qui
ne nous abandonne jamais, à alléger le poids de notre corps. Nous ressemblions
à ceux qui doivent traverser une rivière gelée, et qui ne connaissent pas
l’épaisseur de la glace qui la couvre. Ils avancent un pied ; ne l’appuient
d’abord que légèrement ; bientôt la pression devient plus forte, et si la
glace résiste, ils portent le second pied en avant. Ils gagnent l’autre bord
en tremblant, et toujours terrifiés par l’idée qu’ils ne sont séparés de
la mort que par une planche de glace qui peut se rompre à chaque instant.
C’est ainsi que nous sortîmes de cette gorge affreuse, toujours poursuivis
par les rugissemens de la Reuss. Le philosophe André, qui rit de tout, ne
trouva pas un mot.
Nous
étions sans cesse arrêtés par cette maudite rivière, qui semblait s’attacher
à nous. De nouvelles cascades, moins terribles cependant que la première,
nous fatiguaient sans interruption. Nos yeux cherchaient en vain un site
agréable, sur lequel ils pussent se reposer. Des forêts de noirs sapins,
dont les cimes se perdaient dans les nuages ; des pointes de rochers pelés
; d’autres montagnes formées de leurs débris, et s’écroulant par parties
dans la Reuss ; des ravins profonds, que sillonnent de nouveaux torrens,
tel est le spectacle qui nous poursuivait.
Je pensais
à cette France que j’avais quittée, et je rêvais profondément. Je n’ai pas
une pensée qui échappe à André. « En France, me dit-il, les dangers
sont sans cesse renaissans ; ils sont ici momentanés. Bien d’autres que nous
ont passé par ces tristes lieux. Ils ont gagné le port : pourquoi n’y arriverions-nous
pas comme eux ? »
Nous
découvrîmes bientôt un pont plus extraordinaire que le premier. Il a dû être
moins difficile à élever, quoiqu’il ne soit
également
composé que d’une seule arche ; mais elle a quatre- vingt-dix pieds d’ouverture.
Le pont du diable a été bâti sur des précipices, dont l’œil ose à peine sonder
la profondeur. Celui-ci a pour base un terrein ferme et un, où l’industrie
des ouvriers a pu se développer sans efforts.
J’ai
fait plus haut quelques réflexions sur cette dénomination de pont du diable.
Je ne les répéterai pas ici. Je dirai seulement que ce second pont s’appelle
le saut du moine. Avant son érection, un moine qui fuyait avec une
fille qu’il avait enlevée, fut arrêté en cet endroit par la rivière. Il prit
la fille sur ses épaules, et franchit la Reuss d’un saut. Quel saut !
Gardez-vous
de dire aux habitans que ce fait est controuvé. Ils ne vous lapideraient
pas ; mais ils s’éloigneraient de vous, comme autrefois on fuyait les lépreux.
Quand
nous fûmes arrivés à l’extrémité du pont, nous nous arrêtâmes. Nous regardâmes
devant nous, et à droite et à gauche, aussi loin que la vue de l’homme peut
percer. Nous cherchions des animaux, quels qu’ils fussent, et surtout un
abri. Le chemin était difficile, mais battu ; il devait nous conduire à quelque
habitation. Excessivement fatigués, au moral comme au physique, nous étions
impatiens de revoir des hommes. Nous sentions le besoin de quelque appui.
C’est dans cette position qu’on sent combien l’homme de la nature a dû être
malheureux, et combien nos premiers ancêtres ont eu raison de se réunir en
corps de société. L’état social a de graves inconvéniens, sans doute ; mais
l’isolement absolu a quelque chose d’affreux.
Marianne
avait été silencieuse jusqu’alors. Tout à coup elle poussa un cri que
nous répétâmes tous : un hameau ! un
hameau
! Nous n’apercevions encore que de la fumée ; mais elle devait s’élever d’un
châlet ou d’une cabane.
Nous
commençâmes à respirer librement. Nous nous embrassâmes tous, comme des infortunés
qui viennent d’échapper au naufrage, et nous retrouvâmes des forces. Nous
continuâmes d’avancer, et bientôt les opinions furent partagées. C’est du
brouillard, disait l’un ; c’est de la fumée, disait l’autre ; c’est un nuage,
ajoutait un troisième. Ainsi le pilote égaré croit toucher au port, et va
se briser contre un écueil. Le fond du tableau pouvait ne nous offrir enfin
que des rochers.
Un léger
coup de vent purifia l’air, et nous vîmes distinctement la fumée monter en
serpentant. Nous jetâmes tous un cri de joie ; nous ne marchâmes plus ; nous
courûmes ; bientôt nous découvrîmes les tuyaux des cheminées ; de cent pas
plus loin nous aperçûmes les couvertures, et enfin des portes et des fenêtres.
Nous entrâmes,
rayonnans de joie, dans le village de Wasen. Les habitans nous jugèrent
aussitôt. Nos costumes étaient suisses, mais de différens cantons, et
nous n’en avions pas de celui d’Uri. Ces bons villageois sentirent ce que
des étrangers avaient souffert de fatigues, de quelles craintes ils avaient
été tourmentés, et ils vinrent en foule nous offrir leurs services. En un
instant nos mulets furent dételés, et conduits nous ne savions où. Des mains
caressantes nous prirent deux par deux, et nous introduisirent dans les châlets
les plus apparens. Les chariots restèrent sur la place du village. Ils étaient
là comme chez nous.
On s’empressa
de nous offrir du beurre, des œufs, du fromage et du petit-lait. Nous nous
étions promis de n’être plus à charge à ces bons Suisses ; mais nous
étions si contens de nous
retrouver
avec des hommes ! nous dédommageâmes nos hôtes, en leur présentant quelques
bouteilles de notre meilleur vin. Ils n’en buvaient pas souvent, et le présent
leur fit un grand plaisir.
Ils
ne voulurent pas nous laisser coucher dans nos chariots. En un tour de main,
ils eurent enlevé et placé nos lits dans leurs châlets. Oh, comme on dort,
quand on est las, qu’on a été inquiet, et qu’on se trouve en sûreté !
Nous
poussâmes le lendemain jusqu’à Silenenen, et le surlendemain nous arrivâmes
à Altorf, chef-lieu du canton d’Uri.
Ce bourg
est considérable. Il est l’entrepôt du petit commerce d’échange, que font
entre eux les habitans du canton, et il y circule un peu d’argent de bas
aloi. On y trouve des ruines de fortifications, qui ont été élevées lors
des guerres de l’insurrection helvétique. Altorf est situé dans une vallée,
et sa position rendait cette mesure in dispensable à des gens qui voulaient
conserver le berceau de Guillaume Tell. Il ne reste de tout cela qu’une tour
qui lui est consacrée, et qui porte son nom. Elle est entretenue avec le
plus grand soin. On nous a fait voir la place où était le tilleul auquel
le héros suisse attacha son fils pour abattre la pomme que la tyrannie avait
placée sur sa tête. Cet arbre existait encore deux cent cinquante ans après
sa mort…. dit-on.
On nous
conduisit près de la pointe du rocher, d’où Tell perça le tyran, après avoir
repoussé, du pied, sa barque au milieu des flots. Nous avons différentes
versions sur cet événement. Il n’y en a qu’une à Altorf, et il faut bien
se garder d’en attaquer l’authenticité. On nous mena ensuite au pied du Sélisberg.
Nous y vîmes trois sources, qu’on nomme sacrées, parce qu’elles
jaillirent
de terre au moment où les premiers conjurés, en faveur de la liberté, se
lièrent par un serment solennel. Il faut des fables au peuple, nous l’avons
déjà dit. Plus elles sont incroyables, et plus il y tient.
Un monument,
vraiment recommandable, est la chapelle gothique, que la reconnaissance publique
érigea à la mémoire de Tell, trente-un ans après sa mort…. dit-on. Il fut
incontestablement un des fondateurs de la liberté, et il mérita cet hommage.

Chapelle
de Guillaume Tell, par K.-Fr. Heinzmann, 1825
L’an
1388, le lendemain du jour de l’Ascension, on célébra une première messe
dans cette chapelle, et on y compta cent quatorze vieillards qui l’avaient
connu. On continue d’en dire une tous les ans, et la chapelle est trop petite
pour contenir ceux qui s’y présentent. Nous priâmes devant la porte de la
chapelle, pour le maintien de la liberté helvétique. Elle sera inattaquable,
tant que les Suisses conserveront leurs mœurs simples et pures.
Nous
rentrâmes dans le bourg, et on nous découvrit l’image du grand homme, grossièrement
taillée de son vivant. C’est pour les habitans d’Altorf, le plus précieux
des monumens consacrés à la mémoire de Tell. C’est, par cette raison, le
dernier qu’ils montrent aux étrangers.
Nos
guides s’en approchèrent le bonnet à la main. Nous ôtâmes nos chapeaux, et
ils nous sourirent.
Claire
avait regardé ces différentes choses avec son sang-froid ordinaire. Marianne,
toujours folâtre, jouissait de tout en étourdie : elle louait, ou blâmait
gaîment, et au hasard. Fort heureusement on ne l’entendait pas, j’en étais
sûr. Elle se permit de critiquer l’image de Tell. Elle ne manquait pas de
me regarder, quand elle émettait une pensée qui sortait de la classe de ses
habitudes. Je lui marquai le mécontentement le plus prononcé : le landamman,
premier magistrat du canton, venait de nous joindre, et il pouvait entendre
quelques mots de français. La pauvre petite fit, à l’image, une révérence
jusqu’à terre, et le landamman lui demanda la permission de l’embrasser :
il était connaisseur.
« Tout
le monde fait des fautes, lui dit-il en très-bon français, et il est toujours
beau de les réparer. » Nous restâmes tous muets d’étonnement. « Vous êtes
sans doute logés ? » Nous
nous
étions arrêtés à un cabaret, qui avait quelque apparence, et, après avoir
pris un léger repas, nous avions parcouru le bourg et ses environs.
C’est
une bonne fortune que trouver, en pays étranger, quelqu’un qui entende sa
langue, et la conversation s’engagea aussitôt. Le landamman nous demanda
qui nous étions, d’où nous venions, et où nous allions. « Ces questions,
ajouta-t-il, sont de pure curiosité. Chacun est libre de faire ici ce qu’il
veut, pourvu qu’il se soumette aux lois du pays, et qu’il ménage les opinions
des habitans. » Il adressa ces derniers mots à Marianne, en lui souriant.
Elle rougit, et baissa les yeux.
Quand
il sut qu’André avait connu personnellement Gaspard de Coligny ; que j’avais
vécu familièrement avec le maréchal de Biron ; que j’avais approché Henri
III et le roi de Navarre ; que j’avais eu des relations avec le duc de Guise,
il fut étonné à son tour. Cependant il paraissait avoir soixante ans, et
cet âge n’est pas celui de la confiance. Il nous fit beaucoup de questions
de détail, parce que, disait-il, il aimait à parler de la France. Nous vîmes
bien qu’il colorait, d’un prétexte, le désir de s’assurer que nous n’étions
pas des aventuriers.
Nos
réponses furent claires, précises. Nous lui apprîmes même des choses dont
il ne pouvait avoir d’idées, quel qu’il fût, et qui se liaient naturellement
aux faits que nous lui racontions. Il nous marqua alors de la considération,
et il se mit à conter à son tour : cela était juste.
Catherine
de Médicis opposait tantôt les protestans aux catholiques, tantôt les catholiques
aux protestans. Elle ne voulait écraser aucun des deux partis, parce que
leurs divisions la rendaient nécessaire à son fils Charles IX, et maintenaient
son
autorité. Ainsi, les vues particulières des grands décident du sort des peuples.
En 1566,
Condé et Coligny avaient des troupes nombreuses et redoutables. Une bataille
gagnée pouvait les rendre dangereux. Catherine résolut de rallumer la guerre
civile, et elle rechercha l’appui des puissances étrangères. Six mille Suisses
entrèrent en France, commandés par le général Phiffer. M. Zambeck, notre
landamman, était capitaine dans un de ces régimens.
Il nous
raconta comment les Suisses délivrèrent et conduisirent à Paris le roi et
la reine mère, que Condé et Coligny furent au moment d’enlever à Monceaux;
il s’étendit, avec complaisance, sur leur bravoure, et les savantes manœuvres
de Phiffer, qui décidèrent de la bataille de Saint Denis. La victoire des
royalistes ne fut suivie d’aucun résultat, parce que la reine d’Angleterre,
Élisabeth, envoya au prince de Condé, des troupes et de l’argent. La balance
était devenue à peu près égale entre les catholiques et les réformés. Catherine
cessa de craindre Coligny et les Guises, et elle signa la paix, à Longjumeau,
en 1568. Les Suisses rentrèrent alors dans leurs montagnes.
M. Zambeck
avait vécu deux ans en France, et il était tout simple qu’il parlât bon français.
Mais il fallait connaître ces détails-là pour convenir que la chose la plus
étonnante, peut finir par s’expliquer tout naturellement.
Le landamman
finit par nous engager, avec cordialité, à loger chez lui, et nous acceptâmes
sa proposition avec plaisir. Quelques raisons qu’on ait de s’éloigner de
sa patrie, on est français partout, et nous aimions à entendre un étranger,
qui parlait de la France avec éloge.
André
sortit pour aller donner ses ordres à Bertrand. M. Zambeck offrit son bras
à Marianne, selon la mode de France, dit-il, et il nous conduisit chez lui.
Marianne marchait la tête haute, et semblait dire aux passans : Votre premier
magistrat me marque de la considération, et j’ai droit à la vôtre. La vanité
est un sentiment inné chez les femmes, de tous les climats et de toutes les
classes.
La maison
de M. Zambeck est très-propre, et n’a rien de recherché. Ses meubles sont
ceux d’un Suisse qui vit dans l’aisance, et une petite bourgeoise de Paris
dédaignerait de s’en servir. Le canton d’Uri est très-borné. Mais Zambeck
en est le premier magistrat, et César disait qu’il vaut mieux être le premier
dans une bicoque, que le second dans Rome. D’après cette assertion, notre
landamman était fort au-dessus de nos plus grands seigneurs, et il n’en était
pas plus fier. C’est à sa modestie, à sa simplicité, autant qu’à ses talens
administratifs, qu’il a dû l’honneur d’être nommé, pour deux ans, chef de
sa petite république. Les Suisses sentent la nécessité d’être gouvernés ;
mais ils ne veulent pas de maîtres.
La plus
parfaite égalité règne à Altorf. Le landamman, le bourgmestre n’y sont quelque
chose que lorsqu’ils remplissent leurs fonctions, et si alors ils voulaient
se permettre un acte arbitraire, le nom de Guillaume-Tell les arrêterait
aussitôt. Il a, en Suisse, à Altorf surtout, la force de l’ancienne clameur
de haro, en Normandie.
La porte
de Zambeck est toujours ouverte, comme celles de tous les habitans du bourg.
Ils entrent librement chez lui, leur pipe à la bouche, s’assoient à son foyer,
et le consultent sur leurs affaires, comme un fils demande des conseils à
son père.
La
seule distinction, qu’ils lui accordent, est de lever leur bonnet
quand ils entrent et qu’ils sortent.
Madame
Zambeck les reçoit toujours avec cordialité, quelque chose qu’elle ait à
faire. Elle leur avance une escabelle bien propre ; elle s’informe de la
santé de leurs femmes et de leurs enfans, et elle retourne à ses travaux.
Cette politesse-là est dans la nature.
Elle
nous fit tous mettre à table, sans exception. Là, les domestiques mangent
avec leurs maîtres. Compagnons de leurs travaux, ils le sont aussi de leurs
jouissances. La seule distinction, qui existe entre eux, est dans le silence
rigoureux que les domestiques observent pendant le repas. C’en est une bien
marquée, pensai-je, et que devrait exclure le système d’égalité absolue.
Zambeck
s’aperçut que je regardais ses domestiques, et que je paraissais réfléchir.
Il était pénétrant. « Nous gouvernons ces gens-là paternellement, me dit-il,
et, en Suisse, les enfans ne parlent, à table, qu’après en avoir reçu la
permission de leur père ou de leur mère. » Ces bons Suisses ont réponse à
tout.
Nous
fêtâmes le beurre que Madame Zambeck avait fait elle- même ; des œufs frais
qu’elle avait levés, et toutes les côtelettes d’un mouton qu’elle avait fait
griller. Le pauvre animal devait jouer un grand rôle à ce dîner-là. Un de
ses gigots parut pour terminer le repas. « Nous avons soin, me dit Zambeck,
de ne rien servir qui présente des morceaux de choix. Mais, si nous avons
une volaille, je la découpe, le plat circule, et chacun prend ce qui lui
convient. »
M.
le landamman a d’assez bon vin ; mais il est rare dans le pays, et on l’y
réserve pour les grands jours. Le magistrat en vida une bouteille avec André
et moi, quand les domestiques furent retirés. Ils avaient bu de l’hydromel,
et nos dames du petit-lait.
On cause
nécessairement, quand on ne boit pas de manière à s’égayer. « Vous avez pu
remarquer, nous dit Zambeck, que l’hospitalité ne s’exerce pas, à Altorf,
avec l’empressement et la franche cordialité que vous avez rencontrés jusqu’ici.
La plupart des habitans font un commerce qui n’a rien de brillant, mais qui
est lucratif. Ils partagent nécessairement leur aisance avec les ouvriers
qu’ils emploient, et ils contribuent à faire vivre les cultivateurs. Ainsi,
le bien-être des marchands s’étend de proche en proche ; et, quand on en
est là, la cupidité commence à naître, et on s’occupe peu des autres. Peut-être
le désir de parler de la France, avec vous, est-il le plus puissant des motifs
qui m’aient déterminé à vous recevoir chez moi.
« Il
est certain, dit André, que Bertrand et Gott ont rassemblé des provisions
de bouche, choisies ; mais ils les ont payées très- cher.
« Hélas
! reprit Zambeck, il est malheureusement trop vrai que tout dégénère. Nous
sommes loin du temps où un Suisse vendit un florin un des plus beaux diamans
qui existent.
« Que
sera-ce quand l’abondance multipliera les besoins factices, et les désirs
qu’ils provoquent ? Les femmes introduiront le luxe, et pour leur plaire,
il faudra les imiter. On tournera en ridicule ceux qui respecteront nos lois
somptuaires, et, peut-être, les magistrats seront les premiers à les violer.
Or, le luxe resserre le cœur, et éteint l’esprit public. On n’est plus
libre,
on n’est plus digne de l’être, quand on est soumis à des fantaisies, auxquelles
on attache de l’importance. Cette époque est encore éloignée, mais la force
des choses l’amènera.
« Cependant
les Suisses conserveront l’intégrité de leur territoire, quelle que soit
la dépravation des mœurs. Nos montagnes servent de barrière à l’Allemagne,
au Piémont et à la France. Ces puissances ne souffriront jamais qu’une d’elles
les franchisse. » M. Zambeck est un homme plein de raison et de jugement.
Il n’eût
pas proclamé, sans doute, ces tristes vérités, si d’autres que nous eussent
pu l’entendre. Au reste, la liberté helvétique durera plus que nous et nos
enfans. Leurs descendans prendront leur parti. Hé, mais, suis-je déjà amolli
et égoïste ? Ai-je trouvé, à Altorf, une nouvelle Capoue ? C’en est une,
sans doute, si je la compare aux déserts qui environnent les ponts du Diable
et du Saut-du-Moine.
En attendant
la corruption qui doit anéantir la liberté Helvétique, les Suisses se couchent
de bonne heure, et nous nous retirâmes dans les logemens qui nous étaient
assignés.
« Qui
donc a réglé le mien ? — C’est moi, Monsieur, me répondit Marianne, avec
une petite révérence et un sourire qu’elle sait rendre si piquans. — Ah !
c’est vous ? — Oui, Monsieur. Voilà votre chambre, c’est la plus belle ;
le cabinet est pour moi. » C’est un esprit tentateur que cette petite fille-
là… Un coup de tonnerre, une baume, une entorse, un logement….. Mais elle
est si jolie !
Le lendemain,
de grand matin, nous prîmes congé de nos hôtes, et nous partîmes. M. Zambeck
nous avait parlé du canton de Glaris, de ses vallées, de ses torrens, de
ses montagnes, de
ses
glaciers. J’avais assez vu de tout cela. Aux saillies et aux enfoncemens
près, qui sont variés à l’infini, tous ces objets se ressemblent ; ils ont
un air de famille, et leur aspect uniforme devient fatigant. Il y a, dit-on,
des voyageurs, dont l’admiration est inépuisable, tant mieux pour eux. Je
m’enfermai dans mon chariot, et j’y dormis d’un profond sommeil : j’en avais
besoin.
Nous
commencions aussi à nous fatiguer de notre vie nomade. Elle durait depuis
long-temps, et on compte les jours, quand on les trouve longs. Nous résolûmes
de ne plus nous détourner, pour voir quelque chose que ce fût, et de suivre
la ligne droite, autant que nous le permettraient les rocs à pic, les ravins
et les torrens.
Nous
ne regardions plus autour de nous que machinalement. Cependant André trouvait
toujours l’occasion de philosopher, soit qu’il vit quelque chose, soit que
le mauvais temps nous contraignît à nous renfermer dans nos chariots…. Il
n’y eut plus de coup de tonnerre.
Nous
avancions dans le canton de Glaris. André fit arrêter tous nos équipages,
pour me faire remarquer que si des révolutions épouvantables ont formé les
montagnes, des tremblemens de terre, dans des temps moins éloignés, ont détruit,
en partie, l’ouvrage des premiers. En effet, il me fit voir des débris de
rochers qui couvrent les flancs d’une montagne, dont la cime se perd dans
les nuages. Un passant nous dit qu’elle se nomme la Sand-Alpe, et qu’elle
a quatre lieues d’élévation. « Vous sentez bien, Monsieur, que ces masses,
qui ont fait partie du grand tout, n’ont pu se détacher d’elles- mêmes. —
Je sens que tu t’arrêtes, avec complaisance, sur l’image du chaos, et
je n’aime pas à m’attrister, quand je peux faire autrement. Bertrand, marchons,
» et je me tournai
vers
Marianne. Elle a quelque chose de plus riant que des rocs pelés, entassés
les uns sur les autres.
Nous
arrivâmes à Glaris, chef-lieu du canton, situé presque à ses frontières du
côté de Saint-Gall ; nous y renouvelâmes nos provisions.
Le pays
de Saint Gall est enclavé dans la Suisse, et n’en fait point partie ; il
est soumis à l’autorité souveraine d’un abbé. Ce pays s’étend de celui des
Grisons au lac de Constance, et du lac de Zuric aux frontières d’Allemagne,
dont il est séparé par le Rhin. Cette contrée a presque autant d’étendue
que le canton de Berne.
En 630,
un Écossais, nommé Gall, vint prêcher l’Évangile dans les montagnes de l’Helvétie.
Après avoir beaucoup voyagé, inutilement, ou avec succès, il vint se reposer
dans le pays dont nous parlons, et il s’y bâtit un ermitage sur les bords
de la Steinach. Il y fit des prosélytes, qui, après sa mort, en firent un
saint. Cela devait être.
Quatre-vingts
ans après, des Bénédictins, écossais et anglo- saxons, voulurent s’établir
dans l’ermitage qu’avait sanctifié Gall, et dont il ne restait plus de vestiges.
Il est présumable qu’ils choisirent, dans les environs, un lieu commode et
sûr, et ils y bâtirent une maison. Cette maison devint, avec le temps, la
ville de Saint-Gall.
Ces
religieux, instruits et laborieux, fondèrent une école, qui devint bientôt
célèbre. Les plus grands personnages, les seigneurs allemands surtout, y
envoyèrent leurs enfans. Ils y apprenaient le grec, le latin, les mathématiques,
les règles de la poésie, et de la musique.
C’est
à ces moines respectables que nous devons ce qui nous reste de Quintilien,
la Satyre de Pétrone, le Silius Italicus, le Valerius Flaccus,
les deux Traités de Cicéron, de Legibus, et de Finibus ; l’ouvrage
d’ Ammien-Marcellin, et la conservation de beaucoup de poésies allemandes
des dixième, onzième, douzième et treizième siècles.
Des
forêts furent abattues, des terres, d’une vaste étendue, furent défrichées,
et l’humble retraite des sciences devint le séjour des richesses et des plaisirs.
Tout dégénère avec le temps, comme l’a judicieusement remarqué notre bon
landamman Zambeck.
Des
moines allemands, ambitieux et guerriers, convoitèrent la crosse abbatiale
de Saint-Gall, et s’en saisirent. Ils asservirent d’abord les villages voisins
de l’abbaye, et les muses disparurent avec la liberté. Des seigneurs allemands
succédèrent aux derniers abbés, et ils étendirent leurs conquêtes. Ils les
poussèrent enfin jusqu’aux limites que nous venons d’indiquer.
Le petit
canton d’Appenzell fut long-temps enclavé dans les États de l’abbé de Saint-Gall.
L’excès de l’oppression poussa ses habitans à secouer le joug intolérable,
qui pesait sur eux. Ils s’insurgèrent en 1407 ; l’abbé fit marcher ses troupes
contre eux ; les soldats de l’Église ne sont pas redoutables ; les Appenzellois
les battirent, et se proclamèrent libres. Ils le furent en effet, parce qu’ils
avaient voulu l’être, ou mourir les armes à la main.
En 1489,
l’abbé régnant essaya de les soumettre, et telle était son opulence, qu’il
soudoya des troupes allemandes, et les fit entrer dans l’Appenzell. La lutte
fut terrible et longue. Les Appenzellois firent des prodiges de valeur, et
chassèrent les
ennemis
de leur territoire. Ils se réunirent alors à la ligue Helvétique, et les
autres cantons menacèrent l’abbé de Saint- Gall de le chasser de ses Etats,
s’il osait attenter de nouveau à la liberté du canton d’Appenzell. L’abbé
reconnut son indépendance.
Je n’avais
pas oublié le malheureux serf de l’abbé de Saint- Claude, déchiré à coup
de fouet, pour une faute légère, et je demandai à André si nous serions obligés
de passer par la ville de Saint-Gall. Il n’était pas meilleur géographe que
moi : il ne pouvait tout savoir. Nous arrêtâmes un paysan qui passait sa
bèche sur l’épaule. Il nous salua profondément, à plusieurs reprises. Qu’eût-il
fait, si nous eussions été revêtus de nos costumes de cour ? Le despotisme
s’étend, de proche en proche, et le dernier de ses valets fait trembler l’homme
qui vaut mieux que lui. Ce pauvre serf nous apprit que nous serions encore
éloignés de la ville capitale quand nous entrerions dans le canton d’Appenzell.
Je lui donnai un écu d’argent, et il me remercia à genoux.
Nous
devions passer la nuit à Wildhauss, et entrer demain, de bonne heure, dans
la terre promise, ou du moins dans celle que nous nous promettions ; mais
y arriverons-nous ?
L’abbé
de Saint-Claude est soumis aux lois de l’Espagne ; celui de Saint-Gall est
souverain. Si nous étions arrêtés par quelques-uns de ses drôles….. « Bertrand,
mettez nos armes en état. » Marianne me ferma la bouche, avec sa main, peut-être,
et elle me pressa dans ses bras. Je ne sais comment elle arrange tout ; mais
depuis deux jours elle est établie dans mon chariot. Ce n’est pas ma faute.


Costumes
du canton d’Appenzell, d’après Achille Dévéria, vers 1830
CHAPITRE
XXXII.
La
troupe nomade entre dans le canton d’Appenzell.
Nous
touchâmes enfin ce sol que nous cherchions depuis si long-temps. Nous saluâmes
cette terre qui devait nous nourrir, et où nous devions vivre et mourir
libres, si toutefois il est permis à l’homme de compter sur quelque chose.
Nous
parlions un allemand, très-peu correct, et mêlé de gallicismes ; mais nous
pouvions comprendre ce qu’on nous disait, et nous faire entendre avec facilité.
L’homme
de Saurigny devait être le premier en tout. Il avait fait des progrès qui
nous paraissaient étonnans, et qui, toutes réflexions faites, n’avaient rien
d’extraordinaire. Il avait eu de longs tête à tête avec sa femme, et les
époux les plus unis n’ont pas toujours quelque chose de nouveau à se dire.
André méditait, pendant que Claire bâillait ou dormait.
Nous
n’avions plus besoin d’interprète, et il fut décidé que Gott serait reléguée
à la cuisine. C’est ainsi que lorsque la dernière pierre d’un pont est placée,
on jette à l’eau la charpente qui le soutenait. Ingrats !
Nous
résolûmes d’aller dîner à Appenzell, chef-lieu du canton, et cela n’était
pas difficile. Ce petit pays n’a que dix lieues de longueur d’orient en occident,
sur six à sept du midi au nord. Il ne touche à la Suisse par aucun point.
Il est enclavé dans les Etats de l’abbé de Saint-Gall, et la Souabe, et cependant
il est libre, et aucune puissance n’ose entreprendre de l’asservir. Les douze
autres cantons accourraient pour le défendre.
Nous
nous arrêtâmes sur la place du bourg, et nous sautâmes gaîment à terre. Quatre
chariots et six mulets réunis sont une nouveauté dans le canton d’Appemell,
et les bons habitants nous entourèrent aussitôt. Ils nous offrirent leurs
services, et, en attendant notre réponse, ils dételaient nos mulets, remisaient
nos chariots.
Au milieu
de ce peuple bienfaisant, étaient deux hommes, qui n’avaient de remarquable
que leur inaction. C’étaient cependant le landammann et le bourguemestre.
Ils paraissaient se consulter.
Ils
nous abordèrent enfin, avec la formule d’usage : salut, hommes libres :
notre costume suisse déposait en notre faveur. C’est ainsi que se saluent
toujours deux Appenzellois, qui se rencontrent, n’importe où. Cela veut dire
: souvenons-nous de ce que nous sommes, et de ce que doivent être nos enfans.
La conversation
s’engage facilement entre des hommes, dont les uns sont curieux, et les autres
ont besoin de conseils et d’appui. Il fallut répéter à ces magistrats la
longue histoire que nous avions racontée au landamman d’Altorf, et à quelques
autres. Nous comptions sur des marques d’affection, ou au moins de bienveillance.
Les figures des deux magistrats se
contractèrent.
Leurs regards exprimaient l’embarras, qu’éprouvent toujours d’honnêtes gens,
qui ont quelque chose de désagréable à annoncer. Nous nous regardâmes, André
et moi, avec l’étonnement que devait nous causer une réception à laquelle
nous étions loin de nous attendre. Que vont-ils nous annoncer ? Allons-nous
perdre le fruit de tant de fatigues, et de privations ? Le landamman prit
la parole. « Vous allez être logés, et vos hôtes partageront avec vous ce
qu’ils ont. Allez dîner, nous raisonnerons ensuite. » Quel début, dis-je,
en français, à mon philosophe ! Il n’est pas gai, me répondit-il. Au reste,
si nous sommes mal ici, le chemin qui nous y a conduits nous ramènera où
nous voudrons. »
Nous
fûmes casés dans quatre maisons différentes, et nos hôtes nous reçurent avec
cette cordialité franche, dont nous avions pris la douce habitude, depuis
notre entrée en Suisse. Comment de si bonnes gens se sont-ils donné des magistrats
d’un caractère sec et dur ?
Nous
avions partagé, partout, nos provisions avec nos hôtes, et ils avaient paru
sensibles à ce procédé. Nous crûmes devoir continuer de répondre ainsi aux
marques d’amitié qu’on nous prodiguait. Bertrand distribua partout le pain
d’avoine pure, le poisson mariné, et le vin du Rhône. Tout cela fut trouvé
excellent. Les hommes portèrent nos santés, debout, et la tête découverte.
Nous nous levâmes, le chapeau à la main, et nous gardâmes cette position
jusqu’à ce que celui qui nous saluait eût fini de boire. Nous avions cru
répondre à une politesse par une autre, et nous avions deviné l’usage du
pays. Ils nous prirent la main, et la secouèrent avec force. Cela signifie
: Nous sommes contens de vous.
Le
vin circulait ; les hommes oubliaient le travail de l’après- dîner ; les
femmes avaient quitté leur rouet ; Marianne chantait une chanson allemande,
que Gott lui avait apprise, lorsque le landamman et André entrèrent.
« Je
trouve ici, dit le magistrat, le désordre qui m’a blessé dans les trois autres
châlets. On ne vous a fait aucune observation dans les cantons où vous n’avez
fait que passer. Vous voulez vous faire naturaliser dans celui-ci, et vous
commencez par y porter la corruption. Voilà des hommes qui négligent leur
travail des champs ; des femmes qui abandonnent leur ouvrage et les soins
de leur ménage. Cette vie inconvenante est admise dans les pays de servitude
: il faut que l’esclave s’étourdisse sur sa position. Ici, tout cela est
déplacé et dangereux. Les lois somptuaires du pays séviraient contre vous,
si vous n’étiez étrangers.
« L’hospitalité,
cette vertu du pauvre, est pratiquée et encouragée dans ce canton. Mais elle
doit avoir des bornes, et je ne peux souffrir que vous épuisiez, en une semaine,
le produit des sueurs de mes administrés. » Vous partirez demain.
« Mais,
Monsieur, répondit André, nous ne voulons être à charge à personne, nous
travaillerons. — Et pour qui ? Chacun cultive sa petite propriété, et si
ses bras ne suffisent pas, il a des domestiques, à qui il n’ôtera pas leur
pain pour vous le donner.
-
Nous achèterons de la terre. Nous avons dans
l’un de nos chariots, quarante-quatre mille livres en or. — Vous achèterez
de la terre ! vous allumerez la cupidité dans des cœurs, qui ne la connaissent
pas. Éblouis par l’aspect de votre or, ces bonnes gens renonceront à l’héritage
que leur ont laissé leurs pères, et quand ils en auront mangé le prix, que
deviendront-ils ? des vagabonds, qu’il faudra chasser du canton.
«
Le mal gagnera, de proche en proche, car avec vos quarante- quatre mille
livres vous finirez par agglomérer toutes nos possessions. La liberté périra,
parce qu’elle ne peut exister chez un peuple corrompu. Les Appenzellois deviendront
la proie de l’abbé de Saint-Gall, ou de quelques seigneurs de la Souabe.
Ils devront leurs fers et leur avilissement à trois ou quatre Français, qui
ont rêvé la liberté, et qui ne la connaissent pas. Je vous déclare que si,
de ce moment à celui de votre départ, vous laissez apercevoir votre or, je
le ferai jeter dans la Sitter, avec les formalités voulues par la loi. »
Il sortit.
«
Nous voilà bien, dis-je à André. — Mais nous ne sommes pas si mal. Nous retournerons
à Genève. On y fait bonne chère, et nous y trouverons beaucoup des usages
de la France. — Mais Calvin ! — Mais la nécessité ? et puis, vous n’êtes
plus dévot.
-
Et si le duc de Savoie s’empare de l’État
de Genève ? — C’est le pis-aller. Alors nous irons chercher la liberté en
Hollande. Nous nous y ferons marchands de cannelle, de gingembre et de hareng.
»
On vint
nous dire que le landamman venait d’assembler le petit conseil. « Ah, mon
Dieu, m’écriai-je, ils vont nous faire arrêter ! — Ils n’en ont pas le droit,
nous dit notre hôte ; et puis, pourquoi vous arrêter, puisque vous partez
demain ? »
Qu’on
dût le faire, ou non, Marianne se pressait contre moi ; elle soupirait ;
elle me regardait d’un air attendri. André chantait le couplet que nous avions
composé à Montereau ; Bertrand sifflait ; Claire bâillait ; moi, je boudais.
Le danger nous avait tous rassemblés.
Il nous
paraissait clair que le petit conseil s’occupait de nous, et la séance
durait depuis deux heures. « Vous verrez, dit
André,
qu’ils discutent pour arrêter si nous partirons demain, avant ou après que
nous aurons déjeuné. — Oh, tu ris de tout.
— Il n’est
pas d’événement qui n’ait son côté plaisant, et c’est celui-là qu’il faut
saisir, quand on veut vivre sans soucis. »
Un bourgeois,
membre du petit conseil, vint nous dire que l’assemblée nous mandait. Nous
le suivîmes, André en chantonnant, moi en faisant des réflexions pénibles
sur notre position.
Nous
entrâmes dans une vaste salle enfumée, dont les murs n’avaient, pour décoration,
qu’un crucifix. Au milieu était une grande table de chêne, noircie par le
temps, sur laquelle étaient un registre, des plumes et une écritoire de plomb.
Le landamman présidait l’assemblée, et toutes ces figures avaient un air
sévère qui n’était pas propre à me rendre ma gaîté.
André
qui aime ses aises, trouva une escabelle, derrière lui, et la prit. Le landamman
lui dit avec beaucoup de dignité. « La puissance souveraine réside dans le
peuple. Le petit conseil, dont les membres sont nommés par lui, est une fraction
de la souveraineté. Levez-vous, et écoutez, avec respect, ce que j’ai à vous
dire.
« Approchez-vous,
avec moi, de cette petite fenêtre. Voilà l’Ébenalp, une des plus hautes montagnes
du canton. Voyez- vous là à gauche, une immense quantité de débris ? » Nous
nous regardions, André et moi, d’un air qui voulait dire : où diable veut-il
en venir ? « Nous les voyons très-bien, répondis- je. — Là, était un énorme
rocher, dont la pointe recourbée en avant menaçait la plaine depuis des siècles.
Il s’écroula, il y a quarante ans, avec un fracas épouvantable.
Ses débris ont couvert, à une grande élévation, une esplanade, à mi-
côte,
de soixante arpens en prairies, qu’arrosait un ruisseau. En voyez-vous la
source, qui s’échappe de la crevasse de cette roche, là-haut, un peu à droite
? Elle filtre maintenant sous ces débris, et va se perdre, sans être utile,
dans un petit lac, qui est derrière cette chaîne de montagnes. — S’il plaisait
à monsieur le landamman de venir au fait... — « Les Français sont vifs et
impatiens, dit-on, et vous en êtes la preuve. Ecoutez, écoutez.
— Écoutons.
« Ces
soixante arpens étaient un bien communal. Nos compatriotes, qui n’ont
pas de terres, y faisaient paître leurs vaches et leurs chèvres. La disparition
de ce terrain a jeté la consternation parmi eux. Mais, le temps use tout,
plaisirs et peines, et maintenant on ne pense plus à l’esplanade. — Mais,
Monsieur le landamman, quel rapport y a-t-il entre nous et ces événemens-là
? — Vous ne le devinez pas ? Vous avez cependant l’imagination bien active.
« Voyez,
là-bas, cet angle rentrant, qui se prolonge jusques dans les flancs de la
montagne. On peut y porter cet amas de débris, et on remettrait la prairie
à découvert. — Hé, pourquoi les habitans ne l’ont-ils pas fait ? — Cette
opération exige un travail continuel de quinze jours, et il faut cent hommes
pour l’exécuter. Ici, la sueur de chaque jour amène son pain, et la caisse
publique n’est pas assez riche pour nourrir ceux qu’on aurait employés à
ces travaux. — Ah, j’y suis, m’y voilà, s’écria André. C’est nous qui déblaierons
l’Esplanade. Mais à quelles conditions ? »
Le landamman
nous ramena dans l’intérieur de la salle. Nous y entendîmes, debout et découverts,
la lecture du projet de l’arrêté pris par le petit conseil.
«
Vous porterez, demain, votre or » dans la ville de Saint- Gall : nous ne
voulons pas ici de ce métal corrupteur. Vous le changerez contre de la monnaie
de cuivre, ou d’argent de bas aloi.
« Vous
serez porteurs d’une lettre du petit conseil à l’abbé de Saint-Gall. Nous
lui demanderons une escorte qui vous reconduira jusqu’à la frontière du canton
d’Appenzell. Dans les pays mal gouvernés, il y a beaucoup d’indigens, par
conséquent de voleurs, et plusieurs chariots, chargés de monnaie, fixent
l’attention.
« À
votre retour ici, il vous sera délivré des lettres provisoires de naturalisation.
« Vous
commencerez aussitôt vos travaux. Plus vous prendrez d’ouvriers, plutôt ils
seront terminés.
« Vous
les nourrirez, et vous leur donnerez à chacun six sols par jour, qui serviront
à l’entretien de leurs familles. — Mais, monsieur le landamman, avec quoi
les nourrirons-nous ? — Les habitans font, tous les ans, à la fin du mois
de décembre, un petit commerce d’échanges avec la Souabe, et le pays de Saint-
Gall. Ils y portent le superflu de leur bétail, de leurs cuirs, de leurs
fromages et de leur beurre. Ils en rapportent des étoffes de laine et d’autres
objets, qui ne se fabriquent pas ici. Vous leur achèterez leurs denrées,
et ils paieront en monnaie ce qu’ils prendront chez les serfs nos voisins.
« Aussitôt
que vous le pourrez, vous pratiquerez, avec le ciseau, ou la poudre à canon,
un chemin facile de l’esplanade à la plaine. Vous le pousserez jusqu’à Weissbad,
qui sera votre paroisse, et de là à Appenzell, chef-lieu du canton.
«
Vous ouvrirez un autre chemin d’Appenzell à la Sitter, qui sépare les deux
parties du canton. On la passe en bateau, moyen lent, et par conséquent désagréable.
Vous construirez un pont en bois, à l’endroit du passage.
« —
Mais, Monsieur le landamman, nos finances ne suffiront pas à tout cela. —
Il vous restera plus d’argent qu’il ne vous en faut, pour vous procurer les
douceurs de la vie, et pour faire bonne chère, ce que vous aimez assez :
je m’en suis aperçu. — Mais, Monsieur le landamman, vous vous êtes étendu
avec complaisance sur les charges. Ne serait-il pas temps de nous parler
des bénéfices ? — M’y voilà.
« Les
soixante arpens de prairies vous seront concédés pour cent ans, époque à
laquelle ils seront rendus à la commune. — A la bonne heure.
« —
Vous en jouirez gratuitement pendant dix ans. — Pendant dix ans ? Ah, il
y a encore quelques charges. — La onzième année et les suivantes, vous payerez
à la commune une redevance de trente livres, qui seront partagées entre les
citoyens les moins favorisés de la fortune. Ainsi vous serez riches pour
des Suisses ; vos travaux et votre redevance seront d’une utilité générale,
et contribueront au bien-être de vos concitoyens. Quand on fait du bien à
tous, et qu’on ne nuit à personne, on n’a que des amis, et il est doux d’être
aimé. Si ces conditions vous conviennent, signez le présent arrêté provisoire,
et regardez cette affaire comme terminée.
« Il
lui manquera la ratification du grand conseil ; mais il s’assemble le seize
octobre, et nous y touchons. Loin d’entraver les mesures qui tendent au bien
général, comme cela arrive, dit-
on,
dans beaucoup d’Etats, ce corps en favorise l’exécution de tout son pouvoir.
« Il
faut signer ou partir, me dit André. — Partir ? pour aller où ? — Où vous
voudrez. Je suis prêt à vous suivre. — Mais il me semble que nous serons
bien ici. Signons. — Signons. »
Le landamman
nous adressa une dernière question. « Ces quarante-quatre mille livres sont-elles
à l’un de vous ? À tous deux, répondis-je. » Il prit nos noms et nos prénoms.
« Ainsi, mon cher André, la communauté de biens sera consacrée. »
Le landamman
n’avait plus rien à nous dire comme magistrat. Il nous prit André et moi
chacun sous un bras, et nous sortîmes tous trois, très-satisfaits, lui du
bien qu’il faisait à la commune, nous de voir notre sort assuré.
Il racontait,
à tous ceux que nous rencontrions, ce qui venait de se passer au petit conseil.
Les uns souriaient ; d’autres nous prenaient la main ; tous nous disaient
: Salut, hommes libres, et nous nous redressions en leur rendant le salut.
Il nous semblait que nous étions grandis.
Nous
trouvâmes nos dames et Bertrand rassemblés au logement d’André. Nous nous
empressâmes de leur faire partager notre joie. Claire approuva tout par un
léger mouvement de tête ; Marianne chanta, dansa, et nous embrassa tous trois.
« Et moi, dit Bertrand, suis-je aussi un homme libre ? Très-certainement,
lui répondit M. Heilberg, notre landamman. » Il fit un saut, mais un saut
! Il culbuta la moitié d’un cochon qui était accrochée à une poutre, et ils
roulèrent, ensemble, jusqu’à la porte du châlet.
Il
est nécessaire, pour l’intelligence de ce qui précède et de ce qui suivra,
que j’entre dans quelques détails.
Le canton
d’Appenzell est divisé en deux parties, que sépare la rivière de Sitter.
Le territoire qui touche presque à la Souabe est le plus étendu, et se nomme
Rhodes extérieurs. Il est entièrement peuplé de réformés.
L’autre
partie, toute catholique, est connue sous le nom de Rhodes intérieurs. Ces
deux petits pays sont indépendans l’un de l’autre ; mais ils sont gouvernés
par les mêmes lois. Des deux côtés, le pouvoir souverain réside dans le peuple,
réuni en assemblée générale.
Cette
assemblée se tient, dans la partie catholique, au bourg d’Appenzell, en plein
air, le dernier dimanche d’avril.
Les
réformés se rassemblent, le premier dimanche du même mois, à Grognen, à Urnach,
ou à Hérisau.
Dans
les deux parties du canton, les jeunes gens, qui ont atteint l’âge de seize
ans, sont admis aux assemblées générales.
Elles
nomment, à la pluralité des voix, pour la partie catholique, un landamman,
premier magistrat, qui reste deux ans en place ; un stattaller, ou lieutenant
; un trésorier ; un capitaine général du district ; un commandant d’exercices
militaires ; un édile ; un inspecteur général des églises ; un porte bannière,
et les bourgmestres.
L’assemblée
adjoint à ces dignitaires douze bourgeois. Ils composent le petit
conseil. Ils s’assemblent une fois par
semaine.
Ils jugent les affaires civiles ordinaires, et ils sont chargés de la police
inférieure.
L’assemblée
procède ensuite à la formation du grand conseil. Il est composé de cent vingt-huit
membres, dont ceux du petit conseil font partie.
Le grand
conseil juge les causes majeures, civiles et criminelles, (Il ne se commet
pas un crime en cinquante ans.) Il vérifie l’emploi des deniers publics.
Il s’assemble
deux fois par an, la veille du jour de la convocation de l’assemblée générale,
et le seize octobre. La raison naturelle semble avoir présidé à cette organisation
si simple.
Le grand
conseil ne s’assemble que deux fois l’an ; mais les membres du petit, qui
en font partie, le mettent, en peu de tempe, au courant des affaires. II
y en a bien peu de compliquées, puisqu’il n’a besoin que d’un jour, pour
préparer le rapport qu’il doit présenter, le lendemain, à l’assemblée générale.
Peuple heureux ! Le parlement de Paris s’assemble tous les jours.
Le district
réformé a le même mode d’administration, avec cette seule différence qu’en
raison de sa plus grande étendue, il a deux landammans, deux lieutenans,
etc.
Des
deux côtés, un tribunal, nommé le consistoire, juge les affaires de
mariage, et toutes celles qui tiennent aux mœurs publiques. Il est composé
d’ecclésiastiques et de laïcs. Ils président alternativement. Les laïcs
forment les deux tiers des membres du consistoire. Les Suisses ne veulent
pas
que
leurs prêtres dominent, en aucune circonstance. Plus la liberté a coûté cher,
plus on prend de précautions pour la conserver.
Enfin
un dernier tribunal, dit de la Réforme, veille à l’observation des
lois somptuaires. Ceux qui les violent sont condamnés à une amende, plus
ou moins forte, selon qu’ils se sont, plus ou moins, écartés du texte de
la loi. Dans ce canton, un citoyen témoin d’une rixe, est, par le fait, investi
de l’autorité publique. Il impose silence aux deux parties, et, à sa voix,
elles rentrent dans l’ordre. Ceux qui lui résisteraient seraient traités
comme réfractaires à la loi.
« Il
résulte de tout cela, dit André, que le petit conseil mène le grand, et le
grand l’assemblée générale. Or, elle est composée de tous ces braves gens,
qui sourient au projet de leur landamman, et elle prononcera en notre faveur.
« Mais
vous êtes galant. Monsieur, très-galant, et, ici, le moindre petit scandale
vous fera traduire devant le consistoire. S’il vous prend fantaisie de mettre,
le dimanche, une veste de soie, on vous invitera à l’aller faire voir à la
chambre de la Réforme. Tenez, nous aurions été beaucoup mieux à Genève. On
n’y prend pas garde à ces vétilles-là ; on y mange des truites, du saumon,
et on y boit de bon vin. — C’est toi qui m’as proposé le canton d’Appenzell.
— Je ne le connaissais que par des livres, et je vois que messieurs les auteurs
font des voyages sans sortir de chez eux. Allons, réfléchissez, et mûrement.
Il sera trop tard, quand nous aurons trois dans des chemins du diable ? Le
navigateur jette ses marchandises à la mer, pour alléger son vaisseau, battu
de la tempête. Nous serons obligés de jeter notre argent, çà et là, à peine
de rester cloués au pied de quelque roche. » La petite Marianne
regardait
l’Ebenalp,
et ses jolis yeux exprimaient la satisfaction. Ils semblaient dire que les
belles Genevoises ne viendraient pas là troubler son repos. « Et puis, Monsieur,
toujours du vin du Rhinthal. — Qu’est-ce que ce vin-là ? — C’est celui qu’on
vous a présenté. On le recueille sur ces rochers là-bas, qui séparent le
canton des Etats de l’abbé de Saint-Gall. Voyez-vous ? — Il n’est pas bon
ce vin-là. — Et toujours du pain noir pour le faire passer ! »
Marianne
fit quatre sauts, et revint avec un morceau de ce pain dans une main, et
un verre de vin dans l’autre. Elle y trempa son pain, et le croqua comme
un biscuit. Je la devinai.
« Mon
cher André, je conviens que j’ai ôté à la Religion le masque hideux dont
certaines gens la couvrent. Mais plus je la vois pure et douce, et plus je
m’y attache. Je la pratiquerai ici au milieu de mes concitoyens, et elle
est proscrite à Genève. — Allons, allons, nous habiterons l’Ebenalp, et nous
ferons du biscuit avec du pain noir. »
Il n’y
a que cinq à six lieues du bourg d’Appenzell à Saint- Gall. Nous résolûmes,
cependant, de partir de très-bonne heure, afin de pouvoir, dans la journée,
convertir notre or en cuivre. La plaisante opération que nous allions faire
là ! Mais le petit conseil le veut ainsi.
« Ah
ça, André, qui veillera sur nos femmes, pendant notre absence ? — La foi
publique. — La foi publique, c’est fort bien. Mais si elles couchent chez
nos hôtes, il n’y aura pas de publicité la nuit. — Il faut bien qu’elles
y couchent, puisque nous avons besoin de tous nos chariots. — Mais, André….
— Mais, Monsieur, le sexe est faible. L’occasion, une surprise, suivies d’une
capitulation de conscience, n’est-ce pas là ce que vous redoutez ? Vous connaissez
la force d’une capitulation de
conscience
: vous en avez usé. Il n’est pas là. La nuit, tout chat est gris. Je dormais
; je rêvais….. J’ai cru que c’était lui ; je me suis trompée; ce n’est pas
ma faute.
« Monsieur,
les soupçons sont les enfans du vice. J’ai cru qu’en franchissant la lisière
de la Franche-Comté, vous aviez secoué tout cela avec la poussière de vos
souliers. — André, les maximes sont très-bonnes en théorie. — Hé bien, Monsieur,
emmenez-la avec vous, et si elle s’ennuie en route, elle fera la chasse aux
marmottes. On ne trouve point à chaque pas une baume, une touffe de lilas,
un terrier, bien ouvert…. — Mais je crois que tu deviens Mouche, à ton tour.
— Ah, voici notre landamman. — Il arrive à propos, n’est-ce pas ? — Pour
vous, Monsieur. »
Maître
Heilberg venait nous représenter que nous étions loin encore du moment où
nous pourrions nous installer sur nos domaines ; que nous ne pouvions, pendant
un mois, coucher dans nos chariots, ou incommoder nos hôtes. Il avait avec
lui le charron le plus distingué du bourg, qui était aussi architecte au
besoin. Il était disposé à nous bâtir, sur la place, une maison de bois,
dans les dimensions qu’il recevrait de nous. Elle ne devait être tenue qu’avec
des chevilles. Rien de si facile que de la démonter plus tard, et de la transporter
sur notre esplanade.
Bleker
nous proposa ensuite de se charger de la construction du pont sur la Sitter,
et le tout à des conditions très- raisonnables. « Je suis sa caution, dit
Monsieur Heilberg, et je vous réponds que ses travaux terminés, sa nourriture
et celle de sa famille prélevées, ses frais rentrés, il ne lui restera pas
vingt livres. — Mais, mon cher concitoyen, vous savez donc tout faire ?—
Je vous ferai aussi des brouettes. Il vous en faudra pour transporter les
débris de la vieille roche. Si vous avez une
pièce
à mettre à votre habit, de l’hydromel à fabriquer, je suis encore votre homme,
et, avec tout cela, j’ai bien de la peine à élever, physiquement et moralement,
six enfans que ma femme m’a donnés. — Bah ! il est aussi physicien, moraliste.
— Et homme libre, ce qui vaut mieux. — Dites-moi, mon cher docteur, pourriez-vous
nous recevoir dans votre maison de bois, demain au soir ? — Pourquoi pas
? j’ai des poutres et des planches de sapin ; mais je serai obligé de prendre
du monde, pour m’aider à les mettre en œuvre. — Hé bien, ne perdons pas un
moment. Tu ris, André ; tu ferais bien mieux de croquer le plan de notre
nouvelle habitation. Cela te regarde, mathématicien.
« Un plan,
reprit Bleter ! je n’y entendrai rien. Combien êtes- vous de personnes à
loger ? — Trois hommes et trois femmes.
— Et
vous habitez deux par deux ? — Répondez donc, Monsieur. Il ne faut pas être
grand calculateur pour cela. — Monsieur André est aujourd’hui sur le ton
plaisant. — Je vais répondre pour vous. Une chambre spacieuse pour moi, ma
femme, et deux enfans. Une autre chambre commode pour mon ami. À côté, un
cabinet pour mademoiselle. Il est sujet à des palpitations de cœur, surtout
pendant la nuit, et elle lui administre des calmans. Il n’y a pas de mal
à cela, répliqua le charron architecte. — Enfin vous logerez, comme vous
le pourrez, notre domestique de confiance et notre cuisinière ; mais à distance
convenable. — J’entends, j’entends. Tout cela sera établi dans un petit étage
à six pieds du sol. Vous y monterez par une échelle solide, et vous aurez
le toit sur vos têtes. — Mais, ami charron, il commence à faire froid, le
soir, et les vents coulis ne sont pas agréables. — Vous sentez bien qu’on
ne couvre pas une maison apparente avec du foin, arrêté par des pierres ;
ce serait la déshonorer. Je joindrai les planches
avec
de la résine, elle ne fond pas l’hiver, et l’été, on aime à avoir de l’air.
— Mais la cuisine, partie essentielle d’une habitation ; mais une écurie
pour nos mulets ? — Vous aurez cela sous vos pieds, et si vos mulets se battent
la nuit, vous n’aurez que deux sauts à faire pour aller mettre le holà.
»
Marianne
était toujours à portée de m’entendre ; par conséquent elle ne perdait pas
un mot de ce que disaient mes interlocuteurs. Je l’avais vue pâlir, rougir,
sourire ; elle avait gardé le plus profond silence. À la vérité, il fallait
se fâcher des picoteries d’André, ou avoir l’air de ne les avoir pas comprises.
Mais
le lendemain, elle fut levée la première. Elle éveilla Bertrand ; elle lui
fit enfermer nos petites propriétés dans un des chariots ; elle fit atteler
deux mulets à chacun des trois autres, et quand je descendis sur la place,
elle vint au-devant de moi, une bêche sur l’épaule. « Que voulez-vous faire
de cela ? — La chasse aux marmottes. » Nous sourîmes tous deux ; elle rougit,
encore ; mais, quand elle est seule avec moi, sa rougeur n’annonce pas le
dépit.
Nos
chariots étaient vides, et nous n’étions pas assez dupes pour faire le chemin
à pied ; c’était bien assez de marcher au retour. André conduisait le premier
chariot, Bertrand le second, et moi le troisième. Elle était là, toujours
là. Au reste, nos Suisses, de nouvelle date, avaient l’habitude de l’y voir.
Nous arrivâmes à Saint-Gall, avant midi.
C’est
une forteresse que cette ville-là. Trois gardes, très-bien vêtus, mais d’une
figure très-plate, nous demandèrent ce que nous voulions. André, qui était
en tête, répondit que nous étions députés par le petit conseil d’Appenzell,
auprès de Monseigneur, et que nous avions des dépêches à lui remettre. À
ces
mots, les trois gardes nous portèrent les armes, et l’un d’eux se détacha
pour nous conduire au palais abbatial. « Ah, dis-je à Marianne, on rend les
honneurs militaires à des paysans du canton d’Appenzell ! Monseigneur n’a
pas oublié que les Appenzellois ont battu ses prédécesseurs, et les ont forcés
à reconnaître leur indépendance. Celui-ci veut vivre en bonne intelligence
avec eux. »
L’abbé
de Saint-Claude nous avait marqué quelque considération. Celui de Saint-Gall
nous reçut avec cordialité. Il avait aussi sa petite couronne, à sa crosse.
Il la fit disparaître, sans doute dans la crainte que cet aspect blessât
les yeux d’hommes libres : voilà des procédés. Il lut ensuite les dépêches
dont nous étions chargés. « C’est bien, fort bien, nous dit-il. Tout s’arrangera
comme le désirent Messieurs du petit conseil. Commencez par faire porter,
et faire compter votre or à ma caisse. Dans trois jours, on vous l’escomptera
en monnaie de billon. — Dans trois jours, Monseigneur ! » — Vous sentez bien
que je ne ferai pas cette opération avec mes propres deniers. Je lèverai
un nouvel impôt, et il faut bien trois jours pour la perception, les significations
de contraintes, et les exécutions. »
Monseigneur
me parut très-familier avec les mots techniques de la basse finance. J’en
conclus qu’il avait souvent recours aux moyens innocens pour se procurer
de l’argent.
L’abbé
de Saint-Claude fait cultiver son territoire, très-borné, par ses serfs,
et les fait travailler à coups de fouet. L’abbé de Saint-Gall, souverain
d’une province, ne peut entrer dans ces petits détails. Mais il laisse à
ses sujets tout juste ce qu’il leur faut pour ne pas mourir de faim, et cela
revient au même. Auri sacra fames est la devise de ces deux messieurs.
D’après cela, il
faut
que ces malheureux rendent à César, non ce qui lui appartient, mais ce qu’il
demande.
« Messieurs,
reprit Monseigneur de Saint-Gall, quelle est cette jeune et très-jolie dame
qui vous accompagne ? Messieurs du petit conseil ne m’en parlent pas dans
leur missive. » Je pensai aussitôt à la réponse d’Abraham au roi du désert,
réponse qui le priva, pendant quelques jours, de la belle Sara, qu’il avait
fait passer pour sa sœur. Je m’empressai de répondre que Marianne était ma
femme. Je fus contraint à mentir par la nécessité. Ce ne fut pas ma faute.
« Madame
est charmante, et je vous fais mon compliment. Je ne souffrirai pas que les
députés de mes amis d’Appenzell logent ailleurs que dans mon palais. Faites
transporter ici votre or et vos effets. Je vais donner mes ordres pour que
votre affaire se termine promptement. » Nous n’avions pas de raison pour
refuser. Nous répondîmes poliment, et nous nous levâmes.
« J’espère
que Madame restera avec moi, jusqu’à votre retour. Je lui ferai voir mon
cabinet, ma bibliothèque. — Monseigneur, je n’aime pas la lecture, et je
ne quitte jamais mon mari. » Elle prit mon bras, et nous sortîmes. « On n’est
pas obligé, me dit- elle, de garder son cœur pour quelqu’un qu’on ne connaît
pas ; mais on met son bonheur à le lui conserver, quand il s’est présenté.
» L’abbé de Saint-Gall a raison : cette fille-là est charmante. Elle m’aime
véritablement, et son amour-propre est flatté de me sacrifier un prince.
André,
Bertrand et moi, portâmes facilement, en un seul voyage, notre or à la trésorerie.
Monsieur le trésorier nous reçut avec la plus grande affabilité : l’aspect
de ce métal a quelque chose de séduisant. Nous lui aidâmes à le compter,
et il nous en donna son récépissé. « Cela ne suffit pas, lui dit le prévoyant
André.
Signez-nous l’obligation de nous rembourser, en petite monnaie, dans trois
jours au plus tard. — Bah ! si Monseigneur refusait de remplir cet engagement,
à qui vous adresseriez- vous ? Au canton d’Appenzell, répondis-je fièrement,
qui enverrait dix mille hommes, solliciter notre remboursement, à coups de
mousquets. » Le trésorier baissa les yeux, écrivit et signa.

Saint-Gall
par Julius Zimmerman, 1881

Costumes
de Saint-Gall, par Achille Dévéria, vers 1830
CHAPITRE
XXXIII.
Grande
Catastrophe. Notre emménagement.
Nous
allâmes faire un tour par la ville. Le peuple était dans la consternation.
On y annonçait, à sonde trompe, un emprunt forcé, remboursable selon le bon
plaisir de monseigneur, et qui devait être rempli dans trois jours au plus
tard. « C’est un maladroit que cet Abbé, dis-je à mon philosophe. Il devrait
opprimer les cantons éloignés, et ménager les sujets de sa capitale, qui
touchent à sa personne. Mais le despotisme ne raisonne jamais. — Le gouvernement
de la Turquie est le despotisme, mitigé par le sultanicide. Qui sait
quel sort est réservé à Monseigneur ? »
Nous
rentrâmes à l’heure du souper, et nous fûmes splendidement servis. Monseigneur
avait placé ma dame à côté de lui. Il avait d’elle le plus grand soin, et
il lui adressait les choses les plus aimables, ce qui ne me plaisait pas
du tout. Je conviens, cependant, que c’était un homme d’esprit que cet abbé
de Saint-Gall.
Nous
en étions à l’eau-de-vie brûlée. Les domestiques se retirèrent. Monseigneur
s’égayait. Son exemple gagnait, de proche en proche. Les principaux membres
de son chapitre avaient eu l’honneur de le regarder souper. Admis à sabler
avec
nous
la liqueur bienfaisante, ils se traitèrent en gentilshommes allemands ; ils
en burent, et beaucoup. Bientôt ils chantèrent en duos, en trios, en quatuor.
Monseigneur daignait faire chorus. La joie était dans toutes les têtes,
et si l’Abbé n’eût pas serré Marianne de si près, j’aurais été aussi de très-bonne
humeur.
Tout
à coup la scène changea. Un tumulte effrayant se fit entendre, sur l’escalier
d’abord, et bientôt dans l’antichambre. La porte du salon s’ouvre; un homme
se précipite... Il a un coutelas ensanglanté à la main... Il frappe Monseigneur;
il le perce... sa tête tombe sur les genoux d’André.
Nous
nous écrions... Marianne s’évanouit. « J’ai tué le tyran, dit froidement
l’assassin, » et il sort. Je cours à Marianne ; André se dégage de son fardeau.
Lui et les chanoines regardent, examinent... Monseigneur ne vit plus.
Ils
l’enlèvent. Il faut sortir de la salle, pour le porter sur un lit ; ils chancèlent,
ils tombent... Trois valets, égorgés, ont obstrué le passage. Marianne a
repris ses sens ; je la conduis à la première chambre qui se présente devant
moi ; je l’y enferme. Je descends, j’appelle ; personne ne me répond. Je
me jette dans la rue.... Des cris de joie éclatent de toutes parts. « Le
tyran n’est plus, criaient les uns ; l’emprunt forcé est rempli, criaient
les autres. J’étais stupéfait, étourdi, incapable de prendre une résolution.
Que pouvais-je opposer, d’ailleurs, à un mal sans remède ?
J’espérais
apprendre quelque chose d’un événement, inexplicable moi. Je me glissai dans
la foule, et j’écoutai.
« Les
gardes de la porte de la ville ont voulu arrêter Bellesk : nous étions avec
lui. — Nous lui avons amené sa femme... —
Ils
sont sortis de Saint Gall ensemble... — Et dans une heure ils seront en sûreté.
— Il n’en faut pas davantage pour franchir la frontière des Rhodes extérieurs
du canton d’Appenzell. — Allumons des feux de joie. »
Je me
perdais dans mes conjectures Je m’arrêtai à l’idée que l’emprunt forcé avait
exaspéré Bellesk, et lui avait mis les armes à la main. Cet accroissement
intolérable d’impôts aurait pu le déterminer ; mais, depuis trois mois, il
nourrissait, dit-on, des projets de vengeance.
Il aimait
passionnément une très jolie fille, et il était payé de retour. Partout où
un jeune homme et une jeune fille peuvent vivre, il se fait un mariage. Cette
union est redoutée, de ceux que la misère accable. Cependant les suites d’une
liaison trop intime contraignirent ces jeunes amans à faire légitimer leur
faiblesse. Ils furent mariés.
Monseigneur
tenait beaucoup à ses droits féodaux ; mais surtout à celui de jambage, de
marquette et de prélibation. Les jeunes époux connaissaient cette loi barbare,
et peut-être les avait-elle déterminés à cacher longtemps leur amour.
Monseigneur
se fit amener Edeze par ses gardes, dont un seul n’osait, en ce-moment, se
montrer à ses compatriotes indignés. Edeze pleura. Monseigneur fut sans pitié.
Le lendemain
matin, Bellesk, désespéré, vint réclamer sa femme. L’abbé lui fit dire qu’il
n’avait droit qu’à une nuit sur une vierge ; mais qu’à l’égard des jeunes
mariées, qui ne l’étaient plus, son privilège était indéfini. Bellesk, furieux,
écarte ceux qui s’opposent à son passage ; il pénètre jusqu’à la
chambre
à coucher de Monseigneur. Il le trouve avec sa femme éplorée ; elle vient
se jeter dans ses bras.
« Monseigneur,
s’écrie Bellesk, je vous dois le respect, et je vous le porte ; mais je ne
vous dois pas ma femme, et vous ne l’aurez pas. L’abbé, choqué de cette insolence,
le fait arrêter par ses valets, le condamne à trois mois de prison, et garde
sa femme.
Ce matin,
Bellesk a été rendu à la liberté. Sa vengeance a été prompte et terrible.
« Nous
connaissons la loi, disaient certaines femmes, et nous nous y sommes soumises.
Mais deux, trois, quatre nuits ! cela est intolérable. » Ainsi l’esclave
ne raisonne que sur le degré d’avilissement où peut le réduire un maître,
plus méprisable que lui.
Je rentrai
dans le palais. Tout y était dans un désordre, facile à imaginer ; mais aucun
homme du peuple n’y avait pénétré. Les gens de Saint-Gall n’avaient pas voulu
déshonorer leur vengeur.
Les
membres du chapitre, le trésorier, ce qui restait de valets étaient en fuite.
Bertrand fumait tranquillement sa pipe auprès du corps, qu’on avait confié
à sa garde. Celui, dont le nom seul faisait trembler, une heure auparavant,
deux cent mille serfs, était moins que le dernier d’entre eux. Je cherchai
André. Il était au trésor. « Hé bien, André ? — Hé bien, Monsieur ? — Qu’allons-nous
faire ? — Rien. — Comment, rien ! — Attendre, est-ce faire quelque chose
? — Ah, tu veux attendre, et quoi ? Notre or est là. Reprenons-le, et allons
le changer en ville. Les habitans ont de la petite monnaie, puisqu’en trois
jours, à coups de bâton, ou autrement, ils devaient payer
quarante-quatre
mille livres. — Cette caisse est fermée à clef.
— Nous
la forcerons. — Le joli expédient ! — Il est tout simple. — Et quoi que nous
fassions, le chapitre nous accusera d’avoir pillé le trésor. Il faut attendre.
— Ce chien d’homme-là a toujours raison. — Allez vous assurer que Marianne
ne manque de rien, et revenez ici, avec Bertrand. Vous êtes deux fiers-à-bras
; vous ne permettrez pas qu’on enlève rien de cette caisse, que sur un ordre
écrit du chapitre. — Nous n’avons pas d’armes. — Et ce récépissé du trésorier
? Et cette obligation de nous rembourser dans trois jours ? Au reste, si
vous croyez avoir à batailler, descendez à la cuisine, et prenez des broches.
» Mon premier soin fut de tirer Marianne de sa prison. Mais où est-elle ?
Ce palais est immense, et je n’en connais pas les détours. Fort heureusement,
il y a encore, çà et là, quelques flambeaux allumés. Le vent les éteignit,
les uns après les autres. J’allais d’un corridor à un autre ; j’essayais
ma clef à toutes les portes ; aucune ne s’ouvrait. Comment un homme qui ne
craint rien, a-t-il pu oublier son chemin ? Je ne crains rien sans doute
; mais un assassinat, commis sous mes yeux, a dérangé toutes mes idées.
J’errais
dans l’immensité de ce palais, mon flambeau à la main, comme ces ombres qui
apparaissent la nuit aux mortels effrayés. Le plus profond silence régnait
autour de moi, et toutes ces circonstances m’inspirèrent enfin une terreur
que je ne pus maîtriser. Bientôt une sueur froide coula de tous mes membres
; je voulus m’asseoir ; je m’y pris gauchement, et j’éteignis mon flambeau.
Je voulus crier : ma voix expira sur mes lèvres.
J’étendis
les bras autour de moi. Je sentis une arme... C’était un mousquet qu’un des
gardes avait jeté, sans doute, pour fuir
plus
rapidement. Je n’avais personne à combattre ; je m’en servis pour me relever.
On fait tout mal, quand on a peur. Un de mes doigts se porta machinalement
sur la détente. Le coup partit.
Aussitôt
une vive lumière frappa mes yeux. Elle était à quatre pas de moi. Un homme
d’une stature colossale la portait ; son air était menaçant ; il avait une
pertuisane à la main, et j’étais sans défense. J’invoquai mon patron, mon
patron que j’avais oublié, depuis qu’André m’avait rendu tolérant. Tout changea
aussitôt. Le colosse ne fut plus qu’un homme de ma taille ; sa pertuisane
ne me parut qu’un bâton... C’était Bertrand.
« Sur
qui avez-vous fait feu ? — Aide-moi à me relever. » Il me conduisit dans
la chambre où il gardait un corps, qui n’avait plus besoin de l’être. J’y
trouvai un goupillon ; je me signai, en aspergeant feu sa Grandeur. Comme
la peur rend dévot ! J’étais redevenu le petit frère Antoine.
Je contai
à Bertrand ce qui m’était arrivé, depuis que je m’étais éloigné du trésor.
« Moi je dormais tranquillement, me dit-il ; votre coup de mousquet m’a éveillé.
— Rallume mon flambeau ; prends le tien, et cherchons Marianne. — Mademoiselle
Marianne ! elle est là. — Où là ? — Dans cette chambre ouverte. — Et j’en
tiens la clef. — Vous l’avez tournée ; mais la porte n’était pas poussée.
— En vérité, depuis deux heures, je ne sais ce que je fais. »
Je me
précipitai dans cette chambre. « Pourquoi êtes-vous restée là ? — Parce
que vous m’y avez mise. — Mais ce coup de mousquet. — Il m’a effrayée ; mais
je n’ai pas cru qu’il m’autorisât à sortir. — Prenez mon bras,
Marianne, et
descendons
tous trois à la cuisine. Nous nous y armerons de ce qui nous tombera sous
la main. »
Nous
ne fûmes pas obligés d’aller jusque-là. Ici, nous trouvions un mousquet,
et des cartouches dans une escarcelle ; là, des épées, et une hache d’armes.
Les tyrans ont grand soin d’armer leurs satellites ; mais à quoi des lâches
sont-ils bons ? Ceux-ci avaient pris la fuite, par la seule crainte d’ennemis,
qui ne se présentèrent pas.
On y
voit bien quand on est trois ; nous retrouvâmes assez facilement la trésorerie.
Une autre scène s’y passait. André ne craignait que le fer et le feu. Il
rossait vigoureusement monsieur le trésorier, qui s’était introduit clandestinement,
sans doute par des détours qu’il connaissait. Étourdi de rencontrer là André,
il lui avait offert de lui rendre nos quarante-quatre mille livres ; mais
à condition qu’il le laisserait maître de ses actions : il voulait faire
une saignée à la caisse, et rendre ses comptes avec ses jambes. André s’y
était opposé ; le trésorier avait insisté, et la contestation s’était terminée
par le pugilat.
Nous
mîmes cet homme dehors ; nous nous enfermâmes soigneusement, et nous dormîmes,
le reste de la nuit, Marianne sur le coffre-fort, et nous par terre.
A la
pointe du jour, nous entendîmes un grand bruit. C’étaient toutes les cloches
qui sonnaient ; des gens, qui allaient et venaient dans le palais ; des enfans
de chœur, qui faisaient résonner leurs voix criardes. Nous sortîmes ; nous
fermâmes trois ou quatre portes sur nous ; nous barricadâmes la dernière
avec du bois de chauffage, qui se trouva là ; nous nous assurâmes bien qu’il
n’y avait pas d’autre chemin pour arriver au trésor, et nous allâmes voir
ce qui se préparait.
Nous
rencontrâmes d’abord Messieurs les gardes, en grande tenue. Ils étaient venus
reprendre leur poste, dès qu’ils avaient cru le pouvoir faire sans danger.
« Rendez-moi mon mousquet, nous disait l’un ; rendez-moi mon épée, nous disait
l’autre. Des soldats qui jettent leurs armes, répondis-je, sont indignes
de les porter. — Oh, les poltrons ! crièrent leurs camarades, » et ils avaient
fui comme eux ! Bientôt on se hâta d’inhumer Monseigneur : c’est par-là que
finissent les grands et les petits. C’est bien la peine d’être si fier !
Cette précipitation nous étonna : nous en connûmes bientôt la cause.
Le chapitre
arriva, processionnellement. On chanta, on chanta à rendre l’ouïe à des sourds,
et on déposa sa Grandeur dans le petit caveau, d’où elle ne devait plus sortir,
et où personne n’ira lui rendre visite.
Messieurs
les chanoines s’enfermèrent de suite dans leur espèce de conclave, sans se
donner le temps de quitter leurs habits sacerdotaux. Une heure après, on
proclama le comte Ulric, au son des cloches et du canon. Nous remarquâmes
que les canonniers ne manquaient jamais de tourner la tête en y mettant le
feu.
Le comte
Ulric était un homme de soixante ans, qui n’aimait plus les petites femmes,
et qui, peut-être, aimera son peuple. Ainsi soit-il.
Il signala
son autorité d’un moment en supprimant l’emprunt forcé, et ses serfs le bénirent
: c’est ainsi que commencent les bons et les mauvais règnes.
Nous
allâmes le féliciter, André et moi, et nous lui racontâmes l’escapade qu’avait
voulu faire le trésorier. « Cela ne m’étonne
pas,
nous dit-il. J’ai toujours eu des raisons de soupçonner cet homme. Mais mon
prédécesseur ne comptait jamais avec personne, ni avec lui-même. Au reste,
j’approuve la conduite que vous avez tenue.
« Je
vais vous faire rendre votre or. Vous le changerez facilement dans la ville,
quand on y saura qu’il n’y a rien à perdre. Ceux qui ont des économies seront
bien aises de les convertir en or : cela tient moins de place. » Mais j’espère
que personne ne sera tenté d’enfouir ses richesses, tant que je porterai
la crosse. » Oh, le digne homme d’abbé,... si ces sentimens-là durent autant
que lui.
J’avais
eu l’honneur de trinquer avec sa Grandeur, à la fin de ce souper, dont le
dénouement fut si inattendu et si terrible. Je pris la liberté de lui faire
quelques questions sur la rapidité des événemens qui venaient de se passer.
Les
familles les plus illustres de la Souabe font entrer leurs cadets dans les
ordres. Elles en font des abbés, des évêques, des cardinaux. Les revenus
immenses de l’abbaye de Saint-Gall la font préférer à un archevêché. A la
première nouvelle de la maladie grave d’un abbé, tous les princes de Souabe
intriguent. Ils prodiguent l’or, les promesses, et les menaces. Des troupes
paraissent sur les frontières, et le chapitre de Saint-Gall est obligé de
ployer. Voilà, pensai-je, des élections aussi libres que celle du député
d’Arpajon.
« C’est
pour obvier, au moins une fois, à cet abus, ajouta Monseigneur, que nous
nous sommes hâtés de faire un abbé. Les seigneurs de la Souabe n’auront aucune
observation à faire : nous sommes tous aussi nobles qu’eux. » On n’entre
au chapitre de Saint-Gall, qu’après avoir prouvé douze quartiers de
père
et de mère. — Mais, Monseigneur, le grand Sixte-Quint n’est pas noble. —
Autres lieux, autres mœurs. »
Il nomma
aussitôt un trésorier, dont il était sûr….. autant qu’on peut l’être d’un
trésorier. Nous touchâmes notre or, en échange de nos papiers, et nous commençâmes
à courir la ville, nos sacs sur les bras. La petite Marianne voulut aussi
porter le sien.
Nous
allâmes de porte en porte, et toutes les bourses nous furent ouvertes. A
mesure que nous changions, nous jetions notre billon dans des besaces, et
nous revenions les déposer à la trésorerie. Le nouveau trésorier y apposait
le cachet de Monseigneur, précaution assez inutile : nous n’avions pas à
craindre qu’un trésorier de deux heures, qui ne pouvait être au courant de
rien, s’avisât de se compromettre par quelque gaucherie.
Monseigneur
de la veille nous avait comblés d’amitiés, parce que Marianne lui plaisait
beaucoup. Monseigneur du jour ne nous engagea ni à rester, ni à sortir. Marianne
reprit, pour un moment, ses premières fonctions. Elle nous apprêta un déjeuner
à la française dans un cabaret. « Je me doutais, dit-elle, en tournant ses
casseroles, que vous auriez besoin de moi. »
On ne
connaît pas l’hospitalité dans la principauté de Saint- Gall. Le primo
mihi est la devise de l’homme asservi. Notre hôte se fit payer chèrement
: il faisait son métier.
La plus
grande partie de la journée était écoulée. Cependant, nous avions plus de
temps qu’il n’en fallait pour rentrer dans le canton d’Appenzell. Nous étions
impatiens de respirer l’air de
la
liberté. Nous chargeâmes nos chariots, et nous fûmes prendre congé de Monseigneur.
Il nous
offrit une escorte, d’après le vœu exprimé par le petit conseil. Nous le
remerciâmes, d’abord parce qu’il n’était pas vraisemblable que des gens que
nous avions obligés, en leur donnant de l’or, pensassent à nous voler ; ensuite,
parce que Bertrand et moi valions mieux que toute la garde de monsieur l’abbé.
Les
trois hommes qui étaient de garde à la porte de la ville nous honorèrent
du salut militaire. Des députés du canton d’Appenzell ! Nous le leur rendîmes
avec les mousquets de leurs camarades, chargés de trois balles, et ils eurent
l’air de ne pas les reconnaître.
Nos
voitures étaient pesamment chargées ; nous étions tous quatre à pied, et
il fallait ménager Marianne. Elle marchait en tête de la troupe, sa bêche
sur l’épaule. Ses tresses flottantes, son chapeau de paille, jouant au gré
d’un air doux, ses petites mines, quand elle se tournait, pour voir si nous
la suivions, la rendaient vraiment charmante. C’était une petite Amazone,...
non de celles qui détestaient les hommes, qui les fuyaient, et à qui Alexandre,
dit le Grand, fit l’honneur de les combattre.
À la
chute du jour, nous entrâmes dans le village de Hérisau, le premier du canton
d’Appenzell, du côté de Saint-Gall. Le bourgmestre nous aborde aussitôt.
Nous étions en retard de vingt-quatre heures, et il n’était pas sans inquiétude.
Bellesk et Edeze étaient arrivés de la veille. Ils avaient raconté l’événement
tragique, qui s’était passé au château de St.-Gall, et nous aurions pu en
être victimes. Nous racontâmes, à notre tour, des choses que Bellesk ne pouvait
connaître.
«
Cet homme, nous dit le bourgmestre, est digne d’être Suisse, et si les habitans
de Saint-Gall avaient quelque énergie, ils suivraient le grand exemple que
donna Guillaume-Tell à tous les opprimés.
« J’ai
assemblé hier le petit conseil. Les avis ont été partagés, et on n’a rien
résolu. Si nous faisons passer cet homme et sa femme en Souabe, ils peuvent
être livrés au nouvel abbé. Leur permettre de s’établir ici sera peut-être
provoquer une rupture entre Saint-Gall et nous. Nous avons battu ces esclaves,
et nous les battrions encore. Mais il est dans l’intérêt de tous de prévenir
l’effusion du sang. »
Nous avons
souvent reconnu que rien n’embarrassait André.
« On
ne livrera pas Bellesk à l’abbé de Saint Gall, dit-il, s’il ne le réclame
pas, et il sait bien que sans son coutelas, il serait encore simple dignitaire
de son chapitre. Admettons que le seigneur Ulric entreprenne, pour la
forme, de venger son prédécesseur. La joie que sa chute a inspirée au peuple,
ces réjouissances publiques ne doivent-elles pas faire craindre qu’il se
soulevât, s’il voyait traîner Bellesk au supplice ? Pourquoi, d’ailleurs,
s’exposer à des chances, toujours incertaines ? Cet homme sait-il un métier
? — Il est, dit-il, bon cordonnier. — On use des souliers partout. Qu’il
parte d’ici la nuit avec sa femme, et qu’ils filent sur Genève. Ils n’auront
pas un sou à dépenser sur la route. Nous leur donnerons une lettre pour
notre ami Simon, maître pêcheur à Copet, et de l’argent pour acheter du cuir
en arrivant. Qui diable ira les chercher là ? »
J’embrassai
André; le bourgmestre l’embrassa, et il nous présenta les jeunes époux. Edeze
était vraiment jolie, et son lacet devenu trop court, la rendait plus intéressante.
Nous mîmes quelques poignées de petites pièces d’argent fin de
Souabe,
dans le tablier de la petite femme, et le bourgmestre leur enjoignit d’être
prêts à partir aussitôt qu’ils auraient notre lettre pour Simon.
« Venez
l’écrire chez moi, nous dit-il. Vous y logerez, et je vous arrangerai aussi
bien que je le pourrai. » Nous laissâmes notre fortune sur la place publique,
et nous suivîmes le bourgmestre. André fit sa lettre, Bellesk la prit, nous
remercia jusqu’à nous fatiguer, et Madame Budenn nous invita à nous mettre
à table. Nous fêtâmes les pommes de terre, le seret, le petit lait, l’hydromel,
et nous allâmes nous jeter sur les sacs de paille d’avoine qu’on nous avait
préparés.
Le lendemain
matin, nous nous préparâmes à partir. André me parut rêveur, et je lui en
demandai la raison. « Je pense à ma pauvre Claire. Elle est froide ; mais
elle a un cœur, un excellent cœur, et elle doit être en proie aux plus vives
alarmes. — Dans cinq à six heures, tu seras auprès d’elle. — Oui ; mais en
attendant... » Pour moi, dit Marianne, si j’étais restée à Appenzell, je
serais déjà morte. »
Nous
nous mîmes en route. En traversant le canton, pour aller à Saint-Gall, nous
étions préoccupés. Nous pensions à l’affaire qui nous y conduisait, et ce
qui s’y passa justifie nos réflexions. Nous étions tranquilles, en revenant
à Appenzell, et nous examinâmes le pays. André l’observait avec nous, quand
le nom de Claire ne s’échappait pas de ses lèvres.
Ce pays
ingrat, dont la nature semblait avoir éloigné les hommes, est composé de
montagnes, plus ou moins accessibles, de glaciers, de torrens, de lacs, et
de prairies, qu’arrosent de petites rivières et des ruisseaux. Nous jugeâmes
que la température doit être froide l’hiver, et variable pendant l’été. Ce
climat
ne peut être habité que par des hommes libres, ou par des esclaves que la
force y retiendrait.
Maître
Budenn nous avait assuré que la partie réformée a trente-huit mille habitans,
et que la partie catholique n’en a que treize mille, ce qui fait, au total,
cinquante et un mille, population extraordinaire pour un territoire si resserré.
Mais l’aisance dont chacun jouit ; mais la liberté.... En cas de guerre,
les réformés doivent fournir six mille trois cents hommes armés, et les catholiques
deux mille sept cent quatre-vingts. André avait voulu établir, d’après ces
données, la différence d’étendue de chaque district ; mais le souvenir de
Claire avait dérangé ses calculs.
Les
grands cantons suisses sont divisés en bailliages, et le bailli est le chef
d’une portion de territoire. Celui d’Appenzell est trop cisconscrit pour
avoir besoin de subdivisions.
Nous
avions fait les deux tiers du chemin, sans nous en apercevoir. Le temps coule
rapidement, quand on observe, qu’on réfléchit, et qu’on discute. Tout à coup,
nous aperçûmes un homme et une femme, qui s’avançaient à grands pas de notre
côté. Nous reconnûmes bientôt qu’ils portaient chacun un enfant. « C’est
Claire, s’écria André, et il s’élança au-devant d’elle. — C’est notre landamman,
s’écria Marianne. Il porte Toinette, et elle courut au-devant de lui. Nous
doublâmes le pas, Bertrand et moi, et Marianne mit mon enfant dans mes bras.
Bonne petite fille ! Claire avait pleuré ; André l’avait déjà fait sourire.
Nous nous embrassâmes tous. Vint ensuite le récit de ce qui s’était passé
à Appenzell et à Saint-Gall, depuis trois jours, et cela était tout-à-fait
naturel. Claire était tombée, à la fin du second jour, dans la plus profonde
affliction. Le landannnan ne savait à quoi attribuer notre retard. Ils résolurent
de partir
ensemble,
et d’aller jusqu’à Hérisau, s’ils ne nous rencontraient pas plutôt. Gott
était restée pour nous apprêter à dîner, dans le cas où la fortune nous aurait
permis de revenir.
« Votre
maison est prête, nous dit maître Heilberg ; elle est même meublée, et complètement.
— Comment meublée ! — Oui. Des encaissemens pour recevoir vos matelas ; des
escabelles, des bancs de bois, et deux grandes tables, où on pourra se placer
vingt, aux jours de fériés ; voilà ce qui vous attend en haut. Vous trouverez,
en bas, une cuisine montée, et les ustensiles nécessaires ; à côté, est une
écurie pour vos mulets, et le grenier à foin est au-dessus de leurs têtes.
C’est un véritable palais.
« J’ai
conçu de l’affection pour vous ; mais, indépendamment de ce sentiment, j’étais
intéressé à vous retrouver : j’ai fait des avances que j’aurais perdues,
si vous n’étiez pas revenus.
« À
propos d’avances, vingt brouettes sont déjà confectionnées ; dans quatre
jours, vous en aurez vingt autres, et j’ai arrêté cent concitoyens, qui commenceront
à travailler demain, puisque vous avez des fonds. »
Nous
entrâmes dans notre palais, et nous engageâmes le landamman à dîner avec
nous en famine. Il commença par nous remettre nos lettres provisoires de
naturalisation. Elles étaient dans une petite boîte de carton, sur laquelle
était écrit liberté en lettres rouges. « Cette couleur, nous dit-il,
vous annonce que vous devez être prêts à verser jusqu’à la dernière goutte
de votre sang, pour défendre votre indépendance. » Il nous promena ensuite
dans notre hôtel, et nous en fîmes le tour en cinq minutes. Marianne vint
me dire à l’oreille : « Bleker est un homme charmant : il n’a pas oublié
les palpitations de cœur. »
Telle
qu’était notre maison, nous la trouvâmes fort au-dessus de celle du premier
magistrat du district catholique, et je lui en fis l’observation. « Cela
doit être ainsi, me répondit-il,
« puisque
vous êtes plus riche que moi. Mais aussi vous êtes à jamais exclus des charges
publiques, et il y a compensation. Quand les Suisses porteront l’opulence
aux grands emplois, la liberté périra. » Il n’y avait rien à répondre à cela.
Nous
commençâmes notre joyeux repas en buvant tous, debout et la tête découverte,
au landamman et à la reconnaissance. Il but à la liberté, et à notre santé.
Quand
il fut retiré, nous examinâmes tout, dans le plus grand détail. Gott avait
mis partout un ordre remarquable ; nous l’en félicitâmes, et Bertrand sourit,
ce qui ne lui arrivait pas souvent.
Je regardais
ces planches, qui nous tenaient lieu de murailles, ces cuillers de bois,
ces assiettes de terre commune, et je dis à André : « Ce n’est pas là mon
château de la Tour. — Non, me répondit-il ; mais vous ne craindrez pas ici
que les ligueurs viennent, le mousquet à la main, vous disputer vos vivres.
Il y a encore là compensation. »
Nous
fûmes éveillés par une forte explosion. Nous nous levâmes. Il était déjà
grand jour. Le bruit nous indiqua que nos ouvriers travaillaient depuis le
crépuscule, et il est naturel de vouloir connaîtra l’asile qu’on s’est ménagé.
Nous recommandâmes à Gott de s’occuper de nous : l’invitation était inutile.
Nous chargeâmes Bertrand de vider nos chariots. Il était inutile qu’il comptât
l’argent : il était resté, pendant la nuit, sur la place publique. Il était
là sous la sauve-garde des citoyens. Nous nous mîmes en route pour le village
de Weissbad, qui allait être notre paroisse, et qui se trouva sur notre chemin.
Nous
allâmes saluer le bourgmestre. Il bêchait son jardin, et sa petite fille
lui apportait son déjeuner, dans une écuelle de bois. Il nous demanda qui
nous étions. Quand nous nous fûmes fait connaître, il nous offrit ses bons
offices, et continua à bêcher son jardin.
Nous
entrâmes chez le curé. Nous le trouvâmes, causant d’amitié avec un ministre
protestant, qui avait passé la Sitter, pour venir le visiter. Ce rapprochement
parut nous étonner.
« Deux
hommes estimables, nous dit le curé, se rencontrent toujours. Nous adorons
le même Dieu, cela nous suffit, et nous ne parlons jamais de religion. »
Il nous proposa un verre d’hydromel, que nous acceptâmes. Il présenta du
petit lait à nos femmes et à nos enfans. Elles posèrent Toinon et Toinette
sur le sol, pour éviter au bon curé la peine d’avancer jusqu’à elles, et
pour se reposer les bras.
On a raison
de dire que l’homme, qui sort de chez lui, ne sait où il va. Nous avions
cru être au pied de l’Ebenalp à huit heures ; nous n’y étions pas à midi.
Nous ne pensions pas, en partant, à saluer le bourgmestre et le curé : cette
bonne idée nous était venue en chemin. Nous ne devions que passer : un incident
nouveau, intéressant, touchant, nous retint chez le curé.
Toinon
était assis par terre. Tout à coup, il s’appuya sur ses pentes mains, se
tourna sur ses genoux, et essaya de se lever. Sa figure rondelette toucha
le sol. Un instinct naturel le porta à rapprocher ses mains de ses genoux,
et à faire un mouvement en arrière. Il se trouva debout, et sourit à sa mère,
haletante de plaisir. Il avança vers elle, lentement, bien lentement, en
ne levant un pied que lorsque l’autre lui paraissait solidement établi ;
il se soutenait, en faisant des balanciers de ses petits bras. Claire était
dans l’enchantement. Nous la félicitions tous,
et
nous entourions l’enfant, pour prévenir une chute. André prononça que son
fils serait un grand homme, puisqu’il connaissait, à quinze mois, la force
de levier et les lois de l’équilibre.
Claire
avait pris son Antoine sur ses genoux, et le mangeait de caresses. Il fit
des mouvemens qui annonçaient clairement qu’il voulait descendre. Sa mère
le remit sur ses jambes. Il s’avança vers nous, et se fit faire place avec
ses petites mains. Marianne poussa un cri : Toinette était debout ; mais
elle ne marchait pas. Toinon s’approcha d’elle, et lui prit une main en souriant.
Elle sentait le besoin d’un appui, et elle se mit en marche aussitôt qu’elle
fut soutenue. Ils arrivèrent tous deux auprès de Claire, en se balançant,
en trébuchant quelquefois, et ils poussèrent un cri de joie quand ils touchèrent
les genoux de leur bonne nourrice. Moi, je pleurais de plaisir et d’attendrissement.
J’enlevai
Toinette dans mes bras, et elle me dit : Papa. Que ce mot s’adressât
à moi ou à André, il n’y eut plus moyen de m’en défendre. Je mouillais ses
joues rosées de mes larmes. Celles du curé et du ministre coulèrent. Tout
le monde était heureux.
Les
deux pères décidèrent qu’on peut sevrer des enfans qui marchent. Marianne
me demanda la permission de se charger de Toinette. Avec quel plaisir je
la lui donnai !
Nous
arrivâmes enfin au pied de l’Ebenalp. À quelle élévation la nature a porté
ces rocs sourcilleux, vieux comme le monde ! Des bouquets d’arbustes couronnaient
leur cime, de loin en loin, et la roche, dure et découverte, se montrait
dans les intervalles. Nous vîmes de près cette source, que nous n’avions
pu juger de la fenêtre du petit conseil. Elle jaillissait de la grosseur
du bras, s’engloutissait dans les ruines, depuis
quarante
ans, et allait se perdre, ainsi que je l’ai dit, derrière la montagne, dans
un petit lac, nommé Seealp, mer Alpine, qui se jette dans la Sitter.
Nous
trouvâmes là notre ami Heilberg, qui l’était, autant au moins, de ses compatriotes.
Je lui demandai s’il était venu pour inspecter nos ouvriers ; il ne me comprit
pas. Je lui dis, qu’en France, cent ouvriers auraient au moins deux piqueurs,
chargés de les faire travailler. « Ami Antoine, s’il en paraissait un ici,
ces braves gens mettraient leur pioche et leur pelle sur leur épaule, et
s’en retourneraient chez eux. Quand un Suisse s’est engagé à faire quelque
chose, il travaille avec autant d’ardeur que si c’était pour lui. — Et s’il
se conduisait autrement ? — Les autres l’appelleraient paresseux,
et c’est une des plus piquantes épithètes qu’on puisse adresser à un Suisse.
— Mais s’il se fâchait ? — Un de ceux, qui n’auraient pris aucune part à
la querelle, enjoindrait, de par la loi, aux parties de se taire, tous se
calmeraient, et le paresseux reprendrait son travail.
« Ils
ont employé une heure ce matin à se distribuer le terrain, et ce temps-là
n’a pas été perdu. Cette affaire réglée, chacun a pris sa pioche. En voyez-vous
qui s’étendent jusques dans la plaine. Ils vont élargir et niveler ce détestable
chemin qui conduit de l’Ebenalp à Appenzell.
« Je
suis venu ici pour leur indiquer l’endroit où ils doivent déposer ces débris.
Je leur ai fait remarquer la pointe d’un rocher saillant, qui allait les
arrêter. Ils l’ont fait sauter, et vous devez avoir entendu l’explosion.
Maintenant le passage est libre, et vous voyez qu’on commence à charger les
brouettes. Je suis resté là pour leur répondre, s’ils me demandent des conseils
; mais je me garde bien de les prévenir, je blesserais leur fierté. Amis,
André et Antoine, il est midi, et c’est l’heure
où
ces braves gens dînent. — Voulez-vous que je les invite à se reposer en attendant
? — Ils vous riraient au nez, et continueraient de travailler. Il leur est
dû une heure, et jamais ils n’en prendront davantage. — Je suis le plus jeune
et le plus leste, je vais courir à Appenzell, et savoir la cause de ce retard.
— Allez,
ami Antoine. À moitié chemin je rencontrai trente à quarante femmes, chargées
de hottes, dans lesquelles étaient plusieurs vases de terre, bien propres,
et soigneusement couverts. C’était la provision de nos ouvriers. Je croyais
leur devoir un léger dédommagement ; je voulus faire revenir à Appenzell
deux ou trois de ces femmes, à qui j’offris quelques bouteilles de vin. «
Pendant la semaine, me dit la plus âgée, il faut se soutenir et travailler
; mais si dimanche vous voulez venir à la prairie, et y faire porter du vin,
nous trinquerons, et nous danserons avec vous. Hé, quelques-unes étaient
fort jolies.
Je poussai
jusqu’à Appenzell. Je trouvai la pauvre Gott au désespoir. « Vous ne m’avez
pas donné d’ordres ce matin, et on ne fait pas à manger pour cent hommes,
comme un dîner de quatre personnes. Sans ce bon Bertrand j’étais perdue ;
mais votre argent est resté dehors. — Hé bien, bonne Gott, il est autant
en sûreté là qu’ailleurs.
« —
Il est impossible que je suffise à tout. Vous voyez que j’ai commencé à m’occuper
du souper ; mais quand sera-t-il prêt ? Deux femmes se sont présentées ;
mais je n’ai pas osé les arrêter sans votre permission. — Prends-en trois,
prend-en quatre, et ne perds pas un moment. » Elle courut aussi vite que
sa taille épaisse le lui permit. Bertrand prit une hotte, et alla chercher
des provisions.
J’entrai
dans notre cuisine. Une vaste chaudière était suspendue à un long bras de
bois, frappé, selon l’usage du pays,
dans
une pièce de charpente tournante. De l’eau chauffait ; mais il n’y avait
encore que de l’eau. Je sortis.
Trois
femmes arrivaient. Elles portaient chacune une perche sur l’épaule. Elles
les placèrent, sur la place publique, à une certaine distance les unes des
autres. Elles les réunirent, par le haut, avec une corde, et y attachèrent
une énorme chaudière, que Bertrand apportait sur son dos. Il retourna prendre
sa hotte, et la rapporta pleine d’orge, de fèves et de pommes de terre. Il
fit plusieurs voyages, et bientôt nous eûmes tout ce qu’il fallait pour faire
un souper d’anachorètes. Je l’ai déjà dit : des hommes qui se contentent
de cela sont invincibles.
Il était
deux heures, et je n’avais rien mangé encore. Je pris du pain d’avoine et
du beurre... Mais André et nos femmes n’avaient pas déjeuné. Dois-je, puis-je
m’occuper de moi seul ?
« Bertrand,
selle-moi un mulet, et garnis un panier. » Je partis ventre à terre.
Je ne
mis pas dix minutes à arriver au pied de la montagne. Les femmes étaient
arrivées avec leurs hottes. Les ouvriers étaient assis en cercle, armés
chacun de leur pot et d’une cuiller de bois. Je cherchais André, nos femmes,
nos enfans. Ils étaient placés avec nos travailleurs, et ils dînaient tous
ensemble. On leur avait proposé, avec cordialité, de partager le repas commun,
et ils avaient accepté avec un grand plaisir. Ils prenaient à droite, à gauche,
et les bonnes gens qui les traitaient étaient enchantés.
Je mourais
de faim, et je ne savais que faire de mon panier. Bertrand y avait mis des
choses recherchées, et cette espèce de luxe pouvait déplaire. J’étais embarrassé
; cependant je voulais manger. Le landamman m’appela. Sa femme lui avait
apporté
son
dîner, et il n’avait pas voulu y toucher, avant que ses compatriotes reçussent
le leur. Quelles mœurs ! Il partagea avec moi ce qu’il avait, et le panier
ne fut pas ouvert. Bertrand y avait mis du vin, et j’allai boire, avec les
autres, à la source qui s’échappait du flanc de la montagne. Je me sentis
digne d’être Suisse.
« Ami
Antoine, me dit maître Heilberg, je n’ai plus besoin ici, et je vais retourner
chez moi. N’oubliez pas que vous avez des dettes. — Nous sommes prêts à
les payer. — J’ai fait des avances, et je ne suis pas riche. Bleker a des
ouvriers à payer, et vous devez les provisions que vos gens ont prises dans
le village. — Faites-moi le plaisir de demander de l’argent à Bertrand.
— Sans que vous connaissiez la somme ?
— Je
m’en rapporte à vous. » Il me serra la main. « Et vous permettez que Bertrand
puise à votre caisse ? — C’est un homme courageux, à qui je dois la vie,
et puis n’est-il pas Suisse ? » Maître Heilberg m’embrassa.
Nous
restâmes là quelque temps encore. Nous examinâmes nos alentours. « Vois-tu,
dis-je à André, cette vaste baume qui est là à côté de la source, et dont
la base repose dans ces débris ? nous en ferons une écurie pour nos
mulets. — Il y a quarante pieds de décombres à enlever, et votre baume
restera peut-être en l’air. — Hé bien, nous en ferons un salon d’été. Nous
y monterons par une échelle Et je garnirai l’intérieur de mousse, me dit
Marianne. J’aime beaucoup les baumes. »
Nous
rentrâmes chez nous le soir, et nous trouvâmes un bénitier à notre porte.
C’est notre bon ami Heilberg qui l’avait fait placer.
Nous
avions remarqué, en traversant les Rhodes extérieurs, que les réformés tiennent
à leur religion ; mais sans enthousiasme. Les catholiques sont très-attachés
à la leur ; elle les suit partout. Ils prient dans leurs cabanes, dans les
champs, sur les montagnes. Ils portent presque tous un chapelet à leur ceinture
; ils le récitent, quand ils sont forcés de s’arrêter un moment. On trouve
un bénitier à la porte de chaque maison, et le maître offre de l’eau, avec
le bout du doigt, à ceux qui, en entrant, ont négligé d’en prendre, et de
se signer. Libres de toute espèce de dépendance, d’ambition et de cupidité,
leur piété est toute de conviction. Si j’avais rencontré ces gens-là, quand
j’étais novice chez les Franciscains, je serais tombé à leurs pieds.
Cependant
ces pratiques, souvent trop minutieuses, disparaissent devant les plaisirs,
l’amour, et quelquefois sous la gaîté que produit le vin du Rhinthal : la
nature ne perd jamais ses droits.
Nous
allions à l’Ebenalp, nous en revenions, nous nous promenions dans le bourg,
nous exercions nos jolis enfans, nous faisions connaissance avec nos voisins.
J’observais tout. Je redevenais la Mouche, non pour m’immiscer dans les affaires
des autres ; mais pour connaître des usages, auxquels nous devions nous soumettre.
Le reste de la semaine s’écoula ainsi, et nous savions déjà bien des choses.
Les
Appenzellois sont vigoureux, bien faits, braves, francs, pleins de probité,
et ils ont ira jugement sain, que développe l’instruction. Leur esprit est
vif, et leurs reparties sent piquantes.
On
voit, parmi eux, des vieillards plus robustes que bien des jeunes gens de
nos grandes villes : c’est la suite nécessaire d’une vie frugale, laborieuse,
et exempte de soucis.
Les
femmes sont gaies, fraîches, et quelques-unes sont très- jolies. En général,
elles ont de la grâce dans leur démarche, et même dans leurs actions les
plus indifférentes.
Les
Appenzellois veulent que leurs enfans leur ressemblent un jour, et surtout
qu’ils aiment la liberté comme eux. Ils les exercent, de bonne heure, à la
course, à la bitte, à lancer des pierres d’un grand poids, relativement à
leur âge. C’est leur enseigner à se défendre, comme l’ont fait leurs ancêtres
de Morgenten, de Granson et de Morat.
Ils
méprisent les forteresses, qui ne sont, disent-ils, que des moyens d’oppression.
Leurs montagnes sont leurs citadelles. On ne rencontre, dans tout le canton
d’Appenzell, que deux ou trois bourgs, quelques villages, et des paroisses
formées par des maisons éparses. Elles sont presque toutes bâties en bois.
Les murs de clôture sont élevés en pierres sèches.
Là,
comme dans toute la Suisse, la propriété est sacrée. La liberté, la suppression
de toute charge onéreuse ou arbitraire, la satisfaction de participer, par
leur vote, à la législation, dédommagent les Suisses de leur pauvreté. Elle
est telle, que les Appenzellois ne paient, pour tout impôt, qu’une livre
en argent, ou en denrées, qu’on exporte en Souabe, ou dans le pays de Saint-Gall.
Ainsi, nul n’est assez riche pour acheter son voisin, ni assez pauvre pour
se vendre.
La
plus parfaite égalité soutient le courage de tous, fait naître le goût du
travail, et l’industrie, qui forcent la nature à produire dans un pays ingrat.

CHAPITRE
XXXIV.
Usages,
jeux, travaux, bergers, événemens.
Le dimanche,
tout changea. Une journée de plaisir est toujours courte, quand elle succède
à six jours de travaux soutenus. On craint d’en perdre un moment. Dès l’aube
matinale, chacun s’occupait à faire valoir ses formes athlétiques, ou les
grâces de son sexe. Les maisons étaient ouvertes ; on allait, on venait,
on se prenait la main. Salut, homme libre, entendait-on de tous les côtés.
Une jeune fille s’aperçoit qu’il lui manque une aune de ruban ; elle court
l’emprunter mystérieusement à sa voisine. La jeune femme pare l’enfant, qui
la rend plus chère à son époux.
On se
cherche, on se rapproche ; on commence par le doux sourire, et bientôt le
mot amour se répète à demi-voix. Avec quelle douceur il résonne à
l’oreille de la jeune amante, à celle de son heureux amant ! Ils ont été
une semaine sans le prononcer.
Ici
l’amour seul fait les mariages, et ils sont tous heureux. Le désordre est
fils de l’oisiveté, et à peine son nom est-il connu en Suisse. Aussi le consistoire
s’y assemble bien rarement. Ce tribunal n’a que des remontrances paternelles
à adresser à celui qu’il fait comparaître ; mais on sait qu’il est là, et
le Blâme serait une tache ineffaçable.
Bientôt
les musiciens se rassemblèrent. Ils n’étaient pas élèves de Zampini ; mais
ils parlaient à des oreilles habituées à les entendre.
Tous
les habitans se mirent en marche. Les jeunes gens, les jeunes filles s’avançaient
sur deux lignes. On ne pouvait plus se parler ; mais on se voyait, et les
yeux disent tant de choses ! Les époux venaient ensuite, et les enfans couraient
entre les deux files. Les vieillards des deux sexes fermaient le cortège.
Il s’arrêta à la porte du curé.
Ces
bonnes gens venaient le prendre pour le conduire à l’église. Ils lui donnaient
une marque de déférence, et ils lui rappelaient, en même temps, que les derniers
jours de septembre ne sont pas longs.
Le curé
était prêt. Il sortit, salua et bénit ses paroissiens. Il commença un cantique.
Les assistans le continuèrent, avec un accompagnement de musique. On s’avança
avec recueillement, et on se plaça dans l’église, les hommes d’un côté, et
les femmes de l’autre. Le pasteur officia avec dignité et dévotion. Il faisait
passer dans l’âme de ses paroissiens les sentimens dont il était pénétré.
Il monta
en chaire ; il ne fut pas long, parce qu’il ne prêcha que la vertu, et qu’on
la sent, avant que d’avoir entendu son langage. Il ne défendit pas de danser
: il désirait que ses paroissiens fussent pieux ; mais il ne voulait pas
en faire des machines.
C’est
dans ce petit canton d’Appenzell que naquit cet air, doux et mélancolique,
si connu sous le nom de Ranz des vaches. Les Suisses l’aiment passionnément.
Ceux qui sont au
service
des puissances étrangères ne peuvent l’entendre sans tressaillir, et il a
causé de fréquentes et nombreuses désertions.
Nos
musiciens exécutèrent ce morceau, pendant qu’on sortait de l’église, dans
le plus grand ordre. Quelques paupières me parurent humides. Etait-ce
l’effet du Ranz, ou de la piété ? « Mon ami, dis-je à André,
voilà la vraie Religion : elle est auguste et simple. — Elle n’est jamais
obscure qu’où les prêtres veulent dominer. »
Nous
reconduisîmes le curé chez lui. Il salua et ferma sa porte ; c’est ce moment
qu’on attendait. La troupe joyeuse se mêla, se divisa, chanta, sauta, en
allant prendre, chacun chez soi, les petites provisions de la journée. À
la prairie, à la prairie, se criaient les jeunes gens, quand ils cessèrent
de parler de leurs affaires de cœur. Ils se firent un signe affectueux de
la main, quand ils ne purent plus s’entendre.
Une
prairie, nouvellement fauchée, prêta sa fraîcheur aux amis du plaisir, qui
s’y rendaient de toutes parts. Autant de banquets que de familles, et le
couvert était mis sur l’herbe, verdoyante encore. Chacun avait porté ce qu’il
avait de meilleur : c’était dimanche. Quelques-uns avaient un peu de miel.
Ceux
dont les terres sont à l’abri des vents élèvent des abeilles. C’est avec
ce miel qu’ils font cet hydromel si recherché. Mais, les jours de fête, la
ménagère apporte son petit pot de miel, et toute la famille s’en régale.
Instruit
par l’aventure de mon panier, si bien garni et si inutile, j’avais recommandé
à Bertrand de faire les choses avec une extrême simplicité. Sept à huit bouteilles
de vin établirent
quelque
différence, entre nous et nos concitoyens ; nous la fîmes tourner à notre
avantage. Les vieillards mangent peu, et un verre de petit lait ou d’hydromel
ne les arrête pas long- temps. Ils venaient tourner autour de nous, et nous
regardaient avec bienveillance. Marianne ne manquait jamais de se lever,
et de leur offrir un verre de vin, avec une jolie révérence. M. et Mme Heilberg passèrent. Oh, nous
nous levâmes tous, pour trinquer avec eux.
Bientôt
le bruit des chansons, d’une espèce de luth, d’un cor, particulier aux habitans
des Alpes, se fit entendre de toutes parts. Les jeunes gens, de l’un
et de l’autre sexe, étaient tous deux par deux, et ils formèrent un cercle
aussi étendu que la prairie. La lutte allait commencer.
Deux
jeunes gens s’avancent dans l’arène. La force et le jeu de leurs muscles
annoncent que l’attaque et la défense seront également vigoureuses. Ils se
mesurent des yeux, ils s’approchent, et se saisissent. Tous leurs mouvemens
annoncent la légèreté et la souplesse. Ils se pressent ; ils enlacent leurs
membres ; ce sont deux serpens, unis, roulés l’un dans l’autre, et que l’œil
a peine à distinguer.
La gloire
seule produit-elle de si puissans efforts ?... Non, non. Je vois deux filles,
qui ne sortent pas du cercle, mais dont la tête est portée en avant. Un rouge
incarnat et la pâleur se succèdent, sur ces figures intéressantes, selon
que l’objet chéri a l’avantage ou chancèle. Elles paraissent amies, et elles
savent qu’il y aura un vaincu. Un des deux athlètes tombe, en effet. Comment
le consolera-t-on ? Le vainqueur l’embrasse.
L’heureux
mortel parcourt le cercle d’un coup-d’œil. Il a trouvé Sophitt ; elle lui
sourit, il s’approche. Il reçoit le prix de
ses
mains : c’est une fleur champêtre, qu’elle attache à son chapeau, et il lui
prend un baiser pour la remercier.
Les
instrumens se font entendre. Les danses vont commencer. Marianne se met sur
les rangs ; mais chacun a son amie. Elle s’est avancée étourdiment, et sa
position est embarrassante. Je suis tenté de lui offrir la main ; mais je
danse si mal ! Sophitt a tout vu. Elle pousse doucement Abdonn du côté où
est Marianne, après lui avoir présenté la joue : il lui fallait bien un dédommagement.
Mais renoncer au plaisir de danser, une première fois, avec son amant, avec
le vainqueur ! Et cela, parce que la pauvre étrangère est délaissée. Qui
de vous, belles Parisiennes, seriez capables d’un tel sacrifice ? Sophitt
était, ce jour-là, la jouvencelle marquante du bal. L’exemple qu’elle avait
donné fut suivi par plusieurs de ses compagnes, et Marianne s’amusa beaucoup.
Mais cette scène ne pouvait se renouveler tous les dimanches ; André ne dansait
pas mieux que moi, et il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il commençât
à quarante-cinq ans.
« Sophitt,
me dit Marianne, est couturière, et nous n’en avons pas. — Hé bien, ma petite,
nous l’emploierons. — J’allais vous le proposer. — Dites à Abdonn qu’il vienne
me donner une leçon de danse, tous les soirs, quand il aura fini son travail.
— Ah, que je vous remercie ! »
Il n’est
pas, le dimanche, un moment perdu, à Appenzell. La danse fatigue comme tous
les autres exercices prolongés, quand l’amour-propre ne soutient pas les
danseurs. Plusieurs groupes se formèrent.
Les
jeunes garçons et les jeunes filles tournèrent en rond, au bruit des chansonnettes.
Ce jeu, fort simple, n’est pas sans
agrément.
Une fille ou un garçon sort alternativement du cercle, et touche celui ou
celle qui l’intéresse le plus. On court après celui par qui on a été touché.
S’il l’est à son tour, avant que d’avoir repris la place, qu’il a quittée,
il est constitué prisonnier au milieu du cercle. S’il y arrive sans avoir
été prévenu, celui qui n’a pu le joindre est aux arrêts, et le jeu recommence.
Il continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus assez de monde pour envelopper
les prisonniers. Nous brillâmes, Marianne et moi, à cet exercice-là, et bientôt
les danses recommencèrent.
Les
brillantes soirées, les bals de Paris finissent le lendemain. La fête champêtre
devait se terminer au coucher du soleil. On commença le jeu de l’œuf. Il
annonce que le dimanche n’offrira bientôt qu’un songe léger.
Trois
jeunes gens, choisis par leurs camarades, parurent, vêtus de blanc. Ils placèrent,
sur une même ligne, cent œufs, à deux pieds de distance l’un de l’autre.
Un des trois doit parcourir un long espace déterminé, pendant que son émule
ramasse les œufs, et les dépose dans un panier, garni de son, que lui présente
le troisième.
Celui
qui a le premier rempli sa tâche est proclamé vainqueur. Les œufs lui appartiennent
; mais il les rend ordinairement à ceux qui les ont fournis. Il a le droit
d’embrasser sa maîtresse, et il n’y manque jamais.
On ne
retourne pas au village par le chemin le plus court : les écoliers et les
amans ont toujours préféré le plus long. Ils ont encore tant de choses à
se dire ! Quelquefois une partie de la nuit se passe dans ces doux entretiens,
qui sont toujours sans conséquence. On a perdu deux heures de sommeil ; mais
on les a regagnées en bonheur.
Le
lundi matin, tout rentre dans l’ordre, et les cœurs ne battent plus que le
dimanche suivant.
Les
soirées d’hiver ne sont pas aussi gaies. Le deuil de la nature semble se
communiquer aux amans. Les Suisses ressemblent aux oiseaux : ils ne chantent
l’amour qu’au printemps. Les oisifs des grandes villes de France chantent
toute l’année. Semblables au coursier fougueux, dont les jouissances continuelles
enrichissent son maître, ils se préparent une vieillesse prématurée, douloureuse,
et leurs souvenirs ne calment pas leurs regrets.
Pendant
l’hiver, les jeunes filles et les jeunes garçons se couchent avec le soleil
: ils n’ont rien de mieux à faire. Les hommes, les femmes, les vieillards
se rassemblent dans les maisons les plus vastes et les plus chaudes. Cette
réunion forme ce qu’ils appellent une soirée. On ne s’est pas fait une affaire
importante de sa toilette ; on ne s’assemble pas, les femmes pour se faire
voir, les hommes pour les regarder ; on ne marche pas au bruit d’un
orchestre complet ; on ne joue pas aux jeux de hasard ; on ne fait pas circuler
de rafraîchissemens, imaginés par la cupidité des marchands, et adoptés par
les dupes. Les femmes filent ou teillent du chanvre. Les hommes font des
seaux, et d’autres petits ouvrages en bois. Ils parlent religion, politique.
Les femmes écoutent.
Vers
la fin de cette réunion, la maîtresse de la maison ou du châlet offre une
collation. Ce sont des pommes sauvages, cuites sous la cendre, et une cruche
d’eau.
Il y
a très-peu de malades ici ; mais on y rencontre, assez fréquemment, des blessés.
Des chutes, assez graves quelquefois, occasionnées par l’aspérité des rochers
; des coups
d’instrumens
tranchans, que l’adresse ne dirige pas toujours, forcent les bons Suisses
à garder leur châlet, pendant quelques jours. Ne croyez pas qu’ils manquent
de soins. La graine d’Hippocrate est répandue partout, et nous avons ici
un médecin.
C’est
une vieille femme, estropiée depuis dix ans, et réduite, par conséquent,
à l’impossibilité de travailler. Elle a imaginé d’étudier la botanique, et
elle y a réussi. Elle connaît des herbes émollientes, dont elle fait des
cataplasmes ; elle compose des tisanes qui poussent à la peau. Elle parle
beaucoup ; mais elle prescrit peu de remèdes. Sa grande recette est le repos
et l’eau, et elle guérit tous ses malades. Il est une maladie cependant,
contre laquelle elle ne peut rien : c’est la vieillesse.
Ce docteur-là
se fâcherait si on lui offrait de l’argent. Chacun veille à ses besoins,
et il reçoit ses petites provisions de bouche, parce qu’il faut qu’il vive
pour faire du bien. Cette bonne femme est chérie, considérée. Elle est là,
ce que fut mon père à la Rochelle.
Après
trois semaines de courses, de fatigues, de sollicitudes, nos travaux nous
présentèrent un aspect satisfaisant. Ces ouvriers, qui vivent sobrement,
sont peu payés, et travaillent beaucoup, avaient enlevé les débris, et pratiqué
un chemin tournant et facile, qui conduisait de la plaine à notre propriété
aérienne. Déjà ce chemin se prolongeait de l’Ebenalp au village de Weissbad,
notre paroisse, notre patrie adoptive.
Le territoire,
qui nous était concédé, se trouva nud comme une roche pelée. Il avait été
chargé de débris pendant quarante ans ; il n’y restait pas un brin d’herbe
; mais nous avions une couche
de terre
de douze pieds d’épaisseur. Nos engrais devaient l’élever encore.
Tout était à faire ; mais nous voulions travailler.
André
a, dans beaucoup de choses, un tact, une espèce d’instinct qui le trompent
bien rarement. Cette baume dont je voulais faire une écurie, était effectivement
restée en l’air.
L’entrée
était à quinze pieds du sol : il était difficile d’y faire monter des mulets.
Notre
premier soin avait été de l’examiner, dans tous ses détails. Elle a quarante
pieds d’ouverture à sa base, à peu près autant en profondeur, et il y en
a soixante du sol à sa voûte, solide comme les Alpes. Elle a bravé les siècles
passés ; elle défie les siècles à venir.
« Hé
bien, ami André, que ferons-nous de cette baume ? — J’aime les grandes conceptions,
Monsieur, et je peux me livrer aux miennes, puisque nous avons plus d’argent
qu’il nous en faut.
« Je
fais sauter, au ciseau, les aspérités qui tapissent cette grotte ; elles
nous menaceraient sans cesse. — Supérieurement vu. — Bleker nous établit
deux planchers à dix pieds de distance l’un de l’autre. — Après ? — Le rez-de-chaussée
est consacré aux besoins journaliers ; le premier étage sera notre salon
d’été.... — Et je le garnirai de mousse, je m’y suis engagée, dit la petite.
— Nous établirons notre cabinet au second : les soirées d’hiver sont longues,
et je n’aime pas les pommes sauvages cuites sous la cendre. Au-dessus de
nous, sera notre grenier à fourrage. — Et comment monterons-nous là, partout
? — Hé, parbleu, par un escalier — Non, non. Avec une échelle, dit Marianne
: on la tire après soi. » Cette petite
fille
est toujours étourdie, imprudente, à côté de moi ; sans cesse elle se laisse
aller à son imagination ; mais quand elle remarque un mouvement d’impatience,
elle me présente Toinette, et je souris.
En rentrant
à Appenzell, nous allâmes faire part de nos grands projets à l’ami Bleker.
Il venait de terminer son pont sur la Sitter. Il n’a pas les talens de Vitruve
; mais il est plus expéditif. Quatre pieux, frappés, parallèlement, deux
par deux, dans le lit de la rivière ; deux poutres, l’une au bout
de l’autre, bien chevillées sur les pieux, et des planches en travers,
voilà son pont. Il restera debout, tant qu’il plaira au temps de le respecter.
Bleker
fut très-aise d’apprendre qu’il allait nous arranger une habitation, d’un
genre inconnu dans le canton. Quand il eut bien compris la distribution de
nos étages, il fut question de l’escalier. « Une échelle, dit Marianne. »
Cette fois je lui imposai silence.
André
décrivit l’escalier qu’il voulait avoir. Notre architecte hocha la tête.
« Un escalier tournant ! je n’en ai jamais vu, et je ne me tirerai pas de
là. Je vous ferai, à l’extérieur, un escalier à claires-voies, bien solide,
et fort propre, avec des pièces de rapport ; je le prolongerai jusqu’à votre
grenier à fourrage. À chaque étage, des planches, qui feront saillie, s’appuieront
sur la marche de niveau. Pour entrer, vous n’aurez qu’à faire un demi-tour
à droite, ou à gauche, en vous tenant ferme à un des montans de l’escalier.
— Mais il faut des poignets pour cela. — Eh bien, vous en avez.
« Cet
escalier-là vous procurera un avantage inappréciable. Vous êtes exposés au
midi, et il donnera de l’ombre à vos chèvres, pendant la chaleur du jour.
«
Savez-vous, mes amis, que vous allez être magnifiquement logés. Si un prince
étranger passe par ici, il s’estimera heureux d’être reçu chez vous. » Il
fallut bien adopter le projet d’escalier, puisque Bleker ne pouvait faire
mieux.
Le lendemain,
nous fîmes démonter et transporter notre maison de bois sur l’esplanade.
Rien n’est commode comme ces maisons-là. Elles vous suivent partout, comme
la coquille suit le limaçon.
Nous
achetâmes des instrumens aratoires, et nous commençâmes nos travaux. L’exercice
donna, à nos fèves et à nos pommes de terre, une saveur que nous ne leur
soupçonnions pas. Et notre petit lait ! quelle fraîcheur ! quel goût piquant
! Le petit verre d’hydromel par là-dessus, et on reprend, avec ardeur, la
pioche et la bêche. Henri IV est moins heureux que nous. Il se bat, et nous
jouissons.
Notre
ingénieur André régla le cours de notre petit torrent. Nous devions le diviser
en deux branches principales, qui tourneraient autour de la maison, et qui
se subdiviseraient en ruisseaux. Ils serpenteront par tout notre territoire
et le féconderont. Nous aimons beaucoup le poisson, et il y en a dans la
Sitter. Ainsi nous aurons un étang. Toutes ces eaux se réuniront sur le bord
de l’esplanade ; elles rouleront en cascades sur les pointes de nos rochers,
et reprendront leur cours ordinaire, pour s’aller jeter dans le petit lac,
qui est derrière la montagne.
Il fut
arrêté que quarante arpens seraient mis en prairies, et que la moitié du
reste du terrain formerait un potager, qui produirait des légumes de toute
espèce ; on ne trouve dans le canton que des fèves et des pommes de terre,
et il n’est pas
défendu
à un homme libre de multiplier ses jouissances. André me fit observer, avec
beaucoup de sagacité, que l’Abbé et les chanoines de Saint-Gall aiment la
bonne chère et le pain blanc. Bertrand devait trouver là des graines de toutes
les familles. La dernière partie de notre territoire nous donnera du bled-froment,
et nous aurons la galette le dimanche. Marianne la fait à ravir.
De bonnes
idées en amènent toujours d’autres : l’homme tend sans cesse vers la perfection.
« Nous sommes exposés au midi, me dit André. Je tirerai du plant de vigne
du Rhintal. Nous aurons du vin, et nous apprendrons à le faire bon. Nos amis
de Weisbad et d’Appenzell nous en diront leur façon de penser. »
Il était
impossible que trois hommes fissent toutes ces choses- là. Nous appelâmes
des aides. Abdonn fut le premier élu : il devait me donner des leçons de
danse le soir, et puis il avait fait danser Marianne. Le plus grand plaisir
qu’on pût lui procurer, était d’employer Sophitt. Il est si doux de se rencontrer
plusieurs fois dans la journée ! Marianne prétendit que notre linge avait
besoin d’être remis en état : Sophitt lui avait sacrifié sa première danse.
Tout
allait bien, à merveilles. Chacun avait sa tâche, et la faisait gaîment.
L’apathique Claire partageait son temps entre son fils et un rouet, que son
mari lui avait apporté. Ce travail-là ne fatigue ni l’esprit, ni les jambes.
Un incident, nouveau pour nous, suspendit nos travaux. L’Ebenalp parut tout
à coup, couverte de troupeaux. C’était le premier octobre.
Les
bergers des montagnes forment une classe d’hommes, étrangers, pendant l’été,
à leurs compatriotes. Ils le passent tout entier sur des rocs escarpés, où
ils vivent en société avec leurs troupeaux.
Ils
se font une sorte de pain avec de la farine d’avoine, du sel et de l’eau.
Ils la font filtrer à travers un linge, et ils se nourrissent
de cette pâte, quand elle a pris une certaine consistance. Ils mangent
la chair des moutons ou des chèvres, qui se tuent, en tombant dans
des précipices, ou dans des crevasses, que forment les craquemens effrayans
des glaces. Ils dorment dans des cavernes, que les siècles ont creusées partout.
Leur
marche n’est jamais bornée. Ils s’arrêtent où leurs troupeaux peuvent paître,
et ils s’éloignent les uns des autres, pour leur procurer une nourriture
plus abondante ; ainsi leur isolement est absolu.
Quand
l’herbe est épuisée sur un point, ils en cherchent un autre. Si les nuages
s’élèvent jusqu’à eux, ils leur échappent, en s’élevant davantage. Ils bravent
le froid, qui domine dans ces hautes régions, en s’enveloppant dans des peaux
de mouton.
Du haut
de leurs sommités, ils contemplent la terre, à laquelle ils sont devenus
étrangers. Rien de ce qui s’y fait n’échappe à leur vue perçante. Ils voient
les orages se former sous leurs pieds, et fondre sur les habitans des vallées.
Ils
aiment la chasse. Ils tendent des pièges aux bêtes fauves, et souvent ils
les combattent corps à corps.
L’habitude
leur fait trouver agréable un genre de vie, qui ne peut convenir qu’à eux,
et c’est avec regret qu’ils abandonnent leurs montagnes, pour retourner avec
les hommes.
Là,
cependant, de nouvelles jouissances les attendent. Ils retrouvent leurs maîtresses,
leurs femmes, leurs enfans. Pendant
qu’ils
se sont occupés de l’engrais du bétail, les habitans des vallées ont travaillé
à assurer leur subsistance, pendant l’hiver.
Le jour
où ils rentrent dans leur village est un jour de fête, et nous descendîmes
à Weisbad pour en être témoins. L’affection en fait tous les frais, et l’esprit
n’est jamais difficile sur les productions du cœur. Les uns étaient heureux
de leur satisfaction ; les autres l’étaient en la partageant. Elle s’exprimait
par les caresses franches et sauvages des montagnards, par l’aimable rougeur
de leurs femmes, par les cris joyeux de leurs enfans, par les chants de leurs
voisins. La vierge timide craint de prononcer un mot ; mais elle a des yeux,
et ils parlent. Un ami officieux pousse Péters du coude ; il s’approche peu
à peu ; la conversation va s’engager.
Que
se passe-t-il là-bas à la porte de ce châlet ? il n’est pas de beaux jours
sans nuage, répète-t-on sans cesse. Cette comparaison ne sera jamais triviale,
parce qu’à chaque instant on peut en faire l’application.
Un homme,
chargé d’une peau d’ours, veut pénétrer dans une humble demeure. Une femme
lui en refuse l’entrée. Les habitans se rassemblent. Klopp prétend être le
mari de Crettle ; Crettle proteste qu’elle ne le reconnaît pas. Klopp jure
qu’un coup de griffe de l’ours qu’il a tué l’a rendu méconnaissable. Crettle
réplique que son mari n’a pas ce visage-là, et qu’elle ne s’exposera pas
à une méprise qui l’humilierait pour tout le reste de sa vie. Les témoins
de cette discussion sont incertains, irrésolus. Ils croient bien que cet
homme est Klopp. Cependant ils n’oseraient l’affirmer. « Si je ne suis pas
ton mari, pourquoi as-tu fait entrer le troupeau ? — Parce que chaque bête
a ma marque. — Mais qui te l’a ramené ? — C’est vous, sans doute ; mais qu’est-ce
que cela prouve ? — Qui suis-je donc, si je ne
suis
pas ton mari, car il faut bien que je sois quelqu’un ? — Cela ne me regarde
pas. — Ah, ça, plaisantes-tu ? — Je n’en ai aucune envie. — Tu commences
à m’échauffer les oreilles. — Peu m’importe. — J’entrerai. — Vous n’entrerez
pas. »
Les
spectateurs commençaient à chuchoter entre eux ; le bourgmestre réfléchissait
profondément. Klopp était brutal, et il était possible que Crettle saisît
le prétexte du coup de griffe pour se débarrasser de lui. Il est constant,
au moins, que la figure, que Klopp rapportait des montagnes, était repoussante,
hideuse, et on tient à celle qu’on a épousée.
Le bourgmestre
tira Klopp à part, et ils se parlèrent ‘à l’oreille. Le magistrat interrogea
Crettle en particulier. « M. le bourgmestre, la retenue naturelle au sexe
ne me permet pas d’examiner tout cela — Vous niez donc l’absence ?
— Je ne la nie ni ne la reconnais. — Vous rougissez, Crettle. — On rougirait
à moins. — Me voilà fort embarrassé.
« Embarrassé
ou non, il faut que je soupe, et que je me couche, dit Klopp. — Je vous recevrai
chez moi, et demain nous verrons. — A la bonne heure. »
« Qu’est-ce
donc que cette absence, me demanda André ? — Ma foi, je n’en sais rien. Il
y a nécessairement ici, non du plus, mais du moins. Klopp serait-il un demi…
— Cela pourrait bien être. — Allons, allons, il n’a que l’unité. »
Crettle
disputait vivement, à sa porte, avec l’Hippocrate moderne. « Je vous dis,
moi, que j’en connais trois dans le village. — Qu’est-ce que cela prouve
? — Que Klopp peut faire le quatrième. — Hé, quand cela serait ? celui qui
se présente ne peut-il pas être le cinquième ? — Crettle, la nature ne fait
pas
tous
les jours de ces bizarreries-là. Tenez, votre mari était beau ; l’ours
l’a enlaidi, et vous n’en voulez plus. — Qu’est-ce que cela prouverait ?
que je n’aime ni les ours ni leurs œuvres. »
Une
commère, il y en a partout, s’était glissée près de la porte, et avait tout
entendu. Elle s’écria que Crettle venait, d’avouer que cet homme était son
mari ; la vieille botaniste répéta la même chose. Elles citèrent les propres
termes qu’avait prononcés Crettle. Toutes les femmes du village se prononcèrent
contre elle.
Elle
était dans une position vraiment critique. Je la trouvais jolie, et j’aurais
voulu la dispenser de recevoir ce mari-là. Je me fis son avocat : « Qu’est-ce
que cela prouverait ? n’est qu’une expression hypothétique, et par conséquent
très-loin d’un aveu.
— Hypo…
quoi ? — Il n’y a rien là de pathétique. — Parlez- nous allemand, maître
Antoine. » Et la condamnation de Crettle fût prononcée, en chœur, par toutes
ces bouches féminines.
Le bourgmestre
reparut sur la scène. « Le sage, dit-il, se défie toujours de ses lumières.
J’ai convoqué le consistoire pour demain dix heures du matin. Crettle, vous
paraîtrez devant ce tribunal. En attendant, les choses resteront dans l’état
où les voilà.
« Mes
enfans, je vous invite à ne pas troubler plus long-temps l’ordre public,
et à vous retirer chez vous. Vous savez que je suis le ministre de la loi.
» Ce dernier mot glaça toutes les langues, et cette cohue se dispersa en
un instant. Allez donc, en France, faire taire cinquante commères avec un
mot.
«
Ma foi, dis-je à André, j’irai demain à Appenzell. — Et moi aussi. Ce procès-là
sera intéressant. — Une enquête, une visite de matrones…. — Des témoins,
des procureurs, des avocats….
— Nous
verrons comme on administre la justice en Suisse. — Mais si cette affaire-là
s’instruisait à huis-clos ? — Ah, diable ! ce serait fâcheux. — Nous verrons.
»
En effet,
le lendemain matin la foule était assemblée devant la porte, qui ne s’ouvrait
pas. Chacun parlait de l’affaire qu’on allait juger, et prononçait, d’après
ses dispositions personnelles. Je conclus, de là, que les juges seraient
fort embarrassés, et cette idée ajouta au désir, qui me tourmentait, de voir
ouvrir la porte. Je demandai à un homme, qui était près de moi, si elle resterait
fermée. Cette question le fit rire aux éclats. « Comment les juges répondraient-ils
de leurs jugemens à leurs concitoyens, s’ils n’instruisaient pas les procès
publiquement ? »
La porte
s’ouvrit enfin. Les juges étaient sur leurs sièges, et ils paraissaient s’être
consultés. Quel fut notre surprise, quand nous reconnûmes dans le président
notre architecte Bleker ! Ce n’était plus cet ouvrier docile, accommodant,
prêt à tout faire pour élever sa petite famille. C’était un homme pénétré
de la dignité de ses fonctions, et que ce sentiment élevait au-dessus de
lui. Les étrangers doivent être très-circonspects dans leur manière de s’exprimer
avec les paysans suisses. Ils parlent souvent, sans s’en douter, à un homme
qui, deux heures après, peut être leur juge.
Nous
cherchions en vain cet attirail de jurisprudence, que nous avions rêvé. Crettle
était seule devant les magistrats. Le président lui adressa la parole.
«
Femme, vous êtes Suisse et libre. N’oubliez pas, pendant que je vous parlerai,
que la vertu est la base de la liberté.
« Si
vous êtes intimement convaincue que l’homme, qui s’est présenté hier chez
vous, ne soit, pas votre mari, vous pouvez le rejeter... Ne vous hâtez pas
de répondre. Voyez au-dessus de moi l’image de votre rédempteur, et n’oubliez
pas qu’il punit le mensonge.
« Souvenez-vous
que vous avez promis à Klopp, au pied des saints autels, de l’aimer toute
votre vie, de le soigner en maladie, comme en santé. Que diriez-vous, s’il
vous repoussait, parce qu’un accident vous eût enlaidie ? N’exigeriez-vous
pas qu’il remplît, envers vous, les obligations qu’il s’est imposées ?
« Si
cependant cet homme vous est étranger, c’est un criminel qui veut attenter
à votre pudeur, et s’emparer de vos propriétés. Nos lois le puniront de mort.
Voulez-vous qu’il vive ou qu’il meure ? » Des larmes commencèrent à rouler
dans les yeux de Crettle.
« Pleurez,
femme, pleurez. Nous sommes tous faibles ; mais il est toujours beau de se
repentir…. Vous embrassez vos enfans ! vous leur rendrez un père. Paraissez,
Klopp, vous avez retrouvé votre femme et votre famille. »
Klopp
était assis derrière le fauteuil empaillé du président. Il s’élança dans
les bras de Crettle. Cette femme, profondément émue, oublia sa laideur.
Nous
nous attendions à des plaisanteries, à des sarcasmes, et ils eussent abondé
en France. Les paroles du président avaient
agi
sur l’auditoire, comme sur Crettle. On reconduisit, en triomphe,
les deux époux chez eux.
« Quelle
justice simple et auguste, » dis-je à André ! — Et quelle manière de la rendre
! »
Trois
jours après, un autre procès ajouta à la profonde estime que nous avions
pour les Suisses. Le nommé Frantz vint trouver Gaspard, qui fauchait son
pré. « Mon ami, lui dit-il, nous avons un différend pour une prairie ; nous
ignorons à qui de nous elle appartient, et voici le temps de la coupe des
regains ; il faut en finir. J’ai fait convoquer, pour demain, le petit conseil
à Appenzell. Tu viendras comparaître avec moi. — Tu vois, Frantz, que je
finirai ce soir de faucher ce pré. Le temps est incertain; il faut que demain
je mette ce foin à l’abri ; je ne peux m’absenter. Sais-tu ce qu’il faut
faire ? Va demain à Appenzell ; dis aux juges mes raisons et les tiennes,
et je serai dispensé d’y aller moi-même. » Frantz se charge de plaider pour
et contre lui. En effet, il expose, le mieux qu’il peut, ses raisons et celles
de Gaspard. Les juges prononcent.
Frantz
retourne vers son ami. « La sentence est en ta faveur, lui dit-il ; la, prairie
est à toi, et je t’en félicite. » Le pain noir peut paraître bon, quand on
le partage avec de pareilles gens.
« André,
quand Dieu fit le premier homme, il créa un Suisse ; mais sa femme a tout
gâté. »
Le douze
octobre, les chemins de Weisbad à Appenzell, et d’Appenzell à la Sitter furent
terminés. Nous nous séparâmes, nos ouvriers et nous, comme des gens qui s’estiment
réciproquement, et nous ne pensâmes plus qu’à mettre nos terres en valeur.
André
et Bertrand partirent en chariot, pour Saint-Gall, avec la note des objets
dont nous avions besoin, et la liste était longue. Nos terres étaient préparées.
Je n’avais plus rien à faire. Je m’occupai, pendant deux jours, à mettre
tout en ordre dans notre intérieur, et à étudier les avantages et les inconvéniens
des différentes parties de nos bâtimens.
Je reconnus
d’abord que notre maison de bois serait brûlante l’été, et glaciale l’hiver.
Les Suisses travaillent le jour, et ne se chauffent que le soir, c’est fort
bien ; mais que ferons-nous, quand nos terres seront ensemencées ? Les enfans,
André et ses réflexions, Marianne et ses gentillesses suffisent bien pour
abréger le temps ; mais cela n’échauffe point, et on n’a ici que des broussailles,
qu’on coupe sur les montagnes, et dont on respecte les racines. Voyons notre
baume.
Le président
Bleker a raison : il faut des reins et des poignets pour entrer dans ces
appartemens ; mais nous en avons, ainsi qu’il l’a remarqué. Nous grimpâmes,
à peu près comme des chats, Marianne, Sophitt, Gott, Abdonn et votre serviteur.
Claire était restée en bas avec les enfans. Elle ne voulait voir, disait-elle,
que par nos yeux.
Quel
salon, tudieu, quel salon ! quarante pieds de profondeur, sur trente de large
! Il n’y en a pas comme cela à Paris. À la vérité, le jour est très-faible
dans le fond ; mais une grosse lampe, suspendue à la voûte, remplacera le
soleil. Et sa fumée, allez-vous dire ? Vous savez bien que notre salon n’a
pas de porte ; ainsi la fumée aura une issue. Nous tousserons peut-être un
peu, de loin en loin ; mais un verre de petit lait fera couler tout cela.
Et puis, ne toussez-vous pas dans vos salons de Paris ? N’y transpirez-vous
pas de manière à prendre une pleurésie en sortant ?
Nous
allâmes jusqu’au fond de notre magnifique pièce, et nous y sentîmes une chaleur
douce qui nous fit jeter un cri de joie. Nous eûmes la certitude que notre
salon serait chaud l’hiver, et j’en conclus, avec beaucoup de sagacité, qu’il
serait frais l’été.
Là-dessus
Marianne se mit à chanter et me prit la main. Abdonn prit celle
de Sophitt, et nous nous mîmes à danser. J’avais déjà vingt leçons. Marianne
m’assura que j’étais un fort joli danseur, et je m’en l’apportai à elle :
elle était connaisseuse.
Nous
montâmes ensuite au cabinet. Nous y fîmes les mêmes observations. Toute la
différence de la retraite de messieurs les savans à leur salon, c’est qu’elle
était moins large et moins profonde.
Nous
reconnûmes enfin que le grenier à fourrage pouvait en contenir de quoi fournir
aux besoins de notre bétail pendant plus de trois mois.
Quand
nous fûmes redescendus sur la terre. Sophitt et Gott reprirent leur ouvrage,
et Abdonn me dit : « Je ne fais rien depuis ce matin. J’ai besoin d’argent
; mais j’aime à le gagner.
— Et
mes leçons de danse ? — C’est un bon office : je ne fais pas payer cela.
» — Hé bien, allez à Appenzell. Dites au président Bleker de nous faire des
tables, des bancs, des escabelles et quelques chaises, s’il le peut, en
quantité suffisante pour meubler ces deux pièces-là... Ah, Abdonn, le bas
de la baume sera notre magasin général, et cet escalier convient beaucoup
plus à des faiseurs de tours d’adresse, qu’à des hommes chargés. » Vous prierez
Bleker de venir examiner cela. — Voulez-vous que je vous achète du fourrage
?— Vous me ferez plaisir. »
Et
voilà mon jeune homme qui attelé des mulets à deux de nos chariots, et qui
les découvre. « Pourquoi cela, Abdonn ? — Une commission ne peut pas remplir
ma journée. J’achèterai du fourrage ; je le chargerai sur ces voitures, et
nous le placerons là-haut à nous deux. — Comment à nous deux ? — Hé, oui.
Je le monterai sur ma tête ; vous le recevrez, et vous le rangerez. Voilà
tout. »
Sophitt
est aussi laborieuse que lui. Ils ne se disent pas quatre mots dans la journée.
Mais le travail de l’aiguille n’empêche pas de causer, et elle aime cela
! Oh ! Claire, Marianne et Gott connaissent à présent les deux parties du
canton d’Appenzell, comme si elles y étaient nées. Le soir, les deux jeunes
gens s’en retournent chez eux, bras dessous, bras dessus, pour revenir le
lendemain de la même manière. Sophitt est jolie, Abdonn est beau garçon,
et peut-être..., Oh, non, non. Les mœurs sont pures où il n’y a pas de surveillance.
Et puis, le consistoire est là.
« Vous
n’êtes donc pas content de votre escalier, me dit Bleker. — Moi, mon cher
président... — Chut, chut. Ici, je suis Bleker, charron, charpentier, laboureur.
— Un escalier de soixante pieds de haut !... — Le plus beau que j’aie fait
de ma vie ! — Perpendiculairement planté... — Oh, je vois ce que c’est :
il vous faut, dans vos grandes villes, des escaliers qu’on puisse monter
en carrosse. L’oisiveté est habile à se créer des besoins. — Si, si.....
— Si, si ! Je vais vous arranger cela. Abdonn, déchargeons le fourrage.
»
Sous
le foin étaient les ustensiles de M. le président. « Vous aurez, à gauche,
une corde bien tendue du haut en bas, à laquelle vous vous tiendrez d’une
main. — À la bonne heure.
-
À droite, je vous établirai, à l’extérieur
de chaque étage, un carré en planches, qui vous dispensera de jouer des poignets
;
vous
n’aurez qu’à allonger la jambe, et vous serez d’aplomb, comme dans la prairie.
— À merveilles. — On se moquera de vous ; on vous demandera si vous êtes
impotens. — Faites toujours. »
André
ne revint que le lendemain au soir. Il trouva un escalier, qu’il eût été
difficile de monter en carosse, mais sur lequel on ne risquait plus de se
casser le cou. André nous avait laissés sans ressources, comme des malheureux
jetés dans une île déserte. Il étala à nos yeux l’espoir d’une récolte abondante
et variée. « Qu’est-ce que ces petites grenailles-là, demanda Bleker ? »
C’étaient des pois, des haricots, des lentilles. « Ah ! si nos femmes étaient
obligées de préparer ces friandises-là, que deviendraient nos enfans, la
propreté du châlet ? Qui trairait les vaches ou les chèvres ? qui ferait
le fromage ? qui nous porterait notre dîner à la prairie, ou sur la montagne
? De l’eau, une poignée de sel, des fèves, des pommes de terre, de la farine
d’avoine dans une chaudière, et cela cuit tout seul. Ce ne sont pas vos lentilles,
vos pois et vos haricots qui vous feront traduire devant la chambre de la
réforme, parce que personne ne sera tenté de vous imiter. Il vous faut des
joujoux, et à nous des choses solides.
«Oh,
oh ! du blé froment ! Il n’est pas défendu de manger la galette le dimanche.
Et je la fais, dit Marianne ! Ah, ah ! — J’en viendrai goûter l’année prochaine.
Du plant de vigne ! voilà qui est supérieurement vu. Quand on a bien travaillé,
un verre de vin est utile, et il fait plaisir. Mais, ami André, vous ne vous
êtes occupé encore que du superflu. Les fantaisies passent-elles, en France,
avant les besoins réels ? — Mais quelquefois, ami Bleker. — Des poules, des
chèvres, des moutons, des vaches, voilà la véritable richesse. — Il a raison.
— Mais nous n’avons
pas
de quoi les nourrir. — Br ! en deux jours Abdonn et l’ami Bertrand trouveront
dans le village voisin de quoi remplir votre grenier à fourrage, du chènevis
pour vos poules, et de la graine pour ensemencer votre prairie. — Elle lèvera
encore avant l’hiver.
«
La saison est favorable pour planter la vigne. Je le sais bien, parbleu,
dit l’ami Bertrand. J’ai été vigneron à Surenne. — À Surenne soit. Et où
établirez-vous votre vignoble ? — Tiens, quelle question ? là, le long de
nos rochers. — C’est cela, c’est bien cela, ami Bertrand. »
Nous
payâmes ce que nous devions ; nous donnâmes de l’argent à Bertrand, pour
continuer les acquisitions commencées par Abdonn, et nous soupâmes en Spartiates.
«
Hé bien, ami André, comment Monsieur le comte Ulric gouverne-t-il ses sujets
? — Comme les autres, ami Antoine. Les Saint-Gallois travaillent fort, gagnent
peu, et lui paient beaucoup. — Il me semble que Monseigneur leur avait promis
de belles choses. — Cela ne coûte rien.
«
— Ma foi, André, il est fort heureux que nous ayons pensé à nous retirer
ici. — Monsieur, l’idée est de moi. — Crois-tu, André ? — Vous le savez bien,
Monsieur. — Personne ici ne peut rien nous demander qu’au nom des lois. Elles
sont simples comme les hommes qui les ont faites, comme la nature agreste
qui les environne. L’égalité la plus absolue règne ici, excepté à l’audience
: les magistrats y sont tout. Nos Suisses ne conçoivent pas l’inégalité des
rangs établie dans les monarchies. Si l’un d’eux se permettait de prendre
un air de supériorité, des railleries amères en feraient justice. Mais ils
sont fiers de la position où les ont placés leurs institutions
sociales,
et voilà pourquoi ils sont pleins d’égards les uns pour les autres. Si l’égalité
s’établissait en France, je crois que j’y retournerais. — Donnez ce gouvernement-là
à des gens passionnés ; ils feront de belles choses ! »
Nos
semailles étaient terminées ; nos plantations avançaient ; déjà nous avions
quatre tilleuls en avant de notre maison. Ils donneront de l’ombre, quand
ils pourront. Notre métairie se peuple chaque jour, et Bleker y est en permanence.
Il a construit un vaste poulailler ; il s’occupe de rendre accessible, à
deux cents moutons, le bas de la baume, dont je voulais faire le magasin
général. Il est décidé que nos quatre vaches logeront, avec les mulets, dans
l’écurie attenante à la maison.
Tout
est mouvement, tout est vie chez nous. Chacun a ses fonctions assignées,
et remplit sa tâche du jour. André, Bertrand, Abdonn et moi sommes chargés
des gros travaux ; un jeune berger soigne les moutons, en attendant l’époque
où il les conduira dans les Alpes ; une fille de basse-cour a la direction
du poulailler, des chèvres et des vaches. Madame André, en sa qualité de
femme de mon co-propriétaire, a la haute main sur tout, et ne se mêle de
rien ; Marianne communique, sur tous les points, son activité, son intelligence,
sa gaîté. Elle donne ses instructions en riant, et on les suit de même. Elle
est l’âme de la colonie.
C’était
le seize octobre. Notre affaire devait être irrévocablement arrêtée. Nous
nous présentâmes devant le grand conseil. Cent vingt-huit membres, très-simplement
vêtus, et parmi lesquels nous reconnûmes dix de nos ouvriers, siégeaient
avec la noblesse que donne, plus ou moins, à l’homme, le sentiment intime
de sa dignité. Ceux-ci me paraissaient grandis. Je croyais voir le
sénat de Rome, à
l’établissement
de la république. La pauvreté, l’amour de la liberté, de la patrie, de la
justice étaient communs à tous deux.
Notre
affaire fut bientôt terminée. Depuis long-temps les esprits étaient disposés
; nos patentes étaient scellées. « Vous avez secoué vos fers, nous dit le
président Heilberg ; montrez- vous dignes d’être affranchis. Vous participez
à tous les privilèges des Suisses ; mais n’oubliez jamais que vous êtes soumis
aux mêmes obligations. Votre vie n’est plus à vous. Elle appartient à votre
nouvelle patrie.
«
Prêtez-lui toujours une oreille attentive ; soyez prêts à marcher au premier
coup du tambour.
«
Nous ne vous demandons pas de sermens. Le soupçon les exige, et la fraude
les prête. Nous nous estimons tous réciproquement. »
Le
jour de notre naturalisation devait être marqué par une fête. L’usage voulait
que les habitans de notre village en fissent les frais. Nous ne nous opposâmes
à rien, pour ne pas blesser leur amour-propre.
Le
dimanche suivant nous nous rendîmes à la prairie. Nous y vécûmes plus mal
que chez nous, et la franchise, la cordialité, la gaîté embellirent la journée
: ce ne sont pas le luxe et l’abondance qui constituent les fêtes. Je dansai
avec Marianne, et je dansai fort bien, à ce qu’elle m’assura. Elle fut la
seule qui m’adressa des félicitations : chacun danse pour soi, quand on est
animé par le plaisir.

Crime
et châtiment de Jacques Clément
CHAPITRE
XXXV.
Suite
de la vie de nos héros en Suisse.
Nouvelles
de France.
Deux
années s’étaient écoulées. Les enfans étaient devenus charmans ; Marianne,
toujours jeune, toujours jolie, toujours aimante, était la seconde mère de
ma Toinette ; André n’avait pas changé ; il n’eût pu que perdre, et moi aussi
; nos gens étaient bons et attachés ; nous formions une société d’amis.
Nos
compatriotes nous aimaient, parce que nous prévenions leurs désirs ; que
nous leur rendions tous les services qui dépendaient de nous, et que nous
n’avions pas d’ambition. Deux assemblées générales avaient été convoquées.
Nous y votâmes, et ce que nous avait annoncé Heilberg se réalisa : nous n’eûmes
pas une voix. Mais tous les cœurs étaient à nous. Hé ! pourquoi serions-nous
ambitieux ? Qui fait désirer des places, partout ailleurs qu’en Suisse ?
La cupidité ou l’orgueil. Quel fardeau que de gouverner des hommes, presque
toujours mécontens, et qui, presque toujours, ont sujet de l’être !
Heilberg
n’était plus en place, et il était toujours notre ami. Il avait été remplacé
par Freuden, le maréchal ferrant, homme plein de raison et de jugement, fier
de sa qualité d’homme libre, au point de ne pouvoir s’empêcher de lever la
tête, quand il
entend
le mot Suisse, et de sourire à celui qui l’a articulé avec respect
ou bienveillance.
La
plupart de ces braves gens conservent le sentiment de la liberté jusqu’à
leur dernier soupir. Un homme de Weisbad était irrévocablement brouillé avec
un autre, qui lui avait tenu un propos offensant. Il tomba dangereusement
malade. Notre curé fut le voir, le consoler, le confesser, et lui prêcha
le pardon des injures. Broug refusa de pardonner. Le curé insista ; le malade
se défendit opiniâtrement. Le pasteur, excédé, lui dit : « Hé bien, si vous
ne pardonnez pas, vous irez en enfer. — Je suis un homme libre : j’irai où
je voudrai. »
Nous
sommes dans l’abondance de toutes choses. Nous commençons à récolter du vin.
Nous en avons fait bien peu cette année ; mais il est fort bon : Bertrand
entend cela à merveilles. Toutes les semaines, il va à Saint-Gall vendre
l’excédent du beurre, des œufs, du fromage et des légumes, que nous cultivons
avec un succès remarquable. On fait toujours bien, quand on veut bien faire,
et qu’on a de l’intelligence. Le lecteur sait qu’André et moi n’en manquons
pas. Bertrand nous rapporte des étoffes pour tous, des rubans pour ces dames,
et Sophitt, devenue Madame Abdonn, met en œuvre tout cela. Il nous
reste huit mille livres, dont nous n’avons plus besoin, et qui dorment dans
une armoire.
Nous
avons aussi le fromage de luxe, dont la fille de basse- cour a montré la
fabrication à Gott. Ce fromage se nomme Seret, dans le Valais.
Je lui conserve ce nom, par ménagement pour les yeux français, qu’effraient
des consonnes multipliées.
Nous
n’avons pas encore goûté le nôtre, parce qu’il n’a que dix-huit mois, et
qu’il est loin d’être fait.
Quand
la pâte est bien pétrie, les femmes en forment des meules, de huit à dix
pouces d’épaisseur, et du poids de dix à cinquante livres. Elles les placent
entre des claies, et les chargent de pierres, pour en exprimer la sérosité.
On
ne les sale pas. Leur propre fermentation suffit pour leur donner une saveur
qui les conserve : c’est celle que produisent les aromates dont les herbes
des montagnes sont chargées.
Lorsqu’ils
ont acquis la solidité nécessaire, on les empile dans un lieu, où ils sont
à l’abri de l’humidité et du froid. Là, ils deviennent compacts et durs.
Le
seret prend, avec le temps, la couleur de la cire jaune. Il est alors assez
dur pour qu’on ne puisse le couper sans faire de grands efforts. Il se conserve
pendant cinquante ans et plus.
Son
goût est fort piquant. Nous eûmes beaucoup de peine à nous y faire. Nous
nous y accoutumâmes comme le buveur d’eau-de-vie finit par lui trouver un
goût fin et délicat. Les Appenzellois croient le seret un puissant digestif.
Ils
en font un à chaque événement remarquable. Gott en pétrit un, le jour de
son mariage avec Bertrand : ils finirent par craindre le consistoire. Ils
inscrivirent, sur leur seret, d’après l’usage, leurs noms et la date de leur
union. Ils salèrent, d’après un autre usage, un cochon, de manière à le conserver
aussi long-temps qu’une momie. On ne touche à cela qu’aux jours de très-grande
solennité. C’est quelquefois un héritage qui passe aux petits-enfans.
Pendant
la cérémonie du mariage, Marianne n’avait cessé de me regarder d’un air...
Je l’entendais à merveilles. Cela ne sera jamais. Tout, hors cela.
Nous
avons passé les journées des hivers dans le salon, et notre cabinet
de la grotte. Nous nous y enfoncions davantage, à mesure que le froid devenait
plus vif, et nous y étions au mieux. Les femmes travaillaient en bas; André
et moi faisions de l’esprit en haut. Il compose un in-folio, bien
philosophique, bien raisonné, et qui sent furieusement le fagot. Aussi ne
le communique-t-il qu’à moi. Il le fera lire à son fils, quand il aura vingt
ans.
La
fumée de notre lampe a teint en noir la voûte de notre cabinet, ce qui lui
donne un air tout-à-fait solennel. Garnier écrirait ici des tragédies admirables.
Moi, qui ne porte pas mes prétentions si haut, je faisais des chansons pour
Marianne, sur des airs en vogue du temps du roi Louis XI : je n’en sais pas
d’autres. Elle les chante toute la journée, et elle en fait répéter les refrains
à Toinette. Quelquefois la petite est récalcitrante. Marianne la persuade
avec un brin de la galette du dimanche.
Le
printemps renaît. Tout se ranime ; les oiseaux commencent à chanter leurs
amours ; nos truites jouent sur la surface de notre petit lac ; les enfans
folâtrent sur l’herbe fine. Ils courent, ils s’attaquent, ils se renversent,
et ils rient. Ils ne peuvent vivre un moment l’un sans l’autre, et la joie
se peint dans les yeux de celui qui peut rendre un petit service à son camarade.
Comme ils s’aiment ! Oh, comme ils s’aimeront ! Et puis ils nous font de
petits contes, si plaisans, si naïfs ! Ils nous intéressent, ils nous amusent
tant ! Ils commencent à bien lire. Toinette est la plus avancée ; mais Toinon
est adroit à tous les exercices. Il vous lance une pierre !... il la roule
quand il ne peut l’enlever.
«
Voilà pour l’empereur d’Allemagne ; voilà pour le duc de Savoie ; voilà pour
l’abbé de Saint-Gall. » Il y a un Suisse dans ce petit corps-là.
Les
grands enfans ont leurs jeux comme les petits. Ils ne sont pas si innocens,
et l’habitude les émousse quelquefois. Les petits enfans trouvent des
charmes dans l’inconstance ; l’expérience apprend aux grands que l’apparence
est trompeuse, et que, sous une enveloppe nouvelle, on rencontre toujours
la même chose. J’ai trouvé Marianne dans plusieurs femmes ; je la trouverais
dans d’autres, et puis les soins, les embarras, les soucis ! quand on est
à peu près bien, il faut s’y tenir.
La
végétation est commune aux animaux et aux plantes. Tout fermente autour de
nous, et nous nous trouvons plus jeunes. Un retour de jeunesse donne, à tout,
l’attrait de la nouveauté.
La
vigne bourgeonne, et nous promet une abondante récolte. Nos tilleuls se développent.
Ils sont faibles encore ; mais le sentiment de la propriété les grandit.
Bientôt nous nous assoirons sous leur feuillage, et nous rêverons que nous
sommes à l’ombre. Peu d’amour rend l’amitié indispensable. Celle qui nous
unit, André et moi, est inaltérable. Mais il paraît qu’Oreste et Pilade,
Nysus et Euriale avaient toujours quelque chose de nouveau à se dire. Nous
éprouvions, nous, des momens de vide, auxquels nous avions la sagesse d’échapper.
Après quelques heures d’une expansion étrangère, on revient à son ami avec
un plaisir nouveau. Nous descendions nos rochers, nous allions voir nos amis
de Weisbad et d’Appenzell. Notre curé nous disait de bonnes choses ; notre
bourgmestre était un gros réjoui qui nous faisait rire. Le bon sens, le jugement,
les lumières d’Heilberg et de Freuden, le nouveau landamman, nous
donnaient
à penser. Le président Bleker était original, quand il ne siégeait pas.
Nous
nous promenions tous cinq sur la place d’Appenzell. Tout à coup un grand
bruit coupa net notre conversation. C’étaient des chevaux, qui portaient
un grand seigneur, couvert d’or, et des valets, mis presqu’aussi richement
que lui ; c’étaient une douzaine de mulets, chargés des équipages de Monseigneur,
élégamment recouverts de couvertures à ses armes. C’était l’heure du repos,
et le bruit des grelots, des fouets, rassembla en un instant, tous les habitans.
Une espèce d’écuyer s’adressa à Freuden lui-même. « Mon ami, dites au landamman
de venir parler à Monseigneur. — Je ne suis pas votre ami, puisque je ne
vous connais pas, et le landannnan ne va parler à personne. Dites à votre
seigneur de se rendre devant cette porte, là, en face. Elle s’ouvrira dans
un quart d’heure, et le landamman le recevra. » L’écuyer leva
les épaules
« Apprenez
qu’on ne lève pas les épaules devant un Suisse, et qu’ici, d’ailleurs, on
ne sait à qui on parle. »
Freuden
nous quitta, pour aller rassembler quelques membres du petit conseil, et
je le suivis : j’étais curieux de savoir quel était l’homme fastueux qui
croyait bonnement que nous et nos magistrats allions nous humilier devant
lui. André avait tout ce qu’il fallait pour faire parler monsieur l’écuyer,
et il s’attacha à lui.
La
porte s’ouvrit, en effet, un quart d’heure après, et le landamman entra,
suivi de sept à huit membres du petit conseil. L’écuyer sentit qu’il avait
fait une sottise, et il salua Freuden jusqu’à terre. Monseigneur entra après
nous, et il allait vraisemblablement s’asseoir auprès du landamman. Le garde
de la porte l’arrêta, et lui présenta une escabelle. « Si ce siège ne
vous
convient pas, vous êtes le maître de rester debout. Chapeau bas, s’il vous
plait : vous êtes devant une fraction du souverain. » Monseigneur se pinça
les lèvres, et se découvrit.
«
Je suis le comte de Wirtemberg ; — Peu importe. Que voulez-vous ? — Je suis
chargé, par sa majesté l’empereur, de traiter avec vous. — Avec moi ? Avec
la Suisse. Vous avez traversé les rhodes extérieurs, puisque vous venez de
la Souabe. Avez-vous vu les deux landammans de l’autre partie du canton ?
— Je ne savais pas qu’il y en eût. — Vous ne connaissez pas le gouvernement
de vos voisins ?— « Votre bourg donne son nom au canton, et j’ai cru devoir
venir ici directement. — Il n’y a pas de mal à cela. Je vous demande, pour
la seconde fois, ce que l’empereur désire de nous. — Je ne peux m’expliquer
avec vous qu’en particulier. — Alors vous pouvez partir. Que diraient, mes
concitoyens, si je m’enfermais avec un homme, maître de la plus grande partie
de la Souabe ? Nous avons aussi notre roche tarpéienne. — Vous m’embarrassez
beaucoup. — J’en suis fâché. »
«
— L’empereur, mon seigneur suzerain... — Passez les qualités : je les connais.
— Est parent du roi d’Espagne Philippe
II.
— Oui, Rodolphe est fils de Maximilien II, et petit-fils de Ferdinand premier,
frère de Charles Quint, qui donna le jour à Philippe. Nous savons tout cela.
Au fait, s’il vous plaît. — Philippe est maître du quart de la terre connue....
— Et il veut ajouter la France à ses immenses propriétés. Nous savons cela
encore. — Il est dans l’intérêt de l’Allemagne de l’arrêter dans ses vastes
desseins. — J’entends. L’empereur veut faire la guerre à son cousin, et
il désire que les Suisses soient ses auxiliaires. Cette affaire ne peut
se traiter qu’en diète générale.
-
Je sais cela aussi. Je viens seulement
m’assurer des
dispositions
où sont les esprits. — Je vais vous le dire : il est inutile, pour les connaître,
que vous parcouriez les treize cantons.
« La
liberté ne fera pas le tour de la terre. Peu nous importe à qui elle appartienne,
puisqu’elle doit avoir des maîtres. Nous gémissons sur les maux dont l’accablent
quelques ambitieux ; mais nous en sentons mieux les avantages de notre situation.
Le despotisme hait la liberté, et nous ne le redoutons pas : il viendrait
expirer aux pieds de nos montagnes. Nous n’avons donc aucun intérêt à entrer
dans des querelles d’ambition ou de cupidité. La Suisse ne donnera certainement
pas une armée à votre maître. Elle conservera ses forces pour sa propre défense
; mais elle continuera à vous fournir, à vous et aux autres puissances, quelques
soldats pour votre argent. Quand leur temps est expiré, ils rentrent, instruits
et disciplinés, dans leur patrie, prêts à la défendre contre ceux qu’ils
ont fidèlement servis, s’ils osaient l’attaquer. L’audience est levée. »
Freuden
aborda le comte de Wirtemberg, avec une sorte de cordialité que je n’attendais
pas de lui, à l’égard d’un grand seigneur. Il lui dit que la commune fournirait
à tous ses besoins, et qu’il n’avait qu’à les faire connaître. Le comte accepta
un léger repas, auquel il fit peu d’honneur : son estomac n’était pas assez
fort pour digérer les alimens des hommes libres.
Il remonta
à cheval, et retourna en Souabe. Ce qu’il y a de remarquable, dans cette
conjoncture, c’est que la réponse d’un paysan suisse empêcha l’empereur de
déclarer la guerre à l’Espagne.
Je racontai
tout cela à André, qui, de son côté, avait fait parler monsieur l’écuyer.
Les électeurs n’entendaient pas épuiser
l’Allemagne
d’hommes, pour satisfaire l’ambition du chef de l’empire. Rodolphe, était
borné aux forces que pouvait lui fournir son duché d’Autriche, et voilà pourquoi
il avait désiré contracter, avec la Suisse, une alliance offensive et défensive.
Il était
tout simple que ce prince se fût exactement informé de la situation des affaires
en France : les Suisses pouvaient faire des questions à son ambassadeur,
et il était naturel qu’il pût répondre à tout. Le comte était donc instruit.
Il paraît que son écuyer se conduisait auprès de lui, comme je l’avais fait
avec les plénipotentiaires de Henri III, pendant leur voyage à Bergerac.
Cet écuyer était la mouche du Wurtemberg.
J’écoutai
André avec avidité : on tient toujours à sa première patrie.
« Vous
connaissez Mayenne aussi bien que moi. Vous savez, Monsieur, que nous l’eussions
mis en bouteille, aussi bien que son secrétaire Péricard, si les circonstances
l’eussent exigé.
Il perdit
un temps précieux en Bourgogne, et l’inquiétude le ramena à Paris, où les
Seize le faisaient trembler.
Henri
IV ne perdait pas un moment. Il entra à Dieppe, où les villes de la basse
Normandie lui envoyèrent des provisions de bouche, par mer. Il fortifia le
faubourg, dit le Pollet, et le château d’Arques, situé à une lieue de Dieppe.
Il lui importait de conserver ce port, où les Anglais pouvaient faire entrer
des secours.
Mayenne
était brave, et n’était que cela. Il sentit cependant la nécessité de se
signaler par quelque action d’éclat, qui lui
assurât
l’attachement et la confiance de son parti. Il partit de Paris à la tête
de vingt mille hommes.
La médiocrité
est présomptueuse. Mayenne écrivit au Pape et au roi d’Espagne qu’il tenait
le Béarnais dans ses filets, et qu’il ne lui échapperait qu’en sautant dans
la mer.
Le Béarnais
attendait tranquillement vingt mille hommes, avec sept mille, qui, comme
lui, avaient le diable au corps. Mayenne attaqua bravement, et fut reçu de
même. Il fut repoussé au Pollet et au château d’Arques, et il fut enfin vaincu
en bataille rangée, dans la plaine d’Arques.
« Sept
mille hommes en battre vingt mille ! cela est fort, Monsieur. »
Mayenne
fait publier dans Paris qu’il a vaincu à Arques, et que Henri a été tué dans
la mêlée. Pas du tout. Henri paraît le même jour dans la plaine de Mont-Rouge,
à la tête de sa petite troupe victorieuse, mais qui était augmentée de quatre
mille Anglais et de sept mille réformés, que lui avaient amenés le comte
de Soissons, le maréchal d’Aumont et le duc de Longueville.
Henri
ne s’amusa pas à tenir des conseils de guerre. Il attaqua aussitôt, et enleva,
l’épée à la main, cinq faubourgs de Paris.
« Ah,
Monsieur, que vous avez bien jugé ce prince-là ! on ne peut faire de telles
choses, que lorsqu’on a pour auxiliaires les puissances infernales. — Chut,
chut ! — Vous l’avez pensé, vous l’avez dit, vous l’avez écrit, vous l’avez
fait imprimer. — J’étais encroûté alors du fanatisme monacal, et j’en suis
bien revenu. — C’est ce dont j’ai cru m’apercevoir. »
Mayenne
se hâta de se jeter dans Paris, avec les débris de son armée : il y entra
par les faubourgs du nord, que le roi n’avait pu attaquer avec aussi peu
de troupes. Mayenne se trouva fort alors, parce que la plus grande partie
de la population lui était dévouée. Le Roi, aussi prudent que brave, résolut
de se retirer, et battit en retraite parle faubourg St.-Jacques. On y trouva,
armé de toutes pièces, le fameux prieur Bourgoing, auteur principal du meurtre
de Henri III. Henri IV l’envoya à la fraction royaliste du parlement de Paris,
qui siégeait à Tours, et il fut écartelé.
« Il
méritait cela !— Oui, mais vous conviendrez que c’est payer un peu cher les
bonnes grâces de mademoiselle de Montpensier. »
Le Roi
s’était retiré sur la Loire. Il prenait des villes ; on lui en prenait d’autres.
On tuait des hommes, sans obtenir de résultats. Un incident imprévu avança
les affaires de Henri. La république de Venise le reconnut, en qualité de
roi de France. « Elle fit très-bien, André, et tous les souverains de l’Europe
devraient suivre cet exemple. J’aime beaucoup Henri IV, depuis que je n’entends
plus de prédications incendiaires. »
Les
politiques disposaient partout les esprits en faveur de ce prince. Des écrits
circulaient dans Paris, et tendaient à lui en faire ouvrir les portes. S’il
abjurait le calvinisme, il serait reconnu par toute la France, « S’il embrassait
le catholicisme, je l’adorerais. — Monsieur, sa résistance est son plus bel
éloge. L’homme d’honneur ne transige point avec sa conscience. Je crois cependant
que la force des choses l’amènera à s’humilier devant le pape. — Oh, alors
ce sera un prince accompli. — À ses amourettes près. Il y a là une Gabrielle
d’Estrées, qu’il a élevée jusqu’aux marches du trône... — Ah ! André,
la
perfection
absolue n’est pas donnée à l’homme. — Vous le défendez, maintenant ! tantum
Mutatus ab illo ! — Mon ami, rien de ce qui est exagéré n’est durable.
»
Mayenne
redoutait, avec raison, les talens militaires de Henri
IV.
Ses lenteurs, ses tergiversations, lui étaient, peu à peu, la confiance de
la ligue, et des troupes espagnoles, que Philippe II avait fait entrer en
France. Bientôt le duc fut l’objet de plaisanteries piquantes, et il sentit
la nécessité de se relever dans l’opinion des Français, et des alliés, qu’il
avait été contraint de reconnaître. Il alla chercher le Roi dans la haute
Normandie, près de Nonancourt.
Le Roi
descendit dans la plaine d’Ivry, et rangea son armée en bataille. « Si vous
perdez vos enseignes, dit-il à ses soldats, ralliez-vous à mon panache blanc.
Vous le trouverez toujours au chemin de l’honneur et de la gloire. » Il fit
sonner la charge.
Mayenne
ne pouvait lutter contre un tel adversaire. Il laissa prendre son corps de
bataille en flanc, et, de ce moment, il fut vaincu. Il perdit son artillerie,
ses bagages, et les trois quarts de son armée. Les Allemands et la cavalerie
espagnole furent exterminés.
Alors
le panache blanc, si terrible pendant l’action, devint un gage de bonté et
de clémence. Henri se jeta au milieu de ses bataillons. Il les parcourut,
dans tous les sens, en criant : Sauvez les Français ! sauvez les Français
!
« Oh,
le brave, le bon, l’excellent prince ! — J’ai toujours prévu, Monsieur, que
vous vous réconcilieriez avec lui. — André, si je n’étais libre et Suisse,
j’irais me ranger au nombre de ses sujets. »
Mayenne
courut se renfermer dans Paris, et il y porta la consternation. Si le roi
se fût présenté devant cette ville, il y fût incontestablement entré de vive
force ; mais il craignit la fureur et la cupidité de ses soldats. Il voulait
prendre et conserver Paris. Il vint assiéger cette ville, pour la forcer
à capituler.
Il s’empara
de toutes les communications, et du cours de la Seine. Bientôt la famine
se fit sentir. La faim est ordinairement sourde à tous les raisonnemens ;
mais le fanatisme religieux peut la soumettre, pendant quelque temps.
On soutint
celui des Parisiens, par tous les moyens que purent imaginer le charlatanisme
et la friponnerie. Les prédicateurs firent retentir toutes les chaires de
leurs vociférations ; Caëtani, légat du pape, publia des mandemens, qui menaçaient
de la damnation éternelle quiconque penserait à traiter avec un prince hérétique.
La Sorbonne rendit des décrets foudroyans, dictés par le même esprit. En
conséquence, on pendit, on noya, comme fauteurs de l’hérésie, ceux que la
faim poussa au désespoir, et qui parlèrent de se rendre.
La Monacaille,
persuadée qu’on prend les hommes par les yeux, s’enrégimenta et parada
dans les rues de Paris. Ils avaient la robe retroussée, le capuchon renversé,
le casque en tête, la cuirasse sur le dos, l’épée au côté, un mousquet rouillé
sur l’épaule et la pique à la main. Rose, évêque de Senlis, et chef du comité
des Seize, marchait à la tête de ce burlesque régiment. Hamilton, curé de
Saint-Côme, en était le major-général.
La disette
augmenta au point de ne pouvoir plus être supportée. On avait dévoré tous
les animaux domestiques. On exhuma les cadavres, et les os du cimetière des
Innocens. Cette nourriture fit périr des milliers d’individus. Ceux
qui leur
survécurent
ambitionnèrent la palme du martyre, que promit solennellement la Sorbonne
à ceux qui auraient le courage de se laisser mourir de faim. Cette corporation
de prêtres coupables parvint à soutenir encore le fanatisme. L’homme est-il
né pour être le jouet de l’erreur ?
Henri
connut ces maux affreux, et il voulut y mettre un terme. Il laissa entrer
quelques voitures de vivres dans Paris ; mais, en même temps, il donna un
assaut général aux faubourgs de la ville, et les enleva tous l’épée à la
main. Il ne lui restait plus à réduire que le corps de la place.
L’infortune
produit la méfiance. On remarqua que les moines de Paris ne perdaient rien
de leur embonpoint et de leur fraîcheur. On fit des perquisitions dans tous
les couvens. On les trouva abondamment pourvus de vivres de toute espèce.
On les distribua au peuple. Cette dernière ressource suffit à peine pendant
quelques jours.
Mayenne
fit sortir de Paris les vieillards, les femmes et les enfans. Ces misérables
allèrent demander du pain à Henri IV. Il leur en donna, et leur permit de
s’éloigner.
Cependant
le peuple de Paris, réduit au dernier désespoir, renonça à la palme du martyre,
et demanda, à grands cris, la paix ou des alimens. Mayenne sentit que cette
ville allait lui échapper, et il résolut de traiter avec Henri.
Quelques
jours encore, et ce prince entrait dans la capitale. Le duc de Parme, gouverneur
des Pays-Bas, avait reçu de Philippe l’ordre de soutenir la ligue, et de
se porter sur Paris, avec toutes ses forces. Il parut à la vue de cette ville,
au moment où le cœur de Henri s’était ouvert à la douce espérance de terminer
enfin
cette
guerre cruelle : Paris, dans tous les temps, entraîna les provinces.
Henri
rassembla toutes ses troupes, et présenta la bataille au duc de Parme. Il
lui était défendu de combattre. Il fit entrer dans Paris un convoi considérable
de vivres ; il donna huit mille hommes à Mayenne, et se retira vers les frontières
de la Picardie. Henri le suivit, avec des forces inférieures ; mais il ne
comptait pas ses ennemis. Il espérait profiter de quelque faute : le duc
de Parme n’en fit pas.
Henri
retourna attendre, en Normandie, les secours d’hommes et d’argent que lui
envoyaient Elisabeth d’Angleterre, les Hollandais, et les princes protestans
d’Allemagne. Rouen tenait seul dans cette province pour la ligue. Le roi
ordonna à notre maréchal de Biron d’assiéger cette place, et vint se joindre
bientôt à cet intrépide général. Le duc de Parme rentra en France, à marches
forcées, et sauva Rouen, comme il avait sauvé Paris.
Après
des succès balancés, notre brave Biron fut tué d’un coup de canon sous les
murs d’Épernay. Ici André suspendit son récit. Nous donnâmes des larmes à
la mémoire de ce grand général, quoiqu’il eût fini par me traiter très-mal.
Henri
reconnut les services du père, en portant son affection sur le fils, et en
lui accordant une partie des honneurs et des emplois dont le maréchal avait
été revêtu.
Hélas
! la lettre, qu’il m’avait dictée pour lui, fut malheureusement prophétique.
Elevé, quelques années après, à la dignité de maréchal de France, il conspira
contre son bienfaiteur. Le roi voulut lui pardonner, et n’exigea de lui que
l’aveu
de son crime. Il le nia avec opiniâtreté, et Henri en avait la preuve écrite
dans ses mains. Il porta sa tête sur l’échafaud.
Henri
se rapprocha de Paris. Il prit des villes, les fortifia, et se plaça de manière
à pouvoir secourir ceux de ses généraux que l’ennemi serrerait de trop près.
Depuis
long-temps, Rosny lui disait : Il convient que je reste huguenot, et que
vous soyez papiste. Il avait une répugnance invincible à abandonner sa religion.
Elle servait alors de prétexte à ses ennemis pour l’éloigner du trône. Il
se rendit enfin aux instances de ses amis, et il résolut de sacrifier sa
conscience au bien de l’Etat. Il fit abjuration dans l’église de Saint-Denis.
« Mon
cher André, j’aimais Henri IV protestant, je l’adore catholique. »
Ce prince
croyait n’avoir plus d’obstacles à redouter. Le clergé et les moines ne crurent
pas sa conversion sincère. Ils craignirent de voir le calvinisme dominer
en France, et leur ravir leurs biens immenses. Ils cessèrent de compter sur
la ligue, et ils résolurent d’employer le poignard.
Aubry,
curé de Saint-André-des-Arcs, et Varade, recteur du collège des jésuites,
poussèrent au crime un nommé Pierre Barrière. Il fut découvert, condamné,
et exécuté. Il nomma ses instigateurs, au moment d’aller au supplice. Ils
s’étaient réfugiés chez le légat, et le suivirent à Rome. « Les misérables
! »
Henri
bloqua Paris, pour la troisième fois. La division s’établit entre les princes
Lorrains. Brissac, gouverneur de cette ville,
profita
de cette circonstance en homme habile. Il gagna les personnages les plus
influens de la population, et il ouvrit, au roi, les portes de la capitale.
« Oh, le brave homme, André ! » Dès que Henri y parut, il gagna tous les
esprits et tous les cœurs. Ceux de la grande majorité des Français lui étaient
déjà acquis. « Je le crois bien, parbleu ! »
Un autre
misérable fut fanatisé par les jésuites. Jean Châtel, âgé de dix-huit ans,
se glissa dans le Louvre, au moment où Henri IV y rentrait. Ce prince se
baissa pour embrasser Montigny, qu’il n’avait pas vu depuis longtemps, et
qui était à ses genoux ; le coup de poignard était lancé. Il ne frappa le
roi qu’à la bouche. Ce scélérat fut arrêté à l’instant. Il s’enorgueillit
de son crime, et déclara avoir fait une bonne action.
Cependant
on tira de lui des aveux. Il avait fait ses études chez les jésuites, et
ils connaissaient l’art funeste d’exalter les imaginations.
Châtel
convint avoir souvent entendu dire, chez les jésuites, qu’il serait méritoire
de tuer Henri de Bourbon. La veille du jour où il commit le crime, il s’était
confessé à un de ces pères, qu’il ne put ou ne voulut pas nommer. Ce monstre
l’encouragea au parricide, et lui montra le ciel ouvert pour lui, s’il succombait
dans sa sainte entreprise. Ainsi la confession, instituée pour prévenir ou
expier les fautes, a quelquefois été un instrument de forfaits. L’auteur
de celui-ci subit un supplice affreux.
Le parlement
de Paris cherchait à faire oublier ce que sa conduite, envers le roi, avait
eu d’odieux, en lui marquant un dévouement sans bornes. D’après les dépositions
de Châtel, il
ordonna
de rigoureuses perquisitions dans la maison des jésuites.
On y
trouva d’abord une chambre, dite des méditations. Les jeunes gens,
qu’ils y enfermaient, étaient éclairés par une lampe sépulcrale, qui leur
faisait voir des figures diaboliques, des flammes, des malheureux torturés,
grossièrement peints sur les murs. Le jeûne achevait d’exalter leur imagination.
On les laissait méditer là sur les principes qu’on avait fait germer en eux,
et quelques-uns sortirent de cette effrayante retraite, disposés à tout entreprendre.
On
trouva dans les papiers du professeur Guignard….
« Guignard
! ce jésuite que Poussanville rencontra dans les rues de Poitiers ? — Et
dont le maréchal de Biron disait qu’il jouerait un grand rôle dans l’Etat,
s’il n’était pas pendu. »
On trouva
dans ses papiers, ces paroles écrites de sa main : Ni Henri III, ni Henri
IV, ni la reine Elisabeth, ni le roi de Suède, ni l’électeur de Saxe, ne
sont de véritables souverains. Henri était un Sardanapale ; le Béarnais est
un renard ; Élisabeth une louve ; le roi de Suède un griffon, et l’électeur
de Saxe un porc. Jacques Clément a fait un acte héroïque, INSPIRÉ PAR LE
SAINT-ESPRIT. Si on peut guerroyer le Béarnais, qu’on le guerroye. Si on
ne peut le guerroyer, qu’on l’assassine. Guignard fut pendu.
Le parlement
s’était procuré les écrits de Tolet, de Bellarmin, de Mariana, de Sa, de
Suéars, de Salméron, de Molina, et des jésuites de Naples. Tous érigent le
régicide en doctrine, dans certaines circonstances, spécifiées par eux.
Le
parlement vient de rendre un arrêt, qui chasse les jésuites du royaume. Il
s’exprime en ces termes : La cour a banni cette société, d’un genre nouveau,
et d’une superstition diabolique, qui a porté Jean Châtel à cet horrible
parricide.
« Mon
cher André, ils ont échoué dans leur lâche et infâme projet. Ils sont chassés
de la France. Puissent-ils n’y jamais rentrer ! »

Chapelle
sur l'Ebenalp, d’après un dessin de Geisser, vers 1850.
CHAPITRE
XXXVI.
Voyage
au haut de l’Ebenalp.
Comment
se fait-il que les idées les plus naturelles, les plus simples ne se présentent,
quelquefois que long-temps après le moment qui eût dû les faire naître ?
Nous exigeons, de notre mémoire, quelquefois rebelle, un fait, un mot intéressant,
que nous sommes étonnés d’avoir pu oublier, et elle nous présente des choses
perdues pour nous depuis des années, et qui n’ont aucun rapport avec celles
que nous cherchons. Tout en nous est inexplicable, et nous avons le ridicule
orgueil de vouloir nous connaître.
Comment,
par exemple, personne de nous n’avait-il pensé, depuis six ans, à vouloir
connaître cette montagne, qui nous abrite du vent du nord, et dont la base
nous donne, en abondance, un vin aussi bon que peut le fournir le climat
?
C’était
un beau jour d’été ; nous avions terminé nos travaux. Nous attendions, sur
notre prairie, un souper qui devait nous rendre des forces pour le lendemain.
André et moi philosophions ; Marianne chantait les couplets que j’avais faits
pour elle ; Claire avait quitté son rouet, et se promenait, silencieusement,
sur le gazon ; les enfans jouaient, s’agaçaient, couraient l’un après l’autre,
s’embrassaient, annonçaient un sentiment, plus vif déjà que l’amitié, et
qui ne tardera pas à être
de
l’amour. « Mais, Messieurs, s’écria tout à coup Bertrand, cette touffe de
broussailles, que, depuis si longtemps, nous regardons là-haut, avec indifférence,
trompe nos yeux par sa prodigieuse élévation. Ces broussailles sont peut-être
une forêt. »
L’imagination
va vite, quand on lui a donné l’éveil. « Cette forêt est peut-être composée
d’arbres fruitiers. — Ou au moins de vigoureux sapins… — Qui nous fourniraient
notre chauffage. — Ils doivent receler du gibier, que vraisemblablement nous
ne connaissons pas. Et des fleurs, nouvelles pour nous, dit Marianne. Nous
les naturaliserions ici, et nous vous en ferions des bouquets pour votre
fête, monsieur Antoine. — Et puis, reprit André, quel plaisir de découvrir
un monde nouveau, et de l’exploiter à notre profit, sans avoir une goutte
de sang à verser !
« —
Ami André, voilà un joli rêve. Il n’y a qu’une difficulté pour le réaliser
; mais elle est insurmontable. Il est impossible de gravir cette partie de
l’Ebenalp. — Hé, Monsieur, pourquoi croire impossible ce qu’on n’a pas essayé
de faire ? Hé bien, j’essaierai, dit Bertrand. — Non, mon ami, tu te tuerais,
et nous voulons que tu vives. Je suis jeune et vigoureux, reprit Abdonn.
J’ai de l’agilité, de la souplesse, la plus grande envie de voir ce qui se
passe là-haut. J’y monterai avec Bertrand. »
Gott
et Sophitt s’élevèrent fortement contre ce projet. Leurs maris combattirent
leurs raisonnemens avec avantage. Ils conclurent par un moyen qui ne laissait
pas de réplique : « Si nous ne pouvons monter, sans danger, nous reviendrons.
»
Les
deux femmes résistaient encore. Leurs maris persistaient dans leur courageuse
résolution. Elles nous prirent pour
arbitres,
André et moi. Nous prononçâmes, après nous être consultés, que, puisqu’ils
s’engageaient à céder à des obstacles, qu’ils jugeraient dangereux de vouloir
surmonter, nous ne jugions pas devoir les empêcher de tenter l’aventure.
Ces dames laissèrent tomber leur tête sur leur poitrine, et ne répliquèrent
pas.
La veille
du jour, où Abdonn et Bertrand devaient entreprendre de forcer la nature,
ils s’occupèrent sérieusement des dispositions du départ.
A la
naissance de l’aurore, Abdonn avait, sur le dos, un havre- sac, qui renfermait
les provisions de bouche. Il portait, à sa ceinture, des pistolets, une hache
pour percer les pierres et la glace, et des broches de fer pour se faire
des échelons sur les points les plus inabordables. Bertrand, moins exercé
dans ces sortes de voyages, n’avait que le bâton ferré que nous avions pris
à Copet, et des cordes, dont l’usage n’était pas encore déterminé. Nous leur
souhaitâmes tout le succès qu’ils pouvaient désirer. Leurs femmes les embrassèrent,
tombèrent à genoux, et prièrent le ciel de les leur ramener.
Ils
partent. Ils s’élancent vers des sommités, que personne, avant eux peut-être,
n’a osé essayer de franchir. Nous les suivons des yeux ; nous retenons notre
haleine, quand nous les voyons suspendus sur des abîmes : il nous semble
que le moindre souffle suffit pour les y précipiter.
Abdonn,
plus jeune et plus agile que Bertrand, marchait le premier, et s’avançait
en ligne droite. Son compagnon, moins aguerri, croit, vraisemblablement,
reconnaître une pente praticable, qui lui épargnera les peines et les dangers
que brave le jeune homme. Il porte ses pas de ce côté. Il se sépare, il
s’éloigne
d’Abdonn, qui, à l’aide de sa hache, et de ses broches de fer, monte, lentement,
péniblement, un mur de glace, qui se trouve à pic devant lui. Il arrive au
sommet du glacier, et nous salue avec son mouchoir déployé. Il ne nous paraît
pas avoir plus de trois pieds de haut.
Nous
perdons Bertrand de vue. Il est sans vivres ; il n’a pour ressources que
des cordes, qu’il ne peut attacher au-dessus de lui. Ses pistolets lui seront
inutiles : les ours n’ont pu gravir ces rochers affreux, et les chamois,
s’il y en a dans ce désert glacé, ne penseront pas à l’attaquer. Mais comment
continuera-t-il à monter ? comment retournera-t-il sur ses pas, s’il se décide
à descendre ? Les mains secourables d’Abdonn sont perdues pour lui, et il
ne peut embrasser seul les masses saillantes de roches, auxquelles il faudrait
fixer ses cordes. Ces idées arrachent à Gott un cri déchirant. Nous avons
tous le cœur serré ; nous sommes tous torturés par les mêmes pensées ; nous
souffrons plus, peut-être, que le malheureux que nous n’espérons plus revoir,
et que son activité, du moment, soutient encore. Nous ne nous adressons pas
mot ; nous n’avons plus, d’ailleurs, la force d’articuler.
Après
avoir franchi le mur de glace qui l’arrêtait, Abdonn s’est élancé sur une
roche, à laquelle il s’attache par les mains et les pieds. André court prendre
notre lunette d’approche.
Quand
il revient, Abdonn est parvenu à un point qui n’a pas deux pieds de large.
A droite et à gauche des pointes menaçantes le défient ; d’horribles précipices
sont ouverts sous lui. La fatigue, un froid rigoureux, peut-être, détache
une de ses mains. Il fait un quart de tour sur lui-même.... Nous nous jetons
la face contre terre, pour ne pas voir cet infortuné tomber, en
lambeaux,
dans le fond des abîmes. André et moi nous maudissons notre funeste
condescendance.
Nous
nous relevons enfin... Tout a disparu. Nous ne voyons plus que l’épouvantable
montagne, qui menace du même sort quiconque osera la braver. Sophitt et Gott
tombent dans un accès de désespoir, et elles conservent assez de délicatesse
pour ne pas nous adresser un reproche. Nous les entraînons dans le bas de
notre baume ; nous nous enfonçons, avec elles, dans les entrailles de la
roche. Là, du moins, nous ne verrons rien... Hélas, que nous reste-t-il à
voir ?... Nous passâmes là une partie de la journée, en proie à des angoisses,
impossibles à décrire.
Les
sensations de l’enfance sont extrêmes, et, par conséquent, peu durables.
Toinon et Toinette s’étaient affligés avec nous ; mais un besoin, naturel
et impérieux, force les enfans à changer souvent de position. Le mouvement
tend à développer et à fortifier leurs organes. Les nôtres étaient retournés
à la prairie.
Tout
à coup, ils rentrent dans la baume, en criant de toutes leurs forces : «
Il y a du feu sur le haut de la montagne. Nous l’avons vu distinctement avec
la lunette d’approche. » Nous nous précipitons les uns sur les autres, nous
sortons, nous nous arrachons la lunette, et nous sommes convaincus que la
flamme pétille, en effet, sur l’extrême sommité de l’Ebenalp. Un de nos voyageurs,
au moins, est sauvé. Mais lequel ? Gott et Sophitt se remettent en prière.
Le Ciel ne peut exaucer l’une, sans frapper l’autre.
Oh,
comme on regarde, quand on est intéressé à bien voir ! Nous remarquâmes que
le foyer disparaissait pendant quelques secondes, et se remontrait avec sa
première vivacité. « C’est lui, ce sont eux, peut-être, qui passent et repassent
devant le feu
qu’ils
ont allumé. — Comment sont-ils parvenus jusques-là ?
— Comment
s’y sont-ils réunis ? Ils y sont tous deux, s’écrièrent Sophitt et
Gott ! »
Elles
avaient remarqué, comme nous, une faible lueur, qui s’était répétée quatre
fois, à de courts intervalles. Ils avaient chacun une paire de pistolets,
et, sans doute, ils ont fait feu de leurs quatre coups. Nous n’entendîmes
pas l’explosion.
De quel
énorme fardeau nous nous sentîmes soulagés ! On n’entendait plus que ces
mots : Ils y sont tous deux. Nous les répétions avec une ivresse,
un délire ! Nous nous prenions les mains ; nous nous embrassions ; nous embrassions
nos enfans, à qui nous devions la fin de nos tourmens.
Existe-t-il
de bonheur sans mélange ? De tristes réflexions éteignirent notre joie. Sur
qui ont-ils tiré, nous demandions- nous ? Sur quelque bête farouche. S’ils
ne l’ont pas abattue, ils sont livrés, sans défense, à sa griffe meurtrière.
« Abdonn, dit Sophitt, d’une voix faible, a mis des cartouches dans son havre-
sac. » Auront-ils eu le temps de recharger leurs armes ?
Enfin,
nous comparions les difficultés de la descente, à celles qu’ils avaient surmontées
en montant : on croit facilement ce qu’on redoute. Nous prévîmes des obstacles,
presque invincibles, à leur retour. « Bah, bah, dit André, l’un ne me paraît
pas plus difficile que l’autre. — Il suffit que le pied leur glisse... —
Hé, pour quoi leur glisserait-il ? Ils descendront les pas difficiles sur
le coccyx. Il leur en coûtera une paire de culottes, voilà tout. Je suis
las de me tourmenter, et je les attends de pied ferme. »
Ces
raisonnemens ne nous paraissaient pas persuasifs. Notre anxiété augmentait,
de minute en minute ; la lunette passait, sans interruption, d’une main dans
une autre.
Nous
crûmes enfin remarquer quelque mouvement au-dessous du faîte de la montagne.
Bientôt il devint sensible. Une heure après, nous distinguâmes deux masses
informes qui roulaient lentement vers nous. « Ah ! nous écriâmes-nous, tous
ensemble, ce ne sont pas des hommes ; mais que peut-ce être ? » Un moment
après, ces objets disparurent, et nous retombâmes dans le désespoir.
« Vous
me ferez devenir fou, s’écria de nouveau André. Comment, vous ne pressentez
pas qu’ils sont arrivés à la pente, au talus où nous avons perdu Bertrand
de vue, et qu’ils ont pris cette direction, parce qu’elle leur présente des
facilités. — Mais, ami André, y a-t-il réellement une pente, un talus ? —
Vous l’avez préjugé vous-même, ami Antoine, et, sans cela, comment le lourd
Bertrand fût-il parvenu là-haut ? — Mais ces deux masses ressemblent bien
peu à des hommes. — Si ce n’en est pas, que vous importe ce qu’elles deviendront
? Désolez- vous, affligez-vous, torturez-vous, je ne vous répondrai plus
un mot. Il est quatre heures, et nous sommes à jeun, Gott, apportez-nous
quelque chose, ici. Ceux que les alarmes nourrissent regarderont ce qui se
passe là-haut.
«
— Les voilà, les voilà ! — Bien certainement ce sont eux.
— Ils
arrivent au point d’où Bertrand a disparu. — Mais qu’est- ce donc qui masque
ainsi toutes leurs formes ? Ils sont bossus, par derrière et par devant,
dit André, qui, dès les premières exclamations s’était levé précipitamment...
— Ah, ils sont, vraisemblablement, chargés du gibier, qu’ils ont tué de leurs
quatre coups. Bertrand délie son paquet de cordes. Ils en
attachent
une à la première broche de fer, qu’Abdonn a frappée au pied de ce mur de
glace, qu’il a monté si courageusement. »
La joie
et la crainte nous agitaient alternativement. Nous suivions tous leurs mouvemens.
— André, lui-même, les imitait, sans s’en apercevoir, quand leur position
devenait inquiétante. Ils parvinrent enfin à l’endroit où ils s’étaient séparés.
Ils attachèrent leurs cordes bout-à-bout, et, de ce moment, il ne nous resta
plus que le souvenir de leurs dangers. Une heure après, ils étaient dans
nos bras. Oh, comme nous les caressâmes ! comme nous les fêtâmes ! C’était
une résurrection que nous célébrions.
Bertrand
portait, sur ses épaules carrées, un chamois femelle, qu’ils avaient tuée.
Il la déposa à la cuisine. Abdonn s’était attaché, sur la poitrine, son petit,
qui avait, tout au plus, quinze jours. Il avait déjà les yeux pleins de feu,
et les efforts qu’il faisait, pour se remettre en liberté, annonçaient la
force et l’agilité.
Les
maris suisses ne se bornent pas à aimer leurs femmes, surtout quand elles
sont jeunes. Ils ont, pour elles, les attentions, les prévenances, que nos
Français accordent à peine à leurs maîtresses. Abdonn fit hommage, à Sophitt,
de son jeune chamois, et elle l’embrassa, pour la centième fois.
Marianne,
toujours reconnaissante du sacrifice d’une danse, déjà bien éloigné de nous,
ne manquait jamais de prétexte pour retenir la jeune femme. Il est constant
que nous la trouvions toujours occupée. Marianne avait pris, peu à peu, la
haute main dans notre habitation : les femmes sont bien aises, dit-on, de
regagner en autorité, ce qu’elles perdent en jeunesse et en
fraîcheur.
L’empire de Marianne était plutôt de persuasion que de droit. Il était doux,
comme elle, et chacun la chérissait. Sophitt, reconnaissante à son tour,
la pria d’accepter le petit chamois ; Marianne l’offrit à Toinette. Oh, quelle
joie ! « Qu’il est joli ! Quels beaux yeux !... Mais il doit avoir faim.
» Porte- le, lui dit Toinon, sous Blanchette. » C’était le nom de la chèvre
favorite. Elle veut le soulever ; elle n’en a pas la force. « Aide- moi donc,
mon cher Toinon ; tu sais bien que tout ce que j’ai est à nous deux. » Ils
enlèvent le petit animal ; ils le placent sous Blanchette. Ô bonheur ! ô
ravissement ! il tête avec avidité. Les enfans chantent, dansent autour de
lui. « Toinon, comment l’appellerons-nous ? — Robin, leur dit Marianne. —
Oh, oui.
—
Robin, Robin. »
Robin,
rassasié, se dégage de dessous la chèvre ; il se tourne vers la montagne
; il la regarde avec expression ; il allonge le cou ; il se porte en avant
; il bondit et s’arrête : ses forces lui paraissent insuffisantes. Il va
tristement se coucher aux pieds de Blanchette. « Oh ! ne nous quitte pas,
Robin ! tu seras si bien avec nous » : et l’idée de le perdre tirait des
larmes des yeux de ses jeunes maîtres. Dans huit jours aimeront-ils encore
Robin ?
Vous
savez qu’on ne touche au vieux seret et au cochon momisé que dans
les grandes occasions. Quel jour plus beau pour nous que celui où nos amis
nous étaient rendus ? oui, nos amis : nous nous étions réservé le droit de
diriger des travaux, que nous partagions avec eux ; mais depuis long-temps
nous ne formions qu’une nombreuse famille.
Gott
n’avait eu que le temps d’entendre nommer le seret, et déjà elle y a porté
la hache. Le cochon résiste à ses efforts ; le bras vigoureux de Bertrand
le pourfend de haut en bas, et les
époux
prononcent qu’il ne sera mangeable qu’après avoir passé quarante-huit heures
dans l’eau.
Cependant
André et moi nous voulions une espèce de petite fête. « Messieurs, dit Gott,
laissons de côté la soupe aux fèves et aux pommes de terre : j’ai des œufs
frais, des petits pois et des haricots verds, que j’ai préparés pour demain
dimanche ; une couple de bouteilles de votre vin vieux arroseront les tranches
de seret, et demain nous verrons. — Bien pensé, très- bien pensé. Allons,
à table, à table. »
Rien
ne manque à un festin suisse, quand on y sert du seret. Nous étions tous
contens, satisfaits, et de la bonne chère et de notre réunion, dont nous
avions désespéré, pendant cinq à six heures. Bertrand noua réservait une
surprise pour le dessert.
Il prend
le havre-sac d’Abdonn, et le dépose au milieu de la table, avec un air tout-à-fait
solennel. Les provisions qu’il renfermait avaient été consommées, auprès
du feu, sur la cime de la montagne. Bertrand en tire des rameaux de cerisier
sauvage, chargés de leur fruit verd encore. Nous ne les considérâmes d’abord
que comme des objets de pure curiosité.
« Celui
qui vous fait de bon vin, dit Bertrand avec enthousiasme, vous fera aussi
du kirswaser ; mais il faut retourner là, et je n’y monterai plus par les
moyens que nous avons employés ce matin. Les cerisiers, reprit Abdonn, sont
cachés par cette énorme pointe que vous voyez là, à mi-côte, et qui vous
a dérobé Bertrand. Il n’y a guère en tout, de loin en loin, qu’une soixantaine
de toises, divisées par parties, qui rendent la montée plus que difficile.
Avec de la poudre à canon et des pioches, on peut pratiquer des degrés, selon
le besoin. Et nous exploiterons facilement, reprit André, le monde nouveau
que vous avez découvert. — Mon ami, nous avons là, dans un
coin,
huit mille livres, qui ne nous serviront jamais à rien. — Convertissons-en
une partie en Kirswaser, en bois de sapin….
— Et en
gibier, dit Marianne. Nous vivrons ici comme de grands seigneurs.
« Allons,
mes amis, reprit André, racontez-nous vos aventures ; mais n’imitez pas ces
voyageurs, qui croient embellir la vérité à force d’exagération. »
Nous
savons que Bertrand n’est pas orateur. Abdonn se disposait à prendre la parole,
quand nous vîmes arriver une trentaine des habitans de Weisbad, bien armés.
Le sonneur avait eu affaire dans le clocher, et il avait cru voir deux hommes,
qui descendaient la montagne. Il ne pouvait s’en rapporter au témoignage
de ses yeux ; il se les était frottés, à plusieurs reprises ; enfin ne pouvant
plus douter d’un fait qui, de moment en moment, devenait plus certain, il
était descendu précipitamment, et il avait crié, par le village, que cette
partie de l’Ebenalp était habitée par des hommes d’une forme extraordinaire,
qui allaient descendre dans la plaine, et qu’il avait vu distinctement leur
avant-garde à la hauteur de notre baume.
Il est
aisé de juger de l’impression que fit une semblable nouvelle sur les habitans
du village. Le bourgmestre convoqua les notables ; ils décidèrent qu’on prendrait
les armes, et qu’on viendrait nous défendre. Un cri de guerre retentit partout,
et en envoya un exprès demander du renfort à Appenzell. Nous soupions bien
tranquillement, pendant qu’on se disposait à nous secourir. Les plus ardens,
les plus actifs venaient d’arriver, lorsqu’Abbonn allait commencer son récit.
Cette
apparition de deux hommes sur la montagne, si inconcevable, si extraordinaire,
si prodigieuse, s’expliqua tout naturellement, tout simplement, et la grosse
gaîté succéda à l’humeur belliqueuse qui animait, quelques minutes auparavant,
nos braves compatriotes.
Bientôt
nous entendîmes le bruit du tambour. C’était le bourgmestre de Weisbad ;
il s’avançait à la tête de deux cents hommes, au moins, qui marchaient dans
le meilleur ordre. Bons et dignes Suisses !
André
se détacha, et descendit dans la plaine, pour leur éviter la peine de monter
jusqu’à nous. Le tambour se tut ; mais les hommes libres sont curieux comme
les autres. Ceux-ci continuèrent leur route, pour entendre, de la bouche
d’Abdonn, ce qu’André ne pouvait leur apprendre.
Bientôt
ils furent joints par le landamman, à qui la loi prescrit de se porter sur
le point d’alarme, pour juger, par lui-même, des mesures qu’il convient de
prendre. Il arrivait, à grande course de mulet ; il rit comme ses compatriotes,
et il arriva, avec eux, sur notre esplanade.
Pauvre
prairie ! dans quel état elle fut réduite ! Mais comment marquer de l’humeur
à des gens qui s’éloignent de leurs foyers, disposés à se faire tuer pour
nous ? Il était nuit ; mais la lune venait de se lever, dans tout son éclat.
Malgré la profonde estime que nous avions pour nos hôtes, nous jugeâmes à
propos de nous en débarrasser le plutôt que nous le pourrions. Nous invitâmes
Abdonn à commencer.
Mais
comment se fera-t-il entendre de deux cents hommes, qui ont quitté leurs
rangs ? André n’est jamais embarrassé. Il les
invite
à s’asseoir en rond ; il charge Bertrand et Abdonn d’apporter, au milieu
du cercle, l’échelle double, qui sert à tailler nos arbres ; il convie l’orateur
à monter au haut de cette tribune aux harangues, d’un genre nouveau, et à
s’y tenir, jambe de ci, jambe de là.
Abdonn
parlait avec facilité, avec volubilité ; mais son allemand n’était pas très-pur.
Le lendemain, je traduisis sa relation dans le style des homélies, que j’écrivais
à la Rochelle, pour la maréchale de Biron.
Nous
partîmes, Bertrand et moi, décidés à surmonter tous les obstacles. Nous montâmes
paisiblement jusqu’au pied d’un mur de glace, qui semblait nous opposer une
barrière insurmontable. Une hache, des broches de fer, et un travail opiniâtre
me portèrent au haut de ce glacier, vieux, peut-être, comme le monde. Là,
j’éprouvai une satisfaction inexprimable : je venais de vaincre la nature.
Je me crus plus qu’un homme, et je provoquai l’admiration de ceux que nous
avions laissés dans la plaine, en agitant mon mouchoir, d’un point où nul
mortel n’était parvenu avant moi.
Je cherchai
Bertrand des yeux ; je ne le vis plus : je le crus roulé dans les abîmes,
qui m’environnaient. Je lui donnai un soupir, et je résolus de terminer ma
glorieuse entreprise, ou de finir comme lui.
Je m’élançai
sur une roche, qui m’offrait à peine deux pieds de largeur, au seul endroit
où je pouvais espérer de la gravir. J’avais, à ma droite et à ma gauche,
des pointes saillantes, que nul effort humain ne peut franchir, et derrière
moi des précipices, dont mes yeux n’osaient sonder la profondeur. Je m’attachai,
des pieds et des mains, à cette roche, devant
laquelle
allaient s’éteindre toutes mes espérances. Je me donnais des peines inimaginables,
et j’avançais peu. Bientôt le froid me pénétra, et la fatigue, inséparable
de la position où j’étais, me jetèrent dans le découragement. Je sentis que
ma dernière heure était venue, et je me résignai à la mort avec la fermeté
d’un Suisse d’Appenzell.
Je regardai
derrière moi, et je vis avec une joie, qui avait quelque chose de féroce,
que mon corps serait en lambeaux, long-temps avant que ses débris parvinssent
dans le fond des abîmes. Un malheureux, condamné au supplice, calcule la
durée de son agonie ; la mienne ne devait pas être longue.
J’allais
m’abandonner tout entier... Dans quelque position qu’on se trouve, on tient
encore à la vie. Je sentais l’impossibilité de sauver la mienne, et cependant
je ne lâchai que ma main droite. Ce mouvement me fit faire un demi-tour sur
moi-même, et cette main, qui préparait mon entière destruction, se porta
machinalement sur une pointe, qu’elle put saisir toute entière. L’image de
Sophitt s’offrit à moi, et je pensai à vivre encore pour elle. Cette idée
ranima mon courage éteint.
Je jetai
ma main gauche sur la droite, et toutes deux se trouvèrent fixées sur un
point, qu’elles tenaient facilement, et avec une fermeté qu’augmentait, de
seconde en seconde, le désir de prolonger ma vie. Mais les pieds étaient
encore dans la même position. Il fallait qu’ils suivissent la direction qu’avait
prise le haut du corps. S’ils ne trouvaient pas un appui, j’allais rester
suspendu par les mains, et mes bras ne pouvaient soutenir, qu’un moment,
le poids de tout mon corps.
Je
regardai au-dessous de moi…. Ô joie inexprimable ! une cavité semblait attendre
mes pieds…. Je fis un dernier et violent effort. Je m’enlevai sur mes mains
; les cuisses, les jambes, les pieds tournèrent, et je me trouvai d’aplomb.
Je prononçai le nom de Sophitt, avec autant de satisfaction que le jour où
je l’avais conduite à l’autel.
J’avais
fait beaucoup, sans doute ; mais il fallait me tirer de là. Je regardai sous
moi, et je reconnus la possibilité de descendre. L’espoir me rendit des forces,
et j’arrivai enfin au pied de cette roche, sur la cime de laquelle j’avais
cru trouver la mort. Je tombai à genoux, et je remerciai Dieu. J’ouvris mon
havre-sac, je pris quelques alimens, et j’observai les sites qui m’environnaient.
J’aperçus
une espèce de pente, qui tournait, que je retrouvai plus loin, et qui paraissait
devoir me conduire au sommet de l’Ebenalp. Je la jugeai praticable, et je
marchai avec un courage, que rien ne devait plus altérer.
Je pensai
alors à mon malheureux compagnon. Je le croyais mort ; j’avais cessé de craindre
pour moi, et je portai sur lui toutes les sensations pénibles, qui m’avaient
torturé pendant deux heures. Mes yeux se remplirent de larmes.
Je l’avais
perdu de vue au pied du mur de glace. Ah, pensai- je, il a dû le tourner,
et laisser, sur sa droite, le terrible rocher, que j’ai eu la témérité de
gravir. Il a nécessairement trouvé ce talus, il l’a suivi, et il est sans
doute bien plus avancé que moi.
L’intensité
du froid augmentait, à mesure que je montais. Je croyais voir Bertrand, transi
et tombé d’inanition sous les sapins
qui
couronnent la montagne. Je formai le projet de le rendre à la vie, et je
hâtai ma marche.
J’arrivai
enfin au faîte du mont, haletant, et dévoré d’inquiétude. J’appelai Bertrand
; il ne me répondit pas. Je le cherchai, et je le trouvai, comme je l’avais
prévu, étendu sous ces sapins, qui, d’ici, ne paraissent être que de faibles
arbustes. Je m’assis derrière lui ; je relevai le haut de son corps, je l’appuyai
sur ma poitrine, pour lui rendre quelque chaleur ; je lui versai du vin dans
la bouche, et j’eus la satisfaction de voir ses yeux se r’ouvrir. Je le traînai
contre le plus gros des sapins, et je l’y appuyai. Je quittai ma veste et
je l’en couvris, au risque de périr de froid moi-même. Enfin je cherchai
à faire du feu. Je m’étais chargé de choses qui n’étaient pas d’une indispensable
nécessité, et j’avais oublié de prendre un briquet. Je brisai un caillou
avec un autre plus gros ; des étincelles jaillirent, et tombèrent sur des
feuilles mortes. Il fallait avoir du feu ou périr l’un et l’autre. Je répétai,
plusieurs fois, la même tentative ; je soufflai légèrement ; la flamme pétilla
enfin. Dans l’ivresse de ma joie, je courus çà et là, cherchant, ramassant
des brassées de feuilles, et de branches mortes. Je donnai à mon feu une
activité telle, qu’on a pu l’apercevoir d’ici. Je repris ma veste ; j’aidai
Bertrand à se traîner devant le foyer, à qui nous allions devoir la vie.
Il reprit
bientôt l’usage de ses facultés. Il me reconnut. Il ne pouvait se lever encore,
il m’ouvrit ses bras ; je m’y précipitai. J’avais rappelé sa chaleur presque
éteinte ; il fallait lui rendre des forces. Tout ce que renfermait mon havre-sac
était gelé, le vin excepté. Quel bonheur d’être parvenu à faire du feu !
Nous fîmes un repas excellent, et l’oubli des maux, que nous avions soufferts,
nous rendit notre gaîté habituelle. Bertrand se jeta
encore
dans mes bras, et me jura une reconnaissance éternelle.
« N’aurais-tu pas fait pour
moi ce que je viens de faire pour toi ? — Tu ne dois pas en douter. — Alors
tu ne me dois rien. »
Nous
voulûmes remplir l’objet de notre périlleuse entreprise ; nous examinâmes,
dans tous ses détails, le monde nouveau où nous venions de pénétrer.
Nous
vîmes, d’abord, sur notre gauche, des précipices qu’il n’est pas donné à
l’homme de franchir. De l’autre côté, étaient deux bergers des montagnes,
enveloppés dans leurs peaux de mouton. Nous leur fîmes des signes d’amitié.
Immobiles, stupéfaits, ils nous regardèrent avec admiration.
Nous
tournâmes ensuite vers trois bouquets de sapins, d’une prodigieuse grosseur.
Ils sont séparés par de petits tertres, dont l’herbe nous parut rongée. Il
était facile de reconnaître que la hache n’avait jamais touché ces arbres
antiques. Il y en a quarante ou cinquante dans chacun de ces bosquets. Nous
les parcourûmes tous trois, dans tous les sens. Quel fut notre étonnement
d’y rencontrer une trentaine de chamois, qui ne fuirent pas à notre aspect
: sans doute ils n’avaient jamais vu d’hommes, et ils ne nous craignaient
pas. Sans doute encore ils ne sont pas venus là de l’autre partie de la montagne
: ils connaîtraient les bergers et leurs pièges, et ils se fussent dispersés
à notre approche. « La nature produit partout où la main de l’homme ne la
gêne pas, dit André, et il ne lui est pas plus difficile de faire un chamois
qu’une fleur. — André, m’écriai-je, voilà encore une de vos idées hétérodoxes,
qui m’ont si souvent blessé ! — Le grand Être créa, anima tout, et donna
à la nature la force productive qui continue la création. Je crois, mon cher
Antoine, cette idée-là très-orthodoxe. » Abdonn continua son récit : Nous
nous disposions à descendre, et à
regagner
notre habitation, asile de la paix et du bonheur. Une réflexion nous arrêta
; nous ne voulûmes reparaître ici qu’avec la preuve que notre tâche était
remplie. Des animaux que nous ne connaissions pas, et qui ont beaucoup de
ressemblance avec le lapin, passaient et repassaient devant nous ; nous en
tirâmes trois : nos pistolets étaient chargés à balles, et les coups ne portèrent
pas. Un chamois se présenta en flanc, et je l’abattis. Il est à remarquer
que ces quatre explosions n’effrayèrent pas les innocens habitans de l’Ebenalp
: ils doivent être accoutumés au feu et à l’éclat du tonnerre.
Je
m’approchai de ma victime. C’est une femelle, dont les mamelles sont encore
pleines de lait. Nous résolûmes d’avoir son petit vivant. Nous relevâmes
la mère sur ses quatre pieds ; nous l’appuyâmes contre un sapin, et nous
l’y attachâmes. Je me couchai sous son ventre, et Bertrand s’éloigna8.
Le petit
parut bientôt. Il m’aperçut, malgré les précautions que j’avais prises pour
me bien cacher. Il parut hésiter, pendant quelques minutes. La faim le pressait
sans doute : il s’élança, et saisit le pis de sa mère. Je lui jetai un nœud
coulant aux jambes de derrière, et il nous appartint. Nous l’attachâmes de
manière à lui faire le moins de mal possible ; Bertrand chargea la mère sur
ses larges épaules, et nous commençâmes à descendre. Il en était temps :
le froid recommençait à se faire sentir avec une vivacité alarmante.
Nous
marchions aussi vite que nous le permettaient les fardeaux dont nous étions
chargés, et nous remarquions, de

8 C’est
ainsi, en effet, que les chasseurs suisses prennent les jeunes chamois.
quart-d’heure
en quart-d’heure, que la température devenait plus supportable. Nous arrivâmes
au pied de ce terrible rocher, du haut duquel j’avais entrevu mon tombeau.
L’excès de l’inquiétude et de la fatigue ne m’avait pas permis d’en examiner
les alentours. Nous reconnûmes alors les nouvelles jouissances que nous promet
la nature. Là, sur une plate-forme de quatre ou cinq arpens, sont ces cerisiers
sauvages, que la roche garantit des vents du nord. Nous coupâmes ces rameaux
que Bertrand vous a présentés.
Nous
tournâmes ce rocher redoutable. Alors vous nous avez aperçus, reconnus, et
ma relation finit naturellement ici.
L’orateur
eût pu parler long-temps encore, sans qu’on pensât à l’interrompre. La nouveauté,
la variété des objets, l’intérêt qu’ils inspiraient soutenaient l’attention.
Cependant il était dix heures du soir, heure tout-à-fait indue, et nous ne
pouvions renvoyer nos bons amis, sans leur faire prendre quelques restaurans.
Notre pain, notre petit lait, le beurre, les œufs, le seret, les pommes de
terre destinés pour notre souper, une pièce de vin disparurent en un instant,
et personne ne dut avoir l’estomac chargé.
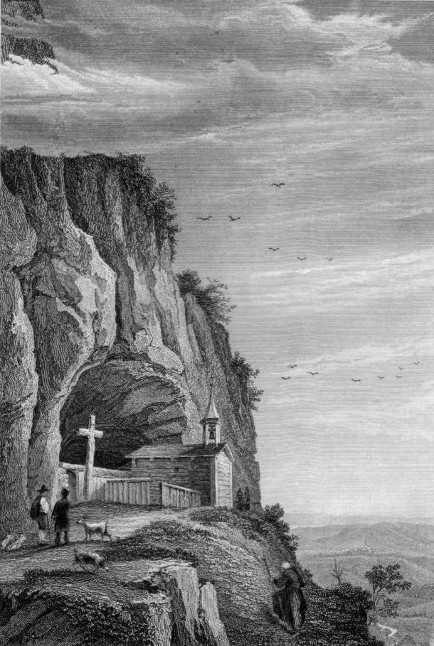
Wildkirchli,
chapelle sur l’Ebenalp, par Winkles, vers 1840
CHAPITRE
XXXVII.
La
petite colonie gravit l’Ebenalp.
Nous
ne rêvâmes que cerisiers, sapins et chamois, nous autres habitans de la plaine.
Bertrand et Abdonn étaient déjà à l’ouvrage, quand nous sortîmes de notre
châlet. Nous les accablâmes de questions, pendant une partie de la journée.
Nous réfléchissions, nous discutions, d’après leurs réponses, et nous brûlions
de voir, par nous-mêmes, la cime de cette montagne, jusqu’alors inviolable.
Mais il fallait que nous pussions entreprendre ce voyage sans danger, et,
pour cela, les degrés devaient être pratiqués. Abdonn décida que quatre ouvriers
seulement pourraient y travailler, et qu’un plus grand nombre ne causerait
que de l’embarras. Toinon et Toinette grillaient de voir notre troupeau de
chamois, et de se promener sous nos sapins. Ils poussaient Abdonn. « Va donc,
va donc vite chercher des ouvriers. »
Il était
inutile de le presser : il sentait qu’il jouerait un grand rôle à Weisbad
et à Appenzell. Aussi il ne rentra que le soir. Il avait été, toute la journée,
entouré de curieux et d’admirateurs, semblables aux courtisans de Ferdinand
et d’Isabelle, qui écoutaient, avec avidité, Christophe-Colomb, revenant
de son premier voyage au Nouveau Monde.
«
Mais, disais-je à André, comment se fait-il que ces chamois, qui n’ont pu
arriver, là-haut, des montagnes voisines, y soient en aussi petit nombre
? — La raison en est bien simple : les espèces ne multiplient que dans la
proportion de la nourriture qu’elles peuvent se procurer. Les petits périssent,
quand les mamelles des mères sont desséchées. »
Abdonn
eût trouvé cent ouvriers, s’il en eût eu besoin. Le lendemain, à la pointe
du jour, les quatre élus se présentèrent, heureux de satisfaire leur curiosité,
en gagnant des journées.
Chaque
explosion de la mine nous annonçait un obstacle de moins à surmonter, et
faisait sauter Toinon et Toinette. Toinette, à laquelle Robin s’était particulièrement
attaché, lui promettait, en le caressant, qu’elle lui amènerait bientôt une
compagne. Robin paraissait sensible à ses caresses ; mais il se tournait
souvent du côté de la montagne, il bondissait, et s’élançait à dix ou douze
pieds de distance : il continuait à essayer ses forces naissantes. En effet,
un matin, jour de douleur et de deuil, il ne se trouva plus. Il paraît que
cet animal a le sang excessivement chaud, et qu’il a besoin de respirer un
air glacial, qui seul peut en tempérer l’ardeur. Peut-être aussi est-il passionné
pour la liberté, et la cherche- t-il loin des hommes.
Ces
pauvres enfans se désolaient ; Toinette répandait des larmes, en appelant
Robin, qui ne pouvait plus l’entendre. Nous leur en promettions un autre.
L’enfance est toujours pressée de jouir. « Mais quand l’aurons-nous, disait
Toinon ? — Oh ! disait Toinette, j’attacherai celui-là avec un ruban, et
il ne m’échappera plus. — Ma fille, c’est peut-être la crainte de l’esclavage
qui a déterminé Robin à fuir. Les animaux, ainsi que l’homme, veulent être
libres. — Mon fils, les animaux que
nous
nous soumettons ont perdu leur instinct naturel ; ce sont des êtres dégénérés.
» Ces raisonnemens des deux papas pouvaient être très-justes ; mais ils intéressaient
peu Toinon et Toinette. Ils cherchèrent un adoucissement à leur chagrin dans
les bras l’un de l’autre, et de nouvelles sensations parurent se développer.
« Ami
André, ces enfans ont douze ans ; ils ont encore leur innocence ; mais ces
caresses-là les conduiront, innocemment, au but vers lequel tend la nature,
et le jour que nous avons fixé est encore loin de nous. — Mon fils est déjà
un grand philosophe. — Oui, ils savent, à peu près tous deux, ce que nous
avons pu leur apprendre ; mais souviens-toi que ta philosophie ne t’a pas
arrêté dans notre petite maison d’Arpajon. — J’étais dans la force de l’âge.
— Si tu étais le père de Toinette, tu verrais les choses tout autrement.
— Hé bien, ami Antoine, quel parti prendrons-nous ? — Gardons- nous bien
de leur faire des remontrances ; ce serait les éclairer. Séparons-les, sans
qu’ils puissent pénétrer nos motifs. — Et comment nous y prendrons-nous ?
— Je dirai à Toinette qu’elle est très-instruite pour son âge ; mais que
cela ne suffit pas ; qu’il faut qu’elle se mette en état de remplacer Marianne
dans la direction du châlet, et que je veux qu’elle s’attache à elle ; que,
dans ses momens de repos, elle apprendra, auprès de Sophitt, à faire ces
ouvrages, si utiles à une femme. — Je dirai à Toinon qu’il est honteux, à
un Suisse de douze ans, de n’avoir pas encore touché une bêche. Je lui proposerai,
pour exemple, les enfans de son âge, qu’il voit travailler tous les jours.
Je lui donnerai des instrumens proportionnés à ses forces, et notre bonne
fortune fera le reste. »
Tout
ce qui est nouveau séduit l’enfance. Toinette, attachée à Marianne, suivit,
très-exactement, toutes les opérations du ménage. Son institutrice variait
ses occupations, et la conduisait, de temps en temps, auprès de Sophitt.
Là, elle prenait une aiguille et des ciseaux, et gâtait de la toile. Elle
se dépitait ; on relevait son courage, en l’assurant qu’elle ferait mieux
une autre fois ; on lui faisait sentir la nécessité de vaincre sa maladresse,
et de ne plus dépendre de personne pour ces sortes d’ouvrages, que toute
femme doit savoir faire.
Ce genre
de travail n’occupe, malheureusement, que les doigts ; il ne captive pas
l’imagination. Celle de Toinette s’exerçait sans interruption, et il est
facile de prévoir de qui elle parlait.
Toinon
partait avec nous, à l’aube du jour. Il marchait fièrement, sa petite bêche
sur l’épaule, et se croyait un personnage. Il faisait aussi mal que Toinette
; mais il travaillait avec courage, et la fatigue repose le cœur. Il déjeunait,
il dînait avec nous, sur le gazon, ou sur une gerbe ; mais il fallait rentrer
le soir.
Toinette
ne manquait pas de venir au-devant de nous. Elle embrassait Toinon ; elle
passait son bras sous le sien, et nous rentrions au châlet, en écoutant leurs
chansons. Ils y mettaient une expression, qui inquiétait les deux papas.
Ils ne savaient à quelle idée s’arrêter.
Une
nouveauté parut fixer ces enfans, pendant quelques jours. Les degrés étaient
terminés, et on ne parla plus que de gravir la montagne. Là, on retrouverait
Robin ; mais il fallait se prémunir contre le froid. André prit son fils
avec lui. Ils allèrent acheter, à Appenzell, des peaux de mouton, beaucoup
de peaux de
mouton,
revêtues de leur laine. Toinette jeta son ouvrage, vers l’heure où elle jugea
qu’ils devaient revenir. Elle courut sur l’esplanade. André et son fils sortaient
de Wiesbad. Le papa avait chargé Toinon, autant que le lui avait permis la
faiblesse de son âge. Toinette descend notre côte avec la légèreté du chamois.
Elle court, elle arrive ; elle essuie la sueur qui ruisselle sur le visage
de son ami. Elle enlève la moitié de son fardeau, et s’en charge elle-même….
Diable! diable!
Il fut
décidé que chacun ferait son costume de montagnard : c’était un nouveau moyen
d’occuper les doigts et la tête de nos enfans. Ils n’avaient aucune idée
de l’ouvrage qu’ils allaient entreprendre, et ils cédèrent à l’attrait de
la nouveauté. Ils travaillèrent avec ardeur ; mais ils étaient de la même
taille, et ils prenaient mesure l’un sur l’autre. Toinette avait reçu quelques
leçons de Sophitt, et elle voulut diriger la grosse aiguille de Toinon. Nous
étions assis en cercle sur la prairie, et on riait beaucoup de la tournure
grotesque que nous aurions sous notre nouveau costume. Mais rien ne m’échappait.
Je fis un signe à Sophitt. Elle fut se placer entre les jeunes gens, sous
le prétexte de les diriger. On ne résiste pas à sa maîtresse : Toinette lui
fit une petite place.
Des
ciseaux, de grosses aiguilles et de la ficelle étaient nos seuls instrumens.
On sent bien qu’un travail aussi grossier ne pouvait nous occuper au-delà
d’une journée. Déjà nous nous enfilions dans nos peaux de mouton, et nous
nous moquions les uns des autres. Toinette prend, avec un cordon, le contour
de la tête de Toinon. Que va-t-elle faire ? Une peau de mouton est taillée,
assemblée, cousue. Toinon a un capuchon qui lui tombe sur les épaules et
la poitrine ; des trous sont percés devant les yeux et la bouche. « André,
m’écriai-je, toi qui as inventé tant
de
belles choses, qui t’ont été inutiles, tu n’as pas trouvé le capuchon. »
Et chacun de nous travaille à s’en faire un, qui nous rend plus plaisans
encore.
Nous
proclamons Toinette l’auteur unique d’une partie de vêtement, inconnue encore
aux bergers des montagnes ; nous la félicitons, et Toinon rend hommage à
son industrie, en l’embrassant tendrement. Toinette était rouge de plaisir.
Diable ! diable !
Le lendemain
fut employé aux préparatifs du grand voyage, que nous allions entreprendre.
Chacun fit son havre-sac avec une peau de mouton : nous ne sortions pas des
peaux de mouton. Nous espérions que cette fourrure empêcherait nos alimens
de geler. Les uns portaient les vivres ; d’autres les instrumens, dont nous
présumions avoir besoin. Nous avions tous un bâton ferré, à la main, lorsque
nous nous mîmes en route. Il est difficile d’imaginer un spectacle plus grotesque
et plus plaisant que celui que nous nous offrions réciproquement. Les femmes,
surtout, étaient à faire mourir de rire. Abdonn marchait en tête de la caravane
: c’était Christophe Colomb, commençant son second voyage, et dirigeant des
troupes que poussait la curiosité, et que tout étonnait.
Toinon
et Toinette se trouvaient toujours sous leur capuchon. Les chemins étaient
praticables ; mais ils rencontraient, à chaque instant, des passages difficiles.
Ils s’en prévalaient, pour se soutenir mutuellement, pour chercher une main,
que leur dérobait la longueur de leurs manches. Ils la devinaient.
La température
était douce encore, et nous fûmes obligés de nous dépouiller de notre épaisse
enveloppe. Nous arrivâmes, découverts, jusqu’aux cerisiers sauvages. Il y
en avait à peu
près
cinquante, et leur fruit était mûr. Il fut décidé qu’on le cueillerait le
lendemain.
Nous étions
engagés dans des montagnes, que nous n’avions vues que de loin, depuis notre
arrivée dans le pays de Genève. Le premier de ces monts nous avait étonnés
par sa prodigieuse élévation. Ceux que nous découvrîmes ensuite
ne nous inspirèrent aucune sensation marquante : nous ne distinguions
que des masses inertes. Ici, nous étions lancés au sein d’une nature morte,
qui nous offrait, à chaque pas, des objets nouveaux pour nous. Les
uns excitaient notre étonnement, notre admiration ; d’autres donnaient
lieu à des digressions conformes au goût dominant d’André. Pendant
que nous raisonnions, Marianne et les enfans enlevaient, aune terre
ingrate, et renfermaient, dans leur havre-sac, des plantes inconnues
dans la plaine, et qui devaient embellir notre parterre.
André
décida qu’elles n’y vivraient pas. « La nature produit partout, nous dit-il,
mais d’une manière analogue au terroir et à la température. » L’événement
justifia sa prédiction. « Voyez, ajouta-t-il, ces masses énormes, renversées,
sans ordre, les unes sur les autres. Il est incontestable qu’elles n’ont
pu naître dans cette position. Observez, sur quelques-unes, des traces incontestables
d’un feu, éteint depuis des milliers de siècles. Ici, sons nos pas, ont existé
des volcans, qui, successivement, ont vomi des montagnes. Réfléchissez aux
immenses cavités que leur absence a produites au sein de la terre, et vous
cesserez de vous étonner du peu d’activité que paraissent avoir aujourd’hui
les feux souterrains : la poudre ne fait explosion que lorsqu’elle est comprimée.
» En raisonnant, ou en déraisonnant, nous nous étions élevés d’environ deux
cents toises. Le froid commença alors à être si piquant, que nous nous hâtâmes
de nous enfermer
dans
nos peaux de mouton. Deux heures après nous étions parvenus sur la cime de
la montagne. Vue de notre habitation, elle paraît se terminer en aiguille
; nous nous trouvâmes sur une plate-forme, qui a au moins cinquante acres
carrés d’étendue.
Notre
premier soin fut de faire du feu. Abdonn avait eu de la peine à en allumer
: nous avions tous profité de son inexpérience. Chacun avait son briquet
et ses allumettes. Nous formâmes trois foyers, que chacun alimenta à son
tour. Nous respectâmes les sapins ; mais nous consumâmes une grande partie
des feuilles mortes et des broussailles, que le temps avait accumulées sur
cette surface. Nous nous assîmes au milieu de ces foyers, et nous tirâmes
nos provisions de leurs étuis.
On est
de bonne humeur, quand on est parvenu au terme d’un long et pénible voyage.
Nous nous félicitions ; nous nous croyions des personnages. Que l’homme est
injuste ! Bertrand et Abdonn avaient bravé, subi tous les dangers, et nous
avaient réservé les jouissances.
Nous
déjeunions gaîment, et chacun plaçait son mot. « Ah, dit Toinon, si le sonneur
de Weisbad est au clocher, il croira la montagne embrasée. — Il sonnera le
tocsin, répondit Toinette, et tous les habitans monteront ici, pour éteindre
l’incendie. — Avec quoi, répliqua Marianne? — Plaisanterie à part, dit André,
ils savent que nous avons ouvert des routes praticables, et ils ne seraient
pas fâchés de trouver un prétexte de faire aussi le grand voyage. — Hé bien,
qu’ils viennent. — Mais qu’ils apportent leur dîner. »
Nous
apprîmes le soir qu’ils en avaient eu la plus grande envie. Mais il fallait
passer sur notre territoire, et tel est, en
Suisse,
le respect porté aux propriétés, qu’ils n’osèrent traverser la nôtre, sans
notre agrément.
Nous
avions repris des forces, et nous avions chaud. Nous nous levâmes, pour parcourir
le pays conquis. Nous trouvâmes le récit d’Abdonn conforme, en tout, à la
vérité, un seul point excepté. Ces chamois, habitués au feu du tonnerre,
et que celui de quatre pistolets n’avait pas fait reculer, fuyaient cependant
à notre approche. Il faut pardonner aux voyageurs de mentir un peu. Nous
leur devons tant, nous qui jouissons, dans nos foyers, de leurs découvertes
lointaines.
On sent
bien que l’aspect des chamois rappela aussitôt le souvenir de Robin. Toinette
l’appela, et il reconnut sa voix. Il vint à elle, et reçut ses caresses.
Toinon se disposa à lui jeter un lacet aux jambes. Les bêtes ne sont pas
si bêtes que l’on pense. Robin se rappela, peut-être, que ce fut par
ce moyen qu’Abdonn lui avait ôté sa liberté. Il se tourna pour fuir; mais
Toinon eut le temps de saisir une jambe de derrière. Robin avait acquis des
forces ; il entraîna le cher enfant. Le brave petit Suisse ne voulut pas
lâcher sa proie. Ses coudes et ses genoux labouraient une terre dure et congelée.
Toinette et Claire jetèrent les hauts cris. Nous courûmes tous. La fatigue
et la douleur avaient forcé Toinon à lâcher prise. Robin s’enfuit dans les
broussailles et ne reparut plus.
Les
peaux de mouton et l’épiderme de Toinon étaient usés aux coudes et aux genoux.
Il souffrait beaucoup, et Toinette souffrait autant que lui. Nous le conduisîmes
au centre de nos foyers, et nous activâmes le feu. Bertrand avait de l’eau-de-vie
dans son havre-sac ; mais nous manquions de linge. Toinette se débarrassa
de ses peaux de mouton, et déchira sa jupe de cotonnade. Nous examinâmes
les écorchures ; elles avaient un
quart
de ligne de profondeur. Toinette fondit en larmes. « Quoi, lui dit Toinon,
la tendre amie d’un Suisse pleure ! Croit-elle qu’il ne sache pas supporter
la douleur ? Je n’ai qu’un regret, ma Toinette, c’est de n’avoir pu te rendre
ton Robin. »
Il ne
pleura pas, mais l’effet de l’eau-de-vie lui contracta la figure de manière
à nous fendre le cœur. Toinette se précipita sur lui, et le couvrit de baisers
et de larmes. Ce ne fut qu’avec des peines infinies que je la rappelai à
la décence, dont elle n’avait aucune idée, parce qu’elle ignorait qu’il existât
des vices.
Nous
pensâmes aux moyens de le transporter à notre domicile. Il déclara, avec
fermeté, qu’il marcherait. Il se leva, et sentit qu’il ne pouvait
faire un pas. Nous décidâmes que chacun des quatre hommes le porterait, à
son tour, assis sur son havre-sac. André arrêta qu’un de nous marcherait
devant le porteur, qui appuierait ses mains sur ses épaules. Claire coupa
le havre-sac de son fils, et en fit des pièces, qu’elle attacha, tant bien
que mal, sur les coudes et les genoux du cher enfant.
André
déclara qu’il porterait son fils le premier : il en avait incontestablement
le droit. Mais il était âgé de soixante ans ; il ne put aller loin. Bertrand
se chargea du précieux fardeau, et le descendit jusqu’aux cerisiers. Abdonn
le reprit et le porta jusqu’à la porte de notre châlet. Toinette avait constamment
marché auprès de lui, quelques instances que j’aie pu lui faire. Si j’avais
employé la force, un saut, à droite ou à gauche, la précipitait dans les
abîmes.
Ainsi
se termina une partie, commencée avec tant d’ardeur et de plaisir. L’homme
est-il sûr qu’une sensation agréable durera un jour, une heure, une minute
?
Je
courus à Weisbad chercher la vieille Thècle, le médecin du lieu. Elle mit
sa petite pharmacie dans son panier, et me suivit. Elle déclara que l’eau-de-vie
est un irritant, et que nous aurions épargné de vives douleurs au blessé,
si nous l’eussions descendu sans le panser. Elle appliqua des calmans sur
ses plaies ; mais elle prononça qu’il garderait le lit pendant quinze jours.
Toinette protesta qu’elle ne le quitterait, ni jour ni nuit. Toinon jura,
par son patron, que si elle s’éloignait de lui, il arracherait ses appareils.
Il était capable de le faire, et son père et moi ne savions à quoi nous déterminer.
Claire nous promit de rester auprès d’eux, jusqu’à ce que nous ayons pris
une résolution invariable. Il lui était égal de filer là ou ailleurs, et
puis elle était mère.
Nous
résolûmes d’éclairer Toinon, de lui confier l’innocence de Toinette, et de
l’en rendre responsable. Hélas ! c’est ainsi, qu’à la Rochelle, j’avais préservé
ma pauvre Colombe d’elle et de moi.
Je proposai
à André d’appeler la Religion à l’appui de la morale. Notre curé était pieux,
sans fanatisme, toujours disposé à obliger ses paroissiens, et ne voulant
que leur estime, pour prix de ses services. Les prêtres se conduiront ainsi
partout où ils seront strictement restreints aux fonctions de leur ministère.
-
Wimen se rendit avec plaisir à notre invitation.
Nous trouvâmes Toinette lisant une histoire touchante à son jeune ami. C’était
celle d’un enfant qui avait fait mourir son père de chagrin. Cette histoire
servit de texte au bon curé. Il parla à nos jeunes gens, avec la simplicité
évangélique, et avec des raisonnemens sans réplique. Mais il fallut qu’il
les instruisît pour leur en faire sentir la force. Quel fut leur étonnement,
lorsqu’ils surent que le sentiment qui les unissait était de
l’amour,
et un amour illégitime, puisque leur tendre jeunesse ne permettait pas qu’on
les unît encore. « Quand donc nous mariera-t-on, demanda Toinette d’un ton
timide ? — Quand vous aurez seize ans, lui répondis-je.
«
Quatre ans encore à attendre, reprit Toinon ! Et si vous vous permettez,
répliqua le curé, la moindre faute, du genre de celles que je vous ai laissé
pressentir, vous ferez mourir vos parens, comme ce méchant Antoni a fait
mourir son père. »
Les
yeux de ces pauvres enfans se remplirent de larmes. Toinette retira lentement
sa main de celle de Toinon. Elle me regarda d’un air suppliant. « Nous est-il
défendu de nous aimer ? — Non, ma fille. — De nous le dire ? — Non pas
absolument ; mais les longs entretiens, et toute espèce de caresses vous
sont sévèrement interdits. — Il faudra donc souffrir, et souffrir en silence.
— Toinette, un Suisse doit son
sang
à sa patrie ; mais ses devoirs ne s’étendent-ils pas plus loin ? Ne doit-il
pas le sacrifices9 à son père
? Tu n’aimes pas plus que moi, et je suis résigné. Seras-tu moins forte que
ton ami ? »
Quel
homme nous promet ce jeune garçon ! Nous l’embrassâmes, André et moi, avec
une extrême tendresse. Toinette se présenta, les yeux baissés, et nous lui
donnâmes le baiser de paix. Elle s’éloigna, en essuyant ses yeux, et alla
rejoindre Sophitt.
Gott
vint nous dire que le dîner était prêt. Nous engageâmes le bon pasteur à
le partager avec nous. Les enfans ne mangeaient pas. À la vérité, la pièce
fondamentale était un quartier de ce

9 Le texte
est ici visiblement corrompu (B.G.)
malheureux
cochon, qui nous inspira un dégoût insurmontable. Toinon et Toinette n’eussent
pas touché au meilleur de nos chevreaux rôti. Le curé leur parla raison.
Il leur cita plusieurs jeunes gens du village, qui éprouvent l’amour le plus
tendre, et qui attendent le moment heureux, sans renoncer au travail, et
sans perdre l’appétit. Nous présentâmes à nos enfans ce que nous avions de
mieux, et ils se rendirent à nos prières. Ils continueront de s’aimer ;
mais ils sont bons, honnêtes, et, ils éviteront les occasions de nous faire
de la peine.
Le
lendemain matin, les quatre ouvriers, qui nous avaient aplani le chemin
de la montagne, parurent la hotte sur le dos, et disposés à aller cueillir
nos cerises. Bertrand et Abdonn partirent avec eux.
Nous
observions nos enfans. Toinon s’ennuyait : nous devions nous y attendre.
Toinette ne quittait pas Sophitt, et elle était, avec elle en conversation
réglée. Nous sûmes, dans le courant de la journée, que la bonne jeune femme
lui avait conté qu’Abdonn et elle s’étaient aimés trois ans, avant que de
se marier, quoiqu’ils fussent d’âge à l’être, et qu’ils ne le seraient pas
encore, si nous ne leur avions procuré les moyens de vivre dans l’aisance.
Petite cause, grands effets : le bonheur de ces jeunes gens était le prix
d’une contre-danse, sacrifiée à Marianne. Nous avions fait une bonne action,
et jusqu’alors nous ne nous en étions pas doutés.
La
journée s’écoulait, et nos montagnards ne paraissaient pas. Les ouvriers
avaient voulu voir cette montagne, dont ils nous avaient ouvert l’accès,
et ce désir était bien naturel. Ils arrivèrent à la chute du jour, après
avoir été au moment de périr de froid ; mais ils avaient une longue histoire
à faire à leurs femmes et à leurs enfans. Cela fait passer une soirée.
Ils
étaient chargés, ainsi que Bertrand et Abdonn, de notre récolte de cerises.
C’est une belle chose que la prévoyance, si belle qu’on ne peut assez l’estimer.
« Voilà des cerises, dis-je à Bertrand, c’est fort bien ; mais comment feras-tu
ton kirswaser ? » Nous n’avons pas d’alambic, et tous les ouvriers du canton
réunis sont incapables de nous en faire un : ils n’en ont jamais vu. — Diable,
diable, dit Bertrand, en se grattant l’oreille. — Diable, diable, tant que
tu voudras ; ce n’est pas répondre. Que ferons-nous de nos cerises ? Du vin,
disait l’un.
—
Oui, il sera bon à laver les pieds de nos mules. Des confitures, dit Marianne
; nous avons du miel. — Et le miel de tout le canton d’Appenzell n’y suffirait
pas.
« Pauvres
gens que vous êtes, s’écria André ! Vous n’aurez donc jamais d’imagination
! Quand on n’a pas d’alambic, on s’en procure un, deux, trois. Demain Bertrand
fera cuver ses cerises, et Antoine, ou moi, se mettra en route pour Saint-Gall,
ou la Souabe. — Tu sais bien, André qu’il n’y a pas d’industrie dans les
pays gouvernés par les prêtres ; chacun y aspire à l’être, et c’est tout
simple : il vaut mieux être oppresseur qu’opprimé. Les liqueurs abondent
à Saint-Gall ; mais elles arrivent toutes faites dans les offices de l’abbé
et de ses chanoines. La manne pleut chez ces messieurs-là, et ceux qui ne
peuvent apprendre un peu de latin boivent de l’eau. — Ce que vous dites là,
ami Antoine, est très-vrai ; mais auriez-vous fait ces remarques-là le jour
où vous traversâtes, à genoux, le champ de bataille de Montcontour ? — Mon
cher André, d’épais nuages nous cachent quelquefois le soleil ; il perce,
tôt ou tard, et ceux qui croient mettre la lampe sous le boisseau, ne sont
que des imbéciles.
«
J’irai demain en Souabe, et je prendrai ma Toinette avec moi. On est forcément
distrait par l’aspect d’objets nouveaux. Ce petit voyage lui sera bon. »
Je
le répète : nous savons toujours ce que nous voulons faire, et jamais ce
que nous ferons. Nous fûmes mandés, André et moi, devant le grand conseil,
qui s’assemblait le lendemain. Hé bien, les cerises cuveront, et nous nous
présenterons devant nos juges, avec la fermeté de gens qui n’ont rien à se
reprocher.
«
Le grand conseil, nous dit le landamman, vous a concédé le terrain que vous
avez mis en valeur, et non la montagne à laquelle il est adossé. Cependant,
vous en avez pris possession, et vous savez qu’elle ne vous appartient pas.
Qu’avez-vous à dire pour votre justification ? » L’argument était serré,
et nous ne l’avions pas prévu.
On
n’a pas oublié que c’est toujours moi qui suis l’avocat, dans les grandes
occasions. Je n’étais pas préparé à l’attaque, et il fallut improviser la
défense.
«
M. le landamman nous donne à entendre que la partie de l’Ebenalp, à laquelle
touchent nos champs, est un bien communal, dépendant du village de Weisbad.
Je lui demande ce que c’est qu’un bien communal qui est inaccessible, et
celui-ci le serait encore, sans les travaux que nous avons fait faire. Nous
avons donc pu croire que ce mont, qui n’était utile à personne, pouvait être
exploité par ceux qui l’ont conquis sur la nature.
«
Si nous renonçons aux faibles produits de cette conquête, qui se réduiraient
à rien, partagés entre les habitans de notre village, il faudra, pour les
recueillir, qu’ils traversent nos terres en culture : ce n’est que par-là
qu’ils peuvent parvenir au seul
chemin
praticable qui existe. Il faudra qu’ils foulent aux pieds nos semences, et
détruisent nos espérances de récolte. Or, les propriétés sont sacrées en
Suisse, et nous protestons d’avance contre quiconque oserait violer la nôtre.
»
Voilà
une cause, où il s’agit de la possession d’une branche des Alpes, développée
et plaidée en bien peu de mots. C’est qu’il n’y a, en Suisse, ni avocats
ni procureurs.
Le
landamman nous annonça que nos juges allaient délibérer, et il nous intima
l’ordre de nous retirer. Nous délibérâmes aussi, André et moi, sur ce que
nous ferions, si on nous donnait gain de cause, ce qui nous paraissait assez
vraisemblable.
On
nous rappela avant qu’un quart d’heure fût écoulé, et le landamman prononça
au nom du conseil-général.
«
Le conseil vous laisse les produits de la montagne ; mais à titre d’usufruit,
et sans que vous puissiez jamais prétendre au droit de propriété. »
Voilà
un procès d’une haute importance terminé en moins d’une heure. C’est que
les juges, en Suisse, n’ont pas le temps de dormir à l’audience.
Je
repris la parole, d’après les conventions arrêtées entre moi et André.
«
Pour prouver à nos compatriotes que nous n’avons été mus que par l’esprit
de justice, dont un bon Suisse ne s’écarte jamais, et non par cette cupidité,
qui dégrade l’homme dans les pays qu’on nomme civilisés, nous nous engageons,
ainsi qu’il suit, pour nous et nos enfans :
«
À chaque mariage, qui se fera dans l’arrondissement de Weisbad, nous fournirons,
pour le repas de noces, un chamois, une cruche d’hydromel, et deux bouteilles
de kirswaser.
«
Le nouvel époux pourra couper, sur la montagne, un sapin, qui l’aidera dans
les constructions qu’il croira devoir ajouter à son châlet. Cette concession
est faite sous la condition expresse que le sapin sera coupé au pied, et
non déraciné, afin que le fils, qui naîtra de ce mariage, en retrouve un,
vingt ans après. Ainsi chaque famille aura, là-haut, sa petite propriété,
qu’elle marquera de son nom.
«
M. le landamman, nous vous prions de faire inscrire notre soumission sur
le registre du grand conseil, et nous la signerons. »
Cette
dernière formalité remplie, le landamman leva l’audience. Le respect avait
contenu l’auditoire : ce fut alors à qui nous marquerait le plus d’estime
et d’affection. On nous prenait les mains, on nous embrassait ; on nous proclamait
dignes des premiers beaux jours de la Suisse ; enfin on nous reconduisit
chez nous en triomphe.

Jean-Frédéric
de Wurtemberg (duc de 1608 à 1628)
CHAPITRE
XXXVIII.
Les
alambics. Nouvelles de France.
Tout
s’use. Trois de nos chariots avaient passé, en détail, sous la chaudière
de Gott. Grâce à l’ami Bleker, le quatrième était en bon état. Nos mulets
avaient perdu leurs forces, et avaient terminé, à l’écurie, leur laborieuse
carrière : ils avaient acquis les droits les plus constans à une honorable
retraite. Nous en avions acheté un neuf. Il suffisait à nos petits voyages.
Toinette
n’avait conservé qu’une idée très-confuse de la France. Elle ne connaissait
bien que Weisbad et Appenzell. Je lui proposai de m’accompagner. Ses yeux
se tournèrent d’abord vers la chambre, où reposait son ami. Je piquai sa
curiosité, en lui disant quelque chose des objets nouveaux qui s’offriraient
à ses regards. Elle me sourit, et me demanda la permission de faire ses adieux
à Toinon. Je la conduisis auprès de son lit. Leurs yeux parlèrent ; mais
leurs expressions furent dictées par la plus rigoureuse réserve, et c’était
beaucoup. Nous partîmes.
Nous
traversâmes le canton d’Appenzell, et le lac de Constance, avant le coucher
du soleil. Il paraît que les auberges se multiplient partout. Nous en trouvâmes
une très-passable, à Buchhorn, et là, Toinette commença à s’étonner, et à
me faire des questions. Bon, me dis-je, son cœur se repose. Elle ne concevait
pas que notre hôte, au lieu de nous prendre la main,
nous
saluât jusqu’à terre ; que notre hôtesse lui fît de profondes révérences,
à elle petite fille de douze ans ; qu’ils nous demandassent nos ordres, comme
s’ils n’étaient pas chez eux. Je lui répondais que, dans les pays de servitude,
la cupidité remplace les sentimens élevés qu’inspire la liberté ; que l’habitude
de prodiguer des marques de respect à ses supérieurs, s’étend naturellement
jusqu’à ceux qui apportent de l’argent, et que l’appât du gain dédommage
de l’humilité. Elle ne concevait pas davantage qu’il fallût payer notre souper
et nos lits. « En Suisse, ajouta-t-elle, un étranger se présente à la porte
d’un châlet ; on va au-devant de lui ; on ne le salue pas ; mais on lui sourit
avec bienveillance ; on le fait entrer, et on lui présente ce qu’on a de
meilleur. Son souper n’est pas recherché, comme celui qu’on va nous servir.
La botte de paille fraîche, sur laquelle il dort d’un bon somme, n’est pas
comparable à ces beaux lits à quatre colonnes et à grands rideaux ; mais
le lendemain matin, il embrasse ses hôtes, et les voilà payés. Le voyageur
trouve en Suisse de la cordialité, et jamais de respect. Pourquoi cela ?
— C’est que les Suisses ne respectent que la vertu et les lois. »
Ce
fut bien autre chose, quand nous approchâmes de Stutgard.
«
Qu’est-ce que cela, mon père ? — C’est une ville, mon enfant. — C’est une
immense prison. Vois cette double enceinte de murailles ; ces terrasses,
ces ponts suspendus à des chaînes de fer, que peut-être on lève tous les
soirs. C’est une prison, c’est une prison. — C’est la capitale du comte de
Wirtemberg, qui vint à Appenzell, il y a quelques années, et qui fut si petit
devant notre landamman. »
Je
lui expliquai ce que c’est qu’une place forte, et dans quelles vues on fortifie
les villes frontières. « Mais pourquoi n’y a-t-il
pas
de forteresses dans le canton d’Appenzell, qui touche à la Souabe ? » Je
lui fis connaître les moyens de défense que la nature a prodigués aux Suisses.
Elle
frémit, en passant sous les voûtes, dont l’écho répétait le bruit de nos
roues. « Mon père, s’écria-t-elle, vous me menez en prison ! N’avez-vous
pas de moyens plus doux de me séparer de Toinon ? » Je l’embrassai tendrement
; je la rassurai, et je lui promis solennellement qu’ils seraient unis, quand
ils auraient atteint leur seizième année. Elle m’embrassa à son tour.
Quand
nous eûmes fait choix d’une auberge, je la promenai par la ville. Le premier
objet qui se présenta à nous, fut le comte de Wirtemberg, parcourant les
rues à cheval, suivi de sa petite cour. Ils étaient magnifiquement vêtus,
et paraissaient très-contens d’eux. Ceux devant qui ils passaient les saluaient
profondément. » Ce luxe, ces décorations, dis-je à Toinette, éblouissent
le peuple. L’observateur éclairé trouve l’homme sous cette enveloppe fastueuse,
et souvent il le voit très petit. »
La
simplicité et la forme de notre costume contrastaient, d’une manière frappante,
avec les vêtemens de la plupart des habitans de la ville. Le comte, en passant
devant nous, nous fixa d’un air dédaigneux. Toinette en fut blessée. « Celui
qui n’a que des serfs, lui dis-je, est incapable d’apprécier un homme libre.
»
L’habillement
des femmes suisses a quelque chose de gracieux et de piquant, qui se fait
remarquer, partout où il n’est pas connu. Un chapeau de paille jaune, dont
les grands bords, jouant au gré du zéphyr, cachent et découvrent, alternativement,
une figure quelquefois séduisante ; de longues tresses, garnies de rubans,
et qui tombent souvent jusqu’au gras-de-jambe ; un corset d’une nuance
vive, serré par un lacet de couleur
tranchante
; un jupon court, qui laisse voir un bas blanc, à coins rouges, telle était
la mise de ma Toinette. On s’arrêtait, on la regardait, on lui adressait
des choses flatteuses, qu’elle méritait sans doute. Elle paraissait jouir
d’un triomphe tout nouveau pour elle.
«
Ma fille, lui dis-je assez haut pour être entendu des admirateurs, l’homme,
qui loue, sans retenue, une femme sur sa beauté, doit lui faire pressentir
qu’il ne lui suppose pas d’autre mérite ; elle doit le juger, lui-même, assez
superficiel pour croire qu’il se contente de celui-là. Hé, qu’est-ce que
la beauté ? un don du hasard, qui se développe avec l’âge, et qui disparaît
avec la jeunesse. Que reste-t-il alors à celle qui n’avait que cela ? Le
regret de n’avoir pas cultivé sa raison, développé son jugement, et acquis
des qualités estimables, qui survivent à tout. »
Je
venais de lui administrer un contre-poison, dont elle m’avait paru avoir
besoin. Il produisit son effet sur mon auditoire. Ces Messieurs, un peu confus,
se retirèrent, et nous poursuivîmes notre route. Nous nous arrêtâmes devant
une boutique, qui nous offrait ce que nous désirions. Nous achetâmes deux
alambics, que nous fîmes porter à notre auberge.
Nous
y retournions. « Qu’est-ce donc, mon père, que ces gens, des deux sexes,
qui marchent lentement par les rues, sans paraître avoir d’objet déterminé
? — Ce sont des personnes riches, qui n’ont rien à faire. — Rien à faire
? Oh, qu’ils doivent être malheureux ! — Ils sont loin de le croire. — Comment
donc remplissent-ils » leurs journées ? — Ils jouent, ils se promènent, ils
bâillent, ils dansent, ils s’amusent. — Mais, mon père, ne s’ennuie-t-on
pas de s’amuser toujours ? »
Nous
allions continuer notre conversation, lorsque l’écuyer du comte, celui qui
était venu avec lui à Appenzell, me reconnut et nous aborda. Je pensai que
la mouche du Wirtemberg pouvait savoir quelque chose de ce qui se passait
en France. J’essayai de le faire parler : cela n’était pas difficile. Il
voulut aussi avoir des nouvelles de la Suisse. Il nous pressa de lui faire
l’honneur de l’accompagner chez lui. Il nous présenta une très-belle
collation, que nous eûmes l’honneur d’accepter. « Oserai-je vous
demander... — Osez tout ce qu’il vous plaira. — Ce que vous êtes venus
faire à Stutgard. — Nous y sommes venus acheter des alambics. — Faire vingt
lieues pour acheter des alambics ! Ah, c’est le prétexte. — La manière, dont
le landamman d’Appenzell a parlé à M. le comte, a dû vous convaincre que
les Suisses n’ont jamais recours aux 33 prétextes, parce qu’ils n’en ont
pas besoin. Les despotes sont souvent réduits à finasser. Les hommes
libres vont droit au fait. Nous sommes venus ici, pour acheter des alambics,
parce que nous en avons besoin.
«
Je suis d’origine française, et je pense souvent à ma première patrie. Vous
avez entretenu longuement mon ami André de l’état où se trouvait alors la
France, et vous en êtes resté à l’expulsion des jésuites. Vous me ferez plaisir
si vous voulez reprendre votre narration, de cette époque, et la continuer
jusqu’au moment actuel. — Je suis très-flatté de pouvoir faire quelque
chose qui vous soit agréable. »
Il
n’est plus ce bon roi, mélange étonnant de valeur et de clémence, de franchise,
de gaîté et de talens administratifs. Henri IV est mort ! — Il est tombé
sous les coups d’un assassin.
— Quel
malheur pour la France ! — Henri commit des fautes graves ; mais sa mémoire
est précieuse au peuple, qu’il rendait
heureux,
et qui est étranger aux intrigues de cour. N’anticipons pas sur les événemens.
»
Après
l’exécution de Jean Châtel, la Sorbonne changea tout à coup de langage. Ce
corps, mutin, avide, et sourdement ambitieux, avait proscrit Henri IV, quand
il comptait sur la puissance et la haute protection de la Ligue et de l’Espagne.
Il voyait Henri rassembler, rapidement, les provinces du royaume sous son
obéissance. Il condamna la doctrine des jésuites, et il enjoignit à tous
les moines de reconnaître Henri IV.
Les
grands seigneurs affectaient, pour ce prince, un attachement, qui n’était
que simulé, dans le plus grand nombre. Ils avaient, disaient-ils, contracté
des dettes, perdant les troubles, et le roi fut obligé de traiter avec eux.
Une partie des impôts passa dans leurs mains avides. Cependant, on doit à
la justice de déclarer, qu’après avoir fait ce qu’ils appelaient leur accommodement,
ils servirent le Roi avec une fidélité à toute épreuve.
Mayenne
n’avait pas fait le sien. Il fallait cependant qu’il s’arrangeât avec lui,
ou qu’il se jetât dans les bras des Espagnols, à qui Henri avait déclaré
la guerre. Agissant presque toujours au hasard, il se décida pour le second
parti. Il ne prévit pas que Philippe ne pouvait accorder sa confiance à celui
qui avait fait pendre les principaux membres du comité des Seize, qui intriguait
ouvertement pour l’Espagne. Cependant il se servit de Mayenne, comme d’un
instrument propre à perpétuer les troubles.
Le
Duc était maître encore des plus fortes places de la Bourgogne. Une armée
espagnole avait franchi les Pyrénées, et était entrée dans la Franche-Comté.
Mayenne la joignit avec ce
qu’il
put rassembler de troupes. Henri s’avança à grandes journées contre ses ennemis.
Il les joignit sur les frontières de la Franche-Comté, entre Dijon et Gray,
dans la plaine de Fontaine-Française. Il y fit des prodiges de valeur et
de talens militaires. Dix-huit cents cavaliers seulement avaient pu le suivre,
et, avec cette poignée de soldats, il battit douze mille Espagnols, ou Bourguignons.
Il entra en Franche-Comté, ravagea le pays, et leva de fortes contributions
à Besançon.
Ce
dernier revers accabla Mayenne. Pour comble de malheur, le général espagnol
lui refusa des troupes, dont il avait besoin pour défendre la Bourgogne,
et il fit son accommodement avec le roi. Henri ne le craignait pas
personnellement ; mais le pape refusait d’absoudre ce grand homme, et Mayenne
pouvait être dangereux encore, par l’influence qu’il conservait sur le clergé
et les débris de la ligue.
Cependant
les cardinaux fatiguaient Clément VIII de leurs représentations. Ils lui
rappelaient que Clément VII avait perdu l’Angleterre, et ils lui déclarèrent
qu’il pouvait perdre la France. Le pontife se rendit enfin ; mais à des conditions
infamantes pour le roi. Il lui traça un règlement de conduite, de prières,
déjeunes, dignes tout au plus d’un moine. Il exigea enfin, que ce prince
se soumît à une pénitence publique. Henri voulait rétablir la paix en France,
et il accepta toutes ces conditions.
Du
Perron et d’Ossat, ses ambassadeurs à Rome, ses représentans, firent amende
honorable, en son nom. Ils se couchèrent ensuite sur le ventre, et on
les frappa de verges, pendant, la durée d’un miserere, psaume très-long,
qui fut chanté par les choristes du pape. Un des plus grands rois, qu’ait
eu la France, fouetté à la porte de l’église de St.-Pierre ! Quel
avilissement
pour le trône et la nation ! Quel triomphe pour un prêtre !
Apres
la réconciliation de Henri avec l’Eglise, il ne restait aux catholiques aucun
prétexte de le méconnaître. Il lui suffît d’un ordre pour lever des armées,
et combattre Philippe. Une forte masse d’Espagnols, sortis des Pays-Bas,
sous les ordres de l’archiduc Albert, gouverneur de ces provinces, obtint
d’abord des succès marquans eu Picardie. Le roi fit face à tous ses ennemis,
et conquit la Provence, où dominait le duc d’Epernon. La soumission de cette
province entraîna celle du duc.
Henri
reprit bientôt les places que les Espagnols lui avaient enlevées, et le sang
continua à couler sans résultats. L’orgueilleux Clément, qui se complaisait
à humilier les rois, daigna se souvenir qu’il était le premier ministre d’un
Dieu de paix. Il interposa sa médiation entre les puissances belligérantes,
et la paix fut signée à Vervins. Philippe II mourut, peu de temps après.
Tous les princes de la maison de Lorraine se soumirent alors, et Henri IV
s’affermit sur le trône. Il eut le mérite de démêler les rares qualités de
Sully, et il lui donna toute sa confiance. Henri IV fut, sans doute, un grand
roi ; mais il lui fallait un ministre comme le sien. Sa vivacité avait besoin
d’être contenue, surtout à l’égard des femmes.
Les
réformés avaient de fortes raisons de compter sur la protection, et même
sur les bienfaits du Roi. Il jouissait de l’autorité absolue, et il n’avait
encore rien fait d’important pour eux. Ils murmurèrent hautement. Henri,
élevé avec eux, avait long-temps combattu à leur tête. Il les aimait sincèrement.
Cependant il fallait concilier leurs intérêts avec ceux de la religion catholique,
et cela n’était pas facile.
Henri
publia cette ordonnance, connue sous le nom d’édit de Nantes. Elle
exige que les réformés rendent aux catholiques les églises qu’ils leur avaient
enlevées ; mais elle accorde aux protestants l’exercice public de leur culte,
Paris excepté.
Le
clergé et les moines affectaient encore de douter de la sincérité de la conversion
du roi. Ils crurent voir, dans l’édit de Nantes, des marques de son attachement
à ses premières erreurs. Ils tremblèrent que l’influence, dont allaient jouir
les calvinistes, portât atteinte à leurs privilèges, et surtout à leurs biens.
Ils n’osèrent s’attaquer directement au roi ; mais ils produisirent une prétendue
possédée, qui criait, dans les rues de Paris, que hors de la religion catholique,
il n’y a pas de salut. Il put paraître un peu extraordinaire que l’émissaire
du diable entreprît de ramener les protestans dans la voie du salut.
Catherine,
sœur de Henri, n’avait pas abjuré encore le culte réformé ; elle tenait,
à Paris, un prêche public dans son palais, ce qui était expressément défendu
par l’édit de Nantes. Trente ou quarante dévotes, ameutées par leurs confesseurs,
parcoururent tous les quartiers de la capitale, armées de crucifix et de
chapelets. Elles s’arrêtaient aux portes des églises ; elles y assemblaient
les passans, et elles prêchaient. Elles finirent par aller demander justice,
au président du Harlay, de l’attentat de la princesse Catherine. « Je vous
la rendrai, Mesdames. Vos maris seront assignés devant la cour, et il leur
sera enjoint de vous faire enfermer. » Les dévotes rentrèrent chez elles.
Mais
la possédée continua son vacarme. Duval, docteur de Sorbonne, accrédita cette
extravagance dans Paris. Les capucins promenèrent la possédée de diocèse
en diocèse. Le parlement instruisit contre eux. Ils répondirent à l’assignation,
qui leur fut délivrée, que la bulle in cœnâ Domini, publiée par Pie
V, leur
défendait
d’obéir aux juges séculiers. Le parlement fit brûler cette réponse, condamna
la bulle, et défendit aux capucins de prêcher. Quelques années auparavant,
cette interdiction eût attiré, sur Henri IV, les foudres de l’Eglise. Mais
Philippe II ne gouvernait plus la cour de Rome, et le pape commençait à redouter
le roi de France. Le temps est le maître du monde.
Ce
fut alors que mourut cette fameuse Gabrielle d’Estrées, maîtresse en titre,
et qui avait eu assez de crédit sur l’esprit du roi pour lui faire légitimer
le duc de Vendôme, son fils. Ce prince la regretta vivement, malgré ses fréquentes
infidélités. Il tomba bientôt sous l’empire d’Henriette d’Entragues, femme
artificieuse et méchante, qui troubla le repos du reste de sa vie. Il eut
la faiblesse de lui faire une promesse de mariage, et Sully, le courage de
la déchirer.
Ce
ministre citoyen, détermina Henri à faire casser son mariage avec Marguerite
de Valois. Dès long-temps, ces époux se livraient à des désordres scandaleux.
Ils s’étaient quittés, repris, pour se quitter encore. Excédés, l’un de l’autre,
tous deux consentirent à demander un divorce, qui déjà existait par le fait.
Le pape déclara leur mariage illégalement contracté. C’était porter
loin la condescendance. Il permit aux parties de se remarier à leur gré.
Le
bien de l’État voulait que Henri eût un héritier. Son ministre et son ami
le détermina à épouser Marie de Médicis, fille de François, grand-duc de
Toscane. Cette princesse avait de la beauté et un bon cœur. Elle fut constamment
malheureuse, par les tracasseries que lui suscita Henriette d’Entragues,
devenue marquise de Verneuil.
Après
la naissance du dauphin, aujourd’hui Louis XIII, le nouveau maréchal de Biron
fut envoyé à Bruxelles. Là il ourdit, avec la cour de Madrid, ces trames
funestes, qui lui coûtèrent la vie, ainsi que nous l’avons rapporté plus
haut. Henri IV n’avait pas oublié ses services et ceux de son père. Il voulut
lui pardonner. Le coupable n’avait qu’un mot à dire. Il nia, avec opiniâtreté,
en présence de ce prince, un complot dont le roi avait la preuve écrite.
« Adieu, baron de Biron, lui dit Henri indigné. » Ces derniers mots furent
l’arrêt de sa mort.
La
perfide marquise de Verneuil, et son ambitieuse famille, étaient entrées
dans la conspiration. Le roi les fit arrêter, et le parlement instruisit
leur procès. Ils furent condamnés au dernier supplice. Tel était le déplorable
ascendant des femmes sur Henri IV, que ce prince, qui avait laissé aller
le cours de la justice, à l’égard du maréchal de Biron, eut la faiblesse
de faire grâce aux d’Entragues.
Les
papes n’ont jamais consenti volontairement à rien perdre de leur autorité.
Clément regrettait les jésuites, que leurs statuts placent, immédiatement
et exclusivement, sous l’obéissance des souverains pontifes. Il n’est,
par conséquent, pas de milice religieuse plus dangereuse pour les rois.
Clément
ne cessait d’intriguer, à la cour de France, pour obtenir le rappel des jésuites.
Ses légats représentaient que c’était à sa médiation que la France devait
la paix avec elle- même et avec, ses voisins, et cela était vrai. Il avait
accordé des dispenses pour le mariage de la princesse Catherine, protestante,
avec le duc de Bar, catholique, et Henri IV ne fut jamais ingrat.
Cependant
il craignait les moines. Il n’avait pas oublié qu’ils avaient poussé Pierre
Barière, le chartreux Ouin, les dominicains Arger et Ridicovi, enfin Jean
Châtel à attenter à sa vie. Les jésuites avaient été particulièrement les
instigateurs de Jean Châtel, et le roi les jugeait redoutables à Rome comme
à Paris. Il se flatta qu’un acte de générosité pourrait les attacher à sa
personne, et il se décida à les rappeler.
Sully
s’opposa fortement à ce dessein. Il rappela au roi les crimes dont cette
société s’était chargée, depuis l’an 1545 jusqu’en 1593. Henri ferma la bouche
de son ministre par ces paroles mémorables : J’aime mieux m’abandonner
une fois à eux, que d’avoir toujours à les craindre. Ils furent rappelés.
Sully
faisait prospérer le royaume. Les finances étaient dans un état brillant
; le poids des impôts devenait plus léger, d’année en année ; de nouvelles
branches de commerce s’ouvraient à l’industrie ; l’abondance commençait à
régner dans toutes les classes. Le peuple bénissait le roi et son ministre.
Les
maîtresses et les courtisans, toujours avides, étaient toujours repoussés
par Sully. Ils le haïrent, et résolurent de le perdre dans l’esprit du roi.
Le jésuite Coton, confesseur de Henri, entra dans cette espèce de conjuration.
Il calomnia Sully ; il affirma l’existence de lettres écrites par ce ministre
à différentes corporations, à qui il défendait d’obéir aux ordres du roi.
Ce prince était trop juste pour agir d’après des assertions vagues. Il somma
Coton de produire ces lettres. Elles n’avaient jamais été écrites. Henri
ordonna à son confesseur de faire des excuses à Sully, et l’orgueil jésuitique
fut contraint de s’humilier.
Cependant
les intrigues de ces misérables avaient élevé des nuages dans l’esprit du
roi. Sully se vengea de la froideur qu’il lui marquait, en continuant à remplir
rigoureusement ses devoirs. Il accabla ses détracteurs, en publiant la conception
la plus vaste et la plus utile qu’il ait formée pendant son ministère. Il
ne s’agissait de rien moins que d’ouvrir un canal, qui joindrait la mer Méditerranée
à l’Océan, travail immense, que la mort prématurée du roi l’empêcha seule
d’exécuter.
Henri
IV était aimant, et il ne se dissimulait pas ce qu’il devait à son ministre.
L’état de contrainte, dans lequel ils vivaient ensemble, lui parut enfin
insupportable. Il eut, avec lui, une explication loyale, franche, entière,
et la justification de Sully fut complète. Le roi l’embrassa avec une tendresse,
qu’il avait trop long-temps comprimée. Le ministre fit un mouvement pour
se jeter à ses pieds. Ne faites pas cela. Ceux qui sont là-bas croiront
que vous me demandez grâce. Il lui prit la main, le conduisit au milieu
de ses courtisans, et leur dit : Messieurs, j’aime Rosny plus que jamais,
et, entre lui et moi, c’est à la mort et à la vie.
À
cette époque, Henriette Charlotte de Montmorenci, fille du connétable, fut
présentée à la cour par Madame de Montpensier, sa tante. Brillante de jeunesse
et de beauté, elle fixa tous les regards, tous les hommages, et elle inspira
au roi cet amour effréné, qui empoisonna le reste de sa vie.
Différens
partis se présentèrent, et le connétable donna la préférence à Condé,
premier prince du sang. Il était difficile que le prince ne remarquât pas
les empressemens du roi, et il hésitait à se marier. Henri le manda, et lui
dit : Vous pouvez l’épouser, sans aucun soupçon sur mon compte. Croyons,
pour la gloire du monarque, qu’il était de bonne foi, quand il
prononça
ces paroles. S’il eût voulu tendre un piège au prince de Condé, il eût cessé
d’être homme d’honneur. Le mariage se fit.
De
ce moment, les assiduités, les obsessions, les imprudences mêmes alarmèrent
avec raison le jeune époux. Le roi crut lui fermer les yeux en le comblant
de distinctions et de présens. Condé s’enfuit la nuit, avec son épouse, et
alla chercher un asile dans les Pays-Bas.
Le
roi fit dire à l’archiduc qu’il entrerait en Flandre, avec une armée, s’il
ne lui livrait le prince et la princesse de Condé. L’archiduc ne fut pas
effrayé de menaces, dont l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre eussent nécessairement
empêché l’exécution. Il garda les époux à sa cour, et Henri essaya, sans
succès, d’y faire enlever la princesse.
Ce
prince, égaré par une passion insurmontable, résolut d’embraser l’Europe
pour la satisfaire. Il avait des millions en réserve à la Bastille. Il les
employa à lever l’armée la plus formidable qu’il ait eue encore. S’il eût
vécu plus long-temps, il se fût déshonoré.
Condé,
en proie aux plus vives alarmes, s’enfuit en Italie, avec sa femme.
Il
est à remarquer que les affaires administratives ne souffrirent pas un instant
des égaremens du roi, et que le bien- être du peuple fut, sans cesse, l’objet
de sa tendre sollicitude.
Le
cœur de la reine était blessé des infidélités scandaleuses de son époux.
Elle se plaignit hautement, et elle en avait le droit. Mais ses plaintes
encouragèrent les mécontens à éclater. Des
prédicateurs
factieux, notamment un père Gontieri, osèrent tourner le roi en ridicule,
du haut de la chaire de vérité. Ils plaisantaient sur des amours, qui convenaient
si peu à son âge. Ils affectaient de plaindre le triste sort de la reine,
si digne de l’amour que son époux prostituait à des femmes perdues. Henri
voulait quelquefois punir ces insolens, et bientôt il revenait à sa bonté
naturelle. « Hélas, dit-il à Sully, avec l’accent de la tristesse, quand
je n’y serai plus, on verra ce que je vaux. » Ces paroles furent prophétiques.
Marie
était mariée depuis neuf ans, et n’avait pas été couronnée. Cette cérémonie
avait été commune à toutes les reines de France. Elle crut que le roi ne
la différait que par mépris pour elle. Elle ne lui laissa de repos que lorsqu’il
eut consenti à son couronnement. Ce prince y porta sa tristesse habituelle
; il en revint agité par les noirs pressentimens, qui ne le quittaient plus,
et qui furent trop justifiés.
En
effet, le lendemain, 14 mai 1610, il monta en voiture, avec quelques seigneurs,
et il ordonna à son cocher de le conduire à l’arsenal, où demeurait Sully.
Il voulait déposer ses alarmes dans le sein de cet ami fidèle. Le temps était
superbe, et il fit ouvrir les rideaux de sa coche. S’ils fussent restés fermés,
il n’eût pas péri ce jour-là.
La
voiture fut arrêtée, dans la rue de la Féronnerie, par un embarras de charrettes.
Un misérable, un scélérat, un monstre, Ravaillac suivait le roi depuis le
Louvre. Il monta sur la petite roue, du côté gauche. Aux portières, dans
le fond, sur le devant delà coche étaient placés sept seigneurs, qui accompagnaient
Henri. L’infâme fut obligé d’allonger le bras jusqu’au milieu du fond de
la voiture. Il frappa le bon prince de deux coups de couteau, dont le second
le fit expirer à l’instant.
Le
forfait fut commis avec la rapidité de l’éclair. On n’eût su à qui l’attribuer,
si le coupable eût jeté son couteau, et se fût perdu dans la foule. Il resta
près du carosse, son couteau à la main, et les yeux égarés. Il fut arrêté
aussitôt. On reporta, tristement au Louvre, le corps sanglant du malheureux
Henri.
Il
était né soldat et général. Obligé d’anéantir les factieux qui désolaient
la France, il les combattit en héros, et fut toujours vainqueur et clément.
Il
avait reçu de la nature un jugement sain, un esprit vif, pénétrant, fécond,
agréable sans affectation, et une franchise qui lui gagnait tous les cœurs.
Sa
taille était moyenne, mais bien prise. Il avait le teint beau, le nez aquilin,
les yeux vifs et grands, le front haut et large, et ses cheveux étaient bruns
dans sa jeunesse. L’ensemble de sa physionomie était agréable et majestueux.
Son
gouvernement fut constamment paternel. Le bonheur du peuple fut sa plus douce
jouissance, et celle-là ne traîne, après elle, ni inquiétudes ni regrets.
La
nouvelle de sa mort étendit un crêpe funèbre sur toute la France. Un même
cri de douleur se faisait entendre partout : nous avons perdu notre père.
Une
acclamation générale s’éleva sur toute la surface de la France. Henri IV
fut proclamé GRAND, par tous les Français. Quelle différence de ce tribut,
qui s’échappait de tous les cœurs, à celui que la flatterie décerna à des
monarques vivans, qui ne furent que fastueux, dissipateurs, ambitieux, persécuteurs
!
Monsieur
l’écuyer s’arrêta là. J’étais un homme libre, et je ne pus m’empêcher de
donner des larmes à un souverain absolu, que j’avais eu la sottise de maudire
long-temps, et dont les grandes qualités couvrirent les faiblesses.
Je
m’étonnai que l’écuyer fût aussi bien instruit. Sa réponse fut simple. «
Le dernier armement de Henri IV menaçait l’Allemagne. Le Wirtemberg, couvert
par la Suisse et la Germanie, redoutait peu la France. Cependant, Monsieur
le comte était intéressé à savoir ce qui s’y passait. Il eut constamment,
à Paris, des émissaires, qui lui rendaient compte de tous les évènements.
Il raisonnait, il discutait avec ses grands officiers. Moi, j’écoutais. Voilà
le mot de l’énigme. »
Nous
prîmes congé de lui. Nous attachâmes nos alambics sous notre chariot ; nous
nous mîmes dedans, et nous partîmes.
Des
objets nouveaux frappent l’imagination des hommes, à plus forte raison celle
d’un enfant de douze ans. Ma Toinette ne pouvait s’occuper que de ce qu’elle
avait vu ; elle m’en parlait sans cesse. Elle faisait, sur la différence
qui existe entre le gouvernement, les mœurs et les usages du Wirtemberg et
de la Suisse, des observations qui annonçaient un jugement précoce, et que
faisaient singulièrement valoir ses expressions naïves et pleines de candeur.
Je me plaisais à la faire parler : elle m’intéressait, elle m’amusait, et
elle oubliait l’amour..., du moins pour un moment.

Lecture
des lettres d’Héloïse et d’Abélard, par Bernard d’Agesci, v.1780
CHAPITRE
XXXIX ET DERNIER.
Dénouement
prévu.
L’étonnement,
l’admiration ne sont que des secousses de l’âme. Elles s’éteignent promptement,
quand elles ne sont pas soutenues par des objets nouveaux. Malgré mes ruses
et mes efforts, le nom de Toinon s’échappa avant que nous fussions arrivés
à l’auberge, où nous devions passer la nuit. Pas un mot d’amour, cela était
convenu, arrêté, promis. Mais il était tout simple que Toinette racontât
à Toinon l’histoire de son voyage. Avec quel plaisir elle lui parlerait !
avec quelle attention il écouterait ! comme sa jolie figure s’animerait à
tel ou tel trait ! il est de fait que ces deux enfans sont charmans.
Toinette,
pleine de ses idées, ne finissait pas. Elle avait oublié Stutgard, pour ne
parler que de Toinon, et l’expression de sa figure, le ton moelleux de sa
voix, ses gestes tout était sentiment. Je l’arrêtais quelquefois. « Mon père,
je n’ai pas dit amour. — Mais tu le sens. — Vous ne m’avez pas défendu de
sentir. — Dans quatre ans, je n’aurai plus d’observation à te faire. — Quatre
ans, quatre ans, c’est bien long ! — C’est un des principaux articles, dont
vous avez juré l’observation à M. le curé. — M. le curé n’a jamais aimé ;
il n’aimera jamais. — Il a vraisemblablement combattu son cœur. Imitez-le,
mes enfans. » Elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine, et ne répliqua
plus.
Le
lendemain au soir, nous rentrâmes dans le canton d’Appenzell. Le surlendemain,
à la pointe du jour, Toinette retrouva ses habitudes, et ne cessa de faire
des applications. Une femme, qui lui paraissait belle et nonchalante, était
sa maman Claire ; celle qui annonçait de la vivacité, était sa bonne Marianne....
Je voyais bien où elle en voulait venir. « Et ce joli garçon, là-bas, qui
paraît si bon, si laborieux — Oh, mon père, Toinon est bien mieux que lui.
— Tu le crois ? — Regardez bien. » Elle allait analyser, comparer les deux
figures, trait pour trait : c’eût été à ne pas finir. Très-heureusement pour
moi, nous aperçûmes notre habitation, et nos amis en mouvement. Elle jeta
un cri : « Le voilà, le voilà !... il vient, en courant, au- devant de nous.
» Je regardais de tous côtés, et je ne voyais rien : les yeux perdent singulièrement
de leur activité, quand on cesse d’être amoureux.
Il
fallut bien qu’enfin j’aperçusse le bon Toinon : il n’était plus à cent pas
de nous. Toinette fit un mouvement. Je voulus la retenir. Elle était déjà
sur le chemin. Bientôt ils furent dans les bras l’un de l’autre. Ce tableau
me causa un extrême plaisir ; mais il fallait paraître mécontent : « Mes
enfans, vous violez le traité, et cela est mal. — Mon père, on dit qu’on
embrasse ses amis, quand on revient, d’un long voyage. » Ses amis ! — « Et
qui a dit cela ? — C’est ma bonne Marianne. — Votre bonne Marianne ferait
mieux de se mêler de ses affaires. — Vous n’avez pas dit ta, mon père
! — C’est que j’ai de l’humeur, ma fille. — Et vous avez lieu d’en avoir,
me dit franchement le bon Toinon ; mais un père aime à pardonner. » Je pardonnai,
en effet : c’était ce que j’avais de mieux à faire.
Bientôt
les amis et les amies s’approchèrent de nous, et nous nous embrassâmes cordialement.
« Vous voyez bien, mon père,
qu’on
embrasse ses amis, quand on arrive de voyage. » La petite rusée ! Je ne
lui répondis pas un mot.
Quand
la voiture fut déchargée, et qu’on eut assez parlé kirswaser, nous dînâmes
en famille. Je lisais dans les yeux de Toinette qu’elle grillait de raconter
l’histoire de son voyage à toute la colonie ; mais, en fille bien élevée,
elle attendit la fin du repas, avant que de nous occuper d’elle. La petite
goutte d’hydromel passée, elle se leva, et me demanda la permission de parler.
Elle savait bien que je ne la lui refuserais pas. Conter n’est pas embrasser.
Son
auditoire se rangea autour d’elle. Toinon s’en approcha de manière à me faire
croire qu’il allait entrer dans son escarcelle. Il ne voulait, pas, disait-il,
perdre un mot. Les coudes, les genoux, se touchaient, et le jeune homme a
l’ouïe excellente. Je me fis faire place, et je m’assis entre eux : c’était
le seul moyen d’empêcher l’orateur de s’écarter de son sujet, et un père
est toujours bien aise de voir briller sa fille. La mienne eut un succès
prodigieux. Je m’y attendais : presque tous ceux qui écoutaient étaient disposés
à admirer. Mais l’ami André, fin connaisseur, déclara le débit de Toinette,
vif, serré et pur. Il loua la justesse de ses observations, et sa comparaison,
des serfs allemands et des Suisses libres, lui parut dictée par la plus saine
philosophie. Je me rengorgeais, dame, il fallait voir ! Ce petit coquin de
Toinon était ivre de plaisir. Marianne se caressait le menton, et appelait
Toinette son élève. Au physique, elle avait tout à fait raison. Un père est
toujours père. Le philosophe André voulait faire briller son fils, quoique
la philosophie et la vanité ne s’accordent pas trop. Il proposa d’établir,
entre les enfans, une controverse sur les droits naturels de l’homme, et
sur les fers dont le charge le despotisme. Avec un peu de
réflexion,
il eût senti que cette question convenait mieux à Aristote ou à Sénèque,
qu’à des enfans. Aussi les nôtres s’embrouillèrent, déraisonnèrent, à qui
mieux mieux. J’éclatai de rire ; Toinon et Toinette, terminèrent la discussion
en chantant et en dansant : ils avaient reçu des leçons du grand danseur
Abdonn, et ils dansèrent fort bien. André s’exécuta de bonne grâce. Il convint
qu’il s’était conduit comme un sot.
«
Qu’ils dansent, me dit-il, et qu’ils ne se mêlent plus de métaphysique. »
Nous
raisonnâmes ensuite sur la gêne de leur position actuelle. Nous convînmes
qu’il fallait leur faire quelques concessions, pour qu’ils ne nous échappassent
pas. Les fêtes de la prairie se répétaient tous les dimanches, depuis deux
mois, et nous ne les y avions pas conduits encore. Nous leur proposâmes d’y
aller faire briller leurs talens. Avec quel enthousiasme ils reçurent celte
ouverture ! Toinette me prit la main ; Toinon arracha sa mère de son rouet
; Marianne chanta ; Abdonn battit la mesure, et nous eûmes un bal impromptu.
Ils s’essayaient, disaient-ils, pour le dimanche suivant. Oh, le dimanche,
ils développèrent leur talent, leurs grâces. Ils charmèrent les spectateurs,
et chacun disait : le joli mariage que cela ferait !
«
Nous nous marierons, dans quatre ans, s’écriait Toinon, et ses yeux étincelaient.
Toinette baissait les siens ; mais elle les relevait, quand elle dansait
avec Toinon, et elle ne dansa qu’avec lui.
Il
est de l’essence de l’homme de désirer toujours. La chaleur de son sang se
communique à son imagination, errante et vagabonde. Aujourd’hui n’est rien
pour lui ; il appelle le lendemain, et sans cesse il accuse la lenteur du
temps. Plus tard,
il
s’étonne de la rapidité avec laquelle soixante ans se sont écoulés.
Le
terme, fixé par André et moi, ce terme, si désiré de nos enfans, approchait.
Six mois encore, et ils seront au comble de leurs vœux. Brillans de jeunesse
et de santé, beaux comme l’amour, aimans comme lui, un regard, un geste,
un mot trahissaient leur impatience. Respectueux, prévenans, dociles envers
leurs parens, ils les aimaient autant que le leur permettait une passion
violente et exclusive. L’été, ils n’avaient de communication soutenue que
le dimanche, à la prairie, commune à tous les habitans, et ils avaient sous
les yeux des exemples de l’amour pur et patient qu’on rencontre si souvent
en Suisse. L’hiver nous obligeait à déposer la bêche. Les journées se passaient
dans notre sallon, ou dans notre cabinet. Ils étaient presque toujours sous
nos yeux, et nous étions à peu près tranquilles.
Cependant,
après avoir été la mouche des ménages d’Étampes, des grands seigneurs,
des évêques et des rois, j’étais devenu celle de nos enfans. Un père prudent
doit tout prévoir, et ce qui n’est que possible arrive quelquefois. Ils n’avaient
pas un goût, une sensation qui m’échappassent. La candeur, la pureté de leur
âme perçait dans leurs actions les plus indifférentes. Je les comparais à
ces boutons de rose, qui n’ont pas encore la force de déchirer leur enveloppe,
et de s’entrouvrir. Quelquefois aussi, une rougeur marquée, des soupirs de
feu, une inquiétude vague et dévorante me frappaient. Je prenais Toinon,
sous un prétexte quelconque ; je lui faisais respirer l’air extérieur, et
je ne le ramenais auprès de ma fille, que lorsque je le croyais calmé. Toinette
était tranquille, quand Toinon l’était.
On
peut amuser la nature, pendant quelque temps : on ne l’étouffe jamais. Un
jour, une crise violente fut au moment d’éclater. J’enlevai Toinon ; j’eus
la cruauté et le courage de lui faire gravir la montagne. Je l’entraînai
jusqu’à nos cerisiers. Je lui montrai, de là, la terre, qui était à trois
cents toises au- dessous de nous. Je lui fis remarquer l’ordre qui règne
partout, et je lui demandai s’il appartient à deux frêles individus de vouloir
le troubler. « Je ne connais pas d’ordre, quand deux cœurs, brûlans d’amour,
ne peuvent se fondre l’un dans l’autre. Il y a désordre, quand on les tient
séparés. Que sommes- nous, d’ailleurs, dans l’immensité des choses, que deux
points imperceptibles de la création ? — Toinon, tu m’affliges. — Ah, mon
père, n’ajoutez pas à ce que je souffre. — Pense qu’André et moi ne vivons
que pour vous ; que notre bonheur est attaché au vôtre ; que ces résolutions,
qui vous tourmentent, nous sont dictées par la plus vive affection ; enfin,
qu’il n’y a plus que six mois... — Mon père, ces six mois seront autant de
siècles.
«
— Insensé, tu veux être époux, tu veux être père ! Frémis à l’idée des dangers
qui t’attendent, même dans six mois ; tes forces épuisées, ta santé ruinée,
toute espèce de bonheur anéantie te soulèveront contre la coupable condescendance
qui nous a portés à fixer un terme trop court à tes désirs. — Moi, vous adresser
des reproches ! jamais. Hé, de quoi me plaindrai- je ! Qu’importe la durée
d’une vie usée dans des torrens de félicité ? — Misérable, qu’oses-tu dire
! Tu n’aimes pas Toinette. — Je ne l’aime pas, grand Dieu ! — Non, puisque
tu la condamnes à te perdre à la fleur de son âge, et à passer le reste de
sa vie dans la douleur et les regrets. »
Ces
derniers mots changèrent entièrement les dispositions du bon jeune homme.
Il tomba à mes pieds ; il se déclara
coupable
; il me demanda pardon. Je le relevai ; je l’embrassai avec la plus vive
tendresse.
L’automne
approchait, et le froid, qui commençait à nous gagner, produisit, sur Toinon,
autant d’effet, au moins, que mon éloquence. Cependant je ne pouvais le laisser
geler pour le maintenir dans ses heureuses dispositions. Je ne me souciais
pas, non plus, de geler avec lui. Nous descendîmes, et nous entrâmes dans
le sallon, où la colonie était rassemblée. Quel fut mon étonnement ! Toinon
raconta ce qui venait de se passer entre nous. Il rapporta les propres mots,
dont nous nous étions servis ; il se déclara coupable, pour la seconde fois
; il tomba aux genoux de Toinette, et lui demanda pardon. Il était impossible
de pousser plus loin la franchise et la candeur. Ma Toinette s’approcha de
moi ; elle ne chercha pas à justifier son jeune ami ; elle me renouvela les
promesses, dont l’exécution avait été jurée, trois ans auparavant ; Toinon
se joignit à elle ; ils répétèrent leur serment. Je les pressai tous deux
contre mon cœur, et tout alla au mieux, pendant deux mois. Il en restait
quatre à parcourir, et quelquefois il n’en a pas fallu autant pour renverser
un empire.
Ils
prirent du goût pour la lecture, et je m’en félicitai. Pauvre dupe ! Ils
se lisaient, l’un à l’autre, les ouvrages qu’André avait rapportés de Saint-Gall,
et de la Souabe. C’étaient des livres instructifs et amusans, mais qui étaient
tout-à-fait étrangers aux passions. J’étais sûr que celui qui tenait le livre
était écouté avec la plus grande attention. Je remarquai bientôt qu’ils lisaient
séparément, et leurs physionomies prenaient une expression alarmante. Je
me gardai bien de m’approcher d’eux : c’eût été leur donner l’éveil. Mais
un jour, pendant qu’on dînait, je sortis, je montai au sallon, j’ouvris leurs
livides. C’étaient les
œuvres
de sainte Thérèse, ces œuvres que nous avions dévorées, ma tendre Colombe
et moi, et dans lesquelles, sous le nom de Dieu, tout est amour et volupté.
Je frissonnai.
Comment
leur interdire la lecture d’un livre, que, depuis leur plus tendre enfance,
ils avaient vu dans notre petite bibliothèque ? C’eût été nous accuser nous-mêmes.
Le leur enlever, serait provoquer une nouvelle explication, et elles étaient
toujours orageuses. J’étais dans le plus grand embarras. Je consultai mon
philosophe André. « Ce n’est que cela, me dit l’homme inventif ! J’arrangerai
cette affaire-là ce soir. »
Les
enfans lisaient à une table, placée sous la grosse lampe qui éclairait le
fond de notre sallon, pendant toute l’année. Les cinq volumes de sainte Thérèse
étaient ouverts sur cette table. Le lendemain, après le déjeuner, nous montâmes
à la baume, selon notre ancienne habitude. Nous y passions une heure avant
que de retourner au travail. Ô stupéfaction ! ô douleur ! la lampe était
tombée, et sainte Thérèse nageait dans une pinte d’huile. Il était impossible
de la prendre autrement qu’avec des pincettes. Elle passa, du sallon, sous
la chaudière de Gott. On sent bien qu’André avait limé les chaînes de fer,
qui la soutenaient.
En
allant, en venant, je m’aperçus qu’un des deux sortait fréquemment, pendant
nos heures de repos. Je ne les observais jamais que lorsqu’ils étaient ensemble.
Cependant ces sorties, que rien ne motivait, fixèrent enfin mon attention.
Je suivis un jour Toinette, en me plaçant de manière à ce qu’un objet volumineux
fût toujours entre elle et moi.
Elle
entra dans l’écurie. Que pouvait-elle avoir à faire là ? elle passa derrière
le râtelier, prit un livre, et lut, pendant un quart-
d’heure.
Elle remit le livre, je ne sais où, et sortit. J’étais blotti, entre deux
tonneaux d’avoine, et je me gardai bien de quitter ce poste avantageux.
Toinon
vint à son tour, et fit exactement ce que Toinette venait de faire. La cloche,
qui nous appelle au travail, se fit entendre, et le jeune homme disparut.
Quel livre peut les intéresser à ce point, et où le cachent-ils ? Je le trouvai
dans un vide que laissait l’extrémité d’une des deux pièces de charpente
qui composaient le râtelier... Lettres d’Héloïse et d’Abailard !!! Je confisquai
celui-là.
Je
ne pouvais revenir de mon étonnement. Où avaient-ils pu se procurer un pareil
ouvrage ? Les mœurs de nos villageois sont tellement simples, qu’aucun d’eux
ne devait le connaître. On aime, on danse en Suisse ; on n’y lit guère que
la Bible. Je me fatiguais la tête, et je ne trouvais rien qui me parût vraisemblable...
Ah !... Pendant que nous nous promenions, dans les rues de Stutgard, elle
aura vu Héloïse en étalage. Le long récit de l’écuyer, l’attention que je
lui donnais lui auront permis de s’échapper un moment, et elle aura couru
acheter le livre... Mais comment, sur le simple titre, a-t-elle pu le juger
?... M’y voilà, m’y voilà. André et moi leur avons appris tout ce que nous
savons, et Abailard fut aussi célèbre par ses malheurs que par son érudition
et son éloquence. Il est présumable que nous nous serons un peu étendus sur
cette première partie de sa vie.
«
Hé bien, ami André ? — Hé bien, ami Antoine ? — Que dis- tu de cela ? — Qu’ils
doivent ruser, puisqu’ils ne sont pas assez forts pour combattre. — Ruser,
c’est tendre à une fin qu’on n’ose avouer hautement. — Sans doute. — La ruse,
dans la circonstance actuelle, est donc condamnable ? — Sans doute.
—
Que ferons-nous ? — Tout ce qu’on pouvait faire est fait. Le livre est enlevé,
et certainement ils ne le réclameront pas.
«
Ils sont ingénieux. — C’est tout simple : ils s’aiment. — Ils chercheront
quelque dédommagement. — Ils s’aiment. — Ils en trouveront. — Ils s’aiment.
— Il faudra donc passer une partie des journées à les surveiller ? — C’est
le métier des pères et des mères. — Tu es du plus beau sang-froid !... —
Pourquoi m’échaufferais-je ? — Ah, si tu étais le père de la jeune personne,
tu penserais autrement. — Peut-être bien. » Je lui tournai le dos.
Ils
se regardent ; ils ont l’air étonné ; sans doute ils chercheront à se parler,
à s’expliquer un mystère, qui peut leur paraître inconcevable. Héloïse ne
s’est pas en allée seule ; ce n’est pas nous qui l’avons trouvée, puisque
nous ne leur en parlons pas…. Ah, Toinette tourne autour du râtelier ; elle
se baisse, elle se relève, elle frappe du pied ; il y a du dépit. Elle revient,
en chantant. La petite rusée!.... Toinon la remplace ; il retourne la litière,
et il jette la fourche par-dessus sa tête… La cloche sonne ; il prend sa
bêche, et nous partons.
Je
m’appuyais, de temps en temps, sur la mienne, et je regardais tantôt Toinon,
tantôt ce qui se passait autour de la maison. Le jeune homme était impénétrable,
et Toinette ne sortait pas. La prairie, qui est en face du châlet, est
coupée par plusieurs routes, qui facilitent les arrivages, et qui nous servent
de promenades. Aux extrémités, sont des touffes de rosiers, de lilas, de
seringat. Toinette ne manque jamais de se promener là, son ouvrage à la main,
pendant nos heures de travail : elle voit son ami, et quelquefois elle fait
deux bouquets. Elle m’en offre un, pour avoir le droit de donner l’autre,
on devine à qui.... Et elle ne sort pas... elle ne sort pas!
Depuis
long-temps la conversation de Marianne et de Sophitt est sans attrait pour
elle. Qui peut la retenu dans notre habitation ? L’amour est inventif, et
elle aura trouvé quelque chose de nouveau.... Je la suivrai de près.
La
voilà, la voilà. Elle veut avoir l’air de marcher sans intention. Elle croit
donner à ses mouvemens une apparence d’abandon, de nonchalance, et sa démarche
est contrainte. Elle a quelque dessein ; mais la Mouche voit clair.
Elle
s’assied sur l’herbe. Elle est découverte de toutes parts ; elle ne fera
rien là : cette station est préparatoire. En effet, elle se lève, elle tourne
autour de nos arbustes. C’est là qu’est le but, vers lequel elle tend. Elle
va, de l’un à l’autre, pour me dérouter, si je l’observe. Elle s’assied derrière
un gros lilas, et se relève presqu’aussitôt ; elle va s’asseoir à côté, derrière,
devant les autres. Elle pouvait ainsi rendre mes recherches longues et multipliées
; mais je ne l’avais entièrement perdue de vue que derrière le premier lilas.
C’est dans celui-là que je chercherai. Oh, je sais mon métier; demandez-le
à l’évêque de Limoges…. s’il vit encore.
Nous
rentrions pour dîner, et nous reposer. Je marchais à côté de Toinon, et à
chaque instant, il trouvait un prétexte, pour rester en arrière. Il a le
mot d’ordre, me dis-je.
Je
changeai de manœuvre. Je me portai rapidement en avant, et je m’arrêtai à
dix pas de ce lilas, que je voulais fouiller. Toinon fut contraint de passer.
Je formai alors l’arrière-garde.
Toinette
nous joignit avec un air riant. Elle me présenta un bouquet, gros comme un
balai, et elle n’en avait pas pour Toinon. Petite maladroite !
Les
deux jeunes gens ne me perdaient pas de vue : ils me croyaient vraisemblablement,
en ce moment, le ravisseur d’Héloïse, et ils avaient encore quelque chose
à dérober à ma pénétration. On allait monter au châlet. Je pris André sous
le bras ; je lui fis part de mes soupçons, et je lui montrai, du bout du
doigt, l’arbuste receleur. « Tu n’es pas un observateur fort adroit. — Bien
obligé. — Tu sais mieux ce qui se passe dans le soleil qu’à tes pieds. —
Voilà qui raccommode un peu les choses. — Les enfans ne se défient pas de
toi. Echappe-toi adroitement, aussitôt que tu le pourras, et va prendre ce
que Toinette a mis dans ce lilas. »
Il
était temps que la conférence finît. Les enfans parurent sur la porte. Ils
avaient l’air préoccupé. J’entrai avec eux, et tout le monde se mit
à table. Toinette me caressait ; Toinon m’adressait des choses
flatteuses : ils voulaient m’inspirer de la confiance. André sortit ; les
jeunes gens s’en aperçurent à peine.
Les
amoureux se couchent comme les autres, quoiqu’ils n’aient pas toujours envie
de dormir. Le plus profond silence régnait dans la maison, lorsqu’André et
moi montâmes à notre cabinet. Je grillais de savoir ce qu’il avait trouvé
dans ce lilas…. Des papiers!.... Des lettres!.... Il y en a dix ou douze.
Ah, elles sont des deux écritures. C’est une correspondance en règle. Ils
ont dû cette idée aux épîtres brûlantes d’Héloïse et d’Abailard. Oh, que
le père des lettres, François premier, eut raison de supprimer l’imprimerie
! Que de pères, de mères, de maris dormiraient en paix, si elle n’eût pas
été rétablie !
«
André, tu n’as pas trouvé tout cela dans le lilas. — Voilà la seule qui y
fût déposée. — Lisons. Toutes réflexions faites, il n’y a que mon père
qui ait pu nous enlever notre chère Héloïse. S’il trouve notre correspondance
; nous sommes perdus. Ah,
mon
Dieu ! Je viens de cacher toutes nos lettres sous le linge de ta mère.
Nous entrons librement tous deux dans sa chambre, et elle ne s’occupe pas
de ce que nous y faisons. L’audacieuse ! Placer cela dans la chambre
de sa future belle-mère ! Sous son linge ! — La cachette était bien trouvée.
— Je ne ris pas, André. Voyons ces lettres. Un amour, profondément senti,
s’y développe à chaque ligne ; mais je n’y trouve pas un mot, qui ne soit
innocent. Le style est pur, coulant. Qui leur a appris à écrire ainsi ? —
Celui qui leur a appris à aimer.
«
— Ami André, il est pénible, affligeant d’avoir toujours à les surveiller.
— Il est cruel pour eux de vivre dans une contrainte perpétuelle. — Que font,
à leur mariage, quelques mois de plus ou de moins ? — Les jeunes gens qu’on
ne marie pas, se marient quelquefois eux-mêmes. — André, marions-les.
—
Marions-les, Antoine : je crois qu’il en est temps.
«
Qu’entends-je ? Qui s’approche de nous ? — Oh, oui, oui, mariez-nous ! »
C’est monsieur Toinon, qui aura soupçonné quelque chose, qui s’est relevé,
qui nous a suivis, qui nous a écoutés. « Ah, mariez-nous ! mariez-nous. —
Certainement, nous vous marierons, et la semaine prochaine. » Toinon saute,
gambade ; il est tantôt à nos pieds, tantôt dans nos bras. Tout à coup, il
s’élance ; il saute les barres de l’échelle, que Bleker appelle un escalier
; il court criant à tue-tête : « Toinette, on nous marie ! on nous marie
! »
Nous
le suivons, mais d’un peu loin. Nous trouvons, en rentrant, tout le monde
sur pied, les hommes en chemise, les femmes à demi habillées : Toinon avait
d’abord répandu une alarme générale. Quand on fut bien éveillé, on le comprit,
on rit. Toinette vint m’embrasser et me remercier, de l’air le plus solennel.
Le
lendemain nous descendîmes à Appenzell, et nous remplîmes les formalités
prescrites par la loi et la Religion. Les charmans futurs étaient rayonnans.
Nous
avions d’abord, André et moi, l’intention de leur prescrire un régime utile
à la conservation de leurs forces et de leur santé. « Ils promettront tout,
dit André, et ils seront de bonne foi. Ils ne tiendront pas plus cette promesse-là
que les autres, parce que la nature les entraînera. Faisons beaucoup travailler
Toinon, et laissons aller les choses, comme nous laissons couler notre ruisseau.
»
La
noce fut magnifique, pour une noce suisse. Les jeunes époux étaient ivres
de bonheur. Nos bons amis partageaient leur joie et la nôtre. Ah, qu’on est
heureux de la félicité de ses enfans !
Comme
le temps passait ! Il coule vite, quand on n’éprouve aucune contrariété.
Quatre ans après, nous avions deux petits- enfans, qui étaient les idoles
des deux familles. Ce sont encore un Toinon et une Toinette.
Le
luxe commence à s’introduire dans le canton. Les femmes portent le corset
de soie, et le tribunal de la Réforme se tait, parce que les épouses
des membres qui le composent sont les premières à enfreindre la loi. Dans
cent ans, les formes du gouvernement seront les mêmes ; mais la liberté ne
sera plus qu’un mot : le luxe caresse toujours la richesse, qui seule peut
l’alimenter, et où l’opulence est tout, l’esprit public a cessé d’exister.
Nous sommes riches ; nos descendans seront landammans.

Mariés
du Valais au XVIIe siècle
(gravure de 1896)
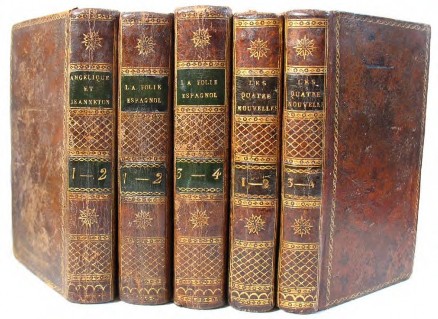
-
Recension de la Revue
Encyclopédique 10
Sainte
(la) Ligue ou La Mouche, pour servir de suite aux Annales du Fanatisme, de
la superstition et de l’hypocrisie, par Pigault-Lebrun, 6 forts vol. in-12,
couv. impr. 21 fr. — net 12 fr.
On a vivement
recherché les romans de M. Pigault-Lebrun et son Histoire de France,
parce qu’il était impossible de ne lui pas reconnaître au plus haut degré
la verve du romancier et le tact d’observation de l’historien. Sa Sainte
Ligue réunira les suffrages des admirateurs de son double talent ; car
c’est un tableau qui tient du roman par l’intérêt qu’il présente, et de l’histoire
par la vérité de la couleur.

10 Revue
encyclopédique, ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables
dans la littérature, les sciences et les arts 43
(1829), p. 15.
-
Recension du Journal
général 11
La Sainte
Ligue, ou La Mouche, pour servir de suite aux Annales du fanatisme, de la
superstition et de l’hypocrisie, par Pigault-Lebrun, 6 vol. in-12.
Chez Barba.
La préface
de ce livre est fort courte, nous pouvons la donner en entier. « Je n’ai
jamais aimé les romans historiques, dit l’auteur, je ne les crois propres
qu’à égarer le lecteur. Quelques soins que prennent les auteurs, ils offrent
presque toujours au public un mélange de fable et d’histoire, plus que difficile
à démêler. Tous mes principaux personnages sont historiques ; ce que je leur
fais faire d’essentiel l’est aussi : tout cela se fond dans des fictions
qui rendent la vérité méconnaissable. Voilà un grand trait de ressemblance
entre moi et mes devanciers ! Mais je veux avoir sur eux l’avantage de la
bonne foi. Voulez-vous connaître les règnes de Henri III et de Henri IV?
consultez mon libraire Barba ; il vous conseillera de lire mon Histoire
de France (8 vol. in-8. Prix, 48 fr.) ; il vous en garantira la véracité
et l’impartialité. » — Nous n’entreprendrons pas d’analyser cet ouvrage,
qui n’est pas susceptible d’extrait ; le nom seul de Pigault-Lebrun le recommande
; on sait que le style de cet auteur favori est original et qu’il a beaucoup
de ressemblance avec celui de Voltaire.

11 Journal
général de la littérature de France, ou indicateur bibliographique et raisonné
des livres nouveaux en tous genres, suivi d’un bulletin de la littérature
étrangère 32 (1829), p. 121.
-
Recension du Mercure
de France 12
LA
SAINTE-LIGUE.
Après
un long silence, M. Pigault-Lebrun vient de lancer dans le monde un dernier
roman : la Sainte Ligue ou la
Mouche13, pour servir de suite, ainsi
qu’il le dit lui-même sur son faux titre, aux annales du fanatisme, de la
superstition et de l’hypocrisie. C’est en effet de l’histoire ; mais de l’histoire
mêlée, sacrifiée au roman, de l’histoire sans physionomie.
M. Pigault
est toujours l’auteur qui amusa notre enfance sous le directoire, notre jeunesse
sous le consulat, et qui, sous l’empire, nous arracha quelquefois ce rire
fou pour lequel nous semblons aujourd’hui n’être plus faits. Sa manière libre,
son style frondeur et froid, son philosophisme ironique ne l’ont pas abandonné,
mais bien sa chaleur et cette force de sensibilité qui de temps à autre tempérait
sa gaîté folle et burlesque. On sent que les distractions historiques qu’il
s’est permises, les infidélités qu’il a faites au roman lui ont été quelque
chose de sa verve et de sa flexibilité. Historien de troisième force, il
a perdu à compiler des chroniques ce cachet d’originalité qui était le fond
de son talent.
Ajoutez
à cela que la restauration nous a vieillis plus vite que lui, nous a mûris
si précipitamment, qu’il y a maintenant entre

12 Le Mercure
de France au dix-neuvième siècle 25 (1829), pp.
88-89.
13 6 vol.
Chez Barba, galerie de Chartres ; Barba fils, rue de Seine, n. 33.
— Et à la
Librairie de l’Industrie, rue St.-Marc-Feydeau, n. 10.
sa
manière de dire et notre manière de juger, la distance d’un siècle ou deux.
Walter Scott |89 domine toutes nos imaginations,
et il y a loin pour l’impartialité, le coloris et la réalité, de l’école
du philosophe de Ferney à l’école du baronnet d’Abotsford. Cette influence
du grand Ecossais sur nous a pesé jusque sur les cheveux blancs et la plume
sexagénaire de l’auteur de l’Enfant
du carnaval.
Il a voulu se laisser aller à l’imitation, et il
a nui à ses anciennes habitudes sans pouvoir en prendre de plus modernes.
Quand il veut hasarder une description pittoresque, on sent qu’il esquisse
à la hâte et que l’impatience lui fait échapper l’intérêt. Les personnages
qu’il arrache de l’histoire sont chargés d’une couleur vigoureuse, mais il
n’en révèle que le côté grotesque : la sainte ligue est un épisode de son
livre ; mais l’esprit du temps, la piété sincère, le fanatisme de bonne foi,
l’hypocrisie rusée, la splendeur des crimes et des misères de cette époque
ne se rencontrent nulle part dans cette création ; il y règne je ne sais
quoi de léger, d’insouciant, d’éternellement satirique, un ton si antipathique
avec toute gravité, si profondément éloigné de la profondeur, que M. Pigault-Lebrun,
en faisant beaucoup de volumes (il y en a six ), n’a rien fait pour instruire
ses lecteurs. Toutefois il ne saurait en manquer dès qu’il sera convenu qu’il
ne faut rien prendre au sérieux dans cet ouvrage, et qu’il ne faut pas plus
y attacher d’importance qu’il n’en a sans doute mis lui-même.
Considéré
sous ce point de vue, c’est un délassement très- jovial que ce dernier effort
d’un auteur qui a eu la renommée la plus populaire et la plus méritée. Chacun
son temps ; cependant il y aura toujours des lecteurs arriérés pour les auteurs
arriérés.
-
Recension de l’Ami
de la Religion 14
Un journal
qui, au mérite de ne point traiter de la politique, joint celui d’offrir
d’excellens principes littéraires, et des articles judicieux et piquans sur
les différentes branches des sciences et des arts, l’Universel, a
donné un fort bon article sur un roman nouveau de M. Pigault-Lebrun. On sait
que M. Pigault-Lebrun est un de nos plus féconds romanciers, qui ne se pique
pas, dans ses romans, de respecter, ni le goût, ni les mœurs. Nous avons
parlé de ses œuvres, n°1129, tome XLIV. Quelques-uns de ses écrits ont même
été l’objet de poursuites judiciaires. Le 3 decembre 1824, le tribunal de
police correctionnelle declara le libraire Barba coupable d’outrages à la
morale publique et religieuse pour avoir réimprimé M. de Roberville, roman
du sieur Pigault-Lebrun. La cour royale, en infirmant ce jugement pour raisons
de formes, maintint la saisie des exemplaires, et ordonna qu’ils fussent
mis au pilon, l’ouvrage contenant des outrages à la morale publique. Le
25 juin 1825, Barba fut encore condamné à l’amende et à la prison pour avoir
publié un autre enfant du sieur Pigault-Lebrun, L’Enfant du carnaval,
et le tribunal ordonna que les exemplaires saisis seraient détruits.
Aujourd’hui
Barba fait annoncer ces mêmes livres dans tous les journaux, et nous avons
vu avec étonnement et douleur, le lundi 30 mars, un journal estimable d’ailleurs,
et qui professe des principes religieux, nous l’avons vu, dis-je, annoncer
les

14 L’Ami
de la religion 59/1531 (11 avril 1829), pp. pp.
271-272.
romans
de M. Pigault-Lebrun, entr’autres, la sainte Ligue ou la Mouche, et
recommander avec éloge l’Esprit de l’Église de Potter, et les Ruines,
de Volney. Cette annonce d’ouvrages, qui fait plus de deux grandes
colonnes aura sans doute échappé à la vigilance d’un rédacteur consciencieux,
et qui s’est même montré quelquefois sévère dans ses jugemens. On ne le soupçonne
pas d’avoir trahi ses principes pour un vil intérêt ; mais il n’en est pas
moins déplorable que de telles annonces et de tels éloges aient paru dans
un journal qui a la confiance d’un
grand
nombre de lecteurs15. C’est ce qui nous engage
à faire connoître le jugement de l’Universel sur M. Pigault-Lebrun,
et
sur son
nouveau roman. Le titre seul de ce roman annonce tout ce qu’on peut en attendre
; c’est la Mouche ou la sainte Ligue, pour servir de suite aux annales
du fanatisme, de la superstition et de l’hypocrisie. Voici un extrait
de l’article de l’Universel :
« C’est
avec les romans, les journaux, les pièces de théâtre, qu’on met la corruption
à la portée de toutes les intelligences. Qu’un faiseur de métaphysique tombe
dans des erreurs dangereuses, il faut de l’instruction pour s’égarer avec
lui, et par conséquent sa fatale influence n’aura qu’un horizon borné. Ce
n’est pas là que le peuple fait son cours de philosophie, il faut mettre
la métaphysique à sa taille. Les mauvais principes, soit en morale, soit
en politique, doivent lui être présentés sous la forme de l’épigramme ou
du quolibet, et les littérateurs se sont chargés de l’égarer en l’amusant,
et de populariser, par des applications bouffonnes, de dangereuses théories

15 Depuis
que cet article est rédigé, le rédacteur du journal dont nous parlons a reconnu
son tort, et a promis de redoubler de sollicitude. Cet aveu qui l’honore
ne nous paraît pas une raison de supprimer notre article, qui devoit d’abord
paroître plus tôt, et qui a été retardé par l’abondance des matières.
«
Ce n’est point assez qu’on ait traduit récemment Henri III et
sa cour devant le parterre, voici venir M. Pigault-Lebrun, qui, dans un beau
mouvement de zèle, a voulu commenter la même idée, et consacrer six volumes
à insulter les croyances religieuses et monarchiques ; et qu’on ne dise point,
pour justifier cette volumineuse diffamation, qu’il est permis de s’indigner
à la vue de tant d’immoralités et de vices. On sait que M. Pigault-Lebrun
ne s’est pas précisément montré l’apôtre de la morale dans ses nombreux écrits,
et on dira peut- être qu’il a mauvaise grâce à faire le procès à la débauche
et à la corruption. Si notre mémoire nous sert bien, chaque pas de
M. Pigault-Lebrun
dans la carrière littéraire a été une insulte aux bonnes mœurs ; et il faut
le dire, malgré les égards qu’on doit à la vieillesse, son dernier ouvrage
est digne des autres ;
M. Pigault
finit comme il a commencé…..
« C’étoit
une bonne fortune pour lui qu’un sujet où il pourrait attaquer à la fois
la monarchie et la religion dans un roi et dans des prêtres, et aussi Dieu
sait comme il s’en est donné. Pas un vice, pas un ridicule n’a été omis ;
l’histoire est commentée, revue, et considérablement augmentée ; pas un crime
qui n’ait un prêtre pour auteur, un noble pour complice ; tout ce qui appartient
aux classes élevées de la société est de droit entaché de cagotisme et de
corruption. M. Pigault fait danser ses marionnettes suivant un système ;
il faut, pour la gloire de la philosophie et l’instruction du peuple, signaler
les fautes des ecclésiastiques et des rois, et dans cette mission, M. Pigault
a tout le zèle d’un neophyte. Met-il Henri III en scène, c’est pour nous
montrer en lui un joueur de bilboquet, une espèce de Cassandre qui passe
sa vie avec des mignons et des chiens ; mais des qualités brillantes de celui
qui fut duc d’Anjou, pas un mot. Il ne faut montrer que le revers de la
médaille
: c’est une bonne œuvre qu’un mensonge philosophique. Sommes-nous introduits
auprès d’un évêque, c’est pour voir tous les vices sous la pourpre. Entrons-nous
au couvent, c’est pour y être témoins d’un vol.
« Comme
les harpies, M. Pigault souille tout ce qu’il touche ; mais, disons-le pour
rassurer les bons esprits, ici la force a manqué à l’auteur, on ne peut lui
savoir gré que de la bonne intention. L’indifférence du public fera justice
d’une rapsodie sans talent, et personne ne reconnoîtra la verve licencieuse
de l’auteur de Jérôme, du Citateur, en lisant les derniers blasphèmes
de cette voix qui tombe et de cette ardeur qui s’éteint. »
Le Gérant,
Adrien Le Clere.
-
Recension de la Southern
Review 16
La Sainte Ligue, ou la mouche, pour servir de suite aux annales
du fanatisme, de la superstition et de l’hypocrisie. Par PIGAULT-LEBRUN. Paris. 1829. […] 319|367 […]
For
thirty years or more Pigault Lebrun has kept all France alive with his inexhaustible
gayety. He does not pourtray very natural characters, nor excel in the probability
or consistency of his plots. But there is no end to the fertility of his
invention, and the oddity of his incidents. The critic may condemn but he
cannot help laughing. All his works are amusing, but the best are the “Child
of the Carnaval,” “My Uncle Thomas,” the “Barons of Felsheim,” the “ Spanish
Folly,” &c. The work at the head of this article has less humour and
more decency than is common with him. As he writes with a careless and unequal
pen, though clear and graphic, his productions cannot be well judged from
mere extracts.
The
Holy League or the Spy (La Sainte Ligue ou la Mouche) commences a little
after the period of the “Chronicle of Charles IX.”17 Many names from history are introduced,
but the principal characters are fictitious, nor is there any attempt to
give a picture of the times. In short, it is a novel of the old school.
We have not room to give a sketch of it. The character of the
philosophic Andrew is well drawn and

16 The
Southern Review (Charleston, Caroline du Sud, USA)
7/14 (may- august 1831), pp. 319 et 367-368.
17 Ouvrage
de Mérimée également recensé par la Southern Review.
sustained.
Poussainville is happily hit off, and we know not why he is so soon killed.
Though Colombe is much like Lord Byron’s females, with very little strong
individuality. She possesses a simplicity and purity, that are attractive.
The rascality and double dealing of the political parties are exhibited with
life and humour, and are admirably contrasted with the downright honesty
and blind bigotry of Mouchy’s early career. The two last volumes seem to
be written without any other design than to lengthen out the hook, and to
increase the price. The scenes are without interest or connexion.
A lubricity
in morals, is a most glaring defect in the novels of Pigault Lebrun. In the
“Child of the Camaval,” the hero, notwithstanding his great love for a wife,
far above him in family and education, to whom he owed every thing, commits
various little infidelities which, in the bland narration |368 of our
author,
would seem to be the inevitable results of the frail temperament of human
nature. That human nature is frail, and that such things do occur, is too
true. True it is, too, that we lie and steal. But is an author, for this,
excusable in bringing forward these aberrations, and expressing them in such
smooth and pleasant phrases, as if, instead of being ashamed of our forgetfulness
of principle, we should comfort ourselves with viewing them as natural and
excusable consequences of our organization ?
TABLE
DES MATIÈRES
|
Préface
|
(de
l’éditeur, 2014)
|
3-5
|
|
Avis
|
(de
l’auteur, 1829)
|
9
|
|
CHAP.
XX.
|
Règlement
pour l’intérieur du ménage.
|
10-25
|
|
CHAP.
XXI.
|
Journée
des barricades,
et
autres événemens plus gais.
|
26-39
|
|
CHAP.
XXII.
|
Détails
de ménage. M. de la Tour est député aux États-Généraux.
|
40-67
|
|
CHAP.
XXIII.
|
Seconds
États de Blois. Assassinat du duc de Guise.
|
68-87
|
|
CHAP.
XXIV
|
Evénemens,
gais, tristes, affligeans. Grand procès, etc.
|
88-113
|
|
CHAP.
XXV.
|
La
Tour reçoit le coup le plus terrible, dont il pût être frappé.
|
114-137
|
|
CHAP.
XXVI.
|
Départ
pour la Suisse.
|
138-161
|
|
CHAP.
XXVII.
|
Suite
de notre voyage.
|
162-183
|
|
CHAP.
XXVIII.
|
Métamorphose,
partie de pêche, et autres événemens.
|
184-215
|
|
CHAP.
XXIX.
|
Les
Cretins. Le coup de tonnerre.
|
216-239
|
|
CHAP.
XXX.
|
Les
chamois. Histoire de Joseph.
|
240-261
|
|
CHAP.
XXXI.
|
Noces
de Joseph. Statistique du canton d’Uri.
|
262-277
|
|
CHAP.
XXXII.
|
La
troupe nomade entre dans le
|
|
|
canton
d’Appenzell.
|
278-287
|
|
CHAP,
XXXIII.
|
Grande
Catastrophe. Notre
|
|
|
emménagement.
|
288-307
|
|
CHAP.
XXXIV.
|
Usages,
jeux, travaux, bergers,
|
|
|
événemens.
|
308-331
|
|
CHAP.
XXXV.
|
Suite
de la vie de nos héros en
|
|
|
Suisse.
Nouvelles de France.
|
332-357
|
|
CHAP.
XXXVI
|
Voyage
au haut de l’Ebenalp.
|
358-383
|
|
CHAP.
XXXVII.
|
La
petite colonie gravit l’Ebenalp.
|
384-407
|
|
CHAP.
XXXVIII.
|
Les
alambics. Nouvelles de France.
|
408-420
|
|
CHAP.
XXXIX.
|
Dénouement
prévu.
|
408-420
|
|
Annexe
1
|
Revue
Encyclopédique.
|
408-420
|
|
Annexe
2
|
Journal
général.
|
421-425
|
|
Annexe
3
|
Mercure
de France.
|
421-425
|
|
Annexe
4
|
Ami
de la Religion.
|
421-425
|
|
Annexe
5
|
Southern
Review.
|
421-425
|
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE
n°12 (janvier 2015)
|
Préface
|
(de
l’éditeur, 2014)
|
5-12
|
|
Avis
|
(de
l’auteur, 1829)
|
14-15
|
|
CH.
XX.
|
Règlement
pour l’intérieur du ménage.
|
16-35
|
|
CH.
XXI.
|
Journée
des barricades, et autres événemens plus
|
|
|
gais.
|
36-58
|
|
CH.
XXII.
|
Détails
de ménage. M. de la Tour est député aux
|
|
|
États-Généraux.
|
60-86
|
|
CH.
XXIII.
|
Seconds
États de Blois. Assassinat du duc de
|
|
|
Guise.
|
88-111
|
|
CH.
XXIV
|
Evénemens,
gais, tristes, affligeans. Grand
|
|
|
procès,
etc.
|
112-136
|
|
CH.
XXV.
|
La
Tour reçoit le coup le plus terrible, dont il pût
|
|
|
être
frappé.
|
138-160
|
|
CH.
XXVI.
|
Départ
pour la Suisse.
|
162-187
|
|
CH.
XXVII.
|
Suite
de notre voyage.
|
188-213
|
|
CH.
XXVIII.
|
Métamorphose,
partie de pêche, et autres
|
|
|
événemens.
|
214-239
|
|
CH.
XXIX.
|
Les
Cretins. Le coup de tonnerre.
|
240-265
|
|
CH.
XXX.
|
Les
chamois. Histoire de Joseph.
|
266-295
|
|
CH.
XXXI.
|
Noces
de Joseph. Statistique du canton d’Uri.
|
296-327
|
|
CH.
XXXII.
|
La
troupe nomade entre dans le canton
|
|
|
d’Appenzell.
|
328-349
|
|
CH.
XXXIII.
|
Grande
Catastrophe. Notre emménagement.
|
350-375
|
|
CH.
XXXIV.
|
Usages,
jeux, travaux, bergers, événemens.
|
376-402
|
|
CH.
XXXV.
|
Suite
de la vie de nos héros en Suisse. Nouvelles
|
|
|
de
France.
|
404-423
|
|
CH.
XXXVI
|
Voyage
au haut de l’Ebenalp.
|
424-443
|
|
CH.
XXXVII.
|
La
petite colonie gravit l’Ebenalp.
|
444-461
|
|
CH.
XXXVIII.
|
Les
alambics. Nouvelles de France.
|
462-479
|
|
CH.
XXXIX.
|
Dénouement
prévu.
|
480-495
|
|
Annexe
1
|
Revue
Encyclopédique.
|
496-497
|
|
Annexe
2
|
Journal
général.
|
498
|
|
Annexe
3
|
Mercure
de France.
|
499-500
|
|
Annexe
4
|
Ami
de la Religion.
|
501-504
|
|
Annexe
5
|
Southern
Review.
|
505-506
|