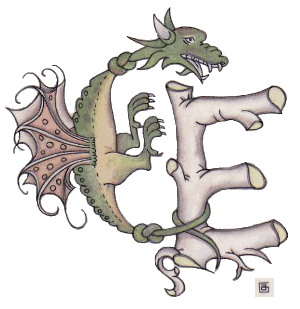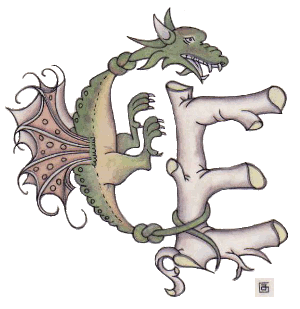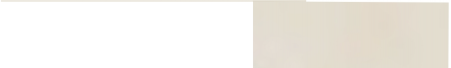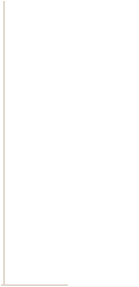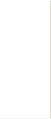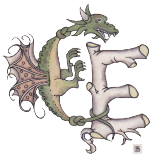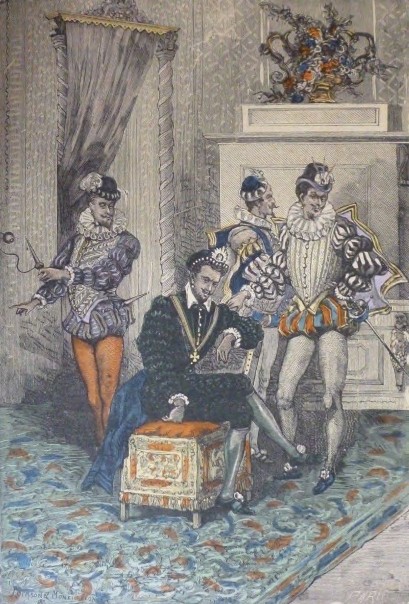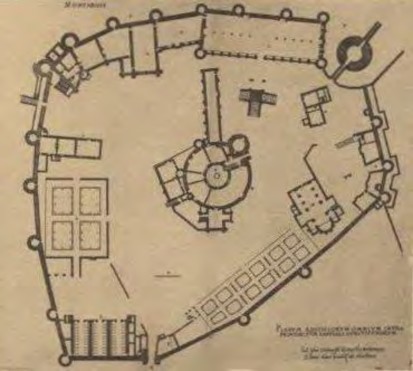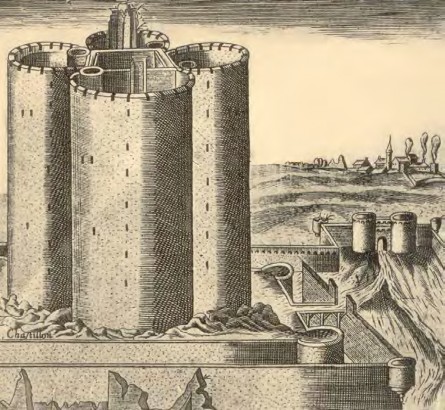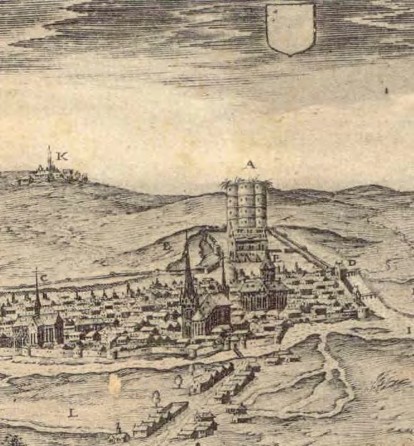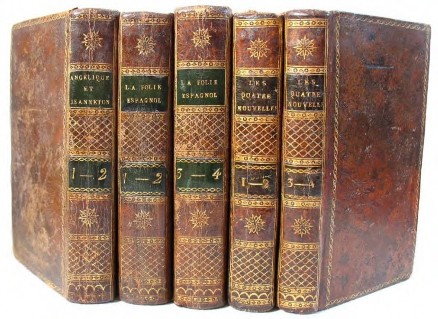|
BHASE n°9
(septembre 2014)
|
AVERTISSEMENT
|
Cette page est une simple
reversion automatique et inélégante au format html
d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne),
pour la commodité de certains internautes et usagers du Corpus Étampois.
|
|
La version authentique, originale et officielle de ce
numéro du BHASE est au format pdf
et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:
|
http://www.corpusetampois.com/bhase009w.pdf
|
|
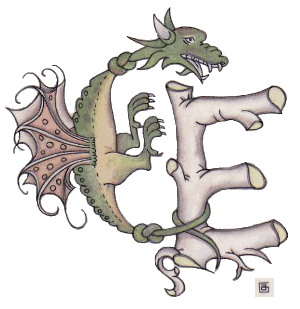
|
BHASE
n°9 (septembre 2014)
|
Préface
|
(de
l’éditeur, 2014)
|
3-5
|
|
Avis
|
(de
l’auteur, 1829)
|
9
|
|
CHAP.
Ier.
|
Mon héros
entre en scène.
|
10-25
|
|
CHAP.
II.
|
Antoine
la Mouche continue son voyage.
|
26-39
|
|
CHAP.
III.
|
Entrée
d’Antoine la Mouche à la
|
|
|
Rochelle.
|
40-67
|
|
CHAP.
IV.
|
Antoine
la Mouche et Colombe sortent de
|
|
|
la
Rochelle.
|
68-87
|
|
CHAP.
V.
|
Désespoir
et consolation de M. de la
|
|
|
Moucherie.
|
88-113
|
|
CHAP.
VI.
|
M.
de la Moucherie est ambassadeur
|
114-137
|
|
CHAP.
VII.
|
M.
de la Moucherie est introduit à la cour.
|
138-161
|
|
CHAP.
VIII.
|
Le
capitaine de la Moucherie éprouve un
|
|
|
grand
malheur.
|
162-183
|
|
CHAP.
IX.
|
Histoire
d’André.
|
184-215
|
|
CHAP.
X.
|
La
Moucherie est admis dans l’intimité
|
|
|
des
plénipotentiaires du roi.
|
216-239
|
|
CHAP.
XI.
|
Catastrophes
sur catastrophes.
|
240-261
|
|
CHAP.
XII.
|
Antoine
de Mouchy retrouve Colombe et
|
|
|
se
désespère.
|
262-277
|
|
CHAP.
XIII.
|
Suite
de la rencontre de Colombe.
|
278-287
|
|
CHAP,
XIV.
|
Départ
pour Étampes. André fait une
|
|
|
rencontre
imprévue.
|
288-307
|
|
CHAP.
XV.
|
Arrivée
de notre héros à Étampes
|
308-331
|
|
CHAP.
XVI.
|
M.
de la Tour fait un voyage.
|
332-357
|
|
CHAP.
XVII
|
Second
voyage à Limoges.
|
358-383
|
|
CHAP.
XVIII.
|
Un
évêque ligueur démasqué.
|
384-407
|
|
CHAP.
XIX.
|
Faction
des Seize. Second Voyage à
|
|
|
Paris.
|
408-420
|
|
Annexe
|
Gustave
Vapereau : « Pigault-Lebrun ».
|
421-425
|


Piuault-
el run

LA SAINTE LIGUE

ou:
es Aventures d'un Étampais pendant les Guerres d t Religion
BHASE
0°9 -'D

septembre
2014 CJlJ man
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE
n°9
Bulletin
historique et archéologique du Sud-Essonne
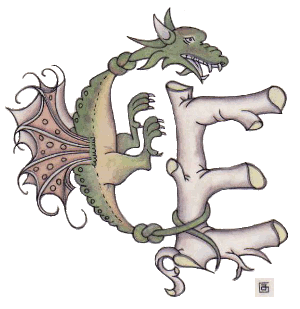
Publié
par le Corpus Étampois
septembre
2014
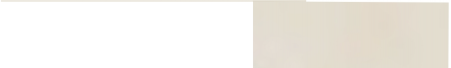
L
A

SAINTE
LIGUE.,
ou
LA
MOUCHE ,
POt;
.11 :..an u 06 SUl'I.G .\ U A:'<:\ .\ LBS DC f .lA.TISMF.1
IH:
1,4 S<J Pt:RSIITIO«
liT DB t. UYPOCD1Sl6,
PA R PIG.\.ULT-LEBRU
,
M
F. >1 11• n t; 1.1 S C t1i r i: P D l l.O l"f.C ll ll J1
•·
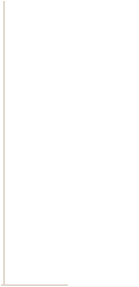

TOME PREMIER.

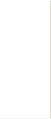

PA R I
S.
J
. N. B.\.RB A, ÉDITEU R ,
OA
tE RIJ! DE CD A nTfli3' DEBR U.BB LE '.flIÉATnll
f i.41iÇA JS.
G.-E.
B ARBA FILS, ÉD ITECR ,
i.
11 Oil 8Slll8, Il, 33.
t 829.
Préface
Voici
un roman de 1829. Son personnage principal est un Étampois dont les aventures
commencent en 1576, à la veille de la sixième guerre de Religion.
C’est
le tout dernier roman d’un auteur prolixe et célèbre en son temps, Charles-Antoine-Guillaume
Pigault de l’Épinoy, dit Pigault-Lebrun (1753-1835), dramaturge,
historien, essayiste et romancier. S’il est aujourd’hui oublié, il a pourtant
été estimé et lu avec plaisir par de grands auteurs comme Stendhal, Flaubert
et Paul Valéry. Qu’on se le dise.
Le titre
complet de ce récit plein de vivacité est : La Sainte- Ligue, ou la Mouche,
pour servir de suite aux Annales du fanatisme, de la superstition et de l’hypocrisie,
par Pigault- Lebrun, membre de la Société philotechnique1. Il a été publié à Paris en 1829 par Barba, en six
volumes. Nous réunissons ici les trois premiers de ces volumes en un seul
premier tome, et nous ne donnerons la deuxième moitié dans un prochain numéro
du BHASE.

1 La Société philotechnique est une
émanation ou une continuation, comme on voudra, de la Société polytechnique
fondée par Auguste Comte.
La
redécouverte de cette œuvre et son intégration à notre Musée virtuel du Pays
d’Étampes enchantera sans doute tous les amoureux du Sud-Essonne. Pour autant,
nous ne réclamerons pas à son auteur une rigoureuse exactitude en matière
d’histoire locale ; et nous n’accableront pas le lecteur à cet égard de notes
rectificatives aussi oiseuses que fastidieuses. Il ne s’agit que d’un
roman. Son sous-titre indique assez,
d’ailleurs,
qu’il s’insère dans une longue tradition, attestée dans le monde chrétien
dès le IIe siècle de notre
ère, celle du fabliau anti-clérical.
L’auteur
veut avant tout nous distraire, et nous ne lui en demanderons pas plus. Mais
si on veut absolument trouver aussi à cet ouvrage un intérêt documentaire,
on ne doit le considérer à cet égard que comme un document intéressant l’histoire
des mentalités au début du XIXe siècle.
Je n’en
prendrais ici qu’un exemple, celui du traitement que fait subir notre héros
étampois à un antique château dont il s’est porté acquéreur, du côté d’Arpajon2. Il a une fière idée, des plus ingénieuses, car tellement
en avance sur son temps : c’est de le démanteler entièrement pour en vendre
les pierres, le fer et le plomb. Ainsi pourra-t-il se bâtir une belle maison
bourgeoise à moindre frais.
Faut-il
dire rappeler que notre roman paraît en 1829 ? Ce n’est qu’en 1831 que Victor
Hugo publiera son Notre-Dame de Paris, qui fera beaucoup pour la redécouverte
du patrimoine médiéval alors en voie de disparition rapide, notamment à Étampes.
Ce roman pionnier contient entre autres une

2 Que l’auteur aurait dû appeler Châtres,
puisque Châtres ne prit qu’en 1720 le nom d’Arpajon.
description
du donjon étampois qu’on appelle Tour de Guinette ; description méritoire
mais très indigente, qui reflète bien l’état alors embryonnaire des connaissances
en la matière. Ce n’est qu’en 1836 que paraît la première étude d’histoire
locale étampoise qui s’intéresse un peu à son bâti ancien. Il s’agit des
Essais historiques de Maxime de Mont-Rond, dont l’auteur prendra ses
rêveries pour des réalités, et lancera une légende locale promise à un bel
avenir : celle des prétendus palais étampois des favorites royales Anne de
Pisseleu et Diane de Poitiers.
Pigault-Lebrun
s’est pris pour un véritable historien, sans doute, comme Voltaire ; il pense
aussi faire une bonne œuvre en donnant au public cette histoire d’une âme
étampoise, c’est-à- dire provinciale, qui progressivement se déniaise et
s’élève des ténèbres d’une piété naïve à la lumière éclatante des idées de
Voltaire et d’Auguste Comte.
Mais
ce qui continue de donner de l’intérêt à ce roman, après deux siècles, c’est
surtout la verve de son auteur, et sa bonne humeur. Voilà quelque chose d’éternellement
utile à notre pauvre espèce humaine.
Bernard
Gineste, septembre 2014
Pigault-Lebrun
LA SAINTE-LIGUE
ou
la Mouche, pour servir de suite
aux Annales
du fanatisme,
de la
superstition et de l’hypocrisie
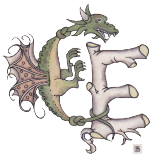
Corpus
Étampois
1829-2014

AVIS
AU LECTEUR,
introduction,
préface, ce que l’on voudra, et ce qui aura le mérite d’être court.
Je n’ai
jamais aimé les romans historiques ; je ne les crois propres qu’à égarer
le lecteur. Quelques soins que prennent les auteurs, ils offrent presque
toujours au public un mélange de fable et d’histoire plus que difficile à
démêler.
Tous
mes principaux personnages sont historiques ; ce que je leur fais faire d’essentiel
l’est aussi : tout cela se fond dans des fictions qui rendent la vérité méconnaissable.
Voilà un grand trait de ressemblance entre moi et mes devanciers ! Mais je
veux avoir sur eux l’avantage de la bonne foi. Voulez-vous connaître les
règnes de Henri III et de Henri IV ? consultez mon
libraire,
Barba ; il vous conseillera de lire mon Histoire de France3 ; il vous en garantira la
véracité et l’impartialité.

3 Histoire de France, depuis
le commencement de la monarchie jusqu’au règne d’Henry IV, inclusivement;
avec cette épigraphe : la vérité, toute la vérité, rien que la vérité
; par Pigault-Lebrun. 8 vol. in-8 de 600 pages chacun. Prix 48 francs
(note de l’auteur).

Colloque
de Poissy en 1561
CHAPITRE
PREMIER4.
Mon
héros entre en scène.
C’était
un homme bien recommandable, qu’Antoine de Mouchy ! Docteur de Sorbonne,
professeur de théologie, science positive comme les mathématiques ; chanoine
et grand pénitencier de Noyon, il parut avec éclat au concile de Trente,
qui dura dix-huit ans pour l’édification des fidèles ; il plaida au colloque
de Poissy, contre Théodore de Bèze, qui avait plus d’esprit que lui, et dont
la grâce le fit triompher ; il fut un des juges d’Anne du Bourg, qu’il eut
l’honneur de faire brûler vif. Ce coquin de conseiller au parlement était
fidèle au roi, et avait des opinions qui sentaient l’hérésie. Mouchy faisait
tout, et faisait, tout bien. Mais ce qui mit le comble à sa gloire, ce qui
doit faire passer son nom à la dernière postérité, c’est qu’il fut nommé
inquisiteur en France pour la foi. Avec quel zèle, quelle intelligence il
remplit ses augustes fonctions ! Ce fut lui qui créa cette classe d’hommes
si rusés, si adroits, si utiles, qui se

4 Je préviens les lecteurs que j’ai
mis en français moderne les mémoires de la Mouche (note de l’auteur).
répandaient
partout, et qui partout cherchaient des huguenots. Il suffisait qu’on trouvât
chez un particulier un livre qui ne fût pas approuvé de la Sorbonne, pour
qu’il fût livré à la sainte Inquisition. Ô le bon temps ! Le peuple français
a toujours aimé, dit-on, les allusions, les applications, et peut-être les
aimera-t-il long-temps. Il nomma mouches ou mouchards, du nom de Mouchy,
les hommes recommandables que l’inquisiteur employait contre les hérétiques.
Ces mouches étaient et sont encore honorés dans la proportion des services
éminens qu’ils rendent à la religion. Mais le Français est si léger, si changeant,
si peu réfléchi, qu’il est possible que ce titre honorifique devienne une
injure. Il me semble que, depuis la suppression de
l’inquisition
en France, les mouches passés5
au service du gouvernement ont perdu quelque chose de leur considération,
et cela est très-malheureux.
Antoine
de Mouchy avait toutes les qualités possibles, ainsi que nous venons de le
voir ; il avait même un point de ressemblance marquant avec les grands rois
David et Salomon. Perrette du Flos lui donna un descendant, auquel le modeste
Mouchy n’osa donner son nom, et à qui il fit prendre celui de sa mère.
La vérité
perce toujours, quelques efforts que fasse l’humilité pour la voiler. Jacques
du Flos avait à peine trois ans, que, lorsqu’il se promenait dans les rues
d’Étampes avec mademoiselle sa mère, on le saluait jusqu’à terre, pour honorer
dans sa petite personne les vertus éminentes de son auguste père. Pour comble
d’égards, et même de respect, on lui en donna le nom, et alors les dénominations
populaires se maintenaient en dépit des savans.

5 Sic (B.G.).
Antoine
de Mouchy sentait les avantages inappréciables de la science. C’est à sa
profonde érudition qu’il avait dû sa promotion à la dignité d’inquisiteur,
et il est beau de marcher l’égal des rois, et même de les diriger, sous des
formes polies, familières aux gens bien élevés.
David
avait désigné pour son successeur son fils et celui de Bethsabée ; ainsi
Antoine de Mouchy voyait dans son petit Jacques un prêtre futur, peut-être
un cardinal, pourquoi pas un pape ? L’ambition, quand elle est louable, est
un mérite de plus. À huit ans, Jacques savait un peu lire ; à douze, il commençait
à écrire ; à seize, il entendait assez bien le latin du bréviaire. Pour le
préparer à entrer dans les ordres, son père lui faisait inspirer, par un
vicaire de paroisse, une haine invétérée contre les huguenots. Jacques, pour
s’occuper d’une manière utile, et honorable à la fois, se fit mouche, en
attendant mieux.
Les
deux cinquièmes des habitans d’Étampes étaient huguenots. Depuis la paix
de Sens6 ils vivaient paisiblement,
ne se mêlaient pas des affaires des autres, et faisaient du bien quand l’occasion
se présentait. Leurs concitoyens les catholiques ne les persécutaient pas
; tolérance très-coupable sans doute ! Cependant on enlevait tous les
jours quelque
huguenot,
et Jacques fut soupçonné. On cessa de le saluer, et bientôt un bâton de bois
de cormier lui apprit qu’il est des vertus dangereuses. Il devait persévérer
dans sa louable conduite, et obtenir la couronne du martyre, que je souhaite
à tous mes lecteurs, si j’en ai ; mais le bois de cormier changea tout-à-fait
sa vocation.

6 Plus communément appelée Traité
d’Étigny ou Paix de Monsieur, cette paix toute provisoire mit
fin le 6 mai 1576 à la Cinquième guerre de religion (B.G.).
L’abbesse
d’un couvent de Visitandines d’Étampes7 se foula un poignet, en châtiant, un peu vigoureusement,
une de ses religieuses. Une malade de cette importance ne pouvait être traitée
par un frater ordinaire. On envoya la coche8 du monastère à Ambroise Paré, chirurgien célèbre, que
les rois Henri II et Charles IX s’étaient attaché, et qui était alors au
service
de Henri III.
Paré
guérit l’auguste malade, et Jacques pensa qu’il valait mieux soulager des
êtres souffrans, que les faire brûler, ce qui est rigoureusement vrai à l’égard
des catholiques, mais ce qui n’est pas admissible envers les huguenots. Il
est évident que cette opinion de Jacques était une hérésie prononcée ; mais
son respectable père ne le poursuivit pas. Je blâmerais sa faiblesse s’il
n’était pas mon aïeul. L’exemple d’Abraham et de Jephté eût pu l’entraîner
; mais sommes-nous toujours nous-mêmes ? D’ailleurs, c’est à cette faiblesse
que je dois l’existence, et je ne dois pas la condamner.
Jacques
fut étonné, confondu, émerveillé des talens d’Ambroise Paré. Il fit une cour
assidue à l’homme célèbre, pendant le traitement de madame l’abbesse. Il
avait une jolie figure, de l’esprit, de l’activité, et l’amour du travail.
Paré le prit avec lui, et le conduisit à Paris.
Après
quelques années d’application, Jacques coupait très- proprement un bras ou
une jambe. L’amour de la patrie parle toujours à un cœur bien placé. Jacques
revint à Étampes, et il y

7 Petit anachronisme : l’ordre des Visitandines,
fondé à Annecy par saint François de Sales et sainte Anne de Chantal en 1618,
ne pouvait pas avoir de couvent à Étampes au XVIe siècle (B.G.).
8 On trouve à la bibliothèque de l’Arsenal
des lettres de Henry IV à Gabrielle. Dans une de ces lettres, il lui dit
: Je vous enverrai ma coche (note de l’auteur).
fit
des cures merveilleuses, sans s’informer de quelle secte étaient
ses malades.
Il avait
vingt-deux ans, et le célibat, le plus pur des états sans doute, ne convient
pas toujours à cet âge. Il vit Madeleine Tournu, fille d’un apothicaire,
qui plaçait des remèdes de toute espèce avec une dextérité étonnante. Jacques
avait quelquefois besoin de son ministère, et le besoin rapproche les hommes.
Madeleine n’avait pas plus de goût pour le célibat que Jacques. L’apothicaire
fut flatté de l’alliance d’un chirurgien de mérite. Le mariage fut arrêté,
célébré, et cœtera.
La preuve
la plus certaine qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul, c’est que je
naquis juste neuf mois après la célébration du mariage. On me nomma Antoine
par respect pour la mémoire de mon vertueux grand-père.
Tout
homme est ambitieux, et Jacques voulait m’élever à la dignité de médecin.
Il s’occupa sans relâche de mon éducation temporelle. Madeleine formait mon
cœur à la piété la plus fervente, et elle réussit complètement. Mon père
se désolait de l’inutilité de ses efforts. Mon directeur spirituel s’en félicitait,
et me faisait avancer à pas de géant dans la carrière où Madeleine m’avait
lancé. Je ne voulais entendre parler ni de médecine, ni de médecin : mon
directeur me répétait sans cesse, que c’est tenter Dieu, que vouloir rendre
la santé à quelqu’un à qui il lui a plu de l’ôter.
Il trouvait
bon cependant que je susse lire, écrire et le latin. Ces connaissances, me
disait-il, sont indispensables pour arriver au sacerdoce. Je faisais des
progrès rapides, ma mère en pleurait de joie, mon père s’affligeait de la
répugnance que je marquais pour la médecine.
Il
me pressait avec la plus vive tendresse de modérer mon zèle pour la dévotion.
Il me rappelait la correction qu’il avait reçue, ce qui l’avait fait surnommer
la Mouche. Je n’avais pas plus de goût que lui pour le bois de cormier, et
je ne voulais servir de tous mes moyens, que l’église triomphante ; mais
je sentais un penchant irrésistible à me mêler des affaires des autres. Je
n’avais encore que six ans, et déjà j’avais brouillé la moitié des ménages
d’Étampes.
Je le
répète : la vérité perce tôt ou tard. La grande réputation de mon père, son
utilité m’avaient ouvert toutes les maisons d’Étampes. Je voyais tout, je
savais tout. Un de mes concitoyens, un savant, qui lisait et écrivait couramment,
s’enveloppa un jour avec un chiffon l’index de la main droite ; il faisait
des grimaces épouvantables, occasionnées, disait-il, par un mal blanc, et
il me pria d’écrire, sous sa dictée, un billet à sa femme, qu’il avait reléguée
à la campagne. Dès que je fus sorti, il compara mon écriture à celle d’une
lettre anonyme qu’il avait reçue un mois auparavant, et dont je fus convaincu
d’être l’auteur. Il revint sur certains détails qu’un jeune homme de mon
âge n’avait pu observer; il jugea que j’avais calomnié madame son épouse.
Il était jeune encore ; d’ailleurs, il trouva beau de rendre une justice
éclatante à l’innocence méconnue et persécutée. Il monta sur sa mule, alla
prendre sa femme au lieu de son exil, et la ramena triomphante dans sa maison.
Il ne
s’en tint pas là. Il assembla un comité secret des maris qui avaient sévi
contre leurs moitiés. Il leur soumit les pièces de conviction qu’il possédait.
Il fut décidé que j’étais un petit drôle, qui se faisait un malin plaisir
de semer la zizanie partout. Je n’ai qu’un mot à répondre à ces inculpations
vagues et insignifiantes : La tolérance coupable des catholiques
d’Étampes
envers leurs concitoyens huguenots, avait amené des mariages entre les membres
des deux cultes, et il est reconnu qu’une femme huguenote ne peut être que
la concubine d’un mari catholique. C’est l’avis de nos plus savans théologiens.
Il résulta
de tout ceci que bientôt chaque rue d’Étampes fut le théâtre de quelque fête
conjugale, et que la population de cette ville augmenta considérablement.
On prétend que c’est l’effet ordinaire des raccommodemens.
Cependant
on crut devoir prévenir de nouvelles brouilleries. On discuta long-temps
sur les moyens propres à réduire à l’inaction celui à qui l’on prodiguait
les épithètes les plus injurieuses, et qui, certes, ne les méritait pas.
Les plus emportés parlaient de renouveler la scène qui avait corrigé mon
père Jacques. Les plus modérés rappelaient les services éminens qu’il avait
rendus à la plupart des habitans, et s’étendaient sur ceux qu’il pouvait
rendre encore. On savait qu’il m’aimait tendrement, et le châtiment rigoureux
qu’on parlait de m’infliger pouvait le déterminer à s’éloigner de la ville.
On résolut de lui faire connaître ma conduite, et de le prier très- sérieusement
d’y mettre ordre.
En conséquence,
une députation se rendit chez Jacques. Je déjeûnais tranquillement entre
lui et ma mère Madeleine, lorsque ces messieurs parurent. Je prévis le coup
dont ils allaient me frapper; je me levai et je me disposais à sortir. On
m’enjoignit de rester.
Le récit
des députés fut long et très-circonstancié. Des larmes roulaient dans les
yeux de mon père ; la figure de ma mère était rayonnante ; Jacques supplia
mes accusateurs de me pardonner. Madeleine déclara qu’on n’avait aucun reproche
à me faire à
l’égard
des époux métis, et qu’à celui des autres je ne m’étais pas toujours trompé.
La fervente dévotion n’exclut pas la curiosité ; ma mère raconta certaines
particularités qui m’étaient inconnues, et dont j’eusse pu tirer un grand
parti. Elle voulait seulement justifier son fils, et elle amena une scène
de violence et de scandale. Je ne sais comment elle aurait fini, lorsque
mon directeur parut.
Madeleine
le mit, en peu de mots, au courant de ce qui se passait. Le révérend père
Boniface leva les yeux au ciel, et improvisa un discours superbe, qui me
déclarait une colonne naissante de la religion, moi qui n’avais pensé qu’à
m’amuser. Il ajouta qu’il allait instruire le révérendissime évêque, et la
Sorbonne des désordres de toute espèce qui régnaient dans Étampes ; que le
très-pieux roi Henri III ne manquerait pas d’y mettre ordre, et pour me
soustraire au ressentiment de mes
ennemis,
il me prit la main et me conduisit dans son couvent9.
Il me
présenta à son prieur comme une victime de la rage des Huguenots. Le prieur
m’embrassa très-paternellement, et il prononça, avec le père Boniface, que
je chanterais en fausset au lutrin, que j’apprendrais à jouer du serpent
et que je balayerais l’église, fonction très-propre à entretenir l’humilité
chrétienne. Il fut arrêté que ma mère seule, dont la ferveur était connue,
aurait la permission de me voir, une fois par semaine ; enfin le prieur,
homme très-instruit et très-éclairé, se chargea de me faire continuer mes
études.

9 L’auteur précise plus loin qu’il s’agissait
de celui des « franciscains d’Étampes » qu’on appelait en fait « cordeliers
», et qui se situait dans la rue qui porte encore aujourd’hui leur nom (B.G.).
En
attendant l’effet des menaces du père Boniface, les habitans d’Étampes se
vengèrent, ne pouvant faire mieux, en me surnommant la Mouche, nom qu’ils
avaient donné autrefois à mon père, et qui, je le crois, deviendra celui
de notre famille.
Jacques
se prononça hautement contre la manière illégale avec laquelle on lui avait
enlevé son fils ; il protesta contre le refus des religieux de l’admettre
auprès de moi. Cet éclat acheva de tout gâter. Le bailly intervint dans cette
affaire. Il fit publier, à son de trompe, toutes les ordonnances rendues
contre les Huguenots, depuis le règne de l’illustre François Ier jusqu’à nos
jours.
Les prisons s’ouvrirent, des procès s’instruisirent, le désordre et la terreur
régnèrent dans la ville, et tout cela, parce que j’avais écrit quelques billets
anonymes.
L’ordre
d’arrêter mon père qu’on appelait le complaisant des Huguenots, fut signé
et allait être exécuté. La providence veillait sur lui. Le bailly, mauvais
jurisconsulte, mais chasseur déterminé, poursuivait une compagnie de perdreaux,
pendant qu’un huissier se disposait à poursuivre mon père. Un vieux mousquet
creva dans les mains du magistrat, et lui enleva le pouce gauche. Le primò
mihi10 se fit entendre
alors. Le bailly remonta sur sa mule, rentra, au galop, dans Étampes, manda
l’huissier,
déchira l’ordre d’incarcérer mon père, et le fit prier, très-poliment, de
venir le panser.
Jacques
était sensible. Il oublia le mal que le bailly avait voulu lui faire. Il
le traita, et le guérit. Mais il jugea à propos de s’éloigner d’une ville,
ou il n’espérait plus trouver de repos, et où sa sûreté était sans cesse
compromise. Il alla porter à la Rochelle sa personne, ses talens, et les
bienfaits de son art. Ma

10 En latin : « D’abord pour moi » (B.G.).
mère
aimait tendrement son mari. Elle me raconta, en gémissant, la persécution
suscitée à mon père. Ses sanglots redoublaient, en me disant qu’il l’avait
méritée, et qu’il ne fallait plus compter sur sa rentrée dans la bonne voie,
depuis qu’il s’était enfermé dans une place forte, uniquement peuplée de
Huguenots.
Elle
convenait que son devoir lui imposait l’obligation de suivre un époux, qui
n’avait pas abjuré la foi de ses pères, Je pensais comme elle ; mais le révérend
prieur et le père Boniface nous firent aisément comprendre que nous devions
rompre tout pacte avec l’impiété. Jacques avait fait une jolie fortune pour
un particulier. Il était tout simple qu’elle fût confisquée. Mais la piété
de ma mère et la mienne arrêtèrent les bras vengeurs déjà levés sur notre
famille. Cependant, on déclara à Madeleine qu’il était indispensable qu’elle
expiât les erreurs de son mari, en faisant un don au couvent. Quelques sacs
furent enlevés de la maison paternelle, et déposés entre les mains du père
prieur. En reconnaissance de notre docilité, le bon père nous revêtit chacun
d’un scapulaire, et nous affilia à son ordre. Nous fûmes pénétrés d’un tel
honneur, et nous fîmes tous nos efforts pour nous en rendre dignes.
Le fameux
baron des Adrets11, célèbre par sa haine contre
les catholiques et par la manière infâme dont il traitait les saints religieux
qui tombaient entre ses mains, le baron fut chargé, par les Rochellois, de
traiter avec la grande reine Catherine de Médicis, qui levait des troupes
contre les huguenots. Mon père avait pris la liberté de le charger d’une
lettre pour ma mère et pour moi. Madeleine ne savait pas lire, quoiqu’elle
fût la fille

11 François de Beaumont (v. 1512-1587),
capitaine protestant reputé pour sa cruauté, passé au catholicisme en 1567
B.G.).
d’un
apothicaire. Elle porta sa lettre au père Boniface, qui la lut d’abord tout
bas, et qui daigna ensuite nous en donner communication.
La santé
de Jacques s’altérait sensiblement. Il entrevoyait la fin d’une carrière
orageuse. Le père Boniface remarqua, avec beaucoup de sagacité, que l’homme
le plus robuste doit dépérir lorsqu’il respire l’air empesté du calvinisme.
Mon père exprimait le désir de nous embrasser encore avant que de s’endormir
pour toujours.
« Pour
toujours, s’écria le père Boniface ! Saisissez-vous le vrai sens de cette
expression ? Les huguenots sont tous damnés irrémissiblement ; mais au moins
ils reconnaissent un Dieu. Pour toujours, signifie clairement que
l’homme meurt tout entier. Jacques est donc un athée, et il n’est pas de
supplice assez rigoureux pour punir, autant qu’ils le méritent, les scélérats
qui professent l’athéisme. » Ma mère pleurait ; mais pleine de respect pour
la décision du père Boniface, elle lui répondit par une profonde révérence.
Le soir elle envoya encore quelques sacs au couvent, afin qu’on priât pour
la conversion de son mari.
J’avais
vingt ans. Depuis long-temps je ne balayais plus l’église. J’étais devenu
un théologien consommé, et je disputais souvent avec le père-prieur, de manière
à l’embarrasser. Depuis long-temps je portais la robe respectable de novice.
Le digne père attendait un moment propice pour recevoir mes vœux. Il voulait
que ses religieux adoptassent, sans restriction, ses opinions théologiques,
et ce qu’il appelait mon indocilité retardait, de mois en mois, ma profession.
La
lettre de Jacques fit naître en moi des idées nouvelles. Je trouvais dans
nos livres des pères sacrifiant leurs enfans ; je n’y trouvais pas d’enfans
rebelles à leurs pères, qu’ils ne fussent plus ou moins sévèrement punis.
Le mien était bon catholique, et il me sembla qu’une expression qui lui était,
échappée, peut- être sans réflexion, ne m’autorisait pas à l’abandonner.
Et puis, on ne change pas son caractère. La vie d’un couvent est uniforme,
et ne fournissait aucun aliment à mon goût pour l’observation. Je résolus
de me rendre au vœu de mon père. Je me gardai bien d’en rien dire à notre
digne prieur ; il eût combattu mon dessein, par des prières, par des caresses,
plus puissantes que ses argumens, auxquels je n’aurais pas été embarrassé
de répondre.
Je mûris
mon projet pendant quelques jours, et bientôt je lui donnai une extension
dont je fus moi-même étonné. Je me persuadai que les erreurs funestes du
calvinisme ne tiendraient pas contre mon éloquence et la force de mes raisonnemens
; que je pouvais prétendre à l’honneur de l’amener les Rochellois au giron
de l’Eglise, et que mon nom passerait à la dernière postérité. Mon imagination
s’exalta. Je sortis du couvent sans prendre congé de personne ; mais je ne
voulus pas quitter Étampes sans embrasser ma mère. Elle fut étonnée de me
voir : depuis quatre ans, je n’avais pas passé la porte d’entrée de mon couvent.
Je lui fis part de mon projet, et je m’exprimai avec un enthousiasme entraînant.
Le père Boniface n’était pas là pour me combattre. Ma mère pleura de joie
en pensant à la conversion des Rochellois, et à leur soumission au grand
roi Henri III. Elle m’embrassa, me mouilla de ses larmes maternelles, glissa
un sac sous ma robe conventuelle, me bénit, et me promit de prier pour le
succès de ma sainte entreprise.
Me
voilà dans les champs, et j’ai le plaisir de promener des yeux, si longtemps
fixés sur quatre murs, à travers un horizon vaporeux, étendu, sur des terres
chargées de moissons, qui n’attendent que la faucille. Mes poumons se dilatent,
en respirant un air pur et toujours nouveau. Mon âme s’agrandit en contemplant
la nature ; elle adore son divin auteur.
Des
idées nobles, sublimes, viennent m’assaillir. Je m’assieds au pied d’un chêne
; je tire mon écritoire de poche, et je commence mon premier sermon. On écrit
facilement ce dont on est fortement pénétré. Je composais rapidement, le
temps s’écoulait, et je ne m’en apercevais pas. J’aurais, je crois, passé
la journée sous mon chêne. Un homme qui passa me tira de mon délire. Coquin
de moine, me dit-il en agitant un pesant gourdin. C’est un misérable huguenot,
me dis-je en moi-même. Il s’éloignait ; mais il avait éteint mon heureuse
inspiration. J’allais remettre mon sermon et mon écritoire dans ma poche.
Une jeune fille se présente devant moi. « Bon père, me dit-elle, il y a cinq
heures que vous êtes là : ma mère les a comptées. Vous devez avoir besoin
de prendre quelque chose. Voilà ce qu’elle vous envoie. » Ah, je vois bien,
me dis-je, que tous les catholiques sont frères. Pourquoi souffre-t-on qu’il
existe d’autres religions au monde ? Pourquoi n’extermine-t-on pas les mahométans,
les juifs, les chrétiens schismatiques, et surtout les huguenots, qui sans
cesse attaquent l’autorité de notre saint père le pape, et osent nier son
infaillibilité ? Cela viendra peut-être. Au reste, convertir les Rochellois,
c’est faire plus que les égorger : c’est assurer leur salut.
La jeune
fille avait déposé un panier à mes pieds. Je levais les yeux sur elle. Elle
était jolie ; elle me regardait avec intérêt, et je me hâtai de porter mes
regards vers la terre. Je devais faire
vœu
de chasteté, et je sentais que le démon n’a pas de moyens plus sûrs de nous
le faire rompre que de nous présenter une jolie fille. Nouveau saint Antoine,
je combattis et j’eus le bonheur de triompher. La victoire me coûta de longs
efforts, et elle en fut plus méritoire.
La petite
s’était assise auprès de moi ; elle me présentait alternativement du pain,
des fruits et du lait ; sa main passait et repassait sans cesse devant moi.
Cette main était brunie par le soleil ; elle était peut-être dure ; mais
je savais qu’elle appartenait à une fille jeune et jolie. Des sensations
nouvelles pour moi m’agitaient, me tourmentaient... Quel parti prendre
?... je me saisis du panier, j’en arrachai un morceau de pain bis, quelques
abricots, je me levai, et je continuai ma route sans regarder derrière moi.
L’air
me paraissait excessivement chaud, il me semblait que je respirais du feu.
Ma poitrine était gonflée, mes muscles tendus. J’invoquai mon patron, et
je découvris, sur la droite, un étang, que sans lui, je n’aurais pas aperçu.
J’y courus, je me déshabillai ; je cachai mon sac d’argent sous mes vêtemens,
et je me jetai dans l’eau ; je m’y plongeai jusqu’au cou. Bientôt mon sang
se rafraîchit ; je respirai un air doux ; je me r’habillai ; je marchai en
relisant ce que j’avais fait de mon sermon, et j’arrangeai dans ma tête une
péroraison, qui devait être d’un effet prodigieux.

Tour de
Brunehaut à Étampes sur la route de Paris

Jeune
paysanne française vers 1600 (recueil de Gaignières)
CHAPITRE
II.
Antoine
la Mouche continue son voyage.
Que
le monde me parut grand ! je n’étais jamais sorti d’Étampes, et il me sembla
que j’étais séparé de la Rochelle par l’immensité. Je n’étais pas habitué
à une marche soutenue ; j’éprouvais des douleurs dans les jambes, et le repas
que j’avais pris dans la journée, n’était pas propre à me donner des forces.
Cependant j’apercevais une ville dans l’éloignement, et cet aspect me donna
du courage. L’idée de la conversion des Rochellois suffisait d’ailleurs pour
me faire surmonter toutes les difficultés.
Que
l’homme est orgueilleux et petit à la fois ! je n’avais vu dans mon projet
qu’une gloire, peut-être trop mondaine. Mon patron me rappela, en ce moment,
à l’humilité dont je n’aurais jamais dû m’écarter. J’avais de l’argent, je
pouvais me procurer les alimens délicats qui abondaient dans mon couvent
d’Étampes. Mais où coucher ? il faudra que je demande l’hospitalité de porte
en porte. Tous les catholiques ne peuvent pas exercer cette vertu, qui illustra
nos anciens patriarches ; si je me présente dans la maison d’un huguenot,
je serai rudoyé, peut-être battu, il est évident que j’ai manqué de prévoyance.
Pourquoi
de bonnes âmes n’ont-elles pas eu l’idée d’élever de distance en distance,
des abris où le pauvre serait reçu gratis, et où les riches déposeraient
des offrandes qui défraieraient la maison ? cela viendra peut-être, avec
quelques modifications.
Mon
orgueil me fit sourire à mon nouveau plan d’amélioration, et je ne sentis
pas que le seul besoin d’un lit avait suffi pour me le suggérer. Que mon
patron me pardonne !
En faisant
ces réflexions, j’entrais, en boitant, dans la ville de Châteaudun. J’examinai
toutes les figures qui se présentaient dans les rues que je parcourais au
hasard; je voyais sur les unes de la bienveillance, et quelquefois de la
vénération. Je lisais sur les autres, le mépris, et même la haine.
J’appris,
en quelques instans, à distinguer les catholiques des huguenots. J’attendis
qu’un de mes frères passât, sous des vêtemens qui annonçassent l’opulence.
J’étais décidé à le prier de m’admettre chez lui... Oh ! mon patron, que
je vous remercie ! un religieux de notre ordre paraît au coin d’une rue ;
il m’aperçoit, me sourit, s’avance vers moi, me prend la main, et me demande
ce que je fais à Châteaudun. Je lui réponds avec le respect que doit un novice
à un profès. Je lui raconte, en peu de mots, mes grands projets, et je lui
fais connaître les moyens qui doivent en assurer le succès. Il me bénit,
me conduit à son couvent, et me présente à son prieur.
Le très-révérend
père jugea qu’il fallait d’abord satisfaire au plus pressant de mes besoins.
Les bons religieux avaient soupé depuis quelques heures ; mais le frère cuisinier
n’était jamais pris au dépourvu. Il me servit un repas très-substantiel.
Je fus conduit, après y avoir fait honneur, dans une cellule où on m’enferma
à clef, ce qui n’est pas dans les usages de notre
ordre
; mais je pensai qu’il pouvait y avoir quelque différence entre ceux d’Étampes
et de Châteaudun. D’ailleurs, le sommeil m’accablait, je me couchai, et je
m’endormis d’un sommeil profond.
Il était
grand jour, quand je m’éveillai. Au premier mouvement que je fis, deux frères
entrèrent dans ma cellule. Ils me dirent que le père prieur et le chapitre
assemblé m’attendaient, et voulaient avoir une conférence avec moi. Un des
frères prit mon sac d’argent, pour m’éviter, dit-il, la peine de le porter.
Autant
les figures de leurs révérences m’avaient marqué de bienveillance, la veille,
autant elles exprimaient de sévérité.
« Votre
nom, me demanda le père-prieur ? — Antoine de Mouchy, ou la Mouche. — Votre
âge ? — Vingt ans. — Depuis quand êtes-vous chez nos frères d’Étampes ? »
— Depuis quatre ans. — Et vous n’êtes pas encore profès ! Vous êtes donc
un mauvais sujet ? — Mon révérend père, je suis un pécheur, sans doute ;
le juste lui-même pèche, et l’orgueil est le péché que mon digne prieur me
reprochait tous les jours. Il m’avait instruit de ce que la théologie a de
plus sublime, et je disputais avec lui sur la grâce et ses effets ; je l’embarrassais
quelquefois, et… — Prenez garde, frère Antoine ; vous retombez encore dans
votre péché d’habitude. Un novice embarrasser son prieur !... Continuez votre
récit avec humilité.
« —
J’avoue, mon très-révérend père, que mon respectable prieur attendait, pour
recevoir mes vœux, que je m’humiliasse devant ses lumières, lorsque je formai
le projet d’aller convertir les Rochellois. — Vous allez donc à la Rochelle
? — Oui, mon très-révérend. — Et, sans doute, vous avez une obédience de
votre supérieur ? — Je confesse encore que je suis sorti du
couvent
clandestinement. — Ah, ah ! — J’ai été recevoir la bénédiction de ma mère,
je l’ai embrassée, et je suis parti.
« —
Dites-moi, jeune rebelle, quels sont les moyens que vous comptez employer
pour convertir les Rochellois ? » Je tirai de ma grande manche ce que j’avais
écrit de mon premier sermon ; je le lus avec la chaleur, la verve qui me
l’avaient inspiré. Je portais de temps en temps un œil furtif sur mon auditoire,
et je reconnus, avec une satisfaction bien naturelle, que je produisais le
plus grand effet.
« Je
vois avec un plaisir ineffable, me dit le père prieur, quand je cessai de
parler, que vous êtes appelé à l’apostolat. Cette éminente qualité me fait
renoncer au dessein que m’avaient inspiré vos premières réponses. Je voulais
punir un fugitif, et le faire réintégrer dans son couvent ; mais je réfléchis
qu’un novice est toujours le maître de se retirer ; qu’un novice qui débute
dans la carrière par un sermon, tel que celui que vous venez de nous lire,
a droit à la considération de tous les
franciscains12. Oui, frère Antoine, vous irez à la Rochelle ; vous
réussirez dans un dessein qu’on ne peut trop admirer, ou vous
obtiendrez
la palme du martyre. Dans l’un ou l’autre cas, vous ferez le plus grand honneur
à l’ordre. Que diront les jésuites, qui affectent de nous mépriser, quand
ils verront un enfant, qui n’a pas encore prononcé ses vœux, porter la lumière
dans une cité infectée du calvinisme, ou mourir pour la foi ?
« Je
n’ai plus qu’une question à vous adresser, frère Antoine. En sortant de votre
couvent, avez-vous passé par la cellule du père procureur ? Vous êtes-vous
arrêté devant sa caisse ? — Non, très-révérend père. — Jurez-le moi. — Je
le jure. — D’où

12 On disait alors « cordeliers » plutôt
que « franciscains » (B.G.).
vous
vient donc ce sac d’argent que voilà ? — C’est un don de ma mère. — Vous
savez que le mensonge est un péché capital.
— Je n’ai
jamais menti.
« —
Ecoutez-moi, mon très-cher frère. Le démon est rusé, et la chair est faible.
Un religieux de vingt ans ne doit pas avoir d’argent à sa disposition. Ce
sac restera dans nos mains, et vous n’en jouirez pas moins, pendant votre
voyage, de toutes les commodités de la vie. Je vous expédierai une obédience
pour nos prieurs de Vendôme, Tours, Chinon, Montcontour, Poitiers, Saint-Maixent
et Fontenai en Rohan. De cette dernière ville, vous vous rendrez à la Rochelle.
Vous y serez reçu par le baron de Biron, zélé catholique, qui y commande
pour le roi. Il vous verra avec plaisir, parce qu’il est le seul, dans cette
ville abominable, qui reconnaisse l’autorité du Saint-Père. Le roi voulait
lui donner des troupes ; mais les Rochellois ont exigé de leur maître légitime,
qu’il entrât seul dans leur enceinte, et tel était le malheur du temps, que
Charles IX fut contraint de souscrire à ce que lui prescrivirent ces rebelles.
« En
passant à Montcontour, vous visiterez le champ de bataille où notre grand
roi Henri III, duc d’Anjou alors, eut le bonheur de faire égorger cinq mille
huguenots, et de prendre leur artillerie, leurs bagages et leurs provisions
de bouche. Vous traverserez le champ de bataille à genoux, en rendant des
actions de grâces à Saint-François et à votre patron. Allons, mes frères,
descendons au réfectoire. »
On dîne
aussi bien chez les franciscains de Châteaudun que chez ceux d’Étampes. En
sortant de table, le révérend père prieur expédia mon obédience ; le frère
Mathurin me mit sur l’épaule une besace, qui renfermait les provisions nécessaires
pour me conduire jusqu’à Vendôme, et je me remis en route.
Je
répétais toutes les belles choses que le père prieur de Châteaudun m’avait
dites. Je ne regrettais pas mon argent : je n’en avais plus besoin. Ma mère
me l’avait donné pour le bien de la religion, et il allait être employé en
œuvres pies.
Je classais
dans ma tête, en marchant, les élémens de cette péroraison, dont j’attendais
des prodiges. Quelques heures après, je m’assis sur le revers d’un fossé,
et j’ouvris la besace du frère Mathurin. Quelle abondance, quelle recherche
dans les mets ! Une succulente volaille, une carpe frite, une tranche d’un
jambon rosé, des biscotins, et une bouteille de cet excellent vin que nous
devons aux révérends pères, possesseurs du Clos- Vougeot !
Je restai
stupéfait. Mille idées vinrent m’assaillir. Je pensai enfin que le prieur
de Châteaudun avait voulu me fournir l’occasion de combattre la gourmandise,
et je lui criai de cinq à six lieues, qu’il ne serait pas trompé dans ses
espérances. Je pris un morceau de pain, je l’arrosai, faute d’eau, d’un grand
verre de vin, et je commençai à écrire ma péroraison.
Je la
terminais à ma grande satisfaction, lorsqu’un malheureux, privé d’un bras,
et traînant une jambe, s’arrêta devant moi. Il regardait, avec concupiscence,
ces mets que j’avais étendus sur l’herbe, et que je dédaignais. « Prenez,
lui dis-je, prenez : tous les pauvres sont mes frères. » Il ne se le fit
pas dire deux fois.
Les
poches de son haut-de-chausses déchiré ne pouvaient contenir toutes ces provisions.
Il les arrangea dans ma besace que je lui abandonnai. « Quel dommage, dit-il
en s’éloignant, que ce petit frère ne soit pas calviniste ! il a une si belle
âme !
—
Ah ! coquin, m’écriai-je, tu n’es qu’un vil huguenot ! Le
frère
Antoine serait dupé par un suppôt du démon ! rends-moi ma besace, misérable.
»
Je courus
après lui. Il tira, de dessous son pourpoint, un second bras dont je ne soupçonnais
pas même l’existence, la jambe sur laquelle il se traînait se raffermit tout
à coup, et il m’allongea le plus vigoureux soufflet qu’un homme puisse recevoir.
Je lui présentai l’autre joue, et il me rit au nez. J’offris la cuisson de
ma joue à mon patron, et je continuai ma route.
Je fus
reçu à Vendôme comme un des flambeaux de l’ordre. Je fus fêté, caressé. Le
prieur commanda en mon honneur un gaudiolum13,
et je reconnus toutes ces marques de distinction, en lisant aux pères assemblés
le sermon que je venais de terminer.
Les
exclamations, les applaudissemens, les cris d’admiration me tournèrent la
tête. Le père prieur me pressa sur son cœur, m’embrassa tendrement, me fit
faire un demi-tour à droite, et me jeta dans les bras du sousprieur, ouverts
déjà pour me recevoir. Le sousprieur me fit passer dans ceux du père procureur,
et j’arrivai ainsi jusqu’au religieux qui fermait la file. Je me crus un
être presque surnaturel.
Le père
prieur s’écria qu’un homme comme moi ne pouvait être plus longtemps novice.
Il ordonna qu’on sonnât la cloche, et qu’on fît toutes les dispositions nécessaires
pour recevoir mes vœux. Je le priai humblement de m’entendre. Je lui dis
que je me croyais toujours sous la dépendance du prieur d’Étampes ; qu’il
ne m’avait pas mis au nombre des profès, parce que j’étais sujet au péché
d’orgueil ; que les éloges que je venais de

13 Petite fête claustrale (note de l’auteur).
recevoir
m’en avaient rendu coupable au plus éminent degré ; qu’enfin je me sentais
indigne de la faveur dont sa révérence de Vendôme voulait m’honorer.
Le prieur
insista. « Si vous mourez à la Rochelle, me dit-il, notre ordre ne pourra
pas vous compter parmi ses plus grands prédicateurs. Que dis-je, frère Antoine,
dès ce moment, vous êtes autant élevé au-dessus d’eux, que le cèdre du Liban
l’est au-dessus d’un roseau du Jourdain. » L’orgueil, malgré mes efforts,
s’empara encore de toutes mes facultés, et je déclarai d’un ton ferme que
je ne prononcerais mes vœux qu’aux pieds du révérend père prieur d’Étampes
; que je lui manquerais essentiellement en faisant profession entre les mains
d’un autre, lorsqu’il m’en avait jugé indigne. Les prières, les instances
ne purent m’ébranler. II. fallut bien me laisser partir novice. Je devais
l’être encore longtemps.
Tous
les matins, je trouvais la besace ; mais j’en réglais le contenu : je ne
voulais pas m’exposer à substanter un huguenot. Tous les jours, j’écrivais
quelque chose d’un sermon nouveau ; tous les soirs, les fêtes conventuelles
se renouvelaient, et je n’en étais pas plus humble. J’entrai dans la plaine
de Montcontour, et je me souvins de ce que m’avait prescrit le père prieur
de Châteaudun. J’usai mes chausses et ma robe ; l’épiderme de mes genoux
fut enlevé, et je persévérai dans mon pieux pèlerinage. La douleur augmenta
de minute en minute. Bientôt elle devint intolérable, et la faiblesse humaine
imposa silence au devoir. Je me relevai, en adressant à mon patron une oraison
jaculatoire.
Il crut,
dans sa bonté, devoir récompenser ma confiance et ma soumission. Un ossement
humain se présenta à mes pieds. Je le relevai et je le baisai avec
respect. Il avait nécessairement
appartenu
à un catholique, puisque mon patron me l’envoyait, et un catholique qui meurt
pour la bonne cause est nécessairement un grand saint.
J’arrivai
à Poitiers dans un état à faire pitié. Une partie de mes vêtemens et la peau
de mes genoux étaient en lambeaux. Je les touchais avec la relique que j’avais
trouvée, et mes douleurs ne se calmaient pas. Je la présentai, après l’avoir
baisée encore, au père prieur. Il la regarda attentivement, la tourna dans
tous les sens, et la jeta par la fenêtre. « C’est un os de mouton, me dit-il,
que vous m’avez apporté là. Gardez-vous, mon frère, de vous livrer à un zèle
exagéré. Vous fourniriez des armes contre nous aux incrédules, et surtout
aux huguenots. » Il sonna, un frère lay se présenta. « Frère Marc, mettez
des compresses d’eau-de-vie sur les genoux de ce jeune homme, donnez-lui
à souper et un lit. Demain matin, vous l’habillerez à neuf, et vous lui aiderez
à monter sur une de nos mules, qui le conduira à Saint-Maixent. »
Cette
froideur m’étonna et me blessa. Oh ! pensai-je, il ne connaît pas ces sermons,
qui m’ont valu tant d’éloges. Je vais l’entraîner, le séduire connue les
autres. Je tirai mon manuscrit et j’allais commencer ma lecture. Il le prit,
le parcourut rapidement et me le rendit en médisant : « De l’exagération,
toujours de l’exagération et quelquefois de l’hyperbole. » Oh ! oh ! pensai-je,
le révérend serait-il entaché d’hérésie ? Mon os de mouton l’avait indisposé
contre moi, et je ne savais pas encore qu’une prévention défavorable ne se
détruit presque jamais.
J’étais
humilié, très-humilié ; je me sentais dans les dispositions, où, depuis long-temps,
voulait me trouver le prieur d’Étampes. Elles pouvaient ne pas se soutenir,
et il me sembla que je devais profiter de ce moment heureux pour m’engager
à
jamais.
Je suppliai sa révérence de recevoir mes vœux. « Nous avons déjà trop d’énergumènes
dans l’ordre, me dit-il, et très- certainement je n’en augmenterai pas le
nombre. Allez à la Rochelle, et tâchez d’en revenir. » Très-décidément, pensai-je
eu mangeant un perdreau, le père prieur de Poitiers est un hérétique.
Tout
se passa comme l’avait prescrit sa révérence. Me voilà juché sur ma mule,
suivi par le frère Marc, qui chantait des cantiques à tue-tête, qui, de temps
en temps, s’humectait la poitrine d’un verre de bon vin, et qui bientôt s’égaya
à mes dépens : le valet devait être l’écho du maître.
Marc
entra dans notre couvent de Saint-Maixent, et j’attendis à la porte qu’il
lui plût de m’aider à descendre de ma mule. Sans doute, il avait reçu de
son prieur des instructions secrètes, qu’il remplissait en ce moment.
Il revint
bientôt, accompagné d’un frère, que suivaient quelques novices bien jeunes,
bien étourdis, qui éclatèrent de rire en voyant mes genoux chargés de bourrelets
de linge, et les grimaces que mes compresses d’eau-de-vie m’arrachaient par
intervalles. J’entendis, très-distinctement, l’un d’eux dire à l’autre :
C’est un fou, dit-on, et il en a bien l’air. Il est dur d’être persécuté
par ceux de son parti ; mais leurs railleries, leur haine même ne doivent
pas nous faire dévier de la bonne route. Je me sentais appelé à l’apostolat
; le digne prieur de Châteaudun me l’avait assuré, et certainement il se
connaissait mieux en hommes que le chef du couvent de Poitiers ; je le croyais
ainsi. J’offris à mon patron, pendant qu’on m’enlevait de dessus ma mule,
les nouvelles humiliations qui m’attendaient.
Je
ne vis ni le prieur, ni les profès de Saint-Maixent. Les frères lais s’emparèrent
de moi, pourvurent à tous mes besoins, pansèrent mes écorchures, me couchèrent
dans un assez bon lit, et me laissèrent la liberté de penser et de faire
ce que je voudrais. Je terminai un quatrième sermon, et je m’occupai de mon
pauvre père, que les fumées de l’orgueil avaient banni de ma mémoire. Ah
! pensai-je, il me reverra avec un extrême plaisir, et je lui consacrerai
tous les momens dont la prédication me permettra de disposer.
J’avais
lieu de croire que l’air empesté de la Rochelle étendait ses funestes effets
à vingt lieues à la ronde, et que les couvens de notre ordre, qui avoisinent
cette cité coupable, en étaient infectés. Si mon père, pensais-je, qui vit
au centre même de la contagion, en avait respiré les miasmes diaboliques
? Hé bien, je le ramènerai à la foi de ses pères, et par conséquent à la
vertu.
Le lendemain
on me jucha sur une autre mule, qui me porta à Fontenai en Rohan, où je ne
fus pas mieux reçu qu’à Saint- Maixent. Le soleil qui devait éclairer le
dernier jour de ma marche parut enfin, et ranima ma ferveur et mes espérances.
Je partis, et dès que nous aperçûmes les clochers de la Rochelle, le frère
qui me conduisait m’aida, tant bien que mal, à descendre de ma mule, m’offrit
deux béquilles, sauta sur ma monture, la tourna vers le point de notre départ,
et la mit au galop, en me souhaitant tous les succès que je pouvais désirer.
On ne
va pas vite quand on voyage sur deux béquilles. Je jugeai que je pouvais
être encore à deux lieues de la ville impie, et je sentais que je ne les
parcourrais pas en moins de quatre heures. La journée s’avançait, et je n’étais
pas sûr d’arriver avant la nuit. La besace des Franciscains n’a qu’une aune
de toile, et elle s’étend sur toute la surface de la France. J’ouvris
celle
que m’avait laissée mon dernier conducteur, et j’y puisai des forces et du
courage.
Je me
remis en marche, et il me sembla, à mesure, que j’approchais de la ville,
que l’air était réellement empoisonné. Était-ce une réalité, une illusion
? J’observais avec exactitude ; je faisais jouer mes poumons avec force,
et de temps en temps une odeur fétide me blessait l’odorat. Il n’y eut plus
moyen de douter. Je sentis facilement que la respiration de trente mille
huguenots ne pouvait manquer de produire de tels effets. Je purifierai cet
air-là, me disais-je en sautant sur mes béquilles. La difficulté était d’arriver.
Bientôt
je reconnus, sur les côtés du chemin, des lieux bas et humides. Le vent soufflait
du côté de la mer, et m’apportait directement des émanations marécageuses.
Cependant ce que je voyais n’était certainement pas des marais. Cette humidité
ne pouvait être produite que par les miasmes épais qui s’échappent des poitrines
des huguenots, et que leur poids précipite à peu de distance des murailles.
Ce raisonnement était simple et conforme aux lois de la physique.
Bientôt
les ténèbres couvrirent la ville sacrilège, et l’ombre commençait à s’étendre
autour de moi. Je ne voyais pas une maison, et il fallut me décider à passer
la nuit dans des herbages que faisait croître l’hérésie. Je trouvai, sur
le bord d’un de ces prétendus marais, des joncs élevés et parfaitement secs.
Je soupai de ce qui restait dans ma besace ; je me couchai, et je me trouvai
fort bien. Ce bien-être, me dis-je, est un piège du démon. Il veut que je
me pénètre pendant toute une nuit de cet air pestilentiel. Il oublie que
mon patron l’a vaincu, et je vais supplier Antoine d’écarter de moi tous
les dangers.
J’avais
à peine achevé ma prière, que le vent changea, et reporta sur la ville ces
miasmes que je redoutais tant. L’atmosphère se dégagea. L’air devint frais
et pur. Je m’endormis, avec confiance, au milieu de mes joncs, et je goûtai,
pendant toute la nuit, le repos des justes.

Un
médecin vers 1586
CHAPITRE
III.
Entrée
d’Antoine la Mouche à la Rochelle.
Le soleil
brillait du plus grand éclat quand je m’éveillai. Je me levai et je me remis
gaîment en route. Les idées les plus riantes et les plus sublimes s’offraient
à la fois à mon imagination. et cela devait être : l’heure de mon triomphe
approchait. Je parcourus, assez lestement, l’intervalle qui me séparait encore
des mécréans.
J’arrivai
sur les glacis de la place, et je me trouvai bientôt entre deux pièces de
canon. Un soldat s’avança vers moi en me menaçant de la pointe de sa pertuisane.
« Un moine à la Rochelle ! s’écria-t-il ; voilà du nouveau, par exemple.
Que veux-tu, coquin ? Je lui répondis humblement que j’étais dépêché vers
monseigneur le baron de Biron, gouverneur pour le roi à la Rochelle.
Il
appela la garde. L’officier qui la commandait m’interrogea. Mes réponses
ne lui parurent ni claires, ni assurées. En effet, je ne pouvais m’appuyer
que du conseil que m’avait donné le père prieur de Châteaudun. « Entre ici,
me dit l’officier. » Il me poussa dans le corps-de-garde, et me donna la
permission de m’asseoir sur un banc de bois.
Il envoya
chercher Jacques Henri, maire de la Rochelle, et le capitaine Lanoue, qui
commandait la force armée. En les attendant, je commençai l’exercice de l’apostolat.
Je lus un de mes sermons à la garde rassemblée autour de moi. La garde rit
beaucoup en m’écoutant, et j’en tirai un favorable augure : le rire n’annonce
ni la haine ni la colère, et il est facile de fixer l’attention de gens que
ces passions n’agitent pas. J’allais commencer ma péroraison, cette péroraison
qui avait électrisé mes auditoires de Tours et de Chinon, lorsque le maire
et le général parurent.
« Qu’est-ce
que cela signifie, dit le capitaine en fronçant le sourcil, et en relevant
sa moustache. Viens-tu faire ici le missionnaire ? Qu’on pende ce drôle-là.
Monseigneur, lui répondis-je, je suis prêt à recevoir la palme du martyre
; mais votre grandeur sait bien que pendre n’est pas répondre. — Tu fais
le raisonneur, je crois ! Soldats, exécutez mon ordre. »
Un moment,
capitaine, lui dit le maire. Le parti que vous proposez est le plus court,
sans doute ; mais je ne le crois pas le plus sage. — Comment, morbleu ! Avez-vous
oublié que le roi, alors duc d’Anjou, tira trente-cinq mille coups de canon
sur la Rochelle ; qu’il nous livra vingt-neuf assauts ; que le sang de nos
concitoyens, de leurs femmes, de leurs enfants, coula à flots sur les brèches,
et il y avait des moines dans l’armée catholique.
—
Je n’ai rien oublié de tout cela ; mais les esprits fermentent
en
France ; la reine Catherine lève des troupes ; elle n’attend qu’un prétexte
pour rallumer la guerre civile. Voulez-vous le lui fournir ? — Hé, qu’importe
à Catherine qu’il y ait en France un moine de plus ou de moins ? — Envisageons
cette affaire-ci sous son véritable point de vue. Ce moinillon demande à
remplir une mission, feinte ou véritable, auprès de Monseigneur de Biron.
Ce général est sans autorité dans la ville ; il est plutôt notre otage que
notre gouverneur ; mais ce titre lui a été conféré par le roi. Il représente
ici la majesté royale… — Il ne représente rien. — On croit le contraire à
la Cour. Pendre un homme qui lui est adressé, c’est vouloir exciter des murmures,
des plaintes, des clameurs dans Paris. La reine et les Guise nous accuseront
du crime de lèze-majesté ; on courra aux armes, et vous savez, capitaine,
que le jeune roi de Navarre et le prince de Condé ne sont pas en mesure de
soutenir la guerre. — Allons, allons, que l’on conduise ce drôle chez le
sire de Biron. D’ailleurs, il sera toujours temps de le pendre. »
Il est
évident que mon patron venait de me tirer du danger le plus imminent où un
missionnaire puisse être exposé. Je lui rendis grâces en marchant entre deux
files de soldats, et je respirai en entrant au palais de Monseigneur de Biron.
Je m’étais résigné à mourir martyr ; mais, toutes réflexions faites, je sentais
qu’il vaut autant utiliser sa vie que la perdre à vingt ans.
Mes
gardes me remirent entre les mains des gens de Monseigneur. Ceux-ci, qui
ne comprirent pas trop ce que je leur disais, me conduisirent au cabinet
de Monsieur son secrétaire, et me laissèrent avec lui.
Il écrivait,
et leva à peine les yeux sur moi. Il me fit signe de la main de m’asseoir,
et continua ses écritures. Me trompé-je,
ne
me trompé-je pas?... Est-ce bien lui, me disais-je ? Oh ! c’est lui ! Quatre
ans de séparation n’ont pu le rendre méconnaissable.... « Je te retrouve,
mon cher Poussif ! — Chut, chut ! Le baron m’a rencontré dans un voyage qu’il
a fait à Poitiers ; il m’a trouvé levant un plan pour Monsieur de Guise.
Il signe son nom assez passablement ; mais il écrit mal et très- incorrectement.
Il m’a proposé d’entrer chez lui en qualité de secrétaire ; j’ai accepté
en attendant mieux. Mon nom ne lui a pas paru assez sonore ni assez distingué
; il veut que tous ceux qui l’approchent soient gentilshommes ou le paraissent,
et il a décidé, dans sa sagesse, que je m’appellerais Monsieur de Poussanville.
Plus de Poussif, entends- tu ? Allons, embrassons- nous. »
Après
les premiers épanchemens, il me demanda ce qui s’était passé à Étampes depuis
qu’il avait quitté notre école commune. Je lui demandai des nouvelles de
mon père. Je lui racontai les belles choses que connaît déjà le lecteur.
Il m’apprit que la santé de mon père était très-languissante. « Tu veux donc
être moine, me dit-il ? — C’est mon unique ambition. —Imbécille ! Tes pères
de Saint-François sont, après les Capucins, les plus ineptes de nos moines.
Entre chez les Jésuites ; ils ont de l’esprit, de l’adresse ; ils sont riches
et puissans. À propos, as-tu déjeuné ? —J’allais t’en parler. »
Poussanville
appela, et me fit servir. Il reprend la parole pendant que je m’occupe à
me restaurer.
« Tes
novices de Saint-Maixent t’ont bien jugé. Tu veux convertir les Rochellois
! Ce projet est d’un fou. À la recommandation du baron, ils te permettront
de prêcher ; mais tu auras affaire à Théodore de Bèze, le plus éloquent de
leurs ministres. Si tu es battu, comme il y a lieu de le croire, tu seras
baffoué
; si tu as l’avantage, tu seras pendu : apprends que l’esprit de parti ne
pardonne jamais. Insensé ! Que t’importe tout cela ? Crois-tu que Catherine,
Guise, le roi de Navarre, le prince de Condé soient pénétrés des sentimens
qu’ils affectent? Ils soufflent le fanatisme sur les gens de leur parti ;
ils les enivrent pour les disposer à se faire tuer, selon leur bon plaisir.
Tu n’es toi-même, sans t’en douter, qu’un agent aveugle des Guise. »
On sent
bien que j’interrompis souvent le discours de M. de Poussanville par de fortes
exclamations. Il riait, et continuait de parler. Moi, je jugeai que mon ami
n’était d’aucune religion, et cette pensée m’arracha des larmes amères.
« Viens,
pleurnicheur, je vais te présenter au baron : tu as ici le plus grand besoin
d’un protecteur. Je te préviens que M. de Biron est fier, irascible, et qu’on
ne l’aborde qu’avec trois révérences, Suis-moi. »
Je marchai
sur les pas de M. de Poussanville. Je m’inclinai trois fois, et profondément,
devant le baron, dont tous les traits annonçaient l’orgueil. Je vis que mon
humilité le disposait favorablement en ma faveur. Cependant il resta assis,
et me laissa debout. Mon ami lui fit part des motifs qui m’amenaient à la
Rochelle, et il arrangea son récit avec beaucoup d’adresse.
« C’est
bien, c’est très-bien, dit le baron, j’aime beaucoup ce beau zèle. Vous prêcherez,
mon ami, j’en obtiendrai la permission du maire, et de Théodore de Bèze.
Cependant, je vous conseille de ne pas vous exposer dans les rues de la Rochelle
avant que j’aie arrangé votre affaire. Poussanville, vous le présenterez
à Madame la baronne. Elle aime beaucoup les moines, et vous la prierez, de
ma part, de mettre celui-ci au nombre des commensaux de sa maison. »
Je
serais tombé dans l’enchantement, dans l’extase, si je n’eusse remarqué des
signes d’intelligence entre le baron et Poussanville. Je saisis même un sourire,
qui vint expirer sur les lèvres de monseigneur. J’en conclus qu’il n’était
pas plus catholique que les grands dont mon ami m’avait parlé. Au surplus,
pensai-je, tant pis pour lui s’il croit que la religion ne soit faite que
pour le peuple. Je serai en sûreté dans ce palais, et je prêcherai, voilà
l’essentiel.
J’allais
suivre M. de Poussanville dans l’appartement de madame, lorsque le capitaine
Lanoue se présenta. Son air farouche, sa longue épée, et la manière dont
il me regarda me glacèrent le sang. « Cet homme, demanda-t-il au baron, a-t-il
près de vous, monseigneur, une mission directe, positive ? —Je ne puis convenir
de cela ; mais je dois vous assurer qu’il m’est recommandé… — Par quelqu’un
que votre grandeur ne connaît peut-être pas ? — Ou, qu’au moins je connais
assez imparfaitement. — Les choses étant ainsi, vous trouverez bon, monseigneur,
que je le fasse pendre. N’ai-je pas trouvé ce coquin-là prêchant la garde
du poste avancé ? Si on le laissait aller, il ferait de belles choses. Sa
mort satisfera aux mânes de nos frères, tués pendant le siège, et ce sera
un spectacle fort agréable pour les survivans... Allons, marche, maroufle.
»
Il
m’avait pris par une oreille, et la tirait de toutes ses forces.
« Un
moment, s’écria Poussanville. Il est fils de Jacques de Mouchy, dit la Mouche.
» Ces paroles firent sur le capitaine l’effet qu’eût produit la tête de Méduse.
Il lâcha mon oreille, me passa la main sous le menton, et prit un air tout-à-fait
caressant. Le fier baron me sourit avec noblesse, avec grâce. « Pourquoi,
M. de
Poussanville, ne m’avez-vous pas appris cela plutôt ? — Pourquoi, petit frère,
ne m’as-tu pas déclaré ton origine, quand
j’ai
voulu te faire accrocher par la garde ? Tu ne sais donc pas que la première
de toutes les vertus est d’être utile à ses semblables, et qu’on ne s’informe
pas quelle est la religion de celui qui soulage l’humanité souffrante ? Ton
père vaut mieux à lui seul, que tous les moines de l’Europe ensemble : il
a rendu l’usage de leurs membres à un grand nombre de Rochellois, blessés
pendant le siège, et qui se croyaient estropiés pour toujours. J’étais guéri
d’un coup de mousquet, qui m’avait percé la cuisse. Ma blessure se rouvrit,
lorsque ton père vint chercher ici un asile contre la rage monacale. Il m’a
guéri de nouveau, radicalement guéri. Voilà de ces choses qui ne s’oublient
jamais. Suis-moi, Frérot. Viens embrasser ton père. Instruis-toi près de
lui, et tâche de le valoir un jour. »
Je passais
de la mort à la vie, et ma tête n’était plus à moi. Les opinions opposées
aux miennes, que j’avais entendu émettre autour de moi, avaient brouillé
toutes mes idées. Je me souvenais seulement que je devais embrasser mon père,
et rendre la Rochelle au pape.
Le capitaine
avait passé mon bras sous le sien. C’est le fils de notre bon Jacques, disait-il
aux furieux, que mon costume rassemblait autour de nous, et ces quatre mots
les dispersaient à l’instant. Nous entrâmes dans une maison d’assez belle
apparence. Je trouvai mon père, très-souffrant lui-même, entouré de malades,
qu’il tâchait de soulager, et je me jetai dans ses bras.
Il n’était
pas prévenu de mon arrivée, et il s’évanouit. Ses malades oublièrent leurs
maux pour le secourir. Le farouche Lanoue aida à le déshabiller, et à le
mettre au lit. Moi, je priais mon patron de lui rendre la santé, et de me
maintenir dans les sublimes dispositions où j’étais en sortant d’Étampes.
Mon
père revint à lui. Mais la surprise, l’émotion, un attendrissement sans bornes,
avaient produit une crise qui acheva d’épuiser ses forces. Il expira dans
mes bras, en bénissant le moment où il m’avait revu.
« Coquin
de moine, me dit le capitaine, si tu n’avais pas infecté notre ville de
ta présence, notre bon Jacques vivrait encore ; il serait encore utile. Si
les Rochellois savaient que tu lui as donné la mort, ils te mettraient en
pièces. Je t’ai promis vie et sûreté, je tiendrai ma parole. Je te le prouve
en te dépouillant de ta jacquette, qui te ferait remarquer partout, et je
ne peux t’avoir toujours pendu à mon bras. » Il déchirait ma robe, il la
mettait en lambeaux. Une robe de franciscain ! Je voulus au moins sauver
mes sermons. Lanoue les jeta sur un brasier, où mon père faisait chauffer
ses médicamens, il n’y avait pas deux heures. Je voulus les arracher aux
flammes, Lanoue me prit par l’oreille, et m’envoya à l’autre bout de la chambre.
Il me
donna des vêtemens qui avaient appartenu à mon père. Il fallut bien que je
les prisse, puisque je n’en avais pas d’autres.
« Puissent-ils,
me dit le capitaine, te pénétrer des vertus que possédait ton père, et dont
tu as un si grand besoin. »
Il était
temps qu’il me rendît méconnaissable. Le maire, Théodore de Bèze, les ministres
du démon, ses confrères, les notables de la ville entrèrent, et témoignèrent
de vifs regrets de la perte qu’ils venaient de faire. Les pauvres se rassemblèrent
à la porte de la rue, et firent entendre de longs gémissemens. « Il les traitait
gratuitement, me dit le capitaine, avec l’argent que lui donnaient les riches.
Ah ! pensai-je, mon pauvre père est mort huguenot. Il est inutile que je
prie pour lui : il est perdu pour toute l’éternité.
Je
sortis d’une maison où tout était confusion et désordre. Le grand air me
rafraîchit la tête, et rétablit une certaine suite dans mes idées. Mes sermons
n’étaient plus qu’un peu de cendre. Je me voyais privé des moyens les plus
puissans de ramener les infidèles. Il me sembla que je n’avais rien de mieux
à faire que de sortir de cette ville impie, et de secouer contre elle la
poussière de mes souliers. Mais comment voyagerais-je ? mes genoux ne sont
pas tout à fait guéris, et le sac que m’a donné ma pieuse mère, est resté
entre les mains du prieur de Châteaudun. Si du moins j’avais encore ma robe,
elle intéresserait les fidèles en ma faveur. Je recevrais des secours abondans.
Mais je suis dépouillé de toutes mes ressources. Il faut retourner chez le
gouverneur ; cette maison est catholique, au moins en apparence, et je n’y
manquerai de rien, monseigneur l’a promis. Je pourrai y écrire de nouveaux
sermons ; je pourrai, au moins, argumenter avec Théodore de Bèze, et si je
persuade cet ange de ténèbres, il gagnera tous les autres. Je repris tristement
le chemin du Palais, et je montai chez Poussanville. Je lui fis part, en
gémissant, des égaremens de mon père, bien prouvés par l’attachement de tous
les huguenots. « Si je pouvais gémir de quelque chose, me dit-il, ce serait
de voir un fils condamner la mémoire de son père. Malheureux, sais-tu dans
quels sentimens il est mort ? Fût-il protestant, en a-t-il moins des droits
à ton affection et à ton respect ? Les hommes, d’ailleurs, ne sont-ils pas
frères, quoique leur croyance ne soit pas la même ? Le Ciel s’est-il prononcé
contre ceux que tu appelles huguenots ? La foudre tombe également sur les
églises et sur les temples. — De la tolérance ! de la tolérance ! Poussif,
la contagion t’a gagné. Tu es entaché
du
crime d’hérésie. O ! grand François Ier ! que ne pouvez-vous
renaître,
et exterminer jusqu’au dernier des huguenots ! — Tais- toi, imbécille furieux,
rappelle-toi les paroles que t’a adressées
le
général Lanoue : On ne s’informe pas quelle est la religion de celui qui
soulage l’humanité souffrante. Ces mots ne prouvent-ils pas que ton père
restait attaché au Catholicisme, et qu’il est mort dans la religion de ses
pères ? Je n’exige pas de toi que tu retournes auprès de ses restes inanimés.
Sa maison retentit des accens de la douleur et de la reconnaissance. Tu ne
manquerais pas de faire quelque scène qui finirait mal pour toi. Je te plains,
et ne veux pas te perdre. Je vais te présenter à madame la baronne ; mais
demain, tu suivras le convoi de ton père dans le silence et le recueillement.
— Tu veux que je paraisse dans les rangs de ces réprouvés ? — Tu le feras,
ou je déterminerai Monseigneur à te faire chasser de la ville. — Oh, grand
saint Antoine ! ô mon patron, inspirez-moi. — C’est moi qui t’inspirerai,
et je t’inspirerai bien. Marchons. »
Cet
homme si sévère me présenta à la baronne, avec les expressions les plus propres
à lui inspirer pour moi le plus vif intérêt. Elle vit en moi un pauvre religieux,
brûlant du zèle de la foi, et je venais, avec l’approbation de Monseigneur,
me mettre sous sa puissante protection.
Je retrouvai
là mes principes, mes précieuses habitudes, et même mon langage. Madame la
baronne, jeune encore, était pieuse comme la piété.
Ces
malheureux huguenots lui avaient refusé jusqu’à un chapelain. Elle s’était
arrangé un oratoire, où elle passait, avec ses femmes, la moitié des journées.
Elle m’y conduisit : j’en admirai l’arrangement. Mais.... ô surprise ! je
reconnus que Madame s’appelait Antoinette. Mon patron, et son compagnon fidèle
étaient suspendus devant son prie-dieu.
Elle
fut, de son côté, très-satisfaite d’apprendre que je me nommais Antoine,
que je chantais et que je savais jouer du serpent. Elle décida qu’à moi seul,
je serais sa musique de chapelle ; elle me chargea exclusivement de la
direction de l’oratoire, et elle me remit entre les mains d’une de ses femmes,
qui me combla d’égards, de prévenances, et qui me logea dans une chambre
très-commode et très-propre. J’ai toujours aimé la propreté et les commodités
de la vie.
Je ne
hais pas non plus la bonne chère, quand elle n’excite pas à l’intempérance.
Je dînai au milieu des dames suivantes, et je dînai bien. Il m’était impossible
de ne pas porter mes regards autour de moi. La demoiselle Colombe me parut
plus jolie que la petite paysanne qui m’avait apporté son déjeûner sur le
chemin d’Étampes à Châteaudun. Je baissai les yeux, jusque sur mon assiette
; mais comment les y fixer ? Mademoiselle Colombe m’offrait de tous les mets,
et il fallait bien la regarder pour lui répondre. Elle m’apprit qu’elle était
chargée de la lingerie de l’oratoire. Elle me dit que nous le décorerions
ensemble. « Non, Mademoiselle, m’écriai-je, non, très- certainement non.
» Mademoiselle Colombe me répondit par une grimace qui ne l’embellit pas,
et j’en fus fort aise. Je me tournai vers madame Claire, femme de cinquante
ans, que la petite vérole avait maltraitée, et je ne regardai plus qu’elle.
Madame
la baronne nous fit dire qu’elle nous attendait à l’oratoire. Je m’attachai
exclusivement à madame Claire, et je la priai de m’aider à marcher. Elle
s’informa, avec bonté, de ce qui me privait du libre usage de mes jambes.
Elle courut aussitôt chercher ce qui était nécessaire pour mon pansement.
Colombe lui demanda la permission de tenir l’assiette, avec un ton si doux,
qu’elle me mit en colère contre elle et contre moi.
«
Non, Mademoiselle, lui dis-je, vous ne la tiendrez pas. » Colombe me tourna
le dos, se rendit auprès de la baronne, et Claire me pansa avec autant d’adresse
que l’eût pu faire un bon chirurgien. Je ne savais pas que les femmes eussent
la main si légère et si douce. Je vis, avec plaisir, qu’il suffirait de quelques
jours, pour me guérir radicalement. Nous passâmes ensemble à l’oratoire.
Là, je racontai à madame la baronne comment j’avais perdu mes sermons. Je
lui demandai la permission de lui en réciter ce que me fournirait ma mémoire.
Elle me l’accorda avec une grâce toute particulière.
Quand
on récite de mémoire, il faut éviter les distractions. Je fixai mes yeux
au plancher qui était sur ma tête. Je parlai avec une facilité qui m’étonna.
Je parlai long-temps, et je retombai dans le péché d’orgueil : je voulus
voir quelles sensations j’avais produites. La baronne seule était restée
assise. Ses femmes m’écoutaient à genoux. Les yeux de Colombe étaient noyés
dans les larmes, et ne me paraissaient que plus dangereux. Elle me prenait
pour un saint, et elle avait tout ce qu’il fallait pour me damner.
Madame
la baronne me présenta sa main à baiser : c’est la plus grande marque
de satisfaction qu’elle pût me donner.
« Frère
Antoine, me dit-elle, il faut récrire ces sermons là ; il le faut absolument.
Je vous en prie, je vous l’ordonne même. Si ces gens-là ne vous permettent
pas de les prononcer, je les ferai imprimer, et répandre avec profusion dans
la ville ; il faut que la vérité triomphe enfin. » Le lendemain matin, Poussanville
me fit appeler : « Voilà, me dit-il, un paquet que le général Lanoue m’a
envoyé hier au soir. Il renferme toute la succession de ton père. » Nous
l’ouvrîmes : nous y trouvâmes quelques vêtemens à demi usés, un peu de linge
et vingt écus. Les pauvres avaient
empêché
mon bon père d’économiser. « Qu’il est triste, dis-je à Poussanville, qu’un
tel homme n’ait pas conservé ce zèle, cette ferveur, qui constituent le bon,
le véritable catholique ! — Va t’habiller, bavard, et viens me retrouver.
J’assisterai aux funérailles de ton père ; j’y représenterai le baron ; tu
te tiendras auprès de moi, et tu ne diras pas un mot, entends-tu ? »
Nous
partîmes. En approchant de la maison de mort, je ne pensai plus qu’à mon
père. Mes yeux se remplirent de larmes.
« Bien
! me dit Poussanville, bien ! Tu es né avec un bon cœur, et je retrouve mon
camarade d’école. »
C’est
un homme bien précieux qu’un bon chirurgien, à la suite d’un siège meurtrier.
On n’eût pu faire au général Lanoue des obsèques plus magnifiques que celles
qu’on avait préparées pour mon père. Les gens en place, les personnes les
plus recommandables de la ville suivaient immédiatement le cortège. J’étais
en tête du convoi avec Poussanville. Les pauvres fermaient la marche.
Théodore
de Bèze prononça sur la tombe un discours qui m’eût paru superbe, s’il n’eût
été tout à fait étranger aux opinions religieuses. Je crus devoir prononcer
à mon tour quelques mots d’une pieuse espérance en faveur du défunt. Je pris
la parole aussitôt que Théodore eut cessé de parler. Poussanville me donnait
des coups de coude, me marchait sur les pieds. J’avais, commencé une improvisation
très-orthodoxe ; rien ne pouvait plus m’arrêter.
L’effet
de mon discours fut terrible pour moi. Les grands avaient commencé par rire
; bientôt, le peuple entra en fureur. Je fus poussé, baffoué, couvert de
boue, chargé d’imprécations. Je fuyais, quand je pouvais m’échapper
des mains de ces
furieux,
et j’en retrouvais d’autres à qui on criait : C’est un catholique, c’est
un moine. Je rentrai au palais avec des vêtemens en lambeaux, glacé d’effroi,
et bien convaincu que les Rochellois étaient inaccessibles à la grâce. J’allai
me jeter dans l’oratoire. J’y voulais remercier mon patron de m’avoir conservé
la vie ; j’y trouvai mademoiselle Colombe, qui décorait de fleurs l’image
du grand saint Antoine.
Elle
fut frappée d’étonnement et d’effroi, en voyant l’état déplorable où m’avaient
réduit les huguenots. Elle me parla, elle m’interrogea. Je n’entendis que
des sons confus ; bientôt je perdis l’usage de mes sens.
Quand
je revins à moi, je me trouvai soulagé, soigné par Colombe. Elle n’avait
voulu, me dit-elle, partager avec personne le plaisir ineffable d’être utile
au frère Antoine. Elle avait été, dans ma chambre, prendre des habits, du
linge.
L’aiguière,
dans laquelle elle conservait les fleurs destinées à former des guirlandes,
servit aux ablutions, et j’allai, dans le coin le plus retiré de l’oratoire,
me dépouiller de mes guenilles et me vêtir d’une manière décente. Je me sentais
très-faible. Un déjeûner léger était auprès de Colombe. Elle me présentait
ce qu’elle avait de meilleur, et ce qu’elle croyait pouvoir me plaire. Les
plus jolies mains du monde passaient, repassaient sans cesse autour de moi,
et me touchaient souvent. J’étais pénétré de la reconnaissance que je lui
devais à tant de titres. J’arrêtai une de ses mains ; je fixai une charmante
figure de seize ans. Je voulus parler ; les paroles expirèrent sur mes lèvres.
Nous
nous regardions en silence. Colombe était rouge comme le feu ; j’étais retombé
dans l’état fatal où m’avait mis la jeune
fille
que j’avais rencontrée sur la route de Châteaudun, et il n’y avait pas d’étang
dans l’oratoire. Je tenais toujours cette main dangereuse. Tout à coup, je
fis un effort violent; j’entraînai Colombe auprès de l’image révérée de mon
patron. Je la fis tomber à genoux avec moi. « Demandons-lui, m’écriai-je,
la grâce de pouvoir surmonter la nature. — Qu’est-ce que la nature, frère
Antoine ? — Colombe, nous nous aimons. — Oh, je vous aime beaucoup, frère
Antoine. — Cet amour-là est un crime. — Il ne nuit à personne. — Il offense
le ciel. — Pourquoi donc m’a-t-il donné un cœur ? — Pour le vaincre, et lui
offrir nos souffrances. — Vous souffrez donc aussi, frère Antoine ? — Ne
le voyez-vous pas ? — Moi, je ne vois rien. — Colombe, vous avez toute votre
innocence ; conservez-la, et pour cela il n’est qu’un moyen. — Et lequel
? — Il faut éviter de nous voir, et surtout de nous parler. — Voilà donc
pourquoi, vous m’avez traitée durement ; voilà pourquoi toutes vos attentions
se portaient sur madame Claire ? — Madame Claire n’est pas dangereuse. —Je
commence à comprendre. — Colombe, jurons-nous d’être sans cesse sur nos gardes,
ou nous sommes perdus. — Comment perdus ! — Ma chère Colombe, je suis plus
âgé que vous ; j’ai plus d’expérience ; mais il est des choses que je ne
peux pas, que je ne dois pas vous expliquer. — Oh, parlez, frère Antoine,
je veux tout savoir. — Jurons, Colombe, jurons en présence de mon patron.
»
Madame
entra, suivie de ses autres femmes. Elle nous trouva à genoux, et nous marqua
de la satisfaction. Elle me félicita d’avoir pu m’échapper des mains des
huguenots : Poussanville lui avait tout appris. Je lui déclarai que je renonçais
au dessein de faire des conversions dans cette ville abominable. « Vous avez
raison, me dit-elle. Renonçons à des illusions flatteuses, qui ne peuvent
se réaliser. Nous prierons ensemble, et je vous
élève
au rang de mon sacristain. Colombe et vous soignerez l’oratoire. Vous y écrirez
des homélies, que nous entendrons avec attendrissement. »
Je frémissais
à l’idée du danger continuel où j’allais être exposé. Je périrai, pensai-je
; Colombe périra. Il faut fuir. Je ne peux encore marcher longtemps. Mais
j’ai vingt écus ; j’achèterai une mule, et, avec ce qui me restera, je gagnerai
un couvent de franciscains : ce sera pour moi le port du salut.
…..
Mais mes vingt écus, où sont-ils ? Je les avais ce matin dans ma bourse,
suspendue à ma ceinture. J’étais presque nud quand je suis rentré ici…. Les
misérables m’ont pris ou coupé ma bourse. Des huguenots doivent être des
voleurs.
Je ne
savais à quel parti m’arrêter. Je me décidai enfin à suivre madame, quand
elle sortirait de l’oratoire. Je lui peignis, en traits de feu, ma situation
et celle de Colombe, et je la suppliai, à genoux, de nous sauver tous deux.
« Voilà de la véritable vertu, s’écria-t-elle, ou il n’y en a pas au monde.
» Vous m’inspirez de la vénération pour l’ordre des franciscains. Vous resterez
à l’oratoire, et je chargerai Colombe d’autres fonctions.
— S’il
m’était permis, Madame, de fixer votre choix, je vous prierais de le faire
tomber sur madame Claire. » Elle sourit.
« Vous
aurez Claire, me dit-elle. De quel fardeau je me sentis déchargé !
Poussanville
me manda chez lui. Il me fit une mercuriale d’une âpreté, d’une sévérité
! « Si tu n’avais eu affaire qu’au général et au maire, ajouta-t-il, ils
se fussent bornés à se moquer de toi. Ils veulent faire de la Rochelle une
république indépendante, dont ils resteront les chefs. Ils n’ont pas de religion
; mais pour réus sir dans leur dessein, ils ont besoin du
peuple.
Il faut qu’il soit fanatique pour être soumis et ils n’ont pu se dispenser
de t’abandonner à sa fureur. Apprends à connaître les hommes et les choses,
et renonce à tes idées folles et exagérées. Je te le répète, fais-toi jésuite,
si tu persistes à vouloir être moine. J’entrevois le moment où ils joueront
un grand rôle dans l’Etat. — Le mien doit être tout d’humilité. — Imbécille!
tu n’es propre qu’à faire un moinillon. Retourne à ton oratoire. »
Je n’y
trouvai pas Colombe, et je soupirai. Madame Claire l’avait remplacée, et
elle ne me donnait pas de distractions. J’étais désœuvré, et je commençai
une homélie. La cloche nous appela pour dîner. Les femmes de la baronne me
regardaient en-dessous, d’un petit air moqueur. J’en conclus qu’elles n’étaient
pas aussi innocentes que madame le supposait. Colombe seule baissait les
yeux, rougissait et mangeait peu. J’avais voulu me placer sur la même ligne
qu’elle, pour être dispensé de la regarder. Ses compagnes l’avaient prévenue,
et s’étaient arrangées de manière à ce qu’elle fût vis-à-vis de moi.
Je ne
mangeais pas plus qu’elle. Nous avions tous les deux les yeux fixés sur notre
assiette. Notre silence, notre maintien, une excessive réserve qui pouvait
bien avoir quelque chose de ridicule, produisirent de ces mots qu’entendent
si bien ceux qui se les adressent, mais qui sont tellement équivoques, que
ceux dont on parle ne peuvent en paraître piqués. Je l’étais vivement, quoique
je me tusse. Colombe n’y comprenait rien.
Je ne
pouvais composer pendant toute la journée. Je me délassais en me livrant
à ces observations qui m’avaient fait surnommer la mouche à Étampes. Elles
tombèrent d’abord sur madame Claire, que je croyais aussi inaccessible à
la tentation,
que
peu faite pour en inspirer. Mais je ne pus m’empêcher de voir ce qui se passait
devant moi.
J’arrangeais
mon plan de vengeance, ce qui, je le confesse, était un grand péché, et j’avais
fermé les yeux : c’est le moyen d’être tout à .ses idées. Claire allait,
venait dans l’oratoire. Elle s’approchait de moi, s’en éloignait ; des mouvemens
d’impatience lui échappaient par intervalles. Je feignis de dormir, et j’entrouvris
mes paupières d’une manière imperceptible. « Dormez-vous, frère Antoine ?
» Je ne répondis pas un mot. Elle prit ma plume : madame la baronne et moi
étions les seuls qui en eussent dans ce quartier du palais. Claire avait
tiré un valet de trèfle de sa bourse : ce genre de papier-là n’est jamais
suspect. Elle écrivit, très-mal, mais de manière à être lue : A queu jeu
meu daiplé issy ! On n’est jamais prolixe quand on écrit comme cela. Elle
veut que son amant, l’enlève. C’est clair. Elle se lève, marche sur la pointe
du pied, et sort de l’oratoire. Ces précautions annonçaient nécessairement
des desseins secrets. Je me lève à mon tour, je la suis dans un long corridor
obscur, qui conduit à l’appartement du baron. Bientôt j’aperçois le jour,
et je reconnais un homme gros, court, mal bâti, qui se promène dans une vaste
salle, et qui étouffe des mots qui doivent ressembler à des juremens. Je
reconnais M. Olivier, l’écuyer de monseigneur, et je me tapis contre le mur.
Olivier prend le valet de trèfle des mains de Claire, et ses mains restent
dans les siennes. Claire n’avait parlé à table que de choses indifférentes,
et ce n’est pas elle que je voulais frapper. Cependant je désirais voir comment
cette scène finirait.
Cette
espèce de halle communiquait aux differens points du palais. Une, deux, trois
des femmes de madame arrivèrent, et les principaux domestiques de monseigneur
se présentèrent à
elles
avec toute la grâce dont ils étaient susceptibles. Oh, oh, pensai-je, voilà
un singulier hasard ! Tout le monde s’est donné rendez-vous à la même heure.
Je ne verrai rien : quand on est huit, on se possède nécessairement. Cependant
il est clair que le plus grand désordre règne dans cette maison. Ce qui le
prouve jusqu’à l’évidence, c’est que Colombe seule n’est pas présente à cette
scandaleuse réunion.
Quel
est mon devoir en cette circonstance délicate ? La piété de madame est solide,
éclairée. Elle ignore donc ce qui se passe chez elle. Elle me comble de bontés.
Je dois, je veux lui faire connaître le mal, afin qu’elle y apporte un prompt
remède.
Je retourne
vers le point d’où je suis parti. Des éclats de voix, des rires soutenus
me poursuivent. Ces gens-là, pensai-je, ont perdu toute espèce de pudeur
et de crainte. Ce tapage suffit pour qu’on les surprenne.
J’entrai
chez madame, et, rouge de colère, je lui racontai ce que je venais de voir
et d’entendre. « Asseyez-vous, frère Antoine, me dit-elle, et écoutez-moi.
Nos domestiques ne peuvent se promener dans la ville, sans s’exposer à des
scènes fâcheuses, quoiqu’ils portent la livrée du baron : ces méchans huguenots
ne respectent rien. Monseigneur s’est entendu avec le maire, et les marchands
de la ville nous apportent ici ce qui nous est nécessaire. L’intérêt leur
tient lieu de ce qu’ils appellent leur conscience.
« Cependant
nos gens ne peuvent passer les jours, les semaines, les mois dans une contrainte
perpétuelle. Nous avons résolu, monsieur le baron et moi, de leur abandonner,
tous les jours, pendant deux heures, la vaste salle où vous les avez vus.
Là, ils s’amusent comme ils l’entendent, et il me paraît difficile
qu’il
se passe quelque chose de répréhensible dans une réunion aussi nombreuse.
»
Elle
eût pu parler une heure encore, sans que je pensasse à l’interrompre : j’étais
stupéfait, anéanti. « Mais, Madame, repris-je d’un air timide et d’un ton
doux, ce valet de trèfle…
— Olivier profite des heures
de récréation pour apprendre à écrire à Claire, et peut-être veut-il enseigner
ce qu’il ne sait pas : il aurait cela de commun avec bien d’autres. Claire
a écrit sur ce valet de trèfle qu’elle s’ennuie à l’oratoire. Elle n’a pas
la patience de Colombe ; mais elle y restera, parce que vous le désirez,
et que je le veux. — Mais, Madame, pourquoi s’éloigner de moi furtivement
? — Vous avez feint de dormir, et elle a craint de vous éveiller, voilà tout.
— Ah, ah, ah !... ah !
Elle me laissa pousser
tous mes ah ! et elle reprit ainsi :
« Cependant,
frère Antoine, cette réunion d’hommes et de femmes dont vous ne connaissiez
pas les motifs, vous a blessé, et j’en conclus qu’elle n’est pas dans les
convenances. À l’avenir, mes femmes auront une chambre particulière et les
hommes une autre. Je vais en faire la proposition à monseigneur. »
Je rentrai
à l’oratoire, très-satisfait de ce que je venais de faire. Ah ! vous me raillez,
Mesdames, vous persiflez l’innocente Colombe ! hé bien ! vous n’aurez plus
de communications avec personne, et cette punition est beaucoup plus douce
que celle que je voulais vous faire infliger.
Je me
frottais les mains avec une satisfaction inexprimable, lorsque mes yeux se
portèrent sur l’image de mon patron. Il semblait me reprocher ma conduite,
et, en effet, elle n’était pas innocente. Je lui demandai pardon, en continuant
de me frotter
les
mains, et je sentis que la dévotion et la vengeance ne sont pas inconciliables.
Madame
entra, suivie de ses femmes. Elles avaient l’air consternées. Bon, pensais-je,
elles n’auront plus de relation avec aucun homme. Madame a parlé ; monseigneur
a adopté ses idées de décence, et déjà les ordres sont donnés. Oh, comme
elles vont s’ennuyer !
Madame
me demanda une homélie. J’obéis. Colombe s’était placée à mes pieds ; elle
me donnait des distractions, de ces distractions qui enlèvent entièrement
un homme à ce qu’il fait. Je lisais mal, très-mal, je le sentais. Une des
femmes de madame toussa avec force ; une autre renversa un candélabre ; la
baronne prit un air sévère, et promena autour d’elle des yeux menacans. Le
calme se rétablit ; mais Colombe était là. Je me conduisais comme un sot.
Je le sentais.
Olivier
entra fort à propos. « Madame, dit-il, monseigneur demande le frère Antoine.
» Je me levai précipitamment ; je suivis l’écuyer, et je lui savais très-bon
gré de m’avoir tiré de l’embarras extraordinaire où j’étais.
Le baron
était assis dans son grand fauteuil. Son air et son maintien étaient menaçans.
« Frère, me dit-il, je suis très- attaché à madame : je ne la contredirai
jamais, surtout pour une chose aussi simple que l’ordre qu’elle veut établir
dans sa maison. Mais je trouve mauvais, très-mauvais que vous cherchiez à
vous emparer de son esprit ; que vous vous érigiez chez moi en manière de
directeur ; que vous abusiez de votre ascendant pour porter madame à me demander
des choses qui ne me sont pas agréables. C’est tout au plus ce que se permettrait
un jésuite. Hé ! qu’êtes-vous qu’un vermisseau, à
qui
j’ai accordé un asile, à la demande de M. de Poussanville, qui m’est très-utile,
et que je considère beaucoup. Je vous préviens, qu’au premier acte d’autorité
que vous exercerez sous le nom de madame, je vous ferai faire une jacquette,
ses accessoires, et que je vous ferai jeter, par mes gens, dans les rues
de la Rochelle. Olivier, conduisez-le chez M. de Poussanville. »
« Oh
! oh ! me disait Olivier, en me conduisant, vous avez cru que madame ne vous
nommerait pas à monseigneur, et c’est sur vos observations qu’elle a motivé
sa demande de réforme. Tenez-vous bien, mon frère. »
« Hé
bien ! me dit Poussanville, tu feras donc toujours des sottises. Tu ameutes
toute une ville contre toi, et ne sachant plus que faire, tu bouleverses
la maison de monseigneur. Je me suis attaché à toi dès ton enfance, quoique
je fusse plus âgé de quelques années. Tu avais de la gentillesse, de la docilité,
et je me plaisais à te faire répéter les leçons que tu recevais de nos maîtres.
On s’attache par les services qu’on rend, et voilà pourquoi je t’ai revu
avec plaisir ; mais je ne croyais pas accueillir un brouillon fanatique.
Tu t’es mis au plus mal avec monseigneur et tous les gens de la maison. Comment
diable as- tu imaginé de les faire vivre comme s’ils avaient fait vœu de
chasteté ? — Ils ne sont donc pas chastes ! — Je ne le crois pas. Il y a
des cabinets qui aboutissent à la salle où tu les as vus. — J’ai donc eu
raison de parler à madame comme je l’ai fait. — Tu as eu tort. Un petit novice
franciscain s’ériger en réformateur de l’espèce humaine ! Cela fait pitié.
Prends les hommes comme ils sont ; laisse-leur faire ce qui leur convient,
et évite soigneusement de te faire des ennemis, toi, qui as besoin de tout
le monde. Voilà le dernier conseil que j’ai à te
donner.
Si tu t’en écartes, je t’abandonnerai à ton sort. J’ai à travailler. Laisse-moi.
»
Transiger
avec sa conscience, pensai-je en retournant chez madame, est faction d’un
lâche ; c’est tout au plus ce que se permettrait un huguenot. Je poursuivrai
le vice et l’hérésie sous quelque forme qu’ils se présentent à moi, Cependant,
monseigneur et Poussanville ne me paraissent pas être dans des sentimens
très-orthodoxes, et je ne peux m’élever contre eux.... Et puis cette petite
Colombe !... Il me semble que je perds chaque jour quelque chose de mon goût
pour la vie monastique. Ah ! je le sens, la chasteté est une vertu bien difficile
à pratiquer. Je me maintiendrai, moi, dans la bonne route, et je plaindrai
simplement ceux qui s’en écarteront. Poussanville a raison : je ne me mêlerai
plus de rien.
Cette
résolution fut prise un peu tard. On descendit pour souper. Claire, en sa
qualité d’aînée, faisait les honneurs de la table, et jusque-là elle n’avait
pas manqué de m’offrir le meilleur morceau. Elle servit toutes ses compagnes,
et remit le premier plat sur la table. On ne disait mot; on soupait, et on
ne s’occupait pas plus de moi que si j’eusse été à Étampes. Colombe me regarda
d’un air affligé, et me passa une volaille.
« Mangez,
Mademoiselle, lui dit Claire, et ne vous mêlez pas du service. » Elle reprit
le plat et voulut le remettre à sa place. Je lui abandonnai le vase, et je
mis le poulet sur mon assiette : je voulais souper aussi.
Un murmure
général s’éleva contre ma pauvre petite Colombe. Des femmes qui ont résolu
de ne pas parler, et qui rompent le silence, ne s’arrêtent plus. « Nous ne
sommes pas faites, pour le servir, disait l’une ; qu’il se serve lui-même,
disait l’autre. » Toutes s’élevaient contre l’officieuse Colombe.
Elles
lui reprochaient d’oublier la dignité de son sexe, pour faire la cour au
favori. Colombe ne répondait rien, et pleurait. Ce spectacle m’exaspéra.
Je sentis que j’allais faire une scène ; mais une scène !... Je pris mon
poulet, une bouteille de vin, et je sortis. Je gagnai ma chambre, poursuivi
par les larmes de Colombe, lorsque je rencontrai madame. Ce poulet, cette
bouteille, les mouvemens convulsifs de ma figure la frappèrent, l’arrêtèrent.
Elle m’interrogea, et je ne pouvais mentir à madame. Je lui racontai ce qui
venait de se passer. Elle me conduisit dans son appartement. « Frère Antoine,
me dit-elle, votre piété solide, vos vertus m’ont touchée. Mais je commence
à sentir que ces vertus sont plutôt celles d’un solitaire que d’un religieux
destiné à vivre avec les hommes. Cependant si nous étions au centre de la
France, je ne balancerais pas à leur sacrifier toutes mes femmes. Mais comment
les remplacerais-je ici ? Me voilà réduite à opter entre elles et vous, et
il faut que je sois servie. D’ailleurs, personne ne m’habillerait avec autant
d’adresse et d’élégance que Claire ; personne ne donnerait à mes cheveux
la tournure et la grâce que leur fait prendre Félicité. Je ne vois personne
; mais à mon âge la toilette est un besoin de première nécessité. — J’entends,
Madame, vous me chassez. — Non, frère Antoine, je ne vous chasse pas ; je
vous prie de vous retirer. Je vous ferai donner une mule et de l’argent.
Si, plus tard, je peux vous être utile, je le ferai avec un extrême plaisir.
» Triste, abattu, je m’enfermai dans ma chambre. Je croyais madame à l’abri
des séductions du monde, me disais-je, et elle m’a sacrifié à sa vanité !
Serait-il vrai qu’il ne peut exister d’être complètement vertueux ? moi-même,
de quoi m’occupé-je exclusivement ? une jeune fille s’est emparée de toutes
mes facultés. Je ne vis, je ne respire que pour elle. Hier, de toute la journée,
je n’ai pas adressé un mot à mon patron.
J’étais
couché ; je ne dormais pas. De tristes réflexions m’agitaient, me tourmentaient.
J’entendis frapper bien doucement à ma porte. « Qui est là ? — C’est moi,
me répondit une voix douce, entrecoupée par des sanglots. Vous partez demain,
frère Antoine ; madame a donné ses ordres. Je ne veux pas me séparer de vous,
sans vous dire un dernier, un éternel adieu. Ouvrez, mon frère, à votre Colombe.
— Si je vous ouvre, Colombe, vous ne sortirez plus, et je n’aurai pas la
force de vous renvoyer. —Ne vous suis-je pas soumise, frère Antoine ? Je
sortirai dès que vous l’exigerez. » Je prévoyais toutes les conséquences
d’une pareille entrevue. Cependant je fus faible, et j’ouvris.
Colombe
était à peine entrée, que des clameurs frappèrent mon oreille. Une clarté
de flambeaux se répandit dans le corridor. « Le voilà, le voilà cet homme
qui porte la vertu jusqu’au rigorisme, et qui reçoit une jeune fille chez
lui ! La voilà, cette innocente Colombe, qui vient chercher un homme jusques
dans sa chambre à coucher ! Les voilà, en tête-à-tête, au milieu de la nuit
! » C’était Claire, c’était Félicité. Elles avaient épié Colombe ; elles
l’avaient suivie. Elles avaient été éveiller madame ; madame ne pouvait croire
à ce qu’elles lui disaient. Cependant elle s’était enveloppée dans une robe
de chambre, décidée à confondre la calomnie, ou à se laisser aller à toute
sa sévérité.
Les
faits parlaient contre Colombe et contre moi. Nous protestâmes en vain de
notre innocence. Je conviens de bonne foi qu’il était impossible que madame
y crût. « Hypocrite, me dit-elle, c’était donc pour éloigner toute espèce
de soupçon, pour me plonger dans une sécurité absolue et aveugle, que vous
m’avez suppliée de vous séparer de Colombe ? Elle était déjà
séduite.
On la croyait ici pure comme l’innocence, et la petite fourbe affectait de
dédaigner les jeux innocens de ses compagnes, pour assurer ses plaisirs clandestins
et coupables. Eloignez-vous de cette chambre, Mademoiselle, et à la pointe
du jour, vous sortirez tous deux de la Rochelle.
Je restai
seul. Ainsi, me disais-je, les hommes jugent donc sur les apparences ! Nous
sommes condamnés, Colombe et moi, et le vice triomphe.

Jeune
noble française (recueil de Gaignières)

Reître
et gendarme
CHAPITRE
IV.
Antoine
la Mouche et Colombe sortent de la Rochelle.
Dès
la pointe du jour tout était en mouvement dans le palais. Le premier individu
que je rencontrai fut Olivier. « Votre mule vous attend, me dit-il, et voilà
une bourse que madame vous donne. Allez, mon ami, et souvenez-vous qu’il
ne faut jamais se mêler des affaires d’autrui. » Le second personnage qui
se présenta à moi fut monseigneur. Il passa, en me riant an nez et en levant
les épaules. Poussanville allait, venait, et s’arrêta devant moi. « Une partie
de mes prédictions s’est accomplie, me dit-il. Au reste, tu n’es pas à plaindre.
On te donne une très- jolie fille, de l’argent et une bonne mule. C’est plus
que tu ne pouvais espérer en entrant dans cette ville. Prends mon épée. Si
tu es attaqué en route, tu te défendras mieux avec cela qu’avec ton chapelet.
« Nous
te suivrons de près. Le général Lanoue nous a envoyé, à minuit, l’ordre de
sortir de la Rochelle dans les vingt-quatre heures. — Bah ! — Je n’ai
pas trop le temps de causer.
Cependant
il est possible que nous ne nous revoyions jamais, et je veux te donner une
dernière leçon. » Il me conduisit dans son cabinet.
« Le
cardinal de Lorraine, oncle des Guise actuels, avait formé le plan d’une
congrégation générale des catholiques. Henri de Guise vient de l’exécuter.
Il a formé cette association pour protéger, dit-il, la religion, le roi,
et l’indépendance de l’Etat. Il a donné à cette ligue le nom de sainte14. Combien de fois on a conspiré à la faveur de ce mot
révéré !
« Le
pape et le roi d’Espagne applaudissent ouvertement à cette institution, et
la favorisent de tout leur pouvoir. Je te parle là de choses dont tu n’as
aucune connaissance ; mais cette exposition me conduira naturellement aux
documens que j’ai à te donner.
« Guise
affecte un grand attachement pour le roi qu’il veut détrôner. II l’entraîne
à des démarches propres à l’avilir, et par conséquent à lui faire perdre
l’estime et la confiance des Français. Bientôt Guise, je le prévois, attaquera
le monarque ouvertement, et déjà les deux partis sont en présence. L’un dit
à l’autre : Otez-vous de là que je m’y mette. L’autre répond : J’y suis,
et j’y reste. Voilà, en quatre mots, l’histoire de toutes les guerres civiles
et de toutes les factions.
« On
lève, dans toutes les provinces, des troupes catholiques, et les réformé
inquiets se préparent à se défendre. C’est ce qui nous a fait donner hier
notre congé.

14 La Sainte-Ligue est formée en juin
1576 (B.G.)
«
Dans les conjonctures délicates, il faut toujours se conduire d’après les
vraisemblances ; souviens-toi de cela. Quelles sont- elles aujourd’hui ?
« Henri
III est livré à de sales débauches, et à une dévotion puérile. Il ne peut
rivaliser de talens et d’adresse avec le duc de Guise. C’est donc à ce dernier
qu’il faut s’attacher, et c’est ce que j’ai conseillé à monseigneur.
« Guise
lui donnera un corps d’armée, qu’il commandera au nom de ce roi, qu’il contribuera
à renverser, quand il en recevra l’ordre. Un général qui tire l’épée n’a
pas besoin de secrétaire. Je suis las, d’ailleurs, d’une place que je crois
fort au-dessous de mes moyens. Guise a tout l’orgueil que peuvent donner
de grandes qualités. Il est sensible aux éloges. Je déterminerai facilement
le baron à me présenter à lui, et, de ce moment, une fortune rapide et brillante
m’est assurée.
« Je
ne crois pas que, possesseur d’une jolie fille, tu penses à rentrer dans
ton couvent. — Possesseur ! possesseur ! — Quoi qu’il en soit, et quelque
parti que tu prennes, ne t’avise pas de crier vive Guise devant des royalistes,
s’il en est de bonne foi, ni vive le roi en présence des partisans du duc.
Marche toujours au soleil levant, et si tu le vois s’obscurcir, tourne-toi
de l’autre côté : l’homme adroit et réfléchi profite toujours des fautes
des autres. »
Il m’embrassa,
me fit sortir de son cabinet, et retourna diriger les préparatifs du départ.
Les
domestiques des deux sexes étaient trop occupés pour qu’ils pensassent
à me tourmenter. Je descendis dans la
principale
cour ;je la parcourus rapidement des yeux :on prévoit ce que je cherchais.
Colombe
était assise sur le petit paquet qui contenait ses effets. Elle avait la
tête appuyée sur ses deux mains ; des larmes coulaient entre ses doigts effilés.
« Colombe, ma chère Colombe, ne pleurez pas. Que craignez-vous ? J’aurai
pour vous les ménagemens que tout homme honnête doit à l’innocence, et je
vous prodiguerai les soins du frère le plus tendre. — Je sais que je vais
être en votre puissance ; mais je vous connais, et ce n’est pas ma position
qui m’arrache des larmes. C’est la douleur, c’est la honte d’être traitée
en coupable. Elle avait relevé sa tête ; ses yeux étaient fixés sur les miens.
Jamais je ne les avais vus aussi expressifs, aussi touchans. Ils portaient
le trouble dans tout mon être. Qu’allais- je devenir, pendant des heures,
des jours entiers, où nulle barrière ne s’élèverait entre Colombe et moi
? « Ô mon patron, m’écriai-je, ne m’abandonnez pas !
Madame
me croyait innocent, quand elle m’avait promis les moyens de voyager commodément.
Son opinion, à mon égard, était tout-à-fait changée, et cependant elle avait
tenu rigoureusement ses promesses, ou plutôt ses ordres étaient donnés, et
elle avait dédaigné de les révoquer. Une belle et bonne mule était attachée
par la bride dans la cour où nous étions. Une valise était fixée sur la croupe.
Elle contenait, sans doute, des effets plus précieux que les miens. Une bourse,
bien garnie, était placée dans une des fontes de pistolets. Cela valait mieux
que des armes dont je n’aurais pas su me servir. Je regardai partout autour
de moi, et je ne vis rien qui pût être destiné à Colombe. C’est sur cette
tendre victime que madame avait épuisé sa sévérité.
On
commençait à descendre des caisses, des ballots, et nous ne pouvions rester
plus long-temps dans cette cour. J’attachai, du mieux que je pus, le paquet
de Colombe sur ma valise. Je me mis en selle, et je conduisis ma mule près
des marches en pierre destinées à l’usage des dames qui n’ont pas la jambe
assez longue pour atteindre à l’étrier. Colombe se plaça derrière moi.
Tout
avait été prévu pour la sûreté de monseigneur et la nôtre. Une garde de cinquante
hommes était placée à la porte extérieure du palais. Le chef avait l’ordre
de faire accompagner et protéger les catholiques jusqu’à ce qu’ils fussent
sortis de la ville. Dix hommes se détachèrent, et nous conduisirent jusque
dans la campagne.
J’avais
été contraint, jusqu’alors, de retenir ma mule : je ne voulais pas qu’elle
dépassât les deux lignes qui étaient notre sauve-garde, et qui marchaient
au pas. Ces huguenots avaient regardé Colombe très-attentivement, et il leur
était échappé, par intervalles, des exclamations énergiques qui ne s’accordaient
pas avec sa pudeur. Elle s’était bouché les oreilles, et je m’étais résigné,
à l’aspect des longues pertuisanes que portaient nos gardes.
Mais
quand nous fûmes libres, je respirai, et je commençai à parler à ma charmante
compagne. Elle me répondait, et nous étions entièrement à notre conversation.
Elle s’animait, par degrés, et je ne pensais plus à conduire notre mule.
Elle prit le trot. Le paquet de Colombe, mal fixé, vacilla sous elle. Elle
passa autour de moi le plus joli bras du monde : il était tout simple qu’elle
cherchât à prévenir une chute. Il était de mon devoir de l’en garantir. Je
pris cette main qui s’offrait à moi, et je la pressai avec plus d’amour que
de force. Colombe soupirait ; des mots entrecoupés s’échappaient de ses lèvres
rosées
; moi, je ne me connaissais plus ; je ne me possédais plus.
Je sautai
à terre ; il était temps. Colombe partageait mon délire ; rien n’eût pu
prévenir une faute que nous n’avions jamais pensé à commettre, et pour laquelle,
cependant, nous étions punis. Je poussai doucement mon amie, et je la plaçai
sur la selle. Je conduisis la mule, la bride passée à mon bras, et je me
retournais à chaque pas, pour m’assurer que Colombe n’avait besoin de rien,
je le lui disais au moins ; mais je sentais bien que ce n’était pas la plus
forte raison qui me faisait regarder en arrière. Je me demandai ce que c’est
que l’amour. Je m’examinai, et je tremblai d’être réellement amoureux. Bientôt,
je déclarai à Colombe que j’étais coupable du crime d’amour. Elle me répondit
avec ingénuité qu’elle était ma complice. « Mais est-ce un si grand crime,
lui dis-je ? » — Je ne le crois pas, frère Antoine. — Cela fait un bien !...
— Oh ! oui, je le sens. — Et puis il est écrit : il n’est pas bon que l’homme
soit seul. —Voilà, peut-être, pourquoi nous sommes deux. — Colombe, il est
impossible que nous prolongions la position où nous sommes, sans succomber.
— J’en ai peur, frère Antoine.
— Je
suis loin d’avoir la vertu de mon patron, — Il n’est pas donné à tout le
monde de porter, jusque-là, l’abnégation de soi- même. — Colombe, nos premiers
parens se sont mariés. — Mon cher Antoine, c’est un grand exemple à suivre.
— Le veux-tu, ma Colombe ! — Oh ! oui, mon Antoine. — Nous sommes libres
l’un et l’autre ; nous approchons de ce village ; j’y vois un clocher. Nous
trouverons là un prêtre catholique, et nous prononcerons, devant lui, le
serment de nous aimer toujours. — Antoine, fais trotter la mule. »
Je
courais, je courais !... et j’excitais de la voix l’animal qui portait ma
vie, mon univers. Nous entrâmes à Benon. Benon ! village précieux, dont le
nom est pour jamais empreint dans ma mémoire !
Je marchai
droit à l’église. Je me souvins, alors, de la manière dont j’avais perdu
mes vingt écus à la Rochelle. Je pris la bourse que madame m’avait envoyée,
et je l’attachai à ma ceinture. Je reçus Colombe dans mes bras ; je la posai
doucement à terre, et nous entrâmes dans le temple saint. Un prêtre, dont
le temps avait blanchi la chevelure, célébrait les adorables mystères. Nous
approchâmes de l’autel, Colombe et moi, dans un pieux recueillement. Nous
nous unîmes d’intention au célébrant, et quand il eut prononcé ses derniers
mots, nous nous approchâmes de lui, et nous le priâmes de nous unir. Avec
quelle ardeur nous lui adressâmes notre prière ! Avec quelle bonté il nous
écouta !
Colombe
était orpheline, moi je venais de perdre mon père. Ma mère était si éloignée
de nous, que je ne pouvais attendre son consentement. Nous n’avions aucun
papier qui constatât ce que nous avancions. « Vous êtes jeunes, nous dit
le prêtre, et votre air, votre ton, vos paroles attestent votre candeur.
Il faudrait le consentement de votre mère ; mais, dans les circonstances
actuelles, les communications sont difficiles. La guerre va éclater. Déjà
les catholiques font justice des huguenots, quand ils sont les plus forts.
Les huguenots persécutent les catholiques, quand ils peuvent le faire impunément,
et cette jeune fille a besoin d’un protecteur. Je vais vous unir. »
Jamais
peut-être on ne prononça avec autant de sincérité le serment d’une fidélité
éternelle. Le digne prêtre nous délivra
l’acte
qui constatait notre union, et il me tendit la main. J’y mis une pièce d’or,
et cette main ne se retirait pas ; j’ajoutai une seconde pièce à la première.
Le prêtre nous bénit, et nous sortîmes du temple saint dans l’enchantement,
l’ivresse, le délire.
Un guerrier,
dans la force de l’âge, suivi de quatre cavaliers, était arrêté à la porte
de l’église. Il regardait ma mule, elle n’avait pas changé de position. Elle
avait la croupe tournée vers la ville impie. « Jeune homme, me dit le capitaine,
venez-vous de la Rochelle ? — Oui, monsieur. — J’y suis envoyé par le roi
de Navarre et le prince de Condé. Que disent, que font le général Lanoue
et le maire Jacques Henri ? — Ils persévèrent, et maintiennent le peuple
dans leurs affreux principes. — Ah, tu es un de ces catholiques exaspérés,
qui sont toujours altérés du sang des protestans ! Je vais t’apprendre qu’on
ne se déclare pas impunément l’ennemi du capitaine Thierry. Ah, ah, voilà
une jolie fille, une fille charmante. — C’est ma femme, monsieur le capitaine
; nous venons de nous marier. — Apprends qu’en temps de guerre, le capitaine
Thierry ne rencontre pas une jolie femme catholique sans lui laisser des
souvenirs. — Que dites- vous, Capitaine ? Que projetez-vous ? A moi les catholiques...,
à moi les catholiques. »
Ils
étaient en force à Benon. À l’instant des hommes armés de fourches, de faux,
de mousquets, sortent des maisons voisines, et me demandent de quoi je me
plains. Le curé paraît sur les degrés de l’église, et pour la dix-millième
fois, il excommunie les huguenots, qui se moquent de l’excommu-nication.
Thierry se voit au moment d’être cerné, il prend Colombe par un bras, l’enlève,
la met sur l’arçon de sa selle, pique des deux, et ses cavaliers le suivent.
Non,
jamais homme n’éprouva un accès de fureur égale à celle qui s’empara de moi.
Je sautai sur ma mule, je la mis au galop, je tirai mon épée, l’épée que
m’avait donnée Poussanville, décidé à reprendre ma femme, ou à mourir les
armes à la main. Les catholiques n’avaient que des chevaux de travail, et
aucun d’eux n’était sellé. » Courage ! me criaient-ils, courage. Vous allez
combattre pour la bonne cause, et vous triompherez. »
Je m’aperçus
bientôt que les chevaux des huguenots étaient fatigués d’une longue route,
ou que mon patron ralentissait leur marche. Ma mule était fraîche, et gagnait
du terrain sur eux. J’arrivai, j’arrivai enfin, ivre de colère, du désir
de me venger, et de délivrer Colombe.
Je tombai
sur Thierry, et je lui assenai sur la tête un coup terrible, mais mal dirigé
: il portait un casque. J’aurais dû chercher le défaut de sa cuirasse ; mais
je ne savais pas encore ce que c’est qu’une cuirasse. Thierry fait volte-face,
tient Colombe d’un bras vigoureux, et de l’autre il pare en riant les coups
redoublés que je lui porte. Colombe m’invoque et me transforme en héros.
Je continue de frapper, et d’estoc et de taille. Le sang de Thierry coule
sur une de ses cuisses, il devient furieux, et se précipite sur moi. Ses
cavaliers m’entourent le pistolet au poing, ma dernière heure va sonner.
Tout
à coup la scène change. Thierry roule à mes pieds. Ses gens demandent la
vie, et rendent leurs armes. Colombe saute sur la croupe de ma mule avec
la légèreté d’un oiseau. Ô grand saint Antoine, m’écriai-je, vous avez combattu
pour moi !
« Bien,
très-bien, s’écria une voix, que je ne reconnus pas d’abord ; tu t’es conduit
comme un petit César. Quand on se bat
pour
la première fois, et qu’on n’est soutenu que par la colère, un accablement
profond succède à des efforts violens. Mes idées n’avaient plus de suite
; mais je sentais Colombe derrière moi, et je me remis peu à peu. Je reconnus
Poussanville ; c’est lui qui avait fait mordre la poussière à Thierry. Biron,
l’épée à la main, était prêt à combattre des ennemis, dont il croyait voir
l’avant-garde. Ses domestiques, armés jusqu’aux dents, avaient cerné les
quatre cavaliers, et les avaient forcés à se rendre. L’écuyer Olivier, frappé
d’un coup de lance dans la poitrine, était étendu par terre. Madame la baronne,
dans sa coche, ses femmes dans les fourgons, avaient prié, et priaient encore
pour les combattans. Mes premiers soins furent pour Colombe. Ô douleur !
sa robe était tachée de sang. « Malheureux ! m’écriai- je, c’est moi qui
l’ai blessée. — Je ne le suis pas, mon ami... Oh ciel ! ce sang qui t’effraie
est le tien. Je m’examinai. J’avais reçu un coup de pointe dans le flanc
gauche, et dans la chaleur de l’action, je ne l’avais pas senti. Colombe
saute à terre ; elle me présente des mains secourables ; je me laisse aller
dans ses bras. Elle m’assied sur une pierre ; elle déchire ses vêtemens pour
me panser. Poussanville accourt. Il examine ma blessure, et prononce qu’elle
est légère.
Je me
sentais très-faible. Cependant je remarquai qu’il souriait en regardant Colombe.
Je tirai de ma bourse l’acte de notre mariage, et je le lui présentai. «
Mon brave ami, me dit-il, voilà qui répare tout. — Mon cher Poussanville,
il n’y avait rien à réparer. Elle n’est pas même encore ma femme. — Bah !
cela est-il possible ? »
Olivier
se sentait frappé à mort, et il demanda à parler à Madame. La baronne ne
balança pas à descendre de sa coche pour écouter un mourant. « Madame,
… furieux, … vos
femmes
et nous des privations que nous avait imposées le rapport d’Antoine nous
avons résolu de le perdre… et d’envelopper Colombe… dans le châtiment…
que nous voulions lui… faire subir… Nous les avons… calomniés… Que… le ciel…
nous pardonne. » Il expira. Poussanville s’était approché. Il déclara à madame
que les soins que me prodiguait Colombe étaient légitimes, et que nous venions
de nous marier à Benon.
« Une
bonne catholique, s’écria madame, ne rougit jamais de réparer ses torts.
Elle vint à nous, et daigna nous prier d’oublier son injustice. « J’en effacerai
jusqu’aux dernières traces, nous dit-elle. » Bientôt, notre petit champ de
bataille offrit un tableau bien neuf, et bien frappant pour moi.
Les
quatre cavaliers de Thierry avaient les mains liées derrière le dos. Deux
des domestiques du baron les gardaient, l’épée à la main. Les autres faisaient
un trou dans un champ voisin, et y déposèrent l’écuyer, après l’avoir déshabillé,
selon l’usage. Les femmes de madame avaient reçu l’ordre de descendre de
leur fourgon. Elles étaient sur le chemin, le paquet sous le bras; elles
avaient l’air triste, abattu, et semblaient se consulter sur la route qu’elles
devaient prendre. Je les comptai : il en manquait deux. C’étaient Claire,
qui habillait madame avec tant d’adresse et d’élégance, et Félicité qui donnait
à ses cheveux une tournure et une grâce inimitables. Serait-il vrai que,
dans toutes les circonstances, l’amour de la toilette soit la passion dominante
des femmes ? Les mules et les chevaux, abandonnés à eux- mêmes, paissaient
sur les revers des fossés qui bordaient le chemin. Le baron et Poussanville,
à cheval, allaient, venaient, causaient, et paraissaient s’occuper d’objets
sérieux. Le baron
s’approcha
de madame, qui, après avoir chassé ses femmes, était revenue auprès de nous.
« Vous
êtes bien la maîtresse, lui dit-il, de faire de ces pimbêches là ce que vous
voulez. Mais vous savez, Madame, que Thierry aimait beaucoup les femmes,
et je présume que ces quatre drôles, qu’on tient là, ne les haïssent pas.
Que fussiez- vous devenue, si mes domestiques, aussi fidèles que braves,
n’eussent exposé leur vie pour vous ? Vous permettrez donc que je les garde.
Je ne suis pas encore à la tête d’une armée, et la scène d’aujourd’hui peut
se renouveler demain.
Il paraît
que vous reprenez Colombe, et j’en suis bien aise. Je ne puis vous donner
une marque plus prononcée de ma déférence pour vous, qu’en vous demandant
ce que vous désirez que je fasse pour Antoine. Il s’est battu bravement,
et il a renoncé à ses idées monacales, puisqu’il vient de se marier. — Monsieur,
j’ai quelques scrupules sur ce mariage-là. Il est bon, selon l’Église; mais
il me semble que les formes légales n’ont pas été observées. — Hé, Madame,
est-ce lorsque toute la France court aux armes qu’on peut s’occuper de longues
formalités ? Benon est aujourd’hui aux catholiques. Demain, peut-être, il
sera aux protestans. Calmez vos scrupules, puisque l’Eglise est satisfaite,
et dites-moi, je vous en prie, ce que je peux faire pour votre protégé. —
Monsieur, vous avez eu le malheur de perdre votre écuyer… —Hé, Madame, je
ne peux donner cette place à un jeune homme qui sait à peine se tenir sur
une mule. Je compte faire un aide de camp de M. de Poussanville, et je lui
adjoindrai Antoine pour la partie des écritures. Voilà ce qu’il lui faut.
Antoine, de ce moment, vous vous appelez Monsieur de la Moucherie : un homme
comme
moi
ne peut admettre à son intimité que des gentilshommes. Il faut masquer votre
roture. »
Monseigneur
ne me donnait pas le titre de son secrétaire ; n’importe, la place qu’il
me proposait me convenait beaucoup. Elle assurait mon existence, et son écrivain
devait, peu à peu, connaître ses secrets et ceux du duc de Guise, si le baron
entrait en correspondance avec lui. Quelle satisfaction pour moi de pénétrer
les secrets de l’État ! Je marquai une vive reconnaissance au baron, qui
était trop heureux de m’avoir trouvé là pour remplacer Poussanville, et cacher
son ignorance à tous les yeux. Je commençais à comprendre que les gens instruits
doivent régir le monde, quand les circonstances les favorisent. Guise n’avait
pas besoin de secrétaire.
Colombe
était aux genoux de Madame. Il faut, lui disait-elle, rendre le bien pour
le mal, et elle lui demandait, avec de vives instances, la grâce de ses femmes.
Elles étaient toujours là, leur paquet sous le bras, et elles observaient
attentivement ce qui se passait de notre côté.
« Hé,
Madame, dit le baron, il est des peccadilles que les maîtres doivent paraître
ignorer. — Des peccadilles, Monsieur !
— Je
ne connais de fautes graves que celles qui nuisent à la régularité du service.
Soyons indulgens, puisque nous avons le malheur de ne pouvoir nous passer
de domestiques. Colombe est une excellente petite femme ; elle vous fournit
l’occasion de pardonner. Vous en profiterez si vous voulez m’en croire. »
Madame
prononça une amnistie générale, et elle finit par quelques mots sur la nécessité
de revenir aux bonnes mœurs. Le baron rit, leva les épaules, et retourna
auprès de Poussanville.
Une
autre scène commença. Les quatre prisonniers furent désarmés, renvoyés, et
s’enfuirent comme s’ils eussent eu une meute à leurs trousses. Les femmes
de service passèrent, d’une pénible anxiété, à la joie la plus vive. Elles
comblèrent madame de protestations pour l’avenir, et de remercîmens qui partaient
du cœur : on est toujours sincère, au moins pour un moment, envers ceux à
qui on doit la transition d’une situation affligeante à celle qu’on désirait.
Elles vinrent toutes embrasser Colombe, et la prier d’oublier le passé. Les
domestiques s’approchèrent, et me firent leur compliment sur le grade où
venait de m’élever monseigneur. La joie était peinte sur tous les visages
; la gaîté régnait partout.
On tira
d’un fourgon les provisions de bouche. Le couvert fut mis sur l’herbe, et
on forma différens groupes, selon la qualité de chacun. L’écrivain de monseigneur
ne pouvait prétendre à manger avec lui. Il ne devait pas non plus être confondu
avec les domestiques : j’avais déjà la morgue de mon nouvel état. Monsieur
et madame de la Moucherie se tirèrent de la foule, et l’amour le plus tendre
vint se grouper avec eux. J’avais perdu du sang ; j’étais faible ; je ne
pouvais qu’aimer ; mais mon cœur n’avait pas un battement qui ne fût pour
Colombe. Avec quel charme elle me regardait ! Avec quel empressement elle
me servait ce qui pouvait me convenir ! Nous n’avions qu’une fourchette et
qu’un verre à nous deux : nous n’en désirions pas davantage.
Le bien
qu’on fait n’est jamais perdu. Les domestiques, sans qu’on leur en donnât
l’ordre, sans même qu’on leur dît un mot, s’occupèrent des moyens de transporter
le blessé : il ne pouvait supporter les cahots d’un fourgon. Une hache suffit
pour couper des branches d’arbres, et en faire un brancard d’une tournure
grotesque,
mais assez solide pour porter un fardeau plus lourd que celui qu’on allait
lui confier. On le chargea de deux matelas, on l’attacha sur deux mules,
et on m’aida à m’y placer. Colombe s’élança et se plaça auprès de moi. La
caravanne se remit en route au bruit des chansons : on chante volontiers
quand on est heureux.
« Monseigneur
a raison, dis-je à Colombe. Mes idées monacales s’éloignent de moi quand
je te regarde, quand je presse ta main. Poussanville avait raison aussi,
quand il me disait : Prends les hommes comme ils sont, et laisse-leur faire
ce qui leur plaît. — Mon cher Antoine, bornons-nous à être bons catholiques,
et à nous aimer. Je sens que l’amour suffit pour remplir tous nos momens.
» De tendres caresses interrompaient nos réflexions. Colombe jugeait qu’elles
pouvaient être dangereuses pour moi ; elle leur donnait les bornes que lui
indiquait sa prudence de seize ans ; moi, je maudissais ma blessure.
Nous
avancions avec sécurité. Nous approchions de la ville de Melle, où Monseigneur
avait décidé que nous passerions la nuit. Tout allait bien jusques là.
Tout
à coup, un nuage de poussière s’éleva devant nous. Bientôt nous distinguâmes
une cinquantaine de cavaliers, qui venaient à nous, à toute bride. Un moment
après, nous reconnûmes que les quatre prisonniers, que Monseigneur avait
eu l’imprudence de renvoyer, leur servaient de guides.
Le baron
tira l’épée ; Poussanville suivit son exemple ; les domestiques apprêtèrent
leurs armes à feu, et se mirent en bataille en avant de la coche, du brancard
et des fourgons. Je tremblai pour Colombe.
Le
chef des ennemis s’avança droit au baron, le pistolet au poing. C’était le
prince de Condé. Ses gens nous cernèrent de toutes parts.
« M.
le baron, vous êtes mon prisonnier. — Comment ! Monseigneur, sans déclaration
de guerre, avant même qu’elle soit commencée ! — Vous ne saviez donc rien
à la Rochelle de ce qui se fait sur toute la France ? La Ligue, que vous
appelez sainte, et qui ne l’est pas du tout, se répand de tous les côtés,
comme un torrent dévastateur. Ses membres, liés par un serment redoutable,
se multiplient tous les jours. Ils ne sont pas encore réunis en corps d’armée
; mais partout où ils sont les plus forts, les protestans sont vexés, tourmentés,
torturés, égorgés. Il faut mettre fin à ces excès, et nos co-religionnaires
se lèvent en masse. Déjà je vous ai pris Melle et toutes les petites villes
situées dans les environs de la Rochelle. La Saintonge et le pays d’Aunis
sont le noyau d’un état indépendant, que Catherine de Médicis, le Roi et
les Guises nous obligent à former. Ils ne font la paix que lorsqu’ils nous
craignent, et ils se font un jeu de violer les traités et leurs sermens.
Vous sentez bien, monsieur le Baron, que je n’aurai pas la maladresse de
leur renvoyer un général tel que vous. Votre valeur, vos talens militaires
ont seuls réduit la Rochelle, il y a trois ans ; mais entre gens comme nous,
tout s’oublie, parce que tout peut se réparer. Passez de notre côté. Henri,
roi de Navarre, sera votre ami, et vous serez mon égal. Henri IV est l’héritier
présomptif de la couronne de France ; il connaît votre mérite ; il considère
votre famille. Vous sentez jusqu’où vous pouvez pousser votre fortune. Vous
n’avez qu’un moment pour vous décider. Soyez notre allié, ou mon prisonnier.
Pendant que vous réfléchirez, je vais saluer madame de Biron. »
Il
s’approcha d’elle avec des marques de considération et une amabilité qui
parurent la toucher. Il lui protesta que quelle que fût la détermination
du Baron, personne ne manquerait aux égards dus à sa naissance et à ses qualités
personnelles. « Quel langage, quelle douceur, me dit Colombe ! Les huguenots
ne sont donc pas des tigres altérés de sang comme on me l’a dit cent fois
? — Ne vois-tu pas que le loup s’est revêtu de la peau de l’agneau ? Le Prince
veut attirer Monseigneur dans son parti, et on ne fait de ces choses là qu’avec
de belles paroles. » J’avais réfléchi à tout ce que m’avait dit Poussanville,
et mon jugement se développait.
Je prêtais
une oreille attentive à tout ce qui se disait autour de moi. Le Baron et
mon ami se parlaient à demi-voix ; mais je saisissais toujours quelque chose.
« Soyez prisonnier un moment, Monseigneur… les chances de la guerre vous
rendront la liberté… le roi saura que vous avez résisté aux séductions du
prince de Condé… le bâton de maréchal sera votre récompense.
-
Mais si les protestans sont vainqueurs ?
— Ils ne peuvent obtenir que des succès passagers… les trois quarts des Français
sont catholiques. » Ainsi, pensai-je, l’intérêt personnel est le grand régulateur
de tous les hommes. Le prince de Condé était brave, mais généreux. Il était
bon général ; mais il ne sut jamais profiter du moment, et les petites choses
ne doivent pas être négligées. Il me semblait à moi, pauvre petit, qu’au
lieu d’user le temps en courtoisies auprès de Madame, le Prince devait nous
conduire tous à Melle, où il se fût expliqué sans danger, et aussi longuement
qu’il l’eût voulu.
Il
retourna enfin demander au baron à quoi il s’était décidé. Il s’arrêta devant
mon brancard, et fixa Colombe. « Voilà une bien jolie fille, s’écria-t-il
! — Mon Prince, elle est ma femme.
-
Cela ne l’empêche pas d’être charmante. »
Allons, me dis-je, Thierry voulait tout devoir à la force, et celui-ci croit
réussir avec ses paroles de miel. Tous les huguenots sont des coquins.
Mes
réflexions m’avaient empêché d’entendre ce que le prince et le baron s’étaient
dit ; mais je vis monsieur de Biron présenter son épée au vainqueur. « On
ne désarme pas un homme comme vous, lui dit le prince. Gardez votre épée,
et puissiez-vous vous décider à la consacrer au service de la justice et
de l’humanité. » II ordonna qu’on se mît en marche.
J’étais
au désespoir. Je pressentais que j’allais être séparé de Colombe. « Quand
donc, m’écriai-je, me sera-t-il permis d’être le mari de ma femme ! Quand
donc, me répondit-elle, pourrai-je être la femme de mon mari ! »
Nous
avancions vers Melle. Colombe et moi, étions plongés dans la plus profonde
tristesse. Tout à coup, nous entendons pousser de grands cris.
Nous
avions, à notre gauche, une colline, que couvrait un bois taillis. Une colonne
d’infanterie, de deux mille hommes au moins, déboucha du bois, et se divisa
en deux corps. L’un marcha vers la grande route, du côté de Melle, avec l’intention,
sans doute, de couper la retraite au prince de CoNdé. L’autre semblait se
diriger sur nos derrières. Chacune de ces colonnes était précédée de deux
pièces d’artillerie. « Ce sont les ligueurs, s’écria le prince de Condé !
» Fort heureusement pour lui, ils n’avaient pas de cavalerie ; mais il ne
lui restait pas un instant à perdre pour se mettre en sûreté. Il ne pouvait
contraindre monsieur de Biron à prendre le grand galop pour le suivre. Il
fallait le tuer sur la place, ou l’y abandonner à lui-même. Thierry n’eût
pas balancé à prendre le premier parti. Le prince
de
Condé se décida pour le second. En un clin d’œil il disparut, lui et les
siens.
Ce cri
: ce sont les ligueurs, me rendit à moi-même. Nous sommes avec des catholiques,
dis-je à Colombe, en l’embrassant tendrement ; nous voilà en sûreté. Les
deux corps s’approchèrent de nous, et on commença à s’entendre. Le bruit
des succès du prince de Condé avait alarmé jusqu’au duc de Guise, qui ne
connaissait pas la crainte. Il avait envoyé, dans le Poitou, Livarot, l’un
des sales favoris du roi, avec l’ordre de lever ce qu’il y aurait de ligueurs,
d’observer les opérations du prince de Condé, et de lui rendre compte de
tous ses mouvemens.
Nous
avons appris, plus tard, qu’il croyait que Livarot se conduirait en lâche,
et que le roi achèverait de se perdre dans l’opinion publique, quand on connaîtrait
bien les hommes à qui il prodiguait ses faveurs.
Livarot
était brave, et il le prouva dans le combat singulier qu’il soutint deux
ans après, avec Cailus et Maugiron, contre d’Entragues, Riberac et Schomberg
; mais il ne savait pas faire la guerre. Il le prouva sans réplique, en s’avançant
au milieu des places qu’occupaient les huguenots. On sent bien que je n’étais
pas assez habile pour faire de semblables réflexions. Le soir, monseigneur
et Poussanville m’instruisirent, en parlant, en ma présence, des événemens
de la journée. Il est constant, au moins, que Livarot nous rendit un service
essentiel, en se portant sur des points, dont la prudence lui ordonnait de
s’éloigner.

Trompette
et général sous Henri III
CHAPITRE
V.
Désespoir
et consolation de M. de la Moucherie.
J’étais
toujours sur mon brancard, attendant avec anxiété ce qu’il plairait à mon
patron d’ordonner de moi. Des soldats de la ligue passaient et repassaient
autour de nous, et ils fixaient ma Colombe d’un air qui me faisait trembler.
Je l’enlaçais dans mes bras, comme si j’eusse pu la défendre. « Ne crains
rien, mon cher Antoine, me dit-elle, ce sont des catholiques. Ces catholiques-là
étaient chargés de provisions et de butin. Ils ne s’étaient point battus
; ce n’étaient donc pas les huguenots qu’ils avaient pillés. Il était clair
qu’ils ne ménageaient pas plus leurs amis que leurs ennemis. Cette pensée
me désespérait. Je pressais ma charmante Colombe contre mon cœur ; je la
serrais de toutes mes forces. On m’eût plutôt arraché la vie que de me séparer
d’elle.
Monseigneur
demanda à Livarot la formule du serment que prêtaient les ligueurs, lorsqu’ils
étaient admis dans la sainte ligue. Il le répéta, à haute voix, sur les flancs
des colonnes, et des applaudissemens éclatèrent de toutes parts. « Monsieur,
dit-
il
à Livarot, je suis général d’armée. — Et un général très- avantageusement
connu. — Vous ne trouverez donc pas mauvais que je prenne le commandement
de vos troupes. » Livarot fit une moue, que je vois encore aujourd’hui. Le
baron lui fit remarquer toutes les fautes qu’il avait faites depuis qu’il
était sorti du Poitou, et les ligueurs crièrent, Vive Biron ! « La plus grave
de ces fautes, Monsieur, est d’avoir permis que vos soldats se chargeassent
de butin, au point de se mettre dans l’impossibilité de combattre. » Des
soldats ne perdent pas volontiers un général qui permet le pillage. Un morne
silence régna sur toute la ligne ; bientôt des murmures éclatèrent de toutes
parts. Le moment était critique, et Biron le sentit.
Il assembla
les officiers autour de lui. « Je ne veux pas, leur dit-il, vous ôter ce
que vous avez. — Vive Biron ! » — Mais je désire que ce butin vous soit utile.
— Vive Biron ! — Nous allons rentrer dans le bois. Vous déposerez, au centre,
des objets qui vous chargent et vous embarrassent. Une grande garde,
choisie par vous, veillera sur vos propriétés. Je vais vous mettre en bataille
sur la lisière du bois. Je placerai vos quatre pièces de campagne à votre
centre. Le prince de Condé est actif ; c’est un ennemi à redouter ; il faut
donc être toujours prêts à combattre. Il a de la cavalerie ; mais elle n’osera
pas vous attaquer dans la position que je vais vous faire prendre. Il n’avait
que quatre ou cinq mille hommes d’infanterie, selon le rapport de M. de Livarot.
Il avoue s’être emparé de plusieurs villes catholiques. Sans doute, il y
a laissé des garnisons. Melle est la plus petite de ces places, et il doit
avoir peu de fantassins avec lui. Nous sommes donc en mesure de nous défendre
avec succès, s’il vient nous attaquer. »
La
nuit approchait, et on se prépara à exécuter les ordres du baron. Le réfléchi,
mais courageux Poussanville sembla se multiplier. Il était partout, et partout
il faisait de sages dispositions. Tous les bagages furent déposés au centre
du bois, selon le plan arrêté par monseigneur. Une garde de cent hommes s’avança
pour les surveiller et les défendre. Poussanville était sûr que, si nous
étions attaqués, la cupidité en ferait des héros. Ce fut au milieu de cette
garde qu’il plaça la coche, les fourgons et le brancard. Il retourna au front
de sa ligne, et il y attendit les événemens.
Le général
Biron ne descendit pas de cheval. Il allait de peloton en peloton. Il parlait
aux ligueurs ; il les encourageait. Il jurait de leur donner l’exemple de
la valeur, quand l’occasion s’en présenterait. Livarot dormait sur l’herbe
comme un homme qui ne connaît pas la crainte, mais qui s’estime heureux de
n’avoir plus à se mêler de rien.
Les
ligueurs, très-zélés catholiques, aiment à souper comme les protestans. On
détermine difficilement un soldat à jeûner, quand il sent des provisions
à trois cents pas de lui. Monseigneur fut obligé de permettre à quelques
ligueurs, pris sur tous les points de la ligne de bataille, de se détacher,
et d’aller chercher des vivres pour eux et leurs compagnons qui gardaient
leurs rangs. La grande garde faisait une orgie, et gaspillait tout. Une querelle
s’engagea, et des injures on en vint aux coups. On se battit, d’abord à l’arme
blanche ; bientôt on se servit des mousquets.
Poussanville
accourt, et veut rétablir l’ordre. On ne l’écoute pas. Les balles sifflent
autour de nous. Madame, ses femmes sont transies de peur. Colombe cache sa
figure céleste contre
mon
cœur. Il est impossible de prévoir comment cette scène finira.
Le baron
faisait des efforts inouïs pour contenir son front de bataille. Il employait
alternativement les prières, les menaces, les caresses, et même les coups.
Ses troupes se rompent, se débandent, accourent au lieu du combat, pour se
disputer quelques rations de vivres. Le feu cesse, parce qu’on est serré
de toutes parts ; mais le désordre, la confusion règnent autour de nous.
On se pousse, on s’élance les uns sur les autres. Ces provisions de bouche,
objets de tant d’efforts, sont foulées aux pieds. On n’entend plus que des
cris, des juremens, le craquement des jeunes arbres qu’on brise pour s’ouvrir
un passage. Le baron est parvenu jusqu’à la voiture de madame. Il empêche,
à grands coups d’épée, qui que ce soit d’en approcher. Poussanville se dispose
à prendre Colombe pour la porter dans cet asile. Je le bénis : c’est tout
ce que je peux.
Un gros
de soldats, poussés par la foule, se précipite entre Poussanville et nous.
Le brancard est renversé ; Colombe m’échappe ; j’entends ses cris ; je ne
peux la rejoindre… Je tombe, accablé de douleur et d’effroi. Je m’évanouis.
Il était jour quand je recouvrai l’usage de mes sens. Un silence effrayant
régnait autour de moi. Je me rappelai les dernières particularités de cette
nuit déplorable. Je me lève ; j’appelle Colombe à grands cris…, Colombe ne
me répond pas… Elle a été entraînée par la foule, me dis-je. Elle est incapable
de m’avoir abandonné.
Je devais
la vie au lieu où j’étais tombé. J’étais étendu entre deux gros arbres environnés
de ronces, impénétrables pour quiconque n’est pas aveuglé par la fureur ou
le désespoir. Je sortis de là avec des peines incroyables. Une pertuisane
brisée
m’aida
à me soutenir. Je parcourus le bois. L’indiscipline lui avait donné l’aspect
d’un champ de bataille, et il n’y restait pas un soldat. J’avais perdu tout
ce qui m’attachait à la vie, et c’est à des catholiques que je devais mon
infortune !
Je trouvai
une des mules qui portaient mon brancard. Le pauvre animal, étranger aux
fureurs des hommes, paissait tranquillement. L’espérance rentra dans mon
cœur. Je conduisis la mule près d’une pointe de rocher qui sortait de terre,
et qui s’élevait à deux ou trois pieds au-dessus du sol. Elle m’aida à me
mettre en selle, et je parcourus le bois dans tous les sens. J’appelais autant
que me le permettaient mes forces… Colombe était perdue pour moi !
Je distinguai,
dans l’éloignement, les quatre pièces d’artillerie qu’on traînait du côté
de Melle. Le reste n’était pas difficile à pénétrer. Le prince de Condé avait
pu entendre la fusillade ; il aura cru le baron attaqué par un corps de huguenots.
Il sera accouru avec sa cavalerie. Il sera tombé sur des malheureux incapables
de se défendre. Il les aura sabrés, dispersés, et il emmène leur artillerie.
Mais Colombe !... Colombe !...
Il est
une sensation que rien ne peut éteindre dans l’homme : c’est celle du besoin.
La veille, au soir, je n’avais rien pris, et la faim commença à se faire
sentir. Je retournai au centre du bois. Avec la pointe de ma pertuisane,
je démêlai dans la poussière, quelques bribes, que j’aurais dédaignées dans
toute autre position. Je les mangeai avec avidité. Je reconnus ce butin,
fruit de l’indiscipline, et que l’indiscipline avait fait perdre aux catholiques.
Il était évident que le prince de Condé n’avait pas voulu s’engager jusques
là. La coche, les fourgons, les chevaux du baron avaient pu s’échapper par
les derrières du bois. Peut-
être,
ma Colombe a été recueillie dans une de ces voitures. Mais quelle route ont-elles
prise ?
Je me
rappelai jusqu’aux moindres particularités de la veille. Je raisonnai et
je me demandai ce que j’aurais fait si j’étais M. de Biron.
Le prince
de Condé lui avait avoué qu’il s’était emparé des places situées aux environs
de la Rochelle. Poitiers est à trente lieues de cette ville, ainsi que me
l’avait appris le frère Marc, en suivant ma mule ; Poitiers devait appartenir
encore aux catholiques. C’est vraisemblablement sur cette ville que le baron
aura fait sa retraite, s’il a pu échapper au prince de Condé.
On croit
si facilement ce qu’on désire ! Je voyais nos voitures sur la route de Poitiers
; je voyais Colombe dans le fourgon des femmes de madame ; elle soupirait
; elle était plongée dans la plus profonde douleur. Allons, m’écriai-je,
c’est la route de Poitiers qu’il faut prendre.
A quelle
distance en étais-je ? je calculai que nous avions fait, la veille, quinze
lieues environ ; il m’en restait donc quinze à parcourir. D’ailleurs, les
fourgons de monseigneur étaient pesamment chargés ; ma mule était bonne ;
il était vraisemblable que je retrouverais Colombe avant que d’entrer à Poitiers.
Les événemens sont loin de s’arranger toujours au gré de nos désirs. Il me
semblait que mes rêves devaient se réaliser. Je partis.
Je me
souvins de ces paroles remarquables de Poussanville : Il faut prendre
les hommes comme ils sont. Je sentais la nécessité de me conformer à
ce précepte. Je demandais mon chemin à
tous
ceux que je rencontrais ; je leur demandais s’ils n’avaient pas rencontré
des hommes de guerre et de gros équipages. Je les reconnaissais de quarante
pas à leur cocarde ; chacun a la sienne dans les guerres civiles ; la mienne
était dans ma poche, et je pouvais me présenter indistinctement aux catholiques
et aux huguenots. Vive le duc de Guise ! criais-je aux uns ; vive le roi
de Navarre !criais-je aux autres. Je sentais que ma conduite sentait furieusement
l’hérésie ; mais il fallait retrouver Colombe, et puis je faisais ce qu’on
appelle une capitulation de conscience : mon patron a voulu que je perdisse
Colombe, il veut que je la retrouve ; donc il me permet d’employer tous les
moyens propres à me conduire à mon but.
J’appris
enfin qu’en pressant un peu ma mule je pourrais joindre monseigneur à Lusignan
: c’est à peu près la moitié du chemin de Melle à Poitiers. Je piquai ma
monture, et bientôt je rencontrai plusieurs de nos fuyards, qui se traînaient
avec ce qu’ils avaient pu emporter. « Donne-moi ta mule, me dit l’un d’eux.
C’était un officier. « Vive le duc de Guise, lui répondis- je. —Vive le diable
si tu veux ; mais donne-moi ta mule. » Je tirai ma cocarde de ma poche. «
C’est fort bien, mais donne- moi ta mule. — Vous voyez bien que je suis blessé.
— Et moi, je suis las. » II tenait la mule par la bride, d’une main, et de
l’autre, il se disposait à me prendre par une jambe et à me jeter au milieu
du chemin. S’il eût été seul, j’aurais essayé de lui passer sur le ventre
; mais cinq ou six de ses soldats s’étaient approchés, m’avaient entouré,
et leurs dispositions me paraissaient fort incertaines. Je me décidai
à descendre.
« Prends
ce bâton, me dit l’officier, il t’aidera à marcher. »
Il est
dur d’être traité ainsi par les gens de son parti. Il est cruel d’être arrêté
dans sa marche, au moment où on a l’espoir
de
se réunir à ce qu’on a de plus cher au monde. Que m’eussent fait de plus
des huguenots ? ils m’eussent tué, peut-être : allons, mon patron a tout
arrangé pour le mieux. Vive notre saint père et son représentant, monseigneur
le duc de Guise.
Ma blessure
était légère, cependant je marchais lentement, appuyé d’un côté sur le pommeau
de mon épée, et de l’autre, sur le bâton, que m’avait laissé le capitaine.
Je n’étais heureusement qu’à une lieue de Lusignan ; j’en distinguais les
clochers. Mais si la baronne ne s’y arrête pas, pensai-je, il me sera impossible
de la joindre. Cependant, madame a passé une nuit déplorable ; monseigneur
et Poussanville sont excédés de fatigue ; oui, oui, ils se reposent à Lusignan.
Un âne
paissait, près d’une misérable chaumière, bâtie à cinquante pas de la route.
Je m’y rendis, j’avais de l’argent, et je m’arrangeai avec une pauvre femme,
qui voulut bien me conduire jusqu’à Lusignan. Elle était catholique, et je
retrouvai en elle les sentimens de charité qui devaient animer tous les ligueurs,
et dont ils étaient si loin ! « Que saint Antoine vous bénisse, lui-dis-je,
bonne femme. » Hélas, je réfléchis, en marchant, que sa charité me coûtait
un écu. Où donc est la vertu, me disais-je ? Ah ! dans le cœur de Colombe.
Mon
âne ne fit envie à personne, et j’entrai dans la petite ville de Lusignan,
sans éprouver de nouvelle mésaventure. Les rues sont tortueuses, et j’aurais
voulu percer les murailles avec les yeux pour découvrir ces voitures, objets
de tous mes vœux.
« Hé,
le voilà, cria-t-on à ma gauche ! Il n’est pas tué, cria-t-on à ma droite
! Quelle satisfaction ! — Quelle joie ! — Quel bonheur ! » c’étaient les
domestiques du Baron. « Colombe est- elle ici ? » Ils m’enlevaient de dessus
mon âne. « Colombe est- elle ici ? » Ils me portaient sur leurs bras. « Colombe
est-elle
ici
? Répondez-moi donc. » Ils ne m’entendaient pas. Ils marchaient, en criant
à tue tête : « Le voilà !... il n’est pas tué…. Quelle joie !... quel bonheur
!... Poussanville accourt, et m’embrasse tendrement. « Colombe est-elle ici
? — Oui, oui, elle est ici. — Où est-elle ?... Laissez-moi, que je coure,
que je vole à ses pieds, dans ses bras. » Elle parut enfin, soutenue par
Félicité. Des pleurs avaient sillonné ses joues ; des larmes de joie leur
succédèrent ; ses forces, épuisées par douze heures passées dans le désespoir,
se remirent tout à coup. Attachés étroitement l’un à l’autre, nous ne faisions
plus qu’un être, pénétré des mêmes pensées, animé des mêmes sensations. Nous
ressemblions à ces malheureux, condamnés à mort, et qui reçoivent leur grâce
au moment où le coup fatal valeur être porté.
Nous
nous adressions une foule de questions sur les événemens de la nuit dernière.
Nous ne prenions pas le temps de nous répondre. Nous étions dans l’enchantement,
dans l’ivresse, dans le délire. Nous parlions tous deux à la fois ; nous
nous interrompions pour nous couvrir des plus vives, des plus tendres caresses.
Des larmes roulaient dans les yeux de l’impassible Poussanville et des gens
du baron. Les habitans de la ville, que cette scène extraordinaire avait
rassemblés, nous prenaient pour des fous. Poussanville nous avertit qu’il
était temps de cesser de nous donner en spectacle. Nous entrâmes dans la
maison, où le baron s’était arrêté.
Monseigneur
et Madame nous félicitèrent cordialement sur notre réunion. Nous ne donnâmes
à nos remercîmens que le temps nécessaire pour ne point paraître impolis
ou ingrats. Colombe m’entraîna dans une chambre où nous commençâmes à causer
raisonnablement, et avec un certain calme. Nous nous
arrêtions
souvent pour nous répéter que nous nous aimions, pour nous jurer que nous
nous aimerions toujours, et nous scellions nos sermens de vingt, de cent
baisers. Colombe et moi oubliâmes ma blessure, et… C’était le moyen le plus
sûr de pouvoir donner de la suite à notre conversation.
J’appris
qu’au moment où notre brancard avait été renversé, Poussanville avait saisi
Colombe par un bras, l’avait portée dans le fourgon des femmes ; qu’elles
l’y avaient retenue malgré ses efforts continuels pour m’aller chercher,
me trouver, vivre ou mourir avec moi ; que le baron et ses voitures s’étaient
retirés par le derrière du bois, ainsi que je l’avais pressenti ; qu’une
centaine de dignes membres de la sainte ligue lui étaient restés attachés
; que le prince de Condé avait borné ses avantages à la prise de notre artillerie
; que Colombe, qui n’avait plus à elle que l’usage de la parole, me demandait
à tous les passans, même à ceux qui venaient du côté de Lusignan ; qu’enfin
elle m’avait cru mort, et avait tenté vingt fois de se précipiter sous les
roues de sa voiture.
Je lui
racontai, à mon tour, ce qui m’était arrivé. Monseigneur et Madame voulurent
m’entendre, et je me rendis auprès d’eux ; ils m’écoutèrent avec intérêt.
« Comme il parle, dit madame ! quel prédicateur c’eût été ! — Je conviens
qu’il n’est pas fait pour un état obscur. Je lui aiderai à parvenir à un
emploi convenable. Il est intelligent, il est brave, et les révolutions,
les guerres civiles mettent toujours les hommes à leur place. Poussanville
entra. Il m’avait conservé Colombe : je le comblai des marques de ma vive
reconnaissance.
J’allai
retrouver ma jeune et séduisante compagne. Elle n’avait cessé de s’occuper
de moi. Du linge blanc, un bon déjeuner, dont j’avais grand besoin, m’attendaient,
préparés par
ses
mains blanchettes. Elle me présentait les morceaux qu’elle croyait devoir
me plaire, et elle me déshabillait en même temps : elle était impatiente
de voir ma blessure, et d’y mettre un appareil. Ses soins empressés n’étaient
pas sans inconvénient.... Je ne mangeais plus — Et.... nous reconnûmes bientôt
que l’amour est le premier de tous les médecins. Ma plaie se séchait, se
fermait. Je pouvais aimer autant que je le voudrais ; j’étais au comble du
bonheur. Colombe le partageait de toute son âme, de toutes ses forces : le
devoir nous en faisait une loi. O mon patron, qu’il est doux d’accorder son
devoir et son cœur !
Il était
naturel que je désirasse savoir ce que nous allions devenir. Je descendis.
Colombe avait passé son bras sous le mien. Elle m’aidait à marcher; elle
me regardait ! Elle n’apercevait rien de ce qui se passait autour d’elle
; elle ne voyait que moi.
Poussanville
n’avait pu prendre que deux heures de repos, et déjà il organisait les soldats
de la ligue qui s’étaient ralliés auprès de monseigneur, et ceux qui entraient,
à chaque instant, dans la ville. Il n’y avait pas un seul huguenot ; il était
le maître absolu de ses opérations. Il voulait rétablir la discipline si
essentielle à la guerre, et, pour la maintenir, il fallait faire des magasins.
« Harangue les habitans, me dit-il ; cela est dans tes attributions. »
Je pris
un tambour ; je lui fis battre la caisse devant moi, et j’arrivai sur la
place publique. Je m’arrêtai devant une maison d’assez belle apparence ;
je demandai une table et des tréteaux : tous les moyens sont bons, quand
ils produisent le bien. Que va- t-il faire, se demandaient ceux qui m’avaient
suivi ? Que va-t-il faire, se demandaient ceux sur qui le bras du tambour
avait agi
plus
lentement ? C’est un officier, disaient les uns ; c’est un prédicateur, disaient
les autres.
Je montai
sur ma table. Colombe n’avait pas quitté mon bras, et nous parûmes ensemble.
« Qu’ils sont jeunes ! qu’ils sont gentils ! s’écriait-on de tous les côtés.
»
Je pris
la parole. J’exposai à mon auditoire les motifs qui avaient porté le duc
de Guise à instituer la sainte ligue. Ses dignes membres n’avaient d’autre
désir, d’autre but que d’exterminer les hérétiques, et d’assurer le triomphe
de la vraie religion. Je croyais tout cela, sans égard pour ce que j’avais
entendu, dire à Poussanville. « Mais, ajoutai-je, les hommes les plus pieux
ne sont pas exempts de faiblesse. Ceux qui sont prêts à se sacrifier pour
de si saints motifs, doivent avoir des moyens d’existence assurés. C’est
en les leur fournissant que vous attirerez sur vous les indulgences de Rome
; que vous déterminerez les soldats de la sainte ligue à protéger vos propriétés,
et à assurer votre repos. Beaucoup d’entre vous, reprit Colombe, connaissent
un sentiment qui rend la vie si douce et si chère. Jeunes femmes, vous aimez
tendrement vos maris ; jeunes filles, vous attendez, avec une modeste impatience,
le moment qui doit couronner vos amours. Nous sommes mariés depuis deux jours.
Voyez combien nous sommes heureux ! Vous pouvez l’être autant que nous, en
offrant quelque chose de votre superflu à ceux qui vont combattre pour assurer
la continuité de votre bonheur. »
Jamais
Colombe ne s’était exprimée ainsi. L’exaltation nous donne donc des moyens
que nous ne nous connaissions pas. Je n’avais parlé qu’aux consciences ;
Colombe avait touché les cœurs. Elle acheva de les entraîner en m’embrassant
tendrement. Ce fut là sa péroraison.
Quand
on veut persuader la multitude, il faut prendre des orateurs comme Colombe.
Les masses ne raisonnent pas ; mais le sentiment les entraîne. « Qu’elle
est jolie ! disaient les uns ; comme elle parle ! disaient les autres ! »
Les jeunes époux s’embrassaient ; les jeunes gens regardaient leurs futures
compagnes avec des yeux ! Et les fillettes rougissaient. Je n’étais pas jaloux
des préférences qu’on accordait à Colombe ; mais il me semblait que je pouvais
être l’objet de quelque attention. Les vieilles calmèrent mon amour-propre,
blessé. J’entendis murmurer, « Qu’il est bien ! quelle expression a cette
charmante figure ! Je crois voir mon Joseph à l’âge de vingt ans. — Et moi
mon Guillaume, le jour où je lui donnai la main. » Toutes les voix s’élevèrent
ensemble. « Donnons, donnons, s’écria-t-on de toutes parts. »
Nous
descendîmes de la tribune aux harangues, et je marchais difficilement. «
Qu’a-t-il donc, demandèrent quelques grand’mamans ? Un coquin de huguenot
m’a enlevée hier, répondit Colombe. Mon Antoine m’a défendue, et le scélérat
l’a blessé. » — Ah, ciel ! juste ciel ! — Rassurez-vous, mes bonnes mères
; M. de Poussanville a tué l’infâme. — Ah, tant mieux ! morte la bête, mort
le venin. »
Nous
arrivâmes devant la maison qu’occupait monseigneur. On y apportait, de tous
les coins de la ville, des provisions de bouche de toute espèce. Déjà la
cour commençait à s’encombrer. « Bien, bien, très-bien, me dirent monseigneur
et Poussanville. — Ah, je n’ai fait que raisonner ; Colombe a parlé aux cœurs,
et l’honneur du succès lui appartient tout entier. Voilà, dit le baron, deux
jeunes gens qui peuvent nous être de la plus grande utilité. Mes amis, il
faut achever votre ouvrage.
Nous
avons des vivres ; mais nous manquons de moyens de transport. »
Nous
nous remîmes, en marche, Colombe et moi : il existait entre nous une unité
d’intention, qui ne nous permettait pas de nous séparer un moment. Nous parcourions
les rues, et à chaque pas on nous demandait si nous étions contens. « Très-contens,
répondions-nous, et notre reconnaissance sera éternelle. — Ces pauvres petits
! ces chers petits ! » Jusques-là tout allait bien.
C’était
un jour de marché, et le dernier, vraisemblablement : l’approche du prince
de Condé allait rendre les communications difficiles. Des paysans avaient
apporté des fruits, des légumes, des grains à Lusignan. Ils se disposaient
à retourner chez eux. Je leur demandai s’ils voulaient servir la bonne cause.
Ils me jurèrent qu’ils étaient prêts à mourir pour elle. « Conduisez vos
charrettes à la porte de M. de Biron. Nous allons les charger de nos provisions,
et demain vous nous accompagnerez jusqu’à Poitiers. » On me frappe sur l’épaule
; je me tourne, et je me trouve face à face avec un magistrat. C’était le
bailly, qu’accompagnaient quelques-uns des principaux habitans.
« Comment,
petits serpens, vous nous extorquez des vivres, sous le prétexte de nourrir
des soldats qui doivent nous défendre, et vous avez le projet de nous abandonner
! Et le prince de Condé est à Melle ! Et il ne nous reste pas de quoi exister
pendant deux jours ! Suppôts des hérétiques, vous nous avez abusés par vos
ruses infernales. »
Nous
avions en effet demandé des vivres pour des soldats voués à la défense des
catholiques ; mais nous ne nous étions pas engagés à rester dans une bicoque,
ouverte de toutes parts. Ce raisonnement me paraissait tout simple ; mais
comment le faire adopter à des gens exaltés par la crainte de la famine,
et
dont
le nombre augmentait à chaque instant ? Déjà les paysans avaient reçu l’ordre
d’atteler et de sortir à l’instant de la ville.
« Il
faudra bien, nous dit le bailly, que vous nous laissiez des provisions que
vous ne pourrez pas emporter. » Cela était d’une vérité incontestable. Je
ne savais pas encore répondre à des argumens qui me paraissaient sans réplique,
et je ne pensais plus qu’à retourner auprès de monseigneur. Il fallait traverser
toute la ville ; les habitans sortaient tous de leurs maisons, et se groupaient
autour de nous ; je sentais le bras de Colombe agité d’un tremblement qui
m’annonçait une terreur profonde.
J’entendis
le bruit du tambour ; je prêtai une oreille attentive au milieu des vociférations
qui éclataient de toutes parts. Le son me parut s’approcher à chaque seconde.
Bientôt, Poussanville et quelques soldats percèrent jusqu’à nous, et Colombe
respira.
Mon
ami faisait lire une proclamation propre à rassurer les habitans sur la conservation
de leurs propriétés. « A quoi bon des meubles et de l’argent, lui dit le
bailly, quand on manque de pain ? Un homme d’esprit n’est jamais embarrassé
: Poussanville répondit en faisant battre la générale.
Nos
soldats, que les habitans avaient reçus chez eux, sortent avec leurs armes,
et se rangent auprès de nous ; les charettes sont attelées ; M. l’aide-de-camp
les fait conduire devant le logement de monseigneur, et il propose ce dilemme
au bailly.
« Le
prince de Condé viendra ici, ou n’y viendra point. S’il vient, vos provisions
et votre argent seront la proie des huguenots ; s’il ne vient pas, vous tirerez
des villages voisins de nouvelles subsistances. — Il viendra, il viendra,
puisque vous nous abandonnez. — En ce cas, M. le bailly, je frappe la ville
d’une contribution de trente mille livres. Vous êtes trop bon catholique
pour ne pas sentir qu’il vaut mieux que votre argent
tombe
entre nos mains qu’en celles des huguenots. Je vous donne deux heures pour
faire la répartition de la somme que je vous demande : allez. » Un dominicain,
frais et vermeil, voulut faire l’orateur. « Oh, oh ! reprit Poussanville,
il y a dans cette ville de bons, de véritables religieux. Vous savez comme
les huguenots vous traitent. Je ne souffrirai pas que vous tombiez entre
leurs mains. Je vous présenterai à M. le Baron : il se fera un honneur, un
devoir de vous tirer d’une ville, qui demain sera mise à feu et à sang. Il
vous conduira à Poitiers ; mais vous ne serez pas assez dupes pour abandonner
à ces enragés ce qu’il y a de précieux dans votre couvent. Allons en faire
l’inventaire, car vous sentez bien que M. de Biron ne recevra vos richesses
qu’à titre de dépôt, et qu’elles vous seront religieusement rendues. — Mais
si les huguenots ne viennent pas ? — Ils viendront : M. le bailly l’a assuré,
et il est bien mieux informé que nous. »
Je ne
quittai pas Poussanville. J’entrai, avec lui et une centaine de soldats,
dans le couvent des Dominicains. Dans toute autre circonstance, j’aurais
frémi en franchissant, avec des hommes armés, le seuil de l’asile sacré ;
mais les raisonnemens de Poussanville me paraissaient sans réplique. Colombe
partageait ma conviction : nous étions si simples encore !
M. l’aide-de-camp
débuta par diviser sa troupe en pelotons, et il en plaça à toutes les portes.
Il commença une perquisition générale, aidé de quelques officiers. « M. de
la Moucherie, me dit-il, prenez du papier et une plume ; vous inscrirez les
objets précieux que nous devons conserver à ces bons religieux. » J’étais
prêt à écrire, et l’épaule de Colombe me servait de pupitre.
Nous
allions, nous venions, et nous ne trouvions rien. « Que voulez-vous, nous
dit le prieur, trouver chez des Dominicains ? Si nous étions des Bénédictins,
des Bernardins, vos recherches pourraient n’être pas infructueuses. — Je
vous crois, mon révérend père, et je vais vous rendre un véritable service.
Demain, votre couvent sera brûlé, et c’est une jouissance que je ne laisserai
pas à des Huguenots. Soldats, prenez des fagots ; placez-en partout, et mettez-y
le feu. —Un moment, M. le capitaine ; il est très-douteux que le prince de
Condé vienne demain. — Il viendra ; M. le bailly l’a dit, et le premier magistrat
de Lusignan ne se trompe jamais. »
Quel
plaisir pour des soldats que celui de brûler une maison ! En un clin d’œil,
le bûcher des révérends pères fut vidé, et des flambeaux s’allumèrent. «
Éteignez ces flambeaux, éteignez- les, s’écria le père prieur, » et des portes
secrètes s’ouvrirent.
Soixante
sacs de mille livres chacun, et un vaste amas de provisions de bouche tombèrent
entre nos mains, « Ecrivez, M. de la Moucherie. — Hélas ! dit le père prieur,
tout cela était destiné aux pauvres. —Oui ? Hé bien, je me charge de leur
distribuer l’argent, et je partagerai les vivres entre nos soldats. Ce sont
de bons catholiques, et, par conséquent, les premiers pauvres. Mes pères,
voulez-vous nous suivre à Poitiers ? » Des mouvemens de têtes, très-négatifs,
furent la seule réponse qu’obtint Poussanville.
Nos
cent hommes se chargèrent des sacs et des vivres, et nous regagnâmes le logement
du Baron. « Voilà, me dit en marchant, mon ami, les tristes résultats des
guerres civiles. On se dépouille, on se vole, on s’égorge, et le voile de
la religion couvre tous les excès. On l’invoque au milieu des décombres ;
on entraîne des malheureux, accablés par la misère, et, je te le
répète,
l’homme adroit ne s’occupe que de lui. Je donne au baron le moyen de lever
des troupes ; il aura le bâton de maréchal de France, et moi, un régiment.
— Cet argent ne sera donc pas distribué aux pauvres ? — Imbécile ! »
Quels
yeux ouvrit monseigneur, quand il vit entrer ce convoi chez lui ! Il embrassa
étroitement Poussanville ; il me frappa sur l’épaule, et il caressa le menton
de Colombe.
Les
deux heures accordées au bailly étaient écoulées, et il ne paraissait pas.
« Va lui déclarer, me dit Poussanville, que s’il ne vient à l’instant, j’épargnerai
aux huguenots la peine de brûler la ville demain. — Mais, mon ami, ta conduite
est affreuse ! — Obéis, sans réflexion, c’est le devoir d’un soldat. Quand
tu commanderas, tu feras ce que tu voudras. — Mais, mon ami…
—Pour
que tu conserves ta Colombe, il faut que nous soyons les plus forts. »
Je ne
répliquai pas. Je courus, à la tête de trente hommes, et je me disais en
courant : Poussanville a raison ; chacun ne s’occupe que de soi. Ô mon patron
! protégez ma Colombe !
Je passai
devant la boutique d’un épicier ; je lui empruntai quelques torches ; je
les fis allumer, et j’entrai chez le bailly. Il m’entendit, et je ne lui
avais pas adressé un mot. Il venait de compléter la somme ; il me la remit,
et je fis éteindre les flambeaux. « Vous vous dites catholiques, s’écria
le bailly, en me conduisant hors de sa maison, et vous donnez aux huguenots
l’exemple de la férocité et du pillage. » Je sentais qu’il avait raison !
mais Colombe, Colombe !...
Nos
soldats avaient été bien nourris par les malheureux habitans de Lusignan.
Ils pouvaient marcher le reste du jour
sans
avoir besoin de rien. Quand j’arrivai devant la maison de monseigneur, ils
étaient rassemblés en cercle autour de Poussanville. Il leur déclara qu’il
serait fait des distributions régulières de vivres ; mais que le premier
qui manquerait à la discipline militaire, serait pendu sans rémission.
Je portai
mes trente mille livres au trésor, et monseigneur me permit d’embrasser Colombe
en sa présence. Nous avions cinq cents hommes à notre disposition, et des
soldats, qui sont dans l’abondance, ne craignent pas plus la fatigue que
les dangers. En moins d’une heure, les charrettes furent chargées. Poussanville,
prit avec quelques hommes d’élite, la surveillance de celle qui portait l’argent.
Les charretiers demandèrent à retourner chez eux ; il était clair que nous
n’inspirions ni confiance, ni affection. On n’avait pas besoin d’eux : on
leur permit d’abandonner leurs voitures et leurs attelages.
Le jour
s’avançait. Cependant monseigneur décida qu’il fallait partir à l’instant.
Condé avait de l’artillerie ; il pouvait nous attaquer pendant la nuit, et
réaliser ce que Poussanville avait dit ironiquement.
La coche
de madame et les fourgons de monseigneur prirent la tête de la colonne. J’étais
monté, avec Colombe, dans une petite voiture couverte, garnie intérieurement
de paillassons, et traînée par une bonne mule. Cet équipage appartenait
au propriétaire de la maison où monseigneur s’était arrêté. Poussanville,
qui n’oubliait rien, le lui avait emprunté pour moi.
Il était
nuit, et nous n’avions encore fait que deux lieues. La lune paraissait dans
toute sa blancheur, et monseigneur arrêta qu’on continuerait de marcher.
Cependant la troupe n’avait pas soupe. On fit halte. Les soldats s’assirent
sur le chemin, ayant
leurs
armes auprès d’eux. Bientôt des rations furent préparées, et distribuées
avec un ordre, que je ne me lassais pas d’admirer. C’est un maître homme,
me disais-je, que ce Poussanville ! il ira loin, si le duc de Guise sait
apprécier les talens.
On sent
bien que monseigneur, madame et leur suite avaient leurs provisions particulières.
Nous avions tous oublié les crises de la nuit précédente : rien ne s’oublie
aussi facilement que le malheur. Nous soupâmes gaîment, Colombe et moi surtout
: nous étions ensemble, et nous étions seuls.
Rien
n’échappait à l’attention de Poussanville. Il avait remarqué deux paysans,
qui marchaient à côté de la colonne, qui s’arrêtèrent quand elle s’arrêta,
et qui rétrogradèrent vers Lusignan. Je ne vois pas, se dit-il, quelle raison
peuvent avoir ces gens-là de retourner d’où ils sont venus. Il les fit arrêter,
et on trouva des poignards sous leurs souquenilles : c’étaient des espions.
On les conduisit à monseigneur, qui les interrogea. Ils avaient l’ordre de
suivre M. de Biron, et de s’assurer de la route qu’il tiendrait. Ils nous
apprirent que le prince de Condé traitait les protestans de Melle, comme
nous avions traité les catholiques de Lusignan. « Quelle guerre, me dit Colombe
! où donc s’est réfugiée la justice ? »
« J’ai
le droit de vous faire pendre, dit monseigneur à ces malheureux ; mais je
ne vous crains pas, et je n’attente pas à la vie des hommes sans y être contraint
par la nécessité. Allez dire au prince que bientôt nous nous verrons en rase
campagne. » Ils furent relâchés, et c’est la seule bonne action que nous
eussions faite en vingt-quatre heures.
À la
pointe du jour, nous arrivâmes aux portes de Poitiers. On vint nous reconnaître,
et nous entrâmes dans la ville, tambours
battans,
et drapeaux déployés : ce n’étaient encore que des chiffons attachés à des
manches à balais. Je possédais mon histoire romaine, et je dis à Poussanville
: « Les premières enseignes des Romains n’étaient que des bâtons, surmontés
d’une poignée de foin, et ce peuple a conquis l’univers. Ainsi s’étendra
la vraie religion sur les ruines de l’hérésie. Ainsi soit- il, me répondit-il
en riant. »
Il ne
lui fut pas possible d’exercer son industrie à Poitiers, comme il l’avait
fait à Lusignan. Six mille bourgeois étaient enrégimentés, et bien armés.
Les remparts étaient garnis de trente pièces d’artillerie, et la place était
approvisionnée de munitions de guerre et de bouche. Nos cinq cents hommes
ne pouvaient causer aucune espèce d’inquiétude aux habitans. Ils furent reçus
comme des auxiliaires, dont on pouvait se passer, avec assez d’indifférence.
Quand on dit que nous avions des vivres pour huit jours ; quand on sut que
le baron avait en caisse quatre vingt-dix mille livres, on nous marqua beaucoup
d’égards : on sentait que nous ne serions pas à charge aux Poitevins. Mais
on nous notifia qu’on n’avait pris les armes que pour défendre la place,
et qu’il n’en sortirait pas un soldat.
Je me
rappelai ce prieur de Franciscains, qui m’avait traité avec tant de mépris,
et dont les opinions religieuses m’avaient paru si suspectes. Je ne l’estimais
pas. Cependant j’avais porté pendant quatre ans l’habit de l’ordre, et on
tient aux habitudes de l’adolescence. J’étais tenté d’aller rendre visite
à mes anciens confrères. Je voulais que le prieur sût que je n’étais pas
un homme exagéré, un ami de l’hyperbole, un énergumène enfin. Ma
vanité était flattée de me présenter l’épée au côté, et une femme charmante
à mon bras. Je crois que ce dernier motif fut celui qui me poussa au couvent
des Franciscains. Le père
prieur
me reconnut, et me marqua quelque bienveillance.
« Avouez,
me dit-il, que j’ai eu raison de ne pas recevoir vos vœux. Vous ne combattriez
pas pour la bonne cause, et vous ne seriez pas marié. Votre état n’est pas
pur ; cependant nous encourageons le mariage ; il faut procréer des défenseurs
de la foi. » II regardait Colombe d’un air qui me fit croire qu’il eût pu
s’abaisser jusqu’à contribuer à la multiplication du genre humain. Il nous
quitta avec assez de politesse, en nous disant qu’il allait prêcher à la
cathédrale, où l’attendait un nombreux auditoire.
Je m’attendais
qu’il prècherait l’amour de l’humanité et la tolérance. J’avais besoin de
combattre encore une exaltation, que j’avais sucée avec le lait, et qui me
tourmentait beaucoup. J’étais homme du monde, quand je regardais Colombe
; le mot huguenot m’irritait quand je la perdais de vue.
Nous
eûmes beaucoup de peine à pénétrer dans l’intérieur de l’église. Nous y trouvâmes
le baron, son aide-de-camp, madame, et deux de ses femmes. On leur avait
donné des places d’honneur, et il me sembla que son écrivain pouvait s’approcher
d’eux.
J’examinai
toutes les figures, en attendant que le prédicateur parût. La figure de madame
exhalait les sentimens de piété dont elle était pénétrée. Monseigneur et
Poussanville étaient dans le recueillement, et paraissaient plongés dans
une profonde méditation. Que mon patron, pensai-je, leur fasse la grâce de
devenir ce qu’ils veulent paraître en ce moment.
Le prédicateur
parut, et le plus profond silence régna partout. Il commença par faire le
plus pompeux éloge de la sainte ligue, des effets qu’elle produisait déjà,
et des prodiges qu’on avait le
droit
d’en attendre. Il invita, il pria, il pressa, il conjura les habitans de
Poitiers de s’aggréger à cette respectable congrégation. Bientôt je ne reconnus
plus l’homme qui m’avait traité de fou, et qui avait jeté par la fenêtre
la relique qui m’avait coûté si cher. « Voilà, dit-il, en tirant, un crucifix
de sa manche, celui qui est mort pour les catholiques, et qui vous ordonne
par ma voix, d’exterminer jusqu’au dernier des huguenots. Guerre, guerre
éternelle, s’il le faut, aux ennemis de Rome et de la foi. Que vos épées
deviennent autant de glaives flamboyans, qui portent la mort dans le cœur
de nos ennemis, même avant que de les avoir frappés. C’est ainsi que vos
pères furent vainqueurs à Dreux, à Saint-Denis, à Jarnac, à Montcontour.
» Aussitôt monseigneur et Poussanville tirent leurs épées, et les agitent
en l’air; des habitans suivent un si bel exemple. On n’entend plus que le
cliquetis des armes, et le cri : mort aux huguenots. J’avais porté la main
sur la garde de la mienne ; Colombe y tint la sienne, et elle me regarda
d’un air-si doux ! je la laissai dans le fourreau. « Que j’avais mal jugé
ce saint homme, lui dis-je ? il mérite les hommages de tous les fidèles.
»
Une
table et un registre étaient placés sous la chaire. On y courut. On se déclara
membre de la sainte ligue ; on jura, d’après un clerc qui lut à haute voix
la formule du serment, une obéissance aveugle au chef suprême qu’on se donnait,
et qui n’était pas nommé. Il faut cependant connaître celui à qui on doit
obéir. C’est le duc de Guise, dit le clerc, qui vous commandera au nom du
roi.
Des
tables étaient dressées sur les places et dans les principales rues de la
ville. Au bout de quelques heures, le duc avait acquis six mille sujets de
plus.
Monseigneur
n’oubliait dans aucune circonstance ce qu’il devait à sa naissance et à son
rang. Il avait jugé fort au-dessous de lui de jurer avec des vilains. Nous
nous rendîmes en grande pompe à l’hôtel de ville. Là M. de Biron renouvela
le serment qu’il avait prêté entre les mains de Livarot. Nous reconnûmes
pour notre maître monseigneur le duc de Guise, commandant pour le roi. Il
est clair que la seconde partie de notre formule nous laissait la liberté,
d’après le système de Poussanville, de nous tourner toujours, vers le soleil
levant.


Soldats
d’infanterie sous Henri III
CHAPITRE
VI.
M.
de la Moucherie est ambassadeur.
Nous
ne savions rien à la Rochelle de ce qui se passait dans le reste du monde.
Il était temps que le baron connût la situation politique et religieuse de
la France : il n’avait que ce moyen d’adopter une conduite réfléchie et suivie.
Sa hauteur
ne se ployait pas à des communications avec ses inférieurs, et il n’avait
pas d’égaux à Poitiers. L’aide-de-camp Poussanville fut chargé de se lier
avec les principaux personnages de la ville. Personne n’était plus propre
que lui à les faire parler, et à interpréter jusqu’à leur silence. La journée
n’était pas écoulée, et déjà monseigneur savait ce qu’il avait voulu connaître.
Le roi
continuait à se conduire d’une manière infâme. Il s’était agrégé à une confrérie
de pénitens. Il ordonnait des processions, et il les suivait avec les démonstrations
de la plus austère piété. Il se couvrait d’un sac de grosse toile ; il portait
une discipline à sa ceinture, et un gros chapelet à la main. Il se rendait,
la nuit, à
Vincennes,
et il y outrageait la nature, pendant que des moines, qu’il y avait établis,
priaient pour lui. Le matin, il se montrait paré, avec ce soin qui n’est
qu’un travers chez tant de femmes. Il entrait partout, le pourpoint entr’ouvert,
et la gorge ornée d’un long collier de perles. Les protestans le tournaient
en ridicule, et les catholiques le méprisaient. Les deux partis ne l’appelaient
plus que frère Henri.
Le duc
de Guise, beau, brillant et brave, n’avait de religion que ce qu’il en fallait
pour entraîner les catholiques. Des prédicateurs à ses gages gagnaient les
uns ; ses libéralités lui attachaient les autres. Il faisait face à toutes
ces dépenses avec l’argent que lui fournissait le roi d’Espagne. Philippe
II faisait de grands sacrifices, pour entretenir la guerre civile en France
: il se persuadait que les deux partis, las de combattre, l’appelleraient,
et lui donneraient un sceptre, qu’il ajouterait à tous ceux qu’il portait
déjà, et qui fatiguaient ses débiles mains.
Quel
homme raisonnable pouvait balancer entre Henri de Valois, et Henri duc de
Guise ?
Je n’étais
pas présent, lorsque Poussanville fit son rapport au baron. Mais il était
facile, surtout avec moi, qu’il voulait pénétrer d’idées, qu’il appelait
saines et raisonnables. J’étais affligé que la religion ne fût qu’un masque
pourtant de grands personnages. Pourvu qu’elle triomphe, me disais-je, qu’importe
par qui et comment ?
C’est
de la part de monseigneur, me dit un valet, qui introduisit, près de Colombe
et de moi, un homme et une femme que je n’avais jamais vus. Ils nous abordèrent
avec les trois révérences que j’avais adressées au baron, la première fois
que je parus devant lui.
L’homme
s’empara de moi, et la femme de Colombe. Ils nous tournèrent, nous retournèrent
avec le plus grand sérieux. Une longue bande de parchemin nous prenait tantôt
de la tête aux pieds, tantôt en travers du corps. Je ne comprenais rien à
ce manège, et Colombe éclata de rire. J’interrogeai ces deux êtres silencieux
; ils ne me répondirent pas un mot. Ils nous firent encore trois belles révérences,
et disparurent. Nous nous regardâmes, Colombe et moi, et nous nous écriâmes
à la fois : Qu’est-ce que cela veut dire?
Monseigneur
demande M. de la Moucherie, vint me dire un autre valet. Je le suivis, et
je laissai Colombe dans la chambrette qu’on nous avait donnée. Elle voulait,
lisait-elle s’occuper sans cesse de moi, lors même qu’elle ne me voyait pas
: elle avait commencé à me broder une écharpe, qui devait être du plus grand
effet. Elle se proposait de la serrer soigneusement jusqu’à ce que j’eusse
le droit de la porter.
« Monsieur,
me dit le baron, vous êtes appelé à de hautes destinées, puisque je vous
accorde ma protection et ma confiance ; justifiez-les par un dévouement sans
bornes. Écoutez- moi.
« Monsieur
de Poussanville va s’occuper de lever de nouvelles troupes ; ainsi je ne
peux l’éloigner de moi. Vous vous rendrez auprès du duc de Guise… — Avec
Colombe, Monseigneur ? — Soit, et vous remettrez au duc et aux autres les
dépêches que vous allez vous faire. Asseyez-vous, prenez une plume, et composez
un alphabet. — Un alphabet, Monseigneur ! — Oui, des chiffres, des signes
qui correspondront à chacune des lettres que vous connaissez. Vous transcrirez,
dans cette langue nouvelle, les lettres que je vais vous dicter, et si vous
êtes arrêté, personne ne pourra lire ma
correspondance.
» Que j’étais heureux ; j’allais connaître tous les secrets de Monseigneur
!
L’alphabet
demandé fut fait en un tour de main. La première lettre que j’écrivis était
adressée au Roi. Elle ne lui présentait que des expressions d’attachement,
de dévouement et de respect. Celle qui était destinée au duc, l’instruisait
de ce qu’avait fait le baron et de ce qu’il comptait faire. Il l’assurait
qu’avant huit jours, il serait à la tête de six mille ligueurs, qu’il assemblerait
dans les alentours de Poitiers. Il était certain que les habitans de cette
ville lui donneraient quelques pièces d’artillerie, si monsieur le duc lui
envoyait l’ordre de les prendre. Il ajoutait que le prince de Condé n’avait
que quatre mille hommes, dispersés dans cinq ou six bicoques situées aux
environs de la Rochelle; qu’il se faisait fort de les surprendre, les unes
après les autres, s’il était revêtu d’une dignité qui lui soumît les capitaines
et les troupes catholiques qu’il rencontrerait pendant le cours de ses opérations.
M’y
voilà, pensai-je. Si le duc succombe, ce qui n’est pas vraisemblable, la
lettre de monseigneur au roi lui facilitera un accommodement avec le souverain,
qui n’est pas nommé dans l’épître au duc, parce qu’il ne proclame encore
ses ordonnances qu’au nom de Henri III. Cela n’est pas maladroit. Enfin,
comme il est juste de se vendre le plus chèrement possible à un parti qui
est intéressé à s’attacher tous les personnages d’un mérite reconnu, monseigneur
demande le bâton de maréchal, et il l’aura.
Il me
fit ensuite écrire à son fils. « Vous êtes, lui disais-je, d’un caractère
inquiet et turbulent, qui pourrait bien vous conduire à l’échafaud : prenez-y
garde. Votre conduite actuelle est dépourvue de sens commun. Vous cherchez,
m’a-t-on dit à
Poitiers,
en vous mettant en opposition, on ne sait avec qui, à établir en France une
paix sincère et durable. Insensé ! vous voulez donc qu’on vous envoie
planter des choux à Biron. » Bien, me dis- l’homme se dévoile ici tout
entier. « Votre belle- mère et moi vous embrassons. »
Il me
fallut le reste du jour pour transcrire ces missives avec les signes que
j’avais imaginés : j’étais obligé de m’arrêter à chaque lettre. Quand j’eus
fini, monseigneur me dit : « Les grands auxquels je vous envoie, ne manqueront
pas de vous parler d’affaires de détail. Vous leur répondrez comme je le
ferais, puisque vous connaissez parfaitement ma situation. Vous allez donc
être revêtu d’un caractère public ; vous serez une espèce d’ambassadeur,
et je veux que vous vous présentiez dans un équipage digne de moi. Votre
blessure n’est rien ; vous avez une voiture ; on l’arrange convenablement,
et vous partirez aussitôt que vous serez habillé. J’ai prévu que vous ne
consentiriez pas facilement à vous séparer de madame de la Moucherie ; voilà
pourquoi j’ai joint une couturière à un tailleur. — Hé ! monseigneur, il
ne m’a pas été possible de leur arracher un mot. — Je le crois bien, ils
ne savent pas en dire deux en français. — Ah ! — Le mari servait dans un
régiment suisse, et sa femme était vivandière. Ils sont venus ici, sans congé,
après la bataille de Montcontour. Les femmes de la ville leur ont reconnu
des talens, et des ouvriers, prônés par le beau sexe, deviennent bientôt
des sujets importans. Les robes de madame ont été chiffonnées dans ce bois
où nous avons passé une nuit assez désagréable. Le suisse et la Suissesse,
les garçons tailleurs et les couturières de la ville, travaillent à les remettre
en bon état. Le bas de ma maison en est encombré. Ils sont dirigés par Claire,
qui ne sait pas un mot d’allemand. Elle leur parle avec les doigts et les
yeux. On dit que cela est très-
plaisant.
— Hé, monseigneur, c’est ce que les Romains appelaient pantomime. — Panto…
quoi ? — Pantomime, monseigneur. — Apprenez l’allemand, monsieur. Il pourra
vous être utile, et votre latin ne vous servira jamais à rien. — Le latin,
monseigneur ! la langue d’Horace, de Virgile, d’Ovide !
— Que
ne leur joignez-vous Homère, Sophocle, Euripide ? — Monseigneur, ces trois
écrivains étaient Grecs. —Mais ils étaient nés à Rome. — En Grèce, monseigneur.
— Je vous dis qu’ils étaient Romains, et quand je vous dis quelque chose,
monsieur, j’entends, je veux que ce que je vous dis soit vrai. N’oubliez
pas que je suis Biron, et que vous n’êtes que le frère Antoine. Allez faire
l’amour à votre femme. Je m’enfermai avec Colombe, et je lui racontai tout
ce qui venait de se passer entre monseigneur et moi. Elle avait beaucoup
de bon sens, et jugea comme moi des motifs politiques qui dirigeaient le
baron. Elle rit beaucoup de la scène sur les Grecs et les Romains, quand
je la lui eus fait comprendre. Tout à coup elle reprit son sérieux. « Mon
cher Antoine, me dit-elle, il est dangereux d’avoir raison avec ses supérieurs,
quand ils ne veulent absolument pas avoir tort. » Tu as blessé l’amour-propre
de monseigneur, et la religion ne défend pas de ménager ceux dont on a besoin.
II faut réparer ta faute. — Oui, mais comment ? — Je n’en sais rien. — Ni
moi. — Réfléchissons, cherchons. — M’y voilà, m’y voilà. »
Je cours,
je me fais annoncer. « Monseigneur, ma mémoire m’est ordinairement très-fidèle
; mais elle m’a trahi dans une occasion importante. J’ai osé vous contester
des faits que je me rappelle parfaitement en ce moment. C’est à Rome, en
effet, qu’Homère, Sophocle et Euripide ont écrit leurs plus beaux ouvrages…
sous le consulat de Scipion l’Africain. — Ah, ah, ah, ah ! Voilà les
jeunes gens. Ils veulent tout savoir. —
J’espère
que Monseigneur ne me retirera pas sa protection — Pour une faute involontaire
? jamais, et pour vous le prouver, je vous retiens à souper avec moi. » Je
restai persuadé que le baron avait entendu parler vaguement de littérature
; qu’occupé d’affaires importantes, il ne s’était attaché ni aux noms, ni
aux lieux, ni aux époques ; qu’il avait tout confondu, et qu’il croyait fermement
ce qu’il avait si vivement soutenu. Il fallait que je m’en tinsse à cette
idée, ou que je ne visse en lui qu’un homme ridicule et entêté. Il était
persévérant dans les plans qu’il avait adoptés ; mais jamais une absurdité
ne s’échappa de sa bouche.
Un repas
est toujours gai, quand les convives sont satisfaits du présent, et comptent
sur un avenir heureux. Les domestiques allaient, venaient ; ce n’était pas
le moment de parler d’affaires politiques. Poussanville était l’homme de
toutes les circonstances ; il s’abandonna à ses saillies, et il eut souvent
le bonheur de faire sourire le patron et madame. Il se mit à conter, et il
contait bien. Il mit en scène quelques héros de l’antiquité qui avaient eu
des travers et des faiblesses. Il soutint qu’Achille, tant vanté par Homère,
n’était qu’un lâche, puisqu’il était invulnérable. « À propos d’Homère, lui
dit le baron, savez- vous, vous qui êtes si savant, à quelle époque Homère,
Sophocle et Euripide écrivaient à Rome ? — À Rome, Monseigneur ! » Je me
crus perdu sans ressource. Fort heureusement, Poussanville était placé à
côté de moi. Je lui pressai le pied, avec le mien, de manière à le faire
crier. Il s’arrêta, la bouche ouverte, et ses grands yeux se portaient alternativement
sur le baron et sur moi. « Hé bien, mon cher Poussanville, vous êtes embarrassé
? — Très-embarrassé, Monseigneur. — Ces beaux esprits là, Monsieur, écrivaient
à Rome sous le consulat de Scipion l’Africain. » L’aide-de-camp continuait
à regarder le patron et moi. Je lui appliquai un
vigoureux
coup de talon sur le pied. Il me comprit enfin, et se tira d’affaire en courtisan.
« On apprend toujours quelque chose auprès de vous, Monseigneur, dit-il en
s’inclinant profondément. » Il est constant qu’une réponse aussi générale
ne pouvait le compromettre.
On quitta
la table, et il me suivit jusque dans ma chambre. Il me demanda l’explication
des niaiseries qui avaient terminé la conversation. Je la lui donnai, et
il rit aux éclats. « Ta femme, me dit-il, manque totalement d’instruction
; mais elle possède ce qui est bien plus utile dans le monde, et surtout
dans les guerres civiles, du bon sens et du jugement. Consulte-la avant que
d’agir. » J’ai dit qu’il avait toujours l’esprit du moment. Il me demanda
si le baron parlait de lui dans sa lettre au duc de Guise. Je lui répondis
que non. « Je vois clair, mon cher Antoine. M. le baron ne peut se passer
de moi, et comme il n’y a pas de grade militaire sans fonctions, il ne dira
pas un mot pour mon avancement. Je m’en occuperai, moi. Je te donnerai une
lettre pour le duc. II t’interrogera, et tu ne seras pas embarrassé pour
lui répondre, parce que je ne lui écrirai que la vérité. Bonsoir. »
Le lendemain
matin un grand nombre d’hommes mal armés s’arrêta aux portes de la ville.
On leur en refusa l’entrée, par une raison très-simple : ils étaient environ
deux mille.
Le prince
de Condé avait eu la fantaisie de faire une incursion jusqu’à Lusignan. Il
avait enlevé aux habitans le peu que nous leur avions laissé. II avait pris
jusqu’à leur linge, pour panser, disait-il, ses blessés. Les vieillards,
les femmes, les enfans, étaient dans le plus affreux dénuement. Les hommes,
les jeunes gens étaient accourus à Poitiers, la rage dans le cœur, et ils
demandaient à grands cris du pain et des mousquets.
Il
n’y avait que deux partis à prendre. Il fallait leur casser les reins à coups
de canon, ou leur distribuer les vivres, qui, pendant quatre jours encore,
devaient nourrir nos cinq cents hommes. Monseigneur n’était pas homme à faire
canonner deux mille soldats qui devaient se ranger sous ses drapeaux. Poussanville
fit faire une distribution à ceux de nos gens qui étaient dans la ville.
Le reste fut chargé sur nos charrettes, et conduit sur les glacis de la place.
Poussanville
mit en ordre les deux mille arrivans, et leur distribua jusqu’au dernier
tonneau de vin. Cela suffisait pour le moment ; mais il fallait pourvoir
aux besoins, qui ne tarderaient pas à renaître. Les habitans de Poitiers
prévoyaient que la famine exaspérerait bientôt les hommes qui étaient dans
la ville, et ceux à qui ils en défendaient l’entrée. Ils avaient des magasins
bien fournis ; mais .ils entendaient ne partager leurs provisions avec personne.
Leur commandant fit battre la générale.
Six
mille hommes se forment dans l’instant en compagnies, en bataillons. Des
chaînes sont tendues dans les rues ; deux mille hommes cernent nos cinq cents
soldats ; ils traînent avec eux six pièces de canon, chargées à mitraille.
Des patrouilles nombreuses parcourent la ville dans tous les sens. Les canonniers
sont sur les remparts, près de leurs pièces ; les mèches sont allumées.
« Poussanville,
qu’allons-nous faire ? — Monseigneur, un général tel que vous se tire toujours
d’un mauvais pas. »
L’aide
de camp aborde le commandant général, d’un air riant.
« Pourquoi
tant de bruit, lui demanda-t-il ? Croyez-vous que nous voulions vivre aux
dépens de braves gens qui nous ont
reçus
comme amis ? Je vais sortir avec mes cinq cents hommes, et je laisse, à votre
loyauté, à vos soins, mon général et son épouse. Je ne vous demande qu’une
chose : si les deux mille hommes, qui sont sur les glacis, tentent de se
débander, forcez- les, à grands coups de canon, à reprendre leurs rangs.
»
Le commandant
de Poitiers n’avait rien à répondre à ces paroles. Poussanville sortit avec
ses cinq cents hommes, et le calme se rétablit dans la ville.
Il déclara
à ceux qui étaient dehors, que, s’ils faisaient le moindre mouvement, l’artillerie
des remparts les écraserait. Il leur promit qu’avant la fin du jour il leur
apporterait des provisions et des armes. Il part avec ses cinq cents hommes,
trente charrettes attelées, et il se jette sur la route de Châtellerault.
Aucun parti protestant n’avait encore paru jusque là.
Il était
six heures du soir, et Poussanville ne paraissait pas. Nos recrues de Lusignan
murmuraient, criaient, mais n’osaient faire un mouvement. Monseigneur était
trop brave pour rester enfermé dans une place, dont l’accès était interdit
à ses soldats. Il sort; je le suis. « Bien, très-bien, me dit-il, en souriant.
Je vois que je peux vous employer de toutes les manières. »
Le baron
parla aux troupes avec une bienveillance mêlée de fermeté. Il ne pouvait
invoquer les principes religieux à l’égard de gens que nous avions commencé
à ruiner. Il leur représenta que la misère leur imposait la nécessité d’être
soldats ; il leur conseilla de se résigner, et il promit de l’avancement
à ceux qui se conduiraient bien. Tout cela était bel et bon, mais il fallait
souper. « Je partagerai vos privations, leur dit monseigneur, je reste au
milieu de vous, je ne vous quitte plus. Mais, pourquoi
ne
pas espérer ? M. de Poussanville va paraître, et notre sort changera. » Monseigneur
cherchait à faire naître des espérances, que lui-même il n’avait plus.
Un certain
bruit confus se fit entendre dans le lointain. Chacun prête une oreille attentive.
Bientôt on croit reconnaître le son des tambours. « Le voilà, s’écria le
baron. Le voilà, criai- je, à me briser la poitrine. » Monseigneur ne savait
encore si la troupe qui s’approchait était commandée par le prince de Condé,
ou par Poussanville. Il mit ses deux mille hommes sous le canon de la place,
et il attendit les événemens.
Il pensa
bientôt qu’il n’était pas possible que Condé vînt avec une poignée de soldats,
s’exposer à périr sous les murs de Poitiers. Il fut le premier à rire des
dispositions qu’il avait faites, et bientôt Poussanville prit le grand galop,
et arriva auprès de son général. « Monseigneur, lui dit-il, on fait toujours
de bonnes affaires, quand on parcourt un rayon de quelques lieues, dans un
pays vierge encore. » En effet, on n’avait pas encore tiré un coup de fusil
dans le haut Poitou et dans la Touraine. Mais on s’armait partout.
Poussanville
avait parcouru les villages situés entre Poitiers et Châtellerault. Les notables
de chaque commune avaient fait des amas d’armes et de vivres. Ils n’attendaient
qu’un ordre du duc de Guise pour s’enfermer dans Châtellerault et dans Tours.
Poussanville n’eut que la peine de prendre. Partout il employait ses argumens
ordinaires, qui ne persuadaient personne ; mais ils étaient appuyés par cinq
cents hommes bien armés.
Il amenait
quatre-vingts charrettes ou charriots, traînés par des chevaux, des mulets
et des ânes. Tout cela était plein de biscuit, de farine, de viandes salées,
de barriques de vin, et de caisses
d’armes.
Un troupeau de cent vingt bœufs marchait en tête du convoi, et le baron n’avait
pas encore dépensé un écu.
Il embrassa
son aide-de-camp, à plusieurs reprises, avec une vivacité, une chaleur qui
annonçaient les sentimens de la plus tendre affection, et de la plus profonde
reconnaissance. « J’ai pensé, lui dit-il, à demander pour vous un régiment
au duc de Guise ; mais vous voyez, mon cher, mon meilleur ami, que je ne
peux me séparer de vous ; vous êtes réellement mon bras droit. — Je n’ai
fait que mon devoir ; mais puisque monseigneur me fait l’honneur de me vouloir
du bien, qu’il me fasse nommer officier-général, employé sous ses ordres.
— Je n’y pensais pas. Oui, morbleu, tu seras maréchal-de-camp, ou je ne m’appelle
pas Biron. »
On buvait,
on mangeait autour de nous ; des chants joyeux avaient succédé aux plaintes,
aux murmures. Poussanville déclara qu’il resterait avec les soldats de Lusignan,
pour les armer et maintenir le bon ordre. Nous marchâmes vers la ville, monseigneur
et moi. Nous étions suivis de nos cinq cents hommes d’élite. On nous reçut
tous les deux ; mais on baissa la herse devant nos soldats. « Ces gens-là
sont bien défians, me dit le baron. — Hé, Monseigneur, croyez-vous qu’ils
aient tort ? »
Nous
rentrâmes à notre logement, et le premier soin de M. de Biron fut de me faire
ouvrir mes dépêches. Il me dicta l’éloge le plus pompeux de Poussanville,
qui, brigandage à part, le méritait bien. Il demanda pour lui le grade d’officier
général, avec des instances qui ne permettraient pas au duc de Guise de le
refuser. Que lui importait, d’ailleurs, qu’il y eût un maréchal- de-camp
de plus ou de moins dans les armées de la ligue ?
«
Quelle guerre, quels hommes, quelle duplicité, me disait Colombe ! faut-il
que nous soyons irrévocablement attachés à de tels êtres ! mon cher Antoine,
sanctifions notre vie par la prière et par l’amour conjugal. — Oh, oui, ma
Colombe. » Et nous priâmes, et…
Le lendemain,
mon silencieux tailleur, sa femme et quelques garçons se présentèrent avec
des vêtemens d’une richesse éblouissante. Monseigneur n’en portait pas d’aussi
beaux ; à la vérité, il s’appelait Biron.
Avec
quel plaisir je regardais mon tailleur me dépouiller de l’habit râpé de mon
père, m’essayer des hauts-de-chausses, une trousse, un pourpoint, un manteau
court, faits des étoffes les plus riches, et de couleurs variées. Une toque
de velours noir, ornée d’une plume blanche qui me tombait sur l’oreille,
acheva de me tourner la tête. Oh, non, non, je n’étais plus le petit frère
Antoine ; j’étais réellement M. de la Moucherie.
Le tailleur
sortit, et sa femme s’occupa de Colombe. L’art, dit-on, n’ajoute rien à la
beauté. Cette idée est fausse, de toute fausseté. Les grâces, les amours,
semblaient accourir, et se cacher dans les plis de la robe de Colombe, sous
son corset, dans sa fraise, dans les crochets de ses cheveux, Elle se regardait
dans un petit miroir d’acier qui se trouva sous sa main ; elle était dans
l’enchantement. Je regardais, je dévorais des yeux madame de la Moucherie.
« Il
faut avouer, me dit-elle, quand nous fumes seuls, que monseigneur a réellement
de grandes qualités. — Il en a d’admirables, ma Colombe. — Il pille un peu
; mais c’est pour la bonne cause. Il est écrit : mangez ce que vous trouverez.
—
Et
il est évident que Poussanville a trouvé tout ce qu’il a amené hier.
»
Nous
voulûmes jouir de notre métamorphose ; cela était tout simple. Colombe était
femme, et je n’avais que vingt ans. Nous rencontrâmes dans les escaliers
monseigneur et Poussanville. Ils s’arrêtèrent, et nous mesurèrent des yeux.
« Qu’ils sont bien ! dit le baron. » Et nous rougîmes, moi de plaisir, et
Colombe de pudeur. « M. de la Moucherie, vous verrez le roi, et vous pourriez
remplacer Livarot, qui, sans doute, est allé se rendre au prince de Condé
pour mettre sa jolie figure à l’abri des accidens. »
Je ne
compris rien à ce que me disait monseigneur. Ah, pensais-je, il a quelquefois
un style entortillé. Les grands politiques ont intérêt à ne pas se laisser
pénétrer, et ils contractent l’habitude de s’exprimer énigmatiquement.
Nous
parcourûmes toutes les rues de la ville, et un murmure d’approbation ne cessait
de flatter notre oreille. « Il est seulement fâcheux, dit un homme à un autre,
qu’elle manque de moelleux dans les mouvemens. » Elle a les hanches et les
genoux ankilosés ; mais elle est jeune, et cela pourra se dissiper.
» Je
regardai Colombe. Elle était droite, et roide comme un piquet. « Ma chère
amie, » lui dis-je, sois toujours, dans ta marche au moins, la charmante
petite fille qui décorait de fleurs l’oratoire de madame. Le joli garçon!
dirent des femmes, qui nous attendaient au coin d’une rue. — Oui, mais comme
il est serré dans ses habits ! On voit bien qu’il n’a pas l’habitude de les
porter. Mon cher ami, me dit Colombe, d’un petit air piqué, sois toujours,
dans ta marche au moins, ce joli petit frère Antoine, qui n’eut besoin que
de paraître pour se faire aimer. »
Un
éclat de rire partit derrière nous. C’était Poussanville.
« Vous
ne vous apercevez donc pas qu’on se moque de vous. Des habits sont faits
pour servir et être usés. Après ceux-là, vous en mettrez d’autres. Le tailleur
et la couturière vont déposer dans votre chambre ce qui constitue une garde-robe
complète.
« Retournez
chez le baron. Nous allons sortir de la ville. M. Perrier, épicier en gros,
commandant la force armée à Poitiers, a interdit l’entrée de la ville à nos
cinq cents hommes. Il pourrait très-bien finir par emprunter au baron ses
quatre-vingt-dix mille livres. Je vais moi, lui emprunter, ou lui acheter
des effets de campemens dont il n’a pas besoin. Madame la baronne ne peut
ni se confiner dans sa coche, ni être exposée à la pluie, ou au soleil. »
Nous
retournâmes sur nos pas, et nous marchâmes avec la plus grande aisance :
des habits de rechange nous attendaient chez nous. Je tournais la tête, de
tems en tems, pour juger de l’effet nouveau que nous devions produire. Je
vis un jésuite aborder Poussanville d’un air mielleux. C’est singulier, pensai-
je, il y a des jésuites partout, et je n’ai encore aperçu que celui- ci,
depuis que nous sommes sortis de la Rochelle.
Nous
rentrâmes chez nous. « Mon ami, me dit Colombe, n’oublions pas, auprès de
nos supérieurs, ce que nous avons été. Allons leur offrir nos services. »
Ce conseil était très-bon, et je le suivis avec empressement. On n’avait
pas besoin de nous ; mais cet acte de modestie et de déférence parut plaire
beaucoup à monseigneur et à madame.
Tout
était en mouvement. Les domestiques, les femmes, refaisaient les malles,
les valises, les paquets. « C’était bien la
peine,
chuchotaient-ils, de défaire tout cela pour si peu de temps. » Je savais
le fin mot. Je me gardai bien de le leur dire. Nous allâmes faire, de notre
côté, nos dispositions de départ.
Poussanville
revint. Perrier ne donnait rien. Il avait fallu lui acheter, fort cher, six
tentes, avec leurs accessoires. L’aide-de- camp venait prendre de l’argent
et un fourgon.
Les
effets de Colombe et les miens étaient descendus, et placés avec le gros
des équipages. Mon premier penchant se reproduisait toujours, quand j’étais
désœuvré, et je ne pouvais toujours faire l’amour à ma femme. Je descendis,
je montai, j’allai, je vins ; j’observai, j’écoutai tout. Je ne vis, je n’entendis
lien de nouveau : je connaissais tous mes personnages, leurs secrets, leurs
principes, leurs inclinations. Mais quand Poussanville rentra, je l’abordai
avec empressement. Il était tout simple que je susse ce que lui voulait le
jésuite qui l’avait abordé dans la rue. « Nous parlerons de cela, j’en parlerai
au baron, quand la caisse sera en sûreté. »
Bientôt
les ponts-levis de la place s’abaissèrent devant nous. Nous en sortîmes,
sans que les habitans nous marquassent ni satisfaction, ni regret. Perrier
pouvait avoir une arrière-pensée, et le baron jugea à propos de se mettre
hors de la portée du canon des remparts. Poussanville mit les troupes en
mouvement, et nous allâmes camper à une lieue de la ville. « Eh bien ! ton
jésuite ? Que t’a-t-il dit ? Où voulait-il t’amener ? — Viens avec moi. »
Nous
nous plaçâmes auprès du baron, qui était assis sur l’herbe. « Monseigneur,
on ne peut pas toujours être en mouvement. Un peu de repos est nécessaire,
et une historiette le rend quelquefois agréable.
«
J’ai rencontré près de la grande place, un jésuite qui paraissait ne respirer
que l’humilité. Il venait à moi, et me regardait d’un air qu’il croyait très-pieux,
et que j’ai trouvé ridicule, parce qu’il était affecté. Il me semblait voir
un loup couvert d’une peau d’agneau. Mon homme était embarrassé. Il a débuté
par des roulemens d’yeux, des soupirs, et même des hocquets : il me prenait
pour un sot. Il étudiait ses mots ; il les cherchait, et ne me disait par
conséquent que des choses insignifiantes. Au fait, lui ai-je dit. Pourquoi
les révérends pères jésuites ne se sont-ils pas trouvés à la cathédrale avec
les autres moines de Poitiers ? pourquoi aucun de vous n’est-il sorti de
son couvent, depuis que nous sommes dans cette ville ? je vous le dirai,
si vous le voulez. Il m’a répondu avec componction, que la règle de son ordre
ne permet pas ces éclats, ces sermons ambitieux, ouvrage de l’orgueil, et
quelquefois de la cupidité.
-
Ce n’est pas cela, mon père, ce n’est pas
cela. —Nous restons chez nous, et nous prions pour nos amis et nos ennemis.
-
Père, vos amis sont ceux qui vous sont soumis
; vos ennemis sont ceux qui vous jugent, et qui veulent vous arrêter dans
votre marche tortueuse. Vous désirez que les catholiques soient vainqueurs,
parce que leur triomphe assurera votre crédit et vos dotations. Mais le succès
est encore incertain, et vous attendez plus que des probabilités pour vous
déclarer ouvertement. En attendant, vous poussez dans les chaires et les
confessionnaux ces moinillons, qui ne sont propres qu’à souffler un fanatisme
aveugle, et si la ligue succombe, les protestans ne pourront vous reprocher
aucun acte, aucune démarche hostile. Voilà, n’est-ce pas, la véritable règle
de votre ordre. Allons, jetez votre masque : nous sommes seuls ; je ne peux
vous compromettre.
« Un
changement subit s’est opéré dans son ton, ses gestes, et sur sa physionomie.
Vous avez de l’esprit et du jugement, m’a-
t-il
dit. On me l’avait assuré, et je vois qu’on ne m’a pas trompé. Me voici
où je voulais venir, car je vous ai abordé pour quelque chose. Une balle
de mousquet tue un homme de mérite, comme un manant. Faites-vous jésuite.
Dans quelques années, vous serez provincial de France, et vous n’aurez au-dessus
de vous que notre général et le pape, à qui nous obéissons exclusivement.
Qu’est-ce qu’un roi, comparé à un jésuite ? nous lui accordons des marques
extérieures de respect, quand il suit la route que nous lui avons tracée
; nous savons nous en défaire, quand il se met en opposition avec nous. —
Père, je combats mes ennemis à force ouverte ; je ne connais ni le poignard,
ni le poison. — Ah, vous avez des scrupules ! — Je suis honnête homme. —
C’est votre dernier mot ? — Absolument. — Parlons d’autre chose.
« La
ligue s’étend de province en province. — Qui vous l’a dit, mon père ? — Avec
l’air de tout ignorer, nous sommes instruits de tout. Bientôt le duc de Guise
aura des armées sous ses ordres ; mais le roi Henri de Navarre est brave
comme lui ; général consommé comme lui ; noble et généreux comme lui. Il
a comme lui, l’art de gagner tous les esprits. Il s’attache les catholiques
mêmes, du midi de la France, par sa tolérance et sa bonté. Nous faisons répandre
partout qu’il est l’ennemi le plus dangereux de la religion. Nous excitons
contre lui toutes les haines, parce qu’il faut que d’une manière ou d’autre,
nous en soyons débarrassés. — Père, vos projets sont ceux d’un lâche, d’un
infâme. — Vous prenez un masque à votre tour. Croyez- vous que je ne vous
aie pas déjà pénétré ? continuons à nous parler franchement. Vous voulez
que Henri de Navarre vive, parce qu’il est l’âme de son parti, qui tomberait
avec lui. Vous êtes ambitieux ; vous voulez parvenir aux premières places
de l’armée, et vous sentez qu’une longue paix vous ferait retomber
dans
l’oubli dont vous commencez à peine à sortir. En quatre mots, voilà toute
votre histoire. Je lui ai serré la main, je lui ai demandé son nom, et je
lui ai tourné le dos.
« Hé
comment s’appelle-t-il, demanda mon-seigneur ? — Il se nomme Guignard. —
Ne l’oublions pas. Cet homme-là est appelé à jouer un grand rôle, s’il n’est
pas pendu. » Voici un moine, pensai-je, qui n’a d’un religieux que l’habit.
Le père prieur des franciscains m’a parlé quand j’allais à la Rochelle comme
un hérétique, une espèce de philosophe, et hier il a prêché en véritable,
en zélé catholique. A-t-il, comme le père Guignard, deux poids et deux mesures
? ne suis-je pas moi- même entraîné tantôt vers mon patron tantôt vers une
gloriole qu’il méprisa pendant toute sa vie ? quand rencontrerai-je donc
un homme véritablement estimable ?
Pendant
toute la journée, il nous arriva des pelotons de recrues. C’étaient ceux
à qui Poussanville avait tout enlevé. « Je vois, me dit Colombe, que le moyen
le plus sûr de trouver des soldats est de ruiner le peuple. Pauvre peuple
! Et ces gens-ci crient vive la Ligue, en demandant du pain. Ma Colombe se
formait.
Il était
clair que monseigneur allait avoir une armée, et qu’il ne tarderait pas à
prendre l’offensive. Mais que fera-t-il de madame ? Elle ne peut passer sa
vie sous la tente, et une défaite la mettrait à la discrétion des huguenots.
Le sort de Colombe allait devenir plus incertain encore. Nous partons demain,
seuls, sans moyens de défense, sans savoir où chercher le duc de Guise. Il
faudra errer à l’aventure. Si nous tombons dans un parti de huguenots, et
même de catholiques, on remarquera Colombe, on m’attaquera. Je me ferai tuer
sans doute ; mais Colombe, Colombe !... cette idée est désespérante.
Ces
réflexions venaient bien tard. Cependant, je les communiquai à Poussanville.
« La première qualité d’un homme qui veut parvenir, me dit-il, est de ne
jamais se défier de sa fortune. La tienne t’a bien servi jusqu’à présent,
pourquoi t’abandonnerait-elle ? — Pourquoi me serait-elle constante ? — Mon
pauvre Antoine, tu n’avances qu’en tâtonnant : tu ne feras jamais rien. »
Il alla
cependant faire part de mes observations au baron et à madame. Madame trouva
que j’étais plein de bon sens. Elle déclara que depuis son entrée à la Rochelle,
elle n’avait trouvé de ressource contre l’ennui que dans la prière ; qu’elle
était fatiguée de suivre des guerriers, avec qui elle n’aurait jamais de
repos ; que d’ailleurs, elle ne voulait pas s’exposer à des dangers de toute
espèce, et sans cesse renaissans.
Quelle
est la jeune femme, qui n’exerce pas un pouvoir absolu sur un mari de cinquante
ans ? Monseigneur assura madame qu’il allait penser à la mettre en sûreté,
et à lui procurer une résidence agréable ; mais il ne savait à quelle idée
s’arrêter. Tous les moyens qu’il voulait employer présentaient de graves
inconvéniens, et, pour la première fois, la féconde imagination de Poussanville
ne savait où se fixer… Ah ! oui, oui, il faut toujours croire à sa fortune…
Et à la vertu de sa mère et de sa femme.
Un de
nos officiers nous amena un père capucin qui venait de Blois, et qui allait
à Poitiers. C’était un émissaire du duc de Guise. Un capucin passe partout,
à la faveur de sa robe de bure et de sa pauvreté. Celui-ci marchait, sa robe
retroussée, la besace sur l’épaule, et un gros bâton à la main. Personne
n’eût pu deviner, en lui, un agent du prince le plus fier de l’Europe. Poussanville
commença par lui rire au nez. « Monsieur, lui dit
le
père Jean-François, on dédaigne la fourmi, et elle est plus ingénieuse que
bien des hommes, qui croient avoir beaucoup d’esprit. » M. l’aide-de-camp
savait réparer une faute. Il fit asseoir le bon père, lui offrit des rafraîchissemens,
et le baron l’interrogea.
« Monseigneur
le duc de Guise, qui est incontestablement un grand homme, puisqu’il protège
les capucins, m’a ordonné de reconnaître la force de toutes les places, depuis
Blois jusqu’aux avant-postes du prince de Condé. J’ai rempli jusqu’ici ma
mission avec beaucoup de bonheur, grâce à mon obscurité, et je n’irai pas
plus loin, puisque je rencontre ici le grand général Biron et une armée.
J’obtiendrai de lui les renseignemens qui me manquent encore. —Et où est
le duc de Guise ? — À Blois, Monseigneur. — À Blois ! Et que fait-il là ?
— Vous ne savez donc rien, Monseigneur ? — Oh, absolument rien. — Le roi,
la
reine
mère, et toute la cour sont dans cette ville. On va y ouvrir des Etats-généraux15. — Ah, ah ! Et le duc de Guise ne redoute pas cette
assemblée ? — Je crois, répondit le père, en souriant, qu’il pourrait bien
avoir fait nommer le plus grand nombre des députés. Cela lui aura coûté
cher ; mais les trésors du roi
d’Espagne
sont à sa disposition. Il nomme à toutes les places, et vous sentez bien,
Monseigneur, que des députés de son choix voteront selon ses vues. —Pas mal,
pas mal, pour un capucin.
— Le
duc a étendu jusques sur moi sa bienfaisance toute paternelle. Il me fera
nommer gardien du premier couvent de notre ordre où cette dignité vaquera.
— C’est trop juste, père Jean-François. — N’est-il pas vrai, Monseigneur
? » Encore un ambitieux sous la bure, me dis-je !

15 À l’hiver 1576 (B.G.)
Monseigneur
me fit tirer mon écritoire de poche, et j’écrivis, sous la dictée de Poussanville,
tout ce que sa révérence avait besoin de savoir.
Le baron
avait pris son parti. Quatre de nos meilleurs chevaux étaient attelés à la
coche de madame ; deux mulets l’étaient à ma modeste, mais élégante voiture.
Vingt-cinq de nos meilleurs soldats arrangeaient des bâts pour leur tenir
lieu de selles. Ce n’étaient que des chevaux de trait qu’ils allaient monter
; mais dans les circonstances difficiles, on se sert de ce qu’on a. « Si
nous étions partis seuls, dis-je à Colombe, on n’aurait pas pensé à nous
donner une escorte. »
« M.
de la Moucherie, me dit le baron, d’après le rapport du père capucin, il
paraît que les chemins sont libres d’ici à Blois. Cependant j’ai voulu pourvoir
à votre sûreté. À ma sûreté !
« Vous
allez partir, et vous vous chargerez de conduire madame. Le comte de Montbason,
mon ami intime, a sa terre près de Tours. Je ne présume pas qu’il soit dans
son château. Cependant, vous y déposerez madame et sa suite, et vous continuerez
votre route sur Blois, avec ou sans madame de la Moucherie, selon que vous
le jugerez à propos. Le père Jean- François s’approcha, les yeux baissés
et les mains croisées sur la poitrine. « Monseigneur, il fallait que je me
glissasse de Blois jusqu’ici dans le plus grand incognito ; mais ne pourrais-je
obtenir de votre Grandeur un cheval qui me reportera jusqu’à mon couvent
? — Un cheval, mon révérend père ! — Monseigneur, S. François peut aller
à cheval, puisque S. Pierre va en carosse. — C’est juste, c’est très-juste.
Il est toujours permis de penser à soi. Qu’on donne un mulet à sa Révérence.

Homme au
bilboquet
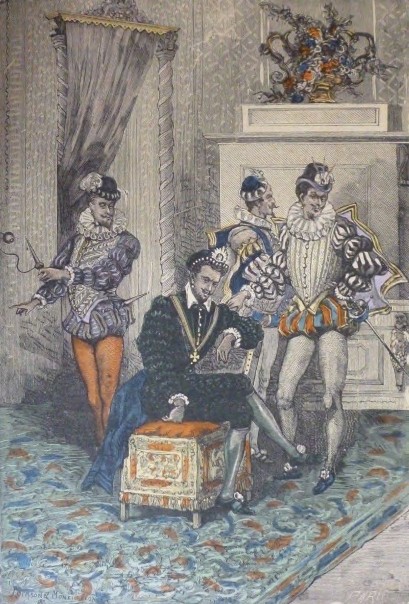
Henri
III, ses mignons et leurs bilboquets
CHAPITRE
VII
M.
de la Moucherie est introduit à la cour.
Nous
partîmes, assez satisfaits, les uns et les autres, de n’être plus exposés
à batailler, tantôt avec un parti, tantôt avec l’autre. La corne d’abondance
était dans un de nos fourgons, et cette précaution donna des idées riantes.
Nos vingt-cinq cavaliers s’étaient fait des bottes avec des chiffons de toutes
les couleurs, des éperons avec des pointes d’aubépine, et des brides avec
des bouts de ficelle. Ils étaient placés, sur leurs bâts, comme doivent l’être
des fantassins. Le buste se portait à droite, à gauche ; une main ferme saisissait
la crinière du cheval, et rétablissait l’équilibre. Quatre cavaliers, exercés
et bien montés, eussent passé sur le ventre à notre escorte. Mais, comme
l’avait très-exactement observé le père Jean-François, les chemins étaient
libres.
Des
éclats de rire partaient de la coche de madame. Quand madame rit, ses femmes
doivent rire. Ces accès de gaîté étaient causés par la tournure grotesque
de nos cavaliers. Bientôt, ils rirent eux-mêmes les uns des autres. Le rire
se communique
comme
le bâillement : Colombe et moi, très-sérieusement occupés, par goût et par
habitude, ne pûmes nous retenir plus longtemps. Nous partîmes enfin, et nous
complétâmes le chœur général.
On ne
peut pas toujours rire. Dans les momens de repos, madame entonnait un cantique
de M. Jodelle, seigneur du Limodin, qui venait de mourir, mais dont les œuvres
vivront éternellement. Ses femmes faisaient chorus ; nos cavaliers chantaient
des chansons de corps de garde ; Colombe et moi soupirions la tendre romance,
ce qui formait un concert très- varié, et surtout très-bruyant.
N ous
voyageâmes ainsi, satisfaits du présent, et sans inquiétude de l’avenir.
Les
maux viennent sans qu’on s’en occupe, sans qu’on puisse les éviter, et il
y a de la philosophie à ne pas les prévoir. Nous arrêtions le soir devant
la première maison un peu marquante qui s’offrait à nous, et le nom de madame
de Biron en ouvrait les portes.
Nous
arrivâmes enfin au château de Montbason, château gothique, orné de créneaux,
de tours, et environné de fossés larges et profonds. On y avait réuni tous
les ruisseaux du canton, et les vassaux, habitans à une lieue ou deux sous
le château, n’avaient d’eau que lorsque le seigneur jugeait à propos de faire
lâcher ses écluses, ce qui est juste, puisque cet usage est consacré par
des siècles.
Notre
baron avait pensé, avec raison, que le comte ne serait pas chez lui ; il
était à Blois, et son absence rendait madame de Montbason extrêmement circonspecte.
Nous trouvâmes les
ponts
levés, et nous aperçûmes quelques fusils de rempart que des domestiques dirigeaient
contre nous. Il ne s’agissait plus de rire, ni de chanter.
Madame
de Biron convenait que nos cavaliers ressemblaient plutôt à des voleurs qu’à
des soldats. Ils pouvaient, d’ailleurs, être l’un et l’autre ; c’était encore
un usage du temps. Il était donc tout simple que madame de Montbason se mit
en défense.
Notre
baronne assembla son conseil, qui se composait d’elle et de moi. Il fut décidé
que je me présenterais en parlementaire, et que j’applanirais les difficultés.
Ma tendre Colombe me pressait dans ses bras ; elle voyait autant de canons
qu’il y avait de fusils aux créneaux des murailles ; elle me voyait, percé
de coups, expirant sur son sein. Dans le fait, cela pouvait fort bien m’arriver.
Je l’entrainai
derrière la coche de madame, où nous étions à l’abri des coups. Là nous tombâmes
à genoux, et nous invoquâmes, avec ferveur, l’assistance de mon patron. L’amour
et des idées purement mondaines m’avaient, depuis quelques jours, exclusivement
occupé. Je lui demandai humblement pardon de ma négligence, et Colombe lui
promit un cierge de dix livres, s’il me ramenait auprès d’elle.
Ces
importans préliminaires ne nous rassurèrent pas ; mais ils me donnèrent la
force d’avancer vers le château, et à elle celle de me le permettre. Je m’approchai
du bord du fossé, mis comme un seigneur, et agitant le mouchoir blanc que
madame venait de me remettre. Un esquif, qui ne pouvait porter au plus que
deux hommes, se détacha de l’autre bord du fossé, et vint me prendre. Je
n’avais que vingt ans, j’étais porteur d’une jolie figure, et mon extérieur
annonçait un homme de qualité.
Madame
de Montbason se rassura en me voyant ; elle sourit, quand je lui nommai madame
de Biron, et elle me donna sa main à baiser.
Il fallut
faire des conditons ; mais elles furent bientôt réglées.. La comtesse consentit,
avec joie, à recevoir madame et ses femmes, mais elle déclara, que moi excepté,
aucun homme n’entrerait au château : elle n’avait avec elle que douze domestiques.
Il fut stipulé que notre escorte et nos valets s’éloigneraient d’un demi-quart
de lieue, avant que les ponts fussent baissés, et qu’alors Madame et ses
équipages seraient admis.
Je fus
reconduit avec les précautions qu’on avait prises pour me recevoir. Colombe
me revit, je la retrouvai, et nous rendîmes de ferventes actions de grâces
à mon patron, qui m’avait préservé.
Nous
lui devions un cierge de dix livres, et la difficulté était de le trouver.
Si le vœu ne s’accomplissait pas, le grand S. Antoine pouvait nous retirer
sa faveur. Comment faire ? Nous consultâmes Madame.
Elle
trouva le cas très-épineux. Elle pria avec nous, et notre patron nous inspira
l’idée de le supplier d’attendre que nous ayons le bonheur de pouvoir remplir
notre vœu.
L’exécution
de la clause importante exigée par la comtesse, n’éprouva aucune difficulté.
L’officier qui commandait notre escorte, répondit de la docilité de sa troupe
; mais il demanda que le fourgon qui portait les vivres lui fut abandonné.
Il monta, sans attendre de réponse, un des chevaux qui le traînait. Dans
un
instant, nous perdimes nos cavaliers de vue. Il était clair que mon, patron
avait reçu favorablement nos excuses.
J’ai
su depuis, que ces braves gens s’étaient dispersés dans la campagne ; qu’ils
avaient rejoint religieusement monseigneur ; mais que leurs chevaux étaient
chargés de butin, quand ils se réunirent à lui. Ils avaient trouvé à glaner,
après l’abondante récolte faite par Poussan ville.
Notre
entrée au château fut une espèce de triomphe. La comtesse fit décharger trois
fois ses fusils de rempart.
Accompagnée
desa dame d’atour et de son écuyer, elle s’avança au-devant de Madame, jusqu’au
milieu de la cour d’honneur ; elle lui donna des marques de la plus sincère
affection, et elle daigna faire des signes de bienveillance à ses femmes.
L’écuyer s’approcha de Colombe, et voulut lui donner la main : je me chargeai
de ce soin-là.
Nous
marchâmes vers le château au milieu de deux files de domestiques, dont chacune
était composée de six hommes, et nous fumes conduits au bel appartement.
Les
femmes de Madame s’étaient arrêtées dans une antichambre, où elles furent
reçues par celles de la comtesse.
« M.
et Mme de la Moucherie, dit la baronne, peuvent rester avec nous : ce sont
de pieux personnages, qui me portent bonheur. » La piété de la comtesse n’était
pas aussi solide que celle de madame ; mais elle m’avait vu ; elle me voyait
encore avec intérêt, et il n’est pas dans les convenances de séparer une
femme de son mari. Nous fûmes admis, pour la première fois, dans l’intimité
de dames d’une haute distinction. Nous nous mîmes à table.
La
baronne fut placée au haut bout, cela était tout simple ; la comtesse s’assit
en face ; Colombe et moi, nous occupâmes les flancs. Le majordome dirigeait
le service, d’après les signes de la comtesse.
Elle
avait pour madame et pour moi, des attentions marquées, recherchées, soutenues.
Elle se plaignit bientôt d’un pied de table qui la gênait, et elle s’approcha
de moi ; cela était tout simple. Un moment après, je sentis quelque chose
qui s’appuyait doucement sur le dessus de mon soulier de buffle. Je regardai
sous la table, et je reconnus le pied de la comtesse. Je retirai le mien,
je me levai, et je lui adressai mes excuses respectueuses.
Quelques
minutes ensuite, j’eus le malheur de rencontrer son genou, dont je croyais
le mien à une distance convenable. Je me levai de nouveau, et je lui renouvelai
mes très-humbles excuses. Madame de Biron sourit ; la comtesse rougit, pâlit.
Colombe nous regardait d’un air qui voulait dire : qu’est-ce que cela signifie
? « M. de la Moucherie, me dit la comtesse, vous êtes sans cesse en mouvement.
Éloignez-vousun peu, je vous en prie. — Je vous proteste, Madame. En voilà
assez, me dit la baronne, approchez-vous de moi. » La conversation tombe
nécessairement, quand les principaux personnages sont embarrassés, et je
remarquai beaucoup d’embarras. Moi, je ne disais rien ; je ne savais pas
encore que les inférieurs dussent amuser ceux qui mettent la table. Colombe
gardait le plus profond silence.
Madame
de Biron le rompit la première. Elle annonça que j’étais porteur de dépêches
pour le roi et M. de Guise, et que je partirais le lendemain matin.
«
Vous ferez bien, Monsieur, me dit la comtesse, je vous crois plus fait pour
les affaires que pour le grand monde. » Chacun se retira dans le logement
qui lui était assigné.
La baronne
me tira à part. « Mon cher Antoine, il est des femmes qui ne se respectent
pas assez. Un honnête homme doit les ménager ; la charité le lui ordonne.
Soyons sévères pour nous-mêmes, et indulgens pour les autres. Pendant le
souper, vous vous êtes permis des esclandres ! — Qu’ai-je donc fait, Madame
? — Vous n’avez péché que par ignorance de certains usages, je le vois ;
mais, mon ami, quand vous rencontrerez, sous une table, le pied ou le genou
d’une femme, n’ayez pas l’air de vous en apercevoir. »
Je n’entendais
rien à ce que madame me disait. Je la regardais d’un air inquiet, étonné.
Elle sentit la nécessité de se faire comprendre. « Ah, c’est cela, m’écriai-je
! je serai toujours Joseph pour toutes les Putipbar que je rencontrerai.
Moi j’oublierais ma Colombe ! je lui serais infidèle ! je lui manquerais
à ce point là ! Je ne la trahirais pas pour la reine Catherine. — Je le crois
; elle a cinquante ans.
« Il
est décidé que vous partez demain. Votre blessure va bien ; vous prendrez
le meilleur de mes chevaux, et vous attacherez vos bagages sur vos mulets.
Un domestique de la comtesse les conduira. — Et Colombe, madame ! — Je vais
maintenant vous donner un conseil que vous suivrez, si vous êtes sage. Vous
allez dans une cour corrompue, agitée par des partis qui s’accusent réciproquement
de toutes les fautes qui se commettent. Colombe est très jeune, elle est
charmante ; on vous l’enlèvera. — Oh ciel ! Oh mon patron ! — Et si l’enlèvement
fait quelque bruit, au milieu des grandes affaires dont on est occupé, les
royalistes accuseront les Guisards, les
Guisards
accuseront les royalistes, et les deux partis se moqueront de vous : c’est
le sort des maris, victimes de semblables événemens. — Me séparer de Colombe
! — Laissez-la-moi, ou exposez-vous à la perdre. — Madame, je ne survivrais
pas à ce malheur. — Laissez-la-moi donc. Je veillerai sur elle comme si elle
était ma fille. — Ah, Madame, que de bontés ! mais Colombe consentira-t-elle
? Envoyez-la-moi. »
Madame
m’avait vaincu, en me faisant voir Colombe arrachée de mes bras. Elle la
gagna en présentant à son imagination son mari mourant pour la défendre.
Nous passâmes la plus cruelle et la plus douce des nuits. Une douleur amère
succéda aux transports de l’amour le plus tendre et le plus légitime. Le
temps s’écoula dans ces alternatives, et le soleil reparut, sans que nos
yeux se fussent fermés.
Madame,
en nous quittant, était entrée chez la comtesse, et avait tout arrangé selon
la raison et ses désirs. Madame de Montbason devait être bien aise de me
voir partir, et elle avait marqué à la baronne la plus grande facilité. Le
domestique, qui devait m’accompagner, vint me dire que tout était prêt.
Colombe
me tenait dans ses bras ; je m’en arrachai. Je descendis les degrés ; elle
était sur mes pas. Je m’arrêtai, je me tournai vers elle. Que de charmes,
et en même temps quelle candeur ! L’amour étincelait dans ses yeux ; la pudeur
brillait sur son front. Elle ressemblait à l’innocence, qui aime avec passion,
et qui ne pense pas à se le dissimuler. Je retombai dans ses bras, pour m’en
arracher encore. Elle revenait se précipiter dans les miens, et elle arrosait
mes joues de ses larmes. Je fis un dernier effort ; je m’élançai sur mon
cheval, je franchis le pont au galop et je me jetai dans la campagne. Je
m’arrêtais souvent. Je portais des regards avides sur ces tourelles qui recelaient
mon
bonheur, ma vie, mes espérances. Le château ne m’offrit bientôt plus qu’une
masse légère et vaporeuse, qui se perdit enfin dans l’atmosphère.
Je m’éloignais,
et déjà je ne pensais plus qu’au retour. Je me retraçais ces scènes délicieuses,
source inépuisable de fëlicité, Il ne m’en restait que le souvenir.
Je sentis
enfin qu’il fallait m’occuper uniquement de ma mission : c’était le moyen
de la terminer promptement. Je m’efforçais de porter toutes mes idées sur
Blois ; des distractions déchirantes me ramenaient au château de Montbason.
Le grand air, l’aspect d’objets variés et toujours nouveaux me calmèrent
insensiblement. Dans le fait, mon absence pouvait n’être que de quatre jours.
Oui, mais il n’y en avait pas huit que j’étais marié.
Je poussais
vivement mon cheval et je ne pouvais le faire aller au gré de mon impatience.
Cependant le domestique et mes mules restaient en arrière, et je m’arrêtais
pour les attendre. Dès qu’ils m’avaient rejoint, je reprenais le galop, pour
m’arrêter encore : je faisais l’enfant.
Nous
arrivâmes à Pocé. Le domestique me représenta qu’il fallait nécessairement
laisser reposer nos bêtes. La mienne haletait : je sentis la nécessité de
m’arrêter.
Je repartis,
après deux heures, qui me parurent plus longues que le temps qui s’était
écoulé depuis mon entrée à la Rochelle. A la chute du jour, je me présentai
aux portes de Blois.
L’officier
qui commandait le premier poste, me demanda ce que je voulais. « Je suis
porteur de dépêches pour le roi. » Il
sourit
d’un rire ironique, et me dit de passer. Ah ! pensai-je, ces troupes ne sont
pas royalistes. Le commandant du second poste me fit la même question. Je
répondis que j’avais des paquets à rendre au duc de Guise. Il leva les épaules.
Il était clair que celui-ci tenait pour le roi. Dès mon entrée à Blois, je
reconnaissais deux partis bien prononcés. Que sera-ce au bout de la ville
? Comment m’y conduirai-je, pour ne pas me compromettre, et sur-tout pour
ne pas m’exposer ? Je ne me prononcerai ni pour le roi, ni pour la ligue,
et je généraliserai mes expressions. Telles étaient les réflexions que je
faisais en marchant.
La ville
me parut surchargée d’habitans. Les états-généraux semblaient y avoir attiré
une partie de la population de la France. Je ne concevais pas comment cette
foule pouvait y tenir, et surtout s’y loger. Je rendis hommage à la prudence
de madame, qui avait retenu ma Colombe auprès d’elle.
« Où
coucherons-nous, demandai-je au domestique ? — Il n’est pas sûr que nous
nous couchions. Mais je vais vous conduire chez M. le comte. »
M. de
Montbason avait trouvé deux petites chambres dans une petite maison. Il occupait
la plus décente, et il avait donné l’autre à son valet de chambre, qui remplissait,
en même temps, les fonctions de secrétaire. Une cuisine, au rez-de-chaussée,
était transformée en écurie. Julien me présenta au comte. Une mise étoffée
donne de la confiance, et prévient favorablement ceux à qui on s’adresse.
J’ignorais les dispositions du comte, et je résolus de les sonder. Je lui
parlai du roi et du duc de manière à ne pas me laisser pénétrer. Je l’examinais
attentivement ; sa figure resta impénétrable ; son air, son ton étaient ceux
d’un homme tout-à-fait étranger aux événemens. Cependant il était à
Blois
pour quelque chose. Allons, pensai-je, les affaires ne sont pas assez avancées
pour que le comte se déclare ouvertement. Je reçois de lui une leçon de prudence,
que je n’oublierai pas. En ce moment, M. de la Moucherie était redevenu la
Mouche.
Quand
le cornet sut que j’arrivais de son château, sa physionomie reprit son caractère
habituel ; elle se montra animée et fianche. Il me parla beaucoup de la comtesse,
de la comtesse, qui… Je devins impénétrable à mon tour. Il parut très-satisfait
de la préférence que lui accordait madame de Biron, sur tant d’autres, qui
se seraient empressés de lui offrir un asile. Nous causâmes assez long-temps
de choses indifférentes ; mais si je nommais le roi ou le duc de Guise, son
visage changeait tout-à-coup de caractère. Il redevenait réfléchi, et même
soucieux. Je persistai à croire que je l’avais bien jugé.
Il me
dit qu’il me logerait, mais pour cette nuit seulement. Je le compris : il
ne voulait paraître en relation intime, ni avec un royaliste, ni avec un
guisard, et il fallait bien que je fusse l’un ou l’autre. « Vous êtes musicien,
me dit-il. Allez trouver demain Zampini. — Zampini ! — C’est le chef de la
musique de la reine Catherine. — La reine a amené ici sa musique ! — Elle
sait allier ses affaires et ses plaisirs. Zampini joue du luth comme
un ange, et si vous êtes un peu fort sur le serpent, à l’instant même il
sera votre ami. Bonsoir, Monsieur. » Bon, pensai-je, il veut se défaire de
moi, et il m’adresse à un homme sans conséquence. Cela n’est pas maladroit.
Je dormis
peu, malgré la fatigue de la journée. Le silence de la nuit m’avait ramené
à Colombe. Je la voyais, je lui parlais, elle me répondait ; sa voix pénétrait
jusqu’à mon cœur ; elle me troublait, elle me charmait. J’étendais les bras
et je ne rencontrais que du vide. Le sommeil l’emporta enfin sur
l’amour
: je m’endormis profondément. Le lendemain matin, je pris le plus magnifique
de mes costumes, et je me rendis chez le signor Zampini. Il était en conférence
avec Davila, écuyer de la reine mère, et je crus d’abord qu’ils traitaient
d’affaires de la plus haute importance : ils ne s’apercevaient pas que j’étais
là.
« Il
faut mettre ces paroles-là en ut majeur, dit Zampim : j’ai cinq hautes-contres.
— Non, non, mon cher ami, mettez-le en la mineur : cela s’entendra
mieux dans les rues.
« Surtout,
ajoutai-je, avec accompagnement de serpent. — Ah, el signor il est mousicien
! Que diable, Monsieur, pourquoi ne parlez-vous pas ? — Je craignais de déranger.
— Oun mousicien il ne me déranze zamais. » Me voilà au mieux avec ces messieurs.
Pendant
que Zampini cherchait des morceaux tout faits dans ses paperasses, moi je
réfléchissais. Le duc de Guise, pensai-je, aime les vers, surtout quand ils
font son éloge ; mais il n’est pas fou de musique. La reine Catherine en
est idolâtre, et Zampini doit lui être irrévocablement attaché. M. de la
Moucherie, vous serez royaliste auprès d’el signor Zampini.
Ut, si, la, ut, fredonna sa seigneurie. C’est cela, c’est cela ; voilà qui fera
notre affaire. « Santez-moi ce morceau-là, Mousieur…, Brava, brava, bravissima.
Le goût un pou français ; mais on fera de vous quelque soze. » Que de grands
effets sont nés de petites causes ! me voilà, sans m’en être douté, du parti
de la cour !
« Eh
! depuis quand, me demanda Davila, êtes-vous dans cette ville ? — Depuis
hier au soir. — Et qui vous a envoyé ici ? — Le comte de Montbason. — On
ne sait encore de quel parti il est, et on ne peut compter sur cet
homme-là. Cependant
puisqu’il
vous a adressé au maître de la chapelle du roi, il faut bien qu’il soit royaliste.
Je dirai au sieur de Villeroi de l’inscrire sur ses tablettes. Vous avez
des chevaux, des équipages ; où les avez- vous laissés ? — Chez le comte.
— Je dispose des écuries et des remises de sa majesté Catherine. Je vais
y faire transporter tout cela. — Santons, santons. — Mon cher Zampini, vous
logerez ce jeune homme. — Et ze le nourrirai : on m’envoie oun ordinaire
copieux des couisines de Sa Mazesté. Mais santons, santons. Nous avons oune
promenade poublique à midi, et ze veux donner dou nouveau : le roi il y sera.
— Monsieur Zampini, j’ai une dépêche très urgente à remettre à Sa Majesté.
— C’est bien, c’est bien ; monsieur Davila i vous présentera. — Oh ! parbleu,
très-volontiers. »
Drelin,
drelin. C’est Zampini qui sonne. Une douzaine de chanteurs, et autant de
symphonistes entrent à l’instant. La répétition va commencer.
« Mais,
monsieur Zampini, je n’ai pas déjeuné. — Vous dézeunerez à deux heures, avec
moi ; si vous manziez à présent, celai vous gâterait la voix. — Mais, monsieur
Zampini, vous oubliez que je dois jouer du serpent. — C’est vrai, c’est vrai.
» Derlin, derlin. « Conduisez ce zoli garçon dans ma salle à manzer ; quand
il aura fini, vous lui donnerez oun serpent. »
Voilà
qui va au mieux, pensai-je, en faisant honneur à un pâté. À midi, je remettrai
mon paquet au roi, et, après le dîner, j’aurai l’honneur de voir monseigneur
le duc de Guise. Demain matin, les brevets de M. de Biron et de Poussan ville
seront expédiés. Après demain, je volerai dans les bras de ma Colombe.
La
répétition continuait, et je rentrai au moment où allait commencer le morceau
nouveau, celui dont Zampini attendait tant d’effet.
De vieux
mâtin qui hurle, De cheval qui recule,
De femme
trop friande, De valet qui commande, De pages freluquets, Dieu vous
gard’à jamais.
Je crus
trouver là une allusion à l’audace ambitieuse du duc, et au luxe que la cour
lui reprochait, disait-on. Il fallait que le roi se crût encore le maître
chez lui, puisqu’il bravait publiquement son ennemi. Je conclus de là qu’il
valait autant être royaliste que guisard. Au reste, le morceau, avec des
ritournelles, et des mots, répétés vingt fois, durait un grand quartd’heure.
Nous
partîmes pour nous rendre au château. Zampini marchait à notre tête ; il
se caressait le menton ; il portait, à droite et à gauche, des yeux qui annonçaient
une haute satisfaction de lui- même, et qui semblaient commander les applaudissemens.
Le roi aimait les promenades publiques, presque autant que les processions.
Il descendit les degrés du château, entouré de ses moines de Vincennes, suivi
immédiatement de ses mignons : j’ai su depuis ce que signifie ce vilain
mot-là. Il portait à sa ceinture un grand chapelet, orné de grosses têtes
de mort, et il avait un bilboquet à la main. Joyeuse et d’Épernon, les seigneurs
de la cour, les pages, et de beaux garçons de toutes les classes, composaient
son cortège. Tous tenaient un bilboquet : le jeu que le roi préfère devient
nécessairement celui des courtisans. Je me tournai quelquefois avec, mon
serpent, et je riais de tout mon cœur, en voyant deux cents bilboquets en
mouvement
à la fois. Le peuple était rangé en haie. Les uns riaient comme moi, et applaudissaient
aux coups d’adresse. Les autres gardaient un sérieux imperturbable, et levaient
quelquefois les épaules. Il me semblait, à moi, que rien n’est plus plaisant
qu’une procession, dont les principaux membres jouent au bilboquet.
Davila
tint sa parole. Quand le cortège rentra, il me présenta, non au roi, mais
à M. Guillaume, huissier du palais ; celui-ci me présenta à M. de Crillon,
capitaine des gardes ; du capitaine des gardes, je passai dans les mains
de M. de Villeroi, secrétaire- d’état, qui m’introduisit dans le cabinet
du roi. Que de présentations ! Si j’avais eu un bilboquet, au lieu de mon
serpent, toutes les portes m’eussent été ouvertes.
Henri
III avait des amusemens tout-à-fait singuliers. Il était entouré de coussins,
et il jetait à Joyeuse et d’Épernon, de petits chiens, que ceux-ci lui renvoyaient,
comme une raquette chasse une balle. Peut-être, me disais-je, est-ce là ce
qu’on appelle régner.
On ne
peut toujours jouer au bilboquet et à faire sauter de petits chiens. Le roi
leva enfin les yeux sur moi. « Il est bien, très-bien. Approchez-vous, jeune
homme. Que voulez-vous de moi ? » J’avais cru, jusqu’alors, que les rois
étaient des êtres presque surnaturels. Celui-ci me parlait comme s’il n’était
qu’un homme. Quelle bonté ! Si je ne m’étais rappelé des faiblesses, des
fautes, qui le rapprochaient de l’espèce humaine, je serais tombé à ses pieds.
Le bilboquet et les petits chiens affaiblirent singulièrement la vénération
que je lui portais.
Pendant
que je cherchais le paquet que je devais lui remettre, il me souriait, il
me caressait les joues. Ces marques de faveur
m’enchantèrent.
Ce sera un grand homme, pensais-je, quand il daignera prendre la peine de
le devenir. Oh, il le voudra. Et puis, n’a-t-il pas déjà fait de grandes
choses ? N’est-ce pas lui qui a forcé ces maudits huguenots de la Rochelle
à capituler.
« Avez-vous
la clef de ces chiffres-là ? — Oui, sire. — Mettez-vous à ce bureau, et traduisez-les
moi.
« Ho,
ho ! Biron m’assure de son attachement, de son dévouement, de son respect,
et il s’est distingué au siège de la Rochelle. Je le nomme maréchal de France.
Villeroi, faites, à l’instant même, expédier son brevet. Jeune homme, vous
viendrez le prendre dans deux heures. »
Voilà
qui va bien, très-bien, à merveille, me dis-je, en sortant du château. Je
n’ai plus que l’affaire de mon ami Poussanville à arranger ; et je courus
chez le duc de Guise.
Là,
tout était grand, noble, brillant, mais sévère. Je rencontrai le comte de
Brissac, qui me regarda d’un air fait pour m’intimider, et qui, cependant,
me conduisit auprès de monseigneur. Pas de petits chiens, pas de bilboquets
chez lui : il était entouré de ses principaux officiers. Je vis un homme
beau, grand, bien fait, dont les vêtemens étincelaient d’or et de pierreries.
Ses manières affables contrastaient singulièrement avec celles de M. de Brissac.
« C’est lui, dit le comte à monseigneur.
« Vous
êtes arrivé hier soir, reprit le duc ; vous avez logé chez Montbason, qui,
pour se défaire de vous, vous a envoyé chez Zampini. Celui-ci vous a fait
chanter des vers impertinens, et jouer du serpent à la promenade ignoble
qui vient de se faire. Davila vous a introduit dans le cabinet de frère Henri.
Que lui
vouliez-vous
? » Je racontai fidèlement tout ce qui s’était passé, et je présentai au
duc la lettre de M. de Biron. Je fus obligé de la traduire encore. « Celle
que vous avez remise au roi, ne signifie rien du tout, et celle-ci est positive.
Je remercierai frère Henri de m’avoir évité la peine de présenter le brevet
de Biron à sa signature. Mais qu’est-ce que ce M. de Poussanville ? Je ne
connais pas cette maison là. »
Je racontai
à monseigneur l’histoire de mon ami, et, par conséquent, une grande partie
de la mienne. Elles l’amusèrent moins que mon inaltérable candeur, et le
récit naïf de mes amours. « Mon cher ami, votre âge n’est pas celui de l’expérience.
Si vous aviez trente ans, je ne vous pardonnerais pas de vous être présenté
au roi avant que d’avoir eu l’honneur de me voir.
« Souvenez-vous,
à l’avenir, que lorsqu’on veut obtenir des grâces, c’est d’abord à moi qu’on
doit s’adresser. Au reste, j’aime le mérite, partout où il se trouve. Votre
ami Poussif sert utilement la sainte ligue ; il sera maréchal de camp. Vous
êtes brave : voulez-vous commander cent hommes d’infanterie ? — Je ne demande
pas mieux, Monseigneur. — Péricard, rédigez les deux brevets. Mayneville
les portera à la signature.
« La
Moucherie, allez me chercher Montbason. Villeroi l’a inscrit sur ses tablettes
; je veux qu’il figure aussi sur les miennes. Il va se trouver dans un terrible
embarras. Je m’en amuserai. La reine Catherine a son bouffon : Pourquoi n’aurais-
je pas le mien ? »
Je courus,
je volai ; j’étais tenté de crier partout que j’étais capitaine d’infanterie.
Le comte de Montbason avait été mandé à la cour, et présenté au roi comme
un de ses plus fidèles sujets.
Il
avait joué ce rôle forcé avec assez de gaucherie ; mais enfin, il avait crié
à demi-voix : vive le roi. Je le rencontrai au bas du grand escalier, et
je lui dis que monseigneur de Guise voulait lui parler. « Vous m’avez-mis
dans une position cruelle. Me voilà royaliste sans m’en être douté. Que me
veut à présent le duc de Guise ? »
Je l’introduisis.
Monseigneur le reçut avec la plus grande affabilité, et finit par lui présenter
la formule du serment des ligueurs. « Monseigneur, je viens de prêter serment
de fidélité au roi. — Je vous en relève de ma pleine puissance et autorité.
Allons, jurez et criez : vive la ligue. — Mais, Monseigneur…
—Etes-vous
mon ennemi ? — Non, très-certainement, Monseigneur. — Ne faites donc pas
l’enfant. Criez et jurez. — Vive la ligue ! »
Nous
sortîmes ensemble. « Parbleu, M. de Biron avait bien besoin d’envoyer ici
cette jeune barbe ! Moi, je ne sais qu’en faire ; je l’adresse à Zampini,
homme nul en politique. Il vous présente à Davila, Davila à Crillon, Crillon
à Villeroi et on me juge, je ne sais comment. Par extraordinaire le duc de
Guise a un moment de gaîté, et il m’envoie chercher. Me voilà en même temps
royaliste et guisard. Je serai appelé, tantôt par le roi, tantôt par le duc,
et les deux partis finiront par se moquer de moi. À présent que je n’ai plus
rien à ménager, vous pouvez revenir chez moi. Nous souperons ensemble, et
demain à la pointe du jour, nous partirons pour retourner à mon château.
— Et j’en serai enchanté, Monsieur le comte. — Avez-vous encore quelque chose
à faire ici ? — J’ai des brevets à recevoir. — Promenez-vous par la ville
en les attendant, et venez me retrouver à la chute du jour. »
J’étais
libre, et je pensai à Colombe. Elle ne m’attend pas demain. Avec quel charme,
quel délire nous nous retrouverons ! J’étais souvent distrait de mes tendres
rêveries, par les coups de coude que je recevais, à droite et à gauche. Les
rues étaient toujours surchargées de gens de toutes les classes, qui allaient,
venaient, se croisaient, se heurtaient. J’étais forcé de prendre garde à
moi, et de regarder ceux dont les épées allaient s’embarrasser dans mes jambes.
Je repris mon rôle d’observateur.
Je m’étais
cru habillé comme un seigneur. Hélas, j’étais éclipsé par la plupart de ceux
qui passaient auprès de moi. Je ne voyais que des pourpoints de soie, de
couleur citron, orange, blanche ou verte. Ce pourpoint, boutonné de la ceinture
jusqu’au cou, est découpé en bandelettes qui se croisent horizontalement
et verticalement. On voit à travers cette espèce de grillage, un dessous
d’une étoffe riche et de couleur tranchante.
Les
manches sont très-larges du coude à l’épaule, et elles sont soutenues par
des baleines. Un manteau très-court, en velours ou en drap, est bordé d’un
riche galon d’or. Une fraise énorme couvre le cou et les épaules, et cache
sous ses plis le bas de la figure. On voit cependant de petites moustaches
; mais on distingue à peine une barbe de deux pouces de long. La tête est
couverte d’un chapeau de feutre à larges bords, à forme élevée, et il est
orné d’une longue plume blanche. Le haut de chausses est tailladé comme le
pourpoint ; il est de la même étoffe et de la même couleur. Il ne descend
qu’au milieu de la cuisse. Les bas sont de soie amaranthe ou verts. Les souliers
et les bottes sont en buffle ; les gants en soie, et brodés. On porte au
cou un médaillon suspendu à une chaîne d’or, qui fait plusieurs tours,
et
qui, d’espace en espace, est ornée de rubis. Un large ceinturon porte du
côté droit une escarcelle ou grande bourse à fermoir, et du côté gauche une
longue épée à monture de fer poli.
Les
femmes de distinction ne s’exposaienl pas au milieu de cette cohue. Cependant
la curiosité en entraînait quelques-unes, qui se faisaient précéder et suivre
par des valets. Celles que j’ai rencontrées, portaient un corset très-étroit,
très-serré, et qui se terminait par une pointe qui descendait au dessous
du ventre. La robe, à partir des hanches, était d’une excessive largeur ;
celle des manches était poussée jusqu’au ridicule. Ces dames portent une
espèce de gibecière suspendue à leur ceinture. On m’a dit que la jeune reine
porte, dans la sienne, un livre de prières, et la duchesse de Montpensier
sœur du duc de Guise, un jeu de cartes : elle aime beaucoup à jouer à la
prime. Le front de ces dames est tout-à-fait découvert. Les cheveux
sont partagés sur la tête, et crépés sur les cotés. Un gros chignon, mêlé
de rubans, garnit le derrière. Au lieu de la fraise, elles portent un collet
montant fait de mousseline empesée. Leurs manchettes sont relevées sur le
bas de la manche, et elles ont, comme les hommes, une chaîne d’or au cou.
Les vêtemens des femmes d’une condition inférieure sont faits à peu près
de même. Les étoffes diffèrent, selon les facultés pécuniaires de chacune.
Les
hommes du peuple s’habillent d’étoffes communes, et suppriment par économie,
le large haut de chausses et les manches bouffantes. Ils portent le manteau
de serge brune ou verte. Les simples ligueurs ont la croix blanche de Lorraine,
et de grands chapelets autour du cou. Cette croix de Lorraine a deux barres
en travers, et forme les armoiries de la maison de Lorraine. Les guisarts
portent ce signe sous les yeux mêmes du
roi,
qui n’est pas assez puissant pour faire supprimer cette cocarde,
qui semble le braver.
J’allai
retirer les trois brevets, qui me furent remis sans difficulté. M. de Villeroi
me remercia d’avoir conquis M. de Montbason au parti royaliste. Le secrétaire
du duc de Guise, M. Péricart, me félicita de l’avoir acquis à la ligue. Ils
avaient tous deux un air goguenard, qui me persuada qu’ils ne comptaient,
ni l’un ni l’autre, sur le nouveau prosélyte. Cependant j’étais l’agent avoué
du nouveau maréchal de France ; les deux partis avaient besoin de lui, et
ces messieurs me marquèrent une considération, qu’ils n’eussent pas accordée
au petit frère Antoine. L’homme n’est quelque chose dans le monde que par
l’opulence, ou la place qu’il occupe.
Je ne
voulus pas quitter Blois, sans prendre congé de Zampini, et de l’écuyer Davila
: ils m’avaient assuré avec beaucoup de bonté, que je pouvais compter sur
eux. Zampini me demanda si je voulais entrer dans la musique de la reine
Catherine. Je lui répondis que je ne le pouvais pas, et il me tourna le dos.
Je priai Davila de faire reconduire mon cheval et mes mulets chez le comte
de Montbason. Il me dit qu’ils n’étaient pas sortis de ses écuries. Je lui
en marquai quelque étonnement.
« Oh,
j’ai eu autre chose à faire que de m’occuper de vos montures. D’ailleurs,
vous avez contribué à nous donner Montbason, et c’est, je crois, tout ce
que vous pouvez faire. Adieu, Monsieur. » J’appris, qu’à la cour, dans les
petites, comme dans les grandes choses, on ne balance pas à promettre quand
on a besoin des gens, et qu’on les laisse de côté, quand on n’en attend plus
rien.
Il
me sembla que j’avais honorablement rempli ma mission, et je ne pensai plus
qu’à me réunir à ma tendre, à ma charmante Colombe. J’allai souper avec M.
le comte.

1Jeune
noble française (recueil de Gaignières)

CHAPITRE
VIII.
Le
capitaine de la Moucherie éprouve un grand malheur.
Le soleil
se montrait à peine, et déjà nous étions sortis de Blois. J’étais aimable
comme l’espérance, gai comme la folie, une seule chose me contrariait : il
me semblait que nos chevaux n’avançaient pas. Je liai conversation avec le
comte, pour tromper l’ennui du chemin.
Il parlait
facilement, il parlait bien, et je reconnus qu’il était observateur. La conformité
de nos goûts, à cet égard, me porta à l’écouter avec plus d’attention. Bientôt
je ne compris pas comment le duc de Guise avait pu en faire son bouffon.
Le comte était timide, irrésolu. Voilà tout ce qu’on pouvait lui reprocher.
« Tous
les mauvais gouvernemens, me dit-il, croient ne pouvoir se soutenir qu’en
opposant continuellement un parti à un autre. Il faut, au contraire, écraser
celui qui peut nuire, et soutenir ceux qui ont été les instrumens de sa ruine.
Il peut être très-difficile d’y réussir ; mais ne vaut-il pas mieux succomber
qu’être alternativement le jouet des factieux ? le courage seul
porte
à entreprendre ; la fortune fait le reste. Pourquoi se défier de la sienne,
quand on ne l’a pas essayée ? c’est qu’on est effrayé de sa faiblesse, et
la crainte ne suggère jamais que des demi-mesures.
« Dès
long-temps le roi ne règne plus. Il subit le joug qu’impose nécessairement
un sujet hardi et puissant à un prince indigne du trône. Son sceptre passe
des mains de sa mère dans celles de ses mignons, et quand ses folies l’ont
conduit sur le bord de l’abîme, il invoque le secours de Catherine.
« Cette
princesse n’est pas sans quelque talent ; mais elle est incapable de régner
dans des temps orageux. Est-elle pressée par les Guise ? elle appelle les
protestans ; elle leur accorde des conditions, qu’elle sait ne pouvoir tenir,
et elle se hâte de rompre les traités, quand le roi de Navarre et le prince
de Condé acquièrent une prépondérance marquée. — Diviser pour régner est
sa maxime. Il faut dire : diviser pour vous soutenir jusqu’à une catastrophe,
que les tergiversations rendent inévitable.
« Catherine
n’a qu’un parti à prendre. C’est de s’unir intimement au clergé, de s’en
faire un appui contre la ligue, et surtout contre le duc de Guise. Si ce
prince entraîne les Français catholiques, en leur parlant de Dieu, quels
avantages n’auraient pas sur lui des prêtres, généralement révérés, qui s’emparent
des consciences, qui les dirigent, et à qui leur caractère permet de s’exprimer
au nom du ciel ? mais ce moyen n’est pas sans danger. Le sceptre et l’encensoir
restent unis, tant que les intérêts sont les mêmes. Mais tous les hommes
sont passionnés, et rendre le clergé nécessaire, c’est le disposer à s’emparer
de l’autorité.
«
Il marchera d’abord sourdement vers ce but ; bientôt il lèvera une tête altière
; il n’intimera ses ordres qu’au nom de la Religion ; mais il commandera,
n’importe à quel titre ? la résistance alors sera inutile au souverain, et
si la sienne est violente, une main obscure sera chargée du poignard.
« Catherine
craindra donc de se livrer au clergé. Sans cesse ballottée par les deux partis,
elle marchera de faute en faute. Guise profite déjà de celles qu’elle a commises.
Il profitera de celles qu’elle doit commettre encore.
« Il
ne dissimule plus ses vues ; il brave le roi jusques dans sa cour ; il ne
le croit pas assez hardi pour oser lui résister. Cependant son triomphe n’est
pas assuré encore. Un événement inattendu peut le faire succomber. Quel homme
sensé et réfléchi, peut, dans l’état actuel des choses, se prononcer ouvertement
pour la maison de Valois, ou celle de Lorraine ? »
Moi,
je pensai qu’un capitaine d’infanterie peut changer de parti sans que personne
s’en aperçoive.
Ce qu’avait
dit le comte était peut-être un peu au-dessus de ma portée. Je ressemblais
à ce paysan qui trouvait le sermon de son curé si beau, qu’il déclarait n’y
avoir rien compris. Cependant j’avais saisi l’ensemble des idées du comte.
Je cherchais à les classer dans mon cerveau, lorsque nous découvrîmes le
clocher de Pocé.
« M.
le comte, dit Julien, déjeûnera sans doute dansce village ? Qu’en pensez-vous,
demanda-t-il à son secrétaire et à moi ? Sans doute, sans doute, répondîmes-nous
à l’unisson. » Il était midi, et nous n’avions rien pris encore.
On
parle peu, quand on a bon appétit. Ces messieurs rêvaient, je ne sais à quoi.
Moi, j’étais tout à Colombe. J’y pensais avec une tendresse, un charme, un
délire ! Cinq heures de marche encore, et je tombais dans ses bras.
Nous
remontâmes à cheval, et nous reprîmes notre conversation politique.
« Savez-vous,
me demanda le comte, quelle est la situation actuelle de la France ? — Non,
Monsieur. — Je vais vous le dire.
« Grégoire
XIII et Philippe II, protègent ouvertement la ligue ; le pape, parce qu’il
espère qu’elle sera assez forte pour exterminer les hérétiques ; le roi d’Espagne,
parce qu’il compte, à la faveur des troubles, mettre sur le trône de France,
sa fille Isabelle-Claire-Eugénie, et régner sous son nom. Grégoire envoie
des indulgences aux ligueurs ; Philippe fait passer au duc de Guise les trésors
de l’Amérique. Il connaît assez peu les hommes, pour croire que le duc ne
s’occupe que des intérêts de l’Espagne.
« Il
est évident que le duc aspire à la couronne ; mais il marche vers le trône
par des voies détournées. Vous savez qu’il a conduit le roi, par son adresse
et ses suggestions perfides, au dernier degré d’avilissement. Il ne lui reste
qu’un coup à porter ; mais il recule devant un crime qui armerait contre
lui le roi de Navarre, les calvinistes, et le roi d’Espagne, déchu de ses
plus brillantes espérances.
« Il
a forcé le roi à convoquer les états généraux, qui siègent en ce moment
à Blois, et il a porté à cette assemblée une majorité composée
de ses créatures. Le jour même de
l’ouverture
de la session, ce corps a contraint le roi à déclarer la guerre aux protestans.
Le lendemain, il lui a refusé des subsides, sans lesquels il ne peut lever
de troupes. Guise a une armée qui lui appartient personnellement, et qu’il
soudoie avec l’or de l’Espagne. Catherine sait qu’il veut enfermer Henri
dans un cloître, et faire instruire le procès du duc d’Anjou, son frère,
qui a porté les armes contre le roi. La révolte du jeune duc a servi, indirectement,
les intérêts des Guise. Ainsi les mesures que prennent les princes Lorrains
sont contradictoires.
« Catherine
a cru déjouer leurs projets, en poussant le roi à se déclarer chef de la
ligue, dans une des séances des États- Généraux. Elle ne sent pas qu’un
souverain n’étouffe pas une faction puissante, en se déclarant le premier
factieux de son royaume.
« Henri
est tombé dans une dégradation telle, que les ligueurs ne lui savent aucun
gré de sa démarche, et qu’ils continueront d’obéir au duc de Guise. Cependant
si Philippe découvre que le duc le joue, il lui fermera son trésor ; il
fera entrer son armée des Pays-Bas dans le nord de la France, ses troupes
espagnoles franchiront les Pyrénées, la Navarre, et pénètreront dans la Guyenne
et dans les provinces du midi ; des proclamations déclareront le duc de Guise
traître envers le roi et la patrie, et ce prince peut être renversé, soit
par la force des choses, soit par le poison : on sait que tous les moyens
conviennent à Philippe, quand ils le conduisent à son but.
« Tels
sont, Monsieur, les véritables motifs de ces irrésolutions, qu’on m’a reprochées,
et qu’on a fini par trouver plaisantes. Ouvrez l’histoire de » France. Vous
y verrez les Montbason rendre des services signalés à leurs souverains, ou
aux partis que les circonstances les ont déterminés à adopter. Je
ne
suis pas indigne d’eux ; mais je ne tirerai l’épée que lorsque je croirai
devoir le faire.
« Je
me montre ouvertement à vous, parce que vous avez été témoin du rôle ridicule
qu’on m’a fait jouer, et que je tiens à l’estime de tous les hommes. Je vous
préviens que si vous M abusez de ma confiance, je vous démentirai, et, très-
certainement, j’inspirerai plus de confiance que vous. » Je rassurai le comte
par les protestations les plus propres à le persuader, et elles étaient sincères.
Il m’avait donné, en peu d’heures, une connaissance exacte des choses et
des hommes. Il était entâché, sans doute, de quelque égoïsme ; mais il était
loin de l’afficher avec l’impudeur, qui m’avait toujours blessé dans Poussanville.
Je m’ouvris
franchement à mon tour. Je lui avouai que mes vœux étaient pour le roi légitime,
à qui on reprochait, avec raison, des fautes graves et des puérilités ; mais
qui les effaçait par l’institution d’ordres religieux, de pénitens de toutes
les couleurs, par ses macérations publiques et privées, par les plus belles
et les plus édifiantes processions. Je finis en le recommandant, du fond
du cœur, à mon patron.
L’aspect
des tours du château de Montbason donna une direction nouvelle à mes idées.
C’est là que m’attendaient Colombe et le bonheur.
Le comte
aimait sa femme, et il était impatient de la revoir. Il mit son cheval au
galop. Il eût été inconvenant que je lui en donnasse l’exemple ; mais avec
quel empressement je le suivis ! Le pont s’abaissa devant nous, et la comtesse
se jeta dans les bras de son mari, avec une ardeur, une expression qui, sans
doute, lui parurent sincères. J’étais sauté de mon cheval, et je
m’étonnais
que Colombe ne fût pas accourue sur les pas de madame de Montbason. Je l’appelais
à haute voix ; j’allais parcourir tous les appartemens du château. La comtesse
m’arrêta. « Madame de Biron n’est plus ici. — Et Colombe ? — La baronne a
emmené tout son monde avec elle. — Et Colombe ? — Je vous dis que madame
de Biron n’a laissé personne ici. — Et Colombe, Colombe ? — Colombe, Colombe
a suivi sa maîtresse, le désespoir dans le cœur. — Ciel, juste ciel ! expliquez-vous,
Madame, je vous en supplie. »
La comtesse,
appuyée sur le poignet de son époux, montait les degrés qui mènent au château
en me parlant, et en écoutant mes exclamations avec un rire sardonique. Je
tombai à ses pieds, et je la conjurai de vouloir bien m’instruire de ce qui
s’était passé. Elle eut la cruauté de me laisser dans la position humiliante
où je m’étais placé, et elle disparut avec le comte.
Il est,
m’avait dit madame de Biron, des femmes qui ne se respectent pas assez. Un
honnête homme doit les ménager. La comtesse s’est-elle vengée de moi, en
affligeant celle dont le bonheur m’est plus cher que ma vie ? Je me lançai
dans les endroits les plus reculés, les plus obscurs de ce vaste château;
je m’étendais sur le careau ; je prêtais une oreille attentive ; j’appelais
Colombe à grands cris, L’écho des voûtes humides, qui étaient au-dessus de
ma tête, répondait seul à ma voix. Ma poitrine était gonflée ; les muscles
de mon visage étaient agités de mouvemens convulsifs ; deux ruisseaux de
larmes s’échappaient de mes yeux. Insensé que j’étais ! La comtesse n’eût
osé faire enfermer Colombe ; madame de Biron ne l’eût pas souffert. Mes cris,
mes sanglots attirèrent enfin quelques domestiques. L’un d’eux alla avertir
le comte. Il accourut. Il y avait long-temps que durait cette scène d’horreur.
Il
me parla avec une extrême bonté. Dans toute autre conjoncture, il m’eût pénétré
de reconnaissance. Je le repoussais avec les gestes et les accens du désespoir.
Julien et lui m’entraînèrent, me firent respirer le grand air, et je me calmai
un peu. Il fallait que je succombasse à l’horreur de ma situation, ou que
je revinsse à moi.
Monsieur
de Montbason me raconta, en peu de mots, ce que la comtesse venait de lui
apprendre.
La veille
au soir, un paysan du village avait annoncé qu’en revenant de Pocé, il nous
avait vus, Julien et moi, attaqués par des braconniers, près de Vouvrai,
et que ces misérables nous avaient dépouillés, après nous avoir ôté la vie.
« Je ne pénètre pas, » ajouta le comte, le motif d’une telle imposture ;
mais je vous donne ma parole d’honneur que son auteur sera sévèrement puni.
» Il continua son récit.
« Cette
déplorable nouvelle jeta Colombe dans un état semblable à celui dont je venais
de sortir ; elle perdit l’usage de ses sens. Elle dut aux secours de la baronne,
le retour de sa raison, et du sentiment de son malheur.
« C’est
une erreur, lui disait madame de Biron. La Moucherie vit, il ne vit que pour
vous ; vous le reverrez. — Il n’est plus ! il n’est plus! s’écria-t-elle.
Ôtez-moi de cette maison, où je viens de recevoir le coup de la mort. » La
baronne déclara qu’elle allait partir à l’instant même. « Sans escorte,
lui dit la comtesse ? — Sans escorte ; les chemins sont libres. Je vais
me retirer à Biron. » Elles sont parties.
« Elles
ne le sont que d’hier, Monsieur le comte. Je ne perdrai pas un moment. Je
vais courir, voler sur leurs traces. Je les
rejoindrai.
— Votre cheval, vos mulets sont fatigués. — Qu’importe ! — Je vais vous en
faire donner de frais. Vous paraissez voir Julien avec bienveillance. Il
vous accompagnera.
—
Que mon patron vous bénisse. »
Je courus
à l’écurie ; je voulus aider à Julien ; je me hâtais, et je faisais tout
mal. Ce brave garçon me priait de le laisser faire ; je dérangeais ce qu’il
avait fait. Nous partîmes enfin : il était huit heures du soir.
Nous
marchâmes une partie de la nuit. Julien m’engageait à m’arrêter, à me reposer,
à prendre quelque chose. Il me représentait que nos chevaux ne soutiendraient
pas long-temps la fatigue que je leur imposais. Je ne l’écoutais pas. Je
comptais sur mes forces : elles étaient épuisées.
Julien
s’aperçut que je chancelais sur ma selle. Il sauta à terre ; je tombai dans
ses bras. Je n’entendis, je ne vis plus rien.
Quand
je revins à moi, je me trouvai dans une chambre très- propre, et dans un
assez bon lit. Ma faiblesse était extrême ; cependant je reconnus Julien.
Il marqua la joie la plus vive, en voyant mes yeux se rouvrir. « Où suis-je,
Julien ? — À Saurigny. — Chez qui ? — Chez un bon curé, qui vous a recueilli.
— Depuis quand ? — Depuis huit jours. — Huit jours, huit jours ! — Calmez-vous,
Monsieur, ou vous allez vous rapprocher de la tombe, dont les soins du digne
pasteur vous ont éloigné. » Je me tus. Je revenais à la vie, et je la consacrai
de nouveau à Colombe.
L’extrême
agitation dans laquelle j’avais passé quelques heures, l’inquiétude dévorante
qui lui avait succédé ; la fraîcheur de la nuit, l’excès de la fatigue,
le défaut de
nourriture,
tout s’était réuni pour enflammer mon sang. Une fièvre ardente le brûlait
déjà, quand Julien me reçut dans ses bras.
Nous
n’étions qu’à un quart de lieue de Saurigny. Il m’y conduisit, avec des peines
incroyables. Le jour ne paraissait pas encore. Où s’adresser, dans un village
dont tous les habitans étaient encore plongés dans le sommeil ? Julien m’assit
sur l’herbe, et m’appuya contre le pied d’une meule de foin. Il marcha vers
l’église. Une maison modeste, mais décente y touchait. Il frappa à la porte.
Cette maison, ainsi qu’il l’avait prévu, était la demeure du curé.
Julien
lui raconta ce qui m’était arrivé sur la route ; il lui parla de l’embarras
où il se trouvait. Il le supplia de me secourir. Il crut l’y déterminer plus
facilement en l’assurant que j’étais un excellent catholique. « Quand Jésus,
lui répondit le respectable prêtre, ressuscita le Lazare, il ne demanda point
s’il était pharisien ou saducéen. »
Il fit
lever sa vieille gouvernante, et un jeune homme, qui était à la fois son
domestique et son jardinier. Ils me transportèrent au presbytère, où les
premiers secours me furent prodigués. Le médecin du village fut appelé. Il
prononça, d’un ton doctoral, que ma maladie était mortelle. Ce n’est pas
la première fois que la médecine s’est trompée.
En dépit
d’un jugement que le docteur croyait sans appel, mon bon curé consultait
son expérience; il étudiait en moi la marche de la nature ; il priait pour
le pauvre malade, et il espérait.
Quand
Julien courut lui dire que j’avais ouvert les yeux, que je l’avais reconnu,
que je lui avais parlé, le pasteur, sa
cuisinière,
son jardiner s’approchèrent de moi sur la pointe du pied. La joie brillait
sur leurs visages : les vertus du maître se communiquent à ses gens.
Le médecin
fut averti de cette espèce de résurrection. Il vint, et ne marqua pas le
moindre embarras. « Je ne me trompe jamais dans mes pronostics, dit-il. Je
vois bien que monsieur guérira ; mais je déclare que ce sera contre toutes
les règles. »
Il me
prescrivit un régime doux, mais réparateur, et il me conseilla de parler
peu. Il sortit en nous disant qu’il allait faire, sur ma maladie, un rapport
dans lequel il prouverait clairement que j’aurais dû mourir ; qu’il l’enverrait
à la faculté de médecine de Paris et de Montpellier, et que, vraisemblablement,
il lui vaudrait une chaire dans une des deux universités.
Mon
bon curé, sans orgueil pour le présent, sans ambition pour l’avenir, me donnait
tous les momens dont il pouvait disposer. Il me parlait de choses qu’il croyait
pouvoir m’instruire ou m’intéresser. Quand il me voyait livré à des réflexions
affligeantes, il nommait Colombe, et me rendait à l’espoir de la retrouver.
Il me
représentait que les affections du cœur peuvent être douces et estimables
en même temps ; mais qu’elles doivent être réglées par la raison, et soumises
aux décrets de la providence ; que les accès de délire dans lesquels j’étais
tombé sont indignes d’un chrétien et d’un homme sage ; que peut-être le ciel,
en nous séparant pour quelque temps, avait voulu nous ramener à des sentimens
de modération, qui nous permettent seuls d’être utiles aux autres et à nous-mêmes.
Je
ne sais si le calme que j’éprouvais était l’effet des raisonnemens
sans réplique de mon bon curé, ou de l’épuisement dans
lequel m’avait jeté ma maladie. J’interrogeais mon cœur. J’y
trouvais Colombe gravée en traits ineffaçables ; notre réunion était l’objet
de mes vœux les plus doux ; mais j’étais disposé à la préparer par des moyens
que peut avouer un jeune homme raisonnable et réfléchi. J’étais presque honteux
des égaremens auxquels je m’étais abandonné.
Quand
les fonctions de mon bon curé l’éloignaient de moi, la vieille Marguerite
le remplaçait, et me contait des histoires de sorciers et de revenans. C’est
tout ce qu’elle pouvait faire pour moi.
Quand
j’étais seul, ce qui m’arrivait rarement, je pensais à Colombe, je rêvais
profondément aux ressources que j’avais pour l’aller joindre. Sans doute
elle était à Biron, et il y a loin de la Touraine en Périgord. Mais on n’a
pas oublié la bourse bien garnie que me fit donner la baronne, lorsqu’elle
nous chassa, Colombe et moi. Je n’en avais pas ôté un doublon. J’avais un
excellent cheval, deux bons mulets, et avec tout cela on peut aller au bout
de la France. Mes forces revenaient promptement, et je me décidai à partir
sous peu de jours.
Je regrettai
d’avoir laissé ma voiture à Montbason. Mais on ne peut avoir toutes ses aises.
La vie de mon saint patron justifie cet axiome.
Jusque
là, je ne m’étais occupé que de Colombe. Mon bon curé me fit souvenir que
j’avais des devoirs indispensables à remplir envers M. de Biron. Je me rappelai
alors seulement les brevets dont j’étais dépositaire. J’allongeais un peu
ma route en passant par Poitiers. Mais j’avais, dans ma poche, un moyen si
sûr
de combler de joie le baron, que je ne balançai pas un moment.
Une
première idée en amène nécessairement d’autres. Je savais qu’au moment où
je m’éloignai de Poitiers, M. le baron n’avait pas plus touché à sa caisse
que moi à ma bourse, et Poussanville trouvait toujours quelque expédient
qui fournissait gratis aux besoins de notre petite armée. Je résolus
de ne garder que ce qui m était nécessaire pour deux journées de chemin,
et de distribuer le reste à ceux qui m’avaient rendu les plus éminens services.
Je récompensai
généreusement Julien, et je le renvoyai à son maître. Le comte, me disais-je,
sera étonné de ma magnificence. Je donnai à la vieille et au jardinier plus
qu’il ne fallait pour qu’ils se souvinssent long-temps de moi ; je croyais
les entendre, dans dix ans encore, vanter ma libéralité. Je mis la même noblesse
dans mes procédés à l’égard de mon médecin, et je l’engageai à ne plus condamner
d’avance personne à mort. Je me tournai enfin du côté de mon digne curé.
« Monsieur,
lui dis-je, je vous dois la vie, et il est des services auxquels on ne peut
fixer de prix. Voilà ma bourse ; daignez y puiser. » Il recula de quelques
pas, avec l’air d’un homme qui vient de subir une humiliation qu’il n’a pas
méritée. « Je ne vends pas mes soins, » me répondit-il, en baissant les yeux.
Je sentis
toute l’étendue de la faute que je venais de commettre, et je tâchai de la
réparer. « Monsieur, c’est pour vos pauvres que je vous ai offert ma bourse.
Permettez-moi de faire une bonne action. »
Il
tira avec assez de force, et pendant une minute ou deux, un cordon placé
près de la porte de la chambre où nous étions. Il correspondait à une cloche
du poids de dix à douze livres, suspendue en dehors du presbytère. « Le son
de cette cloche les avertit que j’ai une distribution à leur faire. J’aime
que les gens charitables connaissent l’emploi que je fais de leurs dons.
» Je jugeai avoir trouvé enfin l’homme estimable que je cherchais depuis
si long-temps.
Cinquante
ou soixante malheureux, des deux sexes, furent introduits, et je leur donnai
à chacun une pistole. Ils nous bénirent le curé et moi. Vraisemblablement
il y avait parmi eux des paresseux et des hypocrites ; mais on ne cherche
à trouver des défauts à ceux qui sollicitent la bienfaisance, que pour leur
fermer son cœur et sa bourse.
Un de
ces infortunés s’offrit pour conduire mes mulets. J’acceptai ses services,
et je montai à cheval le lendemain matin.
Nous
nous étions adressé, le curé et moi, des adieux tendres et prolongés. Ils
pouvaient être éternels, et je sentis qu’on se sépare difficilement d’un
homme de bien.
Ceux
à qui j’avais fait l’aumône étaient rassemblés devant la porte du presbytère.
Mon nouveau compagnon de voyage les avait sans doute instruits de l’heure
de mon départ. Ils se rangèrent sur deux files, et m’accompagnèrent jusqu’aux
dernières maisons du village, en me comblant de nouvelles bénédictions.
Allons,
me disais-je, en m’éloignant d’eux je laisse de longs souvenirs à Saurigny,
et cela est flatteur… Misérable, ajoutai-
je,
tu n’as rien fait que par ostentation. Humilie-toi, superbe, devant les vertus
du respectable curé.
J’arrivai
à Lencloitre. J’avais fait, à peu près, la moitié du chemin de Saurigny à
Poitiers. Il fallait donner du repos à nos bêtes de somme, et je me décidai
à passer la nuit dans cet endroit. Je n’y connaissais personne ; je m’arrêtai
devant un mauvais cabaret, où je ne trouvai que du pain, du vin, et pour
lit, on me donna quelques bottes de paille dans un coin de l’écurie. Je soupai
mal, je dormis mal ; mais à quelque chose malheur est bon : il n’était pas
deux heures après midi, et déjà j’apercevais la grand’garde de M. de Biron.
Je piquai mon cheval, et en quelques minutes je fus auprès de monseigneur.
« Eh,
d’où diable venez-vous ? — Madame a-t-elle passé par Poitiers ? — Qui a pu
vous retenir aussi long-temps ? — Colombe était-elle avec madame ? — Vous
m’interrogez, je crois ! Répondez, Monsieur, aux questions que je vous adresse.
D’où venez-vous ? » Je racontai exactement à monseigneur tout ce qui m’était
arrivé depuis mon départ jusqu’à mon retour, et je terminai mon récit en
lui présentant son brevet de maréchal de France. Il me prit la main et daigna
m’embrasser.
« Oui,
me dit-il, madame et Colombe sont passées ici. Indépendamment des premières
raisons qu’avait la maréchale d’estimer peu la comtesse, raisons que vous
connaissez, elle remarqua, après votre départ de Montbason, plus que de la
légèreté dans la conduite de cette dame avec quelqu’un de l’intérieur du
château, et elle résolut de s’en éloigner. La nouvelle de votre mort, la
manière indécente dont la comtesse parut en jouir, le désespoir où elle jeta
Colombe, la déterminèrent à ne pas différer. Elles ont passé un jour ici,
et
elles
doivent être, à présent, rendues à mon château, situé sur la ligne qui sépare
Bergerac de Cahors. »
Je revins
tout-à-fait à la vie et même à la gaîté. J’allai chercher Poussanville, dont
l’activité ne se démentait jamais. Il exerçait les troupes, quand je l’abordai.
« Voilà, lui dis-je, un titre qui te donne le droit de les commander. » Les
caresses du maréchal lui avaient été arrachées par sa promotion au premier
grade de l’armée ; celles dont me combla mon ami, venaient de son cœur autant
que de son ambition satisfaite. Il me choisit une compagnie d’élite, et m’en
proclama le capitaine, avec les formalités d’usage. Quelle différence de
ma position actuelle, d’avec celle où j’étais en partant d’Étampes ! J’avais
un rang dans le monde, et une femme charmante, adorée, que j’avais l’espoir
de rejoindre bientôt.
L’état
militaire rapproche les hommes, en certaines circonstances, et il règne,
dans les camps, une sorte d’égalité qu’on ne connaît pas dans les palais.
Le maréchal déclara à son maréchal-des-camps, et à monsieur le capitaine,
qu’ils étaient admis à son intimité, sous la tente, et nous dinâmes avec
l’appétit de gens qui sont presque toujours exposés au grand air.
« Parlons
d’affaires, nous dit le maréchal à la fin du repas. La Moucherie, vous voilà
capitaine ; les événemens de la guerre peuvent vous séparer de moi ; la solde
des troupes est loin d’être assurée, et je ne veux pas que vous connaissiez
le besoin. Voilà dix mille livres en or, ménagez-les. Général Poussanville,
je vous connais assez pour ne pas craindre que vous manquiez jamais de rien.
Cependant c’est vous qui avez fait ma caisse, vous y avez des droits incontestables,
prenez-y ce que vous voudrez.
«
— Vous nous parlez, Monseigneur, comme si vous alliez nous quitter. —
C’est ce qui peut arriver, mon cher Poussanville. Je tenais
pour le parti des Guise : les circonstances et mon intérêt personnel m’avaient
seuls déterminé. Mais l’honneur me parle en ce moment. Henri est sans doute
indigne du trône ; mais il est mon roi légitime, et, sans que j’aie rien
fait pour lui, depuis le siége de la Rochelle ; sans que j’aie sollicité
ses faveurs, il vient au-devant de mes désirs les plus chers ; il me nomme
maréchal de France. Il a acquis mon épée, et je la lui consacre. Le parti
que j’adopte est périlleux ; je renonce à tous mes avantages, je le sens
; mais la postérité et l’histoire m’attendent.
« Poussanville,
je suis à la tête de quatre mille ligueurs. Henri s’est déclaré leur chef
suprême ; mais je suis persuadé qu’ils ne recevront d’ordres que du duc de
Guise. Je vous en remets le commandement. C’est au duc que vous devez votre
grade actuel ; vous voyez que notre position n’est plus la même. Faites ce
que vous croirez convenable ; moi, je vais me retirer à Biron, en attendant
que le roi puisse me donner une armée.
« Je
vous y suivrai, Monseigneur, m’écriai-je ! — C’est bien, c’est très bien,
la Moucherie. Et vous, Poussanville, à quoi vous décidez-vous ? — Monseigneur,
je n’attends rien de la postérité ni de l’histoire. — Je vous entends, Monsieur.
— Si j’avais, comme la Moucherie, une femme que j’adorasse ; si j’avais,
en vous suivant, la certitude de la retrouver, je ne balancerais pas.
— Monsieur,
quel que soit le motif qui ait déterminé la Moucherie, et que vous pouviez
vous dispenser d’approfondir, il partira avec moi. »
Le maréchal
venait d’autoriser Poussanville à puiser à la caisse. Il en fit deux
parts, et il demanda au chef, qu’il
abandonnait,
s’il abusait de la permission qu’il avait reçue. M. de Biron lui répondit
par un signe d’acquiescement, et la part de Poussanville fut aussitôt chargée
sur un des fourgons qu’il avait pris à Lusignan ou ailleurs.
Les
deux généraux se quittèrent froidement, et je reçus l’ordre de faire les
dispositions nécessaires pour monter à cheval à la pointe du jour.
En allant
et venant, en demandant de nouveaux ordres, en les exécutant, je pensais
à mes petites affaires. J’avais dix mille francs, et je n’étais, au fond,
ni royaliste, ni guisard ; j’étais Colombien. J’ajouterai à cette somme,
me disais-je, la moitié de la succession de mon père, qui est restée à Étampes,
où ma mère vivra de l’autre moitié.
Avec
tout cela, j’achèterai une petite terre, sur laquelle sera une habitation
simple, mais commode et propre. Là je vivrai avec Colombe, obscur, mais heureux.
La culture de notre bien m’occupera pendant la journée. Colombe se chargera
des soins du ménage et de la basse-cour : nous aimons tous deux la volaille
et les œufs frais. Elle m’apportera aux champs un dîner frugal, mais substantiel,
qu’elle partagera avec moi. Le soir, elle viendra me prendre pour me reconduire
dans l’asile du bonheur. Son bras est passé sous le mien ; nous nous regardons…
comme on se regarde quand on s’aime. Le chant des oiseaux a cessé ; le nôtre
commence. C’est d’abord un cantique, auquel succède une chanson d’amour,
et nous lui donnons une expression !
Notre
petite servante nous attend sur le seuil de la porte. Elle tient dans ses
bras notre nouveau né, que nous comblons de caresses. Bientôt il est suspendu
au sein charmant de sa charmante mère. Le couvert est mis ; nous soupons
gaiement, et
nous
passons tous deux dans mon oratoire. Il est semblable à celui qu’avait arrangé
Colombe à la Rochelle, et où je l’ai vue pour la première fois. Un cierge
éclaire l’image de mon patron. Nous le remercions de notre félicité actuelle,
et nous le supplions d’en prolonger le cours. Nous entrons enfin dans l’asile
des amours et du mystère, et ahie, ahie, ahie! oh, quelle douleur ! c’est
mon sac de dix mille livres qui vient de me tomber sur le pied.
En vérité,
le monde n’est qu’une lanterne magique, où les objets les plus disparates
passent continuellement sous les yeux du spectateur. Le comte de Montpensier
et le sieur de Villeroi arrivent à notre camp. Comment ont-ils su qu’ils
trouveraient le maréchal près de Poitiers ? ah ! c’est par la date de la
lettre qu’il a écrite au roi. Ils lui demandent une conférence secrète :
que lui veulent-ils?
Catherine
fut effrayée enfin de la puissance des Guise. Elle sentit que le sort du
roi était entre leurs mains, et elle connaissait leur ambition. Elle résolut
de leur opposer encore le roi de Navarre et le prince de Condé. Messieurs
de Montpensier et de Villeroi, apportaient au maréchal de Biron l’ordre de
se réunir à eux ; d’aller trouver Henri IV, à Bergerac, et de traiter de
la paix avec ce prince.
« Elle
sera signée, me dit Poussanville ; mais elle ne durera pas. Le duc de Guise
reprendra son ascendant, quand il le voudra. Il eût déjà frappé le grand
coup, si les guerres précédentes n’eussent affaibli la France, et produit
une espèce de famine, et les maladies qui en sont les suites ordinaires.
Il ne veut pas régner sur des déserts.
«
Le roi d’Espagne soudoie la forte armée qu’il a rassemblée. De petits corps
de ligueurs sont disséminés sur toute la France. Je me garderai bien de licencier
les miens. Quand toutes ces forces seront rassemblées et mises en mouvement,
que leur opposeront le roi et les princes protestans ? Le duc de Guise
est tellement convaincu de sa supériorité, qu’il permet à Henri III de faire
la paix.
« Mais
il la veut conforme à ses intérêts, et il a mis le comte de Montpensier,
son parent, au nombre des ministres plénipotentiaires, qui vont traiter avec
le roi de Navarre. Il croit le maréchal de Biron dévoué à son parti, et il
ne s’est pas opposé à sa nomination. Voilà, en peu de mots, l’exposé des
motifs qui déterminent la conduite des uns et des autres. Quel que soit le
résultat des négociations qui vont s’ouvrir, les mains débiles du roi ne
peuvent plus soutenir son sceptre. Il est là, et Guise n’a qu’à se baisser
et le prendre. Tu vois que je ferais un acte de démence en m’éloignant de
lui. J’entre avec toi dans tous ces détails, parce que je veux conserver
ton amitié. Tu me trouveras disposé, dans tous les temps, à te donner des
marques de la mienne. »
Je redevins
la Mouche. Je recueillis le moindre mot, j’observai jusqu’aux physionomies.
Je vis clairement que les plénipotentiaires étaient mus par leur intérêt
personnel, qu’ils s’efforçaient de cacher sous de grandes phrases. Je fus
convaincu que la religion était sacrifiée à des mesures politiques. Poussanville
était le seul qui s’exprimât avec bonne foi.
Mais
la Religion ! la Religion ! Le roi a juré de la faire régner sur toute la
France, et d’exterminer jusqu’au dernier des huguenots ; et il va traiter
avec eux, et il va opposer Baal au
Dieu
d’Israël ! Ainsi ses processions, ses macérations ne sont que des grimaces.
Ces
pensées me mettaient en fureur, et j’étais tenté de rester avec Poussanville.
Mais Colombe était à Biron, et Biron n’est pas éloigné de Bergerac. Ô mon
patron, inspirez-moi ce que je dois faire ! il m’inspira de suivre le maréchal.
Nous
partîmes. J’avais proposé à l’homme qui m’avait suivi depuis Saurigny, de
s’attacher à moi, et André y avait consenti. Des habits décens avaient remplacé
ses haillons. Je causais avec lui, en marchant sur la Villedieu, et sa conversation
avait du charme. Lui parlais-je de Colombe, il répondait en homme sensible
; de la Religion, il attribuait à la colère céleste les maux qui affligeaient
la France. Faisais-je une citation latine, il achevait la phrase. Il se montrait
instruit, de quelque sujet que je lui parlasse, et il devenait plaisant,
quand je lui paraissais gai. C’était un homme de quarante ans, d’une figure
agréable. Il me parut fort au-dessus de l’état où je l’avais trouvé à Saurigny,
et même de sa situation actuelle. Il piqua ma curiosité, et il était naturel
que je voulusse la satisfaire.

L’amiral
Gaspard de Coligny (1519-1572)
CHAPITRE
IX.
Histoire
d’André.
André
consentit volontiers à me raconter ses aventures. Nous n’avions rien de mieux
à faire, lui que de parler, moi de l’entendre.
Je naquis
à Angoulême, en 1537, sous le règne de François Ier,
qui fut évidemment le père des lettres, quoiqu’il supprimât l’imprimerie,
et qu’il inventât la censure. Mon père était un riche fabricant d’Angoulême.
Sa profession n’était qu’utile, et par conséquent peu considérée. Il viendra
peut, être un temps où les hommes apprécieront les choses à leur juste valeur.
S’il eût pu se choisir un père, il est vraisemblable que je serais le fils
d’un roi.
Dans
des temps de guerres, étrangères ou civiles, il faut choisir entre deux partis,
l’encensoir et l’épée. L’encensoir met à l’abri de tous les dangers, et est
brave qui peut ; moi, je ne l’étais pas. Mon père penchait pour l’épée, parce
qu’elle ennoblit, dès qu’on est parvenu au grade de capitaine, et il n’est
pas
de vilain qui ne soit bien aise d’être l’ayeul de petits gentillâtres.
En conséquence,
mon père m’avait acheté un mousquet, une épée, une hallebarde, et une cuirasse,
de dimensions et d’un poids relatif à mes forces. Je ne regardais pas mon
arsenal, et je jouais à la chapelle avec mes camarades. Ma mère avait grand
soin d’entretenir ce goût naissant, parce que, disait-elle, elle n’entendait
pas que je me fisse tuer pour des intérêts qui ne pourraient être les miens.
Ce que
femme veut, Dieu le veut, et, par conséquent, son mari aussi. Mon père me
fit entrer au collége des jésuites. On parle beaucoup de la morale relâchée
des révérends pères. Moi, je confesse n’avoir jamais entendu, dans mon collége,
un seul mot qui fut répréhensible, ce qui ne prouve rien, cependant, en faveur
des jésuites, car s’ils ont des principes erronés en morale et en politique,
ils ne sont pas assez insensés pour initier leurs bambins aux secrets de
l’ordre.
Au reste,
j’appris, sous eux, le latin, le grec, la géographie, l’histoire, les mathématiques,
l’astronomie, la physique, et une mauvaise philosophie. C’est-à-dire, que
j’appris, des hautes sciences, ce qu’il en fallait pour achever seul mon
éducation, quand je sortirais du collège.
Ma mère
mourut, et je la regrettai beaucoup, quoique ce fût une chose toute naturelle,
et qui devait arriver un peu plutôt, ou un peu plus tard : tout ce qui commence
doit croître, décroître et finir. Mon père me notifia qu’il allait me retirer
du collège, parce que j’étais beaucoup plus savant que lui, et qu’ainsi j’en
savais assez. Le père recteur lui dit qu’il avait préparé, pour la clôture
de l’année scholastique, un exercice public, qui devait
faire
le plus grand honneur à sa maison et à moi. Il le pria de ne pas me dérober
aux éloges qui m’attendaient, et dont je me sentais si digne. Je joignis
mes instances à celles du recteur, et mon père se rendit.
De ce
moment, tout changea autour de moi. Les jésuites me comblèrent de marques
d’amitié, et je les trouvai charmans. Ils me peignirent le monde comme un
écueil, où je perdrais mon innocence et mon âme, et je frissonnai. Ils me
vantèrent la sécurité dont je jouirais dans le cloître, et la haute considération
que je partagerais avec eux. Je brûlai de me ranger sous les bannières de
saint Ignace.
Le jour,
où les prix devaient être distribués, jaillit enfin du sein de l’éternité.
Jamais le soleil ne m’avait paru si brillant. Il me semblait ne s’être levé
que pour éclairer mon triomphe. Déjà, je me voyais, le front et les mains
chargés de couronnes et de livres, traversant pompeusement les rues d’Angoulême,
et suivi par d’inépuisables applaudissemens.
L’assemblée
était brillante et nombreuse. Sur le premier banc étaient placés deux évêques
: les jésuites aiment beaucoup à être bien avec les évêques. À la droite
et à la gauche des deux prélats, figuraient leurs grands-vicaires, les curés
et les vicaires d’Angoulême, sur qui leurs Grandeurs semblaient laisser tomber
un rayon de leur gloire. Le président du bailliage, le procureur du Roi,
les juges, quelques braillards d’avocats et un général étaient au second
rang, comme de raison. Il est cependant écrit : qui prendra la première place,
sera mis à la dernière ; mais on ne pense pas à tout.
Après
les illustres personnages que je viens de désigner, étaient assises les femmes
de qualité, jeunes, vieilles, belles et
laides,
parce que le grand roi Henri II, pensait comme le grand roi son père, le
roi chevalier, qu’on doit porter respect aux dames. Or, il est du bon ton
d’adopter, de proche en proche, les usages, les modes et les fantaisies de
la cour.
Par
derrière, étaient entassés et confondus le négociant, le fabricant, le savant,
le poète, leurs femmes, leurs filles, le capucin, le récollet, le procureur
et l’huissier à verges. Les domestiques et les cuisinières montraient humblement
le petit bout de leur nez, à travers la fente de la porte d’entrée, qu’on
avait laissée entrebaillée, afin que chacun pût participer à la fête.
On commença,
selon l’usage établi depuis la renaissance des lettres, par interroger le
fretin, c’est-a-dire, les écoliers des basses classes. Ils expliquèrent Phèdre
et le Cornelius-Nepos comme de petits anges, ce qui leur valut de la part
de leurs régens de petites tapes sur les joues. Le tour des rhétoriciens,
des philosophes vint ensuite. Ils brillèrent tous, parce que le programme
avait été arrangé d’après leur capacité.
Moi,
je ne voulus rien devoir à de petites intrigues de collège, et je me promis
bien de m’ouvrir une route nouvelle, quand je serais interrogé.
Monseigneur
l’évêque de Périgueux me fit l’honneur de me mettre en scène, et me demanda
du latin et du grec. Je badinai avec Horace, Térence, Saluste et Tacite
; avec la théogonie d’Hésiode, et la retraite des dix mille de Xénophon.
L’air d’incertitude avec lequel on m’écoutait, on me regardait me persuada
que Monseigneur, son illustre confrère, et le clergé ne savaient pas un mot
de grec, et n’entendaient de latin que celui de leur bréviaire. Je ne tardai
pas à m’en convaincre.
Monseigneur
de Cahors me demanda la traduction de quelques passages du premier livre
de l’Enéide. Je lui traduisis le second avec une verve, une chaleur dont
je ne me croyais pas capable. Ce n’est pas cela, me dit à l’oreille le régent
de rhétorique. J’allai toujours, et je racontai le sac de Troie, sans que
personne se lassât de m’entendre, et cependant cette histoire est longue.
Je fus couvert d’applaudissemens. Toutes les physionomies exprimaient une
vive satisfaction. Celles des jésuites seuls restèrent froides, et me parurent
sévères.
En effet,
mon espièglerie pouvait être découverte ; il est même étonnant qu’elle ne
le fût pas. Monseigneur de Cahors eût trouvé très-mauvais que les jésuites
fussent entrés, par leur silence, dans la mystification dont il était victime,
et ils attendaient de lui un éloge pompeux dans son prochain mandement.
Il était
tard, et la mort de Priam n’avait ôté l’appétit à personne. On résolut déterminer
la séance, en m’adressant quelques questions, auxquelles je pourrais répondre
en peu de mots. On me demanda l’histoire de la formation du monde. On s’attendait
à une réponse de catéchisme, et je me jetai dans les hauteurs de l’astronomie
et de la physique.
« La
terre, dis-je, est visiblemeut une émanation du soleil. Elle est une superfétation
de son écume, qu’il lança dans l’espace avec une force qui lui imprima son
mouvement de rotation. Il est indubitable qu’elle fut elle-même un noyau
de feu. Les traces de calcination qu’on rencontre sur tous les points du
globe attestent cette vérité. Les volcans, d’ailleurs… » J’allais ajouter
les plus belles choses du monde à ce premier exposé. Une voix aigrelette
cria à l’hérésie ; une seconde voix cria au matérialisme, une troisième à
l’athéisme. Tout le monde se
leva,
vociféra, me menaça. On regardait les jésuites de travers : il fallait qu’ils
fussent les instigateurs d’un petit drôle, qui n’avait pu imaginer les sottises
qu’il venait de débiter. Les clameurs se dirigèrent contre eux. On entendait
dominer les cris : À bas Loyola !
Les
jésuites sont quelquefois embarrassés. Ils ne le sont pas long-temps : ils
ont tant d’esprit et d’adresse ! Ceux-ci imaginèrent de prouver leur innocence
en me chassant de la salle à grands coups de pied dans le derrière. Cet argument
n’est pas sans réplique. Cependant il prévalut. Je rentrai chez mon père,
sans prix, sans couronnes ; et au lieu de me consoler, il me dit que je m’étais
conduit comme un sot.
On ne
parla dans Angoulême que de l’écume du soleil qui forme des mondes. Il parut
certain que je ne tenais pas ces idées des jésuites, puisqu’ils m’avaient
donné des coups de pied dans le derrière. Elles ne pouvaient m’avoir été
communiquées que par mon père, avec qui j’étais en contact continuel. C’est
ainsi que se communiquent la lèpre, et la petite vérole. Mon pauvre père
savait à peine signer son nom.
L’écume
brouillait toutes les cervelles ; mais toutes s’accordaient sur un point
: le délicieux spectacle de l’Estrapade était supprimé ; on pouvait le suppléer,
jusqu’à certain point, en m’enfermant avec mon père dans notre manufacture,
et en y mettant le feu. Il est constant qu’il n’y a plus rien à répondre
après cet argument-là.
Les
plus zélés s’empressèrent de vider leurs bûchers ; d’autres se contentaient
d’apporter de la paille. Nous ne nous doutions de rien, mon père ni moi.
Je rêvais physique et lui multiplication. Mais il faisait vivre cent
cinquante ouvriers,
répartis
dans tous les bâtimens. Assez d’écume comme cela, crièrent-ils ; du pain,
du pain ! Ils se jettent sur les fagots, les délient, et tombent à grands
coups de bâton sur les assaillans. Ils en blessent une douzaine, et dispersent
les autres, comme le vent de bise chasse devant lui les feuilles mortes.
On doit
vouloir brûler ceux qui croient à la puissance de l’écume du soleil ; mais
on ne se soucie pas de se faire estropier, en tentant de faire une bonne
œuvre. Les habitans d’Angoulême rentrèrent chez eux, et se remirent à leurs
petites affaires : c’est ce qu’ils pouvaient faire de mieux. Les magistrats
trouvèrent fort bon qu’on eût prévenu un incendie qui pouvait consumer une
partie de la ville. À la vérité, leurs maisons étaient voisines de notre
manufacture.
Vous
sentez bien, Monsieur de la Moucherie, que le couvent des jésuites et tous
ceux de la ville me furent fermés sans retour. J’avais cependant une vocation
prononcée ; mais que doit faire un homme raisonnable, trompé dans ses désirs
les plus chers ? se consoler et rire, et c’est le parti que je pris.
«
Savez-vous, M. André, que vous êtes un grand philosophe ?
— Monsieur
est bien bon. — Mais que votre philosophie est extrêmement dangereuse. Où
en serions-nous si nous admettions vos idées sur l’écume du soleil ? — Monsieur
voit bien que ce sont les idées fugitives d’un enfant de quinze à seize ans.
Le temps les a effacées. — Oh, tant mieux, mon cher André. Je vous préviens
que je suis très-zélé catholique, et que je ne peux vivre qu’avec ceux qui
partagent mes opinions religieuses. Nous entrons à la Villedieu. Après le
dîner, vous me raconterez la suite de votre histoire. Elle m’amuse, mon cher
André. — Je m’amuse aussi beaucoup en la racontant à monsieur. — Mais
comment se fait-il que j’aie trouvé un
homme
comme vous mendiant à Saurigny ? — Comme on a trouvé Denis de Syracuse maître
d’école à Corinthe. — Il est impossible de mieux répondre. »
J’allai,
prendre les ordres de M. le maréchal. Il n’en avait pas à me donner. Il me
recommanda seulement d’être prêt à remonter à cheval, quand il m’avertirait.
Je voulais dîner, et le maréchal ne me dit pas un mot sur ce sujet important.
Je m’adressai à son major-dôme. Il m’apprit qu’un capitaine d’infanterie
ne peut avoir l’honneur de manger avec les plénipotentiaires d’un roi de
France ; qu’il allait les faire servir ; que les domestiques mangeraient
ce qui resterait, et qu’il m’engageait à me pourvoir comme je le pourrais.
« Le fourgon qui porte les vivres, ajouta-t-il, passera à la Villedieu, pendant
que nous nous y reposerons. Il sera à Civray aussitôt que nous, et là, nous
serons dans l’abondance.
« Mais
en attendant l’abondance, me dit André, il est dur de ne pas dîner. Je vais
à la provision. — André, voilà un écu d’or.
— Ce
n’est pas la peine de le changer. J’ai de la monnaie. — Ah, vous avez changé
à Saurigny, le doublon que je vous ai donné ? — Le voilà, Monsieur
; » et il le tire d’une bourse complètement garnie. « Mais comment se fait-il
donc, André, que je vous aie rencontré, demandant l’aumône à Saurigny ? —
Vous saurez cela, Monsieur, avant que nous soyons à Civray. »
Il part
comme un trait, et revient, quelques minutes après, avec une grosse tranche
de jambon, un quartier de pain bis, et une dame jeanne d’un petit vin blanc,
qui n’était pas désagréable. « La philosophie, me dit-il, m’a appris que
pour conserver la tête lucide, il faut garnir l’estomac. » Il ajouta que
chaque paysan a des vivres ; qu’il les cache soigneusement,
parce
qu’il craint également les catholiques et les huguenots ; mais que la cachette
s’ouvre à l’aspect d’un écu d’argent.
Il me
semble que je ne devais pas tenir à l’étiquette avec un domestique, grand
philosophe, et à qui je devais la faculté de dîner. Je me plaçai sous un
chêne, et j’invitai André à s’asseoir près de moi. Il prit, de nos provisions,
ce qui lui était nécessaire, et il alla s’établir à quelques pas de moi.
Cet
homme-là m’étonne de plus en plus, me disais-je. Il joint, aux qualités que
je lui connaissais déjà, le tact des convenances. Pourquoi donce demandait-il
l’aumône à Saurigny ?
Il vit
les domestiques des ministres du roi qui préparaient les chevaux. Il courut
brider le mien. Le signal du départ fut donné. Je me mis en selle ; André
sauta sur son mulet, et toute la caravane prit le chemin de Civray.
« André,
où en étions-nous de votre histoire, quand nous sommes arrivés à la Villedieu
?... tous les couvens d’Angoulême vous furent fermés, et vous avez pris,
en homme raisonnable, le parti de vous consoler et de rire. » Il continua
son récit.
Ce premier
orage était calmé. Il s’en préparait un second, qu’aucune puissance ne pouvait
conjurer. Mon père devint amoureux d’une jeune personne qui était très-jolie
; il n’y a pas de mal à cela ; qui avait beaucoup de vertu, ce qui est quelquefois
un défaut capital. Mon père crut que c’était une qualité, et il l’épousa.
Le grand
roi François premier avait fait en Italie, et ailleurs, de longues promenades,
qui ne l’avaient pas toujours amusé. Le
grand
Henri II, son fils, crut devoir se promener ; mais dans ses États seulement.
Il vint à Angoulême, où on lui donna des fêtes magnifiques : c’est l’usage.
Les magistrats en font les honneurs; c’est le peuple qui paie.
Le corps
de la noblesse n’est pas nombreux à Angoulême, et elle ne peut danser, sans
élever jusqu’à elle quelques vilains, ce qui lui paraît très-désagréable
; mais le besoin rapproche les hommes. Ma belle-mère était une trop jolie
vilaine pour être oubliée.
Le roi
lui fit l’honneur de danser souvent avec elle ; il daigna quelquefois lui
serrer la main. Il la lui serra plus fortement et plus long-temps, quand
sa timidité lui permit de développer les grâces qui lui étaient naturelles.
Un roi
ne s’en tient pas long-temps à des serremens de main. Le grand Henri II s’exprima
en galant chevalier. Il tenait du grand François premier, son illustre père,
le goût de la chevalerie, qui lui coûta un œil, dans un tournoi qu’il donna,
rue Saint-Antoine à Paris, et la perte de cet œil entraîna celle de toute
sa personne.
Ma belle-mère
n’entendait pas le langage de la chevalerie. Elle regardait le roi d’un air
étonné, en faisant ses pirouettes. Le roi s’exprima plus clairement, et lui
fit comprendre qu’il voulait lui faire l’honneur de la déshonorer. Ma belle-mère
laissa le roi pirouetter tout seul, et s’enfuit à l’extrémité de la salle.
Le roi
l’y suivit, et la fatigua de ses adorations. Il adorait déjà Diane de Poitiers.
Apparemment que deux amours peuvent se loger dans le cœur d’un grand roi.
Ma
belle-mère, excédée, indignée, révoltée, sortit brusquement de l’hôtel-de-ville,
et courut chercher un asile dans les bras de son mari. Le lendemain matin,
deux jésuites, qui ne pouvaient me pardonner mon écume, Montgommeri et sa
garde écossaise entrèrent chez nous. Ils firent partout les plus rigoureuses
perquisitions, et trouvèrent un livre que je n’y avais jamais vu. C’étaient
les psaumes de David, mis en vers français par Marot. Il est clair qu’un
exemplaire de cet ouvrage ne peut se trouver que ch ez un huguenot. On se
conduisit d’après ce principe incontestable.
On enleva
le livre, et ma belle-mère aussi. On pilla la caisse de mon père ; on brisa
ses instrumens de fabrication. La populace s’ameuta, grimpa sur les toits
des bâtimens, et, en moins de six heures, il n’en resta pas une pierre à
sa place.
Nos
ouvriers n’avaient rien perdu de leur énergie ; mais la garde écossaise protégeait
les travailleurs, et ces protecteurs-là paralysent les bras les plus robustes.
Nous
nous promenions tristement, mon père et moi, sur ces débris qui attestaient
notre misère. Il ne nous restait plus rien au monde, et cela parce que ma
belle-mère avait de la vertu.
Nous
n’entendîmes plus parler d’elle, et le roi alla danser, et manger des pâtés
à Périgueux.
Nous
sortîmes d’Angoulême, et nous allâmes vendre à Cognac, quelques bagues qu’on
n’avait pas pensé à nous voler. Nous eûmes bientôt mangé le produit de nos
bijoux, et nous cherchâmes des moyens d’existence. Mon père eut le bonheur
de tomber malade et d’être reçu à l’hôpital. Il y mourut, parce
que
sa femme avait de la vertu. J’assistai pieusement à ses funérailles. C’est
tout ce que je pouvais faire pour lui.
Cependant
j’avais faim, et j’allais dans les maisons de Cognac, qui avaient le plus
d’apparence, demander à manger, et des écoliers qui voulussent apprendre
la physique et l’astronomie. On me demanda si je savais faire de l’eau-de-vie.
Je répondis que non, et on me tourna le dos.
Le marquis
de Marignan entra dans Cognac avec un détachement de cavalerie : il allait
prendre le commandement des troupes françaises en Italie. Vous savez, Monsieur,
que je n’ai pas l’humeur belliqueuse ; mais je n’avais pas dîné. Il est de
droit naturel que celui qui a faim prenne ce qu’il trouve. Les lois sociales
ont décidé que celui qui n’a rien doit mourir de besoin, et j’ai toujours
évité d’avoir des démêlés avec la justice. Je m’enrôlai, pour avoir du pain.
Me voilà forcé de regarder à droite, quand je veux porter la tête à gauche
; d’avancer, quand je veux reculer ; de trotter, quand je veux aller au pas
; de ployer sous le poids d’un mousquet, d’une épée, d’une pertuisane, et
tout cela parce que ma belle-mère avait de la vertu.
Je me
trouvai à la bataille de Marcian, en Toscane. Je regardai derrière moi, et
je vis qu’il m’était impossible de battre en retraite. Je tirai quelques
coups de mousquet, en fermant les yeux. Après la bataille, mon capitaine
prétendit que je m’étais comporté comme un héros, et il me donna la hallebarde.
Me voilà chargé du commandement de dix hommes, que j’aurais voulu voir à
tous les diables, avec le reste de l’armée, moi excepté. Malgré sa victoire,
le marquis de Marignan conclut une trêve de cinq ans avec le duc de Milan.
C’était bien la peine de faire tuer tant de monde !
On
me conduisit dans la Picardie, et on m’y notifia que j’obéirais au connétable
de Montmorenci. J’étais las d’obéir, et je voulais reprendre possession de
ma personne. Mais j’avais des soldats devant moi, derrière moi, et des officiers
voltigeaient à cheval sur les flancs des colonnes. Je fus encore forcé de
me trouver à une bataille. Le duc de Savoie attaqua le connétable sous les
murs de Saint-Quentin. Quel démon force à se battre des gens qui ne se sont
jamais vus ?
Les
Français furent mis en déroute, et je voulus déserter, à la faveur du désordre
et du tumulte. La foule, des fuyards me porta jusqu’à la Fère, où le duc
de Nevers prit le commandement des débris de l’armée. Encore un commandant
! Ils semblaient sortir de dessous terre.
Le duc
de Nevers faisait bonne chère ; mais il ne nous payait pas. Il ne nous donnait
qu’un quart de ration par jour, et il défendit la maraude, sous peine de
mort. Je ne concevais pas que lorsqu’un roi vole une province, il défende
à ses soldats d’escamoter une poule. Je trouvai cet ordre injuste, ridicule,
absurde, et je m’écartai dans la campagne. Je fus trouvé nanti d’un quartier
de lard dont un bout dépassait le bas de mon pourpoint. On instruisit mon
procès en cinq minutes, et je fus condamné à être pendu. Pendu, parce que
ma belle-mère avait de la vertu !
L’armée
de Saint-Quentin avait beaucoup d’aumôniers. Mais au moment de la déroute,
ces messieurs avaient pensé à se mettre en sûreté. Ils avaient jugé, avec
beaucoup de sagacité, que le duc de Savoie poursuivrait les fuyards, et ils
s’étaient dirigés sur Vervins. A notre arrivée, le clergé de la Fère s’était
porté sur Soissons. Le duc de Nevers était très-bon catholique. Il ne voulut
pas que je fusse pendu sans confession, et il me mit
sous
la garde d’une vingtaine d’hommes, pendant qu’on me chercherait un confesseur.
Le lendemain
d’une défaite, le soldat n’est pas remis de la terreur qui lui paralyse les
bras, mais qui donne une action incroyable à ses jambes. Le nom seul du duc
de Savoie répandait l’alarme dans nos rangs. Une fausse alerte mit en déroute
nos avant-postes. Mes gardes s’enfuirent les premiers. Je dénouai, avec mes
dents, les cordes qui garottaient mes mains, et je m’enfuis comme les autres.
À quelques
lieues de là, je rencontrai Coligny, grand-amiral de France, quoiqu’il n’eût
jamais mis le pied sur un vaisseau. Fait prisonnier à Saint-Quentin, il avait
trouvé le moyen de s’évader, et quand on se sauve de prison, on laisse nécessairement
ses bagages et ses domestiques derrière soi.
Nous
étions à pied tous les deux, assez mal vêtus l’un et l’autre, et, dans cette
situation, un goujat et un grand amiral se ressemblent parfaitement. Malgré
cette égalité, je l’abordai respectueusement ; cela était tout simple : j’avais
besoin de lui.
Un général,
tout seul, ne joue pas un grand rôle ; on n’est jamais orgueilleux que devant
témoins. Le pourpoint de monseigneur Gaspard de Coligny était percé au coude
; sa fraise était sale, et il n’avait pas même une houssine16 à la main. Il n’y avait pas
là de quoi trancher du grand seigneur. Aussi reçut-il fort bien mon hommage
: il avait aussi besoin de moi.

16 Baguette de houx ou de tout autre
bois flexible, employée notamment pour faire aller sa monture ou battre les
tapis, les vêtements (B.G.)
Il
me parla d’abord de la bataille de Saint-Quentin, des fautes qu’avait commises
lé connétable : je n’entendais rien à cela. Je lui répondis par des contes
; je le fis rire, malgré sa triste situation, et il me demanda si je voulais
entrer à son service. Vous sentez bien, Monsieur, que j’acceptai sans balancer.
« Ah, André, entrer au service d’un hérétique, d’un huguenot ! — Voudriez-vous
bien me dire, Monsieur, ce que vous eussiez fait à ma place ? — Hé, hé, André,
je crois que j’aurais refusé. — Oui, à présent que vous venez de dîner. Mais
si vous n’aviez rien pris depuis hier ? — Je crois… je crois… — Je crois,
Monsieur, que vous auriez fait comme moi. Je continue mon histoire. »
Monseigneur
Gaspard avait autant d’appétit que moi, et il avait caché quelques pièces
d’or dans une de ses bottines. Il me proposa d’arrêter au premier village
qui s’offrit sur la route. Je me chargeai de lui faire la cuisine : c’était
un moyen sur de dîner avant lui.
Nous
trouvâmes là une méchante cariole, un mulet, et un paysan de bonne volonté,
qui nous conduisirent à Laon. Quelques officiers, qui avaient conservé leurs
chevaux, étaient arrivés avant nous sur la montagne à pic qui porte cette
vieille ville. Le Français rit de tout. Ces messieurs s’amusèrent un moment
de notre grotesque équipage. Mais quand ils en virent descendre l’amiral,
ils le saluèrent avec une gravité imperturbable, et ils lui offrirent des
habitsdes armes, et des rafraichissemens. Pendant que monseigneur quittait
ses guenilles, je m’emparai d’un vieux costume de clerc, qui se trouva là,
je ne sais comment. Le plus fin sorcier ne se fut pas douté que j’eusse eu
l’honneur d’appartenir à l’armée francaise. J’allai ensuite aider à l’amiral
à terminer sa toilette.
Cet
homme, qu’on eût pris, un quart d’heure auparavant, pour un des derniers
officiers de l’armée, reparut avec ses grands airs. Aurions-nous plus de
confiance en nos habits qu’en notre mérite ?
L’amiral
me conduisit à Paris, où il allait remonter sa maison, et demander de nouvelles
troupes à la cour. Depuis qu’il était richement vêtu, il ne me parlait plus
que pour me donner des ordres. Il s’ennuyait, je le voyais bien ; mais il
s’ennuyait avec dignité. Son silence me permit de penser à ma nouvelle position.
Te voilà
donc valet, mon pauvre André ! Te voilà aussi soumis que lorsque tu étais
soldat, avec cette différence, cependant, que tu peux quitter ton maître,
et que tu étais cloué à ton drapeau. On prétend qu’il y a beaucoup d’honneur
à se faire tuer d’un coup de canon, ce dont je ne suis pas convaincu du tout,
et qu’un valet est un être dégradé.
Cependant
les grands seigneurs ne sont-ils pas, sous des dénominations différentes,
les très-humbles serviteurs du roi, quand il a, toutefois, quelque chose
à leur donner ? Et puis, le grand capitaine Lahire n’était-il pas le varlet
de Charles VII ? Cela est prouvé par les cartes à jouer, où il est conservé
sous la figure du valet de cœur. On a supprimé l’r, voilà tout. Or,
si un fameux général fut le valet d’un roi, vous pouvez très-bien, Monsieur
André, être celui du grand-amiral de France. Ce raisonnement me parut sans
réplique.
Monseigneur
Gaspard était très-content de mes services, et des plaisanteries que je me
permettais, quand je le voyais disposé à s’en amuser. Il me menait partout
avec lui, soit qu’il fit la guerre pour le roi, soit qu’il la fit contre
lui. Quand on se
battait,
je me tenais aux équipages. Vous savez, Monsieur, que je n’aime pas la poudre.
Quand
on voyage beaucoup, on a souvent de la peine ; mais on rencontre, parfois,
quelque chose de bon. Nous étions à la Rochelle. Un fourbisseur vint prendre
à monseigneur la mesure d’une cuirasse. Il s’était fait accompagner de sa
fille, qui devait prendre celle des coussinets piqués, qui amortissent la
dureté du fer. Je n’avais rien à faire, et je regardais la jeune fille. Elle
était très-jolie, très-bien faite ; elle avait beaucoup de grâce ; j’étais
dans l’abondance, dans le désœuvrement : rien ne dispose comme tout cela
à devenir amoureux.
J’allais,
tous les jours, chez le fourbisseur, et je trouvais toujours l’occasion de
glisser quelques mots à Guillelmine. D’abord, elle se bornait à m’écouter
; bientôt elle me répondit, et très-tendrement : c’est la marche ordinaire
du cœur féminin. Je lui proposai de l’épouser. Elle rougit : c’est répondre.
Je demandai
sa main à son père : il n’avait rien à refuser au valet favori de l’amiral.
Je fis part de mes vues à monseigneur. Il me répondit que je ferais ce qu’il
me plairait ; mais qu’il n’y a qu’un sot qui se marie dans la situation où
j’étais.
J’avais
vu qu’il dépendait de moi de faire une maîtresse. Mais on ne restait pas
long-temps en place avec monseigneur Gaspard. J’aurais été obligé de laisser
Villelmine à la Rochelle, et j’aimais pour la première fois. Mon titre de
mari devait l’obliger à me suivre à ses risques et périls, et je priai
un ministre calviniste de nous donner sa bénédiction.
« Ah
! André, André ! épouser une femme huguenote, et requérir le ministère d’un
prêtre de cette abominable religion !
Savez-vous
bien, mon cher, qu’une telle union n’est qu’un concubinage, et que vos enfans,
si vous en avez, sont des bâtards. — D’abord, Monsieur, je n’ai pas d’enfans,
et je n’en aurai pas, parce que je ne sais ce que ma femme est devenue. —
Que mon saint patron vous amène à résipiscence. »
Nous
rentrâmes en campagne, et cette fois monseigneur Gaspard allait se battre
contre le roi, qu’il avait si bien servi à Saint-Quentin : la tête d’un homme
est un magasin d’idées incohérentes et contradictoires.
Monté
sur un superbe coursier, monseigneur marchait bravement, fièrement à la tête
de ses troupes. Villelmine et moi, juchés chacun sur un criquet, suivions
l’armée à une distance convenable. Nous nous tenions la main, et nous nous
disions les plus jolies choses du monde : on a toujours quelque chose à se
dire pendant la première huitaine du mariage.
Le bruit
du canon mit fin à nos madrigaux en prose. Nous regardâmes devant nous, et
nous vîlmes qu’on se battait vivement dans la plaine de Moncontour. Il s’agissait
de savoir qui triompherait de Sixte IV ou de Calvin. On ne peut pas massacrer
des hommes pour une plus belle cause.
Malgré
les talens, la valeur et les efforts de l’amiral, Calvin fut vaincu. Monseigneur
fit, dit-on, une retraite magnifique. Tout ce que je sais, c’est que nous
entrâmes avec lui, et une partie de ses troupes, à Saint-Jean d’Angély.
Les
vainqueurs ne sont pas toujours généreux. La cour pensa que le parti Huguenot
serait anéanti, si on pouvait se défaire de monseigneur Gaspard. Elle le
fit condamner à mort par le parlement de Paris, et il n’était pas facile
de mettre l’arrêt à
exécution.
Mais les gens d’esprit ne sont jamais embarrassés. On proclama qu’un prix
de cinquante mille écus serait délivré à celui qui assassinerait l’amiral.
Il est constant que le second moyen pouvait être plus expéditif que le premier.
Monseigneur
avait un valet de chambre nommé Dominique d’Albe. Ce drôle-là faisait sa
cour à Villelmine, même en ma présence, et un mari n’aime pas cela. Villelmine
me protesta qu’elle ne l’écoutait pas, qu’elle ne l’écouterait jamais. Je
ne savais trop qu’en croire. Mais un beau matin, elle me prouva qu’on peut
être fidèle à son mari, après trois mois de mariage. Elle vint me dire que
Dominique apprêtait le déjeuner de monseigneur, et qu’elle lui avait vu mettre
une pincée, elle ne savait de quoi, dans sa coupe de vermeil.
J’aurais
pu lui demander ce qu’elle faisait à cette heure-là auprès de Dominique.
Je ne pensai qu’à me débarrasser d’un homme dont les assiduités metracassaient.
Mon devoir, d’ailleurs, m’ordonnait de sauver la vie de mon maître. Je ne
sais lequel des deux motifs fut le plus puissant, et c’est ce que je n’examinai
pas : on n’ergote pas avec soi-même, quand on fait son bien personnel, et
celui d’un homme qu’on veut conserver.
Dominique
et moi entrâmes ensemble dans la chambre de monseigneur, qui était loin de
penser à mal. Il jouait tranquillement avec la petite chienne de notre hôtesse,
qui l’avait pris en amitié. Le coquin plaça la coupe devant lui, avec un
air d’embarras qui ne pouvait m’échapper, et qui confirmait ce que m’avait
dit Villelmine. Je lui saisis fortement le poignet; j’arrêtai la main de
monseigneur, qui déjà se portait sur la tasse, et je lui criai qu’il allait
s’empoisonner. Dominique rougit, pâlit. Je le renversai sur le plancher,
et j’appelai du monde. On présenta le bouillon à la petite chienne.
Elle
tomba aussitôt dans des convulsions, qui firent jeter les hauts cris à sa
maîtresse. Elle se consola cependant en pensant que la vie du lieutenant-général
de Calvin vaut mieux que celle d’un caniche.
Villelmine
fut mandée. Elle déclara ce qu’elle avait vu, et Dominique fut pendu, sans
autre forme de procès.
Monseigneur
passa au cou de Villelminesa chaîne d’or, qui fit singulièrement valoir sa
peau blanchette, et il la nomma femme de charge de sa maison. Il m’éleva
à la dignité de valet-de- chambre, et, de ce moment, nous devînmes deux personnages
importans.
Le prince
de Béarn, aujourd’hui roi de Navarre, levait des troupes de tous les côtés.
Il en faisait venir de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Angleterre. Il semblait
que tout l’univers dût entrer dans cette querelle-là. La cour trembla, et
fit la paix. Elle accorda aux huguenots tout ce qu’ils demandèrent. Défions-
nous de nos ennemis, quand ils se montrent trop faciles.
On attira
à Paris, par des lettres remplies d’affection, et de magnifiques promesses,
tous les chefs du parti protestant. L’amiral fut comblé de caresses, et gorgé
d’or.
Nous
dormions, tranquilles sur les apparences, et la foi des traités, dans notre
maison de la rue de Béthisy. Tout à coup, le tocsin sonne ; des coups redoublés
font résonner les portes de la maison. Je me lève en tremblant ; je m’habille
à la hâte, et je ne perds pas la tête. Je prévois les événemens les plus
sinistres, et je cherche à m’échapper.
Je
rencontre, sur l’escalier, un grand nombre de forcenés, qui se pressent,
qui se poussent, qu’une fureur aveugle porte vers la chambre de l’amiral.
Je saute les degrés ; ils n’ont qu’un but en ce moment, et leur rage est
telle qu’ils ne m’aperçoivent pas.
Je parviens
jusqu’à la rue, et déjà le pavé est couvert de sang. Les poignards brillent
à la lueur des torches funèbres qui guident les meurtriers. Je me jette au
milieu des morts et des mourans. Meurtri, à demi-écrasé par ceux qui passaient
et repassaient sur mon corps tremblant, le reste de cette nuit affreuse s’écoula
dans des angoisses inexprimables.
À la
pointe du jour, les bras des assassins tombèrent de lassitude. Je me levai,
et j’en vis un qui expirait, appuyé contre une borne. Ce malheureux tenait
encore son poignard. Je le saisis. Je remarquai une croix rouge qu’il portait
au bras. Je l’arrachai et je la fixai au mien, avec une bande de galon, que
j’arrachai de mon pourpoint. Je n’avais plus rien à craindre. Je m’avançai
vers la porte Saint-Antoine. Mon poignard, ma croix, me tinrent lieu de passe-port.
On me laissa sortir de Paris.
J’étais
excédé, anéanti. Je tombai sur la route de Vincennes, et j’y attendis les
événemens. Le mestre-de-camp Crillon, fidèle au roi, mais trop brave pour
approuver des assassinats, sortit d’une ville souillée de crimes. Il passa
devant moi, et me reconnut. Lorsque Coligny rentra dans Paris, Crillon, juste
appréciateur du mérite, s’était lié avec lui. Il m’apprit la mort de son
ami, et de tant d’illustres personnages. J’étais sans ressources. Il me prit
à son service.
Je lui
parlai de Villelmine. Je ne devais plus la revoir de long- temps.
Le
malheur absorbe quelquefois nos facultés au point de nous rendre insensibles
à tout ce qui n’est pas nous. Je ne trouvai pas une larme à donner à une
femme que j’avais aimée.
« Mais
il me semble, Monsieur André, que vous n’approuvez pas cette Saint-Barthélémy
qui purgea la France d’un sang impur. Savez-vous, Monsieur, que le pape consacra
cette grande journée par les indulgences, dont il combla ses auteurs, et
par des réjouissances publiques ? Or ce qu’approuve et ce que blâme notre
saint père le pape doit être approuvé et blâmé par tous les bons catholiques.
— Ma foi, Monsieur, je respecte infiniment les décisions de sa sainteté.
Mais si vous vous trouviez dans une semblable échauffourée, donneriez- vous
des bénédictions à ceux qui vous poursuivraient le poignard dans les
reins ? — Enfin, André, pourquoi demandiez-vous l’aumône à Saurigny ? — M’y
voilà, Monsieur, m’y voilà. — Il en est temps. Dans un quart d’heure nous
serons à Civray. »
Je passai
du service de M. de Grillon à celui de dix à douze seigneurs, d’humeur et
de caractère tout-à-fait différens. Les uns ne me convenaient pas. Je ne
convenais pas aux autres : on exige dans ses domestiques des qualités qu’on
est souvent loin d’avoir soi-même. Depuis vingt ans je n’avais plus une volonté
à moi, et je trouvai dur enfin de vivre toujours pour et par les autres.
Je résolus de redevenir indépendant, et cette idée-là est une des plus entraînantes
qui jaillisse du cerveau humain.
Le secrétaire
d’état, Villequier, mon dernier maître, me dit un jour que j’étais un très-mauvais
domestique, mais que depuis un mois je ne faisais plus que ce qui me plaisait.
Je lui répondis de travers ; il me donna mon congé.
«
Cependant, me dit-il, vous ne manquez pas d’une certaine intelligence. —
Monseigneur est bien bon. — Vous êtes actif, quand cela vous convient ; je
vous crois même adroit, insinuant.
-
Monseigneur voudra bien remarquer qu’avec
ces qualités-là, on n’est pas un mauvais domestique. — Enfin, André, vous
ne me convenez plus. — Monseigneur, il n’y a pas de réplique à cela.
«
— Je vais vous indiquer un moyen de gagner beaucoup d’argent, sans dépendre
directement de personne. — Je l’adopte, sans balancer. — Il est difficile
qu’un valet de chambre ne connaisse pas une partie des secrets de son maître.
Vous vous lierez avec celui du duc de Guise, et lorsque vous aurez découvert
quelque chose d’utile au roi, et de bien constaté, vous recevrez cent pistoles.
— Et qui me les paiera ?
-
Ce sera moi, Monsieur, et en voilà trente
que je vous donne en avance. — Monseigneur, il n’est pas de moyen plus sûr
de commander la confiance. »
On n’aborde
pas facilement le valet de chambre du duc de Guise. Je commençai par me lier
avec les domestiques en sous- ordre, et, de proche en proche, je parvins
jusqu’au personnage que je devais faire parler. Je lui marquai des égards
et de la déférence : tous les hommes sont sensibles à cela. Je lui contai
des aventures plaisantes, et tout le monde aime à rire.
C’est
un bon homme que M. Chopin. Il ne s’informa point de ce que j’étais, de quoi
je vivais. J’étais bien mis, j’avais de l’argent, je l’amusais, je ne lui
demandais rien. Bien d’autres que M. Chopin ont été pris à ce piège-là.
Je découvris
les relations intimes du duc de Guise avec le roi d’Espagne ; M. de Villequier
ne me donna que cinquante
pistoles,
par la raison très-simple qu’il n’en avait pas davantage. Le métier d’espion
n’est pas honorable, et il faut, au moins, qu’il soit lucratif : je me décidai
à tirer de l’argent des deux côtés.
Nous
étions à Blois. Plus un théâtre est resserré, et plus les personnages se
trouvent en contact. M. Chopin voyait souvent
M.
Péricard, secrétaire intime du duc de Guise, et je quittais peu
M. Chopin.
L’occasion qu’on cherche se présente toujours, quand on l’attend avec patience.
Je trouvai le moment de présenter mes hommages à M. Péricard, l’homme le
plus vain de France, après son maître. Je lui marquai le plus profond respect
; je louai la profondeur de ses vues ; je le déclarai digne d’être le premier
ministre du roi de France, quel qu’il pût être, et il ne m’avait encore adressé
que des monosyllabes ; mais quand on a trouvé le côté faible d’un homme,
on en fait ce qu’on veut : la flatterie l’enivre, et ne lui permet plus de
réfléchir.
Vous
veniez, Monsieur, d’arriver à Blois, porteur de dépêches pour le roi et le
duc de Guise. M. Péricard me fit venir. « Mon ami, me dit-il, M. de Biron
est un personnage de la plus haute importance, et les deux partis veulent
se l’attacher. Cependant sa conduite est équivoque. Il offre au duc de Guise
son épée et six mille ligueurs, et le roi lui envoie le bâton de maréchal
de France. Quels sont les véritables sentimens de ce général ? Voilà, mon
cher André, ce que je vous charge de pénétrer. » Mon cher André ! comme on
caresse ceux dont on a besoin !
« L’émissaire
du général va repartir pour retourner à Poitiers. Vous le suivrez, André
; vous vous lierez avec lui sur la route ; vous vous mettrez bien dans son
esprit, et votre adresse fera le
reste.
Voilà cent pistoles. À votre retour, je doublerai la somme, si je suis content
de vous.
« —
Mais, André, vous jouez près de moi un vilain rôle. — Mais, monsieur, vous
ressemblez à ces gens, qui dès les premières scènes d’une comédie
veulent en connaître le dénouement. Un peu de patience, s’il vous plait.
Je sortis de Blois avant vous, et j’allai vous attendre sur la route. Quand
on est arrêté, et qu’on ne fait rien, on pense nécessairement. La commission
dont j’étais chargé était épineuse. M. de Biron n’est pas plaisant, et
si j’étais découvert, il pouvait me faire pendre. L’impression qu’avait faite
sur moi la hart, à la Fère, n’était pas effacée, et je tiens beaucoup à la
vie.
Je
n’étais pas embarrassé de me mettre bien avec vous.
« Monsieur
André, vous me prenez donc pour un sot ? — Au contraire, monsieur ; mais
on est seul, avec un domestique ordinaire ; quand on est seul on s’ennuie,
et alors on est bien aise de rencontrer un compagnon, avec qui on puisse
causer. — À la bonne heure. »
La grande
difficulté était de savoir à quel titre vous présenteriez au maréchal un
homme bien mis, que vous-même ne connaîtriez pas. Si j’avais pensé à prendre
un froc, à Blois, je n’aurais pas eu besoin de vous : on entre partout sous
ce costume-là. Mais quel est le grand homme qui n’oublie pas quelque chose
? « Vous êtes modeste, M. André. — Ouvrez l’histoire, monsieur, vous y verrez
qu’un oubli fait perdre une bataille, ou surprendre une ville ; qu’il envoie
des conjurés à l’échafaud ; qu’il renverse un ministre en faveur, et fait
disgrâcier une maîtresse. »
Je
rêvais profondément, quand je vis un mendiant couché sur le revers d’un fossé.
Son âne broutait à quelques pas de lui. Une idée lumineuse me frappa. Un
moine entre partout ; mais un mendiant n’est suspect à personne, et il a
le privilége d’écouter à toutes les portes. J’avais bien quelque répugnance
à me couvrir des guenilles de celui-ci ; mais dans les grandes occasions
il ne faut pas être difficile.
Je proposai
à cet homme de troquer ses haillons et son âne contre mes vêtemens et mon
cheval. Il crut d’abord que je me moquais de lui, et cela devait être. Quand
il me vit prendre sa modeste monture par le licol, et entrer sous un bouquet
d’arbres ; quand il me vit dépouillé de mon manteau, de mon juste-au-corps
et de mes hautde-chausses, il accourut et mit aussi habit bas.
L’effet
d’une forte dose de jalap17 est
tout au plus comparable à celui que j’éprouvai en endossant les livrées de
la misère. Il fut si prompt, que je n’eus pas le temps de détacher ma valise
de dessus mon cheval, et elle renfermait mon petit trésor. Mon homme disparut
comme un éclair, et je restai avec cette bourse, qui pendait à ma ceinture,
et qui tomba à mes pieds, quand je me déshabillai.
Un philosophe
tient peu aux richesses qu’il n’a pas, qu’il ne peut acquérir, ou dont la
perte ne peut se réparer. Je regagnai la grande route, monté sur mon âne,
vous attendant, et me grattant le devant et le derrière, par manière de passe-temps.

17 Racine d’une plante d’origine mexicaine,
purgatif violent (B.G.).
Vous
passâtes avec votre Julien. La décomposition de vos traits, votre air d’exaspération
me firent juger que vous n’iriez pas loin, et je me consolai de n’avoir qu’une
aussi chétive monture. Le coursier qui s’arrête ne vaut pas un âne qui chemine
toujours.
Je marchai
jusqu’auprès de Saurigny, étonné de ne vous avoir pas joint encore. Il entrait
dans mon plan de paraître exposé à tous les besoins, et je lâchai mon âne
à l’approche des premières maisons. Les ânes, comme les hommes, ne manquent
jamais de maîtres ; mon âne en aura trouvé un.
Je ne
m’étais pas trompé dans mes conjectures. Vous vous étiez arrêté à Saurigny,
et vous y étiez dangereusement malade. Vous êtes jeune, bien constitué. On
ne meurt pas du mal d’amour. Je présumai que vous guéririez, quoique vous
eussiez un médecin, et je ne me trompai pas encore dans cette circonstance.
Il fallait
attendre votre rétablissement, et soutenir dans Saurigny le rôle que j’avais
adopté. Il me parut plaisant qu’un homme, qui, depuis long-temps, ne comptait
que par vingt-cinq et cinquante doublons, tendit humblement la main pour
recevoir un denier, quand il avait encore trente pistoles dans sa bourse.
La facilité avec laquelle j’appris les grimaces d’usage, avec laquelle j’imitai
le ton lamentable de mes confrères, me donnait souvent des envies de rire,
auxquelles je résistai cependant.
Mais
un orage, que je n’avais pas prévu, se formait autour de moi. Messieurs mes
confrères trouvèrent très-mauvais qu’un étranger, un intrus vint exploiter
avec eux la charité de leurs compatriotes. Ils me notifièrent que j’eusse
à évacuer la place, ou à me décider à être jeté par dessus le pont. Je n’ai
pas plus de
goût
pour la noyade que pour le fatal cordon. Cependant je ne voulais pas
désemparer. J’allai trouver le curé. Je lui parlai ; il parut s’intéresser
en ma faveur, et il convoqua mes redoutables adversaires.
« Mes
enfans, leur dit-il, l’homme de la nature vivrait librement des produits
de la terre, et alors il n’aurait de contestation avec personne. Le péché
d’Adam a arrangé les choses tout autrement. L’homme social doit gagner sa
vie par son travail, ou la tenir toute gagnée de ses pères, ce qui est plus
commode. Hors de ces deux cas-là, il faut qu’il vive du superflu des autres,
ou qu’il se brouille avec la justice. Pourquoi cet homme-ci ne tendrait-il
pas la main comme vous ? — Monsieur le Curé, qu’il aille la tendre dans son
pays.
« —
Mes enfans, je me crois obligé de lui donner de quoi y retourner. D’où êtes-vous,
mon ami ? — Monsieur le Curé, je suis de Tunis. — De Tunis ! — Je suis un
des dix-huit mille esclaves que délivra l’empereur Charles-Quint. — Vous
étiez bien jeune alors. — Monsieur le Curé, je n’étais pas né. Ma mère me
conçut à Tunis, et elle accoucha dans la traversée. — Hé bien, il faut le
renvoyer dans la mer. — Hommes durs que vous êtes, pensez donc qu’il est
le fils d’une esclave chrétienne, délivrée par l’empereur Charles-Quint.
— Mais, monsieur le Curé, si les dix-huit mille esclaves délivrés par l’empereur,
venaient tomber à Saurigny, que deviendrions-nous ? — Vous le voulez absolument
? Hé bien ! il ira rejoindre les Espagnols que l’empereur a laissés sur la
côte d’Afrique. Mais j’ai promis de lui donner ce qu’il lui faut pour retourner
dans son pays ; ma parole est sacrée, et il y a loin d’ici à Tunis. Je viderai,
dans ses poches, la caisse des pauvres, et tous les troncs de l’église. Alors,
plus de distributions pour vous le dimanche. Jusqu’à ce
que
j’aie pu faire de nouveaux fonds, vous serez réduits aux deniers que » vous
amassez péniblement dans les rues de Saurigny. — Qu’il reste, Monsieur le
Curé, qu’il reste ! — Ainsi, la cupidité seule vous arrache un acte de cette
charité que vous invoquez sans cesse, et que vous ne savez pas pratiquer
! » Le curé partit de ce texte, et il improvisa une instruction pastorale,
qui tira des larmes de tous les yeux : le peuple passe facilement d’une extrémité
à une autre. Ceux qui voulaient me noyer, une heure auparavant, m’offrirent
ce qu’ils possédaient. Je refusai leurs pites ; mais il fut décidé
que je resterais à Sauriguy. C’est tout ce que je voulais.
Le curé
me tira à part. « Je ne suis pas dupe, me dit-il, du conte que vous venez
de me faire ; mais j’ai feint d’y croire, pour en tirer une leçon utile à
mes pauvres. Vous ne partagerez pas leur pain ; vous n’y avez aucun droit.
Je veux m’assurer néanmoins de la sincérité des dispositions qu’ils ont manifestées.
Je consens que vous restiez ici quinze jours, pendant lesquels je vous assisterai
de ma bourse. Allez.
« Vous
revîntes, Monsieur, à la vie et à la santé, ainsi que je l’avais prévu. Je
vous offris mes services ; vous les acceptâtes. Vous savez le reste.
« J’ai
maintenant à vous faire connaître les motifs de mes derniers aveux, et surtout
de celui des vues particulières que j’avais sur vous.
« On
s’occupe sérieusement de faire la paix : les deux partis en ont également
besoin. Le comte de Montpensier, parent du duc de Guise, est un des plénipotentiaires
du Roi, et il n’accordera aux réformés que des conditions qui ne blesseront
pas trop vivement les catholiques. Dans aucune circonstance les
princes
protestans n’ont commencé les hostilités. Ainsi, il y a lieu de croire que
cette paix sera durable, et, en temps de paix, personne n’a besoin d’espions.
D’ailleurs, ceux qui font ce métier-là finissent toujours mal, et je vous
le répète, Monsieur, j’aime à vivre.
« La
perte de ma valise m’oblige à reprendre du service, et je suis dégoûté de
celui des grands. Je veux un maître qui voie en moi un homme. Je vous ai
étudié, Monsieur, et je crois que vous me convenez parfaitement. Voilà encore
pourquoi je me suis montré à vous à découvert. La vérité pouvait percer plus
tard, et des réticences eussent amené des explications, qui vous eussent
paru trop tardives pour être bien sincères. Je vous crois assez prudent pour
ne parler à qui que ce soit de ce que j’ai fait depuis que j’ai quitté M.
de Villequier. — Soyez tranquille, André. Je ne vous compromettrai jamais.
Je veux vous garder avec moi, et mon intérêt vous répond de ma discrétion,
si ma délicatesse ne suffit pas pour vous rassurer.
« — Hé
bien, Monsieur, je compte sur l’un et sur l’autre. »

Paysan
français (recueil de Gaignières)

M.
de Montpensier
CHAPITRE
X.
La
Moucherie est admis dans l’intimité des plénipotentiaires du roi.
Nous
continuions de marcher, les plénipotentiaires toujours renfermés dans leur
cercle étroit ; André et moi jasant et riant tout haut, sans craindre qu’on
surprit nos secrets. Vingt fois le jour, je parlais de Colombe à mon confident,
car on ne peut pas toujours rire. André se conformait toujours à mes idées
du moment. C’est un homme bien précieux que celui qui s’afflige, qui espère,
et qui s’égaie avec nous !
Quand
nous étions las de la terre, il me transportait dans l’espace. Nous visitions
ensemble le soleil, la lune et les planètes. Il me faisait, sur tout cela,
des contes fort intéressans, qui captivaient mon imagination ; mais qui n’étaient
pas toujours orthodoxes. Oh ! alors je l’arrêtais avec une force, une véhémence
! un peu de contradiction est très-favorable à la conversation. Elle en
éloigne l’uniformité, qui amène l’ennui, et l’ennui est une terrible chose
! c’est une maladie de l’âme, qui,
à
la longue, tuerait le corps, si quelque secousse nouvelle ne la tirait de
son apathie.
Agité
par un sentiment dominateur, je ne craignais pas les tristes effets de l’ennui.
Je revenais à Colombe, dès qu’André perdait quelque chose de ses avantages
; je cessais d’écouter pour descendre dans mon cœur, et j’étais sûr de trouver
là des sensations toujours nouvelles.
Les
grands seigneurs seraient trop heureux, s’ils avaient l’art de se dérober
aux infirmités morales qui affectent l’espèce humaine. Nos plénipotentiaires
bâillaient souvent dans leur coche. C’est le moment où, sans réflexions,
on cherche chez les autres ce qu’on ne trouve plus en soi. La morgue, l’étiquette
cèdent au besoin de se communiquer. L’habitude de voir toujours les mêmes
figures fait disparaître quelque chose des distances que l’orgueil, ou l’ordre
social a établies entre les hommes. Messieurs de Montpensier et de Villeroi
me voyaient souvent voltiger autour de leur voiture. Montpensier, le plus
fier des trois, daigna enfin m’adresser la parole.
C’est
ce que je désirais depuis longtemps. J’enrageais de ne rien savoir de ce
que pensaient, de ce que projetaient ces messieurs. Je saisis, avec empressement,
l’occasion qui se présentait. Je n’avais pas la philosophie et la richesse
d’imagination d’André ; mais quand je parlais de choses dont j’étais fortement
pénétré, je m’exprimais avec facilité, et quelquefois même avec grâce. Le
comte de Montpensier me fit d’abord de ces questions insignifiantes, auxquelles
je ne pouvais guère répondre que par oui et par non. Le maréchal de Biron
fit prendre une certaine tournure à la conversation. « Le capitaine de la
Moucherie, dit-il à ses collègues, n’a pas encore vingt-un ans, et cependant
il a eu bien des aventures. Capitaine,
racontez-les
à ces messieurs. » Il savait mon histoire par cœur ; mais on partage toujours,
plus ou moins, le plaisir qu’on procure aux autres.
Nous
marchions à petites journées, par la raison, très-simple, que nous n’avions
pas de relais. Nous allions tous au pas. Cependant on n’entretient pas les
routes pendant les guerres civiles. Un cahot de la coche faisait perdre souvent
quelques mots à mon illustre auditoire ; un détour de quelques pas, qu’une
ornière m’obligeait à prendre, coupait mon récit, et on commençait à m’accorder
quelqu’attention. Ces Messieurs tinrent conseil sur la question de savoir
si on pouvait m’admettre dans la coche, et on la traita devant moi, homme
sans conséquence, que ne devaient pas blesser les scrupules des grands. On
finit par m’ordonner de donner mon cheval à mon domestique, et j’eus l’honneur
de m’asseoir avec les plénipotentiaires du roi de France. Le petit frère
Antoine assis avec les plénipotentiaires du roi de France ! quel honneur
! quelle fortune ! la tête m’en tournait.
On rit
beaucoup et de la relique trouvée sur le champ de bataille de Montcontour,
et de mes homélies, et de ma disgrâce auprès de madame de Montbason. Mais
on était sérieux, attentif, on exprimait de l’intérêt quand je parlais de
Colombe. Un amour, pur, innocent, passionné, a-t-il, pour les grands seigneurs,
le charme de la nouveauté ?
Mon
histoire finit, et on m’ordonna de rappeler mon valet. À cette interpellation,
le cocher arrêta, et je descendis de la coche, désenivré des fumées d’orgueil
qui m’avaient dérangé le cerveau. Hélas, pensais-je, la faveur des grands
se mesure sur le degré d’utilité, en tout genre, dont peuvent leur être les
petits.
Un
buveur brise une bouteille vide ; un grand jette, dans un coin, le hochet,
dont il s’est amusé un moment.
Je fis
part de mes réflexions à André, il les trouva fort justes ; il regretta seulement
qu’elles fussent le fruit de l’expérience. « Cependant, me dit-il, ce dénouement-là
était facile à prévoir.
« —
Et vous, André, de quoi vous-êtes-vous occupé, pendant les courts instans
où j’ai été l’égal des plénipotentiaires du roi ?
— Moi,
Monsieur ? j’ai voyagé dans les astres : ce sujet-là ne s’épuise jamais.
Je rêvais que le soleil pourrait fort bien être habité. — André, plus d’hérésies,
je vous en prie. — Monsieur, nos livres nous instruisent de la manière dont
le soleil fut formé ; mais ils ne disent pas qu’il serve exclusivement
à nous éclairer, et à nous chauffer. — C’est vrai, c’est vrai ; mais des
habitans dans le soleil ! — Sans doute, Monsieur, ils ne sont pas faits comme
nous. — N’importe, tout doit brûler là-haut. — Pourquoi cela, Monsieur?
n’avons-nous pas, sur notre petite terre, une plante qui résiste à l’action
du feu ? — Et laquelle, André ? — L’amyanthe, Monsieur ; et après le jugement
dernier, les méchans ne doivent-ils pas devenir incombustibles ? — Ah ! par
exemple, ce que vous dites là, est très-orthodoxe, et me réconcilie avec
vous. Oui, je commence à croire que le soleil pourrait fort bien être habité.
»
Mon
cheval, qui ne s’était pas élevé aussi haut que nous, broncha violemment.
J’avais cessé de le tenir en bride, pendant que j’étais dans le soleil ;
je roulai par-dessus sa tête, et je me trouvai étendu dans la poussière.
André me releva, m’épousseta et m’aida à me remettre en selle. « André, le
soleil ressemble aux grands seigneurs ; il nous rappelle à notre néant.
Ne nous élevons plus si haut. — Soit, Monsieur ; restons dans notre
sphère.
— Et parlons de Colombe, un de ses plus beaux ornemens. »
Nous
en parlâmes jusqu’à ce que nous aperçûmes enfin les clochers de Périgueux.
C’était la première ville remarquable, par laquelle nous allions passer,
depuis que nous avions quitté les environs de Poitiers. Nos seigneurs me
firent appeler, et me donnèrent plusieurs ordres. Le plus pressant était
de faire arrêter toute la colonne, et je l’exécutai à l’instant. Le second
fut que je m’en écrivisse un à moi-même. Il en joignait au capitaine de la
Moucherie de prendre avec lui quatre des valets les mieux tournés, les mieux
mis, et les mieux montés ; de partir avec eux, ventre à terre ; de brûler
le pavé de Périgueux, sauf à écraser quelque vilain ; de descendre chez le
commandant de la place, s’il y en avait un ; dans le cas contraire, de m’adresser
au bailli, et de lui enjoindre de recevoir les plénipotentiaires de sa majesté,
avec les honneurs de la guerre.
Je présentai
à la signature la pièce que je venais de rédiger, et mon goût pour l’observation
trouva de quoi se satisfaire amplement.
Qui
signera le premier ? « Ce sera moi, dit le maréchal, parce que j’ai l’honneur
de représenter le roi. — Moi, reprit le comte de Montpensier, je représente
Monseigneur le duc de Guise, mon parent, l’ami intime du pape et du roi
d’Espagne. Or, ces deux souverains-là et leur représentant en France, sont
fort au-dessus de votre Henri III qui… — N’allez pas plus loin, Monsieur
le comte, et apprenez qu’un roi, quel qu’il soit, est toujours le premier
dans ses Etats. — On n’apprend rien, Monsieur le baron, aux princes
de la maison de Lorraine. — Ils peuvent avoir besoin de leçons comme d’autres,
Monsieur le comte. — Ce n’est pas vous, au moins, qui leur en donnerez.
Voilà
la lettre que vous écrivîtes, il y a quinze jours, à mon cousin le duc de
Guise. Vous lui offriez six mille ligueurs, votre bras, votre épée, et vous
vous disiez son très-humble serviteur. Le bâton de maréchal de France a donné
une nouvelle direction à vos idées, et je n’aime, ni n’estime les gens qui
changent selon les circonstances. »
Le maréchal
s’élance sur la lettre, et la met en pièces : c’est ce qu’il pouvait faire
de mieux dans son intérêt présent et à venir.
« C’en
est trop ! » s’écria Montpensier furieux. Il saute à terre, et il a l’épée
à la main. Jamais on ne défia impunément un Biron. Le maréchal ne saute plus
; il descend de la coche, avec le plus beau sang-froid, et il se met en garde.
Villeroi se précipite. Il pare, avec son porte-feuille, les coups que se
portent les combattans ; il parvient à se faire écouter.
« Votre
vie est-elle à vous, Messieurs ? Avez-vous le droit d’en disposer, avant
que d’avoir rempli la mission dont vous êtes chargés ? Vous, négociateurs
d’une paix, dont la France a tant de besoin, vous ne rougissez pas de prévenir
par un duel, les augustes fonctions auxquelles vous êtes appelés ! Si les
catholiques et les huguenots suivent le déplorable exemple que vous leur
donnez, où s’arrêtera le carnage, et que penseront de vous la France et la
postérité ! »
J’étais
sincèrement attaché au maréchal, et j’aurais volontiers baisé le bas du manteau
de M. de Villeroi. En attendant l’effet de sa harangue, je m’étais glissé
entre les deux adversaires. Pour ne pas manquer à la modestie qu’exigeait
ma position, j’avais laissé mon épée dans le fourreau ; mais je présentais
ma poitrine découverte au fer de M. de Montpensier. « Allons, s’écria
ce seigneur, en éclatant de rire, ne voilà-t-il pas le petit
frère
Antoine qui veut que je le tue ! Parbleu, Monsieur le maréchal, il faut qu’il
vous aime bien, puisque vous lui faites oublier sa Colombe. Et M. de
Villeroi, reprit le maréchal, en riant à son tour, qui se fait un bouclier
de son porte- feuille ! » Le rire se communique comme la colère, M. de
Villeroi rit, et quand tout le monde rit, une affaire est bientôt arrangée.
M. de
Villeroi arrêta que les deux seigneurs, ayant eu réciproquement des torts,
se feraient des excuses, et quils parleraient ensemble, pour que l’un n’eut
pas l’air de ployer devant l’autre ; qu’il n’y aurait ni premier ni dernier
signataire, et que l’ordre dont j’étais porteur serait déchiré, dût-on n’être
pas reçu à coups de canon dans Périgueux ; qu’enfin, quand les articles du
traité de paix seraient arrêtés à Bergerac, le comte et le maréchal tireraient
à la courte paille pour savoir qui apposerait d’abord son noble seing au
bas du traité.
Les
deux premières conditions de celui qui venait d’être conclu furent exécutées
à l’instant. On se prit la main, on s’embrassa, on remonta, en riant, dans
la coche ; moi, je sautai sur mon cheval, et la caravanne se remit en route.
Je caracollais
autour de la voiture qui portait les destins de la France. Le maréchal, le
comte me regardaient avec une bienveillance marquée, et me souriaient quelquefois.
Bon, pensai-je, je ne tarderai pas à être admis dans l’intimité de ces messieurs,
et je connaîtrai les secrets de l’Etat. Quelle satisfaction pour un
petit être comme moi d’en savoir autant que des potentats !
Hé,
mais, où est André?... Je ne vois qu’un de mes mulets ! il est attaché derrière
un fourgon… Et l’autre ? Mon philosophe
s’est-il
laissé tenter ? A-t-il succombé à la tentation ? M’a-t-il enlevé ma petite
fortune ? Faut-il que je renonce à ma maisonnette, à mon champ, à mes bosquets,
que doit embellir Colombe, et que nous vivifierons ensemble ?... Réparation
à la philosophie. Ma valise est sur la croupe du mulet ; elle est intacte.
Où donc est-il allé avec l’autre ? Il faut que cet homme- là soit bien peureux
! Fuir devant deux épées qui ne le menaçaient pas ! Ah ! il se sera arrêté,
après avoir eu perdu de vue le champ de bataille.
Nous
voilà aux portes de Périgueux, et il ne paraît pas ! Oh, oh ! mais c’est
lui, c’est bien lui. Il vient à nous au grand galop. Je cours au-devant de
lui.
Il a
jugé, avec raison, que le duel n’aurait pas lieu. Il a pensé que la médiation
de M. de Villeroi, et les pourparlers, prendraient au moins une heure, et
il est allé préparer notre entrée solennelle à Périgueux. La ville est aux
huguenots, ils y sont en force, et ils ont de l’artillerie ; mais ces gens-là
ne tirent pas le canon pour des catholiques. C’était bien la peine de mettre
l’épée à la main ! Cet incident-là est un abrégé de l’histoire de presque
tous les hommes, de presque tous les lieux, de presque tous les temps.
André,
ne pouvant obtenir de bruit, a pensé au solide. On lui a promis sûreté pour
messieurs les plénipotentiaires, en raison de leurs dispositions pacifiques.
On leur a assigné des logemens spacieux et commodes. On a chargé un officier
municipal de pourvoir à leurs besoins. Ainsi, l’homme qui avait eu l’ambition
d’être le régulateur d’une fête, fut borné aux fonctions modestes de maréchal-des-logis.
J’allai
faire part à leurs seigneuries de ce que mon valet venait de m’apprendre,
et les éclats de rire recommencèrent. « Parbleu, dit le comte, nous aurions
bien dû réfléchir avant de nous fâcher, que le Périgord reconnaît l’autorité
du roi de Navarre. Il est inconcevable, reprit le maréchal, que cette idée-là
ne nous soit pas venue. Avouez, Messieurs, poursuivit le secrétaire- d’état,
que nous nous sommes conduits tous trois comme des enfans. Cela prouve, messieurs,
continuai-je, que l’homme, toujours si vain, souvent si content de lui, est
enfant à tout âge. »
Je me
mordis la langue, après avoir émis cette audacieuse observation ; mais je
reconnus qu’on peut tout dire aux grands, pourvu qu’on ait le bon esprit
de savoir choisir le moment. On était gai, et on me proclama, en riant, le
plus grand philosophe qui ait paru depuis Aristote. Je me gardai bien de
demander au maréchal si Aristote était grec ou romain.
Nous
entrâmes à Périgueux, comme de simples particuliers. André nous conduisit
aux logemens qui nous étaient destinés, et messieurs les plénipotentiaires
daignèrent lui adresser quelques mots de satisfaction.
« Nous
voilà à Périgueux. Nos chevaux, nos mulets ont marché pendant cinq jours
; ils ont besoin de repos : il faut passer ici la journée de demain. Qu’y
ferons-nous, au milieu de gens qui ne nous accordent pas la moindre attention
? — Nous bâillerons. — Bâiller pendant tout un jour, c’est un peu long !
— Allons,
capitaine la Moucherie, savez-vous encore quelques historiettes qui puissent
nous amuser ou nous endormir ? » Je ne balançai pas à répondre qu’oui, et,
par Saint-Antoine, je ne savais pas ce que je leur dirais ; mais j’arrivais
à mon but.
«
Allons, capitaine, vous mangerez avec nous, et sans que cela tire à conséquence.
Il est tard. Nous allons souper et nous coucher. — Mais qu’il arrange son
répertoire pour demain à l’heure de déjeûner. »
Je savais
déjà, avant que de me mettre au lit, qu’il existait, en France, un troisième
parti qu’on appelait les politiques ; qu’il avait pour chef de grands
seigneurs catholiques et huguenots, qui voulaient sincèrement le bien de
l’État; que les inférieurs, répandus dans toutes les provinces, y prêchaient
le besoin et l’amour de la concorde. Ces détails-là n’offraient rien de piquant
à ma curiosité, et j’avais, en les recueillant, étouffé quelques bâillemens.
André
me déshabillait : je commençais à jouer le petit seigneur. Je lui parlai
des politiques. Nous raisonnâmes ; nous senthues que des gens qui sont partout,
et ne se rassemblent nulle part, ne peuvent avoir d’influence marquée dans
des temps de trouble, et surtout de fanatisme ; que si le duc de Guise craignait
de les attaquer ouvertement, il calomnierait, avec succès, un parti qui offrait
l’amalgame scandaleux de sectaires des deux cultes ; et, en effet, les politiques
tombèrent plus tard, par cela seulement qu’ils étaient hommes de bien.
André
et moi tenions peu à la politique et aux politiques. Nous nous mîmes
chacun dans un bon lit, André pour dormir, moi pour rêver à Colombe.
Je m’éveillai
en me frottant les oreilles, en me frappant le front, et il n’en sortit rien.
On vint m’avertir que le déjeûner était prêt ; il fallait que je parlasse,
et je n’avais rien à dire. Heureux Jodelle, Pibrac, Ronsard, qui aviez le
talent de payer, en bons mots, les dîners que vous donnaient les
grands,
pourquoi
mon patron ne m’at-il pas accordé votre inappréciable mérite ?
Il m’inspira
de raconter à leurs seigneuries l’histoire d’André. Elle leur plut assez
: c’était quelque chose. Mais il en fallait une pour le dîner, une autre
pour le souper. Oh, qu’il est difficile d’être amusant, surtout quand on
cherche à l’être !
J’avais
été plusieurs fois interrompu dans mon récit. Il nous vient quelquefois des
idées soudaines qui nous échappent, en quelque sorte, malgré nous. J’avais
recueilli, au passage, des mots, qui n’étaient pas sans intérêt. Je savais,
en me levant de table, que le maréchal tenait, de bonne foi, au prince à
qui il devait le bâton ; que Villeroi tenait d’aussi bonne foi à sa place
; que le comte tenait exclusivement à sa famille. En effet, l’élévation du
duc de Guise était le garant de la sienne. Je reconnaissais toujours que
l’égoïsme est le grand régulateur de la conduite des hommes ; mais je vis
avec un plaisir inexprimable, que tous trois étaient les ennemis prononcés
de ce redoutable huguenot, de ce chef d’un parti infâme, que dirigeait Satan
lui-même, de Henri de Navarre enfin.
Je me
promenais par les rues de Périgueux, le nez en l’air. Je regardais ce qui
se passait du sol au haut des cheminées. Je cherchais le sujet d’une anecdote,
et je n’en trouvais pas. Pourquoi tant de gens ont-ils l’imagination si riche,
et le plus grand nombre l’at-il si pauvre ? André ferait, là-dessus, une
dissertation métaphysique trèssavante, mais qui sentirait l’hérésie. Je ne
lui parlerai pas de cela.
Je rentrais,
déterminé à bien dîner, et à me taire. Je trouvai mon philosophe, qui tenait
par la tête, une femme d’un certain
âge,
qui baisait ses joues sèches avec transport, et qui lui mettait sa bourse
dans la main.
« Comment
donc, André, auriez-vous retrouvé votre Villelmine, votre épouse chérie ?
— Pas tout-à-fait, Monsieur ; ce n’est que ma belle-mère. »
Il va
me raconter une histoire, qui me tiendra lieu de celle que je n’ai pu trouver
pour le dîner.
La belle-mère
et les psaumes de Marot avaient été mis dans une voiture particulière, bien
fermée, et escortée par vingt Écossais, qui ne savaient pas un mot de français.
Ainsi les exclamations de la très jolie vilaine se perdirent dans le peu
d’air que contenait sa coche.
Le capitaine
Montgommeri était un homme à toutes mains. Il plaça la belle affligée dans
une chambre richement meublée, et il mit des sentinelles à la porte et aux
fenêtres, avec l’ordre de prévenir un coup de tête : il savait de quoi est
capable une femme réduite au désespoir.
Bientôt
des valets, chargés des plus beaux atours, de pierreries, de perles,
se présentèrent, et étalèrçnt ces richesses aux yeux de la belle-mère, qui,
dit-elle, ne daigna pas les regarder, ce qui est un peu difficile à croire.
Quoi
qu’il en soit, le roi, persuadé que tant d’éclat laissait la belle sans défense,
ne tarda pas à paraître. A son aspect, les Écossais se retirèrent respectueusement.
Un grand
roi est persuadé qu’il doit soumettre enfin la plus rebelle, et cela est
arrivé quelquefois. Le grand Henri II adressa,
à
l’objet de ses vœux, les choses les plus touchantes, les plus délicates,
les plus spirituelles, car il avait infiniment d’esprit, à ce que lui disaient
ses courtisans. Il trouva fort extraordinaire que la dame ne lui répondît
pas un mot. Il la jugea très-bornée, mais elle était si jolie ! Et une femme
ne peut pas tout avoir.
Le grand
roi jugea à propos de joindre le geste aux paroles, et il se montra très-gesticulant.
La dame avait des ongles superbes, et elle savait s’en servir dans les grandes
occasions. Elle les imprima sur la figure de sa majesté, auprès de l’œil,
de celui même que Montgommeri creva plus tard. Une fatalité était attachée
à cet œil-là.
Le roi
sortit furieux, en déclarant à sa belle qu’elle n’était qu’une sotte et une
vilaine, indigne de l’honneur qu’il voulait lui faire. Comme un grand prince
ne reprend jamais ses présens, il la laissa au milieu de ses richesses, et
il continua sa majestueuse promenade, avec son œil éraillé.
La vertu
n’exige pas d’une femme qu’elle méprise des choses qui deviennent le prix
d’une victoire pénible, remportée sur elle-même. Elle considéra, avec satisfaction,
ses nouvelles propriétés ; elle se baissa même pour ramasser la bourse que
le roi avait laissé tomber, en gesticulant.
Son
premier soin fut d’envoyer un exprès à Angoulême : elle brûlait d’avoir des
nouvelles de l’époux qu’elle adorait. Elle apprit bientôt qu’il était complètement
ruiné.
Une
femme est bien aise de savoir si elle est veuve ou non. Dans le premier cas,
ses richesses étaient à elle seule, et cela méritait quelqu’attention.
Elle
dépêcha un second courrier, chargé de s’informer, dans les villes voisines,
de la destinée de son époux. Celui-ci lui rapporta son extrait de mort, signé
de l’hôpital de Cognac. Elle se couvrit de crêpes noirs de la tête aux pieds,
ce qui, très- souvent, ne prouve rien.
La dame
n’avait qu’une vertu, la chasteté. C’est beaucoup, sans doute; mais cela
ne suffit pas. Elle crut ses richesses inépuisables, et elle résolut de vivre
somptueusement. Il est un genre d’hommes qui se glissent partout, qui vivent
partout, et dont les revers n’éteignent pas la persévérance. La dame voulut
réaliser, cela était nécessaire, et un honnête israélite lui donna moitié
de ce que valaient ses bijoux.
La prévoyance
est une qualité ; l’économie, bien entendue, est presque une vertu. La jolie
dame n’avait ni l’une ni l’autre. Elle se jeta dans le grand monde ; elle
donna des dîners ; c’est le moyen d’avoir des amis. Mais elle ignorait ce
que l’expérience a appris des milliers de fois, c’est qu’on doit peu compter
sur ces amis-là.
Elle
commença à réfléchir quand elle n’eut plus que cinquante doublons ; c’était
s’y prendre un peu tard. Elle supprima les dîners, et elle fut abandonnée,
selon l’usage. Cette vérité est tellement connue, qu’il y a presque de la
trivialité à la rappeler.
L’abandon,
cependant, ne fut pas général. Il y avait à Périgueux, comme ailleurs, de
ces hommes qui spéculent sur les besoins d’une joliefemme. Celle-ci reçut
des propositions, et elle n’égratigna personne, parce que les amateurs jugèrent
à propos de prendre des intermédiaires. Chacun garda ses yeux, et elle sa
vertu.
Cependant
elle se trouva vis-à-vis de son dernier doublon : c’est un triste tête à
tête. Elle s’en servit pour se rendre à Limoges. Périgueux avait été témoin
de son faste, et allait l’être de sa misère : cette ville ne lui convenait
plus.
Elle
chercha à se procurer, à Limoges, des moyens d’existence : elle ne savait
qu’être sage. Elle fut contrainte de descendre à l’état de domesticité. Personne
ne voulut d’elle, parce qu’elle était inconnue, et que sa mise, élégante
encore, ne donnait pas une haute idée de ses mœurs. Les hommes sont loin
d’être infaillibles, et la vertu peut avoir, à leurs yeux, les apparences
de la galanterie, ou de quelque chose de pis.
La dame
se résolut à subir la dernière humiliation, à laquelle elle put se résigner.
Elle revint à Périgueux, et elle y demanda du service. Oh ! toutes les portes
lui furent ouvertes. Quel plaisir pour les Périgourdines de commander à celle
qui les avait éclipsées, et qui avait eu l’insolence de donner des tentations
à quelques-uns de leurs maris !
Elle
débuta par être femme de charge d’une dame qui lui disait les plus jolies
choses du monde, quand elle était dans l’opulence ; mais qui était acariâtre
et caustique. La belle-mère n’avait pas la vertu qui détermine à se soumettre
à sa destinée.
Elle
entra, en qualité de femme de chambre, chez la plus jolie personne de Périgueux,
après elle. Elle l’habillait mal, elle la coiffait de travers : c’était un
moyen sûr de lui déplaire à l’excès. Elle reçut son congé, et elle alla chercher
fortune ailleurs.
Elle
fut chargée, dans une troisième maison, de raccommoder le linge. Elle y trouva
l’avantage d’être seule dans une chambre,
et
par conséquent de ne pas craindre les traits malins dont l’accablaient ses
premières maîtresses. Mais elle faisait des reprises qui ressemblaient à
des coutures, et elle fut renvoyée. C’est une triste chose de n’être que
jolie et vertueuse, quand on manque de tout.
Elle
était fortement constituée. Une blanchisseuse, pour qui elle avait eu des
bontés, la recueillit avec humanité. Voilà celle, qui avait pu être la maîtresse
d’un roi, frottant au cuvier, et s’écorchant les poignets. Quelle chute !
Cependant la maîtresse blanchisseuse n’avait jamais eu de prétentions à la
beauté, et ne connaissait pas l’art de faire des épigrammes. L’ouvrière était
fort tranquille, pourvu qu’elle travaillât du matin au soir, le temps donné
aux quatre repas excepté.
On salit
beaucoup de fraises, quand on voyage par un temps sec. Un valet de confiante
avait rassemblé celles de leurs seigneuries et était allé chercher une blanchisseuse.
Il tomba chez la maitresse de la beauté déchue, et celle-ci reçut l’ordre
d’aller prendre le paquet.
André
était désœuvré. Il causait avec les domestiques des plénipotentiaires, qui,
en ce moment, n’étaient pas plus occupés que lui. On tient toujours au lieu
où on est né. André parlait d’Angoulême, quand sa belle-mère entra. Elle
prêta d’abord une oreille attentive, et se mêla bientôt à la conversation.
De souvenir en souvenir, de rapprochement en rapprochement, on arriva à la
reconnaissance théâtrale, dont la fin m’avait frappé.
« Hé bien,
André, que ferez-vous pour votre belle-mère ? — Comment, Monsieur, ce que
je ferai ! J’ai fait tout ce que je pouvais faire : je lui ai donné jusqu’à
mon dernier écu. — Mais des soins ? des consolations ? — Des soins
? nous partons
demain.
Des consolations ? Je suis valet, et elle blanchisseuse, parce qu’elle a
eu de la vertu. Je me console : qu’elle fasse comme moi. »
Je ne
manquai pas de raconter, au dîner, l’histoire de la belle- mère. Elle parut
amusante et instructive, et on me proclama homme d’esprit. Que de gens brillent
dans le monde, et n’ont, comme moi, que de l’esprit d’emprunt !
L’homme
d’esprit ne trouva rien à dire au souper. Il s’aperçut que leurs seigneuries
ne seraient pas fâchées de parler à leur tour. Il écouta : cela mène toujours
à quelque chose.
Il apprit
quelle était la composition et l’esprit de la sainte ligue. Elle avait à
Paris un comité, qui réglait, qui dirigeait tout, d’après les ordres de Guise.
Ce comité enrôlait des ligueurs, et faisait des quêtes, sous le prétexte
de pourvoir au nettoyage des rues. Déjà il avait recueilli trois cent mille
écus. Il avait des agens dans toutes les provinces, à qui il faisait passer
ces fonds, et partout on trouve des hommes avec de l’argent.
Le roi
d’Espagne avait, dans chacun des quartiers de Paris, un payeur, qui soldait,
à la fin de chaque semaine, tous les gens du peuple qui s étaient agrégés
à la ligue. Des chefs, choisis par le comité, dans toutes les classes de
la population, faisaient chaque jour des enrôlemens nouveaux, et bientôt
la capitale du royaume appartint au duc de Guise.
On arrêta
enfin le plan de la journée des barricades, et on pressait e duc de le mettre
à exécution. Il ne jugeait pas le moment favorable.
Des
courriers allaient sans cesse de Paris à Blois, et de Blois à Paris. Catherine
avait des espions, qui valaient bien monsieur André. Elle connut le danger
qui menaçait elle et le roi. Elle se hâta de traiter avec les huguenots :
il lui fallait un appui contre la maison de Lorraine. Le duc se trouvait
contraint à jeter son masque, ou à ne mettre aucun obstacle à la paix. Il
fit porter le comte de Montpensier au nombre des plénipotentiaires. Voilà
tout le secret des négociations précipitées qui allaient s’ouvrir.
On sent
bien que je ne recueillis pas ces renseignemens d’une manière suivie. Le
maréchal avait de l’esprit naturel, et il était franc et loyal. Monsieur
de Villeroi était fin ; M. de Montpensier n’était que fier. Villeroi n’avait
besoin, pour lui arracher des mots, très-significatifs, que de piquer son
amour- propre. Ce sont ces mots, échappés par intervalles, que je viens de
mettre en ordre.
Nous
étions sur la route de Beauregard, et je causais avec André. « Je vois, lui
dis-je, que jamais on ne doit désespérer de rien. Vous avez retrouvé votre
belle-mère ; pourquoi ne retrouveriez-vous pas votre Villelmine ? — Si je
la retrouvais, je la reprendrais ; il le faudrait bien. — Il le faudrait
bien ! Cette femme, si jeune, si jolie, n’a-t-elle plus de droits sur votre
cœur ? —Cette femme, si jeune, si jolie, a trente-six ans, et elle a perdu
ses attraits, qui consistaient uniquement dans sa fraîcheur. Je la reverrais
sans peine et sans plaisir. — Qu’est devenu l’amour qu’elle vous a avait
inspiré ? — Il s’est éteint, parbleu, victime du temps et de l’absence. Il
se fût peut-être évanoui plus promptement, si nous fussions restés ensemble.
Nous ne sommes ici-bas que des passagers. Nos sensations sont passagères
et fugitives comme nous. Cette vérité est tellement démontrée, que les
lois ont essayé de combattre la nature.
L’ordre
social vne peut exister que par la distinction des familles. Il a fallu,
pour le maintenir, rendre le mariage respectable, et on se fatigue, assez
communément, de ce qu’on est forcé de respecter. — Que dites-vous là, André
! Moi, je me fatiguerais de Colombe, si belle, si jolie, si candide, si aimante
! Cela est impossible. — Monsieur, la passion voit tout éternel, et la nature
veut que tout finisse. — André, vous calomniez mon cœur, et cela me déplait
singulièrement. — Je ne veux pas déplaire à Monsieur, et je me tais. Je
le prie seulement de vouloir bien remarquer que je n’ai fait que répondre
à ses questions. » Nous continuions de marcher, et je rêvais profondément
à ce qu’André venait de me dire. Quelques exemples, présens à ma mémoire,
fortifiaient ses assertions. Mais je conclus, après avoir bien réfléchi,
que Colombe et moi devions faire exception à une règle, à peu près générale.
Nous
arrivâmes à Beauregard, où on devait souper et coucher. Je me présentai au
moment où leurs seigneuries allaient se mettre à table : leur ordinaire me
convenait beaucoup. La fantaisie des historiettes était passée, et on me
notifia, avec assez de ménagement, que je n’aurais pas l’honneur de souper
avec messieurs les plénipotentiaires. J’allai trouver André, et je le chargeai
de faire un tour à l’office. Il ne parut pas étonné de ma méssaventure. «
Les grands, me dit-il, ressemblent au soleil, qu’il faut ne voir que de loin.
Les petits, qui ont l’ambition d’en approcher, se brûlent : vous l’avez déjà
dit. Pour être heureux, autant que le comporte notre organisation, il faut
vivre avec ses égaux. »
Il me
fit souper, et très-bien. Nous jasâmes d’amitié, et je reconnus la vérité
de ce qu’il m’avait rappelé quelques minutes auparavant. Qu’étais-je à la
table de leurs hautes puissances ?
Un
complaisant, obligé de les amuser. Si je me mêlais à la conversation, qui,
de loin en loin, coupait mes récits, il fallait réfléchir avant que de parler,
peser mes paroles, éviter celles qui pouvaient déplaire, en chercher qui
fussent flatteuses sans fadeur. Quelle contrainte, et que de difficultés
!
Ces
messieurs m’avaient proclamé homme d’esprit, sans doute pour justifier la
bonté avec laquelle ils m’avaient admis à leur familiarité. L’homme d’esprit
n’est, auprès d’eux, que ce brillant et frêle joujou, que brise un enfant
qui en est fatigué. Homme d’esprit, parlez ; homme d’esprit, amusez-nous
; homme d’esprit, taisez-vous ; homme d’esprit, retirez-vous. Voilà, avec
des circonlocutions et les ménagemens prescrits par la politesse, à quoi
se réduit le protocole des grands à l’égard de leurs inférieurs.
Mais
ne tiens-je pas, à l’égard d’André, la conduite qui me blesse dans messieurs
les plénipotentiaires ? Il est plus savant que moi, plus gai que moi, et
il y a moins loin de mon valet à moi, que de moi aux ministres du roi de
France. Ma foi, l’homme est le même dans toutes les conditions où le sort
l’a placé. Il veut dominer, et celui qui ne peut commander à personne, a
un chien.
Le désir
de savoir de quoi s’occupaient leurs seigneuries mit un terme à mes réflexions
philosophiques. Je ne manquais pas de prétextes pour entrer dans leur salle
à manger. C’était un papier à remettre à M. le maréchal ; un mot obligé à
lui dire à l’oreille ; des ordres à prendre pour le lendemain, et, en allant
et venant, je saisissais toujours quelque chose à la dérobée.
Ces
messieurs conféraient, avec le plus grand sérieux, sur la manière dont ils
aborderaient le roi de Navarre. Faut-il faire tant
de
façons avec un huguenot ? Ils calculaient les honneurs qu’ils rendraient
à un prince, qui n’avait, entre lui et le trône de France, que le frère
de Henri III. Pressentir qu’un huguenot régnerait un jour sur nous, c’est
être soi-même hérétique, relaps, renégat. Cette idée me mettait en fureur.
« Ah
! dis-je à André, Poussanville juge bien les grands : ils n’ont pas de religion.
— Monsieur, on prend un masque pour aller au bal, et on le jette quand on
n’en a plus besoin. »
Le maréchal
me fit appeler après le souper. Il me dicta, pour le roi de Navarre, une
lettre qui lui annonçait l’arrivée des plénipotentiaires à Bergerac. Il n’y
avait pas un mot qui ne fût respectueux. Quelques phrases paraissaient dictées
par une sensibilité profonde : leurs seigneuries espéraient que sa majesté
mettrait un terme aux maux qui affligeaient la France, par une paix conclue
à des conditions raisonnables. La majesté d’un huguenot ne peut être que
celle de Satan. Le prince des ténèbres seul avait pu souffler une lettre
semblable à leurs seigneuries. Le secrétaire-d’état Villeroi la signa seul,
pour éviter toute espèce de contestation entre le maréchal et le comte.
Je reçus
l’ordre de partir le lendemain, avant le jour, et d’annoncer, pour midi,
l’arrivée des plénipotentiaires. Me voilà métamorphosé en courrier de l’enfer,
et je ne partirais pas, s’il ne fallait suivre cette route pour me rapprocher
de Colombe.
Chère
Colombe, je vais donc te revoir, retrouver près de toi le bonheur et la vie,
fondre mon cœur dans le tien, redevenir plus qu’un homme !
Nous
partîmes, André et moi, deux heures avant le jour, et, à trois heures du
matin, nous étions aux portes de Bergerac. Les scènes qui m’avaient révolté,
affligé à mon entrée à la Rochelle, se renouvelèrent ici. Des soldats huguenots
me demandèrent ce que je voulais. Je répondis que je voulais parler à Henri
de Navarre. « Dites au roi, me répliqua durement un officier. Que lui voulez-vous
? — Lui annoncer l’arrivée des plénipotentiaires de la cour de France, et
lui remettre une lettre de leurs seigneuries. — Passez. »
Les
mêmes questions se renouvelèrent à tous les postes ; je fis partout les mêmes
réponses, et j’arrivai au cœur de la place. « Ne trouvez-vous pas, dis-je
à André, que tous ces gens- là ont des figures de réprouvés ? — Ils le sont,
sans doute ; mais je vous avoue, Monsieur, que je ne vois rien en eux qui
annonce la réprobation. »

Homme
de cour (Recueil de Gaignières)

Henri
IV (médaille de 1830)
CHAPITRE
XI.
Catastrophes
sur catastrophes.
Je demandai
à un personnage, qui me parut recommandable, à qui il fallait que je m’adressasse
pour être présenté au roi de Navarre. Il me rit au nez, et me tourna le dos.
Je le suivis, résolu de lui demander raison de son impertinence. « Et Colombe,
me dit André ! » Ce mot seul m’arrêta.
Je remarquai
un groupe de cinq à six personnes, qui se promenaient par les rues, en causant
familièrement. Je les abordai. L’un d’eux avait une figure belle, noble,
et qui annonçait la bonté. Un instinct secret nous pousse toujours vers ces
gens-là. Je renouvelai, à celui-ci, la question que j’avais adressée à mon
insolent rieur. Il me sourit, et se nomma. C’était le roi de Navarre lui-même.
Ma physionomie exprima sans doute quelqu’étonnement de le voir pressé ainsi.
II me devina.
« Oh !
me dit-il, ils me pressent bien autrement un jour de bataille. »
Je
lui présentai la lettre dont j’étais porteur. Il la lut à haute voix. « La
cour veut la paix, dit-il, et elle nous a toujours trouvés disposés à la
faire. Puisse-t-elle être sincère en ce moment ! » Il m’adressa quelques
questions sur les dispositions où j’avais laissé les plénipotentiaires. Je
pouvais l’instruire de choses que leurs seigneuries ne se doutaient pas que
je connusse. Je résistai au désir de faire l’important, et j’avais quelque
mérite à me conduire ainsi : on sait que la modestie n’est pas ma vertu d’habitude.
Je cherchai à répondre évasivement ; mais j’avais affaire à un homme pénétrant.
« Mes
amis, dit-il, Catherine veut nous opposer au duc de Guise. Si on peut s’en
rapporter aux apparences, il est présumable que la paix sera durable. Cependant
les négociations seront longues, puisque Condé est à la Rochelle. » Il parla
sur cet objet avec une facilité, avec cette éloquence du cœur qui persuade,
qui entraîne. Il s’attendrit sur le triste sort de la France ; il exprima,
pour son bonheur à venir, des vœux qui me parurent sincères. Je l’écoutais
avec un plaisir inexprimable. Je ne pensais pas à m’éloigner de lui.
« Chavagnac,
dit-il enfin, conduisez le capitaine chez Justin, et dites-lui de se tenir
prêt à recevoir les plénipotentiaires. Ils n’y feront pas bonne chère ; mais
ils vivront comme nous, et, ventre-saint-gris, ils ne peuvent rien exiger
de plus. Rosny, Mornai, faites recevoir ces messieurs au bruit de l’artillerie.
»
J’avais
oublié, un moment, que Henri de Navarre était huguenot. Le charme se dissipait
à mesure que je m’éloignais de lui. Bientôt je pensai que Satan s’exprimait
par sa bouche, pour attirer à lui les catholiques, et je me promis bien de
résister à la séduction.
M.
Justin était un négociant de Bergerac, qui avait une maison d’assez belle
apparence. Il pria M. de Chavagnac d’assurer le roi qu’il pouvait disposer
de lui, et de tout ce qu’il possédait. Allons, me dis-je, me voilà chez un
huguenot. Ô mon patron, soutenez-moi !
« Vous
êtes le maitre ici, me dit M. Justin. Faites, avec mes domestiques, les dispositions
qui vous paraîtront nécessaires, et même agréables, pendant que j’irai entendre
la messe. — André, cet homme est catholique, et il aime le roi de Navarre
! Cela me parait contradictoire, inexplicable. — Monsieur, ne serait-il pas
prudent de voir et d’entendre avant que de se former une opinion ? — J’ai
vu, j’ai entendu, André, et je vous invite à ne pas me contredire. »
Je n’avais
plus que deux heures à moi. Je visitai la maison, et, pendant que j’arrêtais
les logemens, M. Justin rentra. Il s’approcha de moi, avec un air gai et
affable. « Vous me laissez peu de place, me dit-il ; mais je me prêterai
à tout pour obliger notre Henri. — Votre Henri, et vous êtes catholique !
Ce prince a donc l’art funeste de séduire tous ceux qui l’approchent ? —
Il ne connaît pas d’art. Il est franc, loyal, gai, populaire, généreux, brave,
juste surtout. Jeanne d’Albret, sa mère, nous avait ôté nos églises ; il
nous les a rendues. Il veut honorer Dieu à sa manière ; mais il entend que
chacun jouisse de la même liberté. »
« Vous
l’avez trouvé au milieu de son conseil. Il a composé des seigneurs les plus
éclairés, et les plus équitables. Il parle d’affaires partout, parce qu’il
ne connaît pas la ruse ; il ne se donne pas même la peine de dissimuler.
Le luxe règne à la cour de France, et à celle du duc de Guise.
«
Le roi de Navarre est simplement vêtu ; mais il a de bonnes armes, et il
sait s’en servir. Il sort souvent seul, et les habitans de Bergerac l’entourent,
le pressent, le bénissent, et le gardent. Voilà son luxe à lui.
« —
Monsieur, il n’est pas de catholique qui ne fût trop heureux de réunir d’aussi
éminentes qualités ; mais dans un huguenot ce sont de fausses vertus. — M.
le capitaine, vous êtes bien jeune, et votre âge est celui de l’enthousiasme.
Le temps et l’expérience vous amèneront à des idées plus raisonnables.
— M. Justin,
j’espère que mon patron me fera la grâce de me soutenir dans celles que j’ai
adoptées. »
Je montai
sur les remparts, et je vis, dans le lointain, le cortège qui s’avançait
en bon ordre. Le baron de Rosny avait fait préparer les pièces, et il salua
MM. les plénipotentiaires d’une première décharge. Je montai à cheval, et
j’allai au- devant d’eux.
Je leur
rendis compte de ce que j’avais fait, et ils m’en témoignèrent une franche
satisfaction : le bruit du canon les avait mis en gaieté. Je profitai du
moment, pour leur donner un avis salutaire. « Messeigneurs, je vous supplie
de voir le roi de Navarre, le moins que vous le pourrez. Il m’a séduit, moi
qui ai l’honneur de vous parler, et, si vous n’êtes sur vos gardes, vous
ne résisterez pas à la séduction. » Ils rirent beaucoup de mes craintes,
et de ma manière de les exprimer. Voilà, pensai-je, de ces hommes qui ne
doutent de rien. Leur présomption sera punie.
Les
négociations seront longues, avait dit le dangereux huguenot. Je brûlais
d’être à Biron, et je conjurai le maréchal de m’accorder un congé. « Monsieur,
» me dit-il sèchement, vous
ne
pensez qu’à votre Colombe. Occupez-vous d’abord de votre devoir. Vous êtes
le seul officier que j’aie à ma suite ; vous ne me quitterez pas. »
Une
seconde salve d’artillerie annonca notre entrée dans la ville. Les catholiques
et les huguenots, pressés, confondus autour de nous, levaient les mains au
ciel, nous bénissaient, et criaient : vive la paix. Des catholiques unis,
par leurs vœux, à des huguenots ! et personne ne pensait à séparer le bon
grain de l’ivraie. Des lévites d’Israël ne rougissaient pas de se trouver
auprès des ministres de Baal ! Ô grand duc de Guise, c’est vous qui apprîtes
à votre fils à ne jamais transiger avec l’impiété ! C’est vous qui, en passant
à Vassy, purgeâtes cette contrée de trois cents soixante huguenots, rassemblés
dans une grange ! La palme du martyre fut votre récompense. Un suppôt de
Calvin, Poltrot, vous la décerna.
Les
plénipotentiaires allèrent saluer le roi de Navarre, qui les attendait chez
lui. Je le revis, cet homme redoutable. Il exerça, sur leurs seigneuries,
l’influence à laquelle il était presque impossible de se soustraire, dès
qu’on s’approchait de lui. Cette première entrevue fut consacrée uniquement
au cérémonial, et ne dura qu’un quart d’heure. Le roi de Navarre se leva
ensuite, s’approcha des ministres de Henri III, causa familièrement avec
eux, laissa échapper de ces traits d’esprit, si naturels, si simples, qu’on
était surpris de ne les avoir pas trouvés. Il se laissa aller ensuite aux
sensations de son cœur, et des larmes roulèrent dans tous les yeux. Non,
Henri de Navarre n’est point un homme, pensai-je. Un dieu, ou un démon suborneur,
a pris sa figure pour séduire, corrompre les humains. Je m’enfuis : je sentais
que j’allais pleurer aussi.
Je
repassais tout ce que j’avais vu et entendu depuis mon entrée à Bergerac,
et le souvenir de Colombe calma les idées noires qui me poursuivaient.
Les
négociations seront longues, avait dit le roi de Navarre, et le maréchal
m’a défendu de m’éloigner de lui ! « André, je suis au supplice. Il faut
que je la revoie, ou que je retombe dans le désespoir où vous » m’avez trouvé
à Saurigny. — Du désespoir, Monsieur ! Il n’y a pas à balancer : désertez,
et allons à Biron.
« —
Non, mon ami, je ne déserterai pas. Mais le maréchal aime tendrement son
épouse. Partez. Allez dire à cette dame que nous sommes ici pour long-temps,
et que Monseigneur sera heureux de l’avoir auprès de lui. Je vous donnerai
une lettre pour Colombe ; vous la lui lirez, et si la maréchale refuse de
vous suivre, vous lui parlerez de celle qui m’est si chère. Vous l’aurez
entendue ; ne perdez pas un mot de ce qu’elle vous aura dit, pas un mot,
mon cher André. Allez, partez, et puisse votre retour combler bientôt
tous mes vœux ! » Je lui donnai de l’argent, il monta à cheval, et il disparut.
Je me
promenais de chambre en chambre, chez M. Justin, en pensant à Colombe. Une
jeune personne, de dix-sept à dix-huit ans, allait, venait, donnait des ordres
à ses domestiques, et les faisait exécuter. Elle portait à sa ceinture un
chapelet, qui fixa mon attention. C’est une catholique, pensai-je, et cette
idée me porta à m’approcher d’elle, et à lui adresser la parole. C’est mademoiselle
Clotilde, la fille unique de M. Justin. Elle est vive, légère, enjouée, et
elle doit paraître charmante à qui ne connaît pas Colombe. Une jolie figure
attire toujours, et je trouvais du plaisir à causer avec elle.
Nous
étions en conversation réglée, quand leurs seigneuries entrèrent. Le maréchal
s’arrêta devant nous. « Vous auriez dû nous attendre, me dit-il, et nous
conduire ici. —Monseigneur, le roi de Navarre fait rire ou pleurer à son
gré. Il me fait peur. — Vous êtes un enfant. Voyons nos logemens. « M. Clotilde
conduisit ces Messieurs partout, avec une grâce toute particulière. Le maréchal
la regardait avec une attention très- remarquable, et qui, par conséquent,
ne m’échappa point. Il n’en fallait pas plus pour que j’observasse sa conduite.
Pendant
le reste de la journée, il saisit les occasions qui se présentèrent de s’approcher
d’elle, et de lui adresser quelques mots. Il la chercha le lendemain.
Voilà,
pensai-je, le maréchal amoureux, malgré ses cinquante ans. Amoureux d’une
fille de dix-huit ! Il perdra son temps et son amour.
Pas
du tout. La petite semble vouloir lui donner quelque facilité. Elle lui sourit
quand elle le rencontre, et elle a toujours quelque chose à voir ou à faire
dans nos logemens. Bien certainement le maréchal n’a pas eu avec elle de
conversation suivie, ainsi il ne lui a pas fait d’aveu. Il paraît que les
femmes, même les plus jeunes, n’en ont pas besoin, et qu’elles ne se trompent
jamais sur les sentimens qu’elles inspirent. Mais un amoureux de cinquante
ans ! Ah ! les femmes ont peut-être deux amours, amour de cœur et amour de
vanité. Les rides naissantes du maréchal disparaissent aux yeux de Clotilde,
sous les lauriers qui les couvrent.
La première
conférence devait avoir lieu chez le roi de Navarre, ce jour-là, à midi.
Messieurs les plénipotentiaires
m’ordonnèrent
de les suivre, et d’être prêt à écrire, si les circonstances le
demandaient.
Leurs
seigneuries furent reçues avec l’affabilité qui distinguait le roi de Navarre.
On s’assit, et Rosny ouvrit la séance par un discours, prescrit, me dit-on,
par l’usage. Selon les apparences, l’usage veut que ces discours ne signifient
rien, car Rosny parla longtemps sans rien dire. Au reste, le roi et lui pouvaient
émettre, après cela, toutes les idées que le moment ferait naître, sans crainte
de se mettre en contradiction avec eux-mêmes, et c’est quelque chose.
Monsieur
de Villeroi prit la parole : on sait qu’il était le plus fin des trois ministres
du roi de France. Il parla d’abord de la paix et du besoin qu’en avait la
France. Les deux partis avaient la même opinion, et on posa aussitôt cette
première base des négociations.
On commença
à discuter les conditions du traité. M. de Villeroi voulut se rendre impénétrable
sur les concessions que la cour était disposée à faire : c’était le moyen
d’accorder le moins possible aux huguenots.
Le roi
de Navarre l’interrompit. « Monsieur de Villeroi, ne perdons pas le temps
en ruses diplomatiques. Traitons franchement, loyalement. Voici ce que vous
pouvez accorder. » Il répéta aux plénipotentiaires ce qu’ils avaient proposé
et arrêté, dans leurs conférences secrètes, de Poitiers à Bergerac.
Le maréchal
se tourna vers moi, et me lança un regard foudroyant. Que me veut-il ? Je
n’ai rien dit au roi de Navarre de ce qu’il vient de rapporter.
Leurs
seigneuries parurent déconcertées. Le Béarnais rit.
« Voilà,
Messieurs, leur dit-il, bien des articles réglés en moins d’une heure. Je
vais expédier un courrier au prince de Condé. Il sera porteur des conditions
que nous venons d’arrêter ; le prince les approuvera, sans doute, et au retour
du courrier, il suffira d’une séance pour clore le traité. Messieurs, vous
dînez avec moi. »
Quand
nous fûmes rentrés chez Justin, les plénipotentiaires s’enfermèrent dans
leur salle des conférences. Ils m’y appelèrent, et me firent une scène épouvantable.
Je ne savais où j’en étais ; j’étais incapable de trouver un mot pour ma
défense, et cependant je croyais n’avoir rien à me reprocher.
On ne
peut toujours crier. Ces messieurs commencèrent enfin à se rendre intelligibles.
Ils m’accusaient d’avoir livré au roi de Navarre les secrets de la cour de
France. Ils savaient que j’avais entendu bien des choses, et j’étais le seul
qui ait pu en parler à Bergerac. Les apparences étaient contre moi.
Je me
défendis, avec la confiance et l’énergie que donne l’innocence. Mon ton,
mes expressions, le jeu de ma physionomie avaient un caractère de vérité,
qu’on ne joue pas, à vingt ans surtout. « Mais qui donc a pu instruire le
roi de Navarre, me demanda le maréchal ? — Monseigneur, il n’a pas besoin
de l’être. Le diable s’est emparé de lui, et parle par sa bouche. — Hé, Monsieur,
le diable n’est pour rien dans cette affaire-ci. Ce prince vous a-t-il fait
des questions, quand vous avez paru devant lui ? Oui, Monseigneur. — Que
vous a-t-il demandé ? Que lui avez-vous répondu ? »
Je me
rappelai assez facilement la conversation que j’avais eue la veille avec
ce prince. Je la rendis, à peu près, dans les
mêmes
termes. « Allons, allons, dit M. de Villeroi, la Mouche n’a rien dit de positif.
Il est même facile de reconnaître qu’il a cherché à se renfermer dans des
réponses générales, et par conséquent évasives.
« Mais
il a eu affaire à un homme pénétrant. Henri a tiré des inductions certaines
de ce qu’il lui a dit : ce jeune homme est innocent. Mais, Messieurs, nous
venons de recevoir une leçon assez forte pour éviter, à l’avenir, toute communication
directe avec qui que ce soit, quand nous parlerons d’affaires.
« La
Moucherie, reprit le maréchal, vous vous logerez à l’extrémité de la maison.
Vous n’approcherez du quartier que nous occupons que quand vous y serez mandé.
Dites à Clotilde
» que
je la prie d’avoir soin de vous. »
Le voilà
donc calmé, cet orage qui menaçait de m’abîmer. Il faut avouer -que je reviens
de loin, car enfin leurs seigneuries pouvaient être injustes avec impunité,
et elles ont daigné ne pas m’écraser. Tenons compte aux grands du bien qu’ils
nous font, et du mal qu’ils ne nous font pas.
Je n’avais
pas mon philosophe André, et ma position me plaçait au-dessus des valets.
Il ne me suffisait pas de penser ; il fallait que je parlasse à quelqu’un,
qui pût m’entendre et me répondre. Clotilde est jeune, et toute jeune femme
doit être, plus ou moins, sensible. Sa chambre, d’ailleurs, n’est pas éloignée
de la mienne. Nous devons nous rencontrer souvent. Elle sera ma confidente.
Je lui
parlais de mon amour, de mes privations, de mes espérances, avec cette chaleur
qui se communique si aisément. Clotilde soupirait en m’écoutant ; souvent
elle baissait les yeux,
en
jouant machinalement avec son chapelet, et elle me répondait avec une justesse
étonnante. C’est un bouton de rose, pensai-je, qui n’attend pour s’ouvrir
qu’un rayon du soleil.
Jamais
le maréchal n’avait eu autant de choses à me dire, et il m’en disait souvent
de fort insignifiantes. Il fronçait son sourcil gris, quand il me trouvait
avec Clotilde, et je la quittais peu. Bientôt, il ne chercha plus de prétextes
pour lui parler. Il me parut épier, au contraire, les momens où je sortais.
J’avais
été faire un tour par la ville. Le grand air m’avait rafraîchi la tête, et
je revenais auprès de Clotilde épancher de nouvelles pensées d’amour. Je
la trouvai assise auprès du maréchal. Il tenait une de ses mains, et il lui
parlait avec vivacité. Il rougit en me voyant. Rougir, en pareil cas, c’est
s’avouer coupable. Cependant, il aime tant la maréchale ! Ah, je vois ce
que c’est : certains hommes ont aussi deux amours, amour de devoir, et amour
du cœur.
« Monsieur,
me dit-il, nos chevaux et nos équipages sont à la discrétion de nos valets.
Je vous charge du soin de les surveiller. Allez dire à mon majordome de vous
loger de manière à ce que vous puissiez facilement remplir la mission que
je vous donne. » Le véritable motif qui portait le maréchal à m’éloigner,
n’était pas difficile à deviner.
Les
droits de l’hospitalité violés, une jeune fille conduite au bord du précipice,
le respect, la reconnaissance, l’attachement que je devais à madame la maréchale,
tout m’imposait la loi de prévenir les événemens que je redoutais. Je résolus
d’instruire Justin de ce qui se passait.
Je
le rencontrai sur l’escalier qui conduisait à la chambre de sa fille. Il
avait l’air soucieux. « Monsieur le capitaine, où est Clotilde ? — Dans
sa chambre, Monsieur Justin. — Et le maréchal ? — Voyez, cherchez,
Monsieur Justin. » Il monta rapidement. Bon, pensai-je, il a des soupçons.
Il va mettre ordre à tout cela, et je n’aurai pas commis d’indiscrétion :
il faut quelquefois se borner à jouer un rôle secondaire.
Je n’étais
pas pressé de parler au majordome. Je m’arrêtai au bas de l’escalier. Je
voulais connaitre le dénouement de la scène qui, vraisemblablement, se passait
en haut : cela était bien naturel.
Justin
descendit promptement. Sa fille le précédait. Elle était rouge comme une
cerise. Cependant son collet montant et la dentelle qui le bordaient n’avaient
rien perdu de leur fraîcheur. Je crois, au reste, qu’il était temps que Justin
arrivât.
Il conduisit
sa fille, je ne sais où, et le maréchal parut bientôt. Il avait le calme
et la dignité d’un ministre plénipotentiaire : il reprenait le masque qu’il
avait déposé en haut. « Que faites- vous là, Monsieur, me dit-il du ton le
plus dur ? » Un grand ne pardonne pas à un inférieur qui l’a trouvé faible.
« Pourquoi n’êtes-vous pas aux écuries ? Vous avez la manie de tout voir,
de tout écouter. Elle vous a nui à Étampes ; elle vous sera funeste à Bergerac,
s’il vous échappe un mot indiscret. Allez, obéissez, et ne reparaissez devant
moi que lorsque je vous ferai appeler. Ah, envoyez-moi Quentin. »
La discrétion
que me commandait le maréchal, sous des peines graves, me prouvait ses vues
sur Clotilde, et qu’il l’aimait au point de perdre la tête : il eût plaisanté,
dans toute autre circonstance, d’un incident qui allumait sa colère, et qu’un
air
de gaîté eût pu faire croire tout-à-fait sans conséquence. C’était le sourire
sur les lèvres qu’il devait se présenter à moi ; mais l’homme passionné ne
réfléchit pas.
Justin
commit une autre faute. Il mit sa fille chez une parente, bavarde à l’excès.
Deux heures après, le maréchal et Clotilde étaient la fable de la ville.
Quentin
rôdait sans cesse autour de la maison qui recélait la jouvencelle. Tout le
monde le remarquait, et je jugeai, moi, qu’il était un de ces valets qu’un
peu d’or dédommage de l’avilissement où les plonge leur maître.
J’étais
réduit à surveiller des chevaux, et ces fonctions-là n’ont rien d’agréable.
J’étais dédommagé de ma disgrâce par la satisfaction d’apprendre tout ce
qui se passait : les domestiques sont les espions de leurs maîtres. Je sus
que Montpensier et Villeroi plaisantaient le maréchal ; que le roi de Navarre
le félicitait sur la rapidité de ses conquêtes ; que Justin était au désespoir
; que sa fille pleurait ; que sa vieille parente la sermonait ; enfin que
le maréchal jouait un fort sot personnage. Quel bruit, quel scandale ! Et
je n’étais pour rien dans cette affaire-là ! Quelle tournure elle eût prise,
si je l’eusse dirigée ! J’étais incapable de cette perfidie.
J’avais
voulu, au contraire, sauver cette jeune fille, et toutes les circonstances
s’étaient réunies pour la perdre ! Quel sera le dénouement de cette aventure
? Il n’y apas d’intrigues qui n’ait le sien. J’étais loin de prévoir celui
qui se préparait. Je devais en être la première victime.
On ne
peut s’occuper toujours des affaires des autres. Il faut revenir aux siennes,
surtout quand elles sont du plus haut
intérêt.
Il y avait trois jours qu’André était parti. Je commençais à compter les
heures, les minutes ; j’aurais voulu précipiter la marche du temps. Hélas
! il marchait avec trop de rapidité.
Je sortais
de la ville, et je me portais sur le chemin de Cahors. Je regardais au loin
et je ne découvrais rien. Mes yeux fatigués s’efforçaient en vain de pénétrer
dans le vague qui terminait l’horizon, et je rentrais à Bergerac, triste
et abattu.
Je ne
pus maîtriser plus long-temps mon cœur et ma tête. Je sautai sur un cheval,
décidé à braver le courroux du maréchal, et je pris, ventre à terre, la route
de Biron.
Je distinguai
bientôt un cavalier; une voiture le suivait de près, et je poussai mon cheval
plus vivement que jamais. Je reconnus André.
La gaîté
était son élément, et sa figure exprimait, en ce moment, une tristesse profonde.
Je ne m’arrêtai pas avec lui, et je courus à la voiture de madame la maréchale.
J’y vis cette dame avec Claire et Félicité. « Colombe, m’écriai-je, Colombe
!
— J’ignore
ce qu’elle est devenue. »
Le tonnerre
tue, écrase, pulvérise ; ce coup terrible ne m’ôta pas la vie. André était
déjà descendu de son cheval. Il me reçut dans ses bras, et me porta dans
la coche de madame. Elle me parla long-temps, et je n’entendis rien de ce
qu’elle me dit. Je souffrais horriblement, et je ne pouvais mourir.
André
ne savait rien de l’aventure de Clotilde, et il conduisit la coche à la porte
de la maison qu’habitaient leurs seigneuries. Madame et ses femmes y descendirent.
Je ne vis plus rien.
Je
sortis d’une espèce de léthargie, et je me trouvai dans le logement que m’avait
donné le majordome. André était près de moi ; il me tenait les mains. Il
n’opposa point à ma douleur ces lieux communs, par lesquels le vulgaire croit
consoler les affligés. Il s’efforça de faire renaître l’espérance dans mon
cœur flétri. L’espérance ranime le courage : il m’en fallait de plus d’un
genre. Je me sentis la force d’écouter le récit de mon infortune.
Colombe
me croyait mort et l’existence lui était insuppor- table. Les soins, les
consolations de la maréchale lui étaient à charge : elle voulait penser et
souffrir seule. « Il n’y a que Dieu, s’écria-t-elle enfin, qui puisse le
remplacer dans mon cœur. » Madame ne put obtenir d’elle que ces paroles.
La bonne,
la respectable dame voulait l’éloigner de ce château de Montbason, où elle
avait été frappée du coup mortel. Elle espérait que le grand air, et la vue
d’objets nouveaux, lui donneraient quelque distraction. Elle marcha ce jour-là
jusqu’à Preuilly, et la journée était forte. Elle fit dresser, dans sa propre
chambre, un lit pour l’infortunée. Elle l’entendit plusieurs fois répéter
dans la nuit : Dieu seul peut le remplacer dans mon cœur.
Elle
parut plus calme le jour suivant: la vraie piété est le seul baume qui puisse
guérir les plaies de l’âme. Colombe avait pris une résolution invariable,
et elle se sentait soulagée.
Elles
arrivèrent au camp du maréchal, et l’infortunée ne fit, ne dit rien qui pût
donner des inquiétudes à madame. Elle ne s’occupait que de l’exécution de
son dessein.
Le
surlendemain elles s’arrêtèrent à Saint-Junien, et c’est-là que Colombe disparut.
Madame la fit chercher, pendant le jour suivant, par ses femmes, par ses
domestiques. Elle-même parcourut la ville, cherchant partout des renseignemens,
qu’elle ne put obtenir. Elle se décida à continuer sa route.
Tel
était l’état des choses, quand André arriva à Biron. Il prévit celui où me
jetterait cette affreuse nouvelle. « Dieu seul peut vous remplacer dans son
cœur, me répéta-t-il, pour la vingtième fois. Il est clair qu’elle s’est
jetée dans un cloître, à Saint-Junien, ou dans les environs. Nous la chercherons,
nous la trouverons. — Oh, oui, oui, André. Voilà le moment de déserter, partons.
— Vous ne déserterez pas, monsieur. Le Maréchal n’est plus rien pour vous.
— Comment cela ? »
Lorsque
la voiture arrêta devant la porte de monseigneur et qu’il reconnut madame,
il resta frappé d’étonnement et d’une sorte de crainte. Bientôt il composa
son visage, et il embrassa son épouse, avec une tendresse sincère ou simulée.
Il lui présenta la main pour la conduire chez elle. André les suivait : il
aidait aux domestiques à monter les paquets de Madame. Le maréchal lui demanda
à quel heureux hasard il devait le plaisir de la revoir sitôt. Cette question
parut l’étonner. Elle répondit qu’elle s était conformée à ses ordres. Il
était impossible que cette réponse n’amenât pas une explication.
Le maréchal
sut que j’avais expédié André à Biron avec une invitation positive à Madame
de se rendre près de son époux.
« Il espérait,
ajouta-t-elle, que je lui ramènerais sa Colombe.
« Pauvre
jeune homme ! » La figure du maréchal exprima des sentimens violens, et quelquefois
contraires.
Le
comte de Montpensier et M. de Villeroi, se hâtèrent de descendre. Ils félicitèrent
Madame sur son heureuse arrivée ; et ils regardaient le maréchal d’un certain
air ironique, qui parut ne pas échapper à son épouse. Cette première impression
se serait dissipée sans doute ; mais un incident imprévu brouilla tout.
Justin
désolé, exaspéré, parut inopinément. Il tomba aux genoux de Madame et la
supplia de sauver sa fille ; de la protéger contre le rang et les entreprises
du maréchal. L’éclat était fait, et la démarche de Justin était au moins
inutile. Mais le désespoir ne permet pas de raisonner. Ces scènes se passèrent
sur l’escalier.
Tout
était éclair ci, et Madame parut profondément affectée, Villeroi entreprit
de rétablir l’harmonie entre les deux époux. Il avait de l’esprit : c’était
bien le moment de s’en servir.
Il convint
franchement que peu de maris, éloignés de leurs femmes, résistent à l’occasion,
quand elle se présente ; mais que l’épouse qui réunit la beauté à une haute
naissance et à une amabilité remarquable, n’a qu’à paraître pour n’avoir
plus de rivales à redouter. « Ce qui prouve invinciblement, madame, que l’erreur
de M. le maréchal n’est que celle d’un moment, c’est le vif intérêt, l’extrême
tendresse avec lesquels ses yeux se fixent sur vous. » Un mari pris sur
le fait, joue toujours un sot personnage, et le maréchal laissait parler
son interprète. Villeroi avait caressé l’amour-propre de madame, et il s’en
était aperçu. Il ajouta quelques phrases flatteuses pour elle, et elle ouvrit
ses bras à son époux. La dévotion n’éteint jamais, entièrement, dans une
femme, la confiance que lui inspire sa beauté.
Le
dénouement n’était pas complet encore. André voulait savoir quel serait mon
sort. Il n’attendit pas longtemps. Le maréchal descendit, après avoir conduit
madame à son appartement. « Votre maître, dit-il à mon domestique, est un
faquin, qui a la fureur de se mêler de tout, et que les plus tristes expériences
ne corrigeront pas de cette détestable manie. Je lui dois la scène, infiniment
désagréable, que je viens d’essuyer. Qu’il n’essaie pas de se justifier.
Sa présence renouvellerait des explications, qui ne peuvent qu’être dangereuses,
en ce moment. Il m’a demandé un congé, pour aller voir sa Colombe. Je lui
en donne un de cent ans. Il aura le temps de chercher sa belle. — Et ce qu’il
tient de vous, monseigneur ? — Qu’il le garde, et que je ne le revoie jamais.
»
« Voilà,
me dit André, la péripétie la plus embrouillée complètement terminée, tant
bien que mal. Voyons maintenant quelle est notre position. Vous avez dix
mille livres en espèces sonnantes, et avec cela on va loin. Ajoutons, au
principal, des accessoires, qui ne sont pas à mépriser ; une garde-robe montée,
qui vous permettra de vous présenter partout ; une voiture assez jolie, qu’on
s’est donné la peine de ramener de Poitiers ici ; deux bons mulets et un
excellent cheval. Avec cela, on voyage commodément. — Partons, André. — Partons,
Monsieur. C’est ce que nous avons de mieux à faire. » En moins d’une heure,
il avait fait les dispositions nécessaires pour notre départ.
On pense
bien que nous prîmes la route de Saint-Junien. J’étais successivement agia;
par deux sensations opposées, la crainte et l’espérance. Je passais rapidement
de l’une à l’autre. Je ne parlais pas; mais André lisait ce que j’éprouvais
dans mes yeux, et sur les muscles de mon visage. Il entreprit de me faire
oublier
pendant un moment, la terre, et la plus parfaite des créatures qui l’habitaient.
« Monsieur,
me dit-il, nous sommes à peu près persuadés que le soleil est habité. — Que
m’importe ? — Mais notre soleil n’est pas le seul qui nagedans l’immensité
de l’espace. — Où est le second ?— Que pensez-vous des étoiles fixes ?
— André, vous m’impatientez. — Les étoiles sont autant de soleils. Nous les
voyons petits, en raison de leur éloignement. Mais si la lumière primitive
n’émanait pas d’eux, ils n’auraient qu’une lumière réfléchie, et nous apercevrions
facilement les globes de feu qui la leur communiqueraient. Ainsi nous pouvons
promener notre imagination dans cette foule innombrable de soleils, qui,
peut-être, diffèrent essentiellement entre eux : vous le savez, Monsieur;
diversité est la devise de la nature. — Non, je ne sais pas cela.
— «
Pourquoi chacun de ces soleils n’aurait-il pas, comme le nôtre, des planètes
à qui il imprime un mouvement de rotation, qu’il attire à lui, et que leur
poids soutient dans le vague ? — Finissez, et occupons-nous de Saint-Junien.
— Nous ne pouvons les apercevoir, parce que leur lumière d’emprunt échappe
nécessairement à notre vue. Mais si tout est varié dans la nature, n’est-il
pas vraisemblable que les habitans de telle de ces planètes naissent et vivent
pour l’amour ? — Tu crois cela, André ?— Qu’ils s’attachent à l’objet de
leur tendresse, comme la vigne à l’ormeau ? — Ils en seraient plus malheureux.
— Qu’ils ne sont contrariés par aucune institution sociale ; que leur organisation
leur impose la nécessité d’être toujours contens ; que leurs enfans couvrent
leurs rides de guirlandes de fleurs ; qu’ils s’éteignent dans les bras de
ceux qui leur doivent le bonheur d’aimer à leur tour, le même jour, à la
même
heure,
à la même minute, sans avoir connu le chagrin, ni les regrets ? — André,
mon cher André, c’est le ciel que tu me peins là. — Monsieur, le bonheur
est partout ; il est sur notre terre ; vous l’avez goûté un moment. Il a
fui ; cherchons-le, et vous le retrouverez. — L’espérance renaît dans mon
cœur. — Mais cherchons-le gaiement. L’œil qui se baigne dans les larmes,
passe à côté de lui, parce qu’il ne peut l’apercevoir. L’œil qui sourit voit
tout, saisit tout. La gaieté fixe l’espérance, et espérer, c’est déjà jouir.
»
André
s’était emparé de mon imagination. J’étais, avec Colombe, dans la planète
fortunée, où on n’existe que pour aimer ; nous augmentions le nombre de ses
heureux habitans ; nous partagions leurs plaisirs simples et touchans. «
Mais, André, pourquoi ces rides et ces guirlandes de fleurs ? je ne peux
m’accoutumer à l’idée de voir Colombe perdre sa fraîcheur et ses attraits.
Terminons le tableau séduisant que tu as offert à mon cœur. Je veux que dans
ta planète, on arrive à la fin de sa carrière, sans avoir connu aucun des
désagrémens de la vieillesse. — Oh, ma foi, Monsieur, c’est être trop exigeant.
Bientôt vous voudrez qu’on ne meure pas dans ce monde-là. — André, on doit
y être si bien ! » En raisonnant, ou plutôt en déraisonnant, nous entrâmes
à Saint-Junien.


Dames
du temps de Henri III
CHAPITRE
XII.
Antoine
de Mouchy retrouve Colombe et se désespère.
On sait
que le maréchal tenait beaucoup à tout ce qui annonçait sa grandeur.
Les casaques de ses domestiques, les couvertures de ses chevaux, celles de
ses fourgons offraient ses armoiries à l’admiration du public. Elles étincelaient
d’or sur la coche de madame. Elles avaient été assez maltraitées dans les
magasins de la Rochelle ; il les avait fait rétablir à neuf à
Bergerac. Les ouvriers cherchent toujours de l’ouvrage : ils avaient
placé l’écusson de monseigneur sur ma modeste voiture, dont on ne
leur avait point parlé. Cela m’avait été fort indifférent jusqu’alors ; mais
les choses les plus insignifiantes reçoivent quelquefois, des circonstances,
une valeur inattendue.
Le particulier
qui avait reçu madame la maréchale, reconnut ses armoiries. Il accourut nous
demander où en étaient les négociations de paix, et il finit par nous inviter
à descendre chez lui. Il avait vu Colombe; il lui avait probablement parlé;
sa proposition était la plus agréable qu’il pût me faire.
Il
nous fit servir un bon souper, dont je m’occupai peu ; mais il le partageait
avec nous, et je lui adressai, sur la disparition de Colombe, une foule de
questions, auxquelles il ne put répondre d’une manière satisfaisante. Il
avait trouvé Colombe charmante ; il avait cela de commun avec tous ceux
qui la voyaient. Son air annonçait la mélancolie ; il ne m’apprenait rien
de nouveau. Elle s’était enfuie à l’approche de la nuit ; madame la maréchale
avait ordonné à ses domestiques de la chercher dans la ville, et dans les
environs. Elle était allée, elle- même, chez le président, chez le curé ;
elle les avait priés instamment d’ordonner des recherches, et de faire conduire
la jeune femme à Biron, si on la retrouvait. Les domestiques n’étaient pas
amoureux. Il leur était fort égal que Colombe fût trouvée ou non, et il est
probable qu’ils passèrent la nuit à jouer à la prime au cabaret. En effet,
au point du jour, ils vinrent dire à Madame qu’ils n’avaient rien vu, et
ils ne purent répondre un mot aux questions que notre hôte leur adressa sur
les lieux qu’ils avaient parcourus. Madame voulut bien attribuer leur silence
à l’ignorance des localités, et elle partit.
Il résultait
de ce rapport que nous avions tout à faire. Je m’en félicitai, parce que
rien ne prouvait que Colombe fût sortie de la ville, et j’étais déterminé
à la chercher dans les recoins les plus cachés. « Monsieur, me dit André,
vous êtes amoureux, très- amoureux, c’est fort bien ; mais cela ne vous autorise
pas à faire des perquisitions chez les habitans, et à mettre leur ville en
combustion. De quel droit leur demanderez-vous l’ouverture de leurs maisons
? — Du droit de l’amour. — Du droit de l’amour, du droit de l’amour ! ce
droit-là parait le premier quand on n’a que vingt-un ans ; mais les bonnes
gens de Saint-Junien ne sont pas amoureux, et ils se moqueront de vous, s’ils
ne vous assomment pas.
«
Quand on veut juger sainement des choses, il faut se mettre à la place des
personnages qu’on a intérêt à pénétrer, et se demander ce qu’on ferait dans
telle ou telle position. Faites- vous Colombe, pour un moment. Iriez-vous
vous réfugier chez quelqu’un qui ne vous connaîtrait pas, et qui n’aurait
aucune raison de vous accorder un asile ? Qu’y feriez-vous, d’ailleurs, si
vous l’aviez obtenu ? rien que vous n’eussiez pu faire auprès de madame la
maréchale. Dans les actions les moins réfléchies, on a toujours un but.
Pénétrons celui qu’a pu se proposer Colombe. Je ne crois pas que cela
soit difficile. Dieu seul, a-t-elle dit, peut vous remplacer dans son cœur.
Cherchons-la dans les bras de Dieu. Où a-t-elle pu se vouer exclusivement
à lui ? dans un cloître. Les filles du Seigneur tiennent beaucoup à une dot
; elles tiennent aussi à une figure angélique, que fait valoir une belle
voix, surtout quand on sait la conduire comme madame de la Moucherie. — La
Moucherie ! ce sobriquet est de l’invention du maréchal, et je reprends mon
nom. — Ma foi, Monsieur, je ne vous en connais pas d’autre. — Tu m’appelleras
Mouchy : c’est le nom de mon père et celui de mon aïeul. — À la bonne heure.
« —
C’est donc sur les couvens de filles que nous dirigerons nos recherches.
— Oui, Monsieur. Nous les commencerons demain. Il est tard, et je vous demande
la permission de me coucher. Je vous invite à en faire autant, et à dormir,
si vous le pouvez. »
Dormir
! Le sommeil fuit les malheureux. Le lendemain, à la pointe du jour, j’étais
habillé, et il me semblait que tout le monde devait l’être comme moi. J’entrai
dans la chambre d’André ; je m’approchai de son lit. Il dormait profondément.
Ah, pensai-je, je n’ai pas besoin de lui dans une ville dont je
ferai
le tour dans un quart-d’heure. Qu’il repose, puisqu’il est assez heureux
pour le pouvoir faire.
Malgré
la justesse des observations qu’il m’avait adressées la veille, je résolus
de ne rien négliger. Quelques ouvriers commençaient à ouvrir leurs boutiques,
et je leur demandai la demeure du président. Je frappai, je sonnai à sa porte
de manière à réveiller des sourds. Une vieille servante, à demi-nue, mit
la tête à une lucarne, et me demanda, d’une voix glapissante, ce que je voulais.
« Je veux parler à Monsieur le Président. — Parler à un président à six heures
du matin ! êtes- vous fou ? — La justice doit toujours veiller. — Nous n’avons
pas besoin de vos sentences. Laissez-nous tranquilles. » Et elle referma
sa lucarne. Une idée heureuse se présenta. Je recommençai à frapper et à
sonner. La lucarne se rouvrit, et la vieille reparut, armée d’un vase dont
le contenu me menaçait. Je sautai de quatre pas en arrière, et je lui criai
que j’avais à parler à Monsieur de la part de madame la maréchale de Biron,
et que l’affaire était pressée. « De la part de cette illustre Dame, qui
est si belle et si bonne ? Oh, c’est autre chose. L’épouse d’un maréchal
de France, ministre plénipotentiaire du Roi ! Oui, je peux éveiller Monsieur.
« Il
ne se lève pas de bonne heure, sans avoir la migraine. Mais je lui ferai
de la camomille. — Finissez votre verbiage, et introduisez-moi. — Verbiage,
verbiage ! dit-elle, en m’ouvrant une salle basse. Il y a vingt-sept ans
que je sers Monsieur le président, et jamais il ne m’a fait le moindre reproche.
— Allez donc l’éveiller. — Je fais seule les affaires de sa maison, et jamais
il ne compte après moi. Les plaideurs recherchent ma protection, oui, Monsieur,
ma protection… hé, bien, où court donc cet étourdi ?... Monsieur !... Monsieur
!... »
J’avais
franchi les degrés en quatre sauts. J’ouvrais toutes les chambres, et j’appelais
le président de manière à le rendre sourd. J’aperçois un lit à quatre colonnes,
qui soutiennent une espèce de dais garni de serge feuille-morte. Les rideaux,
hermétiquement fermés, sont de la même étoffe. Je les tire, à droite à gauche
; les anneaux jouent sur les tringles de fer, et font un charivari, dont
j’aurais ri en toute autre circonstance. Je distingue enfin une masse informe,
à demi-ensevelie dans le duvet. Des bras épais et courts, une moustache qui
s’agite, des cris inarticulés me font connaître que ce paquet n’est autre
chose que le Président.
La
vieille arrive, hâletante, sa canne en béquille à la main.
« Marguerite,
allez me chercher les archers… non, appelez-les par la fenêtre… je ne veux
pas rester seul avec cet enragé-là. — Un moment, Monsieur. — Je le ferai
jeter dans un cul-de- basse-fosse, et je l’y tiendrai six mois. Oser réveiller
un président, qui digérait tranquillement son bouillon, et l’éveiller en
sursaut ! Appelez donc, Marguerite. — Un moment, vous dis-je. Monsieur est
l’homme de confiance de Madame la maréchale de Biron. — De Madame la maréchale
de Biron ! approchez un fauteuil à Monsieur. »
Après
quelques efforts infructueux, mon paquet de président parvient à se mettre
sur son séant. Marguerite s’empresse de lui garnir le dos d’oreillers, pour
le maintenir dans la position qu’il a prise. Il lève péniblement son bonnet
de velours noir, et il incline devant moi sa tête chauve, autant que le lui
permet un cou, gros et court.
Ce cérémonial
me désolait, m’exaspérait. « Colombe ! Colombe, répétai-je, sans interruption.
— De quelle Colombe me parle Monsieur l’agent de madame la maréchale,
me
répondit
enfin le président ? — De cette femme charmante, qui s’est perdue dans cette
ville, et que madame de Biron vous a prié de retrouver. — Ah, oui, oui, Monsieur…
je me rappelle… nos environs sont infestés de brigands. Tous mes archers
les poursuivent depuis long-temps ; mais dès qu’ils rentreront. — Hé, Monsieur,
ils sont ici depuis quatre jours. — Je vous dis, Marguerite, qu’ils ne sont
pas rentrés. — Je vous assure, Monsieur, qu’ils le sont. Vous le savez bien,
puisque vous m’ordonniez tout à l’heure de les appeler. — Marguerite, vous
prenez parfois des licences, qui me déplaisent fort, je vous le signifie.
Je suis votre maître, pour avoir toujours raison, entendez-vous
?
« Je
vois, monsieur, lui dis-je, que vous êtes de ces gens qui promettent tout,
et qui ne tiennent rien. Savez-vous que le chancelier de Birague est l’ami
intime de madame la maréchale, et qu’il a des moyens sûrs de donner de la
mémoire à un petit robin tel que vous ? — Monsieur. Je vous proteste… Je
vous jure… »
Je le
laissai finir sa phrase, et je descendis l’escalier, aussi promptement que
je l’avais monté. Je courus chez le curé. Je fus reçu par une gouvernante,
qui ne se servait pas de canne en béquille, et qui était loin d’avoir des
cheveux gris. Elle me reçut d’un air très-affable, et me présenta à son maître.
Je lui exposai le sujet de mon voyage, avec le moins de mots possible : je
n’avais pas de temps à perdre.
M. le
curé ne ressemblait en rien au président. Il avait la mémoire sûre, surtout
quand il pouvait rendre un service à une dame aussi pieuse que madame la
maréchale. Les mesures qu’il a adoptées n’ont jusqu’à présent produit
aucun résultat
heureux
; mais cela peut venir, me dit-il, d’un ton mielleux, très-propre sans doute
à persuader.
« Finissons,
je vous en prie, monsieur le curé. Quelles sont ces mesures que vous avez
prises, et dont vous attendez des effets satisfaisans ? — Monsieur, j’ai
publié à mon prône dimanche dernier, la jeune dame à laquelle vous vous intéressez
si fortement. — Vous l’avez publiée au prône ! c’est à peu près, comme si
vous aviez fait battre le tambour. Croyez-vous qu’une femme, qui se cache,
se trouve sur le pavé comme une vieille perruque, ou un mouchoir de
poche ? vous n’êtes pas plus officieux que votre président. » Et je
lui tournai le dos.
Je rencontrai
André, à qui je racontai ce que je venais de faire. Il me rit au nez. « La
plupart des hommes, me dit-il, flattent bassement les grands en leur présence.
Ils les oublient dès qu’ils sont sûrs de n’en rien obtenir. Que voulez-vous
que la maréchale puisse faire à Bergerac pour un président qui doit s’estimer
heureux de garder sa place, et pour un curé qui publie des filles au prône
? moi, Monsieur, j’ai été au fait. Il n’y a à Saint-Junien que deux communautés
de religieuses. L’une est habitée par des filles, qui se consacrent au service
des malades, et dont le premier devoir est d’être utiles aux malheureux.
La dévotion vient ensuite, et ce n’est pas dans de telles maisons que se
retirent celles qui se dévouent à une vie ascétique. Je n’ai pas pris la
peine d’entrer à l’hôpital.
« La
seconde maison est celle des Ursulines, et je n’y ai pas mis le pied. — Comment
donc avez-vous été au fait ? — Par mes reflexions, Monsieur, et je crois
que vous les trouverez très-sensées. Une femme, qui prend la fuite, ne reste
pas dans une petite ville, où elle sait qu’on la cherchera.
«
Il est vraisemblable que madame de Mouchy aura marché pendant toute la nuit
de son évasion, et qu’elle sera arrivée avec le jour à Limoges : cette ville
est à peu de distance de celle- ci. Là, elle aura trouvé, pour se cacher,
des ressources que ne lui oftrait pas Saint-Junien. D’ailleurs, elle n’avait
pas d’argent ; elle n’aura pu aller plus loin.
« Nous
avons fait hier une marche à crever nos trois bêtes. Elles ont besoin de
repos. Notre hôte est obligeant et bon. Laissons-les-lui, et allons à pied
à Limoges. — Voilà une excellente idée. — Ou je me trompe fort, ou cette
ville sera le terme de notre voyage et de nos recherches. — Que mon patron
t’entende, et nous exauce. Partons, André. »
Je n’avais
pas dormi, et cependant je me sentais une vigueur extraordinaire. Les secousses
de l’âme agissent directement sur le corps. La mienne me poussait à Limoges,
et je brûlais le chemin. Quelquefois André me demandait grâce. Je ne l’écoutais
pas, et il recommençait à trotter.
Je ne
pensais qu’à Colombe ; je ne voyais, je ne rêvais qu’elle, et André fit de
vains efforts pour engager une conversation propre à me distraire, et à ralentir
ma marche.
Nous
entrâmes à Limoges. Nous ne fûmes pas une heure à obtenir des renseignemens
positifs. On ne parlait dans toute la ville que d’une jeune fille, jolie,
pieuse, éloquente comme sainte Thérèse, dont la voix pure, douce, harmonieuse,
donnait une idée des concerts des anges. « Et où est-elle ? — Chez les filles
de Saint-Augustin. — Courons-y, André. — Vous y jouirez, Messieurs, d’un
plaisir ineffable. Elle doit chanter à deux heures. Toute la ville y sera.
»
Nous
volons, nous arrivons. J’interroge la tourière ; je lui dépeins Colombe.
C’est elle, c’est bien celle que je cherche avec tant d’ardeur et de persévérance.
« Que je la voie, ma sœur, que je lui parle à l’instant même : il le faut
absolument.
-
La sœur Sainte-Colombe ne peut
voir personne sans l’agrément de madame la supérieure. — Courez le lui
demander, répondis-je, en mettant une pièce d’or dans la main de la tourière.
Dites-lui que c’est l’époux le plus tendre, le plus passionné qui brûle
de la revoir. — Depuis hier, Monsieur, elle n’a d’époux que saint Augustin.
— Elle a prononcé des vœux ! Ils sont nuls, de toute nullité. Je les romprai
; je les anéantirai. » André me prit à travers le corps, et m’emporta dans
la rue.
«
Prenez garde à ce que vous allez faire, Monsieur ; ceci n’est pas un jeu
d’enfant. Vous êtes dans une position cruelle, j’en conviens ; mais elle
a est assez critique pour que vous réfléchissiez avant que d’agir. — Ce n’est
pas elle, André, ce n’est pas elle. Il y a tout au plus quinze jours qu’elle
a quitté la maréchale, et les lois prescrivent un noviciat de six mois. —
Hé bien, Monsieur, si ce n’est pas elle, nous chercherons ailleurs. Mais
attendez jusqu’à deux heures. — Attendre ! Je ne le puis !
-
La jeune épouse de saint Augustin doit chanter
; les rideaux de la grille, qui donnent sur l’église, seront ouverts, et
nos doutes se dissiperont. » Je veux la revoir à l’instant, à l’instant même.
La tourière s’est trompée ; elle a confondu les personnes et les choses.
Ce n’est pas Colombe qui a prononcé hier ses vœux ; cela ne se peut pas.
Je veux la revoir, te dis-je, et ne veux plus t’entendre. » Un effort violent
me dégagea des bras d’André. Il courut après moi, me saisit de nouveau, avec
une force que je ne lui connaissais pas, et me porta à l’autre
extrémité
de la ville. Je criai, je m’emportai, je menaçai ; il fut sourd.
Cette
scène extraordinaire assemblait, autour de nous, une foule, qui augmentait
à chaque instant. « C’est un fils de famille, disait André, qui a perdu la
raison, et que je conduisais à la maison des aliénés de Montmorillon. Il
m’a échappé à Saint-Junien. — Non, je ne suis pas insensé. Je veux ma femme,
qu’on retient, contre toutes les lois, dans le couvent des filles de saint
Augustin. J’en briserai les grilles, et je l’enlèverai. — Vous voyez bien,
Mes» sieurs, qu’il extravague. De grâce, prêtez-moi main forte ; je ne peux
le retenir plus long-temps. »
Quatre
hommes me saisirent et me mirent dans l’impossibilité de faire un mouvement.
La colère m’égarait; ma bouche se couvrait d’écume ; des mots entrecoupés
m’échappaient, et donnaient à la fable d’André une apparence de vérité. «
Il est furieux, disaient les uns. Il faut s’assurer de lui, » disaient les
autres. Fort heureusement, Messieurs, répondait André, ces crises violentes
sont rares, et durent peu. Dans quelques heures il sera calmé, et il me suivra
avec docilité. » On me porta à l’hôpital de Limoges.
« Quel
dommage, dirent les bonnes sœurs ! Si jeune, avec une figure si intéressante,
être frappé de cette cruelle maladie ! Quel malheur ! » Mes porteurs me déposèrent
sur une table. Je m’élançai à terre ; je me précipitai vers la porte ;
elle était fermée à clef. Je la frappai de mes pieds et de mes mains. On
se saisit de moi encore. André dénoua, dans un tour de main, les cordons
blancs qui tombaient devant les robes de cinq à six sœurs ; il prit, dans
le premier lit, un matelas, le jeta sur la table,
et
on m’y attacha de manière à ce que je ne pusse penser à m’échapper. André
disparut.
Je sentis
que je n’avais rien à attendre que de la persuasion. Je m’efforçai de rappeler,
sur ma figure, le calme que rien ne pouvait ramener dans mon cœur. Je tâchai
de ressembler à un homme qui sort d’un songe pénible. Je donnai à mes yeux
et à ma voix l’expression de la douceur. Les bonnes filles ne perdaient rien
de ce que je leur disais. Elles observaient avec satisfaction le changement
qui s’opérait en moi. « Voilà la crise terminée, se dirent-elles. — Oui,
mes sœurs, et elle ne se renouvellera pas de plusieurs semaines. Infortuné
que je suis ! il faut que je perde ma liberté, et que, pendant de longs jours
lucides, je sente l’excès de mon malheur ! » Les femmes sont nées pour aimer
; elles s’attendrissent aisément. Des larmes roulèrent dans les yeux des
bonnes sœurs. Je me plaignis de la douleur que leurs cordons me causaient
aux poignets et aux jambes : en effet, les ligatures étaient serrées de manière
à me faire souffrir. Elles parlèrent de me délier.
« Ayez
pitié de moi, leur dis-je. — Mais serez-vous tranquille ? — Je vous le
promets. — Resterez-vous avec nous, jusqu’à ce que votre gardien vienne vous
reprendre ? — Ah, c’est mon meilleur, ou plutôt c’est mon unique ami ! —
Pauvre jeune homme ! » Les cordons furent détachés, et rendus à leur première
destination.
Je me
promenai dans une vaste salle, avec une tranquillité qui eût trompé des femmes
plus clairvoyantes que mes bonnes sœurs. Cependant une d’elles me précédait,
une autre me suivait ; une troisième marchait à ma droite ; une quatrième
à ma gauche. Pauvres filles, que pouvaient-elles contre moi ? Je leur souriais,
et cela paraissait leur faire plaisir. Je leur contais
que
j’étais le petit-fils du fameux Antoine de Mouchy. « Ah, me dirent-elles,
le descendant de ce grand homme est incapable de manquer à sa parole. »
Bientôt
elles me serrèrent de moins près. L’une d’elles se détacha, et fut me chercher
de quoi déjeuner. La digne fille m’apporta ce qu’il y avait de mieux dans
la maison. Je n’avais rien pris encore, et je sentis, à l’aspect des alimens,
que l’amour peut n’être que le second de nos besoins.
Les
bonnes sœurs me choisissaient les morceaux les plus délicats. Elles me versaient
un vin pur et bienfaisant. Elles prenaient un plaisir extrême à me voir fêter
l’offrande de la charité chrétienne.
À mesure
que je réparais mes forces, épuisées par une mauvaise nuit, et les scènes
violentes de la matinée, l’image de Colombe se présentait à moi, avec un
empire toujours croissant. Je me levai ; je recommençai mes promenades par
la salle, et j’examinai les localités. J’étais au premier étage, et les croisées
donnaient sur une cour, au bout de laquelle était la grande porte d’entrée.
Elle était ouverte, comme celles de tous les hôpitaux. Je trouvai, sous ma
main, la vie de sainte Cécile ; je la pris, et je feignis de lire.
Ma conduite
avait dissipé les soupçons. Les sœurs reprenaient leurs fonctions, et ne
me donnaient plus qu’une attention légère. La salle avait deux portes, à
chacune desquelles l’une d’elles s’était assise, et travaillait de l’aiguille.
Je m’élance, j’ouvre la croisée, et je saute dans la cour, au risque de me
tuer. Je me relève, un peu étourdi de ma chute, et des cris partent de la
salle que je viens de quitter. Un vieux portier se présente, et croit me
barrer
le chemin. Je suis forcé de renverser le bon homme et de lui passer sur le
corps.
Je cours,
je vole à l’église des Augustines. Elle chante. Je reconnais sa voix, et
je ne suis pas encore dans le temple saint. J’écarte, à droite et à gauche,
tout ce qui s’oppose à mon passage ; je fends la presse. Me voilà contre
cette grille, qui est, pour moi, une barrière insurmontable. Mes mains ne
peuvent l’ébranler. Je vois ma Colombe, je la vois, je la regarde. Il me
semble que la guimpe et le voile l’embellissent encore.
« Colombe,
Colombe, m’écrié-je ! » Elle lève les yeux sur moi ; elle me reconnaît ;
elle s’évanouit. Les chants cessent ; le grand rideau se tire ; tout disparait
avec elle ; je suis dans un désert.
La foule
crie au scandale, à l’impiété, au sacrilège. Des forcenés se jettent sur
moi, et vont me mettre en pièces.
« Arrêtez,
s’écrient deux ou trois individus. Ce jeune homme est l’insensé que nous
avons porté, ce matin, à l’hôpital. » On me chasse du lieu saint ; on me
pousse dans la rue ; je tombe dans les bras d’André.
« J’aimerais
autant, me dit-il, avoir affaire au diable qu’à vous. Il faut que je vous
aime bien pour continuer à vous servir ! Ne rougissez-vous pas de vous
porter à de tels excès ? C’est avec du sang-froid, de la réflexion, qu’on
parvient quelquefois à arranger une affaire délicate, et vous ne faites que
des extravagances. Vous vous conduisez comme si vous vouliez perdre Colombe
sans retour. — André, que faut-il faire ? — M’écouter, et vous laisser conduire.
« Pendant
que je vous croyais en sureté à l’hôpital, je n’ai cessé d’agir. Je suis
parvenu à voir la supérieure des Augustines. Voici, en peu de mots, ce qui
s’est passé dans le
couvent,
depuis dix à douze jours… Que diable regardez-vous toujours de ce côté ?
Vos traits se décomposent, votre poitrine se gonfle, vos poings se serrent.
Prétendez-vous escalader le couvent ? Rien n’est désespéré encore ; mais
je vous déclare qu’à la première imprudence que vous vous permettrez, je
vous abandonne sans retour.
« André,
mon cher André, rien n’est désespéré, dis-tu ! Je me livre entièrement à
toi. Mais parle ; tire-moi de l’état affreux où tu me vois. » Nous sommes
ici en spectacle, et, en dépit de ce que je pourrais dire, ces gens-là vous
remettraient, peut-être, dans la maison d’où vous vous êtes échappé. Marchez
en homme raisonnable, et suivez-moi. »
On nous
regardait aller, et on paraissait, à la fois, étonné et satisfait de ma docilité.
André me conduisit en un endroit écarté des remparts. Il me força à m’asseoir
sur l’herbe. Cette position ne convient pas à un homme passionné ; mais celui
qu’on contraint à la prendre se calme insensiblement.
André
s’assit près de moi. Il appuya fortement ses mains sur mes cuisses, et il
commença son récit.

Colombine
(croquis anonyme du XIXe siècle)

La
Colombine de la Commedia dell’arte
CHAPITRE
XIII
Suite
de la rencontre de Colombe
Colombe
arriva ici à la pointe du jour qui suivit son évasion de Saint-Junien. Elle
se présenta à la porte du couvent des Augustines, et demanda à parler à la
supérieure. Elle lui déclara qu’elle était veuve d’un époux quelle adorait
; que Dieu seul pouvait le remplacer dans son cœur ; qu’elle voulait se consacrer
à lui ; mais qu’elle ne pouvait donner de dot. Elle ajouta qu’elle entendait
très-bien tous les ouvrages de femmes, et qu’elle chantait passablement.
La supérieure la fit entrer dans l’intérieur du couvent, et mit aussitôt
ses talens à l’épreuve.
« Au
fait, André, au fait par grâce. — Hé, j’y arrive, Monsieur. »
La bonne
dame fut enchantée de sa voix, et lui proposa de prendre l’habit de novice.
C’était l’objet de ses vœux les plus chers. On monta, on apprit des morceaux
d’ensemble, où on lui ménagea des solos brillans. On les essaya devant
une nombreuse assemblée, et l’effet en fut étonnant.
La
supérieure lui représenta que, pendant un noviciat de six mois, ses dispositions
pourraient changer ; qu’une néophyte, qu’on reçoit sans dot, ne peut manger
gratuitement le pain de saint Augustin, et aller ensuite en demander ailleurs.
Elle lui proposa de prononcer ses vœux. Colombe regarda cette proposition
comme une faveur insigne. On demanda des dispenses à l’évêque, qui les accorda,
et le serment de renoncer au monde fut reçu, avant-hier, par ce prélat.
« André,
mon cher André, ses vœux sont nuls, puisque je vis, et qu’elle s’était donné
à moi au pied des autels. — C’est une observation que j’ai fait faire à la
supérieure. — Hé, qu’a-t-elle répondu ? — Que cette affaire n’était pas de
son ressort, et qu’elle regardait uniquement monseigneur. » — Courons à l’évêché.
— Un moment donc, Monsieur. J’ai été lui demander une audience, et elle m’est
accordée pour quatre heures. — Quelle heure est-il ? — Je ne le sais pas
précisément. — Tu ne le sais pas, et tu es d’une tranquillité qui me tue
! Si le moment passe, quand le retrouverons-nous ? — Comment, nous ?— Oui,
oui, je t’accompagnerai. Il est tout simple qu’un mari qui réclame sa femme,
porte la parole. — Et pour peu que vous éprouviez quelque difficulté, votre
tête se montera ; vous ferez de nouvelles extravagances, et vous détruirez
tout l’effet de mes soins. Quatre heures sonnèrent à l’horloge de la cathédrale.
Je fis
un effort violent ; je me dégageai des mains d’André ; je pris ma course
; il courut sur mes pas. « Au nom de Dieu, arrêtez-vous. — Je veux entrer
à l’évéché avec toi. — Hé bien, j’y consens. Mais tâchez de vous posséder.
— Tu vois que je me possède. » Je sentais, en effet, la nécessité de paraître
maître de moi.
Monseigneur
nous attendait, assis dans son grand fauteuil. Il nous donna sa bénédiction.
Ah ! pensais-je, c’est un saint homme ; il me rendra ma femme. Cette idée
me calma autant qu’il le fallait pour que je parusse tranquille. Le prélat
nous demanda ce que nous voulions.
André
lui expliqua notre affaire clairement, et en peu de mots. Il dit que l’amour
malheureux avait altéré mes facultés intellectuelles, et que le seul moyen
de les rétablir était de me remettre dans les bras de mon épouse. Il craignait,
avec raison, quelque trait d’exaspération de ma part, et la démence fait
tout excuser.
Je pris
la parole à mon tour. Je représentai humblement à monseigneur que Colombe
n’avait fait qu’un noviciat de huit jours, et que les lois du royaume en
fixent la durée à six mois.
« Vous
devez savoir, me répondit le révérendissime, que le saint Père est au-dessus
des rois, et par conséquent, des ordonnances qui émanent d’eux. Or, je représente
Sa Sainteté dans mon diocèse, et j’ai pu donner, à la supérieure des Augustines,
la dispense qu’elle m’a demandée. Je n’avais pas à répondre à un argument
de cette force-là. Mais je crus avoir trouvé le moyen de le tourner en ma
faveur.
« Sans
doute, notre saint Père a le droit de lier et de délier, et monseigneur,
qui le représente, peut révoquer les vœux qu’il a reçus. —Je m’en garderai
bien. Rendre au monde une jeune religieuse, dont la figure et le chant angéliques
font tous les jours des conversions ! Réfléchissez, jeune homme, et vous
sentirez que cela n’est pas possible. Ici, mon sang commença à s’allumer
de nouveau.
«
La sœur Sainte-Colombe, poursuivit le prélat, a suivi l’exemple d’Héloïse.
Prenez Abailard pour modèle ; choisissez un couvent d’hommes, et je vous
accorderai les dispenses qui ont facilité l’entrée en religion de celle que
vous réclamez. » La proposition de l’évêque me parut être une plaisanterie
du plus mauvais goût. Je n’avais rien de commun avec Abailard, et j’espérais
bien ne lui ressembler jamais. Je me contins encore, et j’essayai la force
d’un raisonnement qui me paraissait sans réplique.
« Un
engagement antérieur, sacré, irrévocable, dis-je au révérendissime, rompt
nécessairement tout acte postérieur, qui est en opposition avec le premier.
Colombe est mon épouse. Je tirai, de mon escarcelle, mon acte de mariage.
« Un
mariage fait à Benon, dit-il avec dédain, à deux lieues de la Rochelle, centre
des plus abominables erreurs ! Ne sentez- vous pas, jeune homme, que le prêtre
qui a cru vous bénir, respirait les miasmes de l’hérésie, en était infecté,
les rendait par tous ses pores ? d’ailleurs, je ne connais pas de mariage,
sans publication de bans à l’Eglise. »
J’étais
déjà furieux. L’évêque allait déchirer mon acte. Je m’élançai sur lui.
André me fit faire une volte, et m’envoya à l’extrémité de la salle. Mon
acte était en morceaux.
Je m’emportai,
je menaçai, je jurai, je crois, pour la première fois de ma vie. Que mon
patron me le pardonne. André me tenait ; lévêque sonnait à rompre tous les
cordons ; sept à huit jeunes clercs accoururent, et s’emparèrent de moi.
« Comment,
dit l’évéque à André, avez-vous osé m’amener ce furieux ? — Monseigneur,
j’ai fait de vains efforts pour
l’arrêter.
— Qui êtes-vous ? d’où venez-vous ? — Ce jeune homme est le petit-fils du
grand Antoine de Mouchy. — En vérité ? — Oui, monseigneur. L’amour malheureux
a altéré sa raison, ainsi que j’ai eu l’honneur de vous le dire, et je le
conduisais à l’hospice de Montmorillon. Nous sommes arrivés hier à Saint-Junien.
Il était tranquille, et je lui faisais prendre l’air aux environs de la ville.
Tout à coup, une crise violente se déclare ; il fuit à travers les champs
; je ne veux pas le perdre de vue ; il m’est par conséquent impossible de
retourner prendre sa voiture et ses mules. Je suis contraint de le suivre,
et il ne s’arrête qu’à Limoges. Votre grandeur sait le reste. — Je vous donnerai
une voiture, et des hommes sûrs, qui vous conduiront jusqu’à Saint-Junien
; mais je vous déclare que si vous reparaissez à Limoges, je vous fais jeter
dans les prisons de l’officialité. »
Un quart
d’heure après, des archers parurent, et me mirent les fers aux pieds et aux
mains. André soutenait son rôle, en leur aidant avec un zèle apparent. Il
me fallut subir cette humiliation. Bientôt on me porta dans une charrette
couverte, et nous prîmes la route de Saint-Junien. Un accablement profond
succéda aux transports violens, qui m’avaient agité, pendant presque toute
cette funeste journée. Il n’est pas dans les forces humaines de les supporter
plus long-temps. Il faut qu’ils cessent, ou que le malheureux, qui en est
attaqué, perde la vie. Je devais vivre encore.
Nous
arrivâmes à Saint-Junien, et André fit arrêter la charrette à la porte de
la ville. « Je réponds de lui maintenant, dit-il à mes gardes. » Il leur
donna quelques écus ; ils m’ôtèrent mes fers, et reprirent le chemin de Limoges.
André me prit sous les bras : je
ne
pouvais me soutenir. Nous entrâmes chez notre hôte. Il était nuit.
Mon
excellent, mon fidèle André, mon unique ami, me fit coucher. Il m’apporta
un potage succulent. Bientôt j’oubliai mes maux dans les bras du sommeil.
André approcha un fauteuil de mon lit, et me veilla jusqu’au jour.
Mon
réveil me rendit au souvenir de mes peines ; mais j’étais d’une faiblesse
extrême, et je ne pouvais faire un mouvement. André, tranquille, parce qu’il
était maître de moi, essaya de ramener l’espérance dans mon cœur.
Il me
parla d’abord du danger imminent, où je m’étais exposé à Limoges. Troubler
l’office divin ; essayer d’arracher la grille du chœur d’un couvent de filles
; saisir un évêque au corps, dans son propre palais, étaient des crimes,
contre lesquels, disait-il, les lois divines et humaines se seraient infailliblement
soulevées, s’il n’eût eu l’heureuse idée de me faire passer pour fou. Je
sentis que son intelligence et son affection m’avaient seules soustrait à
une mort infamante.
« Colombe,
Colombe, dis-je d’une voix presqu’éteinte, est restée à Limoges ! elle
m’a reconnu ; elle s’est évanouie ; peut- être à présent a-t-elle cessé de
vivre. — Monsieur, une femme aimante soupire, pleure, et ne meurt pas. —
Hé, pourquoi vivre l’un et l’autre, si nous sommes séparés sans retour !
« —
Sans retour ? Pourquoi cela, Monsieur ? La paix se fera à Bergerac, parce
que la cour a besoin des princes calvinistes. Ce qui leur paraissait devoir
la rendre solide, il y a quelques jours, est précisément ce qui en abrégera
la durée. Le duc de Guise est intéressé à fomenter des troubles, à la faveur
desquels il espère
percer
jusqu’au trône. Il est vraisemblable qu’il aura enjoint au comte de Montpensier
d’accorder aux réformés des conditions telles, qu’il puisse, à son gré, soulever
les catholiques contr’eux. — Hé, que m’importe la paix ou la guerre ! —
Vous ne le voyez pas ? Vous avez conservé votre brevet de capitaine. Vous
demandez, vous obtenez une compagnie. Vous entrez dans le Limousin ; vous
vous joignez aux ligueurs que vous rencontrez sur votre route. Vous leur
soufflez l’ardeur du pillage, ce qui est très-facile ; vous en savez quelque
chose. Vous leur vantez les richesses que renferme Limoges ; vous déterminez
le général à y entrer en ami, ou en ennemi. Pendant qu’on pille la ville,
vous forcez le couvent des Augustines avec votre compagnie…. — Je délivre,
j’enlève ma Colombe. — C’est bien cela. — Mais voudra-t-elle me suivre ?
— Oui, parce que son cœur est à vous. — Mais mon acte de mariage est déchiré.
— Elle sait qu’il a existé. — L’évêque, la supérieure lui auront représenté
que son premier engagement était nul, parce qu’il n’a pas été précédé des
formalités voulues par l’Eglise. — Vous lui demanderez pourquoi un évêque
instruit déchire un acte qu’il croit être sans valeur. — Effectivement, André,…
je conçois… Oui tout cela peut se réaliser. — Et se réalisera.
Il ne
faut qu’un rien pour briser un cœur sensible ; un rien y rétablit l’espoir
et la paix. Je recommençai à vivre dans l’avenir.
Un sentiment,
long-temps concentré, se ranime facilement, et il y a de l’adresse à l’opposer
à celui qui paraît être le grand dominateur. Il faut, nécessairement, que
le premier modère le second.
« Monsieur,
me dit André, vous avez fait part à votre mère de la mort de son époux. Mais
depuis cette époque, vous êtes-vous
occupé
un moment de celle à qui vous devez la vie ; qui vous a élevé avec la plus
vive tendresse, qui vous a inspiré ces sentimens de piété, qui peuvent adoucir
vos chagrins, et vous faire attendre une meilleure vie, s’ils doivent durer
autant que vous ? Un amour forcené vous a fait oublier la nature, et ces
sentimens doux, qui ne causent jamais d’inquiétude, et qui jamais ne laissent
de regrets. Peut-être votre tendre mère, infirme, malade, prête à expirer,
vous appelle en ce moment. Peut-être-vous croit-elle mort dans les sentimens
qu’elle vous a inspirés, et vous prie-t-elle de la recommander aux puissances
célestes… Vous vous attendrissez, Monsieur ; vos yeux se remplissent de larmes…
Il est vrai que je viens de prêcher comme un missionnaire, et, en vérité,
je ne m’en croyais pas capable.
« —
André, mon cher André, un homme tel que toi n’est pas fait pour me servir.
Sois mon ami, et le confident désintéressé de mes peines et de mes plaisirs.
Mettons en commun ma petite fortune, et ce que j’ai à réclamer de la succession
de mon père… — Ainsi, Monsieur, nous partirons pour Étampes, quand vos forces
seront rétablies. — Jevoudrais, André, qu’elles le fussent déjà. Que de
torts j’ai à réparer ! — Une mère est toujours disposée à les oublier. —
Je tomberai aux pieds de la mienne. — Elle vous pressera sur son sein. —
Je mouillerai ses joues de mes larmes. — Elle y mêlera les siennes. — Je
lui prodiguerai mes soins. — Avec quelle satisfaction elle les recevra !
— Nous achèterons ensuite ce petit bien, unique objet de mon ambition. —
Et nous y philosopherons, jusqu’à ce que la guerre civile se rallume de nouveau.
« André,
je me sens en état de partir. — Monsieur, je vous demande deux jours. — Je
veux partir, te dis-je. — Monsieur,
on
ne dit pas je veux à son ami. — Tu as raison, André. Allons, je t’accorde
deux jours.
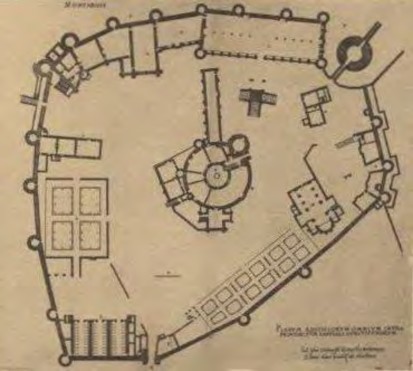

Château
de Montargis
CHAPITRE
XIV.
Départ
pour Étampes.
André
fait une rencontre imprévue.
Nous
apprîmes à Argenton que la paix était signée à Bergerac, et ratifiée à Poitiers,
par le roi. Les huguenots de Châteauroux nous firent connaître les conditions
du traité. Il confirmait les avantages qu’ils avaient obtenus par la paix
de Sens. Il leur assurait la possession de toutes leurs places de sûreté
: c’était laisser exister un état indépendant dans l’État. Les chambres des
parlemens devaient être composées, indistinctement, de catholiques et de
réformés : c’était un moyen certain d’irriter les catholiques de toutes les
classes. Un article important de ce traité portait la suppression des processions
instituées pour célébrer l’assassinat du prince de Condé à Jarnac, et le
massacre de la Saint-Barthelemy.
Une
Religion simple ne suffit pas au peuple, disait André. Il faut des cérémonies
qui parlent aux yeux. Les moines souffleront le fanatisme, et la cour sera
obligée de purger les parlemens, et de rétablir les processions. Si elle
résiste, la ligue reprendra les armes ; si elle cède, les protestans recommen-
ceront
la guerre ; ainsi, de quelque manière que tournent les choses, une rupture
prochaine est inévitable.
André
avait soin de varier la conversation. La variété éloigne l’ennui, et souvent
les réflexions tristes. Il savait être intéressant, quelque sujet qu’il traitât.
Le hasard m’avait présenté un valet ; ma bonne fortune m’avait donné un ami.
Nous
avancions vers Étampes, parlant de tout, et n’approfondissant rien. Certains
cabaretiers commençaient à établir des lits à l’usage des voyageurs. On ne
trouvait encore chez eux que du pain et du vin ; mais les marchés se rouvraient
à la faveur de la paix. Chacun allait y acheter ce qui lui convenait, et
revenait faire cuire ses provisions au cabaret. Cela était, ordinairement,
assez mal apprêté ; mais au moins, on était sûr de ne pas mourir de faim,
et de ne pas coucher dans les champs.
Nous
venions d’entrer à Montargis : André alla faire son tour de marché, et revint
bientôt avec des légumes et une oie grasse.
« Allons,
allons. Monsieur, de la gaieté, voilà de quoi faire bonne chère, si j’ai
autant de talent en cuisine aujourd’hui, que j’en ai marqué peu jusqu’à présent.
Je vais vous faire un potage, dans lequel la cuiller tiendra debout. Je ferai
rôtir notre oie. Nous en mangerons une moitié à notre dîner, je mettrai l’autre
dans notre voiture, et demain nous la croquerons, en cheminant et en jasant.
»
Il trouve
un chauderon sous sa main, et de l’eau au puits ; voilà de quoi faire la
soupe. Une poignée de sel et un peu de la graisse de notre oie la rendront
excellente. Il métamorphose un bâton en broche, et notre cuisine est montée.
En
allant, en venant, en faisant ses dispositions, il me contait des historiettes,
plus ou moins plaisantes. L’hôte, l’hôtesse, leurs enfans écoutaient, la
bouche et les yeux ouverts, autant que la nature les leur avait fendus.
« Ah ! monsieur André, s’écria enfin maître Jacques, vous êtes fin cuisinier,
et grand conteur. Si vous vouliez passer du service de M. le capitaine au
mien, vous feriez la fortune du Sabot royal, et je vous donnerais
moitié dans les bénéfices. André lui répondit par un apologue, fort bien
trouvé, qui prouvait que celui qui s’associe à plus fin que lui est un sol.
Maître
Jacques répliqua par une profonde révérence, et les contes recommencèrent.
« Parbleu, Messieurs, nous dit-il, pendant que nous dînions, vous devriez
aller à la comédie. — On joue la comédie à Montargis ! — Certainement, Monsieur.
— Où
cela ? — En plein vent. Il y a là un gilles, qui est bête à faire plaisir
; un scaramouche qui est un fin matois, et une colombine ! ah quelle colombine
! elle est blanche comme du lait, grosse comme une tour, et elle danse la
sabotière avec la légèreté d’un oiseau. Elle a tout plein de mots, à double
entente, qui nous font rire, mais rire !... Allez la voir, Messieurs. Vous
en serez si contens que vous ne pourrez vous dispenser d’acheter une fiole
de son baume.
« —
Hé bien, Monsieur, avez-vous un peu dîné ? — Très- bien, mon ami André. —
C’est un grand cuisinier qu’un bon appétit, car, en vérité, je vous ai fait
faire maigre chère ? Voulez-vous, à présent, que nous allions voir danser
la sabotière à Colombine ? — Je le veux bien, mon ami André. »
Sur
la grande place de Montargis était élevé un théâtre, qu’on apercevait à soixante
pas de distance. Huit futailles vides soutenaient les deux plus grandes tables
du cabaret voisin. Des
cordes,
tendues sur des pièces de bois fixées en terre, soutenaient des décorations
que le soleil, le vent et la pluie avaient rendues à peu près méconnaissables.
André, grand connaisseur, prétendit qu’elles avaient représenté une forêt.
Il me jura qu’il distinguait parfaitement la queue d’un tigre, dont le corps
avait disparu. « Ainsi, Monsieur, me dit-il, la scène est à la fois en Afrique,
et sur la place de Montargis. L’avant-scène était garnie de petites bouteilles,
très-artistemenl rangées dans des hottes. Un caustique de la ville, il y
en a partout, disait à la race moutonnière qui l’entourait, que les médecins
permettaient le débit des drogues malfaisantes, pour multiplier les maladies,
et avoir ensuite l’honneur et le bénéfice de les guérir. Mais les guériront-ils,
lui demanda André. — Ma foi, Monsieur, d’un empirique breveté à un empirique
qui ne l’est pas, la différence est de bien peu de chose, et quand un malade
meurt dans les règles, on l’enterre également, et il n’en est plus question.
Ses héritiers rient ou pleurent, et ne réclament jamais. »
Le spectacle
commença. Scaramouche vint faire un discours qui n’avait pas le sens commun.
Gille vint dire des balourdises. Colombine accourut, et lui appliqua cinq
à six soufflets, avec une grâce toute particulière. Elle prit ensuite la
parole, et parla… Elle parla de manière à persuader tous les habitans de
Montargis de se purger, le soir même, avec son baume.
André
murmura d’abord, entre ses dents. « Monsieur, me dit- il bientôt, je ne suis
pas à mon aise ici ; allons nous-en. — Et la sabotière, mon ami ? — Oh, ma
foi, Monsieur, voyez la danser, si cela vous convient. Moi, je retourne chez
maître Jacques.
Déjà
Scaramouche avait crié trois fois, silence, d’une voix de stentor ; déjà
Colombin s’était arrêtée au milieu de sa péroraison. André s’éloignait, ainsi
qu’il me l’avait dit.
Tout
à coup, Colombine s’élance ; elle renverse, en sautant, la table qui soutient
sa fortune ; pas une fiole n’est entière. Le précieux médicament sillonne
les figures de ceux que l’amour des arts a poussés jusqu’au bord du théâtre
; ils font une grimace à faire reculer le duc de Guise. Gille et Scaramouche
s’arrachent les cheveux. Colombine fend la presse, et saisit André par son
manteau. « Je te le laisse, madame Putiphar, lui dit-il ; fais-en un haut-
de-chausses à ton Scaramouche, et il court comme s’il avait cinquante huguenots
derrière lui. Je commençais à prévoir une reconnaissance théâtrale, et je
courus à mon tour, pour ne pas manquer le dénouement.
André
était l’entré chez maître Jacques, et Colombine le suivait de près. Il traverse
la maison ; entre à l’écurie ; se tapit sous nos mulets, et attend, pelotonné
dans lalitière, ce qu’il plaira au destin d’ordonner de lui. Colombine ne
le quitte pas ; c’est la Vénus moderne acharnée sur sa proie.
« Mon
cher André, mon cher petit mari, peux-tu méconnaître, repousser ta Villelmine
! — Ma Villelmine ! elle est belle à présent. — Belle ou non, je suis ta
femme. — Et celle de qui, depuis la journée de la Saint-Barthélémy ? — Ah,
mon ami, c’est une terrible chose que l’indigence ! — Et tu disais tout à
l’heure que tu ne vends des drogues que par amour de l’humanité. — Ce sont
des contes, qui ont la propriété de faire des dupes. »
Ils
s’étaient relevés, et ils continuèrent leur conversation conjugale dans une
position un peu plus commode.
« Te
voilà mis comme un prince, donc tu es riche. Souffriras- tu que ta femme
soit comédienne de plein vent ?— Qu’elle soit ce qu’elle pourra. — Cette
Villelmine, qui a partagé ta couche !
-
Elle n’y rentrera, sacrebleu, pas. — Mon
petit André ! mon cher André ! — Ma grosse dondon, va-t-en à tous les diables.
-
C’est ton dernier mot ? — Absolument. »
Quelques
apostrophes, plus ou moins énergiques, se firent entendre, pendant qu’André,
pressé de quitter cette ville de malheur, mettait nos mules à la voiture.
« Ah ! tu veux l’éloigner de moi, m’abandonner, quand il ne me reste pas
une goutte de mon baume ! coquin, scélérat, monstre ! je vais t’arracher
les yeux. » D’un tour de main, André l’envoie au fond de l’écurie. « Frapper
une femme, et la sienne encore ! Au secours, au voleur, à l’assassin ! »
Les
spectateurs étaient déjà nombreux. Les cris de Villelmine attirèrent la foule.
Cette scène me déplaisait fort. Cependant je restai impassible, persuadé
que les querelles de ménage ne regardent pas le public. Les deux archers,
spécialement chargés de protéger le spectacle, intervinrent dans cette affaire.
Elle commençait à s’embrouiller, et je ne jugeai pas à propos de la compliquer
davantage, en coupant la figure à ces deux drôles- là.
Ils
notifièrent à André qu’il fallait qu’il les accompagnât chez
M. le
bailli, qui, seul, pouvait prononcer dans, une cause aussi délicate. Je conseillai
à André de ne pas se révolter contre les suppôts de la justice. « Ah, parbleu,
me dit-il, c’est bien assez pour moi d’avoir affaire à ma femme ! »
Au milieu
de notre marche, deux avocats et deux procureurs se rangèrent près des époux.
Ils déclarèrent qu’ils entendaient occuper, une couple pour la plaignante,
une couple pour le mari. Il est à remarquer qu’aucun des quatre ne connaissait
l’état
de la cause. Mais les gens de loi, comme les corbeaux, cherchaient partout
alors une curée.
Monsieur
le bailli reçut, avec beaucoup de dignité, les partis et leurs défenseurs.
Les procureurs s’assirent, tirèrent leurs écritoires de poche, et barbouillèrent
chacun quatre lignes en façon de requête, qu’ils présentèrent humblement
au magistrat. Les avocats toussaient, crachaient, s’essuyaient la bouche,
se préparaient à parler, et ils ne savaient encore de quoi il était question.
Monsieur
le bailli fit aux parties les questions, et les interpellations d’usage,
et procureurs et avocats surent que Colombine était la femme légitime d’André
; qu’elle voulait ravoir son mari, et que son mari ne voulait pas la reprendre.
« Mais,
lui dit le bailli, vous lui avez promis protection. — Oui ; mais elle s’est
fait protéger par d’autres. D’ailleurs, elle m’a promis fidélité — Et elle
n’y a jamais manqué, s’écria son avocat. — Qu’en savez-vous, Monsieur le
braillard ? — Voyez cet air de candeur, ces yeux baissés, cette modeste rougeur.
S’il est vrai que la figure soit le miroir de l’âme, quelle âme est plus
pure que celle de Colombine ?
L’avocat
d’André allait répondre. « Je ne vous ai pas requis, lui dit mon philosophe,
ni le procureur, si empressé d’écrire. Je déclare à M. le bailli que j’entends
plaider ma cause moi-même, et personne ne peut m’en contester le droit. Il
a raison, dit le juge. Aussitôt le procureur d’André remet son écritoire
dans sa poche, son avocat retrousse sa robe, et tous deux se retirent, après
avoir fait au magistrat une profonde révérence.
« S’il
est vrai, dit André, que le visage soit le miroir de l’âme, contemplez, Monsieur
le bailli, ce sourcil qui monte, cet autre
qui
descend ; ce teint enflammé, cet œil furibond, ce nez barbouillé de tabac,
et jugez quelle âme doit loger sous cette enveloppe-là.
« Monsieur
le bailli, reprit l’avocat de Colombine, je conviens que j’ai un peu exagéré
les charmes de ma cliente ; mais il est indifférent au fond de l’affaire
qu’elle prenne du tabac, et que ses sourcils ne soient pas sur la même ligne.
Je concluerai même des petits désagrémens, qu’un mari cruel lui reproche,
qu’ils sont les garans de sa fidélité. Or, si elle a tenu ses engagemens,
rien ne peut dispenser ma partie adverse de tenir les siens, et je demande
qu’ils soient remis dans les bras l’un de l’autre.
« —
Avocat opiniâtre et entêté, je soutiens que Colombine a rompu, pulvérisé,
anéanti tous les nœuds qui l’attachaient à moi. — La preuve de cela ?— Hé,
parbleu, en peut-on donner de pareille chose ? Elle n’a pas toujours été
mal bâtie et laide. Qu’aurait-elle fait, depuis vingt ans qu’elle court le
monde ? »
« Des
enfans, dit maître Jacques. » Il s’intéressait à nous, et pendant qu’on criaillait
en présence de monsieur le bailli, il avait été prendre des informations.
Colombine vivait tout-à-fait conjugalement avec Scaramouche, et deux enfans
se roulaient dans la grange qui leur tenait lieu d’hôtellerie.
« Voilà
des preuves, avocat. Qu’avez-vous à leur opposer ? Exigerez-vous que je reprenne
Colombine, et que je me charge des fils de monsieur Scaramouche ? Ménélas
mit Troie en cendres, pour reconquérir son épouse infidèle ; je brûlerais
Montargis pour me défaire de la mienne. »
«
Avocat, dit le bailli, votre cause n’est pas soutenable. Je mets les parties
hors de cour, avec défense à olombine de troubler à l’avenir le repos du
sieur André. — Et mes dépens, Monsieur le bailli ? — Votre partie les paiera.
— Ah, Monsieur le juge, vous me condamnez aux dépens ? cela est très-facile
; mais me faire payer, tudieu, je vous en défie, car je n’ai pas un sou.
»
André
m’avait souvent donné de bons conseils ; je devins l’homme raisonnable à
mon tour. Je le tirai à part. « Villelmine est dégradée, lui dis-je ; mais
elle a fait ton bonheur pendant quelque temps ; tu ne dois pas l’oublier.
— Si ce coquin de mendiant n’avait pas enlevé ma valise, je la donnerais
toute entière à Villelmine, pour n’entendre plus parler d’elle. Si je n’avais
vidé ma bourse, ma dernière ressource, dans le tablier de ma belle-mère…
— En voici une pleine ; conduis-toi en homme de bien. »
André
s’exécuta de fort bonne grâce. Le juge lui en témoigna sa satisfaction, et
il fit apposer la croix de Villelmine au bas d’un acte, par lequel elle renonçait,
et pour cause, à tous ses droits sur son mari. L’avocat cria ; je lui donnai
deux écus à partager entre lui et le procureur. Il nous salua d’un air tout-à-
fait gracieux, et disparut. Colombine retourna à ses petits Scaramouches
; nous allâmes remercier et payer maître Jacques. Dix-minutes après, nous
étions sur la route de Nemours. Il faisait nuit ; mais André avait cru ne
pouvoir sortir trop tôt de Montargis. Son imagination avait été fortement
frappée, et il croyait, à chaque instant, voir Colombine sauter dans notre
voiture, et s’asseoir à côté de lui.
Les
événemens de la soirée fournirent un ample sujet à la conversation. On aurait
pu écrire un volume de ce que nous
dîmes
sur l’indissolubilité du mariage. André trouvait ce lien en opposition directe
avec la nature. Moi, je soutenais qu’il fait le bonheur d’époux bien assortis.
« Vous avez vos raisons pour voir comme cela, monsieur ; moi, j’en ai de
bonnes pour voir autrement. — André, nous sommes tous organisés de même,
et ce qui convient à l’organisation de l’un doit convenir à celle de l’autre.
— Etablir un principe général sur nos dispositions morales est une absurdité.
Nous avons tous deux bras et deux jambes, et nous ne pouvons nous en servir
de même. Il y a des hommes de six pieds, et d’autres qui n’en ont que quatre
; des sots et des gens d’esprit. Je conviendrai, si vous le voulez, que leur
organisation est la même ; mais j’ajouterai que les résultats diffèrent essentiellement.
Ainsi je déteste le mariage, et vous en êtes idolâtre. Peut-être, cependant,
l’opposition de nos idées à cet égard est-elle simplement l’effet des circonstances
différentes, dans lesquelles nous sommes placés, vous et moi. J’épouse Villelmine,
jeune, jolie, fraîche comme un bouton de rose. Je trouve d’abord ma position
délicieuse. Un an, deux ans s’écoulent, sans nuages, sans contradictions,
et le bijou le plus brillant, qu’on porte sans cesse au doigt, n’est plus
remarqué que par ceux qui ne le voient qu’en passant. La nuit de la Saint-
Barthélémy arrive ; je perds mon bijou, et je m’en console aisément, en pensant
que j’ai conservé la vie. Je retrouve Villelmine, des années après, laide,
mal bâtie, dansant la sabotière, et vendant du baume. Qui diable, à ma place,
bénirait le mariage ?
« Vous
vous unissez à Colombe, et on vous l’enlève au sortir de l’église. Vous féraillez
pour la reconquérir, et un ravisseur de filles vous perce le flanc. Le prince
de Condé et le maréchal de Biron se battent, et vous perdez encore votre
épouse, qui ne l’est que de nom. Vous la retrouvez à Lusignan ; mais votre
blessure
vous borne à la contemplation. Vous devenez enfin son mari, et huit jours
après madame de Montbason vous sépare d’elle. Tout homme est plus ou moins
opiniâtre. Ces obstacles multipliés eussent suffi pour vous donner de l’amour,
si déjà vous n’en eussiez eu assez pour en mourir, et je crois, Monsieur,
que la constance est fille de la contrariété. L’avantage essentiel que vous
avez sur moi, c’est que Colombe est dans un couvent, et qu’elle y restera
jusqu’à ce que vous puissiez l’en tirer. Nous verrons ensuite ce que deviendra
votre amour.
Je me
récriai beaucoup sur l’incertitude que marquait André de mes sentimens futurs.
Je jurai que qui aime Colombe doit l’aimer toute sa vie ; que notre amour
était devenu partie intégrante de .notre être ; que non-seulement il ne pouvait
s’éteindre, mais qu’il ne devait pas même subir la plus légère altération.
« Et
quand il s’éteindrait, Monsieur, qu’y aurait-il que de très- ordinaire ?
— C’est impossible, André. — Que d’amans ont tenu le même langage, se sont
fait les mêmes sermens, et ont fini par ne pouvoir plus se supporter ? —André,
vous calomniez mon cœur et celui de Colombe. — Croyez-vous, Monsieur, que
la nature en ait fait deux exprès pour vous ? d’ailleurs, l’indifférence
absolue n’est-elle pas préférable, cent fois, à cette frénésie, à cette rage,
qui vous tourmente souvent, et qui a failli dix fois à vous coûter la vie
? — Ne pas aimer est-ce vivre ? — Ma foi, Monsieur, je me porte à merveille,
je ne suis pas amoureux, et j’espère bien ne plus le devenir. — Qui n’aime
rien est un être dégradé, un simple végétal. — Monsieur, il vaut mieux, je
crois, être un mirthe ou un oranger qu’un tigre. — André, la guerre civile
recommencera-t-elle bientôt ?
Cet
homme, que j’avais mis au rang des végétaux, n’avait pas de rancune, et raisonnait
conséquemment. II me représenta qu’il fallait, avant que de penser à délivrer
Colombe, que j’allasse m’acquitter, envers ma mère, de ce que me prescrivait
mon devoir ; que je reçusse, de ses mains, ce qui m’appartenait dans la succession
de mon père ; que j’achetasse ensuite une terre et une maison, « car enfin,
me disait-il, il sera très-beau sans doute de délivrer votre épouse ; mais
il faut la loger, quelque part. Ces préliminaires remplis, nous soufflerons
le feu de la guerre, si de petits particuliers, comme vous et moi, peuvent
porter la main sur le manche du soufflet.
Nous
entrâmes à Nemours avec les premiers rayons du soleil levant, et André me
fit observer qu’il était temps de renoncer à la métaphysique de l’amour,
pour nous occuper de choses plus substantielles. Nous n’avions pas soupé
la veille, et il était temps de déjeuner.
Nous
trouvâmes à nous loger un peu moins mal qu’à Montargis : tout s’agrandit
à mesure qu’on approche de la capitale. Nous trouvâmes chez maître Martin
six chaises de paille, six cuillers, six fourchettes de fer, six assiettes,
un lit assez large pour quatre, et qui était garni de ses draps. A la vérité,
ils servaient pendant huit jours à tous les voyageurs qui s’arrêtaient chez
maître Martin, parce qu’il n’en avait encore que deux paires ; mais il nous
dit que nous étions les maîtres de ne pas nous déshabiller.
Maître
Martin avait conçu l’heureuse idée de pourvoir aux besoins des passans. Une
éclanche de veau rôtie décorait son buffet, et deux lapins en civet bouillotaient
sur un fourneau. Comme les aisances de la vie s’étendent avec les inventions
nouvelles ! oh, si ce coquin d’Omar n’eût pas brûlé la
bibliothèque
d’Alexandrie, que de choses perdues nous aurions sous la main ! « Peut-être
les grandes routes de l’empire de Babylone étaient praticables l’hiver comme
l’été. — Il est constant au moins que les voies romaines l’étaient. Peut-être
les voyageurs Babyloniens trouvaient à leur disposition des voitures commodes
et douces, et des relais de distance en distance, qui leur faisaient parcourir
l’espace avec rapidité. — Il est certain, André, que ces moyens de transport
étaient inconnus à Rome. — Peut-être y avait-il dans l’Assyrie des cabarets
élégans, abondamment fournis de toutes choses, où, moyennant une faible rétribution,
un satrape était aussi bien que dans son palais. — L’histoire romaine ne
parle pas de semblables établissemens ; donc ils étaient inconnus à Rome.
« À
quoi rêves-tu donc, André ? — Je pense, Monsieur, que sans nous en douter,
nous venons de découvrir une nouvelle branche d’industrie et d’utilité publique,
qui, peut-être, était consignée dans quelque manuscrit de la bibliothèque
d’Alexandrie. — Mon cher ami, il est donné à l’esprit humain de parcourir
un cercle assez étendu, et cependant borné. Quand l’homme a fait le tour
du cercle, il s’arrête, et si les révolutions publiques et physiques anéantissent
les connaissances acquises, il recommence à parcourir son cercle. Ainsi que
de prétendues découvertes, faites dans les temps modernes, n’étaient que
des choses usées par les anciens !— Vous avez raison, Monsieur ; mais ceux
qui les ont retrouvées n’ont pas moins de mérite que les premiers inventeurs,
et nous pouvons nous mettre au nombre des êtres privilégiés modernes. — Comment
cela, André ? — Ne venons-nous pas de trouver qu’on peut faire des routes,
praticables l’hiver comme l’été ? — Ne venons-nous pas d’inventer des voitures
publiques, dont la marche serait accélérée par des relais ? — Et des cabarets
somptueux, où les
voyageurs
seraient hébergés… — Un moment, Monsieur : oute découverte nouvelle doit
être décorée d’un nom nouveau et sonore. » Hébergé, hébergé.... héberger
veut dire recevoir chez soi, loger. Nos établissemens nouveaux s’appelleront
auberges.
-
Bien trouvé, André. — N’est-il pas vrai,
Monsieur ?
«
—Mais comme nous ne pouvons faire construire des voies romaines, des voitures
publiques, qui parcourent la France dans tous les sens, et des auberges,
de distance en distance, il faut que nous abandonnions notre découverte.
— L’abandonner, Monsieur ! jamais. Pendant que vous arrangez vos affaires
à Étampes, j’écris nos idées nouvelles ; je les présente sous le jour le
plus avantageux. Si elles ne peuvent faire notre fortune, il faut au moins
qu’elles nous donnent l’immortalité. J’appelle les grandes routes andréades,
et les voitures des mouchettes. — Bien, non cher André, très-bien,
à merveilles. — Je vais à Paris ; je fais imprimer mon ouvrage, et je le
distribue au public, avec la permission de laSorbonne. —André, je fais une
réflexion. — Et laquelle, Monsieur ? — Vous êtes un ambitieux. — Comment
cela ? — Avant qu’il y ait des auberges et des voitures publiques, il faut
qu’il existe des grandes routes. Les grandes routes praticables dans toutes
les saisons, sont la base essentielle de notre projet, et vous leur donnez
pompeusement votre nom ? — C’est moi, Monsieur, qui ai été déterrer, dans
les ruines de Babylone, les routes imperméables.
-
J’ai rappelé celles des Romains. — C’est
une réminiscence,
-
et il y a l’immensité entre un souvenir et
une invention. — Nos superbes et imperméables chemins s’appelleront des mouchettes.
— Des andréades. — Des mouchettes, vous dis-je.
-
Je ne céderai pas sur un point aussi important.
— Vous céderez, Monsieur. — Ah, vous avez de l’humeur ! ah, vous m’appelez
Monsieur ! modérez-vous, et rendez à César ce qui
appartient
à César. —Vous César ! — Tout est relatif. — Je vous entends. Vous êtes l’aigle,
et moi le passereau. — Hé, hé… — Comment, hé hé ? vous êtes un insolent.
» Je me lève, furieux. Je renverse la table. Trois des six assiettes de Martin,
et une dame-jeanne sont brisées ; le reste de notre civet et du vin couvrent
le pavé ; un chien de basse-cour se lance entre les jambes d’André, et le
fait asseoir sur les débris de notre déjeuner.
« Ma
foi, dit-il, me voilà revenu de Babylone, et dans une posture propre à dissiper
les fumées de l’amour-propre. » Je me mis à rire ; le bon André rit aussi.
Il quitta son haut de chausses ; Martin se chargea de le remettre en état
de servir. Nous allâmes nous coucher, et à notre réveil il ne fut plus question
de mouchettes, ni d’andréades. C’est ainsi qu’une idée heureuse disparaît
devant un incident qui fixe l’attention sur un objet nouveau, pour ne se
reproduire, quelquefois, que des siècles après. André m’avait contredit,
je l’avais brusqué ; nous avions eu des torts tous les deux, et nous ne cherchâmes
qu’à nous les faire oublier réciproquement… Rien ne nous obligeait à voyager
la nuit. J’étais bien aise, d’ailleurs, d’entrer à Étampes en plein jour
: j’allais y paraître dans un équipage propre à exciter l’envie. « Toujours
le péché d’orgueil, me dit André. — J’en conviens, mon ami. Mon patron me
l’a souvent pardonné ; il me le pardonnera encore cette fois-ci. — C’est
ainsi, Monsieur, qu’on se tire d’affaire avec des capitulations de conscience.
Je remarque que les gens les plus pieux ont souvent recours à ce moyen-là.
Il favorise des passions, que la dévotion n’éteint jamais entièrement. »
Nous
avions résolu de ne partir que le lendemain, et il fallait user le reste
de la journée. Nous nous promenâmes par les rues
de
Nemours. On trouve partout de ces figures heureuses, qui plaisent, qui attirent,
on ne sait pourquoi. Il est constant que tous les hommes influent, les uns
sur les autres, en bien ou en mal. Deux particuliers, qu’on n’a jamais vus,
jouent à la prune ou au trictrac. On désire que l’un gagne ; on souhaite,
par conséquent, que l’autre perde. Pourquoi cela ? « Monsieur, dit André,
cela n’est peut-être pas impossible à expliquer. J’ai lu, autrefois, un vieux
livre, composé par un vieux docteur écossais, sur la médecine d’attouchement.
Il prétend qu’il s’échappe de nous des molécules, qui repoussent ou attirent
; qu’un médecin, dont les émanations sont en rapport avec celles d’un malade,
peut le guérir en le touchant, et mon docteur cite des faits. — Mon cher
André, ceci est trop fort. — Monsieur, c’est un système comme un autre. Il
y a, dans tous, à prendre et à laisser. »
Quoi
qu’il en soit, nous rencontrâmes, sur une petite promenade de Nemours,
un homme dont les molécules’ étaient en harmonie parfaite avec les nôtres,
car nous ne balançâmes pas à l’aborder. Notre qualité d’étrangers fut notre
prétexte et notre excuse.
La conversation
s’engagea. Nous n’avions pas entendu parler des affaires publiques, depuis
que nous étions sortis d’Argenton, et quoiqu’on n’ait rien de commun directement
avec les rois, on aime à savoir ce qu’ils font. Leurs moindres actions influent
toujours sur notre sort, à nous pauvres petits. Notre inconnu nous remit
au courant, avec une complaisance, dont nous lui sûmes le meilleur gré.
Pendant
qu’on signait la paix, Lesdiguières battait les catholiques dans le Dauphiné
; un de ses lieutenans prenait Montpellier ; le duc d’Anjou, frère
du roi, enlevait aux
huguenots
La Charité et Issoire. La paix était dans toutes les bouches, et personne
ne remettait l’épée dans le fourreau.
Le roi
se crut dégagé du joug des Guise, parce qu’il s’était rapproché du roi de
Navarre et du prince de Condé. Il était retombé dans cet état d’apathie,
qui l’avait plusieurs fois exposé à des dangers réels. Il ne connaissait,
pour en sortir quelquefois, d’autre moyen que de varier ses plaisirs. Il
en avait de toute espèce.
La misère
était extrême. Il prodiguait à Joyeuse et à d’Epernon le faible produit des
impôts. Il pensait à les marier aux sœurs de la reine de France, Louise de
Vaudémont. Ils n’avaient pas plus besoin de femmes que lui.
Un jour
il donnait un bal. Le lendemain, il se promenait .par les rues de Paris,
à la tête d’une mascarade de pénitens, nud jusqu’à la ceinture, et il se
fustigeait, avec eux, en chantant des psaumes. Il croyait persuader ainsi
les ligueurs de la pureté de son catholicisme. Un autre jour, il instituait
l’ordre du Saint- Esprit. Il inséra, dans les statuts, que tous les chevaliers
professeraient la religion romaine. Il espérait que les seigneurs protestans
feraient abjuration pour obtenir la décoration nouvelle. Aucun d’eux ne se
prononce encore, et cependant l’ordre de Saint-Michel est tombé dans un tel
discrédit, qu’on ne l’appelle plus que le collier à toutes bêtes.
Deux
de ses mignons, Quélus et Mangiron se sont fait tuer en duel, et il leur
fait ériger des statues, dans l’église paroissiale de Saint-Paul. Il les
pleure, tous les jours, jusques dans les bras de Joyeuse et de d’Epernon,
et, en même temps, il établit des comédiens italiens à l’hôtel de Bourgogne.
Telle
est la faiblesse de son autorité, que le parlement de Paris a osé rendre
un arrêt qui expulse ces histrions de la capitale. Il les y maintient par
la force.
Le duc
de Guise approuve des contrastes et des fautes, qui achèvent de couvrir Henri
du mépris général. La ligue est à ses ordres, et il n’a qu’un mot à dire
pour renverser le roi du trône. Le moment n’est pas venu.
Catherine
deMédicis gémit en secret, et entretient une correspondance active avec les
princes protestans. Elle affecte, en public, une gaîté, qui a fui loin d’elle,
depuis long-temps, ce Tel est, Messieurs, l’état actuel de la France. »
« Vous
conviendrez, au moins, Monsieur, dis-je au narrateur, que le roi est un excellent
catholique, et que cette qualité-là balance bien des défauts. C’est une réflexion
que j’ai déjà eu l’occasion de faire. — Monsieur, un roi qui n’a que cette
qualité-là, est peu de chose en temps de paix, et n’est rien dans des momens
de troubles. Vous ne tarderez pas à être convaincu de ce que j’avance. Monsieur
Duport continuait à blâmer la conduite du roi, et il s’exprimait avec amertume
; je le défendais avec chaleur. Un prince, qui institue, tous les jours,
des ordres religieux, et devant qui j’ai eu l’honneur de jouer du serpent,
à la procession des bilboquets ! M. Duport s’échauffait ; je m’échauffais
davantage. « Prenez garde, Monsieur, me dit André. Vous avez derrière vous,
la table, le civet et les assiettes du matin. » Je me mis à rire, André rit,
et comme le rire se communique, M. Duport rit aussi. Cependant un homme raisonnable
veut savoir de quoi il rit. Il fallut lui conter l’histoire entière des Andréades
et des Mouchettes. Les éclats de rire redoublèrent, et M. Duport finit par
nous inviter à souper.
On
aime à parler de sa ville natale, et il n’y a pas bien loin de Nemours à
Étampes. M. Duport pouvait savoir quelque chose de ce qui s’y passait. Je
lui fis plusieurs questions, en sablant un vin, qui valait mieux que celui
de maître Martin. J’appris que, peu de temps avant la signature de paix,
les ligueurs étaient entrés à Étampes, et avaient massacré tous les huguenots.
« Que le ciel les récompense, m’écriai-je ! Ma mère, catholique ardente,
aura trouvé sûreté et protection. Monsieur, me répondit-il sèchement, il
est vraisemblable que la guerre civile se rallumera bientôt, et si les réformés
entrent à Etampe, que deviendra votre mère ? » Cette observation me fit frissonner.
« Quelles
que soient, poursuivit M. Duport, nos opinions religieuses, n’oublions jamais
que Dieu ne veut pas de sacrifices de sang; que nous pouvons lui plaire par
celui de nos passions haineuses, et qu’une charité, bien entendue, peut seule
établir en France une paix sincère et durable. »
Je remarquais
qu’André était sérieux quand je parlais, et qu’il souriait, quand notre hôte
reprenait la parole. Depuis long- temps, je le trouvais entaché d’une sorte
d’hérésie ; mais il était si bon, si intelligent, si instruit, qu’il fallait
bien lui passer quelque chose. Au reste, je vis clairement qu’ils étaient
deux contre moi, et que j’aurais du désavantage, si je soutenais la discussion.
Il commençait à être tard ; je voulais partir le lendemain de grand matin
; je remerciai cordialement M. Duport de ses bontés, et je gagnai, avec André,
l’auberge de maître Martin.
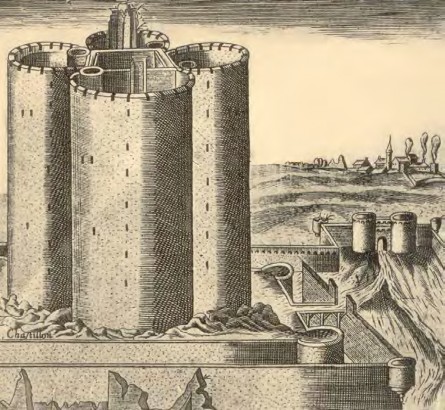
Étampes
à la fin du XVIe siècle (gravure de Chastillon)
CHAPITRE
XV
Entrée
de notre héros à Étampes.
Il parut
ce jour, où la piété filiale devait honorer une mère estimable, et lui faire
oublier ses chagrins et ses privations. Quelques heures encore, et j’allais
être dans ses bras. Mon cœur, plein des plus doux sentimens, oubliait les
passions tumultueuses ; l’image de Colombe même ne pouvait rien sur lui en
ce moment.
Déjà
je distinguais les clochers d’Étampes ; déjà mon imagination créait les
scènes de bonheur qui allaient s’ouvrir, pour ma mère et pour moi ; je jouissais
de sa surprise et de son attendrissement ; le son de sa voix frappait mon
oreille ; ses bras me pressaient sur son sein, elle bénissait son fils, respectueux
et sensible. André ménageait ma délicieuse rêverie ; il gardait un profond
silence.
J’aperçus,
sur le bord du chemin, cette jeune fille, si naïve et si bonne, qui m’avait
offert du lait et des fruits, lorsque je m’évadai du couvent des Franciscains
d’Étampes. Elle filait au
fuseau,
avec le calme de l’innocence. Je priai mon patron de veiller sur elle.
Je reconnus,
en entrant dans la ville, toutes les rues, toutes les maisons, et je les
revis avec un plaisir inexprimable. J’en nommais les habitans à André, comme
s’il eût dû les connaître. Là, demeurait un camarade d’école ; ici, un ami
de mon père ; plus loin, un marguillier. Je m’inclinai profondément, en passant
devant le couvent des Franciscains.
Nous
arrêtâmes devant la maison de ma mère. Je m’élançai de ma voiture, et je
frappai à la porte. Déjà mes bras s’ouvraient pour recevoir mon excellente
Madeleine… Un inconnu me demande ce que je veux. « Où est ma mère ? — De
qui me parlez-vous ? — De dame Madeleine de Mouchy, » et je l’appelais en
parcourant la maison. « Un moment, Monsieur, vous êtes chez moi. — Ma mère
a vendu sa maison ! Où s’est-
elle
retirée ? — Dans le couvent des filles du sacré-Cœur de Jésus18. — André, courons à son couvent. — Vous ne la verrez
pas. — Pourquoi cela ? — Elle a prononcé ses vœux, et la règle de son ordre
lui interdit toute communication extérieure. — Je ne verrai pas ma mère !
Ainsi donc, les couvens m’auront enlevé tout ce que j’ai de cher au monde
!
« Qu’a-t-elle
fait de son bien ? demanda André. — Oh, que de questions ! Adressez-vous
aux Franciscains ; ils vous donneront, s’ils le veulent, tous les éclaircissemens
que vous désirez, » et le bourru ferma la porte sur nous.

18 Anachronisme notable, car la dévotion
au Sacré-Cœur ne s’est développée en France qu’à partir de la fin du XVIIe siècle (B.G.).
«
André, je verrai ma mère. Si on me refuse cette satisfaction, je mets le
feu au couvent, j’enlève Madeleine à travers les flammes, et… — Enlever sa
mère ! Voilà, je crois, ce qui ne s’est jamais vu. — Eh bien, ce sera la
première fois. — Ta, ta, ta, ta, ne connaîtrez-vous jamais que les movens
violens ? — Ce sont les plus prompts. — J’en conviens ; mais si vous refusez
de revenir à des sentimens raisonnables, je ne vous quitterai pas d’un instant,
et je marcherai à côté de vous, une pompe sous le bras. » Je ris ; c’est
ce que voulait André : on ne brûle pas une maison en riant.
« André,
il faut cependant prendre un parti. — Sans doute, Monsieur ; mais il faut
agir avec réflexion. Occupons-nous d’abord de nous loger, nous et nos équipages.
Cette opération préliminaire vous refroidira la tête, et nous verrons après
ce qu’il faudra faire. »
Loger
au cabaret, après avoir eu une maison à moi ! Cela était dur ; mais il fallut
me résigner. Nous cherchâmes, et, en allant et venant, je rencontrai un ancien
camarade, parvenu au poste éminent de bedeau. Il me reconnut, et, une heure
après, on disait, par toute la ville, qu’Antoine la Mouche y était revenu
avec une jolie figure, des vêtemens somptueux, un équipage brillant, et cent
mille livres. On avait oublié mes anciennes espiègleries ; on m’arrêtait,
on me félicitait, et, comme un homme qui a cent mille livres est un personnage
important, on me marqua de la considération. Personne ne m’offrit de logement,
sans doute parce qu’un gros capitaliste doit épuiser, en peu de temps, une
maison bourgeoise ; mais on nous indiqua le meilleur cabaret d’Étampes.
Ces
conversations, courtes, mais répétées, m’avaient calmé, ainsi que l’avait
prévu André. Je ne pensais plus à enlever ma
mère,
et il me proposa d’aller rendre visite au prieur des Franciscains.
Le frère
portier appela le père Boniface ; le père Boniface me regarda avec une sorte
d’embarras, et il alla avertir le prieur. Il n’était plus, ce temps, où on
ne m’adressait pas un mot qui ne fût dicté par la bienveillance ; où on m’attirait,
par des caresses, sous le scapulaire de-saintFrancois. Deux figures, froides
et sévères, attendaient que je m’expliquasse.
Je demandai
ce qui avait déterminé ma mère à prendre le voile : le père Boniface le savait
au moins aussi bien qu’elle. Il me répondit que la grâce l’avait appelée
à cet état de perfection. André demanda ce qu’était devenu son bien. On lui
répondit qu’elle en avait disposé. « En faveur de qui ? — Elle l’a employé
en œuvres pies. — Ah! j’entends. »
J’exprimai
le plus vif désir de la voir. On me répondit que la règle ne lui permettait
pas de me recevoir. « Sortons d’ici, Monsieur, me dit André. »
« Il
me paraît évident, continua-t-il, quand nous fûmes dans la rue, que ces gens-là
sont parvenus à dépouiller votre mère, et qu’ils l’ont mise dans un couvent
pour s’en débarrasser. — Ah, qu’ils gardent son bien, et qu’ils prient pour
elle et pour moi. — Ils prieront si cela leur plaît ; mais ils vous restitueront
jusqu’au dernier sac. — Que je voie ma mère. — Vous la verrez. — À ce prix,
je renonce à tout. — Moi, je ne renonce à rien. Que les membres catholiques
du parlement de Paris favorisent le cagotisme, l’idiotisme, ils font les
affaires du duc de Guise ; mais ils comptent parmi eux une moitié de protestans,
intéressés à donner une haute idée de leur équité, et ceux-là se soulèveront
contre des moines spoliateurs. — Moi, j’attaquerais ces saints
religieux,
au milieu desquels j’ai passé ma première jeunesse !
— Monsieur,
la robe ne fait pas l’homme, et celle de saint François couvre ici des fripons.
— Mais, André !... — Mais, Monsieur, il vous faut une petite terre pour nourrir
Colombe ; un superflu de produits pour lui procurer les agrémens de la vie
; une maison agréable pour la loger, et on n’a pas tout cela avec dix mille
livres. Allons trouver le procureur du roi d’Étampes. — Allons chez le procureur
du roi. — S’il fait son devoir, cette affaire pourra se déterminer sans éclat.
Si c’est un sot, je pars pour Paris ; je m’adresse au chancelier de Birague,
et il nous fait raison de toute cette canaille-là. »
À l’époque
de la signature de la paix, la cour s’était occupée de garantir les réformés
des persécutions sourdes et ouvertes des catholiques. La composition mixte
des parlemens assurait le repos des sectaires des deux cultes, et le chancelier
avait favorisé ces vues pacifiques, en expulsant des tribunaux et des bailliages
les forcenés et les hypocrites.
Le procureur
du roi d’Étampes était catholique ; mais il voyait, dans chaque Français,
un homme qni avait droit à la protection de la justice, quelles que fussent
ses opinions religieuses. Il était magistrat intègre, et ne voulait être
que cela.
André
porta la parole, et fut écoulé avec attention, « Je vais, me dit le procureur
du roi, chez les filles du Sacré-Cœur, et je parlerai à votre mère. Revenez
dans une heure. »
Cette
heure nous parut longue : elle devait décider de choses d’une grande importance
pour moi, et celui qui attend, compte les minutes. M. Vernier rentra enfin,
et nous invita à l’écouter.
Il
s’était fait présenter les statuts et les réglemens de la maison. « Les statuts,
émanés du pape, sont sévères ; mais aucune main laïque n’a le droit d’y porter
atteinte. Ils ordonnent une clôture absolue, et ne privent pas ces religieuses
de la satisfaction de communiquer avec les personnes de l’extérieur. Ce couvent
est dirigé par les pères Franciscains, et ils y ont établi, depuis trois
mois, une réforme, qui peut être prescrite par des motifs purement temporels.
Je présume qu’ils veulent prévenir toute explication entre votre mère et
vous. Ils ont fait approuver ces nouveaux réglemens par l’évêque diocésain
; cependant ils sont loin d’avoir force de loi. D’ailleurs, ils n’interdisent
aux religieuses que les visites des étrangers, et un fils ne peut
être étranger à sa mère. Un reste de pudeur n’a pas permis de vous exclure
nominativement du parloir. On eût blessé toutes les convenances, on eût irrité
ces bonnes filles, si on eût parlé d’enfans qu’elles n’ont pas, et qu’elles
ne doivent pas avoir. Une veuve, sous la guimpe, est une chose extraordinaire,
et on a cru vous éloigner de la grille, en vous comprenant dans une interdiction,
qu’on a voulu rendre générale. Je crois, au contraire, qu’il doit y avoir
exception en votre faveur. Au reste, je prévois l’existence d’une trame,
sourde et coupable, contre votre sensibilité et votre fortune. J’en démêlerai
les fils.
« J’ai
parlé de vous à votre mère. Elle vous croyait mort, et elle a versé des larmes
d’attendrissement, en apprenant que vous êtes à Étampes. Je lui ai demandé
si elle serait bien aise de vous voir. Elle est tombée à 33 genoux devant
la grille, et elle a baisé ma main, que j’avançais pour la relever. Que Dieu
me pardonne, a-t-elle dit, de tenir encore à la terre ; mais je crois que
je mourrais de joie, si je revoyais mon Antoine. »
M.
Vernier envoya chercher le greffier du bailliage, deux témoins, quatre
archers, et nous prîmes tous ensemble le chemin du couvent.
L’acte
d’autorité qu’avait fait le procureur du roi, s’était borné à demander la
communication des statuts et des réglemens, et il avait suffi pour répandre
l’alarme dans le couvent. La supérieure parut seule, du côté intérieur de
la grille, quand nous demandâmes à voir la sœur Madeleine. Le père Boniface
entra dans le parloir, au moment où le procureur du roi ordonna que ma mère
fût introduite. Le révérend père représenta, d’un ton humble, au magistrat,
que la pureté de la sœur Madeleine serait ternie, si elle partageait l’air
que respire son fils. « Qui peut vous faire juger que ce jeune homme soit
un être corrompu ? — Monsieur le procureur du roi, il, a été quatre ans novice
chez nous, sans être jugé digne de prononcer ses vœux. Il a fui, en coupable,
de notre maison ; il est allé à la Rochelle, au centre de l’hérésie, se réunir
à un père huguenot et athée… — Prenez garde, mon père : ce que vous dites
implique contradiction. Un huguenot est un chrétien, et un chrétien n’est
pas athée. Continuez. » — Depuis ce temps, nous n’avons plus entendu parler
de lui, ni de son père. Nous les avons crus morts, l’un et l’autre, livrés
aux plus abominables principes, et nous avons maudit leur mémoire. — Vous
êtes prêtres pour prier et non pour maudire. Mais sur quelles présomptions
avez-vous cru que Jacques et Antoine de Mouchy n’existaient plus ? — Sur
une lettre écrite à la sœur Madeleine, par le maréchal de Biron. » Le greffier
inscrivait, sur son procès-verbal, les questions et les réponses.
«
— Où est cette lettre, qui constate le décès du père et du fils ? — Je ne
sais si on pourra la retrouver. Mais en voici une qui prouve l’athéisme de
Jacques. — Voyons cette lettre.
« Jacques
y exprimait le désir d’embrasser encore sa femme et son fils, avant que de
s’endormir pour toujours. — Pour toujours, signifie positivement,
Monsieur le procureur du roi, que l’homme meurt tout entier. — Ces mots peuvent
s’appliquer aussi au sommeil des justes, qui s’endorment pour toujours, relativement
à la terre. Mais comment se fait-il que vous ayez conservé une lettre insignifiante,
et que celle, qui peut tenir lieu d’un acte de décès, ne se retrouve pas
? » André demanda la parole.
« On
peut prouver, dit-il, que M. de Mouchy n’a quitté le maréchal de Biron, qu’au
moment de l’ouverture des négociations pour la paix, et jamais ce général
n’a écrit à la sœur Madeleine. Mon ami était son secrétaire intime ; il rédigeait
toutes ses écritures, et le père Boniface ne prétendra pas nous faire croire
qu’il ait annoncé sa propre mort à sa mère. Il lui a donné avis de celle
de son père. Cette lettre prouve l’existence du fils, et voilà pourquoi elle
ne se trouve pas. Le maréchal est à Biron ; il y a loin d’ici ; mais je ne
demande que quinze jours pour apporter, à monsieur le procureur du roi, des
preuves incontestables des faits que je viens d’avancer.
« Voici
les conséquences que j’en tire. Les franciscains ont pu croire ce jeune homme
au nombre des victimes de nos guerres civiles, et ils ont voulu hériter du
père et du fils. Madeleine ne sait pas lire. On lui a présenté et lu un papier
écrit dans des vues perfides. Monsieur le procureur du roi suivra ce premier
fil. Il le conduira à la connaissance des détails.
«
— Caporal, portez à vingt de vos camarades, l’ordre de garder les issues
du couvent des franciscains, et de ne pas permettre qu’on en sorte la moindre
chose. Mme la supérieure, choisissez de faire conduire la sœur Madeleine
dans ce parloir- ci, ou de m’admettre dans le vôtre. Je veux parler à cette
religieuse, sans témoins. Voilà la seconde fois que je vous donne l’ordre
de la faire paraître ; ce sera la dernière. Si vous n’obéissez à laminute,
j’userai des moyens que la loi met à ma disposition, pour protéger ceux qui
invoquent mon ministère. Vous savez que les portes tombent devant moi. »
La supérieure pâlissait, rougissait, et paraissait ne savoir à quoi se déterminer.
Le procureur du roi lui lança un regard foudroyant. Elle sortit.
Le père
Boniface était assis dans un coin, et paraissait accablé. Le procureur du
roi le fit conduire dans une pièce voisine, et le mit sous la garde de ses
archers.
La sœur
Madeleine parut enfin, pâle, défaite, et dans un état de stupeur remarquable.
La vue de son fils ramena la vie dans sou cœur et dans ses yeux. Nous nous
précipitâmes dans les bras l’un de l’autre ; nous nous y tînmes long-temps
pressés ; de douces larmes coulaient de nos yeux ; des mots entrecoupés s’échappaient
à peine de nos poitrines oppressées. Cette scène touchante dura long-temps.
« Cette
entrevue me coûtera cher, dit enfin ma mère. Mais j’aurai joui d’un instant
de bonheur, avant que de descendre vivante dans la tombe. » Le procureur
du roi l’interrogea.
On lui
avait défendu de rien révéler, sous les peines les plus graves, et celles
qu’on inflige dans les couvens sont cruelles.
« Mais
mon fils vit, dit-elle, on l’a dépouillé, et j’étais mère avant que d’être
religieuse. J’abandonne de tout mon cœur à
l’Eglise,
ce qui m’appartenait ; mais je supplie M. le procurateur du roi, de faire
rendre à Antoine ce qu’a laissé son père. Je remplis un devoir sacré, et
je me résigne à la mort.
« Vous
ne mourrez pas, Madame, s’écria le procureur du roi. Je vous prends sous
ma protection, et elle ne sera pas impuissante. Je vous ferai même transférer
dans un autre couvent, si les circonstances l’exigent. Parlez librement et
avec calme. »
Ma mère
raconta que le père Boniface lui avait lu une lettre, qui lui annonçait la
mort de son fils ; qu’il lui avait représenté qu’elle ne tenait plus au monde
par aucun lien ; que les biens terrestres n’étaient que des moyens de perdition.
Il lui conseilla de s’en défaire en faveur des franciscains, qui en feraient
un digne usage, et de ne s’occuper désormais que de son salut. Il la pria,
il la pressa d’entrer en religion.
L’espoir
que la nouvelle de la mort de son fils pouvait n’être pas fondée, la fit
résister pendant quelque temps. On lui montra l’abîme infernal, ouvert sous
ses pas, et prêt à l’engloutir. Elle vendit sa maison, et enjoignit le produit
aux sommes qu’elle avait déjà. Elle en remit la totalité au père Boniface,
et elle entra chez les filles du Sacré-Cœur dé Jésus.
« Combien,
Madame, avez-vous livré à ce moine ? — Environ trente mille livres. — Greffier,
dites, qu’on fasse rentrer Boniface.
« Mon
père, vous êtes coupable de fraude et de faux, et vous savez que les faussaires
sont pendus. — Pendu ! un religieux, un prêtre ! — J’avoue qu’il sera difficile
de vous conduire au gibet ; il ne le sera pas autant de vous faire restituer
ce que vous
avez
extorqué. Qu’avez-vous fait des trente mille livres que sœur Madeleine vous
a remises ? — Nous avons payé à son couvent trois mille livres pour sa dot
; le surplus a été employé en œuvres pies. — Cela ne se peut pas. On ne distribue
pas vingt-sept mille livres en aumônes, dans une petite ville comme Étampes,
sans que le public en ait connaissance, sans que la mendicité y soit éteinte,
et on y rencontre des mendians à chaque pas.
« Votre
couvent est cerné. Épargnez-moi la peine d’y faire une perquisition. Apportez-moi
les vingt- sept mille livres, dont vous êtes nantis. — Monsieur le procureur
du roi, s’écria André, je vais conduire notre voiture à la porte des franciscains,
et je recevrai en masse ce qu’on y a porté en détail.
« Mais,
Monsieur, dit le père Boniface, vous savez que nous faisons vœu de pauvreté.
— Si je ne trouve rien chez vous, votre justification sera éclatante. Mais
je crains bien qu’il y ait d’autres sommes, destinées à des œuvres pies.
Allons, décidez- vous. — Mais au moins, Monsieur, me donnez-vous votre parole
que cette affaire n’aura aucune suite ? — Je vous le promets ; mais je prendrai
mes sûretés. »
Pendant
cette instruction, j’étais à côté de ma mère ; je tenais ses mains, je les
pressais, je les baisais ; elle me prodiguait les plus tendres caresses.
Nous vîmes cependant sortir André et le père Boniface.
Une
heure après, vingt-sept sacs de mille livres étaient déposés sur le plancher
du parloir. « Monsieur, me dit le procureur du roi, votre mère est morte
au monde ; cet argent vous appartient. Faites-en ce que vous voudrez. Caporal,
allez
relever
l’escouade que vous avez mise en surveillance autour du couvent des franciscains.
« Père
Boniface, je ne cherche pas de coupables. Je ne veux pas savoir, si vous
avez encore de l’argent mal acquis. Je vous conseille de répandre dans le
public que vous aviez chez vous un dépôt, qui devait être transféré, en plein
jour, au couvent du Sacré-Cœur, et que vous avez requis main-forte, pour
contenir les gens qu’on rencontre partout, et dont l’industrie est au bout
de leurs doigts. Si on vous fait des questions, vous ne serez pas embarrassé
d’y répondre : vous avez l’imagination active et féconde.
« Je
garde mon procès-verbal. Je ne le communiquerai à personne ; mais il servira
de base à une action criminelle, si je ne suis pas satisfait de votre conduite.
Qu’on fasse venir la supérieure de cette maison.
…. «
Madame, je vous laisse les trois mille livres de dot que vous a payées la
sœur Madeleine, quoique cette somme excède de beaucoup ce qu’on exige ordinairement
des novices ; mais j’entends, je veux qu’elle soit traitée doucement, et
même avec quelques égards. Yous lui permettrez de recevoir son fils, quand
il se présentera. Je viendrai la voir tous les jours, et à la première plainte
fondée qu’elle m’adressera, je la ferai transférer dans un couvent de Paris,
et vous rendrez sa dot.
« Vive
le procureur du roi d’Étampes, s’écria André ! Pourquoi ne lui ressemblent-ils
pas tous ?? Monsieur, lui dit sèchement ce magistrat, la justice était de
votre côté, et elle a dû prononcer en votre faveur ; mais je vous engage
à user de vos avantages avec une extrême réserve. Les moines et les
religieuses
ne sont pas dans la religion ; mais ils y touchent de très près. Ne l’oubliez
pas. Retirons-nous.
J’aidai
à André à transporter nos sacs dans notre voiture, et nous fûmes les déposer
dans une chambre de notre cabaret, à côté des dix mille livres que nous avions
apportées à Étampes. J’en mis la clef dans ma poche, après avoir fermé les
volets des fenêtres. Je commençais déjà à sentir les embarras et les inquiétudes
que donnent les richesses.
« Hé
bien, Monsieur, n’avais-je pas raison de vous dire que, d’une manière ou
d’une autre, nous aurions raison de ces fripons-là ? — André, le couvent
des franciscains a presque été mon berceau, et je porte à ces bons pères
un vif intérêt. — Oh, ces bons pères, ces bons pères ! apprenez donc, Monsieur,
à estimer les hommes ce qu’ils valent. — Je ne me consolerais pas de les
voir diffamés. — Il faut, pour qu’ils le soient, qu’ils se diffament eux-mêmes,
et ils sont trop adroits pour n’être pas discrets. — Mais le procès-verbal...
— M. Vernier est incapable d’en abuser ; mais il est là ; vos bons pères
le savent ; il les contiendra, et ils se tairont. Allons remercier le procureur
du roi. »
Nos
remercîmens furent aussi vifs que le service qu’il nous avait rendu était
important. « Messieurs, nous dit-il, remercier un magistrat qui n’a fait
que son devoir, c’est l’offenser, quand il est honnête homme. Vous ne me
devez rien. Je vous salue. »
Nous
parlions, en nous retirant, des rares qualités de M. Vernier. Nous en parlions
en retournant à notre cabaret. Nous en parlions, en nous assurant que les
fermetures de la chambre, qui l’enfermait notre trésor, étaient intactes.
Nous voulions faire un tour de ville, et nous revenions, sans y penser, vers
la maison
où
était notre précieux dépôt. « André, je ne pourrai plus dormir. — Ni moi
non plus. Monsieur. Je sens que je perds ma gaieté et ma philosophie. Sénèque
a dit, avec beaucoup de raison, que la richesse est le poison de l’âme.
« —André,
demandons à souper. — Il n’est pas l’heure, Monsieur. — Nous l’attendrons
auprès de nos sacs. » — Monsieur, il faut placer promptement cet argent-là,
ou il nous fera perdre la tête. »
On nous
servit un souper très-passable, et nous ne pûmes manger ni l’un ni l’autre.
« André, va chez le notaire du lieu, et demande-lui s’il y a ici quelque
chose à vendre. — Vous resterez donc auprès de votre argent ? — Oui, et j’ai
l’épée au côté. »
Assis
sur une pile de mes sacs, je récapitulai les événemens de la journée, et
de celles qui l’avaient précédée. Je ne trouvai, dans toute ma conduite,
que l’amour pour Colombe et l’affection pour ma mère. Pas un retour vers
mon patron ; pas une oraison jaculatoire adressée à ce grand saint, et il
était évident qu’il m’avait conduit, par la main, à la fortune. Je le priai
avec ferveur, et je le suppliai de me rendre le repos. Le repos ne vint pas.
Ah, pensai-je, mon patron ne veut pas tout m’accorder. Il faut que je me
souvienne que je ne suis qu’un homme, et un pécheur.
Il était
nuit depuis quelque temps ; je ne voulus pas demander de lumière. On eût
pu l’apercevoir à travers les fentes des volets, et on n’eût pas manqué de
chercher à pénétrer les motifs qui me faisaient avoir de la chandelle à une
heure indue, à neuf heures du soir. D’ailleurs, elle eût pu diriger les entreprises
de notre hôte ; il est facile de brûler la cervelle à un homme, dans
une
chambre éclairée, et Leclerc sait que j’ai de l’argent, beaucoup d’argent
: il nous l’a vu transporter… J’entends du bruit en bas… Il redouble… Je
place mes sacs contre la porte ; je me couche dessus ; il faut qu’on me passe
sur le corps pour me voler. J’ai mon épée nue à la main.
Le bruit
cesse ; mes alarmes se dissipent ; mais André ne revient pas. Où est-il ?
que fait-il ?... Tout a un terme. Mon agitation cessa ; mes paupières s’appesantirent
; je m’endormis enfin. Mon sommeil fut troublé par des songes effrayans.
Je m’éveillai en sursaut, en criant au voleur.
Bientôt
on frappa à ma porte. Je me levai précipitamment, la pointe de mon épée tournée
vers les assaillans. « Qui est là ? — C’est moi, Monsieur, c’est votre hôte,
c’est Leclerc. J’ai entendu, chez vous, un vacarme infernal ; j’ai cru qu’on
y était entré par une fenêtre, et je venais vous défendre. Me tend-il un
piège ? Veut-il m’amener à lui ouvrir ma porte ? « Je rêvais, mon ami, et
je n’ai besoin de rien. — De rien ? Vous n’avez pas soupé, et vous passez,
sur le carreau, une nuit froide, tandis que vous pouviez disposer d’un lit
passable : Je remercie saint Nicolas de n’être pas riche. » Il se retira.
L’absence
d’André me paraissait.inexplicable. Les notaires ne passent pas d’actes au
milieu de la nuit. Lui serait-il arrivé quelque malheur ? Oh, il est, après
Colombe et ma mère, ce que j’ai de plus cher au monde.
Je me
sentais moulu, brisé, et cette nuit me paraissait interminable. Je crus apercevoir
enfin, à travers quelques fentes, les faibles rayons, du jour renaissant.
J’entrouvris un de mes volets : le soleil commençait à dorer le haut des
cheminées. De quel poids insupportable je me sentis soulagé ! La
lumière
dissipa
mes terreurs ; mais elle ne me rendit pas ma sécurité ordinaire.
Je me
sentis prêt à tomber de besoin. Je .fermai soigneusement ma porte, et je
descendis. Leclerc dormait d’un sommeil paisible : il n’avait pas de trésor
à garder.
Je l’éveillai,
et je lui demandai à manger. II s’empressa de me servir ce qu’il avait de
mieux. Il me regardait d’um air de compassion, qui me fit sentir le ridicule
de ma conduite. Je me promis de bannir, sans retour, des terreurs avilissantes.
Le jour d’ailleurs, me rassurait. Je lui demandai s’il pouvait me donner
quelque nouvelle d’André. Il était venu, à huit heures du soir, prendre mon
cheval, et il n’avait pas reparu. Où pouvait-il être allé ?
Je sortis,
et je me tournai souvent vers le modeste cabaret de Leclerc. Je jurai enfin
à mon patron de n’être plus un riche malheureux. Je revenais toujours à lui,
après une crise violente, et je m’en trouvais bien.
J’entrai
dans l’église des filles du Sacré-Cœur. Elles chantaient les matines. Je
m’unis à elles d’intention, et quand l’office fut terminé, je demandai à
voir ma mère. Elle vint à la grille, sans avoir éprouvé d’opposition. Après
les premiers épanchemens, nous nous racontâmes ce qui nous était arrivé depuis
notre séparation : tout est intéressant, entre une mère et son fils. La mienne
était heureuse, quoiqu’elle ne possédât plus rien au monde. J’étais, moi,
le jouet des passions.
Je la
quittai, et je retournai chez Leclerc. Il était dix heures, et André ne paraissait
pas. Mon inquiétude augmentait de moment en moment. Je sortais, je parcourais
les rues, les avenues de la
ville,
je rentrais, je me désolais. Je parlais à Leclerc. Il ne pouvait me rien
dire de satisfaisant. Il cherchait à me consoler. Il parut enfin cet André,
alors l’unique objet de mes alarmes. Il descendit de cheval, et m’embrassa,
en me saluant du titre de seigneur châtelain. « Hé, d’où viens-tu, malheureux,
que j’ai cru perdu ? — Ma foi, Monsieur, j’ai vu que je ne .mangerais et
que je ne dormirais pas plus que vous, et j’ai voulu utiliser le temps. »
Le notaire
d’Étampes n’avait rien à vendre, et l’avait adressé à celui d’Arpajon19. Il était parti, et était arrivé trop tard pour voir
le notaire. Mais il avait passé une bonne nuit : les exhalaisons pestilentielles
de nos sacs ne lui offusquaient plus le cerveau.
À la
pointe du jour, il avait fait lever le garde-notes, et comme il n’entend
rien aux affaires, il s’en était rapporté uniquement à lui. Cent acres d’excellente
terre, nommés le fief de la tour, parce que dans le milieu s’élève une grosse
tour carrée, bâtie du temps des croisades ; une rivière d’eau limpide qui
entoure la forteresse ; des bois, des prés, des terres labourables composent
l’ensemble de cette propriété. Elle rapporte net deux mille livres par an,
et le notaire en a voulu trente mille. « J’en aurais donné, Monsieur, jusqu’à
votre dernier écu, pour que nous n’ayons plus ces vilains sacs sous les yeux.
Le notaire m’a fait signer un acte provisoire, et je lui ai promis que dans
la journée l’affaire serait terminée. — Mais, André, as-tu vu ta tour carrée,
tes bois, les prés, tes terres labourables ? — Non, Monsieur. Tous les notaires
sont des gens pleins d’instruction, de probité, d’honneur et de délicatesse.
Cela pourra changer ; mais en attendant, on peut traiter de confiance avec
eux.

19 Au XVIe siècle Arpajon s’appelait en réalité Châtres (B.G.)
«
Je vais mettre les mules à la voiture ; nous y jetterons vos sacs, et nous
irons nous en débarrasser. Ce qui nous restera ne nous empêchera pas de dormir.
»
J’allai
prendre congé de ma mère, pendant qu’André faisait ses dispositions. Nous
montâmes en voiture, et nous prîmes gaiement le chemin d’Arpajon.
« Mais,
André, que ferons-nous de ta grosse tour carrée ? — Votre habitation. — Je
ne logerai pas Colombe dans une grosse tour carrée. — Pourquoi cela, Monsieur
? Elle y sera en sûreté contre les amis et les ennemis, quand la guerre civile
se rallumera : lorsqu’on a une très-jolie femme, il faut tout prévoir.
— Par
saint Antoine, tu as raison. — On ne pourra pénétrer jusqu’à elle qu’à coups
de canon, et on ne s’amusera pas à canonner une tour isolée, dont les murs
ont, peut-être, quatre pieds d’épaisseur. — Ce serait faire le mal, uniquement
pour le mal. — Et ces voleurs qu’on nomme des conquérans ne le font jamais
sans motif. — Tu as raison, tu as raison, tu as toujours raison. —N’est-il
pas vrai, Monsieur ? »
C’est
une singulière chose que le sentiment de la propriété. Peut-être n’est-il
qu’une espèce d’avarice, qu’on n’a pas assez observée. J’avais tremblé de
perdre mon argent ; l’idée de me trouver propriétaire m’enivrait. Ces deux
sensations étaient exagérées, sans doute, mais l’une et l’autre tenaient
exclusivement à l’amour de moi.
« André,
mon grade de capitaine m’ennoblit. La possession d’un fief, jointe à ce titre,
ne me rend-elle pas gentilhomme ? — Ma foi, Monsieur, je n’en sais rien ;
mais je crois qu’au moins vous pouvez vous, appeler Monsieur de la Tour.
— Hé, ce nom- là résonne agréablement à mon oreille.
«
Nous entrons dans mon château fort par un pont-levis — Qui peut-être n’a
pas été levé depuis un siècle. — Au rez-de- chaussée, nous trouvons l’ancienne
salle des gardes des chevaliers de la Tour. — Nous la coupons en deux parties.
D’un côté sera la cuisine, pièce essentielle, Monsieur. — De l’autre la salle
à manger. Au premier, nous pratiquons un logement gai et commode. —Au second,
logeront votre serviteur, votre jardinier, et votre fille de basse-cour.
— De la plate-forme, je jouis d’une vue superbe, nonchalamment accoudé sur
l’ouverture d’un de mes créneaux.
Je fais
entrer ma petite rivière dans mon jardin. — Un étang reçoit ses eaux. — J’y
mets du poisson. — Je me charge de cela, Monsieur. J’aime beaucoup le poisson.
— Et puis c’est une ressource à la campagne. Je fais percer des allées dans
mon bois. — J’y construis des bancs de gazon, de distance en distance. —
C’est là que je vais chercher, avec Colombe, la fraîcheur et l’amour. »
Nous
entrâmes à Arpajon, en faisant des châteaux en Espagne. Nous descendîmes
chez le notaire ; nous lui délivrâmes nos fonds ; il rédigea le contrat ;
le propriétaire fut mandé ; il signa, et me voilà Monsieur de la Tour.
« André,
allons prendre possession de mon manoir. — Ne perdons pas un instant, Monsieur.
— Mon fermier s’empressera de nous servir à dîner. — Oh, peu de chose, une
soupe au lait, des œufs frais, un dindonneau20,
une salade, et quelques fruits.
— Il nous
couvre à chacun un bon lit, à la ferme ou à la tour : nous en avons grand
besoin. — A notre réveil, je fais venir des

20 Petit anachronisme, si l’on songe
que les poules dindes n’ont été acclimatées en Europe que progressivement
après la découverte des Amériques (B.G.).
journaliers...
— N’es-tu pas un peu ingénieur, André ? — Je suis astronome, Monsieur. —
Quand on peut, comme toi, dessiner le plan de la lune, on n’est pas embarrassé
de faire aligner quelques allées. — Oh, rien ne m’embarrasse, Monsieur. —
Tu dirigeras les travaux.
Bientôt
nous distinguâmes, de loin, cette tour qui flattait si agréablement mon ambition,
et nous lui trouvâmes un aspect imposant. A mesure que nous approchâmes,
elle nous parut un peu dégradée, et nous cherchâmes en vam ces créneaux,
signes de ma puissance.
Nous
arrivâmes enfin, et un rustre, en sabots, nous demanda ce que nous voulions
: c’était mon fermier. André lui présenta notre contrat d’acquisition : il
ne savait pas lire. Il lui en donna communication, et ce manant se mit à
courir, comme si nous étions des épouvantails. Il revint bientôt avec une
vieille canardière et deux pistolets rouillés. Il tira ses trois coups en
l’air ; il s’approcha ensuite, son bonnet de laine à la main ; il m’adressa
un compliment assez mal tourné ; il s’embrouilla deux ou trois fois ; mais
je vis avec plaisir que cet homme se mettait à sa place.
Nous
nous avançâmes vers la tour. Une planche vermoulue avait remplacé le pont-levis
; la salle des gardes était transformée en poulailler ; le premier étage
tenait lieu de grange, et le second était devenu un colombier. Le terrain,
à cent pas à la ronde, était chargé des débris d’un ancien château, et de
décombres, qui s’échappaient successivement du haut de la tour. Je me promis
bien de la faire rétablir : elle était la preuve et la garantie de ma noblesse.
Je ne pouvais trancher du grand seigneur sur ma plate-forme ; je me décidai
à m’humaniser, et nous entrâmes à la ferme. Ma fermière était
crottée
des pieds à la naissance des reins ; quatre enfans barbotaient dans la boue,
avec quelques canards. « André, il me semble que ton notaire, si plein d’honneur
et de délicatesse, a diablement fardé sa marchandise. — Monsieur, il n’a
rien avancé que de vrai. Voilà la tour, les bois, les prairies, la rivière,
et de plus une ferme, dont il n’a pas parlé. Voilà le bail qui soumet votre
fermier à vous payer deux mille livres par an. Que voulez-vous de plus ?
— Une habitation agréable. — Vous l’aurez. On fait tout avec de l’argent,
et sur les dix mille livres que vous a données le maréchal, nous n’avons
dépensé que vingt écus en frais de route. »
Je priai
ma fermière de nous apprêter à dîner. Elle avait porté, le matin, toutes
ses provisions au marché de Corbeil. Il ne lui restait que de vieilles poules,
de vieux canards, de vieux pigeons, et des œufs, qui attendaient l’hiver
sur la paille. « Ma foi, me dit André, il vaut mieux manger des œufs qui
sentent la paille, que de ne pas manger du tout. La mère, faites nous une
omelette. —Monsieur, il ne me reste pas de beurre. — Faites-la à l’huile.
— Je n’ai que celle de not’lampe. — Pouah ! pouah ! il y a de l’eau dans
la rivière ; mettez-en sur le feu, et faites- nous des œufs durs. Voyons
votre pain. Ah, qu’il est noir ! qu’il est sec ! — Je dois cuire demain.
— Cela nous avancera beaucoup. »
Je proposai
à André d’aller visiter ce bois, où je devais fixer l’amour et le bonheur.
Il était tellement obstrué de ronces et de broussailles, qu’un hérisson n’eût
pu y pénétrer. « Quelle chute, lui dis-je ! toutes mes illusions sont détruites.
— Elles renaîtront, Monsieur. »
En mangeant
nos œufs durs, en trempant notre pain noir dans de la piquette, nous parlâmes
du coucher. Thomas n’avait qu’un
mauvais
lit, de six pieds en carré, qu’il partageait avec Catherine, et leurs quatre
marmots. « Ah, mon ami André, quel réveil succède au rêve charmant que nous
faisions il y a trois heures ! — Hé, monsieur, vous commencez toujours par
vous affliger. Je vais vous coucher en grand seigneur. Montons à ce premier
étage, qu’habitaient les anciens chevaliers de la Tour : on doit y respirer
encore un air de noblesse. Je délie cinq à six bottes de paille ; je vous
fais un oreiller de la sacoche qui renferme le reste de votre argent ;
nous nous couchons ; nous dormons profondément, et demain nous verrons.

Tour
carré de Brunehaut à Morigny (détruite peu avant 1819)

Henri
Ier de Lorraine, duc de
Guise
CHAPITRE
XVI
M.
de la Tour fait un voyage à Paris.
Il y
avait, dans la salle des gardes, un grand nombre de poules, et cinq à six
coqs, au moins. Ils se mirent à chanter long-temps avant le jour ; mais nous
dormions depuis sept heures du soir.
« Vous
voyez, Monsieur, me dit André, que vous retrouvez les avantages, dont jouissaient
vos illustres prédécesseurs. Ces gardes-ci n’avertissent pas de l’approche
de l’ennemi ; mais ils annoncent le retour du soleil, c’est quelque chose.
« —
Voyons, mon ami André, ce que nous ferons aujourd’hui.
-
Il faut d’abord nous loger, et assurer nos
moyens de subsistance. — Sans doute. Nos fumées de noblesse sont beaucoup
pour la vanité ; mais elles n’ont rien de substantiel. — Nous louons une
maison à Arpajon. — Tu y établis une bonne cuisinière. — Je fais moi-même
la cuisine au besoin. — Cela ne se peut pas. Tu es mon ami, mon écuyer, et
je ne veux pas que tu déroges. — Diable ! me voilà presque noble, moi ! Et
puis, il
y
aura ici des travaux à suivre, et ce soin-ïà me regarde. D’abord, je fais
démolir la tour. — Et mon nom, étourdi ? — Elle a donné le sien au fief ;
c’est ainsi qu’il est désigné dans tous les actes, et il le conservera. —
A la bonne heure.
«
— Je présume que ces énormes pierres sont liées intérieurement par des attaches
en fer ; toutes les fenêtres sont grillées. — Nous trouverons peut-être des
plombs qui servaient à conduire les eaux… — Vous y voilà, Monsieur. Avec
les débris, nous élevons un monticule... — Sur lequel sera élevée une maison
jolie et commode… — De laquelle vous domine rez l’ensemble de votre domaine.
— Nous la bâtissons avec une partie des matériaux... — Et nous vendons le
surplus pour en payer la façon. C’est bien cela, Monsieur. «
Nous
nous levâmes, avec le soleil. Nous examinâmes la tour dans ses plus grands
détails. Nous jugeâmes qu’il y avait sept à huit maisons dans ces grosses
murailles-là.
Thomas
nous proposa de faire déblayer le bois, si nous voulions lui abandonner les
ronces, les broussailles et leurs racines. C’était pour lui un très-bon marché
; mais j’étais pressé de jouir. Je voulais, d’ailleurs, donner à mon fermier
une haute idée de ma générosité. J’acceptai sa proposition, à condition que
ce travail serait terminé dans quinze jours. Je me proposais de faire élever,
de suite, au milieu des bois, une chapelle à mon patron, qui m’avait toujours
visiblement protégé. C’est là que j’irai prier avec Colombe.
Nous
partîmes pour Arpajon. Nous prîmes Thomas avec nous, pour qu’il ramenât,
au fief, ma voiture et mes bêtes de somme. Le bail ne l’obligeait pas à les
nourrir ; mais un seigneur a incontestablement le droit de fouler un peu
ses vassaux.
Avant
la fin de la journée, nous avions une maison, quelques meubles, et une jolie
cuisinière, qui nous a fait faire deux bons repas. Je représentai à André
qu’il n’était pas nécessaire que j’eusse une jolie cuisinière. Il me répondit
qu’une figure intéressante récrée toujours la vue, et ne coûte pas plus cher
qu’une autre. « André, il n’est qu’une figure qui puisse m’intéresser. —
Moi, Monsieur, je n’ai pas de Colombe. »
Le
lendemain, un maître maçon fut mandé. Nous lui fîmes part de nos projets
; il en trouva l’exécution facile, et peu dispendieuse : on n’a jamais de
discussions avec les ouvriers, que lorsqu’il s’agit de les payer.
Il
nous traça, sur une ardoise, un plan de maison qui me plut beaucoup. Ce qui
me flatta singulièrement, c’est que du milieu d’un toit, en plateforme, devait
s’élever une tour de douze pieds de haut, dont l’architecture serait conforme,
en tout, à celle qui était en usage, dans le bon temps des croisades. Au
sommet, devaient être des créneaux, dans les ouvertures desquels je me proposais
de placer des canons de bois. C’est de-là, qu’avec un porte-voix, je donnerais
des ordres à mon fermier.
La
plate-forme de la maison serait entourée d’une balustrade en fer. C’est là,
que je me dépouillerais de ma grandeur, et que je prendrais l’air avec Colombe.
A
la droite de la maison devaient être un hangard, et une écurie ; à gauche,
mon bûcher et ma basse-cour. Enfin, comme il ne convient pas que l’habitation
d’un misérable laboureur touche à celle de son seigneur, il fut décidé que
la ferme, dont les murs étaient de terre glaise, serait transportée à cent
toises de mon manoir, et rebâtie en pierres de taille : je voulais travailler
pour ma postérité.
Après
avoir arrêté, définitivement, nos plans, il fut question du paiement. Maître
Dubois nous dit qu’il ignorait ce qu’on tirerait de la vieille tour, et cela
était vrai. Il ajouta, selon l’usage, qu’il nous traiterait en conscience,
et que nous n’aurions pas de démêlés. Je lui ordonnai de mettre la main à
l’œuvre, sans délai. Je prenais l’habitude commode de donner des ordres à
tout le monde : j’étais noble, et j’avais de l’argent.
«
Monsieur, nié dit André, vous êtes impatient et désœuvré. Vous vous ennuierez
beaucoup ici. Vous feriez bien d’aller à Paris. — Par saint Antoine, je crois
que tu as raison. »
Je
ne connaissais pas la capitale, et je me promis beaucoup de plaisir à la
visiter. D’ailleurs, j’avais vu, à Blois, le roi et le duc de Guise ; ils
étaient rentrés à Paris, et je me proposais de leur faire une cour assidue.
J’envoyai
prendre mon cheval à la tour. Je fis attacher une valise derrière ; je mis
quelques pièces d’or dans ma bourse ; je laissai à André le surplus de nos
fonds ; je le nommai mon représentant, en présence de Dubois ; je lui recommandai
de faire marcher les travaux avec la plus grande activité ; je l’embrassai,
et je partis.
Quelle
ville magnifique que Paris ! Deux ponts en pierre, pour y entrer ; des maisons
élevées de deux ou trois étages, dont un tiers, au plus, est bâti en bois
; des rues, presque circulaires, qui laissent deviner à l’œil ce qu’il va
voir, et dont la moitié est pavée, celles-là sont balayées tous les quinze
jours ; une majestueuse cathédrale, où l’on arrive en montant dix degrés.
Les savans prétendent qu’autrefois on en montait treize, il paraît que le
terrain s’est exhaussé ; dix couvens d’hommes et de filles, dans chaque quartier,
dont un, rue Saint-Antoine, est
dédié
à mon patron ; une rivière bordée partout de joncs et de roseaux, très-utiles
à ceux qui gagnent leur vie, en faisant des paniers, dont les dames décorent
leur toilette ; jusqu’à quinze ou vingt bateaux, qui approvisionnent journellement
la ville, et qu’on a grand soin de brûler, pendant les guerres civiles, pour
empêcher les ennemis d’entrer à Paris, quand on ne veut pas les y recevoir
; des filoux qui pullulent le soir, ce qui prouve que l’industrie fait tous
les jours des progrès, car on ne vole pas ceux qui n’ont rien ; un guet,
chargé de veiller à la sûreté publique, ce qui est très-beau, et ce qui
n’empêche pas les gens raisonnables de rentrer chez eux à la chute du jour
; enfin des théâtres, pour l’amusement des oisifs, plaisir très-condamnable,
sans doute, mais qui empêche souvent de faire plus mal. Tel est, en gros,
le tableau de Paris.
Le
projet sublime, conçu sous le nom d’Andréades et de Mouchettes, et qui amena
une scène très-vive entre mon écuyer et moi, commençait à s’exécuter. Pour
être voisin de mon patron, je cherchai un logement dans la rue Saint-Antoine,
et j’y trouvai, pour quinze sols par jour, une chambre avec un lit pour moi,
et une place à l’écurie pour mon cheval.
Madame
Mortier se chargea de me bien nourrir, et son mari de traiter et de soigner
mon coursier, en raison de six sols par repas ; mais je devais être nourri
comme un prince, et lui comme Bucéphale. Tout cela était un peu cher ; mais
il faut que tout le monde vive.
Monsieur
Mortier était pourvoyeur, pour la cour, du poisson de mer qu’il allait prendre
à Dieppe, deux fois par semaine. Il avait eu l’heureuse idée de ménager,
sur le devant de sa voiture, trois places pour des amateurs, manière très-agréable
de voyager, pour ceux qui aiment l’odeur de la marée.
Si
André eût été avec moi, il m’eût fait remarquer que les beaux esprits se
rencontrent, et il m’eût exprimé ses regrets d’avoir été prévenu par Mortier.
Je lui aurais fermé la bouche, en lui déclarant que les arts mécaniques sont
au-dessous de monsieur de la Tour et de son écuyer.
Je
m’habillai avec la dernière élégance, pour aller rendre une visite au roi.
Il y avait alors, à Paris, des gens, qui, pour deux sols, vous conduisaient
le soir, d’un bout de la ville à l’autre, un fallot à la main. Il y avait
aussi, aux portes du Louvre, des officieux, qui se chargeaient de tenir les
chevaux et les mules de ceux qui venaient faire leur cour au souverain.
Je
m’avançai, la tête-haute, la poitrine ouverte, et le jarret tendu. Un factionnaire
me demanda ce que je voulais. « Je veux tirer ma révérence au roi. » Il me
rit au nez, et me tourna le dos.
Ah,
pensai-je, si le roi savait que je suis ici, moi, qui ai été admis dans son
cabinet, à qui il a pincé les joues, et qui ai eu l’honneur de lui traduire
la lettre du maréchal de Biron ; s’il savait que je suis noble, et même gentilhomme,
il m’enverrait prendre par un écuyer, et j’aurais l’honneur d approcher et
de saluer le roi. Un misérable factionnaire ose me rire au nez !
Je
tournai mes pas d’un autre côté, et partout je trouvai des gardes qui me
fermaient les passages. Je commençai, à avoir de l’humeur, beaucoup d’humeur,
lorsque la reine Catherine de Médicis descendit les degrés, appuyée sur l’épaule
de son écuyer Davila.
Oh,
celui-là, me dis-je, a vécu, sans façon, avec moi, chez il signor Zanipini,
il m’a quitté assez lestement ; mais il me reconnaîtra, et cela me suffit.
Quelques seigneurs se groupèrent
autour
de la reine Catherine, et son écuyer prit rang à la suite du cortége. J’allai
à lui et je lui pris la main ; cela me paraissait tout simple. Il la dégagea,
me fixa, et recula de quelques pas.
«
Qui êtes-vous ? que voulez-vous ?... Hé, mais.. que je me rappelle… c’est
ce petit » musicien, qui a joué du serpent à la procession des bilboquets,
à Blois. — C’est moi qui vous ai donné le maréchal de Biron, et le comte
de Montbazon. — Vous avez aussi donné le comte au duc de Guise. Avez-vous
encore quelque présent de ce genre-là à nous faire ? — Je ne suis ici, ni
pour donner, ni pour recevoir. — Diable, vous êtes fier ! Que venez-vous
donc faire à la cour ? — Je viens me rappeler au souvenir du roi. — Ah, ah,
ah ! Il est comique ce petit serpent. Apprenez, mon ami, que les plus grands
seigneurs, les ducs de Guise, d’Épernon et de Joyeuse exceptés, n’approchent
le roi que lorsqu’ils sont mandés. Les moines seuls ont le privilège de le
voir, en tout lieu et à toute heure, parce qu’il les aime beaucoup.
Vous n’êtes pas moine, retournez d’où vous êtes venu. »
Tu
retomberas donc toujours, me dis-je, dans ce vilain péché d’orgueil, qui
t’a si souvent égaré ! Qui es-tu, pour prétendre être admis, sans motif,
dans le cabinet du roi, pour oser prendre familièrement la main à l’écuyer
de la reine Catherine ! Oh, que tu mérites bien l’humiliation que tu viens
de subir !
À
l’instant, les fumées, qui m’étaient montées à la tête, se dissipèrent. Mes
idées de noblesse s’évanouirent, et je résolus de n’être plus que l’époux,
l’amant de Colombe. C’était assez pour mon bonheur. Je ne pouvais alors en
désirer d’autre.
Je
remontai à cheval, et je gagnai ma rue Saint-Antoine, en pensant à ma modeste
maison, à mon étang, et à mes bosquets. L’homme perd tout en s’éloignant
de la nature ; c’est une bonne
mère
qui lui ouvre ses bras, quand il est assez sage pour s’en rapprocher.
J’approchais
de la maison de Mortier, entièrement rendu à moi-même. Une troupe de cavaliers
occupait toute la largeur de la rue. Je me rangeai contre le mur, pour la
laisser passer. C’était le duc de Guise, qui venait de passer en revue un
corps de ligueurs sur la place de la Bastille. Il me reconnut, et piqua droit
à moi.
«
Je me souviens très-bien de vous avoir nommé capitaine, il y a quelques mois.
À quelle armée de la ligue êtes-vous attaché ? — Monseigneur, j’ai été employé,
pendant quelques jours, par le général Poussanville ; maintenant je suis
sans emploi. — Mon cher ami, je vous replacerai. Vous êtes jeune, fort, brave
; je veux que vous serviez. Péricard, vous n’oublierez pas cela… À propos,
vous m’avez parlé d’une jeune et jolie femme qui chantait des cantiques,
comme un petit ange, sur la route de la Rochelle à Lusignan. Qu’est-elle
devenue ?
Quelle
différence entre les manières d’un prince, qui descend directement des Carlovingiens,
ainsi qu’il l’a fait imprimer, et celles d’un faquin d’Italien, qui n’est
que l’écuyer d’une étrangère ! Ce prince, qui prouve, à toute 1a France,
que les Valois sont des usurpateurs, m’appelle son cher ami ! Son cher ami
! Il y a de quoi devenir fou ! Je lui racontai comment Colombe m’avait cru
mort ; comment de désespoir, elle s’était jetée dans un couvent ; comment
l’évêque de Limoges lui avait donné les dispenses nécessaires pour prononcer
ses vœux, et comment il avait refusé de me la rendre.
«
Suivez-moi, mon cher ami, me dit le prince, je vais arranger cette affaire-là.
» Son cher ami !
Je
marchai, immédiatement derrière lui. Nous rencontrâmes, dans la rue Saint-Honoré,
Davila, qui allait exercer des chevaux neufs. Il se colla à la première maison
et salua profondément M. de Guise. Il me regarda. J’enfonçai ma toque sur
ma tête, et je portai la main sur la garde de mon épée. Il pâlit.
Le
duc me fit entrer dans son cabinet. Il avait auprès de lui le duc de Mayenne,
son frère, le comte de Brissac, Péricard et Maineville. Je me promis bien
de démêler la véritable disposition des esprits. Il ne fallait que des
mots jetés au hasard pour former mon opinion. Je redevins la Mouche.
M.
de Guise aime beaucoup les aventures. Il me fit raconter celles qui m’étaient
arrivées à Limoges, et plus récemment à Étampes. Je remarquai qu’il n’était
pas toujours à ce que je racontais. Il riait souvent ; mais il réfléchissai
tpar intervalles.
«
La Tour, me dit-il, les évéques et les moines sont des hommes. Ils peuvent
avoir des faiblesses, sans cesser d’être respectables. — Monseigneur, c’est
ce que j’ai toujours pensé.
-
Péricard, il faut ôter Vernier d’Étampes.
— Monseigneur, c’est à ce magistrat que j’ai dû la satisfaction d’embrasser
ma mère. — C’est fort bien, on lui donnera une place avantageuse à l’université.
» Je compris qu’un procureur du roi juste envers tout le monde, même avec
les moines, ne marche pas dans le sens de la ligue, et qu’il peut être dangereux,
pour elle, aux portes de Paris. Je convins intérieurement, que les habitans
d’Étampes, qui avaient souffert l’humiliation des franciscains, n’étaient
que des catholiques tièdes et tolérans, et qu’il leur fallait un procureur
du roi, qui ranimât leur ferveur.
« Péricard,
vous noterez l’évêque de Limoges pour un archevêché. — Comment, Monseigneur,
celui qui m’a ôté ma femme ! — Il vous la rendra. »
Je
sentis que ce prélat maintenait ses diocésains dans la fervente piété, qui
seule fait des élus, et que ses talens le rendaient digne d’une scène plus
vaste.
« J’ai
à me plaindre de monsieur de Biron. Personne ne l’a contraint à m’écrire
une lettre de soumission et de dévouement, et il a pris parti pour le roi
; mais j’ai conservé sa lettre. »
M’y
voilà, pensai-je. Le maréchal est un brave officier, et un grand général.
Le duc de Guise inspirera, contre lui, de la défiance au roi, et l’empêchera
de l’employer, en lui envoyant cette lettre, quand il en sera temps.
Le duc
m’adressa plusieurs questions sur les forces de la ligue, dans les provinces
que j’avais parcourues, et sur les desseins qu’on pouvait attribuer aux huguenots.
Je dois, me dis- je, l’accueil, que me fait ce prince, au désir d’acquérir
des lumières propres à diriger sa conduite ; mais que m’importent ses vues
particulières, s’il me rend ma Colombe, l’objet de mes vœux les plus chers
?
La conversation
devint générale, et on cessa de s’occuper de moi. J’aurais ramené de suite
le duc à sa promesse, si je n’avais espéré découvrir encore quelque chose,
En effet, je crus entrevoir qu’on tramait quelque coup décisif. Peut-être
pensait- on à enfermer le roi dans un cloître. Il me parut constant que le
duc, malgré sa prudence et sa pénétration, était entraîné par les chefs de
son parti ; qu’on lui faisait prendre, chaque jour, des mesures, qui ne s’accordaient
pas avec son plan général, et que de là, naissaient ces hésitations apparentes,
que lui reprochaient ses principaux officiers.
Je
profitai d’un moment de silence pour prononcer le nom de Colombe. « Il a
raison, s’écria le duc. Péricard, vous irez demain de bonne heure chez le
légat, et vous lui raconterez ce qui s’est passé au couvent des filles de
Saint-Augustin de Limoges. Vous lui ferez sentir que celui qui représente
ici le pape dans les affaires temporelles, peut être aussi son représentant
dans les choses spirituelles. Vous le prierez de vous expédier, sans délai,
une bulle qui annulle les vœux de Colombe. J’étais assis dans un coin du
cabinet. D’un saut, je tombai aux pieds du duc de Guise, et je les pressai
dans mes bras.
« Péricard,
si le légat résiste, vous lui représenterez, qu’en sa qualité de cardinal,
il est fort au-dessus d’un évêque. Que, d’ailleurs, celui de Limoges ne fera
entendre aucune plainte, parce qu’il saura que je le présenterai pour le
premier archevêché vacant. Vous ferez cette lettre, Péricard, et la Tour
la lui remettra. Enfin, si le légat ne se rend point à ces raisons- là, vous
lui direz que je le veux.
« La
Tour, vous viendrez demain à midi, prendre vos dépêches. Vous observerez,
soigneusement, sur la route, tout ce qui aura rapport aux affaires politiques,
et vous m’en rendrez compte. Allez. »
L’austère
piété du roi m’avait fait fermer les yeux sur ses mignons, son bilboquet
et ses petits chiens. Je m’étais attaché à lui irrévocablement : je le croyais
du moins. Mais comment résister à un prince qui m’appelle son cher ami, et
qui me rend Colombe, Colombe que je ne cessais d’adorer, sans espoir de la
revoir jamais, Colombe qui va répandre sur ma vie des torrens de félicité
? je devins guisard, et je sentis que je l’étais sans retour.
«
On me la rend, on me la rend, criai-je à madame Mortier, en lui prenant la
tête à deux mains, et en l’embrassant de toutes mes forces. — Qui donc, Monsieur
? — Hé, ma Colombe. — Qu’est-ce que cette Colombe ? Je lui racontai ce qui
venait de se passer chez le duc de Guise.
De ce
moment, j’oubliai André, ma vieille tour et ma noblesse. J’étais tout à l’amour,
et à l’avenir qu’il me promettait. Madame Mortier me servit un joli dîner.
A peine, le regardai-je.
Un jeune
homme, dans ma position, tient difficilement en place. Je me levai, je sortis,
et je marchai au hasard par la ville.
Je commençais,
à me fatiguer, lorsque je vis un certain nombre de personnes rassemblées
devant, une maison, assez vaste. C’était l’hôtel de, Bourgogne. Il était
deux heures, et la comédie italienne allait commencer. Je pensai qu’il valait
autant me reposer là qu’ailleurs. On me dit à la porte que tout était plein,
excepté le parterre. Je donnai mes quatre sous, et j’entrai.
Je ne
concevais, pas comment les places les moins chères étaient les moins garnies.
Je sus bientôt à quoi m’en tenir. Arlequin, Pantalon, le Docteur et Argentine
m’ennuyèrent complètement : je n’entendais rien à leur baragouin. Je compris
que le peuple veut avoir du plaisir pour son argent.
Je portai
les yeux dans les régions élevées de la salle. Je remarquai, sur la plupart
des physionomies, un air d’incertitude qui me fit juger que ces gens-là n’entendaient
pas l’italien ; je surpris même quelques bâillemens. Que viennent-ils faire
là… ? ah, je vois ce que c’est. Ce théâtre est soutenu par la cour, et il
est du bon ton de venir s’y ennuyer.
J’étais
las en y entrant, et j’y étais debout. La fatigue et le dégoût m’en chassèrent.
Il fallait
cependant employer à quelque chose le reste de ma soirée. Je me fis conduire
au collège de Boncours, où on jouait la Cléopâtre captive, de Jodelle. Je
craignais de n’y pas trouver de place ; il y avait à peine cent personnes,
et je fus commodément assis. Jodelle est, sans contredit, le premier poète
tragique français, et je marquai à un monsieur, près de qui j’étais, mon
étonnement de ce que ses chefs-d’œuvre ne fussent pas plus suivis. « Tout
le monde, me dit-il, sait les belles choses par cœur, et on finit par se
lasser de tout. Le Français, d’ailleurs, aime la nouveauté, et il court voir
des niaiseries, que condamne le bon goût. Ceux que vous voyez ici sont tous
passionnés pour la belle et bonne littérature. Là, vis-à-vis de vous, est
le vieux et célèbre Rémi Belleau. Il a écrit des pastorales, dignes des églogues
de Virgile. Sa traduction d’Anacréon est aussi estimée que l’original. Il
est membre de la pléiade française, espèce d’académie, composée de sept poètes,
fondée par Ronsard, sur le modèle de celle qu’institua Charlemagne. Il
assiste à toutes les représentations des sublimes tragédies de Jodelle, pour
qui il conserve la plus grande vénération.
On venait
de finir Joseph vendu par ses frères, lorsque je me plaçai. Il était, par
conséquent, inutile que je demandasse à mon voisin ce qu’il en pensait. Mais
j’avoue que je ressemblais un peu à ces gens qui admirent sur parole, et
qui sont certains de n’être jamais contredits, puisqu’ils partagent l’exaltation
générale. Je n’avais que des idées très-confuses de Jodelle ; je fis tomber
la conversation sur cet admirable poète, avec assez d’adresse pour ne pas
compromettre mon amour-propre.
J’appris
qu’Etienne Jodelle, sieur de Limodin, naquit à Paris en 1532. Il fut le premier
poète français qui nous donna une tragédie. Sa Cléopâtre captive eut un succès
prodigieux, et lui valut l’honneur d’être reçu membre de la pléïade française.
Sa Didon et sa comédie d’Eugène parurent ensuite, et réussirent également.
Safacilité était telle, qu’aucune de ses pièces de théâtre ne lui coûta plus
de dix matinées de travail.
Il écrivit
des sonnets, des chansons, des odes, des élégies. Il fit des vers latins,
que les docteurs de l’université admiraient encore, à l’époque où je fus
voir sa Cléopâtre.
Il jouit,
pendant sa vie, d’une reputation colossale, et la postérité a confirmée jugement
de ses contemporains. Henri II l’estimait beaucoup, et paraissait disposé
à lui faire du bien. Mais il est rare qu’un homme de génie s’abaisse jusqu’à
faire sa cour aux grands. Jodelle vécut dans les plaisirs, et mourut pauvre,
en 1573. Il était âgé de quarante et un ans.
Le moment
désiré arriva enfin ; la pièce commença. J’étais tout yeux et tout oreilles.
Quand ceux qui étaient chargés des rôlets déclamaient un vers marquant, mon
voisin me donnait un coup de genou, pour m’en faire remarquer la beauté.
Cette précaution était fort inutile : je reconnus que j’avais, connue lui,
de l’âme et de l’imagination.
Je sentis,
avec une satisfaction inexprimable, que Jodelle s’était formé à la lecture
des anciens : chacun de ses actes se termine par un chœur. Je suis musicien,
et je les trouvai assez mal chantés, quoiqu’ils charmassent mon voisin. Mais
les chanteurs se donnaient la peine de prononcer très-distinctement, et je
ne perdais pas un mot : c’est tout ce que je désirais.
J’éprouvais
souvent un enthousiasme que je ne pouvais maîtriser, et qui m’eût fait paraître
ridicule, s’il n’eût été partagé par tous ceux qui jouissaient de ce chef-d’œuvre.
Au cinquième acte, lorsque l’actrice qui représentait Cléopâtre prononça
les vers suivans, des transports, des cris, des trëpignemens me firent croire
que la salle allait s’abîmer. Je les ai retenus ces vers : malheur à quiconque
les a entendus une fois, et a pu les oublier !
Icy sont
deux amans, qui heureux en leur vie D’heur, d’honneur, de liesse ont leur
âme assouvie, Mais enfin tel malheur on les vit encourir,
Que le bonheur
des deux fut bientôt de mourir.
Quelle
idée sublime de faire faire à l’héroïne son épitaphe sur la scène ! Sophocle
et Euripide n’ont rien imaginé qu’on puisse comparer à ce trait de génie,
et les successeurs de Jodelle n’approcheront jamais de lui.
Cléopâtre
continue :
Reçoy, reçoy
moi donc, avant que César parte,
Que plustôst
mon esprit, que mon bonheur s’écarte, Car entre tout le mal, peine, douleur,
encombre, Soupirs, regrets, soucis, que j’ai soufferts sans nombre, J’estime
le plus grief, ce bien petit de temps
Que de toi,
ô Antoine, éloigner je me sens.
À la
fin de la pièce, l’actrice fut écrasée d’applaudissemens. Elle en marqua
sa reconnaissance au public, en lui débitant d’elle-même, et sans y être
invitée, le fameux monologue de Didon, autre chef-d’œuvre de Jodelle, qu’on
redemande toujours à grands cris, quand on joue cette tragédie.
Dieux
! qu’ai-je soupçonné ! dieux, grands dieux, qu’ai-je Mais qu’ai-je de mes
yeux moi-même — apperceu? [sceu ? Veut donc ce desloyal avec ses mains traistesses,
Mon honneur,
mes bienfaits, son honneur, ses promesses Donner pour proie aux vents ? je
sens, je sens glacer Mon sang, mon cœur, ma voix, ma force et mon penser
Las, amour, que deviens-je, et quelle aspre furie
Se vient
planter au but de ma trompeuse vie ? Trompeuse, qui flattait mon aveugle
raison Pour enfin l’estouffer d’un étrange poison !
Est-ce
ainsi que le ciel nos fortunes balence ?
Est-ce ainsi
qu’un bienfait le bienfait récompense ? Est-ce ainsi que la foi tient l’amour
arresté ?
Plus de
grâce a l’amour, moins il a de seur’té. Ô trop fresle espérance ! ô cruelle
journée !
Ô
trop légère Élise ! ô trop parjure Énée !
Je sortis
du théâtre, pénétré d’impressions si vives, si entraînantes, que je ne les
oublierai de ma vie.
Je soupai
de grand appétit, et en soupant. je récitai les vers admirables de Jodelle.
Je cherchai à prendre les inflexions de vois de l’actrice, qui avait entraîné
tous les spectateurs. Madame Mortier était arrêtée devant moi, et m’écoutait
avec ravissement. Tel est l’empire du vrai beau ; il séduit, il subjugue
jusqu’à ceux qui paraissent le moins faits pour le sentir. Oui, Jodelle est
le plus grand poète qui ait paru, et qui paraîtra jamais.
Je me
couchai, en répétant ces vers sublimes. Je m’endormis, en pensant à Colombe,
à Cléopâtre, et à Didon.
En
m’éveillant, je me trouvai assez tranquille pour récapituler les événemens
de la veille. Grand saint Antoine, pardonnez-moi de ne vous avoir pas donné
un moment dans la journée. Je suis tombé, comme un païen, aux pieds du duc
de Guise ; c’est devant votre image que je devais me prosterner ; c’est à
vous seul que je dois tout ce qui m’est arrivé d’heureux ; c’est vous qui
avez inspiré au duc de Guise l’idée de faire relever Colombe de ses vœux.
Soyez béni à jamais.
On sent
bien que je fus de la plus grande exactitude au rendez- vous que m’avait
donné le duc de Guise. M. Péricard me fit lire l’ordre qui rendait Colombe
à la liberté. La lettre de monseigneur à l’évêque de Limoges était déjà cachetée.
Je pris les deux pièces, et je m’écriai, en sortant, que le duc de Guise
était le plus grand homme qui eût jamais paru en France, et qu’il était digne
de là couronne. Péricard sourit.
Je courus
à la rue Saint-Antoine ; je sautai sur mon cheval, et j’arrivai à Arpajon
d’un temps de galop. Je ne trouvai chez nous que la jolie cuisinière. André
était à la tour, avec maître Dubois, et une douzaine d’ouvriers. Je poussai
jusques-là.
« Mon
ami, lui criai-je de loin, il n’est plus question d’assiéger Limoges, de
forcer le couvent des filles de Saint- Augustin, et d’enlever Colombe. J’ai
dans mon escarcelle la bulle du légat, qui la relève de ses vœux. — Monsieur,
nous avons déjà trouvé, entre les ruines de la plate-forme de la tour et
la voûte qui termine le second étage…. — II s’agit bien de cela.
— Du
fer et un commencement de conduits en plomb… — Colombe ! Colombe ! — Qui
me donnent l’espérance que votre fief ne vous coûtera pas cher. »
Je
sautai à terre, et j’embrassai André avec une ardeur, une force !... Il ne
cessait de me parler fer et plomb ; je ne me lassais pas de répéter le doux
nom de Colombe. « Hé, que diable, Monsieur, il me semble que vous pouvez
bien donner un quart-d’heure à vos affaires. — Je n’en ai qu’une ; je n’en
peux plus avoir qu’une. — Toujours dans les extrêmes ! Cette tête-là ne mûrira
donc jamais ! » Je consentis à l’écouter, pour qu’il m’écoutât à son tour.
Il avait
fait des spéculations à perte de vue. Il comptait les quintaux de fer et
de plomb, les toises de magnifiques pierres qu’on tirerait de la tour. Il
calculait l’argent que tout cela produirait. Il voyait clairement que non-seulement
les bâtimens qu’on allait élever ne coûteraient rien, mais, qu’il entrerait
dans ma caisse douze ou quinze mille livres. Je bâillais de temps en temps,
et alors André fronçait le sourcil.
« Ne
te fâche pas, mon ami. Tu sais qu’il y a trois sortes de bâillemens, et il
y a long-temps que j’ai déjeuné. — Retournez à Arpajon. Claire est toujours
en mesure, et elle ne vous laissera manquer de rien. — Tu ne viens pas avec
moi. — Oh, moi, j’ai tant de choses à faire ! Je compte, et je fais ranger
tous les matériaux qu’on descend de là haut. Le seul moyen de n’être pas
trompé par ses ouvriers, c’est de les suivre soi-même. Maître Dubois m’a
répondu de ceux-ci, et ils voient que j’inscris jusqu’à un clou ; mais cela
ne me dispense pas de les surveiller. Ils se reposeront de deux à trois heures
; alors j’irai vous retrouver.
Claire
est non-seulement une jolie fille, c’est une petite personne d’un ordre et
d’une propreté, qu’on rencontre rarement dans une domestique. Notre maison,
bornée et fort simple, avait l’air de quelque chose. Elle me servit un petit
dîner,
qui me confirma dans la haute opinion que j’avais de ses talens en cuisine.
Elle
allait, venait, et était à tout. Elle semblait deviner ce qu’il me fallait.
Je ne disais pas un mot, et j’étais servi à la minute. Claire, en revanche,
parlait beaucoup. On devine aisément de quel objet j’étais occupé. Le caquet
de Claire ne pouvait me donner de distractions, et l’accueil distingué que
j’avais reçu du duc de Guise avait reproduit toutes mes idées de grandeur.
Cependant je pensai qu’un gentilhomme ne déroge pas en causant avec une femme,
quelle qu’elle soit, surtout lorsqu’elle est jolie : un roi de France a bien
daigné danser avec la belle- mère d’André. Je voulus sauver à Claire le désagrément
de parler seule. D’ailleurs, il n’a été donné qu’à Jodelle de faire d’cxcellens
monologues.
Je commençai,
selon l’usage, par lui parler de la pluie et du beau temps. Elle valait à
elle seule, tous les astrologues de Catherine de Médicis. Elle raisonnait
sur l’influence de la lune, comme si elle y fut née. Hé, mais, pensais-je,
André lui ferait-il faire un cours d’astronomie ?
Elle
me raconta assez longuement, qu’elle était née à Paris, il y avait vingt
ans, d’une marchande de poisson et d’un porte- faix ; que son père battait
sa mère, et que peu d’années après sa naissance, sa manie de battre s’étendit
jusqu’à elle ; qu’ayant jugé un jour que M. son père avait porté la correction
trop loin, elle avait quitté le toit paternel ; qu’elle avait trouvé ouverte
la cuisine de Bussy-Leclerc, alors maître en fait d’armes, aujourd’hui procureur
au parlement ; qu’attirée par l’odeur agaçante d’un rôti, elle était allée
s’asseoir auprès du foyer, et que la cuisinière l’avait chargée du soin de
tourner la broche ; que Bussy-Leclerc l’avait trouvée gentille, et l’avait
reçue au
nombre
des commensaux de sa maison ; qu’elle avait grandi sous les yeux de Jacqueline,
qui lui apprit tous les secrets de la cuisine ; que le vieux Bussy-Leclerc,
qui avait des conférences continuelles avec le vieil Espagnol Sanchez, cabaretier
d’une haute distinction, s’était grisé avec lui, il y avait trois jours,
et s’avisa de dire, pour la première fois à Claire, qu’elle était charmante
; qu’il se donna avec elle certaines licences, que Jacqueline prit en mauvaise
part ; qu’elle l’avait mise à la porte par les oreilles, lui avait jeté son
paquet par la fenêtre, et lui avait crié que si elle la rencontrait dans
Paris, elle lui casserait un bras ; qu’enfin elle avait marché au hasard,
et s’était trouvée à Arpajon, où M. André l’avait prise à son service. Pendant
qu’elle racontait, je tournais et retournais, dans mes mains, la lettre du
duc de Guise à l’évêque de Limoges… Au révérendissime de Mellac, évêque de
Limoges. J’avais remarqué que le duc ne faisait rien, sans motifs personnels,
et la réflexion me fit trouver, alors, un peu extraordinaires, les marques
de bienveillance qu’il m’avait accordées. Je sentis, malgré l’opinion que
j’avais dé mon mérite, qu’elles avaient pu être l’effet de vues particulières.
Qu’attendait-il de moi ? Qu’écrivait-il au révérendissime ?
Les
doigts me démangeaient d’une étrange manière. J’examinais cette lettre dans
tous les sens ; elle était si bien fermée qu’il était impossible de distinguer
un mot de l’intérieur. Un énorme cachet, en cire, portait les armes de la
maison de Lorraine, et je n’étais pas assez audacieux pour le rompre. Comment,
d’ailleurs, remettre cette lettre à M. de Mellac, avec un sceau, dont l’altération
attesterait mon infidélité.
Non,
non, me dis-je, je ne trahirai pas la confiance d’un prince, qui m’a appelé
son cher ami, et sa lettre arrivera intacte à Limoges.
Cependant
mes yeux étaient constamment fixés sur ce cachet. Son épaisseur me donna
une idée assez lumineuse… Cette lettre, pensais-je, ne parle que de moi,
ne peut parler que de moi, et il est bien naturel, qu’avant de la présenter,
j’en connaisse le contenu. Je fis chauffer légèrement la lame d’un couteau,
et j’allais l’appliquer à la partie inférieure du sceau… Ma main tremblait.
J’étais agité par la curiosité, et la crainte de faire une mauvaise action…
La curiosité l’emporta.
J’enlevai
le cachet avec une adresse digne de ces gens qu’on emploie à ouvrir des lettres
interceptées, qu’on lit, qu’ils referment, qu’on fait parvenir ensuite à
leur destination, ou qu’on supprime selon les circonstances.
Celle
du duc de Guise est déployée ; elle est là, devant moi. Je la parcours d’abord
rapidement ; je la lis ensuite avec réflexion ; j’en pèse tous les mots.
« Mon
cher Mellac, vous avez rendu des services essentiels à la ligue, et je n’ai
pas encore trouvé l’occasion de vous en récompenser. Je crois que je ne l’attendrai
pas long-temps.
« L’archevêque
de Lyon, d’Espignac, est un misérable, perdu de débauches de toute espèce.
La publicité de son libertinage, sa gourmandise, nuiraient essentiellement
à nos affaires, si le peuple pouvait voir autre chose en lui qu’un prêtre.
Il tombe à genoux, pour recevoir la bénédiction d’un drôle, qui sort du lit
de sa sœur ou de sa belle-sœur, et qui souvent est gorgé de vin. Ses excès
le conduisent rapidement au tombeau.
«
Personnen’est plus digne que vous, mon cher Mellac, d’occuper le siège de
Lyon. Vous avez toutes les apparences d’une austère piété, le genre d’éloquence
propre à faire des fanatiques, et si vous aimez le plaisir, vous vous renfermez
dans le cercle que vous tracent votre état et les bienséances. Vous pouvez
compter sur moi.
« Je
vous renvoie un jeune homme que voas avez cru fou, et qui ne l’est que d’amour
et de dévotion. C’est un de ces êtres, aveugles et de bonne foi, qui sont
propres à souffler, dans les basses classes, les fureurs de la ligue, quand
ils sont bien dirigés. Vous sauvez qu’il n’est pas de levier qu’on doive
dédaigner. J’emploierai celui-ci à Paris.
« II
fautd’abord le guérir d’un amour qui lui tourne la tête. Rendez-lui sa Colombe
: vous y êtes autorisé par le légat. Dans peu de temps, la Mouche, la Moucherie,
la Tour ne verra plus qu’une femme fort ordinaire dans la sienne, et il sera
tout à nous.
« Adieu,
Mellac, je vous embrasse. »
J’étais
furieux, quand André rentra. « Poussanville avait bien raison, m’écriai-je
! la Religion et le peuple ne sont que des instrumens pour les princes. —
Tenez-vous à l’écart, et vous ne serez l’instrument de personne. — André,
si je n’étais idolâtre de Colombe, je me ferais hermite. — Nous serions deux,
car il faut avoir quelqu’un qui nous écoute et nous réponde. — Nous nous
retirerions dans un bois, ou sur la cîme d’une roche escarpée. — Et nous
y passerions le reste de notre vie à dire le chapelet… — Et à prier mon patron
pour la conversion du genre humain. — Cependant, Monsieur, nous pourrions
trouver ce genre de vie là un peu uniforme, et l’uniformité
fatigue.
Croyez-moi, faisons-nous hermites à la tour, et que votre Colombe anime notre
hermitage. — Oh, ce que nous venons de dire ne se réalisera pas. — Je l’espère,
Monsieur.
« —
Et ce duc de Guise, avec quel mépris il me traite ! — Ses expressions sont
offensantes ; mais c’est un très-grand seigneur.
-
Ne suis-je pas un homme ? — Prouvez-le. —
Et comment !
-
En suivant le conseil que vous donna M. de
Poussanville, à la Rochelle : prends les hommes comme ils sont.
« —
Je prouverai au duc de Guise que je ne suis pas un lévrier aveugle. Je n’aurai
plus rien de commun avec lui. — Et vous aurez raison. — Un homme qui ose
calomnier mon cœur ; qui présume que, dans quelque temps, Colombe ne sera
plus pour moi qu’une femme fort ordinaire ! Quelle indignité ! — Monsieur,
plus d’une jolie femme a promptement cessé de l’être aux yeux de son mari.
— Monsieur André, ces femmes-là n’étaient pas des Colombe.
« Pour
rompre toute relation avec le duc de Guise, je vais lui renvoyer mon brevet
de capitaine. — Gardez vous-en bien. Il ne vous gêne pas dans votre escarcelle,
et vous serez peut-être trop heureux de l’y retrouver plus tard : qui diable
peut lire dans l’avenir ? Et puis, si le duc de Guise, piqué de votre démarche,
expédiait à M. de Mellac, un courrier qui arrivât avant vous, et que le prélat
fît continuer votre Colombe à chanter comme un petit ange, chez les filles
de Saint-Augustin ; hem ! — Tu me fais frémir !
« —
Commencez par remettre le sceau du duc de Guise où il était. — Tu as raison.
— Hé bien, que faites-vous donc ? vous allez le noircir au feu de la cuisine
? — Tu as raison, toujours
raison.
— Ma petite Claire, une tasse, de l’eau-de-vie dedans, et un papier allumé.
»
Le cachet
fut replacé plus promptement, plus facilement qu’il n’avait été enlevé, et
nous recommençâmes à faire les gens à projets. André était tout entier à
ses bâtimens, et moi à Limoges. Je lui notifiai que nous partirions le lendemain
matin, et que nous irions à marches forcées. « Monsieur, vous partirez seul.
— Pourquoi cela, Monsieur ? — D’après la tournure que prennent les choses,
vous n’aurez pas d’extravagances à faire, et je ne vous serais bon à rien.
— Et ta conversation, toujours si attachante, et quelquefois si instructive
? — Ma conversation ne vaut pas quatre ou cinq mille livres, qu’on vous volera,
si je m’absente, et que je vous conserverai pendant que vous ferez l’amour.
»
Je me
décidai à partir seul, avec ma voiture et mes deux mules. Ce moyen n’était
pas très-expéditif ; mais je voulais que Colombe voyageât commodément. Je
m’endormis, en prononçant son nom ; André en calculant ce que valaient les
pierres, le fer et le plomb, qu’on avait déjà extraits de la vieille tour.

Moulin
étampois (gravure de Sarazin)
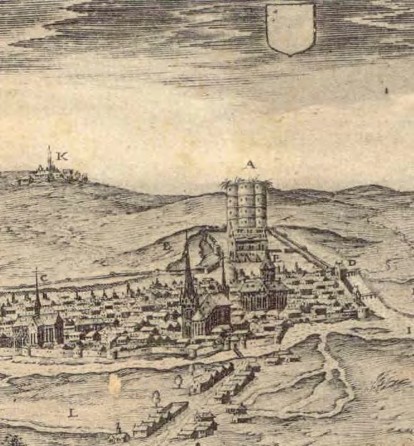
Étampes
à la fin du XVIe siècle
CHAPITRE
XVII
Second
voyage à Limoges.
Je montai
dans ma voiture, à la pointe du jour. J’avais de l’or, pour les frais de
la route, et pour habiller Colombe en femme de condition ; mon épée et deux
pistolets pour ma défense, et l’image de la bien-aimée pour charmer la longueur
du voyage.
Je m’arrêtai
à Étampes, pour voir encore ma mère. Elle ne m’attendait pas, et je lui procurai
une nouvelle jouissance. J’avais les plus grandes obligations à M. Vernier,
et je savais ce qui se tramait contre lui.
Je lui
rendis une visite, et je lui répétai exactement ce que j’avais entendu dire
au duc de Guise. « Je n’ai aucun moyen de résistance, me dit-il, et le chancelier
ne voudra pas désobliger les princes Lorrains, en soutenant le procureur
du roi d’un petit bailliage. Je serai sacrifié.
« Je
serai remplacé par quelque fanatique qui appuiera la persécution que les
Franciscains renouvellent contre votre mère.
Vous
avez voulu me rendre un bon office ; je vous marquerai ma reconnaissance
en faisant transférer la sœur Madeleine dans le couvent des filles du Sacré-Cœur
de Paris. Cet acte d’autorité accélérera ma chute. Mais puisqu’elle est inévitable,
il importe peu qu’elle arrive plus tôt ou plus tard. »
Nous
nous quittâmes, comme devaient le faire des hommes qui s’estiment et qui
s’aiment. Je me félicitai de n’avroir pas perdu un mot de ce qu’avait dit
le duc, et je me promis bien de ne jamais laisser échapper l’occasion devoir
et d’écouter.
Je suivais
la route qui m’avait conduit de Saint-Junien à Paris. Je retrouvai, dans
chaque ville, le cabaretier qui m’avait reçu ; j’étais partout libre comme
chez moi, et je m’arrêtais peu aux privations que m’imposait la nécessité.
Pendant
que je marchais, je répétais quelques-uns des cantiques de Colombe : je les
savais tous par cœur. Je cherchais à prendre son ton, à imiter les inflexions
de sa voix, et je croyais l’entendre chanter. Je pensais, avec transport,
au moment de notre réunion, et j’étais heureux.
Un autre
jour, je m’occupais d’exercices de piété. Je composais, pour mon patron,
des oraisons jaculatoires ; je lui demandais la conservation de Colombe,
et l’extermination des huguenots. Je formais des vœux ardens pour que les
princes et le haut clergé revinssent aux véritables sentimens de piété, qu’ils
jouaient avec impudeur, et qui devaient animer tous les Français.
Les
journées ne se succédaient pas au gré de mon impatience. Cependant j’avançais
vers cette ville, qui renfermait l’objet du
plus
tendre amour. J’entrai à Argenton. Le surlendemain je devais être à Limoges.
En longeant
les rues d’Argenton, je remarquai un grand nombre de ligueurs armés, disséminés
dans les différens quartiers de la ville. Que faisaientils là ? Argenton
n’est pas une place forte ; ils ne devaient donc qu’y passer. Où allaient-ils,
lorsque rien ne paraissait encore devoir troubler la paix, dans ces cantons
?
Je mis
ma voiture et mes mules dans le cabaret où j’avais logé, en allant de Saint-Junien
à Étampes, et je parcourus la ville. Les ligueurs étaient dans l’abondance
; ainsi ils n’étaient redoutables pour personne. Le soldat qui vit bien est
toujours gai, et il est facile de faire jaser des gens de bonne humeur.
Ils
étaient trois mille. Ils venaient du camp qu’avait occupé le maréchal de
Biron, près de Poitiers, et ils ne savaient où on les conduisait. Je continuai
ma promenade, et je vis, sur une espèce de place, un officier supérieur qui
paraissait donner des ordres. C’était bien le moment d’écouter, et je m’approchai.
Me trompé-je
?... est-ce bien lui ?... mais non… hé, oui, oui… par mon patron, c’est lui-même.
Je m’élançai, et je tombai dans les bras de Poussanville.
On juge
aisément du plaisir que nous eûmes à nous revoir. Notre reconnaissance fut
digne du pinceau de Jodelle ; mais son génie était enfermé dans la tombe.
Poussanville me conduisit à son logement. On sait que jamais il ne manquait
de rien : nous soupâmes tête-à-tête, et nous soupâmes bien. Nous nous racontâmes
ce qui nous était arrivé, depuis notre séparation, en sablant d’excellent
vin vieux de la Loire.
Quand
j’eus terminé mon récit, il me félicita sur l’état actuel de ma fortune ;
mais il ajouta que je ne serais jamais un personnage marquant, parce que
l’ambition n’est qu’une passion d’accès, quand elle est surbordonnée à l’amour.
Il chercha à me prouver, par des exemples, qu’elle doit être dominante, exclusive,
et que l’amour doit être simplement le délassement des grands travaux, qui
conduisent à la célébrité. Je consentis, très-volontiers, à n’être que l’amant
de Colombe, et le sort des héros qu’il me cita, me parut fort au-dessous
du mien.
Il me
raconta ensuite comment de Poitiers, il était venu à Argenton. Il recevait
souvent des ordres du duc de Guise, qui tous tendaient à bien connaître les
forces de la ligue, dans les provinces de l’Ouest, et à en rendre un compte
exact à ses émissaires. Il lui était expressément enjoint de sonder partout
la disposition des esprits, relativement à Henri III, et de s’efforcer de
le faire haïr, autant qu’il était méprisé. Ainsi Poussanville semblait tourner
sur lui-même, et marcher au hasard. Il avait cependant un but déterminé.
La plupart
des émissaires du duc étaient des hommes obscurs, de qui Poussanville ne
pouvait rien apprendre sur la véritable position des affaires. Il était cependant
dans son intérêt personnel d’en être instruit. Le capitaine Saint-Paul, un
des officiers favoris du duc, fit un voyage à Bellac, pour ses affaires particulières,
et il lui fut expressément recommandé de voir Poussanville en passant.
Saint-Paul
était assez borné ; mais il était vain, très-vain, presqu’autant que son
maître. Il suffit à mon ami, pour le faire parler, de paraître douter qu’il
fût, en effet, dans les bonnes grâces de M. de Guise. Saint-Paul, piqué,
prouva la réalité de sa
faveur,
en racontant ce qu’il savait, et peut-être ce qu’il ne savait pas.
La Belgique
et la Hollande étaient insurgées contre le roi d’Espagne. La noblesse belge
se donna au duc d’Anjou, frère du roi, et le duc de Guise consentit à ce
qu’il se rendît à Bruxelles à la tête de douze mille protestans : c’était
affaiblir le parti calviniste en France. Il avait subjugué son souverain,
au point de le contraindre à exiger, des huguenots, la restitution des places
fortes qu’il leur avait abandonnées par le traité de Bergerac : c’était leur
déclarer indirectement la guerre. Mais la paix ne convenait ni à Grégoire
XIII, ni à Philippe II, ni surtout au duc de Guise. Poussés tous trois par
des intérêts différens, ils sentaient également que leurs projets ne pouvaient
réussir qu’à l’aide de troubles, sans cesse renaissans.
La reine
Louise de Vaudemont priait beaucoup, et ne se mêlait de rien ; le roi dansait,
ou se donnait la discipline ; Catherine de Médicis connaissait seule la véritable
situation des affaires, et voyait la couronne chanceler sur la tête de son
fils.
Elle
fit dire au roi de Navarre qu’il se gardât bien de rendre ses places de garantie,
et que son parti n’avait de salut à attendre que de la force des armes.
Pendant
que je causais avec Poussanville, un courrier lui apporta l’ordre de se rendre,
à marches forcées, à Cahors, et de s’enfermer dans cette place, avec ses
troupes. Le brave Vérins y commandait ; mais il manquait de forces.
L’actif
et intrépide Poussanville me donna une dernière leçon, sur la manière dont
je devais me conduire avec ceux dont la piété n’était qu’extérieure, et
notamment avec l’évêque de
Limoges.
Ses observations étaient dictées par l’égoïsme, règle unique de sa conduite
; mais je sentis qu’il fallait reconquérir Colombe, et je lui promis sincèrement
de suivre ses conseils. Il m’embrassa, m’offrit son lit, et il sortit pour
faire ses dispositions de départ.
Il était
quatre heures du matin, quand il rentra. Il se jeta tout habillé, à côté
de moi, dormit une heure, et alla faire battre la générale. Je me levai ;
je fis mettre mes mules à ma voiture, et nous sortîmes en même temps d’Argenton,
lui pour acquérir de la gloire, moi pour voler où m’appelait l’amour.
Je traversai
Saint-Junien, et je ne trouvai pas à propos de m’y arrêter. J’étais entré
à pied à Limoges, il y avait quelque temps, et j’en étais sorti en charrette.
Je voulus y reparaître dans un équipage convenable. Une voiture aux armes
du maréchal de Biron, deux mules et un cheval en avant, formant la flèche,
placée sur une arbalète ! quel effet j’allais produire sur les habitans de
Limoges ! la vanité imposa, pour un moment, silence à l’amour. Bientôt je
chantai un des cantiques de ma précieuse Colombe, et je m’identifiai avec
elle.
J’entrai
à Limoges en chantant, et quelques personnes s’arrêtèrent. « Bon, disait
l’un, c’est ce fou qui voulait nous enlever la sœur Sainte-Colombe. Il se
sera échappé de Montmorillon, disait un autre. — Il aura trouvé cet équipage
suu quelque chemin, ajoutait un troisième ; il sera sauté dedans, et le voilà.
»
Ces
propos me blessaient vivement, et ils augmentaient à chaque instant le
nombre des spectateurs. Ils me barraient le chemin. Dans un mouvement de
colère, je fouettai mes bêtes de trait à grands coups, au risque d’écraser
ceux qui étaient devant
elles.
On se rangea précipitamment, et j’arrivai au galop à la grille du palais
épiscopal. Je sautai dans la cour, et dans moins d’une minute elle fut pleine
de monde. Je me fis faire place l’épée d’une main, et de l’autre, je tenais
en l’air le paquet du duc de Guise. Chacun se hâta de se coller contre les
murs.
J’appelai
le portier, et plus je criais, plus il s’enfonçait dans sa loge. Il est fou,
il est fou, criait-on de toutes parts. M. de Mellac parut à une croisée,
et demanda la cause de ce tumulte. Il me reconnut, et ordonna qu’on se saisît
de ma personne. Mon épée écarta les plus audacieux. Je montrai au révérendissime
le paquet que je tenais à la main, et je lui dis que je lui étais envoyé
par le duc de Guise. Il sourit de pitié, et leva les épaules. Il allait refermer
sa croisée.
« Prenez
garde, Monseigneur, à ce que vous allez faire. Ce paquet est de la plus haute
importance. M. Péricard l’a écrit en ma présence, dans le cabinet du duc
de Guise. » II est fou, il est fou, cria-t-on encore, dans tous les recoins
de la cour. Une escouade d’archers y entra, et je respirai : j’étais certain
que ceux-là ne me craindraient pas, et que par conséquent ils m’écouteraient.
Je remis l’épée dans le fourreau, et je m’avançai vers le chef de la troupe.
Je m’expliquai avec lui, et il fit aussitôt porter mes dépêches à monseigneur.
« Vous
ne voyez donc pas, commandant, qu’il n’y a rien dans ce paquet… — Que les
chansons qu’il nous a fait entendre en entrant dans la ville. — Désarmez-le,
Monsieur le comman- dant. » Je fis un saut en arrière, et je portai la main
sur la garde de mon épée. « Point de violence, dis-je, et je ne m’en permettrai
aucune. Monsieur l’officier, ordonnez qu’on garde mon équipage, jusqu’à ce
que je puisse le mettre en sûreté. — En sûreté ! c’est lui qu’on y mettra.
— Il est fou, il est fou. —
Désarmez-le
donc, Monsieur le commandant. — Mes amis, il sera toujours temps d’employer
la force. Attendons ce que monseigneur décidera. »
Ces
clameurs m’avaient monté la tête. « Apprenez, canaille que vous êtes, qu’on
ne désarme pas un capitaine d’infanterie, seigneur du château de la Tour.
— Il est fou, il est fou. »
Deux
clercs descendirent l’escalier qui conduisait à l’appartement de monseigneur.
Ils s’approchèrent de moi avec des marques de déférence, qui frappèrent les
spectateurs d’étonnement. L’un d’eux s’adressa aux Limousins rassemblés.
« Omnis
homo mendax, leur dit-il, ce qui signifie que tout homme est menteur,
et vous avez menti en proclamant fou ce saint jeune homme ; mais vous avez
menti involontairement, et errare humanum est, ce qui veut dire qu’il
est del’essence de l’homme de se tromper. Ce pieux catholique a couru les
rues de Limoges à plusieurs reprises ; mais les pères du désert ne couraient-ils
pas, çà et là, en chantant des hymnes, et en se roulant sur les ronces ?
« Ah,
c’est un père du désert, dit un savant de la troupe ! Nous ne savions pas
cela. Retirons-nous. » Et tous les Limousins défilèrent devant moi, en baisant
le bas de mon manteau, et en répétant : omnis homo mendax; errare humanum
est.
Je fus
conduit, en cérémonie, au cabinet du révérendissime. Il me reçut dans son
fauteuil à oreillettes, et il me fit signe de prendre un pliant.
« Vous
voulez donc absolument vous marier, mon cher frère ?
— Je
l’étais, Monseigneur. — Ne parlons plus de cela. Le mariage n’est pas un
état pur ; mais on peut le sanctifier par de
bonnes
œuvres. Saint Paul l’a prouvé, et il vous laisse un grand exemple à suivre.
Le suivrez-vous ? — Oui, Monseigneur. — Voilà qui est bien, mon enfant.
« Le
souverain pontife m’ordonne, par l’organe de son légat, de relever sœur Colombe
de ses vœux, et monseigneur le duc de Guise me prie de vous unir à elle.
Consentez-vous à la prendre pour épouse ? — Mais, Monseigneur, elle l’est
déjà. — Ne parlons plus de cela, vous dis-je. Le mariage contracté à Benon
ne l’a pas été selon les canons de l’Eglise. Il faut le renouveler ici. —
Oh, de toute mon âme, Monseigneur. »
Je suis
catholique zélé, ardent même ; mais l’hypocrisie m’a toujours révolté, et
mon sang bouillait dans mes veines. Je me contins cependant.
« Parlons
à présent, d’autre chose. — Ne parlons que de cela, Monseigneur. — Je vois
bien qu’il faut terminer cette affaire-ci, pour vous rendre capable de quelque
attention.
« Je
vais faire sonner à volée toutes les cloches de la ville. Les bedeaux la
parcourront, en annonçant aux fidèles la grande cérémonie, qui aura lieu
ce soir au couvent des filles de Saint- Augustin. Vous vous y rendrez. —
Je n’y manquerai pas, Monseigneur. — Demain, dimanche, je ferai publier un
ban, je donnerai dispense des deux autres, et lundi Colombe et vous serez
unis en légitimes nœuds. — Lundi ! — mais c’est bien tard, Monseigneur !
— N’oubliez pas, jeune homme, que la sensualité est indigne du mariage, et
que l’objet de ce sacrement est seulement de donner des âmes à Dieu. »
Et le
duc de Guise lui écrivait : Si vous aimez le plaisir, vous vous renfermez
dans le cercle que vous tracent votre état, et les
bienséances.
Quel empire il fallait que j’eusse acquis sur moi, pour ne pas éclater !
Colombe ne m’était pas encore rendue.
M. de
Mellac me congédia, en me donnant rendez-vous, pour quatre heures du soir,
aux filles de Saint-Augustin, et en me répétant qu’il allait donner ses ordres.
J’avais
mon or dans mon escarcelle ; mais cela ne suffisait pas. Je voulais savoir
ce qu’était devenu mon équipage. Le chercher, c’était m’occuper de Colombe.
Je parcourus
les principales rues de Limoges. Le bas peuple se rangeait devant moi ; répétait
: c’est un père du désert, et me saluait avec respect.
J’appris
enfin qu’un cabaretier avait retiré ma voiture et mon attelage. J’y courus,
et je vis qu’ils étaient aussi bien que je pouvais le désirer. Je voulus
convenir de prix avec Ambroise. Il me répondit que l’équipage d’un père du
désert porterait bonheur à sa maison, et que décidément il ne recevrait rien.
Bientôt
le son des cloches me fit connaître que l’évêque commençait à exécuter ses
promesses ; mais il n’était encore que deux heures, et je bouillais d’impatience.
Il me
sembla qu’attendre dans l’église du couvent, c’était, en quelque sorte, abréger
le temps. Tout devait m’y parler de Colombe, jusqu’au rideau qui défendait,
aux regards profanes, de pénétrer à travers la grande grille, qui leur dérobait
les vierges du Seigneur. C’est là qu’elle est, me disais-je ; c’est de là
qu’elle paraîtra bientôt à mes yeux, avides de la revoir. J’étais seul dans
l’église, et je la parcourais dans tous les sens.
Mon
attention se fixa sur un tableau qui représentait sainte Cécile, et qui d’abord
me parut assez mauvais. Bientôt je crus reconnaître dans les traits de la
sainte ceux de ma Colombe, et l’ouvrage me parut médiocre. Je continuai à
l’examiner… Oh, c’est elle… c’est bien elle, pensai-je, je ne peux plus m’y
méprendre. Voilà ce jeu de physionomie enchanteur, auquel je ne conçois pas
que personne puisse résister ; voilà ses doigts effilés, qui s’étendent voluptueusement
sur ce psaltérion. Dans la moyenne région de l’air paraissent des anges,
qui vont placer une couronne sur sa tête. Oh, cette couronne est de myrte
; ces anges sont des amours. Ce tableau est digne de Léonard de Vinci !
Je tombai
à genoux, et je suppliai mon patron de me pardonner les idées mondaines auxquelles
je venais de m’abandonner dans une église. J’étais devant le portrait de
sainte Cécile, et je la priais, plus vivement encore, d’intercéder pour moi.
Est-ce bien elle que j’invoquais ?
Le bruit
des cloches se fit entendre de nouveau, et l’église s’emplit à l’instant.
Le bedeau me conduisit près de la grille, et m’indiqua un prie-dieu, couvert
en damas cramoisi, qu’il avait placé pour moi. Je m’agenouillai une seconde
fois.
L’orgue
annonça que l’auguste cérémonie allait commencer. Le cœur me battait avec
une .extrême violence. Il était partagé entre d’amour divin, et celui que
m’inspirait Colombe. Je m’efforçai de les concilier : cela était difficile.
Je me recueillis cependant, et, pour un moment, j’appartins tout entier à
mon patron.
Le
grand rideau se tira enfin. Oh, toutes mes idées pieuses s’évanouirent. Je
cherchai, je trouvai Colombe, et je tombai dans un ravissement, qui tenait
de l’extase.
Elle
était placée entre deux religieuses, et la supérieure était debout, derrière
elle. Elle avait les mains étendues sur la tête de celle qui allait lui échapper
; elle la bénissait. Toutes quatre étaient tournées vers l’intérieur de l’église.
Colombe m’aperçut, et me sourit.
Oh,
quel sourire ! Son effet est impossible à peindre. Vous seul le concevez,
vous qui, après des obstacles, qui paraissaient insurmontables, avez été
unis à l’objet de l’amour le plus tendre, ou qui en avez été séparés, après
huit jours d’une félicité, qui ne faisait que naître.
L’évêque
parut, dans ses habits pontificaux, et entouré de son clergé. Il déclara,
à haute voix, que la pleine puissance de notre saint père le pape remettait
Colombe dans le monde, et qu’elle’ y était appelée pour la plus grande sanctification
de son âme.
Un grand-vicaire
lut la bulle du légat, et tous les assistans répondirent amen.
M. l’évêque
nous adressa ensuite un discours, plein d’onction, sur les devoirs du mariage.
Il peignit le ciel ou l’enfer ouvert pour les époux qui les pratiquent ou
s’en écartent.
Je me
rappelai le passage de la lettre du duc de Guise… Oh, pensai-je, combien
la Religion est étrangère aux faiblesses de ses ministres ! Colombe n’en
peut faire la distinction : elle est plus heureuse que moi. Imitons sa ferveur,
et revenons à la foi implicite.
Les
deux religieuses la dépouillèrent, en cérémonie, des signes qui constataient
son sacrifice, et sa captivité volontaire. Ses longs cheveux blonds tombèrent,
par boucles, sur des épaules d’albâtre ; la rougeur du plaisir, et peut-être
de la pudeur couvrirent ses joues du plus vif incarnat.
On la
revêtit de la robe qu’elle portait, quand elle se présenta aux filles de
Saint-Augustin. C’était la seule qu’elle eût, en fuyant Madame la maréchale.
Cette robe était dans un triste état, et Colombe n’en était que plus belle
: elle devait tout à la nature et à la jeunesse. La laideur seule a cherché
à détourner d’elle une attention défavorable, en la fixant sur des habits
somptueux.
Cependant
je voulais que l’épouse d’un homme comme moi parût avec un état digne d’elle,
et je me promis d’employer à cela la journée du lendemain.
L’évêque
ordonna à Colombe de passer du côté de la grille où j’étais, et au directeur
du couvent de nous fiancer. Nos mains se touchèrent… Colombe laissa tomber
sa tête charmante sur ma poitrine. J’y sentais un volcan qui me dévorait…
On fut obligé de nous soutenir.
On reconduisit
Colombe dans l’intérieur du couvent, et Monseigneur prononça qu’elle n’en
sortirait que pour se présenter à l’autel.
Je me
retirai, satisfait, heureux, autant qu’on peut l’être, quand on attend.
Amhroise
était un gros réjoui, catholique zélé, prêt à tout faire pour la Religion,
et faisant tout gaiement. Il convint que
Colombe
ne pouvait se marier sans avoir une robe belle et neuve. Mais il était six
heures du soir, et le lendemain ôtait dimanche. « Diable, diable, disait-il,
en se grattant l’oreille, il n’y a pas une minute à perdre. »
Nous
courons chez une, deux, trois couturières.-Elles commencent par me faire
observer le peu de temps qu’elles ont à elles ; je leur fais voir de l’or.
Une d’elles se détache pour aller prendre la mesure de Colombe ; la seconde
court pour trouver des aides ; la troisième nous conduit chez un marchand
d’étoffes. Nous levons ce qu’il y a de plus riche et de plus élégant.
Une
heure après, six ouvrières étaient établies chez Ambroise. Je fis apporter
ce qu’il avait de légumes cuits : c’était samedi. Il les servit dans un coin
de la chambre que nous avions érigée en laboratoire. Huit heures sonnèrent
: nous n’en avions plus que quatre nous.
Cependant
il fallait souper. Nous perdîmes encore quinze minutes : je les comptais.
J’encourageais,
je pressais mes ouvrières. Malgré mes soins, leurs paupières s’appesantirent
: c’était l’heure où les honnêtes gens se couchent partout. Il fallait les
tenir éveillées, et je leur fis apporter du vin chaud. Il produisit d’abord
l’effet que j’en attendais, et l’ouvrage allait avec une rapidité qui m’enchantait.
Bientôt les têtes s’échauffèrent ; elles s’embrouillèrent ensuite, et la
robe de Colombe tomba des mains des couturières sur leurs genoux. Je redoutai
l’accident ordinaire en pareille circonstance ; j’enlevai la robe, et je
la mis en sûreté : il était temps. Ambroise riait ; moi je me désolais.
Les
fumées du vin se dissipèrent peu à peu, et à dix heures ces dames reprirent
leur aiguille. Mais elles s’en servirent avec une nonchalance, une lenteur
désespérante. Minuit sonna. Il est dimanche, s’écria l’une d’elles, et toutes
jetèrent leur ouvrage, avec effroi. J’enrageais ; mais je ne pouvais blâmer
leur respect pour les lois de l’Église.
« Colombe
se mariera donc sans avoir une robe neuve, dis-je en soupirant. Pourquoi
cela, me répondit Ambroise ? minuit sonnele dimanche comme le samedi, et
nous les remettrons à la besogne. Vous ne vous marierez pas avant dix heures,
et en dix heures, six femmes font bien des choses. Allons nous coucher, Monsieur.
» C’est ce que je pouvais faire de mieux.
Ma pauvre
tête était surchargée d’idées, souvent contradictoires, et le sommeil fuyait
loin de moi. Je m’endormis enfin, et il était grand jour quand je m’éveillai.
Je m’habillai
précipitamment. « Où allez-vous, Monsieur, me demanda Ambroise ? — Passer
la journée dans l’église des filles de Saint-Augustin. — Monsieur, les pères
du désert vivaient de racines ; mais ils mangeaient. Je ne souffrirai pas
que vous sortiez sans avoir déjeuné. » II fallut me soumettre : c’est souvent
le seul moyen de se débarrasser d’un importun. Je courus au couvent, et je
me mis en prières devant le portrait de sainte Cécile. La messe sonna, deux
grandes heures après, et à l’élévation le grand rideau s’ouvrit. Je volai
à la grille ; mes yeux et ceux de Colombe se rencontrèrent. Nous oubliâmes
la sainteté du lieu, et celle des grands mystères qu’on y célébrait. Quand
le rideau fut tiré, j’allai demander pardon à sainte Cécile de mes coupables
distractions.
Une
idée lumineuse, excellente, admirable me frappa. Colombe, me dis-je, ne doit
sortir du couvent que pour se présenter à l’autel ; c’est fort bien ; mais
on ne m’empêchera pas de voir ma fiancée et de lui parler.
Je ne
savais plus marcher au pas Je courus à la porte d’entrée du couvent, je sonnai,
et je demandai Colombe. La tourière me répondit que cela ne se pouvait pas.
« Et la raison, ma sœur ? — Tout a été prévu, Monsieur, et on a pensé que
si vous vous trouviez ensemble au parloir, on ne pourrait plus vous en arracher.
» Il fallut me soumettre encore.
Je rentrai
à l’église. Le bedeau vient me dire qu’il allait la fermer, jusqu’à l’heure
des vêpres. Que de formalités, de lenteurs ! Il y avait de quoi devenir véritablement
fou.
Je retournai
chez Ambroise. Ses contes me rendirent un peu de tranquillité. « Savez-vous
bien, Monsieur, me dit-il, que vous avez beaucoup perdu, auprès de moi,
de la réputation de sainteté qu’on vous a faite par la ville. Ce père du
désert n’est réellement qu’un beau jeune homme, amoureux jusqu’à la frénésie.
— Ambroise, je confesse mon indignité ; mais je n’ai cherché à tromper personne.
»
La curiosité
est une passion dans les petites villes. On voulait voir de près ce jeune
homme pour qui on déliait les religieuses de leurs vœux, et qui passait pour
un saint. Des personnages notables de Limoges vinrent me rendre visite, et
je leur parlai de Colombe. Quelques-uns m’engagèrent à dîner, et le nom de
Colombe était la seule réponse qu’ils tiraient de moi. Ils me quittèrent,
en regardant Ambroise, et en lui souriant d’un air très-significatif.
Ils
répandirent, par la ville, que le prétendu saint n’était qu’un homme fort
ordinaire ; le peuple se souleva contre eux. L’évêque et son clerc avaient
parlé, c’était assez pour lui. Les gens raisonnables m’avaient bien jugé,
sans doute ; mais ils apprirent qu’il faut toujours paraître respecter les
préjugés populaires. Nous entendîmes, Ambroise et moi, un grand bruit dans
la rue. C’étaient les vitres des incrédules qu’on cassait ; c’étaient les
archers qui cherchaient à rétablir l’ordre.
Dès
que je parus dans la rue, le commandant vint à moi. et me dit que je pouvais
seul ramener le calme dans les esprits. Des hommes du peuple me prirent dans
leurs bras et me promenèrent comme une relique : j’étais destiné à jouer
tous les rôles à Limoges, et j’avoue que je ne fus pas fâché d’y faire briller
mon éloquence.
Du haut
de l’espèce de pavois, sur lequel on m’avait élevé, je haranguai le peuple,
avide de m’entendre, et je lui dis ce que je pensais sincèrement. Je déclarai
que je n’étais qu’un misérable pécheur ; mais que j’étais plein de religion
et de foi, et que j’allais en donner la preuve. J’ajoutai que nos livres
saints nous ordonnent d’aimer notre prochain, catholique, bien entendu, et
de le plaindre quand il s’égare ; que les lois divines et humaines nous défendent
de nous faire justice nous-mêmes, et que les excès, quels qu’en, soient les
motifs, sont toujours répréhensibles. Enfin je louai le zèle que ce bon peuple
venait de marquer pour la Religion ; mais je le priai de réserver son courage
pour combattre, et exterminer les huguenots.
Des
acclamations universelles s’élevèrent. On me rapporta en triomphe à mon cabaret,
en criant : Mort aux huguenots, gloire au père du désert !
Étrange
peuple, qui voulait, deux mois auparavant, que je fusse fou, et qui voulait
aujourd’hui que je fusse un saint ! Il m’avait négligé, depuis que j’étais
sorti de l’évêché, et il avait suffi de quelques mots pour ranimer son fol
enthousiasme !
Deux
cent cinquante d’entre eux coururent à la mmiicipahté, et s’inscrivirent
sur les rôles des ligueurs. D’autres mirent en œuvre tous les vitriers de
la ville, et firent réparer le dégât qu’ils avaient fait. Quel instrument
que le peuple, dans les mains de ceux qui savent s’en servir ! Que la cour
et les Guise le connaissent bien !
La maison
d’Ambroise ne désemplissait pas. Le vin y coulait à flots. Les clameurs,
les vociférations se succédaient sans relâche. On aiguisait des épées rouillées,
de vieilles pertuisanes sur les tables du cabaret. On jurait, par ces mauvaises
armes, de traiter les huguenots comme les Amalécites l’avaient été par les
Hébreux.
M. de
Mellac m’envoya dire de me rendre au palais épiscopal. Il me félicita sur
ce que je venais de faire, sur les succès brillans que j’avais obtenus. Il
m’assura que personne ne pouvait résister à la force des argumens religieux
que j’avais développés à la multitude, à l’éloquence entraînante avec laquelle
je les avais présentés. « Vous avez, ajouta-t-il, conquis deux cent cinquante
hommes de plus à la vraie Religion. Le duc de Guise vous a bien jugé.
« Parlez-moi
maintenant des observations que vous avez faites, des renseignemens que vous
avez recueillis sur la route de Paris à Limoges. — Monseigneur, les vêpres
sonnent chez les filles de Saint-Augustin, et je m’éloignai à grands pas.
« Oh, quel homme, disait-il en me regardant aller ! mardi il parlera. »
J’entrai
le premier à l’église, et j’en sortis le dernier. Le grand rideau ne s’ouvrit
pas. Je m’en consolai aux pieds de sainte Cécile.
Je rentrai
chez Ambroise. Les Hébreux étaient dans un état d’ivresse complet. L’intérieur
de la maison offrait un tableau repoussant ; mais le cabaretier avait vendu
deux bariques de vin.
Je me
fis servir à souper dans ma chambre. Je courus ensuite la ville pour rassembler
mes couturières. Elles dansaient, clandestinement, dans un faubourg, en l’honneur
de sainte Madeleine, qu’on fêtait ce jour-là. Je crus remarquer qu’elles
avaient quelque rapport avec la sainte… avant sa conversion.
Elles
répondirent à mes instances qu’il n’était que six heures, et qu’elles ne
pouvaient commencer à reprendre l’aiguille qu’à minuit. Je répliquai qu’il
n’y a pas plus de mal à coudre qu’à danser. Une d’elles, la plus savante,
sans doute, me dit que son curé défendait la danse ; mais que les commandemens
de l’Église n’en parlent pas ; qu’au contraire, ils interdisent rigoureusement
le travail les dimanches et les fêtes. Je n’avais rien à répliquer à cela.
J’avais
encore six mortelles heures à attendre. Que faire pendant ce temps-là ? Depuis
long-temps ma tête était dans un état de contraction, qui augmentait, à mesure
que le moment du bonheur approchait. Elle était pesante, embarrassée ; je
sentais un certain engourdissement dans tous mes membres. Je ne suis pas
de fer, me dis-je, et je me marie demain. Allons nous reposer.
J’allai,
en effet, me jeter sur mon lit, et je m’y endormis si profondément qu’Àmbroise
fut obligé de m’éveiller à minuit. Mes ouvrières avaient été de la plus grande
exactitude au rendez-vous ; mais elles me parurent harassées, et je prévis
encore quelque nouveau contre-temps.
Je chargeai
Ambroise de se procurer quelque chose de léger, de la pâtisserie, ou autre
chose semblable. J’interdis rigoureusement le vin ; mais je permis le miel
délayé dans de l’eau.
Elles
reprirent leur ouvrage. J’avais dormi six heures ; j’étais frais et dispos.
Je ne les perdais pas de vue un moment ; je les encourageais, par des promesses,
et des paroles de bienveillance. La nature fut plus forte que la cupidité.
Je ne cessais d’aller de l’une à l’autre. J’éveillais celles qui sommeillaient,
je jurai, par mon patron, que Colombe aurait une robe neuve pour se marier
; il était six heures, et il me paraissait difficile que celle-ci fût prête
pour dix.
Je trépignais,
en pensant à la foule qui se presserait à notre mariage, et combien il serait
humiliant, pour Colombe, et pour moi, qu’elle parût à l’autel dans un équipage
digne tout au plus d’une servante. Je jurai même ; mais j’en demandai aussitôt
pardon à saint Antoine.
« Monsieur,
me dit celle qui m’avait porté la parole au bal, vous n’avez qu’un moyen
de nous éveiller complètement. — Eh, quel est-il ? Parlez, parlez. — Permettez-nous
de danser une ronde. — Comment une ronde ! y pensez-vous ? N’avez-vous pas
perdu assez de temps ?—Monsieur, reprit la plus jeune, toute espèce de plaisir
produit la lassitude, et il n’y a qu’un moyen de la dissiper : c’est, comme
disent les bonnes gens, de
reprendre
du poil de la bête. — Dansez donc votre ronde, et dépêchez-vous. » Je leur
en aurais joué une, si j’avais eu là mon serpent.
Elles
s’éveillèrent en effet, et si complètement que l’ouvrage marcha pendant une
heure avec une rapidité surprenante. Elles se jetèrent, aussi vivement, sur
les rafraîchissemens, que je leur avais fait servir. « Allons, me dis-je,
encore une demi-heure de perdue ! »
Bientôt
une contestation s’engagea entre elles, et détruisit toutes mes espérances.
L’une dit à celle qui avait coupé la robe, qu’elle s’était trompée, et qu’il
manquait une pointe, je ne sais où. Celle-ci répondit que la pointe y était.
« Elle n’y est pas. — Elle y est. —Je vais vous faire voir que non. —Vous
ne toucherez pas à cela. » Elles tenaient la robe, chacune de leur côté ;
elles tiraient avec force; il en resta moitié dans les mains de Perette,
et moitié dans celles de Margot.
Je ne
me possédai plus. Je pris la cruche à l’eau miellée, et je la leur vidai
sur la tête ; un balai se trouva sous ma main, et je les jetai dans l’escalier,
les unes sur les autres.
« Que
diable avez-vous fait là, me dit Ambroise ? Le mal pouvait se réparer… —
Se réparer, et il est huit heures ! — Vous l’avez rendu irréparable. » En
effet, la malheureuse robe était tachée, et poissée partout.
Que
faire à présent, que vais-je devenir ? — C’est ce qu’il fallait vous demander,
avant que de mettre la main sur cette diable de cruche. — Colombe se mariera
sans robe ; mais elle se mariera, dussé-je l’épouser en chemise. — En chemise,
en chemise ! Les jeunes gens sont bien extraordinaires ! Ils
désespèrent
sans raison, et… — Comment sans raison ! et quel remède trouvez-vous à cela
? — Moi, Monsieur, je n’en vois point ; mais ce n’est pas à moi à en trouver
un : ce n’est pas moi qui me marie… Ah, ah, quel trait de lumière ! Ah, Monsieur,
Monsieur ! — Parlez donc, au nom de Dieu. — Je connais une jeune fille, chargée
de décorer l’image de la Vierge… — Hé bien ? —Hé bien, vous ne saisissez
pas mon idée ! Nous prenons chez les marchands de soieries une pièce d’étoffe
; chez la mercière un millier d’épingles ; chez la galantière des fleurs
pour garnir le chignon....y êtes-vous à présent ? — Ambroise, vous devez
voir que je ne suis pas disposé à plaisanter. — Marion drape madame Colombe
à la turque… — M’y voilà, m’y voilà, à la grecque, à la romaine. Le costume
sera noble, imposant et nouveau. Courons, mon cher Ambroise, courons. »
À neuf
heures Marion était dans le couvent, avec tout ce qu’il lui fallait pour
parer l’idole du jour. C’était un peu tard ; mais on attache bien des épingles
en une heure.
Ah,
mon Dieu, j’ai oublié une chose de grande importance. Le contrat de mariage
n’est pas fait : on ne saurait penser à tou.
« Ambroise,
allez me chercheur un notaire ; il écrira pendant que je m’habillerai. »
Le contrat
ne se composa que d’une seule clause : tout à Colombe après moi ; tout
à moi après Colombe. Ambroise me servait de valet de chambre ; le notaire
et lui finirent en même temps.
Toutes
les cloches sonnèrent à volée. L’heure fortunée était venue. Je pris le notaire
sous le bras, et je le fis trotter, peut-être pour la première fois de sa
vie. Il fallait que le contrat fût signé
avant
la célébration du mariage. On nous fit entrer dans la sacristie. Colombe
y était déjà, belle comme Aspasie, et modeste comme l’innocence. Nous signâmes.
On vint
nous avertir que monseigneur allait se rendre à l’autel. J’y présentai ma
Colombe. Dès que nous parûmes, un murmure général d’approbation se fit entendre,
et en effet, on ne voyait pas souvent un couple aussi remarquable. Les femmes
examinaient le costume de Colombe, et le trouvaient aussi élégant qu’extraordinaire.
Au reste, disaient-elles, tout devait être nouveau à un mariage comme celui-ci.
Monseigneur
commença par nous adresser une exhortion pathétique, sur la sainteté et les
devoirs du mariage. Je reconnus le lendemain qu’il ne pensait pas un mot
de ce qu’il disait. Il nous fit jurer une haine irréconciliable aux huguenots
: la conservation de ses revenus tenait à leur affaiblissement. Cette haine
était sincère dans le cœur de Colombe et le mien ; nous jurâmes avec une
véhémence, qui tira des larmes des yeux de l’auditoire. Enfin, monseigneur
prononça les paroles sacramentelles.
Nous
repassâmes à la sacristie. Le révérendissime nous y suivit. Il embrassa
la mariée, ce qui ne me plut pas trop, et il m’invita à dîner pour le lendemain.
Ma prédication
de la veille, et le rôle que monseigneur avait joué dans cette affaire, avaient
attiré sur nous la considération générale. On nous entoura, on nous déclara
qu’on ne souffrirait pas que la charmante mariée logeât au cabaret.
Quelle transition, nous disait-on ; pour une très-jeune femme, que de passer
d’une maison sainte dans un réceptacle d’ivrognes !
Je
sentais la justesse de celte observation. Je sentais aussi que je ne pourrais
causer librement avec Colombe que le soir… Toujours des difficultés, des
obstacles : l’homme est-il né pour être soumis aux circonstances ? Ne lui
est il pas permis de vivre pour lui ? Il me fut impossible de résister à
des instances, qui se répétaient sans relâche. Un marguillier de la cathédrale
demanda la préférence, en raison de ses rapports directs avec le prélat qui
nous avait mariés. Je la lui accordai, parce qu’il était garçon, qu’il avait
soixante ans, et que vraisemblablement, il ne serait pas importun. On nous
conduisit en triomphe jusqu’à sa porte.

Jeune
femme française vers 1600 (recueil de Gaignières)

CHAPITRE
XVIII
Un
évêque ligueur démasqué.
M. Dupont
fesait très-bien les honneurs de chez lui. Il nous mena d’abord à un logement
écarté : je trouvai cela très-bien. Il nous invita ensuite à venir partager
son dîner : il me semblait que cela ne pressait point. Il fallut encore nous
soumettre.
Quel
dîner ! Le ciel prodigue ses biens, à ceux qui se donnent à lui, même indirectement.
J’étais placé, comme de raison, à côté de Colombe, et la nappe était longue…
Avec quelle tendresse, quel feu nous nous regardions ! Je n’y pus tenir plus
long-temps. Je l’embrassai… comme on embrasse une femme que l’on adore, qu’on
a perdue, et qu’on vient de retrouver. J’en demandai ensuite la permission
à monsieur le marguillier.
Je regardais
Colombe, et ses draperies. J’étais effrayé du nombre des épingles qui les
attachaient. Oh, pensais-je, il y en aura pour une heure… Nous dînions à
travers tout cela. La satisfaction du cœur donne de l’appétit. A la fin du
repas, je déclarai à M. Dupont que je ne m’étais pas couché la nuit
précédente
; Colombe ajouta qu’elle n’avait pas dormi, et nous lui demandâmes la permission
de nous aller reposer. Il sourit ; c’était répondre. Nous nous levâmes.
La tourière
des Augustines entra. Elle apportait le paquet de Colombe ; il était bien
léger ; mais ce qu’il contenait était d’une nécessité indispensable. Je le
pris sous mon bras.
Mes
couturières parurent ensuite. Elles venaient demander leur argent. Elles
ne l’avaient pas gagné. Je les payai, pour m’en débarrasser, et je présentai
la main à Colombe. Tout à coup les deitx battans des portes s’ouvrirent avec
fracas. Les nobles de la ville, et leurs femmes venaient nous féliciter.
Au diable les félicitations et les féliciteurs, grommelai-je entre mes dents,
« Mon
cher Antoine, me dit tout bas Colombe, il faut être poli. » Cette voix allait
toujours à mon cœur. Je restai.
Après
les premiers complimens, les dames s’approchèrent de Colombe, et son costume
devint l’objet de la plus stricte attention. Elles en louaient la légèreté
et la grâce ; elles finirent par demander le nom de l’ouvrière qui drappait
avec cette perfection. Je nommai Marion, d’un ton brusque, que je m’efforçais
en vain d’adoucir.
« Mesdames,
dit la baronne de Polainville, nous recevons les modes de Paris, quand elles
y sont à peu près usées. Ayons la noble ambition de donner le ton à la capitale.
Habillons-nous toutes à la Colombe. A la Colombe, à la Colombe, s’écrièrent-
elles, toutes à la fois. Elles sortirent aussi précipitamment qu’elles étaient
entrées. Il ne me fut pas difficile de pénétrer le but essentiel de leur
visite. Cependant je ne pus m’empêcher de leur savoir bon gré de prendre
Colombe pour modèle.
Les
maris étaient restés. Que veulent-ils encore ? Je ne vois pas ce qu’il leur
reste à dire.
L’un
d’eux s’avança d’un air doucereux, en faisant trois ou quatre révérences.
« Je ne crois pas, dit-il à Colombe, que M. de la Tour fasse un long séjour
dans cette ville. N’aurons-nous pas, Madame, l’extrême satisfaction d’entendre,
pour la dernière fois, cette voix angélique, qui nous a fait, si souvent,
tressaillir de volupté ? — Hé, Messieurs, vous avez assez entendu Colombe
au chœur, et il ne s’agit plus de chansons. » Elle me tira à part. « On nous
comble d’amitiés, me dit-elle, et un peu de complaisance coûte si peu ! »
Elle n’attendit pas ma réponse, et elle commença à chanter.
Elle
chanta, elle enchanta. C’étaient un ravissement, des cris, des applaudissemens,
qu’on n’avait pu se permettre dans l’église, et qui éclataient avec une telle
force, que cent personnes se rassemblèrent devant les croisées. J’enrageais,
oh, j’enrageais ! Vingt fois je fus tenté de prendre ma Colombe par la main,
et de souhaiter le bonsoir à la compagnie. Je n’étais pas à la fin de mes
tourmens.
Une
table de cinquante couverts fut dressée. Monsieur Dupont nous avait permis
de nous aller reposer après le dîner ; mais il n’entendait pas perdre les
apprêts d’un magnifique souper. Colombe lisait dans mes yeux. « Mon bon ami,
me dit-elle à l’oreille, veux-tu que je marque un empressement, qui donnerait
de moi la plus mauvaise opinion ? Possède-toi, mon cher Antoine. Si nous
n’avions pu nous marier que demain… — Oh, je ne sais rien supposer. — Je
t’en prie, je t’en conjure. » Je m’efforçai de sourire, et je crois que je
fis la grimace.
Les
dames rentrèrent, en folâtrant, en sautillant, elles étaient au comble de
la joie. Une mode créée à Limoges ! La boutique du marchand de soieries était
vide ; Marion était devenue un personnage de la plus haute importance. Elle
avait rassemblé sous ses ordres, toutes les couturières de la ville. Le surlendemain,
les premières draperies à la Colombe devaient paraître dans les rues de Limoges.
« Je
vous engage, Mesdames, à recommander à Marion de ne donner, à ses ouvrières,
ni vin chaud, ni eau miellée. » On me demanda, avec empressement; ce que
cela signifiait. Je racontai les accidens de la nuit précédente, et je les
racontai assez gaiement. On voit que je me résignais. Il le fallait bien
: Colombe le voulait ainsi. Un regard, lancé à la dérobée, me témoigna sa
satisfaction et son amour.
On rit,
on rit beaucoup. Je finis par faire comme les autres : j’ai déjà remarqué
que la gaieté se communique. On ne laissa échapper, ni l’occasion de nous
adresser quelque chose de flatteur, ni celle de dire un bon mot ; on trouve,
par fois, en province quelques gens d’esprit.
« Ah,
mon Dieu, mon Dieu ! neuf heures sonnent à la cathédrale, dit la baronne.
Ah, Mesdames, quel libertinage ! M. Dupont, veuillez faire appeler nos gens.
»
Aussitôt
vingt cuisinières se rangèrent en file dans l’allée de la maison. Chacune
d’elles portait à la main une lanterne, dont jaillissait la lumière à travers
un carreau de corne, à demi-grillé. On nous adressa un bonsoir plein d’affection,
à travers laquelle perçait un sourire sardonique, et on disparut.
M.
Dupont s’occupa à faire ranger sa salle-basse, et nous fûmes seuls enfin.
Je saisis un flambeau ; nous montâmes l’escalier en quatre sauts, et nous
nous enfermâmes à double tour dans notre chambre, bien résolus à n’ouvrir
à personne, fût- ce même à mon patron.
Je commençai
à détacher cette multitude d’épingles. La précipitation, l’impatience ont
leurs inconvéniens : je ne cessais de me piquer les doigts, et j’allais toujours.
Colombe m’arrêta.
« Mon
cher ami, me dit-elle, nous avons tenu une conduite bien répréhensible. Pendant
les huit jours que nous avons passés ensemble, nous n’avons pas élevé une
seule fois nos pensées vers le Ciel. C’est à cet oubli coupable que nous
devons les disgrâces, que nous n’avons cessé d’éprouver. Depuis que le saint
évêque de Limoges nous a unis, nous nous sommes exclusivement livrés à l’amour,
et ton patron t’en punit : tu as tous les doigts en sang. Tombons à genoux,
mon ami, et louons le Seigneur. »
Il ne
fallait qu’un mot pour me rappeler à la piété, solide et fervente, que j’avais
sucée avec le lait de ma mère.
Nous
chantâmes, à haute voix, un Te Deum, un Te Deum tout entier.
Bravo, bravo, nous cria M. Dupont, par le trou de la serrure, quand nous
cessâmes de chanter.
Je reconnus
bientôt combien était sage le conseil que m’avait donné Colombe : mon patron
m’inspira qu’il est désagréable d’avoir les mains enveloppées de linges une
première nuit de mariage, et je déshabillai ma Colombe avec circonspection.
Il m’inspira
encore que la chasteté veut qu’on tire un voile épais sur des délices...
Je n’en parlerai pas.
Le
matin, nous nous trouvâmes assez calmes pour nous raconter ce qui nous était
arrivé depuis notre séparation. Je ne répéterai pas ce que j’ai déjà écrit.
Colombe
m’apprit qu’elle avait failli mourir de douleur, quand on m’arracha de la
grille, à mon premier voyage de Limoges ; qu’elle avait demandé son époux
à grands cris ; qu’elle avait protesté contre des vœux qui étaient rompus,
puisque je vivais encore ; enfin qu’on n’avait pu modérer ses transports,
qu’en parlant à sa conscience.
La supérieure
lui représenta que son mariage de Benon était nul, et qu’ainsi elle avait
pu contracter un engagement indissoluble avec le Ciel ; qu’elle avait passé
huit jours avec moi dans un état de concubinage, et qu’elle devait expier
cet énorme péché, en sanctifiant le reste de sa vie. Toujours digne de son
nom, Colombe s’était soumise.
Nous
retombâmes dans un nouvel embarras. Nous avions vingt aunes d’une riche étoffe
; mais je ne possédais pas les talens de Marion. Il fallait se lever, cependant,
pour éviter le scandale et les caquets. Colombe fut trop heureuse de retrouver
cette petite robe de voyage, que j’avais jugée indigne d’elle.
Je descendis.
M. Dupont voulut m’adresser les quolibets d’usage : j’étais déjà dans la
rue, j’entrai partout, et partout je demandai des couturières ; elles étaient
rassemblées chez la baronne de Polainville. Là, sous les ordres de Marion,
elles faisaient des robes à la Colombe, pour les dames les plus distinguées
de la ville. On se tire de tout avec de l’imagination et de l’argent. Je
retournai chez Ambroise ; je fis mettre mes mules à ma voiture, et je les
poussai ventre à terre jusqu’à Saint-Junien. J’y fis une levée de couturières,
et je les ramenai
du
même train à Limoges. Je les établis chez Ambroise, pour ne pas abuser de
la complaisance de M. Dupont. Les mesures prises, elles me déclarèrent qu’elles
n’avaient jamais drapé de statues, et qu’il fallait que madame se contentât
d’être habillée comme les femmes de la cour. Nous bornâmes là notre ambition.
Je n’avais
rien pris de la journée, et je devais à plusieurs causes un appétit dévorant.
M. Dupont s’empressa de le satisfaire. II était dix heures, et je devais
dîner chez monseigneur à midi. Le besoin du moment l’emporta sur cette considération.
Je passai avec Colombe les momens dont je pouvais disposer, et je me présentai
à l’évêché, plus disposé à causer qu’à me mettre à table. Je ne pouvais me
dispenser de m’y asseoir, et je satisfis à tout ce qu’exigeaient de moi les
bienséances. Je feignis de manger. J’écoutais, et j’observais tout.
Au nombre
des convives étaient M. Dumoutier, receveur des revenus de l’évêché, et sa
femme, jeune, brune, vive et agaçante. Monseigneur s’était placé entre elle
el moi, et au bout d’un quart-d’heure j’étais au courant.
Certain
auteur a écrit : Quand une intrigue commence à se lier, l’amant se trahit
par des empressemens indiscrets ; la dame, encore maîtresse d’elle-même,
affete une réserve qu’elle croit propre à éloigner le soupçon. Quand elle
s’est rendue, la crainte de perdre son amant la porte sans cesse à de petites
démarches inconsidérées, qui ne frappent pas ceux qui ne sont pas intéressés
à bien voir, mais qui n’échappent jamais à l’observateur. L’amant, qui n’a
plus rien à espérer, el à qui la vanité persuade qu’on ne peut lui être infidèle,
devient impénétrable à son tour.
D’après
cette donnée générale, je jugeai que le révérendissime et madame Dumoutier
étaient au mieux. Cependant, je confesse, avec humilité, que je ne dus pas
cette découverte uniquement à ma pénétration. Cette phrase de la lettre du
duc de Guise : si vous aimez le plaisir, etc., en fut la cause première.
Quand
on quitta la table, monseigneur me fit entrer dans son cabinet. Il m’y répéta
les questions qu’il m’avait faites la veille de mon mariage, et auxquelles
j’avais répondu en courant aux vêpres, chez les Augustines.
Je lui
racontai tout ce que Poussanville m’avait appris, à Argenton, des affaires
politiques, et je m’en attribuai tout l’honneur : ce mensonge-là était innocent,
et peu d’hommes se fussent autrement conduits, en pareille circonstance.
Monseigneur me marqua une vive satisfaction, et il s’écria pour la seconde
fois, que le duc de Guise m’avait bien jugé.
Nous
en étions là, quand on annonça à monseigneur un courrier qui lui était expédié
de Paris. Il envoya prendre ses dépêches, et les lut avec la plus grande
attention. « La Tour, tout ce que vous m’avez dit est de la plus exacte vérité.
En voici les conséquences :
« Châtillon,
fils de Coligny, est campé dans les Cévennes, d’où aucune puissance ne peut
le chasser ; Lesdiguières et ses huguenots se sont rendus maîtres des Alpes,
depuis Briançon jusqu’à Grenoble ; Condé a surpris La Fère en Picardie ;
le roi de Navarre a enlevé Cahors, après s’être battu, en désespéré, pendant
trois jours, dans les rues de cette ville. Nous y avons perdu nos plus braves
soldats, entr’autres le général Poussanville… Que vois-je ? des larmes !
Apprenez, Monsieur,
qu’un
capitaine ne doit pas pleurer un général mort, et qu’il doit se livrer à
la noble ambition de marcher sur ses traces.
« Vous
voyez que la cause de Dieu est en danger, » l’hypocrite ! « et que vos services
sont plus nécessaires que jamais. Voici ce que me mande le duc de Guise.
« Un
nouveau parti se forme ici dans l’ombre et le silence. Il n’est pas dans
mes intérêts, puisque ses chefs ne s’adressent pas à moi. Je veux les connaître.
Il me faut, pour cela, un homme qui puisse s’introduire dans de bonnes maisons,
el qui ne soit pas d’un rang assez élevé pour paraître suspect au peuple,
quand il se mêlera avec lui. La Tour tient au genre mixte qui convient à
mes vues, et je lui crois de l’adresse. Faites-le partir à l’instant, et
qu’il se rende à Paris, à marches forcées. »
« Vous
voyez, Monsieur, quelle est la confiance qu’a en vous le duc de Guise. Je
doute fort que vous puissiez la justifier ; mais vous devez tout tenter pour
y parvenir. — Et pourquoi, Monseigneur, ne la justifierai-je pas ? — Je vous
crois plus emporté qu’adroit. — Je suis l’un et l’autre, selon les circonstances.
—Vous avez de la vanité, jeune homme. — Monseigneur, chacun a la sienne.
— Découvrir des chefs de parti, intéressés à se cacher, puisqu’ils ne se
mettent pas en évidence, est une tâche qui me paraît au-dessus de vos forces.
-
J’ai découvert ici, dans votre palais, des
choses qu’on y croit très-secrètes, et il ne m’a fallu, pour cela, qu’un
mot, un mouvement, un regard. — Expliquez-vous, Monsieur, je vous l’ordonne.
— Un pied mignon, qui en cherche un autre, et qui foule maladroitement la
pâte d’un chien, qui est sous la table ; des mains qui se rencontrent, à
chaque instant, en prenant le pain, le couteau, la fourchette ; un verre
à demi-plein, changé, comme par inadvertance ; des regards furtifs, et qui
n’en ont
que
plus d’expression — En voilà assez, en voilà assez. Il sied bien à un ver
de terre d’épier la conduite des grands. — Le ver de terre n’a pas tout dit
encore, et ne craint personne : on ne lui enlèvera plus l’objet de ses vœux
les plus chers. —Non ; mais on le dénoncera au duc de Guise. — Il sait qui
il dénoncera à
M.
Dumoutier. »
Un
silence de quelques minutes suivit cette explication. Le révérendissime approcha
son siège du mien, et me prit la main.
«
Mon cher ami, vous partirez dans une heure, n’est-il pas vrai ?
-
Je ne partirai que dans trois jours. — Je
vous en prie. — Prière inutile. — Tout homme est faible, vous le savez….
— Et une indiscrétion compromettrait singulièrement deux êtres, qui couvrent
leur faiblesse du manteau de l’hypocrisie. Je me tairai, soyez tranquille.
» Encore un moment de silence.
« —Au
reste, vous ne pourriez donner aucune preuve de ce que vous avanceriez, et
vous avez passé pour être fou à Limoges. — Et ce papier, qu’on a cru dan
s la main de celui à qui il était destiné, que j’ai vu tomber, et que j’ai
ramassé en me levant de table ? — Vous me faites frémir. Rendez-le-moi. —
C’est alors que vous auriez raison de me croire un maladroit. Engagez la
dame à ne plus écrire : elle a tant d’occasions d’exprimer, verbalement,
ses petits mouvemens de jalousie ! — Rendez-moi ce papier, je vous en prie,
je vous en conjure. — Je vous promets, par saint Antoine, de n’en faire aucun
usage, si vous ne m’y forcez, et je vous crois trop prudent pour vous permettre
un éclat. Cependant, je garderai le papier ; il me répondra de vous. »
Qu’un
fourbe est bas, quand il est démasqué ! Mellac s’épuisa en protestations
affectueuses, en promesses, eu supplications à l’égard du dangereux billet.
Il était presque à mes pieds. Je le
quittai,
bien vengé du mal qu’il m’avait fait à mon premier voyage à Limoges.
Je ne
fus pas plutôt dans la me, que je me rappelai ces paroles admirables : Pardonnez-nous
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi
les réflexions sages et utiles ue se présentent-elles que lorsque nous avons
satisfait nos passions ? Pourquoi, me dis-je, ne donne-t- on pas des évêchés
à ce curé de Benon, si simple dans ses mœurs et dans sa conduite ; à celui
de Saurigny, dont le zèle charitable s’étend sur tout ce qui l’entoure ?
c’est que l’intrigue fait tout, et qu’elle repousse ceux qui n’ont en leur
faveur que des vertus obscures. Ce sont cependant celles que prescrit l’Evangile.
On pense
bien que je ne résistai pas long-temps au désir de lire ce terrible billet.
Je vis, avec une grande satisfaction, quej’en avais deviné le contenu en
masse. Encore un mouvement d’orgueil ! oh, l’homme, toujours l’homme ! Madame
Dumoutier se plaignait, longuement et amèrement, de trois visites rendues
dans le courant de la semaine dernière, à une dame qu’elle ne nommait pas,
mais qu’elle désignait de manière à ce que je crusse reconnaître la baronne
de Polainville. Elle finissait en disant que les momens où on pouvait se
rencontrer étaient rares, et trop précieux, pour les passer en explications.
Elle n’avait pas signé ; mais j’étais certain qu’elle n’avait pas pris de
secrétaire, et quelle arme pour moi, que cette écriture, si des circonstances
imprévues me contraignaient à m’en servir !
Je me
sentais humilié d’être au service de ces fripons-là, car enfin le duc de
Guise ne valait pas mieux que son évêque. Mais Je leur devais Colombe, et
un bienfait ne peut cesser d’en être
un,
quel que soit le caractère de ceux à qui on le doit. D’ailleurs, pensais-je,
il se forme à Paris une faction dont les chefs ne sont pas du parti des Guise
; ils sont nécessairement de celui du roi. Les découvrir, c’est me conduire
en homme, reconnaissant à l’égard du duc ; les encourager, me joindre à eux,
c’est remplir les devoirs d’un sujet fidèle. J’irai à Paris.
Quelle
machine inexplicable que l’homme ! j’étais royaliste par inclination, et
par principes religieux ; l’amour m’avait tourné tout entier du côté du duc
de Guise. La lecture de la lettre dont il m’avait chargé pour Mellac, m’avait
plus qu’indisposé contre lui, et je revenais à mes premiers sentimens pour
le roi ! Je ne pouvais m’empêcher de me comparer à une girouette, que je
voyais tourner, à tout vent, sur le faîte d’une maison qui était devant moi.
J’entrai
chez Ambroise. Mes couturières travaillaient avec activité, et elles avaient
de l’intelligence : elles variaient les ornemens de chaque robe. Elles n’avaient
que ce moyen-là pour qu’on reconnût qu’il en existait plusieurs. Je rentrai
tard chez
M.
Dupont. Colombe et le bonheur m’y attendaient.
Je n’avais
rien à faire de toute la journée suivante ; je la consacrai à l’amour. Le
surlendemain devait faire époque dans les fastes de Limoges. La baronne de
Polainville avait arrangé, pour elle, et les dames de sa connaissance, une
marche triomphale, par les rues et les promenades de la ville. Les vêtemens
à la Colombe allaient éblouir les Limousins stupéfaits.
Il était
onze heures, et rien ne paraissait encore. Les amateurs prévenus garnissaient,
depuis huit heures du matin, les magnifiques allées de la promenade publique.
La patience a ses
bornes,
et déjà des murmures, très-peu galans se faisaient entendre.
Hélas,
bien des hommes n’ont fait qu’un chef-d’œuvre en leur vie, et le reste de
leurs œuvres s’est perdu dans l’obscurité des siècles. Ainsi, Marion avait
eu, en drapant Colombe, des inspirations sublimes, qui ne devaient plus se
reproduire. Bientôt un bruit se répandit dans la ville, et la suite le confirma.
Ces dames avaient trouvé qu’elles ressemblaient à des fagots, et elles n’avaient
pu se regarder sans rire. Elles résolurent de garder les arrêts pendant deux
jours, pour échapper aux quolibets ; la pauvre Marion fut complètement disgraciée,
et alla cacher sa honte, on ne sut où, semblable à ces auteurs tombés, qui,
dit-on, se dérobent à tous les regards.
La garde-robe
de Colombe était terminée. Rien ne nous retenait plus à Limoges. Je payai
mes ouvrières ; Ambroise, qui avait cessé de voir en moi un père du désert,
reçut sans difficulté la gratification que je lui offris, et que je lui devais
à tant de titres. Nous montâmes en voiture, comblés des bontés de
M. Dupont,
et lui des témoignages de la plus sincère reconnaissance.
Nous
n’avions encore parlé que de notre amour, et de ce qui y tenait directement.
Que de choses nous avions à nous dire ! J’adressai les regrets les plus vifs
à la mémoire de Poussanville ; Colombe, qui l’avait connu, le pleura avec
moi. Il vivrait encore, disions-nous, si l’égoïsme ne l’eût pas détaché de
M. de Biron, son bienfaiteur : il n’est pas de faute qui ne porte sa peine.
Je pensai ensuite à ce bon et fidèle André, que j’avais oublié depuis trop
longtemps. Je le dépeignis à Colombe, sans flatter son portrait, et cependant
je fis naître, dans le meilleur des cœurs, le désir de connaître son histoire.
Nous
entrions à Saint-Junien, et je m’étais déjà apperçu qu’il est fort désagréable
de conduire une voiture, quand on est assis à côté de la plus jolie et de
la plus aimée des femmes. Je ne voulus pas abuser de la générosité du bon
bourgeois, qui nous avait reçus, André et moi, à mon premier voyage de Limoges.
D’ailleurs, je ne comptais pas m’arrêter à Saint-Junien : c’eût été perdre
une grande partie de la journée. Je me bornai à prier le brave homme de nous
en trouver un, qui voulût nous conduire jusqu’à Arpajon.
Les
questions commencèrent, dès qu’il apperçut Colombe dans le fond de la voiture.
« Est-ce là cette dame, dont la perte vous a si vivement affligé ? est-ce
celle que vous avez tant cherchée, pour qui vous avez bravé tant de fatigues,
et même de dangers ! » Colombe lui répondit en me donnant un baiser d’amour
et de reconnaissance. « Oh ! Monsieur, qu’elle mérite bien tout ce que vous
avez fait pour elle ! »
Un bon
paysan monta sur une de nos mules, et nous partîmes. Je racontai à Colombe
l’histoire d’André. Elle est longue ; de temps en temps, je m’arrêtais, et…
« Mon cher Antoine, la décence est une qualité nécessaire a une jeune femme
; quelle opinion veux-tu donner de moi à cet homme ? » J’allais tirer les
rideaux du devant de la voiture… « Laissez cela, Monsieur, j’aime le grand
air. » Il fallut que je cédasse ; mais je me promis bien de me débarrasser
promptement d’un témoin incommode. Je reprendrai les rênes. Un peu plus de
peine ; mais aussi plus de bonheur.
J’appris
à Colombe qu’elle était l’épouse d’un capitaine ; qu’elle avait un joli
fief auprès d’Arpajon, et qu’ainsi elle était femme de condition. « Ah !
me dit-elle, soyons toujours toi Antoine, et moi Colombe. »
Le
jour baissait ; il fallut arrêter à un mauvais cabaret de village. « Tu seras
mal, dis-je à Colombe, et j’en suis affligé. — Ne serai-je pas partout, avec
toi, sur un lit de roses ? »
Le lendemain
matin je congédiai notre cocher, et je repris les rênes. Combien elle me
donna lieu de m’en féliciter !
Ou jouit
de la rosée bienfaisante, qui anime, qui vivifie tout ; on ne se demande
pas d’où elle vient. J’avais une femme charmante, et je ne la connaissais
pas encore. Tout à l’amour, à ses plaisirs, à ses traverses, je n’avais vu,
je n’avais pu voir que Colombe.
Elle
avait déclaré au curé de Benon qu’elle était orpheline ; mais qu’avaient
été ses parens ? voilà ce que je désirais savoir. et ce que je craignais
de lui demander : il est cruel de faire rougir ce qu’on aime. Cependant…
« Qu’as-tu, mon Antoine ? tu me parais rêveur ? » Je ne pouvais mentir à
Colombe, et je lui fis part des idées qui m’occupaient. Elle sourit, « Mon
histoire n’est pas longue. Je suis née au bourg de Biron, sous les murs du
château. Ton père était chirurgien ; le mien était médecin. Je ne me souviens
pas de l’avoir vu, et je n’avais que trois ans, quand je perdis ma mère.
Je n’avais rien au monde ; madame la maréchale eut pitié de moi. Elle m’éleva,
et je n’avais jamais eu à me plaindre d’elle, quand elle nous chassa à la
Rochelle. » Tu sais le reste, mon Antoine.
« — N’oublie
pas, mon ange, que tu es madame de la Tour.
— Ah !
laisse-moi continuer à t’appeler Antoine! c’est sous ce nom-là que j’ai eu
le bonheur de te connaître. »
Elle
avait raison : partout nous trouvions un lit de roses, une chaumière et du
pain, voilà tout ce qu’il nous fallait.
Nous
apprîmes à Vierzon que la guerre se faisait avec activité. Le maréchal de
Biron était entré en Guienne, avec une armée que le roi avait levée, on ne
savait trop par quels moyens. Il avait arrêté, dans ses succès, l’émissaire
du Démon, ce dangereux roi de Navarre. Le maréchal de Matignon venait de
reprendre la Fère sur les huguenots, qui avaient défendu cette ville avec
une opiniâtreté infernale. Nous priâmes mon patron de faire triompher partout
les catholiques.
La guerre
pouvait s’allumer sur tous les points de la France, et nous nous félicitâmes
d’approcher de Paris. Cette ville n’avait été encore le théâtre d’aucun trouble
sérieux. Le duc de Guise, que je n’estimais pas, que je n’aimais pas, y était
le maître, et donnerait à Colombe un asile sûr, si les circonstances l’exigeaient
: il avait besoin de moi. Cette réflexion me fit abandonner le parti du roi,
et je me dévouai, de nouveau, au duc de Guise.
On pense
bien que je ne passai pas à Étampes, sans m’occuper de ma mère. Le procureur
du roi Vernier n’y était plus. Il m’avait trompé en me disant que ma bonne
Madeleine était transférée à Paris. Quel avait pu être son motif ? Il était
remplacé par un homme, qui ne connaissait que le pape, le clergé et les moines,
sentimens très-louables, sans doute, mais qui pouvaient influer cruellement
sur le sort de ma mère. J’appris que ce magistrat ne se permettait de rigueurs
salutaires que lorsqu’elles étaient indispensables. Il distinguait, il recommandait
aux puissances ces prédicateurs zélés, qui soufflaient dans tous les cœurs
la haine contre les huguenots. Mais les franciscains m’avaient rendu mon
bien ; il n’était pas possible de revenir là-dessus. Pourquoi tourmenter
celle qui, dans cette affaire, n’avait été qu’un instrument à peu
près
passif
? on lui rendait la vie assez douce, et on me permit de la voir sans aucune
difficulté.
Je lui
présentai Colombe. Elle frémit, en voyant, avec son fils, une femme de dix-huit
ans, jolie comme tous les chérubins ensemble, et dont les yeux exprimaient
la plus vive tendresse. Elle sourit, quand elle sut que Colombe était la
fille d’un médecin, et que nous étions unis par le nœud le plus légitime
et le plus respectable. « Je n’avais qu’un enfant, nous dit-elle ; maintenant
j’en ai deux. J’aimerai ma fille avec la plus vive tendresse, et celle que
j’ai vouée à mon Antoine n’en sera pas affaiblie. Le cœur d’une mère ressemble
à une bougie, qui répand sa lumière sur ce qui l’entoure, sans rien perdre
de son intensité. »
Elle
nous félicita sur l’état actuel de notre fortune. Elle nous conseilla de
la sanctifier, en la partageant avec les pauvres. Elle nous fit une exhortation
touchante sur les devoirs du mariage, et sur le genre d’éducation qu’il conviendrait
de donner à nos enfans. « Qu’elle soit toute catholique, nous dit-elle ;
on est assez savant quand on combat l’hérésie, et qu’on contribue à l’extirper.
» Cette visite se termina par des caresses aussi tendres, que nous le permit
la grille qui nous séparait.
Nous
approchions du terme de notre voyage, et Colombe allait jouir de toutes les
commodités de la vie. Déjà je distinguais le clocher d’Arpajon, et je piquai
mes mules. Claire était sur le seuil de notre porte, et elle poussa un cri
de joie, en me reconnaissant. Elle fit à Colombe une révérence qui n’était
pas sans quelque grâce ; elle lui présenta une main, probablement un peu
dure… Ma charmante petite femme était déjà dans la maison. Je sautai à terre,
et j’admirai de nouveau l’ordre et la propreté qui régnaient partout.
«
Te voilà chez toi, mon ange, dis-je à Colombe en l’embrassant. Tu ne craindras
plus les fatigues d’un long voyage, et les dangers auxquels on y est sans
cesse exposé.
« Claire,
où est mon ami André ? » Claire n’était plus là. Je mis la tête à une croisée,
et je la vis trottant du côté de la tour. Bientôt, je reconnus André, qui
la laissait loin derrière lui. quoique ce ne fut pas l’heure où les ouvriers
ont l’habitude de se livrer au repos.
Je revis
ce bon André avec un extrême plaisir, et je le pressai longtemps dans mes
bras. Il salua Colombe avec des marques de déférence, qu’elle méritait sans
doute, et qui nous flattèrent tous deux. Je lus dans ses yeux que mon ami
serait le sien.
Pendant
que Claire s’occupait des besoins des voyageurs, André me gronda, mais très-sérieusement.
D’après son calcul je devais être de retour depuis quatre jours, et, d’heure
en heure, ses inquiétudes augmentaient. Claire était en vedette sur la porte,
autant que le lui permettaient les soins du ménage, et devait l’aller avertir,
quand nous paraîtrions. On a vu avec quel zèle elle avait rempli sa mission.
Colombe
prit la parole, et raconta ce qui nous était arrivé, avec cette naïveté,
cette candeur inséparables de sa manière d’être et de sentir. Ce genre était
nouveau pour André, et il en sentait tout le charme. Claire, assise dans
un coin de la salle, ne perdait pas un mot. Je vis plusieurs fois ses mains
s’approcher ; elle avait envie d’applaudir. Le respect la retint. « Ah, mon
Dieu, s’écria-t-elle lorsque Colombe eut cessé de parler, mon rôti brûle,
» et elle disparut.
C’était
une oie, la quatrième qu’elle avait mise à la broche, depuis le jour où André
nous avait attendus. Mon fermier Thomas avait eu le double plaisir d’en recevoir
le prix, et de manger les trois premières, avec sa femme et ses marmots.
Celle-ci parut sur la table, accompagnée d’un pâté, dont l’intérieur venait
aussi de mon fief, et que séparait une soupe, digne d’être présentée à des
connaisseurs.
Thomas
avait été conduire notre voiture et nos mules à son écurie. Il entra, avec
Catherine. Tous deux avaient pris leurs habits du dimanche ; ils avaient
chacun un bouquet gros comme un balai, et ils l’offrirent à madame de la
Tour, en lui adressant un compliment, auquel elle ne comprit rien, ni eux
non plus.
« Mon
excellent ami, me dit Colombe, ce jour est un jour de fête. Elle serait incomplète,
si ces braves gens ne la partageaient pas. J’étais fier, mais toujours empressé
de complaire à Colombe. Je pris Catherine et Claire par la main, et je me
plaçai entre elles deux.
Dubois,
mon maître maçon, survint. Il voulait aussi me féliciter sur le succès de
mon voyage. Colombe fit, pour lui et André, ce que je venais de faire pour
Catherine et Claire. La joie brillait dans tous les yeux. Oh ! pensai-je,
qu’il est facile aux grands de se faire aimer ! Ils n’ont qu’à le vouloir.
Pourquoi ne le veulent-ils pas ?
Je n’avais
pas encore fait de dîner aussi gai, et je remarquai que nos inférieurs ne
cherchent à s’élever que lorsque nous avons la ridicule prétention de vouloir
les abaisser. Chacun se tint à sa place, et je n’entendis pas un mot que
la plus rigoureuse décence ne pût avouer.
André
n’oubliait rien. Claire nous servit l’eau-de-vie brûlée : c’est le dessert
des grands seigneurs. La gaîté augmenta, et Dubois nous chanta, sans en être
prié, des couplets que depuis vingt ans il faisait entendre à toutes les
noces où il était invité. André termina la fête par un épithalame, plein
de verve et de goût.
Il voulait
m’entretenir de ses travaux, Je le priai de remettre les affaires sérieuses
au lendemain.
Qu’on
est bien chez soi, indépendant, aimant, aimé ! Quelle fatalité porte les
hommes à aller chercher au loin le bonheur qui est là, auprès d’eux ? Je
n’entrevoyais, dans l’avenir, que des jours heureux ; ils m’appartenaient,
et une inquiétude vague me poussait à Paris, chez le duc de Guise, dont je
n’avais pas besoin. Colombe sommeillait encore ; je la regardai, et tout
disparut devant elle.
Claire
vint frapper doucement à la porte de notre chambre. André nous attendait
en bas avec la voiture. Il voulait conduire madame à son domaine, et me rendre
compte, en chemin, de ce qu’il avait fait. On sait comment on éveille une
femme qu’on adore. Je descendis, pendant que Colombe s’habillait.
André
me mit au courant des moindres circonstances. Il attachait beaucoup d’importance
à ce qu’il avait fait, et il avait raison. En s’occupant uniquement de mes
intérêts, il avait développé une rare intelligence, et mon approbation devait
être le prix de ses travaux. Je l’écoutai avec la plus grande attention :
il m’était beaucoup plus facile d’être attentif le matin que le soir. Je
lui donnai les éloges qu’il attendait, et dont il était digne.
Nous
montâmes en voiture. André nous conta qu’il avait vendu pour trois mille
livres de fer et de plomb : on aurait pu avoir l’idée de les convertir en
mousquets et en balles au nom du roi, ou en celui du duc de Guise. De grands
noms imposent toujours au vulgaire, et couvrent souvent la rapine et le meurtre.
André philosophait en dirigeant nos ouvriers. .
Nous
arrivâmes à la tour. Je fixai Colombe, et je surpris sur ses lèvres un sourire
de satisfaction. Elle voyait, sur une hauteur, une jolie et spacieuse maison,
qui s’élevait comme par enchantement ; la ferme, solidement rebâtie, à une
distance convenable ; un étang creusé au milieu d’un jardin qui déjà était
tracé ; des allées, sinueuses et larges, ouvertes dans le bois ; le ruisseau
qui sortait de l’étang pour aller se perdre dans un bosquet, qui promettait
d’être délicieux, au retour du printemps. Le bras de Colombe était passé
sous le mien ; je tenais sa main, je la caressais ; nos yeux se rencontraient
à chaque objet nouveau qui se présentait à nous. J’interrogeais les siens
; ils répondaient amour et reconnaissance. « Ah, lui dis-je, tu ne me dois
rien, faire ton bonheur, c’est assurer le mien. »
Maîtres,
amis, ouvriers s’éloignèrent à l’heure du déjeûner. Le nôtre nous attendait
à la maison. Là, je parlai de la nécessité de me rendre à Paris, et Colombe
pleura ; de ma ferme volonté de ne me mêler de rien quand j’aurais terminé
l’affaire qui m’y appelait, et Colombe sourit.
Après
le déjeuner, j’accompagnai André à la tour. Il voyait tout de sang-froid,
et j’étais bien aise de le consulter sur la démarche que j’allais faire.
« Je suis bien loin, me dit-il, de partager l’admiration aveugle de certaines
gens pour ce duc de Guise. On le croit un grand homme ; ses continuelles
irrésolutions prouvent qu’il manque d’énergie, en beaucoup de
circonstances,
et cette qualité est la première que doit posséder un usurpateur. ».
« Il
affecte de contredire le roi et de le braver publiquement. Cette conduite
peut satisfaire sa vanité, et ne le conduit à rien : elle le perdrait au
contraire, si Henri III n’était le plus nul des hommes. Il est difficile
de prévoir le dénouement d’un drame qui dure depuis si long-temps ; mais
quel qu’il soit, il doit être très-dangereux, pour un particulier, de se
faire un ennemi du duc de Guise. Je vous conseille de suivre votre projet.
»
Nous
parlâmes ensuite de cette faction nouvelle qui se formait dans Paris. André
convint avec moi qu’elle devait être opposée au duc de Guise, puisque ce
prince n’en connaissait pas les chefs. Il nous parut plus que douteux que
ce parti fût dans les intérêts du roi. Il faut de l’or pour remuer le peuple,
ou lui inspirer cet enthousiasme, qui le soumet aveuglément à ceux qui le
dirigent. Or, le roi n’a pas d’argent, et il est méprisé. Quelle influence
peut-il exercer par sa naissance, ou ses qualités personnelles ? Quel est-il
en fin ? Le rebut de tous les partis. Qui donc possède des trésors dans Paris,
et veut les sacrifier à son ambition ? Toute la question était là ; mais
nous ne pûmes la résoudre.
Le duc
de Guise devait m’attendre depuis plusieurs jours, et on ne l’indisposait
pas impunément. Colombe me comblait de caresses, quand je parlais de monter
à cheval, et je m’oubliais auprès d’elle. André entreprit de lui persuader
que la continuité de notre bonheur tenait à l’exécution des ordres que j’avais
reçus à Limoges. Ses raisonnemens étaient forts et serrés ; mais l’amour
ne sait bien entendre que ce qui le flatte. Colombe résista, pleura, pria,
supplia. Pouvais-je lui résister ?
Le
reste de la journée s’écoula dans des scènes d’enchan- tement : on aime plus
fortement encore, quand on se quitte pour la première fois.

Président
du Parlement de Paris (recueil de Gaignières)
CHAPITRE
XIX
Faction
des Seize. Second voyage à Paris.
Je dormis
peu, et à la pointe du jour, je sortis du lit conjugal. Je m’habillai dans
le plus grand silence, et à chaque instant mes yeux caressaient le doux objet,
que le sommeil semblait embellir encore. Je brûlais de lui donner le baiser
d’adieu : je l’aurais éveillée, et je ne serais pas parti. Je m’arrachai
de cette chambre, temple de l’amour heureux, où Colombe allait se trouver
seule.
La porte
de la rue était fermée, et j’entrai dans le cabinet de Claire, pour y prendre
la clef. Elle n’était pas chez elle. André m’avait fait observer qu’une jolie
figure récrée toujours la vue, ne coûte pas plus qu’une autre, et qu’il n’avait
pas de Colombe. Il ne me fut pas difficile de deviner où je trouverais Claire
; mais il est des choses qu’il faut avoir l’air de ne pas voir, lorsqu’elles
ne nuisent à personne. La charité, d’ailleurs, nous ordonne d’éviter le scandale,
et de laisser porter à chacun le poids de ses péchés. Eussè-je pensé ainsi,
si le pécheur eût été tout autre qu’André ? J’en doute un peu.
Comment
faire ?... Hé, sortir par une fenêtre du rez-de- chaussée… Mais sera-t-il
présumable que j’aie pris ce parti, avant que d’avoir voulu me procurer la
clef de la porte? J’appelai André, de la salle à manger, au risque d’éveiller
Colombe. Le pis-aller était de passer encore cette journée auprès d’elle,
et je m’y serais facilement résigné. On dort peu pendant la nuit qui précède
une séparation, et l’heure du repos avait sonné pour ma Colombe. Elle n’entendit
rien.
André
ne se fit pas long-temps attendre. Il descendit à demi habillé. Je lui dis
que je n’avais pas voulu partir sans lui dire adieu, et je le priai de m’ouvrir
la porte. Il alla prendre la clef, chez lui, chez elle, n’importe, et je
fus à la tour faire seller mon cheval.
Je m’arrêtai
devant notre maison d’Arpajon. Rien n’était ouvert encore. Je fus tenté,
vingt fois, de descendre, et de frapper à la porte. J’eus le bon esprit de
sentir que plutôt je partirais, plutôt je serais de retour. J’envoyai à Colombe
un dernier baiser, et je piquai mon cheval, en m’écriant, comme César lorsqu’il
passa le Rubicon : Le sort en est jeté.
J’allai
loger chez Mortier, rue Saint-Antoine. Je m’étais trouvé bien chez lui, et
je contracte facilement des habitudes.
Je suis
très-comniunicatif, et c’est souvent un défaut. Il me fut utile dans cette
circonstance. En m’habillant, je parlais à Mortier du parti qui se formait
dans Paris, Il ne savait rien ; mais il était partisan du duc de Guise, sans
trop savoir pourquoi. Il n’avait que du bon sens, et quelquefois on fait
plus avec cela qu’avec tout l’esprit des membres de la pléiade française.
«
Je vais vous parler contre mes intéréts, me dit-il ; mais je m’estimerais
heureux d’être indirectement utile au duc de Guise. Remontez à cheval, et
allez descendre au coin de la rue de la Mortellerie, vis-à-vis Saint-Gervais.
Vous y trouverez un très-bon cabaret, tenu par un nommé Sanchez, vieil Espagnol,
qui s’est établi là depuis peu de temps. On assure que sa maison est ouverte
toute la nuit, et qu’il s’y tient des assemblées secrètes et nombreuses.
Or, les créatures du duc de Guise se montrent à visage découvert, et celles
du roi ne sont pas encore réduites à se cacher. On soupçonne à Philippe II
des vues directes sur la couronne de France. Il est possible que son ambassadeur
trame quelque chose dans Paris, et que Sanchez soit un de ses agens subalternes.
André,
avec toute sa finesse, et moi avec ma pénétration, nous n’eussions pas été
frappés en un mois de ce trait de lumière. Je payai Mortier généreusement
; je cherchai, et je trouvai l’enseigne du grand Saint-Laurent.
Sanchez
me regarda, quelque temps, avec de grands yeux, qu’ombrageaient de longs
sourcils blancs. Il me demanda enfin ce que je voulais. Je lui répondis que
j’arrivais de province, et je lui demandai, à mon tour, si on avait des nouvelles
de Madrid. Il me regarda plus attentivement encore. Il réfléchit, et me dit
qu’il n’avait de correspondant, en Espagne, qu’un parent, qui demeurait à
Séville. Je le priai de me loger ; il me répondit qu’il vendait du vin, de
l’eau-de-vie, et qu’il ne logeait personne. Je retournai chez Mortier, persuadé
que la maison de Sanchez était le théâtre d’une intrigue espagnole.
Je n’étais
pas disposé du tout à partager, avec Mortier, les avantages de cette découverte,
et c’est à lui seul que je la devais ! mais si une éternité de gloire et
de félicité doit être
l’unique
objet de tous nos vœux, il ne nous est pas expressément défendu de cueillir
quelques fleurs, pendant notre passage dans cette vallée de misère.
Je ne
dis à Mortier que des choses tout-à-fait insignifiantes, et je me rendis
chez le duc de Guise. II avait ordonné qu’on m’introduisît dès que je paraîtrais.
Il me
reçut avec hauteur, et de l’air le plus mécontent : je m’y attendais. Il
me demanda, d’un ton sévère, ce que j’avais fait depuis que j’avais quitté
M. de Mellac. Je lui répondis que j’étais à Paris depuis quatre jours, et
que je n’avais pas voulu me présenter, sans avoir quelque chose de satisfaisant
à lui annoncer. Je priais, mentalement, mon patron de me pardonner un mensonge,
que ma position avait rendu indispensable.
Il ne
faut rien faire à demi avec les grands : on perd leur confiance en hésitant,
sur quelque sujet que ce soit ; on la fixe avec de l’audace. Je ne balançai
pas à assurer le duc, que le roi d’Espagne intriguait à Paris ; que Mendoza,
son ambassadeur, était son agent principal, et le vieux Sanchez un intermédiaire
entre l’ambassadeur et les factieux de classes inférieures. Je ne m’exposais
pas en nommant Mendoza : il fallait bien qu’il jouât le premier rôle dans
cette affaire.
À mesure
que je parlais, la figure du duc reprenait l’expression de la bienveillance,
qui lui faisait tant de créatures, et qu’il croyait propre à m’encourager.
Il avait écrit à Mellac que je serais l’instrument aveugle de ses volontés,
et il n’avait plus une pensée qui m’échappât : je le tenais.
Je conclus,
de plusieurs phrases assez obscures, qu’il avait chargé quelques seigneurs
d’épier les démarches de Mendoza,
et
qu’ils n’avaient rien découvert. Cela était tout simple : l’ambassadeur voulait
paraître oisif; il donnait des dîners et des bals pendant le jour ; ces Messieurs
ne pouvaient passer la nuit dans son palais, et leur rang ne leur permettait
pas de surveiller les portes extérieures.
Le duc
termina un discours qu’il crut très-flatteur pour moi, en me marquant sa
satisfaction, et en me recommandant de ne pas perdre de vue le cabaret de
Sanchez.
J’avais
assez fait pour que le duc crût à mon activité, et je pouvais lui dire, plus
tard, que je n’avais rien découvert. Cet aveu eût tout terminé entre nous.
Il eût promptement oublié un jeune homme, qui ne lui était plus utile, et
je n’attendais, je ne voulais rien de lui.
Je repassai
devant la maisou de Sanchez, et je n’y vis personne. Je n’étais pas disposé
à perdre, sur le pavé de Paris, des nuits que je pouvais rendre délicieuses.
Cependant j’étais Français. Il était certain que le roi n’aurait pas d’enfans,
et Henri de Navarre, son héritier présomptif, était en horreur à tous les
bons catholiques. Le duc de Guise était naturalisé Français, et, toutes réflexions
faites, je crus ma conscience engagée à lui donner les moyens de déjouer
les projets d’un monarque étranger. Philippe II, ou sa fille Eugénie s’assoierait
sur le trône de France ! Cette pensée me faisait frissonner ; mais Colombe
était à Arpajon. Je remontai à cheval, et j’y retournai au galop.
Après
les premiers épanchemens, je communiquai à André mes dernières réflexions
sur le danger où était la France de subir le joug de l’Espagne. « Hé, Monsieur,
me dit-il, que vous importe tout cela ? De quelque manière que les choses
tournent,
nous
aurons toujours un berger, et ce berger-là aura des chiens pour nous pincer
les gras de jambes. Laissez gronder le tonnerre ; faites l’amour, et vivez
heureux. — Il a raison, s’écria Colombe ! Par saint Antoine, je le crois,
lui répondis-je, et je ne pensai plus qu’à vivre, en homme opulent, auprès
de ma charmante petite femme.
Le troisième
jour, un homme se présenta chez nous. Il était porteur d’un billet qui ne
contenait que ces mots : Que faites- vous à Arpajon ? — Tremblez. Le porteur
disparut.
André
avait lu, avec moi, les dépêches dont le duc de Guise m’avait chargé pour
Limoges. Nous reconnûmes son écriture. Comment, nous demandâmes-nous, a-t-il
su que je vivais à Arpajon, étranger aux orages politiques ? Ah, il m’a chargé
d’épier les habitués du cabaret de Sanchez, et un être obscur l’a été de
suivre mes moindres démarches. Qui sait si un troisième n’a pas reçu l’ordre
de s’assurer de la fidélité du second ?
« Monsieur,
me dit André, ce billet change tout-à-fait votre position. Il ne suffit plus
de renoncer aux faveurs du duc de Guise ; il faut éviter la persécution.
Un torrent renverse tout ce qui lui résiste ; il arrose l’ormeau qui ombrage
sa source. Retournez à Paris. — Mais, André, les factieux ne se rassemblent
chez Sanchez que la nuit, et qu’elles seront longues et froides celles que
je passerai à Paris ! » Colombe me serra dans ses bras, et couvrit mes joues
de ses larmes.
« Madame,
lui dit André, faire quelques concessions, est souvent l’unique moyen de
ne pas tout perdre. — Mon Antoine, Mortier peut-il nous donner une chambre
? — Voici la clef de la mienne. — Je la partagerai avec toi. — Tu y seras
gênée, tu y manqueras de bien des choses. — N’ai-je pas tout, quand je suis
près
de toi ? — Madame a raison, reprit André. L’amour trouve partout des autels.
Partez ensemble ; Claire et moi nous veillerons à vos intérêts. » Le coquin
!
Mortier
devina d’abord que la dame qui m’accompagnait, était cette Colombe dont
je parlais seul, quand je ne trouvais personne qui voulût m’écouter. Je l’avais
dépeinte à Mortier comme la plus belle des femmes, et il n’était pas possible
qu’il se méprît.
Il joignit
un cabinet à ma chambre ; il s’engagea à nous traiter comme des princes,
et il attacha une de ses filles à Colombe.
Tout
allait bien jusque-là ; mais je ne devais sortir que la nuit, et je n’étais
ni infatigable, ni patient. Ma bien-aimée répondit à cette observation qu’elle
se coucherait le matin. Elle se prêta à tout, avec une résignation et une
douceur angéliques.
Le duc
de Guise ne voulait pas attendre, et je résolus de commencer mes courses
le soir même. Colombe voulut que je me reposasse avant que d’entrer en campagne.
J’étais toujours prêt à me rendre à cette invitation-là, depuis que je l’avais
retrouvée, parce que tout nous était commun, fatigue, repos et plaisirs.
Ma mission
était périlleuse. Sanchez m’avait vu et parlé, quelques jours auparavant.
S’il s’apercevait que j’observasse sa maison, il pouvait me faire faire un
mauvais parti. Je priai Mortier de me prêter un costume, qui pût me rendre
méconnaissable. Je sortis à dix heures du soir, et j’entrai avec assurance
au cabaret du grand Saint-Laurent. J’y demandai du vin.
On
me servit dans une première pièce, où étaient quelques hommes qui me parurent
être là, uniquement pour le plaisir de boire. Leur conversation était gaie,
et roulait sur des objets indifférens. Mais, dans le fond, était une pièce,
éclairée seulement par la faible lueur d’une lampe, et dont la porte s’ouvrait
rarement. J’y remarquai cependant quelques personnages, qui paraissaient
occupés d’affaires très-sérieuses. Il me parut que les bouteilles qu’ils
avaient devant eux, ne leur avaient été apportées que pour leur servir de
maintien.
« Vous
ne buvez pas, me dit Sanchez. Mon vin est pourtant bon. Vous avez les yeux
partout, et je n’aime pas cela. Qu’êtes- vous venu faire ici ? — Boire au
roi d’Espagne et à l’infante, si quelqu’un veut trinquer avec moi. — Je suis
votre homme, » Il continua à me faire subir, le verre à lamain, un interrogatoire,
qui finit par m’embarrasser beaucoup. Il me demanda les motifs de l’intérêt
que je portais au roi d’Espagne, et pourquoi j’avais préféré sa maison à
une autre. Il fallait lui faire une histoire, et je n’y étais pas préparé.
J’hésitai, je balbutiai. Il frappa dans ses mains.
Trois
des buveurs, qui étaient à côté de nous, se levèrent, en faisant des gestes,
qui m’annoncèrent clairement leur dessein. J’étais sans armes; mais fort
heureusement, je ne perdis pas la tête. Aussi prompt que mes assaillans,
je leur jetai aux jambes quelques tables qui étaient autour de moi ; je pris
Sanchez par sa fraise, je le lançai sur ses sbires, et je sautai dans la
rue.
Cette
scène pouvait faire changer le lieu des réunions, et porter les factieux
à prendre des mesures propres à déjouer les ruses des plus fins. Il fallait
rétablir la confiance. Je courus chez Mortier, et je lui fis sa leçon. Il
enviait la prospérité de Sanchez, et il suivit exactement mes instructions.
J’étais
son porteur de marée, à qui un coup de pied de mulet, sur le crâne, avait
dérangé le cerveau : j’étais destiné à passer pour fou, dans toutes les crises
violentes auxquelles je m’exposais. Je conviens que le mérite de l’invention
appartenait tout entier à André. Ma manie était d’entrer dans tous les cabarets,
d’y demander du vin, et de ne pas le payer. Il est constant que Sanchez n’avait
pas reçu la valeur de celui qu’il m’avait servi. Mortier, pour se débarrasser
de moi, m’avait fait enfermer.
Je m’étais
évadé vers le soir, et il m’avait cherché dans tous les cabarets du quartier.
Sanchez
déclara qu’il m’avait vu ; qu’il paraissait que Mortier me considérait encore
comme étant à son service, et que les maîtres, répondant civilement pour
leurs domestiques, il voudrait bien payer le vin répandu, les bouteilles
et les tables cassées. Mortier répondit que cela était trop juste ; il remit
à Sanchez ce qu’il lui demanda, et il sortit en disant que s’il trouvait
son homme, il le ferait serrer de si près qu’il ne lui échapperait plus.
La porte
se ferma sur lui. Il s’en rapprocha quelques minutes après, et il écouta
par le trou de la serrure. On remettait tout en ordre ; il entendit le son
de quelques sacs qu’on changeait de place, et qui prouvaient que l’indémnité
que lui avait demandée Sanchez n’était que de pure forme. Enfin personne
ne sortit avant quatre heures du matin. On n’avait donc conçu aucun soupçon.
J’avais
commencé cette entreprise, pour ni’acquitter envers le duc de Guise, à qui
je devais Colombe, J’avais failli à me faire assommer, et ce prince n’aurait
eu aucun reproche à me faire, si
je
n’avais pas poussé les choses plus loin. Mais mon amour- propre était blessé
: j’avais été contraint de fuir devant Sanchez, et quelques drôles que j’eusse
fait pâlir, si j’avais eu mon épée. D’ailleurs, je ne pouvais oublier la
lettre écrite par le duc de Guise à l’évêque de Limoges. J’étais, selon lui,
un être aveugle ; mais il n’est pas de levier ou’on doive dédaigner. Je voulus
lui faire connaître la force de ce levier-là.
Je recommandai
à Mortier de ne rien dire à Colombe de la scène qui s’était passée chez Sanchez
: elle m’eût aussitôt ramené à Arpajon. Je ne pouvais plus me présenter dans
cette maison-là. Il était clair que je devais changer ma marche, et il fallait
imaginer un nouveau plan.
Je dis
à ma séduisante compagne que courir la nuit, et dormir le jour, était un
genre de vie infiniment désagréable. Elle sourit, et m’embrassa. J’ajoutai
que nous pouvions nous coucher de très-bonne heure, et que je me lèverais
avant le jour, si elle approuvait ce nouveau plan. Elle s’en était formé
un : c’était de souscrire à tout ce qui me conviendrait.
Je résolus
de me rendre tous les jours, à trois heures du matin, dans la rue de la Mortellerie,
l’épée au côté, et mes pistolets dans ma poche ; de suivre, les uns après
les autres, tous les personnages marquans qui sortiraient de cette maison,
de bien remarquer leur domicile, et d’aller, dans la journée, prendre, sur
leur nom et leurs qualités, des renseignemens dans leur quartier. L’exécution
de ces mesures devait prendre du temps, puisque je ne pouvais, chaque matin
suivre qu’un seul membre du comité espagnol. Mais j’étais décidé, et je m’armai
de patience.
Il m’en
fallut, en effet. Quelquefois je perdais de vue, au détour d’une rue, celui
que j’observais depuis long-temps. Un
autre
jour, des charrettes qui commençaient à circuler dans Paris, m’en dérobaient
un autre. J’enrageais ; mais enfin je recueillis le prix de ma persévérance.
Après
quinze jours de courses, plus ou moins infructueuses, je connus La Roche
Blond, bourgeois de Paris ; Jean Prévôt, curé de Saint-Séverin ; Jean Boucher,
curé de Saint-Benoit ; Guillaume Rose, évêque de Senlis, et Mathieu De l’Aunay,
chanoine de Soissons. Tous les soirs, ils s’assemblaient chez Sanchez, travestis,
tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Sans doute, ils y rédigeaient
le plan de la conspiration, et peut- être, les statuts, dont ils voulaient
faire jurer l’observation à ceux qu’ils affilieraient à leur coupable société.
Mortier
avait entendu résonner des sacs d’argent, qu’on avait paru changer de place.
C’était une suite du désordre que j’avais causé dans le cabaret, car pendant
mes quinze jours d’observation, je n’entendis rien de semblable. Mais le
rapport de Mortier avait étendu mes idées ; rien ne m’échappait, et j’avais
remarqué que les conjurés portaient, en se retirant, quelque chose de volumineux
sous leur manteau. Il est vraisemblable que c’étaient les doublons du roi
d’Espagne, que Mendoza faisait tenir à Sanchez, et qu’il destinait à acheter
des partisans à son maître.
Je me
présentai devant le duc de Guise, avec mes conjectures, et ce que je savais
de positif. « Vous vous êtes très-mal conduit pendant quelques jours, me
dit-il ; mais vous avez réparé vos torts. Je vous prouverai ma satisfaction,
en vous accordant toute ma bienveillance. » Je m’inclinai profondément devant
monseigneur, et j’eus l’imprudence de lui dire que le plus faible levier
soulève quelquefois de pesans fardeaux.
Il
réfléchit un moment : « Cette comparaison-là n’est pas neuve, me dit-il ;
il me semble que je la connais. Au reste, vous l’avez heureusement appliquée.
Vous avez fait tout ce que j’attendais de vous, et tout ce que vous pouviez
faire. Le reste me regarde. Vous pouvez retourner à Arpajon. »
Je ne
restai pas une heure dans Paris. Colombe, rayonnante de joie, sauta avec
moi dans notre voiture, et nous rentrâmes dans nos modestes foyers, séjour
de la paix, de la modération et du bonheur.
LA SUITE
DANS UN PROCHAIN NUMÉRO DU BHASE.
Gustave
Vapereau
Notice
sur Pigault-Lebrun 21


21 Gustave Vapereau, « Pigault-Lebrun
», in ID., Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette,
1876, p. 1599.
PIGAULT-LEBRUN
(Charles-Antoine-Guillaume PICAULT DE L’ÉPINOY, dit), romancier français,
né le 8 avril 1753 à Calais, mort le 24 juillet 1835. D’une famille que la
tradition faisait remonter à Eustache de Saint-Pierre, et fils d’un magistrat
d’une grande sévérité, il fit ses études chez les oratoriens de Boulogne
et fut envoyé dans une maison de commerce à Londres ; mais ayant séduit la
fille de son patron, et celle-ci ayant péri dans le naufrage du navire sur
lequel les deux amants avaient pris la fuite, il n’osa pas retourner en Angleterre
et revint à Calais, où son père, au moyen d’une lettre de cachet, le fit
mettre en prison. Après deux ans de captivité, il entra dans la gendarmerie
d’élite de la petite maison du roi, et devint par sa franchise, sa gaieté,
son amour des plaisirs, le boute-en-train du régiment. La gendarmerie d’élite
ayant été supprimée, il reparut à Calais, lia une nouvelle intrigue amoureuse
et fut de nouveau emprisonné par lettre de cachet, à la demande de son père.
Cette seconde captivité dura deux ans, au bout desquels il s’évada et se
fit comédien en province. Acteur pitoyable, il parvint cependant à décourager
les sifflets du public par son esprit et sa bonne humeur. Ayant séduit à
Paris la fille d’un ouvrier, il l’emmena en Hollande, l’épousa et vécut à
Bruxelles et à Liége, continuant à jouer la comédie, donnant des leçons de
français et faisant représenter quelques pièces de sa composition, entre
autres, Il faut croire à sa femme, comédie en un acte, en vers (1786).
Cependant son père, à la nouvelle de son mariage, l’avait fait porter sur
les registres de l’état civil de Calais comme n’existant plus. Il présenta
une requête au parlement de Paris, qui par arrêt confirma sa mort. II modifia
alors son nom, et Pigault de l’Épinoy devint Pigault- Lebrun. La prise de
la Bastille le sauva d’une autre lettre de cachet. Plein d’indignation, il
composa sur ses dernières aventures une comédie en cinq actes, en prose,
intitulée Charles
et
Caroline, qu’il porta au Théâtre-Français en 1790. Malgré
les déclamations, malgré la faiblesse du plan et des caractères, de vifs
applaudissements accueillirent cette pièce où l’on sentait l’accent de la
vérité. L’auteur fut admis au Théâtre-Français en même temps comme acteur,
régisseur et metteur en scène ; mais bientôt il s’engagea dans les dragons,
devint sous-lieutenant et se battit à Valmy. Après une mission à Saumur,
en 1793, comme chef de remonte, il quitta le service mililaire. L’année suivante,
il publia l’un de ses romans qui eurent le plus de vogue, l’Enfant
du carnaval, et regagna par le succès l’affection de son
père, qui même dans son testament l’avantagea comme ainé ; mais Pigault-Lebrun
ne voulut rien avoir au delà de ce qui lui revenait par un partage égal entre
ses frères et sœurs. En 1806, il eut une place dans l’administration des
douanes et ne la quitta qu’en 1824. On lit, dans la première édition de la
Biographie universelle, qu’il accompagna le roi Jérôme
en Westphalie et qu’il joua un rôle important et peu honorable à la cour
de Cassel. On y donne même, à ce sujet, des détails très- circonstanciés
mais, dans la nouvelle édition de ce recueil, on a reconnu la fausseté complète
de ce récit.
La qualité
dominante de Pigault-Lebrun est la verve, une verve qui tenait au fond de
sa nature et n’était pas de jeunesse, puisqu’il avait près de quarante ans
lorsqu’il écrivit son premier roman. Il la pousse jusqu’aux folies de la
gaieté et ne cherche pas à la garantir des indécences alors à la mode. Le
lecteur, d’abord rebuté par des aventures multipliées qui vont jusqu’à l’extravagance
et à la grossièreté, est entrainé par le mouvement, la fécondité de l’imagination
et l’intarissable gaieté auxquels viennent se joindre quelquefois des observations
fines et des lueurs de sensibilité. Le style, qui laisse à désirer au point
de vue de la correction, a l’entrain et la
vivacité
propres au genre de l’auteur. Les romans de Pigault- Lebrun sont l’Enfant
du carnaval (1792) ; les Barons de Felsheim (1798) Angélique
et Jeanneton, Mon oncle Thomas, les Cent-vingt jours, la
Folie espagnole, tous les quatre en 1799 ; M. de Kinglin, Théodore,
Métusko, tous les trois en 1800 ; M. Botte (1802) ; Jérôme
(1804) ; la Famille Luceval (1806) ; l’Homme à projets (1807)
; une Macédoine (1811) ; Tableaux de société (1813) ; Adélaïde
de Méran (1815) ; le Garçon sans souci ; avec R. Perrin (1816);
M. de Roberval et l’Officieux (1818) ; l’Homme à projets
et Nous le sommes tous (1819) ; l’Observateur (1820) ;
le Beau-père et le gendre, avec son gendre Augier (1820) ; la Sainte-Ligue
(1829). Les plus renommés de ces romans sont, avec les deux premiers
de cette liste, la Folie espagnole et M. Botte. Pigault-Lebrun
donna au théâtre plusieurs pièces, dont le succès fut presque égal à celui
de ses romans : le Pessimiste, comédie en un acte, en vers (1789)
; l’Amour et la Raison, comédie en un acte, en prose (1791) ; les
Dragons et les Bénédictines, vaudeville (1794) ; les Dragons en cantonnement,
vaudeville (1794) ; les Rivaux d’eux-mêmes, comédie en un acte, en
prose (1798), souvent reprise au Théâtre-Français, etc. Ses romans et son
théâtre, ainsi que ses Mélanges littéraires et critiques (1816, 2
vol. in 8), ont été réunis sous le titre d’Œuvres complètes (Paris,
1822-1824. 20 vol. in-8). On a encore de lui le Citateur (1803, 2
vol. in-12), recueil de citations contre la religion chrétienne, empruntées
en grande partie à Voltaire et mêlées de plaisanteries de la façon de l’auteur
; ce livre, saisi et condamné sous la Restauration, a été plusieurs fois
réimprimé après 1830 ; Histoire de France abrégée, à l’usage des gens
du monde (1823-28, 8 vol. in-8), ouvrage fort médiocre, qui va seulement
jusqu’à la mort de Henri IV ; Contes à mon petit-fils (1831, 2 vol.
in-12). — Son frère, PIGAULT-MAUBAILLARCK, mort
vers 1830, a publié
deux
romans dans le genre d’Anne Radcliffe : la Famille Vicland (Paris,
1809, 4 vol. in-12) ; Isaure d’Aubigné (1812, 4 vol. in-12), etc.
— M. Émile Augier est, par sa mère, le petit-fils
de Pigault-Lebrun.
Cf.
Rabbe, etc. : Biographie univ. des contemporains ; — Encyclopédie des gens du monde ; — Querard : la France littéraire.
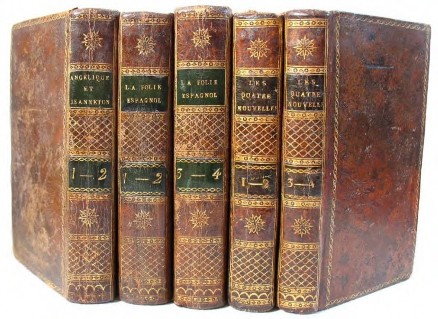
TABLE
DES MATIÈRES
|
Préface
|
(de
l’éditeur, 2014)
|
3-5
|
|
Avis
|
(de
l’auteur, 1829)
|
9
|
|
CHAP.
Ier.
|
Mon héros
entre en scène.
|
10-25
|
|
CHAP.
II.
|
Antoine
la Mouche continue son
|
|
|
voyage.
|
26-39
|
|
CHAP.
III.
|
Entrée
d’Antoine la Mouche à la
|
|
|
Rochelle.
|
40-67
|
|
CHAP.
IV.
|
Antoine
la Mouche et Colombe sortent
|
|
|
de
la Rochelle.
|
68-87
|
|
CHAP.
V.
|
Désespoir
et consolation de M. de la
|
|
|
Moucherie.
|
88-113
|
|
CHAP.
VI.
|
M.
de la Moucherie est ambassadeur
|
114-137
|
|
CHAP.
VII.
|
M.
de la Moucherie est introduit à la
|
|
|
cour.
|
138-161
|
|
CHAP.
VIII.
|
Le
capitaine de la Moucherie éprouve
|
|
|
un
grand malheur.
|
162-183
|
|
CHAP.
IX.
|
Histoire
d’André.
|
184-215
|
|
CHAP.
X.
|
La
Moucherie est admis dans l’intimité
|
|
|
des
plénipotentiaires du roi.
|
216-239
|
|
CHAP.
XI.
|
Catastrophes
sur catastrophes.
|
240-261
|
|
CHAP.
XII.
|
Antoine
de Mouchy retrouve Colombe
|
|
|
et
se désespère.
|
262-277
|
|
CHAP.
XIII.
|
Suite
de la rencontre de Colombe.
|
278-287
|
|
CHAP,
XIV.
|
Départ
pour Étampes. André fait une
|
|
|
rencontre
imprévue.
|
288-307
|
|
CHAP.
XV.
|
Arrivée
de notre héros à Étampes
|
308-331
|
|
CHAP.
XVI.
|
M.
de la Tour fait un voyage.
|
332-357
|
|
CHAP.
XVII
|
Second
voyage à Limoges.
|
358-383
|
|
CHAP.
XVIII.
|
Un
évêque ligueur démasqué.
|
384-407
|
|
CHAP.
XIX.
|
Faction
des Seize. Second Voyage à
|
|
|
Paris.
|
408-420
|
|
Annexe
|
Gustave
Vapereau : « Pigault-Lebrun ».
|
421-425
|
ISSN
2272-0685
Publication
du Corpus Étampois
Directeur
de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com
BHASE
n°9 (septembre 2014)
|
Préface
|
(de
l’éditeur, 2014)
|
3-5
|
|
Avis
|
(de
l’auteur, 1829)
|
9
|
|
CHAP.
Ier.
|
Mon héros
entre en scène.
|
10-25
|
|
CHAP.
II.
|
Antoine
la Mouche continue son voyage.
|
26-39
|
|
CHAP.
III.
|
Entrée
d’Antoine la Mouche à la
|
|
|
Rochelle.
|
40-67
|
|
CHAP.
IV.
|
Antoine
la Mouche et Colombe sortent de
|
|
|
la
Rochelle.
|
68-87
|
|
CHAP.
V.
|
Désespoir
et consolation de M. de la
|
|
|
Moucherie.
|
88-113
|
|
CHAP.
VI.
|
M.
de la Moucherie est ambassadeur
|
114-137
|
|
CHAP.
VII.
|
M.
de la Moucherie est introduit à la cour.
|
138-161
|
|
CHAP.
VIII.
|
Le
capitaine de la Moucherie éprouve un
|
|
|
grand
malheur.
|
162-183
|
|
CHAP.
IX.
|
Histoire
d’André.
|
184-215
|
|
CHAP.
X.
|
La
Moucherie est admis dans l’intimité
|
|
|
des
plénipotentiaires du roi.
|
216-239
|
|
CHAP.
XI.
|
Catastrophes
sur catastrophes.
|
240-261
|
|
CHAP.
XII.
|
Antoine
de Mouchy retrouve Colombe et
|
|
|
se
désespère.
|
262-277
|
|
CHAP.
XIII.
|
Suite
de la rencontre de Colombe.
|
278-287
|
|
CHAP,
XIV.
|
Départ
pour Étampes. André fait une
|
|
|
rencontre
imprévue.
|
288-307
|
|
CHAP.
XV.
|
Arrivée
de notre héros à Étampes
|
308-331
|
|
CHAP.
XVI.
|
M.
de la Tour fait un voyage.
|
332-357
|
|
CHAP.
XVII
|
Second
voyage à Limoges.
|
358-383
|
|
CHAP.
XVIII.
|
Un
évêque ligueur démasqué.
|
384-407
|
|
CHAP.
XIX.
|
Faction
des Seize. Second Voyage à
|
|
|
Paris.
|
408-420
|
|
Annexe
|
Gustave
Vapereau : « Pigault-Lebrun ».
|
421-425
|